|
|
Les questions classées par ordre chronologique
QUESTION 1533 - type de stockage et éthique
Posée par Maxime BEAULIEU, L'organisme que vous représentez (option) (VILLEMAU SUR VANNE), le 15/12/2013
type de stockage et éthique
Réponse du 31/01/2014,
Réponse de la CPDP
La CPDP constate que l'éthique est tréquemment ciitée dans le débat entre les modalités de stockage et d'entreposage. Pour nombre d'opposants au projet, persuadés que celui-ci n'est pas sûr dans le moyen et long terme, il serait contraire à l'éthique de faire peser un risque sur les générations suivantes. Pour les souteins du projet de stockage profond, au contraire, c'est l'entreposage qui comporte à terme les risques les plus préoccupants, et il serait contraire à l'éthique d'y recourir.
QUESTION 1530
Posée par Michel GUEROULT (MULHOUSE), le 30/01/2014
Question posée dans le cahier d'acteurs n°143 de M. Michel Guerault : Comment puis-je vous faire crédit en Bure STOCKAGE quand en STOCAMINE (avec un cahier des charges négocié et draconien de par la pression associative) la catastrophe sept. 2002 s'est produite et que nulle solution conforme et à sécurité n'est à ce jour trouvée?
Réponse du 06/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Vous avez raison, il faut tenir compte de l’histoire de Stocamine et des enseignements de l’incendie de septembre 2002 dans la conception de Cigéo, même si les 2 projets sont très différents. Le premier consistait à réutiliser une ancienne mine pour stocker des déchets chimiques tandis que le second est un projet spécifiquement conçu pour le stockage des déchets radioactifs et fait l’objet d’études depuis près de 30 ans.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Plus précisément, concernant le risque d’incendie de nombreuses mesures sont prises pour maîtriser ce risque :
Une première mesure consiste à limiter la quantité de produits combustibles ou inflammables dans les équipements du stockage. Par exemple, si Cigéo est réalisé, les câbles électriques seront ignifugés et les véhicules à moteur thermique seront interdits dans l’installation nucléaire souterraine de Cigéo. De plus, des dispositifs de détection incendie seront répartis dans les installations pour détecter rapidement et localiser tout départ de feu. Plusieurs systèmes d’extinction automatiques seront installés dans l’installation souterraine. Des systèmes embarqués d’extinction automatique (gaz, poudre...) seront placés sur les engins de transfert des colis de déchets et sur les engins de manutention en alvéole, afin d’éteindre tout départ de feu. Des systèmes d’extinction automatique seront également disposés dans certaines zones de l’installation souterraine telles que les locaux électriques et les zones de soutien logistique. Ces dispositifs seront mis en place en complément de moyens de lutte contre l’incendie plus traditionnels de types extincteurs, points de raccordement à un réseau d’alimentation en agent extincteur (eau, mousse…) etc.
Malgré toutes ces dispositions, une situation d'incendie est quand même considérée par prudence. Dans les installations de surface, les mêmes principes seront appliqués que dans les installations nucléaires de base : en cas d’incendie, les locaux concernés seraient isolés du reste de l’installation, les moyens d’extinction et d’intervention seraient déclenchés et le personnel serait évacué. Dans l’installation souterraine, compte tenu de sa géométrie spécifique, ces dispositions sont adaptées dès la conception. Des systèmes de compartimentage et de ventilation sont prévus pour limiter la propagation du feu. Des équipements d’intervention seront prépositionnés dans l’installation souterraine en permanence. L'architecture souterraine retenue pour le stockage permettra aux secours d'intervenir dans des galeries à l'abri des fumées et facilite l'évacuation du personnel.
Outre la mise à l’abri du personnel, la maîtrise du risque incendie vise aussi à protéger les colis contenant les substances radioactives des effets de l’incendie afin de maintenir le confinement de ces substances. Pour cela, les colis seront disposés dans des équipements qualifiés pour résister au feu (cellules résistantes au feu munies de portes coupe-feu, hotte de protection pour le transfert dans l’installation souterraine). Les conteneurs de stockage sont également conçus pour assurer une protection contre l’incendie. Ces dispositions permettent d’exclure tout effet domino entre les colis stockés.
La définition de l’ensemble de ces dispositifs associe les services compétents des sapeurs-pompiers et fait l’objet de contrôle par l’Autorité de sûreté nucléaire. Cigéo ne sera jamais autorisé si l’Andra ne démontre pas qu’elle maîtrise tous les risques, dont le risque d’incendie.
QUESTION 1529
Posée par Michel GUEROULT (MULHOUSE), le 30/01/2014
Questions posées dans le cahier d'acteurs n°143 de M. Michel Gueroult : Nombre estimé de colis entreposés? En quoi vous engagez-vous à ce que d'aucune manière et définitivement nul déchet stocké ne puisse devenir produit? Problématique graphite : solution exutoire en quelle proportion et condition de stockage? Comment imposer - inconditionnellement à plus haut degré juridique - et stockage et traitement par filière contingentée et isolée selon chaque élément? Gravats comme bouche-vides à volis et alvéoles ou à norme arbitraire (sic, selon l'ASN) en 1 Bq/g? Et métaux (fonte recyclé ou...) comme matériau de conteneurs? Quel appareillage technique de mesure à fixer (en termes de contrôle de radiation) à clarté transparence univoque?
Réponse du 10/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Nombre estimé de colis entreposés?
L’inventaire détaillé des colis de déchets (nombre, volume) est donné dans le document Les déchets pris en compte dans les études de conception de Cigéo ../docs/rapport-etude/dechets-pris-en-compte-dans-etudes-conception-cigeo.pdf
En quoi vous engagez-vous à ce que d'aucune manière et définitivement nul déchet stocké ne puisse devenir produit?
Conformément à la loi du 28 juin 2006, les déchets radioactifs destinés à Cigéo sont des déchets ultimes, c’est-à-dire qui « ne peuvent plus être traités dans les conditions économiques du moment, notamment par extraction de leur part valorisable ou par réduction de leur caractère polluant ou dangereux. »
Problématique graphite : solution exutoire en quelle proportion et condition de stockage?
L’inventaire des déchets de graphite et les scénarios de gestion à l’étude pour ces déchets sont donnés au chapitre 4.2.1 du document Les déchets pris en compte dans les études de conception de Cigéo.
Comment imposer - inconditionnellement à plus haut degré juridique - et stockage et traitement par filière contingentée et isolée selon chaque élément? Gravats comme bouche-vides à volis et alvéoles ou à norme arbitraire (sic, selon l'ASN) en 1 Bq/g? Et métaux (fonte recyclé ou...) comme matériau de conteneurs? Quel appareillage technique de mesure à fixer (en termes de contrôle de radiation) à clarté transparence univoque?
Ces questions ne sont pas compréhensibles.
QUESTION 1528
Posée par Michel GUEROULT (MULHOUSE), le 30/01/2014
Questions posées dans le cahier d'acteurs n°143 de M. Michel Gueroult : Pourriez-vous mettre et ordre sérieux à ce fatras et clarté à situation que nul ne gère (en atteste, les demandes formelles de l'ASN)? Ne vous est-il permis, possible d'nevisager l'abandon pur et simple de ceprojet - à l'instar de Yucca Mountain States - si non, pourquoi? Comptant sur votre comprhénesion, et à prbité - sagesse [à Constitution inscrire le principe de précaution n'est-il que coup du Président Chirac à conjoncture politicienne OU sécurité-sûreté du vivant in concreto?? vous avez cartes en main force de paix à réponses détaillées et convaincantes fournir], veuillez, Messeirus, agréer mes salutations les meilleures que tout vivant, citoyen ou mollusque, advienne en démocratie.
Réponse du 10/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de ces déchets. Grâce à la réversibilité, les générations suivantes garderont la possibilité de faire évoluer cette solution si elles le souhaitent.
QUESTION 1527
Posée par Michel GUEROULT (MULHOUSE), le 30/01/2014
Questions posées dans le cahier d'acteurs n°143 de M. Michel Gueroult : En quoi participez-vous - sciemment ou non - à une activité purement sécuritaire? Participez-vous à une politique de sûreté? Si oui, en quoi? De quoi vous portez-vous garant à charte & cadre déontologique négociés en citoyen (hormis droit de réverse, secret défense ou professionnel, ou source secrète)?
Réponse du 11/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La loi sur la transparence et la sécurité nucléaire du 13 juin 2006 précise que : « La sécurité nucléaire comprend la sûreté nucléaire, la radioprotection, la prévention et la lutte contre les actes de malveillance, ainsi que les actions de sécurité civile en cas d'accident. La sûreté nucléaire est l'ensemble des dispositions techniques et des mesures d'organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, à l'arrêt et au démantèlement des installations nucléaires de base, ainsi qu'au transport des substances radioactives, prises en vue de prévenir les accidents ou d'en limiter les effets. La radioprotection est la protection contre les rayonnements ionisants, c'est-à-dire l'ensemble des règles, des procédures et des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes, directement ou indirectement, y compris par les atteintes portées à l'environnement. »
Pour que la création de Cigéo puisse être autorisée, l’Andra doit montrer que le projet ne compromet pas la sécurité, la santé et la salubrité publiques ni la protection de la nature et de l'environnement.
QUESTION 1526
Posée par Michel GUEROULT (MULHOUSE), le 30/01/2014
Questions posées dans le cahier d'acteurs n°143 de M. Michel Gueroult :
Monsieur le directeur, Monsieur le président,
D'emblée, je m'étonne : initialement - Loi du 28 juin 2006 n°2006-739- le sigle CIGEO ne comprend la notion de "stockage", rajoutée en 2011, M. Renard ou d'autres élus s'en émouvant même. Ce rajout est-il : ruse de l'histoire ou oubli-manquement-négligence? avancer masqué de Descartes? irréversibilité nihilisme sans retour autre que celui du fascisme? pure et simple force capitale progrès-profit trou dettes?
Réponse du 10/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question des déchets radioactifs a été abordée dès les années 1950 et les débuts de la production d’électricité d’origine nucléaire. C’est au cours des années 1960 et 1970 que le stockage a commencé à être considéré comme une possibilité de gestion au sein de la communauté scientifique internationale et notamment le stockage profond pour les déchets de haute activité et à vie longue. Le Parlement s’est saisi de la question des déchets radioactifs et a voté en 1991 une première loi qui a défini un programme de recherche pour les déchets de haute activité et à vie longue. Après 15 ans de recherche, leur évaluation et un débat public, une seconde loi a été votée en 2006. Elle a retenu le stockage profond comme solution de gestion à long terme de ces déchets pour protéger l’homme et l’environnement sur le très long terme et afin de limiter la charge de leur gestion sur les générations futures.
Le sigle Cigéo, choisi en 2011, signifie Centre industriel de stockage géologique. La notion de stockage n’est donc pas oubliée.
QUESTION 1525
Posée par FEDERATION SEPANSO AQUITAINE (BORDEAUX), le 30/01/2014
Question posée dans le cahier d'acteurs n°151 de la Fédération Sepanso Aquitaine :
Nous regrettons que la possibilité d'abandon du projet ne soit pas étudiée. Il aurait été intéressant de lire ce que l'Andra imaginerait si le stockage profond n'était pas autorisé. N'est-ce pas la preuve que les dés sont pipés et que le débat public n'est qu'une formalité administrative?
Réponse du 03/02/2014,
l'ANDRA, etablissement public de l'Etat, est chargé par la Loi de juin 2006 de préparer un projet de stockage profond reversible; c'est donc ce qu'elle présente au débat public; cependant, une partie du public fomule des objections qui effectivement devraient conduire, selon elle, à un autre projet de gestion des déchets - l'entreposage -. Elle l'a fait dans le débat public, ce dont le compte rendu, publié le 12 février, ne manquera pas de faire état. Ainsi des alternatives, puisque c'est le fond de votre question, ont elle été traitées dans le cadre du débat public.
QUESTION 1524
Posée par FEDERATION SEPANSO AQUITAINE (BORDEAUX), le 30/01/2014
Question posée dans le cahier d'acteurs n°151 de la Fédération Sepanso Aquitaine : La réversibilité est prévue pour 100 ans alors qu'on parle d'allonger la durée de vie des centrales nucléaires à cinquante, voire soixante ans. Le rapport ne semble-t-il pas dérisoire?
Réponse du 13/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le projet Cigéo est conçu pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets français les plus radioactifs et ne pas reporter leur charge sur les générations futures. Le Parlement a également demandé que ce stockage, prévu pour être définitif, soit réversible pendant au moins 100 ans pour laisser des choix aux générations suivantes et notamment la possibilité de récupérer des déchets stockés. Les conditions de cette réversibilité seront définies dans une future loi. L’Andra a présenté lors du débat public ses propositions relatives à la réversibilité de Cigéo (../docs/rapport-etude/fiche-reversibilite-cigeo.pdf).
QUESTION 1523
Posée par FEDERATION SEPANSO AQUITAINE (BORDEAUX), le 30/01/2014
Questions posées dans le cahier d'acteurs n°151 de la Fédération Sepanso Aquitaine : Nous aimerions connaître la somme totale dépensée à ce jour pour l'ensemble du projet : études, versement pour tenter d'obtenir l'acceptabilité du projet...
Réponse du 11/02/2014,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Depuis le début des années 1990, 1,5 milliards d’euros ont été investis pour la recherche sur le stockage profond, menée par l'Andra et financée par les producteurs de déchets radioactifs. L’accompagnement économique du projet est décidé par le Parlement. L’article L. 542-11 du code de l'environnement définit les missions des groupements d’intérêt public (GIP) constitués en Meuse et en Haute-Marne. Ils ont pour missions :
1° De gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation du laboratoire ou du centre de stockage ;
2° De mener, dans les limites de son département, des actions d'aménagement du territoire et de développement économique, particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils généraux concernés ;
3° De soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques, notamment dans les domaines étudiés au sein du laboratoire souterrain et dans ceux des nouvelles technologies de l'énergie.
Depuis sa création en 2000 jusqu’à fin 2012, plus de 2.500 projets ont été soutenus par les fonds d’accompagnement du GIP Haute-Marne avec plus de 225 millions d’euros accordés (sur la période 2007-2012, le GIP Haute-Marne a accordé 176 millions d’euros de financements pour un montant d’investissement cumulé de 775 millions d’euros). Sur la période 2007 et jusqu’à fin de l’année 2012 le GIP OBJECTIF MEUSE a attribué plus de 156 M€ d’aides (subventions et dotations) dont 137 M€ de subventions qui ont permis de soutenir 1 438 projets meusiens, représentant globalement 733 M€ d’investissement sur notre territoire. De 2000 à 2006 le GIP OBJECTIF MEUSE a attribué plus de 57 M€ de subventions qui ont permis de soutenir 1451 projets. Depuis sa création, le montant cumulé attribué depuis la création du GIP OBJECTIF MEUSE est donc de 213 M€ pour 2 889 projets.
QUESTION 1522
Posée par FEDERATION SEPANSO AQUITAINE (BORDEAUX), le 30/01/2014
Questions posées dans le cahier d'acteurs n°151 de la Fédération Sepanso Aquitaine : Que deviendra le projet si les producteurs de déchets radioactifs ne peuvent pas payer? Le principe de pollueur-payeur sera-t-il vraiment appliqué aux producteurs de déchets radioactifs? Si oui quelle sera la répercussion sur le prix du kilowatt nucléaire pour le citoyen consommateur?
Réponse du 11/02/2014,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Le projet Cigéo est financé par les producteurs de déchets radioactifs en application du principe pollueur-payeur. L’article L.542-1 du code de l’environnement indique ainsi que « Les producteurs de combustibles usés et de déchets radioactifs sont responsables de ces substances, sans préjudice de la responsabilité de leurs détenteurs en tant que responsables d'activités nucléaires. » Il appartient donc bien aux producteurs des déchets radioactifs de financer intégralement la gestion à long terme de leurs déchets et donc leur stockage.
Si un producteur de déchets est défaillant et ne peut plus payer, c’est l’Etat qui est responsable en dernier ressort de la gestion des déchets radioactifs et du combustible usé produit sur son territoire en application de l’article 4 de la directive européenne du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre des déchets radioactifs et du combustible usé.
L’article 20 de la loi du 28 juin 2006 stipule que les exploitants d’installations nucléaires évaluent, de manière prudente, les charges de démantèlement de leurs installations et les charges de gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs. Ils constituent les provisions afférentes à ces charges et affectent à titre exclusif à la couverture de ces provisions les actifs nécessaires. Si l’autorité administrative relève une insuffisance ou une inadéquation dans l’évaluation des charges, le calcul des provisions ou le montant, la composition ou la gestion des actifs affectés à ces provisions, elle peut, après avoir recueilli les observations de l’exploitant, prescrire les mesures nécessaires à la régularisation de sa situation en fixant les délais dans lesquels celui-ci doit les mettre en œuvre.
QUESTION 1521
Posée par FEDERATION SEPANSO AQUITAINE (BORDEAUX), le 30/01/2014
Question posée dans le cahier d'acteurs n°151 de la Fédération Sepanso Aquitaine : Les porteurs du projet sont sûrs d'eux, mais les riverains plus ou moins éloignés sont-ils en sécurité?
Réponse du 11/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Pour que le projet puisse être autorisé, l’Andra doit démontrer à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) qu’elle maîtrise les risques liés à l’installation, que ce soit pendant son exploitation ou après sa fermeture. Ainsi, conformément au principe de défense en profondeur, tous les dangers potentiels qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation sont identifiés en amont de la conception. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels (dont ceux liés à une erreur humaines ou à des défaillances techniques) et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels montre que leurs conséquences resteraient limitées, et nettement en deçà des normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire.
Comme toutes les installations nucléaires, Cigéo fera l’objet régulièrement de réexamens complets de sûreté, en accord avec les exigences de l’ASN qui impose un réexamen périodique de sûreté au moins tous les 10 ans. Tout au long de l’exploitation du stockage, l’ASN pourra imposer des prescriptions supplémentaires voire mettre à l’arrêt l’installation si elle considère qu’un risque n’est pas maîtrisé correctement, comme c’est le cas pour toute installation nucléaire placée sous son contrôle.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’ASN, qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 1520
Posée par FEDERATION SEPANSO AQUITAINE (BORDEAUX), le 30/01/2014
Question posée dans le cahier d'acteurs n°151 de la Fédération Sepanso Aquitaine : Pourquoi la Meuse / Haute-Marne? La réponse n'est pas fournie dans le document présenté dans le cadre du débat public.
Réponse du 06/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Cette question fait l’objet de l’intégralité du chapitre 3 du document du maître d’ouvrage support au débat public : Pourquoi la Meuse/Haute-Marne pour implanter Cigéo ? ../docs/dmo/chapitres/DMO-Andra-chapitre-3.pdf
Suite au vote de la loi de 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, des recherches ont été menées en France pour implanter un laboratoire souterrain. Plusieurs sites se sont portés candidats et ont été étudiés, dont les départements de Meuse et de Haute-Marne. En 1999, après l’évaluation scientifique du site, la consultation des collectivités locales et une enquête publique, le Gouvernement a autorisé l’Andra à construire un laboratoire souterrain à la limite entre les deux départements de Meuse et de Haute-Marne pour étudier la couche d’argile du Callovo-Oxfordien.
En s’appuyant sur l’ensemble des recherches menées sur le site depuis 1994, l’Andra a montré que le site présente des caractéristiques favorables pour assurer la sûreté à long terme du stockage. La Commission nationale d’évaluation mise en place par le Parlement pour évaluer sur le plan scientifique les travaux de l’Andra souligne ainsi dans son rapport 2012 : « le site géologique de Meuse/Haute-Marne a été retenu pour des études poussées, parce qu’une couche d’argile de plus de 130 m d’épaisseur et à 500 m de profondeur, a révélé d’excellentes qualités de confinement : stabilité depuis 100 millions d’années au moins, circulation de l’eau très lente, capacité de rétention élevée des éléments ».
QUESTION 1519
Posée par FEDERATION SEPANSO AQUITAINE (BORDEAUX), le 30/01/2014
Questions posées dans le cahier d'acteurs n°151 de la Fédération Sepanso Aquitaine : Pourquoi un stockage profond? N'est-ce pas avant tout pour éviter un risque d'attentat sur un stockage?
Réponse du 07/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Notre génération a la responsabilité de mettre en place des solutions de gestion sûres pour les déchets radioactifs produits depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Le but étant de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Si Cigéo est autorisé, il donnera ainsi la possibilité aux générations suivantes de mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs. La réversibilité leur permettra également de faire évoluer cette solution si elles le souhaitent.
Pour que le projet puisse être autorisé, l’Andra doit démontrer à l’Autorité de sûreté nucléaire qu’elle maîtrise les risques liés à l’installation, que ce soit pendant son exploitation ou après sa fermeture. Ainsi, conformément au principe de défense en profondeur, tous les dangers potentiels qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation sont identifiés en amont de la conception. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels montre que leurs conséquences resteraient limitées, et nettement en deçà des normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire.
Du fait de son implantation à 500 mètres de profondeur, le stockage est une installation peu vulnérable. En particulier, après sa fermeture, le stockage sera complètement inaccessible à toute agression depuis la surface. Les installations de surface, nécessaires pendant la phase d'exploitation pour le contrôle et la préparation des colis de stockage, sont conçues pour protéger les opérateurs et les riverains des différents risques qui peuvent survenir. En particulier, le risque de malveillance est pris en compte par l'Andra. Des dispositions appropriées (contrôle des accès, gardiennage, résistance des bâtiments…) sont prévues pour assurer la protection des installations. Comme pour toute installation nucléaire, ces dispositions sont contrôlées par le Haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère en charge de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Pour être autorisées, les installations de Cigéo - en surface et en souterrain - devront répondre aux exigences des autorités de contrôle, qui ont été renforcées suite aux attentats de 2001.
QUESTION 1518
Posée par Geoffroy MARX (VERDUN), le 30/01/2014
Questions posées dans le cahier d'acteurs n°139 de M. Geoffroy Marx : Il en va de l'économie comme de la politique : les changements sont fréquents et imprévisibles. Grande dépression de 1929 à 1937, chocs pétroliers de 1973 et 1979, crise financière de 2007 à 2010. Certains pays frôlent la faillite (le Mexique dans les années 90, l'Argentine et la Russie en 1998, la Grèce ou le Portugal aujourd'hui). Ces crises influent sur les priorités de financement. Aujourd'hui, pour équilibrer les ocmptes, on remet en cause le financement des énergies renouvelables, de certaines aides sociales ou d'avantages fiscaux aux entreprises et on abandonne des grands travaux ; demain ça sera le projet Cigéo qui sera considéré comme un gouffre financier. Cette hypothèse d'une cessation de paiement est-elle envisagée dans les études de l'Andra? Dans quelles mesures le budget prévisionnel du projet Cigéo prend-il en compte les incidents et les retards qui ne manqueront pas de se produire? Quelles sommes seront provisionnées au démarrage du projet aifn d'en garantir non seulemet la viabilité économique et financière mais également la sureté et la sécurité? Le coût d'une catastrophe majeure a-t-il d'ors et déjà été estimé? Est-il couvert par une assurance?
Réponse du 10/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne directement rattaché à l’Etat, l’Andra, et non à une entreprise privée. Si Cigéo est autorisé, il est effectivement important que l’Andra dispose des ressources nécessaires pour exploiter en toute sécurité le site pendant toute sa durée.
Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat. Les provisions sont constituées dès aujourd’hui pour couvrir les charges à financer par les producteurs, et sont sanctuarisées dans des placements qui ne peuvent être sujets à des coupes budgétaires. Pour un nouveau réacteur nucléaire, sur l’ensemble de sa durée de fonctionnement, le coût du stockage des déchets radioactifs est de l’ordre de 1 à 2 % du coût total de la production d’électricité. L’évaluation des coûts réalisée par l’Andra comprend le chiffrage des risques et des aléas.
Le cadre législatif et réglementaire qui s’applique à l’Andra, futur exploitant du stockage s’il est autorisé, est très clair et donne la priorité à la sûreté. Outre les limites strictes imposées par les textes, ceux-ci imposent également aux exploitants d’abaisser autant que possible le niveau d’exposition des populations au-delà des limites fixées par la réglementation. L’Andra, comme tous les exploitants, est soumise à ces exigences réglementaires, qui sont de plus complètement cohérentes avec sa mission, qui est de mettre en sécurité les déchets radioactifs, afin de protéger l’homme et l’environnement sur le long terme.
En ce qui concerne le coût d’un éventuel accident, les risques nucléaires sont couverts par un régime spécifique de responsabilité civile nucléaire régie en France par les conventions de Paris et de Bruxelles. Celles-ci définissent notamment les dommages rattachés à ces risques, l'indemnisation des victimes et les niveaux de garanties requis. Plusieurs tranches de garanties sont prévues : une première à la charge de l'exploitant (qui doit faire l'objet d'une garantie financière, un contrat d'assurance par exemple), une seconde à la charge de l'Etat et enfin une dernière à la charge d'un fonds international.
En France, l’IRSN conduit des travaux sur le coût économique des accidents nucléaires entraînant des rejets radioactifs dans l’environnement. Selon les évaluations réalisées par l’IRSN, un accident grave représentatif engendrerait un coût global de quelque 120 milliards d'euros. Un accident majeur pourrait coûter plus de 400 milliards d’euros. http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20130219-Travaux-recherche-IRSN-cout-economique-accidents-nucleaires.aspx
Cependant, ce type d’accident ne peut s’appliquer à Cigéo : Cigéo n’est pas une centrale nucléaire mais un centre de stockage situé à 500 mètres de profondeur, qui sera peu vulnérable aux activités humaines comme aux catastrophes naturelles. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade des études, de l’impact des scénarios accidentels montre que leurs conséquences resteraient limitées, et nettement en-deçà du seuil réglementaire qui imposerait des mesures de protection des populations (mise à l’abri, évacuation).
QUESTION 1517
Posée par Irma NIJENHUIS-SPRUIT (LUBERSAC), le 28/01/2014
Questions posées dans le cahier d'acteurs n°140 de Mme Irma Nijenhuis-Spruit : La réversibilité de leurs superbes "colis" a été exigée? Alors, on aura la réversibilité. Mais nous n'avons aucune garantie que la "récupérabilité" sera possible. Même les robots tombent en panne, attaqués par les rayonnements. Cela a été vérifié à Tchernobyl et à Fukushima. Dire que l'enfouissement serait réversible n'est que du bluff! Sauf... si il y a un jour une explosion, un incendie, ou la perte de confirnement avec une arrivée d'eau, et qu'alors le contenu des colis remontera à la surface, emporté par l'eau, bien sûr! La Meuse, la Haute-Marne et tout le bassin parisien seraient alors perdus. Et les vignes de la Champagne? Et les Eaux de Vittel et Contrexéville? Et le tourisme vert?
Réponse du 06/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestions sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
Concernant la récupérabilité des colis :
Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de ces déchets. Grâce à la réversibilité, les générations suivantes garderont la possibilité de faire évoluer cette solution si elles le souhaitent. L’Andra place cette demande de la société au cœur du projet. Elle a ainsi fait des propositions concrètes pour pouvoir récupérer les colis de déchets si besoin et laisser des choix possibles aux générations suivantes (../docs/rapport-etude/fiche-reversibilite-cigeo.pdf).
L’Andra prévoit dès la conception de Cigéo des dispositifs techniques destinés à faciliter le retrait éventuel de colis de déchets stockés. Les déchets seront stockés dans des conteneurs indéformables, en béton ou en acier. Les tunnels pour stocker ces conteneurs (alvéoles de stockage) seront revêtus d’une paroi en béton ou en acier pour éviter les déformations, avec des espaces ménagés entre les conteneurs et les parois pour permettre leur retrait. Les robots utilisés pour placer les conteneurs dans les alvéoles pourront également les retirer. Des essais à l’échelle 1 ont d’ores et déjà été réalisés avec des prototypes.
Les moyens de manutention et d’intervention qui seront mis en œuvre sur Cigéo se fondent sur le retour d’expérience important des exploitations nucléaires actuelles. En effet, les engins de manutention manipulant les déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité ainsi que les moyens de dépannage et d’intervention associés sont mis en œuvre dans les installations des producteurs de déchets depuis des décennies. Par ailleurs, la France a développé des compétences dans le domaine des robots d’intervention en milieux irradiants. Les sociétés Areva, CEA et EDF, par exemple, développent en commun des robots spécifiques pour les besoins d’intervention dans leurs installations nucléaires.
QUESTION 1516
Posée par Irma NIJENHUIS-SPRUIT (LUBERSAC), le 28/01/2014
Questions posées dans le cahier d'acteurs n°140 de Mme Irma Nijenhuis-Spruit :
Ce projet était nécessaire de par la "Loi Bataille", qui prévoyait deux "laboratoires" : un dans l'argile (le laboratoire de Bure) et un dans le granite. Choisir, par défaut, Bure pour faire la grande poubelle nucléaire de la France était prématuré. Pourquoi les nucléocrates de la France sont-ils tellement pressés?
Cigéo est une construction maligne. Selon la règle du "pollueur payeur", les coûts sont à la charge de EDF, AREVA, CEA et l'industrie nucléaire militaire, qui produisent ces déchets. Le gouvernement à créé l'Andra qui devrait disposer d'un budget au minimum de 35 milliards d'euros. Cette facture serait payée par nous, citoyens, et par les générations à venir, à travers les impôts et les factures d'électricité? Mais, non!
Réponse du 10/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Concernant le choix du site
Le choix du site de Meuse/Haute-Marne pour étudier l’implantation d’un stockage profond n’est pas un choix par défaut. En s’appuyant sur l’ensemble des recherches menées sur le site depuis 1994, l’Andra a montré que ce site présente des caractéristiques favorables pour assurer la sûreté à long terme d’un éventuel stockage. La Commission nationale d’évaluation mise en place par le Parlement pour évaluer sur le plan scientifique les travaux de l’Andra souligne ainsi dans son rapport 2012 : « le site géologique de Meuse/Haute-Marne a été retenu pour des études poussées, parce qu’une couche d’argile de plus de 130 m d’épaisseur et à 500 m de profondeur, a révélé d’excellentes qualités de confinement : stabilité depuis 100 millions d’années au moins, circulation de l’eau très lente, capacité de rétention élevée des éléments. »
La loi de recherche du 30 décembre 1991 prévoyait la réalisation de laboratoires souterrains pour l’étude des possibilités de stockage dans les formations géologiques profondes. Suite à une mission de concertation lancée fin 1992 et à des premières analyses géologiques, quatre sites candidats avaient été identifiés dans les départements du Gard, de la Meuse, de la Haute-Marne (couches argileuses) et de la Vienne (couche granitique). L’Andra a été autorisée par le Gouvernement à mener des investigations géologiques sur ces sites dans le but de savoir s’il était intéressant d’y construire un laboratoire souterrain pour continuer les études. En 1996, l’Andra a déposé trois dossiers de demandes d’installation de laboratoires souterrains. Les résultats des investigations géologiques ont montré que la géologie du site en Meuse/Haute-Marne (les deux sites ont été fusionnés en une seule zone en raison de la continuité de la couche argileuse étudiée) était particulièrement favorable. Concernant le Gard, le site présentait une plus grande complexité scientifique liée à son évolution géodynamique à long terme et faisait l’objet d’oppositions locales. L’instruction du dossier relatif au site étudié dans la Vienne n’a pas abouti à un consensus scientifique sur la qualité hydrogéologique du massif granitique.
En 1998, le Gouvernement a décidé la construction d’un laboratoire de recherche souterrain en Meuse/Haute-Marne et la poursuite des études pour trouver un autre site dans une roche granitique. La recherche d’un site dans une roche granitique a finalement été abandonnée, la mission de concertation n’ayant pas abouti. L’Andra a toutefois poursuivi ses recherches sur le milieu granitique jusqu’en 2005, en s’appuyant notamment sur les connaissances déjà disponibles sur les massifs granitiques français et sur les travaux menés dans les laboratoires souterrains d’autres pays (Suède, Canada, Suisse). Ces recherches ont conduit l’Andra à conclure en 2005 qu’un stockage dans les massifs granitiques ne présenterait pas de caractère rédhibitoire mais que la principale incertitude porte sur l’existence de sites en France avec un granite ne présentant pas une trop forte densité de fractures.
Concernant le coût du projet
Les déchets radioactifs ont été produits par l’usage que les générations passée et présente font de l’énergie nucléaire. Quelle que soit notre opinion sur cette source d’énergie, il nous appartient de ne pas reporter le problème des déchets existants sur les générations futures.
Le Parlement a créé l’Andra en 1991 pour assurer la gestion à long terme des déchets radioactifs. Depuis plus de vingt ans, l’Andra fonde son travail sur cette seule mission. Agence publique, indépendante des producteurs de déchets, elle porte un projet qui n’est pas dicté par la rentabilité financière mais par le seul souci de protéger de la manière la plus robuste possible l’environnement et les générations futures.
Pour un nouveau réacteur nucléaire, sur l’ensemble de sa durée de fonctionnement, le coût du stockage des déchets radioactifs est de l’ordre de 1 à 2 % du coût total de la production d’électricité. Au stade des études de faisabilité scientifique et technique, le chiffrage arrêté par l’Etat en 2005 était d’environ 15 milliards d’euros, répartis sur une centaine d’années (coût brut non actualisé). En 2009, l’Andra a réalisé une estimation préliminaire d’environ 35 milliards d’euros, répartis également sur une centaine d’années (coût brut incluant une mise à jour de l’inventaire des déchets et des conditions économiques), avant le lancement des études de conception industrielle. L’Etat a demandé à l’Andra de finaliser son nouveau chiffrage en 2014, après prise en compte des suites du débat public et des études d’optimisation en cours. Sur cette base, le ministre chargé de l’énergie pourra arrêter une nouvelle estimation et la rendre publique après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et observations des producteurs de déchets, conformément au processus défini par la loi du 28 juin 2006.
A titre de comparaison, le coût de la gestion des autres déchets en France (déchets ménagers, entreprises, nettoyage des rues) est de l’ordre de 15 milliards d’euros par an.
QUESTION 1515
Posée par Thierry DE LAROCHELAMBERT (BELFORT), le 28/01/2014
Questions posées dans le cahier d'acteurs n°118 de M. Thierry De Larochelambert :
L'évaluation du coût final réel du projet reste très incertaine, particulièrement dans le contexte de crise économique actuel : de 14,1 G€ en 2003, le projet a été réévalué à 35 G€ par la Cour des Comptes en 2011. Quel sera le nouveau chiffrage en 2013-2014?
Les coûts d'assurance ne sont pas inclus dans le projet Cigéo : aucune assurance ne couvre les risques nucléaires dans aucun pays. Le budget national assumera-t-il les coûts des accidents ou catastrophes susceptibles de survenir dans l'installation?
Des évaluations indépendantes des coûts de contamination ne devraient-elles pas être menées?
Réponse du 06/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Pour un nouveau réacteur nucléaire, sur l’ensemble de sa durée de fonctionnement, le coût du stockage des déchets radioactifs est de l’ordre de 1 à 2 % du coût total de la production d’électricité. Au stade des études de faisabilité scientifique et technique, le chiffrage arrêté par l’Etat en 2005 était d’environ 15 milliards d’euros, répartis sur une centaine d’années (coût brut non actualisé). En 2009, l’Andra a réalisé une estimation préliminaire d’environ 35 milliards d’euros, répartis également sur une centaine d’années (coût brut incluant une mise à jour de l’inventaire des déchets et des conditions économiques), avant le lancement des études de conception industrielle. A titre de comparaison, le coût de la gestion des autres déchets en France (déchets ménagers, entreprises, nettoyage des rues) est de l’ordre de 15 milliards d’euros par an.
L’Andra a lancé en 2012 les études de conception industrielle de Cigéo avec l’appui de maîtres d’œuvre spécialisés qui apportent leur retour d’expérience sur d’autres projets industriels (construction de tunnels, d’ateliers nucléaires, d’usines…). L’Etat a demandé à l’Andra de finaliser son nouveau chiffrage d’ici l’été 2014, après prise en compte des suites du débat public et des études d’optimisation en cours. Sur cette base, le ministre chargé de l’énergie pourra arrêter une nouvelle estimation et la rendre publique après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et observations des producteurs de déchets, conformément au processus défini par la loi du 28 juin 2006.
Les risques nucléaires sont couverts par un régime spécifique de responsabilité civile nucléaire régie en France par les conventions de Paris et de Bruxelles. Celles-ci définissent notamment les dommages rattachés à ces risques, l'indemnisation des victimes et les niveaux de garanties requis. Plusieurs tranches de garanties sont prévues : une première à la charge de l'exploitant (qui doit faire l'objet d'une garantie financière, un contrat d'assurance par exemple), une seconde à la charge de l'Etat et enfin une dernière à la charge d'un fonds international.
En France, l’IRSN conduit des travaux sur le coût économique des accidents nucléaires entraînant des rejets radioactifs dans l’environnement. Selon les évaluations réalisées par l’IRSN, un accident grave représentatif engendrerait un coût global de quelque 120 milliards d'euros. Un accident majeur pourrait coûter plus de 400 milliards d’euros. http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20130219-Travaux-recherche-IRSN-cout-economique-accidents-nucleaires.aspx
Cependant, ce type d’accident ne peut s’appliquer à Cigéo : Cigéo n’est pas une centrale nucléaire mais un centre de stockage situé à 500 mètres de profondeur, qui sera peu vulnérable aux activités humaines comme aux catastrophes naturelles. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade des études, de l’impact des scénarios accidentels montre que leurs conséquences resteraient limitées, et nettement en-deçà du seuil réglementaire qui imposerait des mesures de protection des populations (mise à l’abri, évacuation).
QUESTION 1514
Posée par Thierry DE LAROCHELAMBERT (BELFORT), le 28/01/2014
Question posée dans le cahier d'acteurs n°118 de M. Thierry De Larochelambert : Les incertitudes sismiques locales sont importantes (failles actives, séismes 5.9 du 22 février 2003 à Saint-Dié). Les conséquences d'un déplacement massif de couches d'argilite seraient la rupture de sbarrières géologiques. Ont-elles été négligées ou volontairement ignorées?
Réponse du 10/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La zone retenue pour étudier la roche argileuse à la limite de la Meuse et de la Haute-Marne a été choisie à l’écart des failles connues et les études menées par l’Andra ont ensuite permis de montrer qu’aucune faille n’est présente dans la zone d’implantation prévue pour Cigéo.
Le site de Meuse/Haute-Marne appartient à un domaine géologique stable, particulièrement favorable pour l’installation d’un stockage. L’activité sismique est en effet extrêmement faible, comme le prouvent les enregistrements de sismicité instrumentale (écoute sismique depuis 1961 à l’échelle de la France) et les chroniques historiques (séismes ayant été ressentis et/ou ayant occasionné des dégâts au cours des derniers 1 000 ans). Lorsque l’Andra a commencé à étudier le sud de la Meuse et le nord de la Haute-Marne, en 1994, elle avait connaissance des fossés de la Marne et de Gondrecourt, reportés sur toutes les cartes géologiques. La démarche de caractérisation géologique du site, avec tous les moyens d’études correspondant (cartographie, forage, sismique réflexion, images satellite), a consisté à :
- Identifier un site d’implantation précis à l’écart de ces deux failles, dans un secteur où les formations géologiques sont planes,
- étudier en détail ces deux systèmes de failles pour en connaître les caractéristiques et vérifier qu’elles ne peuvent pas avoir de conséquences sur le futur stockage.
C’est ainsi que la zone de 30 km² étudiée pour l’implantation de l’installation souterraine (zone en rouge sur la carte) est, au plus proche, à 1,5 km du fossé de Gondrecourt, et à 6 km du segment le plus proche du système des failles de la Marne (le fossé de la Marne étant lui-même est à 14 km). Les analyses cartographiques montrent l’absence de mouvements de ces failles au cours des derniers millions d’années. Les derniers mouvements tectoniques du fossé de Gondrecourt datent de 20 à 25 millions d’années (datations de cristaux de calcite) ; les derniers mouvements des failles de la Marne sont du même âge ou plus anciens. La réalisation d’une écoute sismique dont le seuil de détection est très bas, et qui discrimine sans ambiguïté séismes naturels et tirs de carrières, permet d’affirmer l’absence de toute activité sur ces failles. En accord avec la réglementation en vigueur concernant la sûreté des installations nucléaires, les ouvrages de stockage sont toutefois dimensionnés pour résister aux séismes maxima physiquement possibles que pourraient générer ces failles si elles redevenaient actives dans le futur.
QUESTION 1513
Posée par Thierry DE LAROCHELAMBERT (BELFORT), le 28/01/2014
Questions posée dans le cahier d'acteurs n°118 de M. Thierry De Larochelambert :
La montée en puissance des énergies renouvelables et des politiques de sobriété-efficacité ne remet-elle pas d'ores et déjà en cause toutes les hypothèses sur lesquelles le projet Cigéo a été basé et présenté comme inéluctable?
Le graphite irradié (FA-VL) des anciens réacteurs UNGG est hautement contaminé par des éléments aussi nocifs que le chlore 36, le tritium 3H, le carbone 14, le nickel 63, le cobalt 60, le technetium 99, l'iode 129, le plutonium 239 et 240, l'américium 241, etc. et les procédés envisagés (chauffage à haute température, filtration ou lessivage à l'eau, etc) sont loin d'être au point (von Lensa et al., 2012). Le graphite ne devrait-il pas être exclu?
Pourquoi ce projet a-t-il été dimensionné à une échelle industrielle sans qu'aucune expérimentation en conditions réelles n'ait au préalable été réalisée sur plusieurs décennies comme pour n'importe quel projet industriel pour étudier sa faisabilité, sa réalisabilité et la tenue à long terme des colis nucléaires enfouis en galerie profonde, contrairement au projet de stockage géologique suédois (tests de corrosion et de retrait en cours sur 20 ans en vraie grandeur ; essais opérationnels avec 200 à 400 fûts, suivis par une évaluation sur plusieurs années (Rosborg et al., 2008)?
Le projet, apparamment structuré et défini, reste pourtant très flou en terme d'évolution, d'emprise au sol, de permis de construire, etc. N'est-ce pas un blanc-seing?
Le choix de l'argilite n'est pas le choix géologiquement le plus cohérent : déformation, plasticité, faillage, infiltrations, gestion des eaux souterraines menancent l'intégrité et l'étanchéité des structures béton et des fûts entreposés ; c'est un choix par défaut après les oppositions rencontrées sur les sites granitiques. Les vieux gisements granitiques des socles hercyniens me semblent à cet égard beaucoup plus fiables à très long terme. Ne faut-il pas reprendre cette option?
Réponse du 13/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La montée en puissance des énergies renouvelables et des politiques de sobriété-efficacité ne remet-elle pas d'ores et déjà en cause toutes les hypothèses sur lesquelles le projet Cigéo a été basé et présenté comme inéluctable?
Cigéo est conçu pour prendre en charge les déchets les plus radioactifs produits par les installations nucléaires passées et actuelles. Le stockage est en premier lieu destiné aux déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue déjà produits depuis plus de 50 ans ainsi qu’aux déchets qui seront inévitablement produits quels que soient les choix énergétiques futurs.
Concernant les déchets qui seront produits dans les années à venir par les installations actuelles, différents scénarios ont été étudiés afin d’anticiper les conséquences sur la nature et les volumes de déchets qui seraient à stocker (d’une part poursuite de la production électronucléaire avec recyclage complet des combustibles usés*, avec une durée de fonctionnement des réacteurs de 40, 50, 60 ans, d’autre part arrêt de la production de l’industrie électronucléaire et stockage direct des combustibles usés). Ces scénario sont présentés dans le chapitre 1 du Dossier du maître d’ouvrage : ../docs/dmo/chapitres/DMO-Andra-chapitre-1.pdf. A la demande du Ministère en charge de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, l’Andra, EDF et Areva ont étudié l’impact des différents scénarios établis dans le cadre du débat national sur la transition énergétique sur la production de déchets radioactifs et sur le projet Cigéo : ../docs/rapport-etude/20130705-courrier-ministere-ecologie.pdf
Cigéo est ainsi conçu pour être flexible afin de pouvoir s’adapter à d’éventuels changements de la politique énergétique. L’inventaire détaillé des déchets radioactifs pris en compte dans les études de conception de Cigéo est disponible sur le site du débat public (../docs/rapport-etude/dechets-pris-en-compte-dans-etudes-conception-cigeo.pdf). La nature et les quantités de déchets autorisés pour un stockage dans Cigéo seront fixées par le décret d’autorisation de création du Centre. Toute évolution notable de cet inventaire devra faire l’objet d’un nouveau processus d’autorisation, comprenant notamment une enquête publique et un nouveau décret d’autorisation.
* Les déchets produits par un éventuel futur parc de réacteurs ne sont pas pris en compte.
Le graphite irradié (FA-VL) des anciens réacteurs UNGG est hautement contaminé par des éléments aussi nocifs que le chlore 36, le tritium 3H, le carbone 14, le nickel 63, le cobalt 60, le technetium 99, l'iode 129, le plutonium 239 et 240, l'américium 241, etc. et les procédés envisagés (chauffage à haute température, filtration ou lessivage à l'eau, etc) sont loin d'être au point (von Lensa et al., 2012). Le graphite ne devrait-il pas être exclu?
Le projet de stockage profond Cigéo est conçu pour mettre en sécurité définitive les déchets dont le niveau de radioactivité et la durée de vie ne permettent pas de les stocker, de manière sûre à long terme, en surface ou à faible profondeur. Des volumes supplémentaires de déchets sont ainsi prévus par précaution en réserve dans Cigéo, correspondant en particulier aux déchets qui, le cas échéant, ne pourraient pas être stockés dans le stockage à faible profondeur aujourd’hui à l’étude par l’Andra pour le stockage de déchets de faible activité à vie longue (réserve d’environ 20 % du volume de déchets de moyenne activité à vie longue à stocker). L’inventaire des déchets de graphite et les scénarios de gestion à l’étude pour ces déchets sont donnés au chapitre 4.2.1 du document Les déchets pris en compte dans les études de conception de Cigéo.
Pourquoi ce projet a-t-il été dimensionné à une échelle industrielle sans qu'aucune expérimentation en conditions réelles n'ait au préalable été réalisée sur plusieurs décennies comme pour n'importe quel projet industriel pour étudier sa faisabilité, sa réalisabilité et la tenue à long terme des colis nucléaires enfouis en galerie profonde, contrairement au projet de stockage géologique suédois (tests de corrosion et de retrait en cours sur 20 ans en vraie grandeur ; essais opérationnels avec 200 à 400 fûts, suivis par une évaluation sur plusieurs années (Rosborg et al., 2008)?
Creusé directement à environ 500 m de profondeur dans la formation argileuse, le Laboratoire souterrain permet de caractériser in situ les propriétés thermo-hydromécaniques et chimiques de l’argile, de déterminer les interactions entre le milieu géologique et les matériaux qui seront introduits lors du stockage (tests de corrosion en particulier), de mettre au point des méthodes de construction des ouvrages et de suivre leur comportement sur la durée, ou encore de tester des méthodes d’observation et de surveillance. Des essais de retrait de colis en vraie grandeur ont également été réalisés sur des maquettes en surface. Le Laboratoire n’est pas une installation nucléaire et il n’est pas possible d’y introduire un colis de déchets radioactifs. Les essais en conditions réelles devront être réalisés dans Cigéo. Cette démarche est similaire à celle mise en œuvre en Suède, où la demande d’autorisation de création du stockage est en cours d’instruction.
Si Cigéo est autorisé, le démarrage de l’exploitation se fera de manière progressive. Des premiers colis de déchets radioactifs pourraient être pris en charge à l’horizon 2025. Le stockage des déchets de moyenne activité à vie longue (MA-VL) débuterait en 2025 et se poursuivrait pendant plusieurs dizaines d’années. Pour les déchets les plus radioactifs, l’Andra propose de réaliser une zone pilote au démarrage du stockage pour stocker une petite quantité de déchets de haute activité (HA). Cette zone serait ainsi observée pendant une cinquantaine d’années et permettrait d’avoir un retour d’expérience important avant de commencer la phase de stockage des déchets HA à l’horizon 2075.
Le projet, apparamment structuré et défini, reste pourtant très flou en terme d'évolution, d'emprise au sol, de permis de construire, etc. N'est-ce pas un blanc-seing?
L’implantation des installations de Cigéo et sa construction progressive sont présentées aux chapitres 3 (../docs/dmo/chapitres/DMO-Andra-chapitre-3.pdf) et 4 (../docs/dmo/chapitres/DMO-Andra-chapitre-4.pdf) du dossier du maître d’ouvrage.
Le choix de l'argilite n'est pas le choix géologiquement le plus cohérent : déformation, plasticité, faillage, infiltrations, gestion des eaux souterraines menancent l'intégrité et l'étanchéité des structures béton et des fûts entreposés ; c'est un choix par défaut après les oppositions rencontrées sur les sites granitiques. Les vieux gisements granitiques des socles hercyniens me semblent à cet égard beaucoup plus fiables à très long terme. Ne faut-il pas reprendre cette option?
Selon les pays et leur géologie, plusieurs types de roches sont étudiés pour l’implantation de stockages profond. Dans tous les cas, la conception du stockage soit être adaptée aux caractéristiques de la roche hôte et du site d’implantation.
Le granite est une roche avec une résistance mécanique importante, ce qui facilite le creusement des ouvrages souterrains. Cette roche peut néanmoins présenter des fractures par lesquelles l’eau peut circuler. Les concepts de stockage dans le granite étudiés en Suède et en Finlande prévoient des conteneurs de stockage en cuivre protégés par de l’argile gonflante placée entre ces conteneurs et le granite pour assurer le confinement à long terme de la radioactivité. L’Andra a poursuivi ses recherches sur le milieu granitique jusqu’en 2005, en s’appuyant notamment sur les travaux menés dans les laboratoires souterrains d’autres pays. Ces recherches ont conduit l’Andra à conclure qu’un stockage dans les massifs granitiques ne présenterait pas de caractère rédhibitoire mais que la principale incertitude porte sur l’existence de sites en France avec un granite ne présentant pas une trop forte densité de fractures.
L’argile est très peu perméable et possède la propriété de pouvoir fixer un grand nombre d’éléments chimiques grâce à sa microstructure en feuillets. La roche étudiée par l’Andra au moyen du Laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne possède des propriétés favorables pour confiner la radioactivité à très long terme : l’eau n’y circule pas, la couche est homogène et son épaisseur est importante (plus de 130 mètres). Aucune faille affectant cette couche n’a été mise en évidence sur la zone étudiée. Contrairement au granite, les galeries souterraines doivent être soutenues avec un revêtement en béton ou en acier. Plusieurs pays étudient également l’option d’un stockage dans l’argile (Belgique, Japon, Suisse).
QUESTION 1512
Posée par Eve SISMONDINI (SAINT-MIHIEL), le 22/01/2014
Questions posées dans le cahier d'acteurs n°153 de Mme Eve Sismondini : Les démonstration de l'Andra sont très techniques et seuls les ingénieurs et les spécialistes sont en mesure de les comprendre. Doit-on pour autant leur signer un chèque en blanc lorsqu'ils prétendent être prêts? Pourquoi aller si vite, pourquoi prétendre qu'il n'y a pas de risque ou que tous les risques ont été envisagés? Y a-t-il une activité humaine sans risque? Comment peut-on nous assurer aujourd'hui que les risques soulevés ces derniers mois par des chercheurs indépendants seront maîtrisés! Et les autres mis au jour demain? Qui peut prétendre aujourd'hui qu'ils sont tous écartés?
Réponse du 30/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Il n’est pas question de signer un chèque en blanc à l’Andra. Il faut savoir que Les recherches menées par l’Andra font appel à une large communauté scientifique (10 organismes et établissements universitaires partenaires, 70 laboratoires académiques, participation à 12 programmes de recherche européens depuis 2006…). L’ensemble de ces travaux font l’objet de publications dans des revues à comités de lecture (50 à 70 publications scientifiques internationales par an depuis 10 ans) et sont évalués par des instances indépendantes, en particulier la Commission nationale d’évaluation, mise en place par le Parlement, et l’Autorité de sûreté nucléaire qui s’appuie sur l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Les grands dossiers scientifiques et techniques que l’Andra remet dans le cadre de la loi font l’objet, à la demande de l’Etat, de revues internationales sous l’égide de l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’OCDE. Des expertises sont régulièrement commandées par le Comité local d’information et de suivi du Laboratoire souterrain sur les grands dossiers de l’Andra ou sur des sujets plus ciblés. Enfin, l’Andra a été évaluée en 2012 par l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) qui, dans son rapport d’évaluation a considéré que « l’Andra est probablement l’un des établissements les plus évalués de France y compris et surtout dans son activité de recherche. »
Pour que le projet puisse être autorisé, l’Andra doit démontrer à l’Autorité de sûreté nucléaire qu’elle maîtrise les risques liés à l’installation, que ce soit pendant son exploitation ou après sa fermeture. Ainsi, conformément au principe de défense en profondeur, tous les dangers potentiels qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation sont identifiés en amont de la conception. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels montre que leurs conséquences resteraient limitées, et nettement en deçà des normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire.
QUESTION 1511
Posée par ADEPR (PONTFAVERGER-MORONVILLIERS), le 22/01/2014
Question posée dans le cahier d'acteurs n°148 de l'ADEPR : Si on regarde le projet Cigéo à la lumière des 50 ans vécus sur ce polygone de Pontfaverger-Moronvilliers, n'y a t-il pas lieu d'être inquiet?
Réponse du 07/02/2014,
Réponse apportée par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) :
Dans le cadre du recensement des sites et sols pollués, le CEA a déclaré le site du PEM, dans la base de données BASOL en mai 1997. L’ensemble du site fait l’objet d’une surveillance environnementale renforcée dont les résultats sont régulièrement transmis à l’ASND et au Préfet.
QUESTION 1510
Posée par ADEPR (PONTFAVERGER-MORONVILLIERS), le 22/01/2014
Questions posées dans le cahier d'acteurs n°148 de l'ADEPR : Le site de Moronvilliers vient tout juste de fermer, après seulement 55 ans d'activité, avec les meilleurs scientifiques du monde, l'un des ordinateurs les plus puissants d'Europe, des investissements sans limite budgétaire, la Loi TSN, les organismes censés protéger les habitants et le sol français tel que DREAL, DSND, ICPE, HCTISN, CEA, DAM, IRSN, INBS... et personne ne connait les lieux précis où ont été enfouis les matières radioactives. Dans quelles conditions d'entreposage cela a été fait? Quelles sont les matières chimiques et radioactives, les quantités? Dans combien de temps les radionucléides vont-ils migrer dans l'air, l'eau? Comment aller les rechercher alors que les puits d'expérimentations nucléaires sont profonds de 100 m (500 m pour Cigéo). Comment les repérer dans une zone de 500 hectares (25 km² pour Cigéo)?
Réponse du 07/02/2014,
Réponse apportée par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) :
Dans le cadre du recensement des sites et sols pollués, le CEA a déclaré le site du PEM, dans la base de données BASOL en mai 1997. L’ensemble du site fait l’objet d’une surveillance environnementale renforcée dont les résultats sont régulièrement transmis à l’ASND et au Préfet.
QUESTION 1509
Posée par ADEPR (PONTFAVERGER-MORONVILLIERS), le 22/01/2014
Question posée dans le cahier d'acteurs n°148 de l'ADEPR : Comment faire croire que la mémoire de Cigéo ne sera jamais mise en défaut sur les centaines de milliers d'années futures?
Réponse du 28/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage. C’est une des raisons qui a conduit, en 2006, le Parlement à retenir la solution du stockage profond.
Malgré cette robustesse du stockage même en cas d’oubli, l’Andra conçoit Cigéo avec l’objectif d’en conserver la mémoire et de la transmettre aux générations futures le plus longtemps possible. Des solutions d’archivage de long terme existent pour les centres de stockage de surface exploités par l’Andra et font l’objet de revues périodiques. Le retour d’expérience montre que ces solutions paraissent robustes pour au moins les 500 premières années. Ainsi, pour Cigéo, l’Andra prévoit qu’un centre de la mémoire perdurera sur le site. Il pourra accueillir le public et comprendra notamment les archives du Centre.
De manière générale, le maintien de la mémoire doit aussi impliquer les acteurs locaux, qui peuvent prendre le relai en cas de défaillance de l’Andra ou de l’État. L’Andra veille d’ores et déjà à les informer sur les enjeux associés à la mémoire et étudie avec des anthropologues, des philosophes ou encore des artistes les facteurs qui peuvent favoriser la transmission de la mémoire. La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
L’Andra a lancé en 2010 un programme d’études pour proposer des outils qui rendent cette transmission plus robuste sur une échelle de temps millénaire. Des pistes se dessinent tels des marqueurs de surface, mais aussi des rendez-vous réguliers à mettre en place au niveau des populations locales.
En tout état de cause, comme il est impossible de garantir notre capacité à communiquer avec des êtres vivant dans plusieurs milliers d’années, c’est chaque génération qui aura la responsabilité de contribuer à transmettre cette mémoire aux générations suivantes.
QUESTION 1507
Posée par Geoffroy MARX (VERDUN), le 30/01/2014
Questions posées dans le cahier d'acteurs n°139 de M. Geoffroy Marx : Que se passera-t-il lorsqu'un évènement politique majeur viendra perturber la construction du site au cours des cent prochaines années? Un parti politique opposé au projet qui arriverait au pouvoir? Une perte de souveraineté liée au développement des prérogatives européennes? Un nouveau conflit armé sur le territoire français? Ou simplement la montée en puissance d'un mouvement écologiste radical qui bloquerait le site? En outre, au regard de l'importance du projet et de sa proximité avec d'autres états européens, une prise de décision et un encadrement à l'échelle européenne ne serait-elle pas préférable?
Réponse du 13/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’histoire industrielle récente fournit des exemples d’installations qui ont été exploitées pendant plus d’un siècle. Sous leur forme moderne, l’exploitation des mines de fer lorraines et l’industrie sidérurgique qui l’a accompagnée se sont ainsi déroulées depuis approximativement le milieu du XIXème siècle, pour se terminer vers la fin du XXème, à la fin des années 80.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion des déchets radioactifs sur le long terme à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat, et non à une société privée. La loi du 28 juin 2006 a également institué un dispositif de sécurisation du financement des charges nucléaires de long terme. Il prévoit la constitution d'un portefeuille d'actifs dédiés par les exploitants nucléaires, sous le contrôle de l’Etat.
La société et la géologie ont chacune leur rôle à jouer pour permettre une gestion sûre des déchets radioactifs. A l’échelle de quelques dizaines d’années, la société doit être en capacité d’assurer une gestion active des déchets radioactifs qu’elle produit, qu’ils soient entreposés dans des bâtiments en surface sur les sites des producteurs de déchets radioactifs ou stockés en profondeur dans Cigéo si sa création est autorisée. Au-delà de quelques centaines d’années, la pérennité d’un contrôle institutionnel ne peut être garantie. Compte tenu de la durée pendant laquelle les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue resteront dangereux (plusieurs centaines de milliers d’années), seul le stockage profond, qui assure le confinement de la radioactivité de manière passive grâce au milieu géologique, est à même de garantir la protection de l’homme et de l’environnement à très long terme.
Du fait de son implantation à 500 mètres de profondeur, le stockage est une installation peu vulnérable. Si, en cours d’exploitation, il était décidé d’arrêter l’exploitation du stockage, les installations ne seraient pas abandonnées. Les opérations de stockage engagées seraient achevées. Les installations de surface pourraient ensuite être démantelées. Les déchets non stockés resteraient entreposés sur les sites des producteurs de déchets.
Comme pour toute création d’installation nucléaire et conformément aux dispositions du traité Euratom, la Commission européenne sera associée au processus d’autorisation :
- l’Andra devra déclarer à la Commission européenne son projet d’investissement concernant une installation nucléaire nouvelle ;
- l’Andra devra transmettre à la Commission européenne un dossier relatif aux rejets d’effluents radioactifs ; l’autorisation de création de Cigéo ne pourra être accordée qu’après l’avis de la Commission sur ce dossier ;
- au titre du contrôle des matières nucléaires, l’Andra devra faire une déclaration à la Commission européenne. Tout au long de l’exploitation, la Commission exercera un contrôle sur les matières nucléaires présentes dans l’installation.
QUESTION 1506
Posée par Michel GUERITTE, Président de l'Association La Q.V (VILLE-SUR-TERRE), le 22/01/2014
Questions posées dans les cahiers d'acteurs n°97 et 98 de M. Michel Gueritte :
Pourquoi la décision finale de construire ce pharaonique stockage n'est-elle pas prise par le pouvoir législatif : Chambre des députés et Sénat?
La CNE (Commission nationale d'évaluation des travaux de l'Andra). Autre entité "voyou"? Sa finalité est-elle d'étudier ou de valier les travaux de l'Andra?
Et comment CNE et IRSN peuvent-ils participer à ces travaux et en même temps être évaluateurs de Cigéo?
Réponse du 13/02/2014,
Réponse apportée par le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
La loi du 28 juin 2006 a fait le choix du stockage réversible profond pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations futures. Elle demande à l’Andra d’étudier et d’implanter un Centre de stockage réversible profond de déchets radioactifs (Cigéo) en indiquant que « la demande d'autorisation de création [d’un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs] doit concerner une couche géologique ayant fait l'objet d'études au moyen d'un laboratoire souterrain ». L’Andra poursuit donc ses études en vue d’élaborer pour 2015 le dossier support à l’instruction de la demande d’autorisation de création de Cigéo en Meuse/Haute-Marne.
La décision d’autoriser ou non la création de Cigéo en Meuse/Haute-Marne n’est donc pas encore prise. Elle reviendra à l’Etat après l’évaluation du dossier remis par l’Andra en 2015 par l'Autorité de sûreté nucléaire et la Commission nationale d'évaluation, l’avis des collectivités territoriales, le vote d’une nouvelle loi fixant les conditions de réversibilité et une enquête publique.
Le projet Cigéo suit la procédure décrite à l’article L. 542-10 du Code de l’Environnement. Plusieurs procédures de consultation sont organisées afin de recueillir l’avis des populations locales et nationales (débat public, avis des collectivités territoriales, enquête publique).
Le Parlement fixe périodiquement les choix relatifs à la mise en œuvre de ce projet :
- loi du 30 décembre 1991, dite loi « Bataille », fixant un programme d’études et recherches de 15 années d’études et recherches sur les déchets radioactifs ;
- loi du 28 juin 2006, définissant le stockage géologique profond comme solution de référence pour les déchets les plus radioactifs et demandant sa mise en service en 2025 ;
- loi à venir sur la réversibilité du projet.
En outre, l’Etat est en contact permanent avec les parties prenantes locales. Un important travail de concertation a été mené, notamment avec les exécutifs locaux, pour élaborer un projet de schéma interdépartemental du territoire.
La Commission nationale d'évaluation, CNE, a été créée par la loi du 30 décembre 1991 et confirmée par la loi du 28 juin 2006 pour évaluer annuellement l'état d'avancement des recherches et études relatives à la gestion des matières et des déchets radioactifs. Cette évaluation donne lieu à un rapport annuel, destiné au Parlement français, qui est transmis à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST).
La Commission est composée de douze membres, choisis sur propositions de l'Académie des sciences, de l'Académie des sciences morales et politiques, et de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques. Sa composition est renouvelée par moitié tous les trois ans. Le dernier renouvellement date en fin d’année 2013.
L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), Autorité administrative indépendante créée par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (dite "loi TSN", désormais codifiée aux livres Ier et V du code de l'environnement par l'ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012), est chargée de contrôler les activités nucléaires civiles en France.
L’IRSN a été créé par l’article 5 de la loi n°2001-398 du 9 mai 2001. C'est un établissement public chargé de missions de recherche et d’expertise dans les domaines liés à la radioprotection et à la sûreté nucléaire.
Réponse apportée par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) :
L’IRSN a pour missions de développer la recherche sur les risques nucléaires et radiologiques, d’évaluer la manière dont ces risques sont pris en compte, de fournir un appui scientifique et technique aux pouvoirs publics et autorités, d’informer et de faciliter la vigilance de la société par la diffusion publique d’information.
Pour mener à bien ses missions, l’IRSN échange avec l’ensemble des acteurs de la gouvernance du risque nucléaire : les industriels du nucléaire, les autres utilisateurs de substances radioactives ou rayonnement ionisants, les autorités et ministères, les autres parties prenantes (société civile, commissions locales d’information…).
Dans ce contexte, l’Institut veille à préserver son indépendance de jugement et d’action pour la réalisation de ses évaluations et les choix des recherches prioritaires à mener dans l’objectif de faire avancer la sûreté nucléaire et la radioprotection. A cet égard, afin d’établir un cadre pour la résolution d’éventuels conflits d’intérêt dans ses activités, l’IRSN s’est doté d’une « Charte d’éthique et de déontologie » qui fixe les principes d’éthique et énonce les règles de déontologie que l’Institut s’impose dans l’exercice de ses missions. Cette charte a été mise en place par un Comité d’éthique et de déontologie, qui veille également à son application. Ces principes et règles satisfont en outre aux exigences de la Charte de l’environnement en matière de droit à l’information et à la participation. Sur ce point, il faut noter que l’IRSN développe une politique d’ouverture qui vise à faciliter l’accès à l’expertise et la montée en compétence des acteurs non institutionnels. L’IRSN coopère ainsi avec les Commissions locales d’information et l’Association nationale des comités et commissions locales d’information afin de construire et faciliter un tel accès à l’expertise. Au travers de cette démarche d’ouverture, l’Institut s’engage ainsi concrètement dans le partage des connaissances, qui est l’un des principes de sa charte.
Dans le domaine des déchets radioactifs, le rôle principal de l’IRSN est d’évaluer la sûreté des filières de gestion en s’appuyant sur des travaux de recherche qu’il effectue lui-même ou dans le cadre de partenariats nationaux et internationaux.
Pour l’IRSN, ces travaux de recherche constituent un élément essentiel pour maintenir sa compétence et la pertinence de ses expertises. Ils constituent également un levier pour renforcer l’indépendance de l’Institut : grâce à ses moyens propres de recherche, l’IRSN a en effet la capacité d’initier et de développer par lui-même des travaux de recherche sur les questions qui lui apparaissent importantes. Pour l’étude des stockages géologiques, il dispose en particulier de la station expérimentale souterraine de Tournemire, qui lui permet de mettre en œuvre des travaux dans un milieu géologique proche de celui étudié pour le projet Cigéo, indépendamment des moyens expérimentaux qui sont développés par l’Andra. Dans ce contexte, les relations partenariales nouées par l’IRSN sont un moyen de stimuler la vitalité des recherches et d’étendre le périmètre des questions scientifiques abordées par ses équipes. Pour éviter que les coopérations ne puissent constituer un obstacle à son indépendance de jugement, l’Institut s’assure, par des clauses appropriées dans les accords qu’il établit, que la nature des collaborations engagées ne compromet pas sa liberté de communiquer et d’utiliser, notamment à des fins d’expertise, les résultats des travaux partenariaux. Il est ainsi à noter que dans le domaine du stockage géologique, l’Institut a émis ou été associé à plus de 260 publications depuis l’initiation par la loi de 1991 des recherches sur la gestion des déchets de haute activité à vie longue. Cette politique de publication constitue un gage supplémentaire de crédibilité des connaissances acquises puisqu’elle permet aux scientifiques de toute appartenance d’apprécier la qualité des recherches effectuées ainsi que l’absence de biais dans leur réalisation
Enfin, s’agissant de l’expertise de sûreté associée au projet Cigéo, les échanges techniques entre l’Andra et l’IRSN découlent du processus réglementaire défini et mis en œuvre par les pouvoirs publics. Tout projet d’installation nucléaire fait l’objet d’une démonstration, établie par et sous la responsabilité de l’exploitant (pour Cigeo, l’Andra) de la maîtrise des risques. L’évaluation de cette démonstration est effectuée par l’IRSN, pour le compte de l’Autorité de sûreté. Cette évaluation est l’occasion d’un dialogue technique qui est destiné à compléter la compréhension du dossier par l’évaluateur, sur la base de questions écrites et de réunions techniques. Cet échange est réalisé selon un processus certifié, auditable et conforme aux exigences de la norme NF-X50-110 « qualité en expertise » qui vise notamment à écarter tout conflit d’intérêt entre l’évaluateur et l’organisme. Depuis 2006, l’IRSN a en outre publié l’ensemble des expertises qu’il a réalisées sur le projet Cigéo.
Pour aller plus loin :
- Consulter la Charte de d’éthique et de déontologie de l’IRSN :
http://www.irsn.fr/FR/IRSN/Gouvernance/ethique-deontologie/Pages/Charte-ethique-deontologie.aspx
- Plus d’informations sur les engagements de l’IRSN en matière d’information et de participation du public :
http://www.irsn.fr/dechets/transparence/Pages/engagement-information-participation-public.aspx
- Plus d’informations sur la recherche et l’expertise de l’IRSN sur les déchets radioactifs :
http://www.irsn.fr/dechets/Pages/Home.aspx
QUESTION 1505
Posée par C MERCIER (JOINVILLE), le 21/01/2014
Je n'ai pas Internet, je m'excuse. Pourquoi mener une enquête sur ce sujet qui est décidé d'avance... N'est-ce pas un coup de bons comédiens pour ironiser sur ceux qui mettent en doute la valeur d'une telle opération.. qui engage une fois encore de l'argent perdu.. on en déborde à l'ANDRA comme à CIGEO..
La manipulation est bien organisée.. on en connaitre jamais le nombre de réponses qui mettent en doute cette mascarade.. in globo oui, mais combien ont répondu, argumenté à l'appui, dans un sens un peu différent du désir des organisateurs..? Mystère..?
Cigéo est une organisation indutrielle de plus qui n'apporte pas de réponse, sinon le stockage, à la gestion des déchets ingérables, l'argent étant assuré.
Alors questions : les dégagements d'hydrogène auront bien lieu donc grandrisque d'incendie.. vous ne pouvez pas le nier.. l'entreposage n'empechera pas les fuites radioactives. Aller à la rencontre de la déterioration des emballages dans 100, 1.000 ans.. quelle illusion! Preuve donnée à Stockamine en Alsace, réversibilité? Quelle fût réversible même avec les robots, qui ose y croire.. à 500m sous terre, l'argile la plus imperméable n'existe pas!
Le mensonge continue bien! L'Andra annonçait toujours un laboratoire pour endormir les élus consentants.. or enfouir il s'agit bien de stockage définitif, avec la disparition des villages et habitants aux alentours, la preuve : l'achat des surfaces environnantes qui mettent à la porte les exploitations des terres et des forêts (voir la prépositiion faite à Mandre en B!)
Vous avez même le plus de participants à l'enquête or vous avez l'audace d'annoncer des cours de formation sur le sujet sans inviter ceux qui mettraient en doute votre assurance à prouver la capacité et la sûreté de ce cinéma.. en incitant les ex-travailleurs du nucléaire (EDF + AREVA) etc à se manifester pour dire leur bonne conscience à approuver une telle monstruosité.. bien sûr Internet rend bien service!
Pourquoi aussi ne pas tenir compte des 45.000 electeurs qui ont demandé la consultation, donc appuyer auprès des autorités donc vous avez la main et l'oreille à organiser enfin un vote sur toute la région.
Vous annoncez l'emploi.. oui pour les travaux et autres sous-traitants.. mais quelle mensonge, quelle illusion.. dans 20-30 ans? A peine des maitre-chiens ou jardiniers pour les pelouses! Et vous voulez notre approbation!
Les déchets futurs.. que contiennent-ils réellement.. bien plus que les isotopes, etc, reconnus..! Soyons là aussi plus cohérents scientifiques.
Enfin, une question qui fait mal.. pourquoi tant d'arrosages financiers pour faire des élus vendeurs.. veulent donc détériorer une conscience déjà bien fragile devant le fric et le profit.. nouvelle religion?
Aurez-vous le courage de me lire? J'en doute.. votre réponse se fera sur Internet bien sûr.. tellement formulaire ou si peu interessante! Mettre en doute la science radionucléaire.. quelle honte, quelle injure faite à toutes les personnes qui s'y baignent? Alors merci, je ne tiens pas à une trempée dans votre piscine. Voyez Tchernobyl.. Fukushima. Nos centrales nucléaires ne font qu'attendre.. EPR! Salutation
Réponse du 10/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 1504
Posée par EUROPE ECOLOGIE LES VERTS (PARIS), le 20/01/2014
Question posée dans le cahier d'acteurs n°149 d'Europe Ecologie Les Verts : A quoi cela sert il de vider les silos de La Hague pour reconcentrer les risques en surface à Bure après avoir traversé une bonne moitié de la France?
Réponse du 28/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les déchets les plus radioactifs destinés à Cigéo sont des déchets dangereux, qui le resteront plusieurs dizaines à centaines de milliers d’années. Ces déchets, produits en France depuis les années 1960, sont en effet actuellement entreposés de manière sûre mais provisoire dans des bâtiments sur leurs sites de production, dans l’attente d’une solution de gestion à long terme. Les installations d’entreposage, qu’elles soient en surface ou en subsurface, ne sont pas conçues pour confiner la radioactivité à très long terme. En cas de perte de contrôle de telles installations, les conséquences radiologiques sur l’homme et l’environnement ne seraient pas acceptables.
Le stockage à 500 mètres de profondeur dans une couche géologique assurant le confinement à très long terme permet de protéger l’homme et l’environnement de la dangerosité de ces déchets et de ne pas reporter indéfiniment la charge de leur gestion sur les générations futures. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Enfin, dans l’hypothèse où Cigéo serait autorisé, les bâtiments de surface du Centre auront pour unique fonction l’accueil, la réception, le contrôle et la préparation des colis avant leur transfert vers l’installation souterraine. A ce stade des études, la durée moyenne de ces opérations pour un colis de déchet est estimée de l’ordre de 2 semaines.
Les installations réalisées sur Cigéo n’auront pas vocation à se substituer aux entreposages sur les sites des producteurs de déchets. Le refroidissement des déchets les plus chauds continuera ainsi à être réalisé à La Hague, où une extension de l’entrepôt accueillant les déchets vitrifiés vient d’être mise en service par Areva.
QUESTION 1503
Posée par Elisabeth BRENIERE (CHAMBERY), le 20/01/2014
Questions posées dans le cahier d'acteurs n°108 de Mme Elisabeth Breniere : On sait qu'il y a une limite à la mise en oeuvre de solutions techniques, c'est leur coût. Mais l'arbitrage économique se fera en d'autres temps et d'autres lieux avec les producteurs de déchets, hors la présence du public. Qu'est-ce qui sera privilégié par ces producteurs, la sécurité ou le moindre coût? L'électricité nucléaire est de plus en plus chère, si les consomatteurs n'en veulent plus, qui payera pour les déchets?
Réponse du 28/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le cadre législatif et réglementaire qui s’applique à l’Andra, futur exploitant du stockage s’il est autorisé, est très clair et donne la priorité à la sûreté. Outre les limites strictes imposées par les textes, ceux-ci imposent également aux exploitants d’abaisser autant que possible le niveau d’exposition des populations au-delà des limites fixées par la réglementation. L’Andra, comme tous les exploitants, est soumise à ces exigences réglementaires, qui sont de plus complètement cohérentes avec sa mission, qui est de mettre en sécurité les déchets radioactifs, afin de protéger l’homme et l’environnement sur le long terme.
Les producteurs doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction et à l’exploitation de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’État.
QUESTION 1502
Posée par Elisabeth BRENIERE (CHAMBERY), le 17/01/2014
Questions posées dans le cahier d'acteurs n°108 de Mme Elisabeth Breniere : Quelles sont les sommes qui ont été provisionnées pour la gestion des déchets et pour quelle quantité et nature de déchets? Quels sont les coûts déjà engagés pour chacun des sites de stockage ou d'entreposage? La répartition des budgets aux différentes étapes de cette gestion? Les provisions sont-elles suffisantes dans chaque hypothèse? Sinon, qui pourra payer, le consommateur d'électricité actuel, futur, l'Etat? Quel est le coût maximal que notre économie peut supporter pour cette gestion? Qui pourra assurer les charges financières en cas de dépassement des coûts, en cas d'accident? Si le financement prévu n'est plus possible, l'exploitant pourra-t-il être obligé d'accepter des déchets étarngers pourboucler son budget, ce qui transformerait la France en poubelle radioactive de l'Europe? Quelle comparaison peut-on faire en terme de coût global entre le nucléaire et les autres solutions pour produire de l'électricité et pour les usages médicaux?
Réponse du 10/02/2014,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Le calcul des provisions correspondant aux charges de gestion à long terme des déchets radioactifs, qui est sous la responsabilité des exploitants des installations nucléaires qui produisent ces déchets, fait l'objet du contrôle du gouvernement au titre des articles L. 594-1 et suivants du code de l'environnement. L'exploitant doit donc montrer annuellement que leur calcul et les actifs financiers dédiés au financement des charges permettront, à terme, de bien couvrir les dépenses futures.
Les sommes provisionnées pour la gestion de l’ensemble des déchets radioactifs correspondait, fin 2011, à 9Md€ (cf. page 45 du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs 2013-2015 ../docs/docs-complementaires/docs-planification/pngmdr-2013-2015.pdf). Les informations détaillées sur la gestion des actifs sécurisant la couverture des charges de long terme sont disponibles dans les documents de référence des exploitants nucléaires, consultables sur internet.
La question des coûts de long terme du nucléaire et du mécanisme de leur financement a été traitée dans le rapport de la Cour des Comptes de janvier 2012 (../docs/docs-complementaires/docs-avis-autorites-controle-evaluations/rapport-thematique-filiere-electronucleaire.pdf), le rapport de la Commission nationale d'évaluation du financement des charges de long terme (CNEF) de juillet 2012 (http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/1207_10_Rapport_de_la_CNEF.pdf) et le rapport de la commission d'enquête du Sénat sur les coûts réels de l'électricité de juillet 2012 (http://www.senat.fr/commission/enquete/cout_electricite/).
D’autre part, concernant votre question sur les déchets étrangers, il convient de rappeler que depuis la loi de 1991, le Parlement a interdit le stockage en France de déchets radioactifs en provenance de l’étranger. Cette interdiction figure aujourd’hui à l’article L. 542-2 du Code de l’environnement. Cette législation est cohérente avec la directive européenne du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre des combustibles usés et des déchets radioactifs, qui réaffirme la responsabilité de chaque État dans la gestion de ses déchets radioactifs.
Enfin, concernant votre dernière question, la Cour des Comptes a estimé dans son rapport de 2012 sur les coûts de la filière électronucléaire que le coût de production de l’électricité nucléaire par les centrales nucléaires en exploitation était d'environ 50€ par MWh.
A titre de comparaison, voici ci-dessous les coûts de production de différentes formes d'énergies :
- énergie hydraulique : 15-20 €/MWh,
- éolien terrestre : 80-90 €/MWh,
- éolien en mer : plus de 220 €/MWh,
- photovoltaïque : entre 230 et 370 €/Mwh selon la taille de l'installation,
- charbon et gaz : entre 70 et 100 €/MWh (pour les nouveaux projets de centrales).
Réponse apportée par EDF, AREVA et le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) :
Ces questions ont été abordées lors du débat contradictoire sur internet du 13 novembre 2013, consacré aux coûts et au financement du stockage, dont l'enregistrement vidéo et le verbatim sont disponibles sur ce site: ../informer/13-11-13-couts-et-financement.html. Le représentant de l'Etat a, lors de ce débat, rappelé que les producteurs de déchets EDF (78%), CEA (17%) et Areva (5%) devaient supporter l'ensemble des coûts d'étude, de construction, d'exploitation et de fermeture du futur stockage Cigeo et avaient constitué pour ce faire, conformément à la loi, des provisions sous forme d'actifs dédiés.
Pour Cigéo, la procédure d’évaluation du coût du projet est définie dans la loi. Les exploitants évaluent les provisions afférentes en fonction du seul coût arrêté par le Ministère en charge de l’énergie. Ce coût a été arrêté en 2005 à l’issue des travaux mené par l’Etat, l’Andra et les exploitants ; les coûts de construction, d’exploitation et de fermeture du stockage avaient été estimés entre 13,5 et 16,5 milliards d’euros répartis sur plus de 100 ans. A l’intérieur de cette fourchette, les exploitants ont retenu un coût de référence de 14,1 milliards d’euros (conditions économiques janvier 2003) correspondant à une prise en compte prudente des aléas de réalisation des risques et opportunités. En tenant compte de l’inflation, cette estimation s’établit à environ 16,5 milliards d’euros aux conditions économiques de 2012. Ce montant demeure la seule référence pour calculer les charges futures et les provisions pour le stockage des déchets HA et MA-VL. Un processus d’échanges piloté par la DGEC est actuellement en place entre l’Andra et les exploitants destiné à affiner le chiffrage afin de prendre en compte les recommandations des évaluateurs ainsi que les modifications éventuelles qui seront apportées au projet suite au débat public. Sur cette base, il reviendra à l’Andra, qui est le maître d’ouvrage du projet, de proposer au Ministre une estimation affinée du coût du stockage. Lorsque le nouveau chiffrage, en cours de construction par l’ANDRA, et qui intègrera toutes les évolutions techniques et les optimisations par rapport au chiffrage de 2005, sera publié par le Ministre de l’Energie, les exploitants EDF, le CEA et AREVA ajusteront si nécessaire les montants des provisions correspondants. Tout cela garantit d'une part que les coûts de stockage sont bien supportés par les consommateurs actuels de l'électricité produite, d'autre part que les exploitants disposeront bien des fonds voulus au moment voulu.
Il faut noter qu'au terme de la loi française, les producteurs des déchets nucléaires restent responsables des déchets qu'ils ont produits, après la prise en charge de ceux-ci par l'ANDRA.
QUESTION 1501
Posée par Elisabeth BRENIERE (CHAMBERY), le 17/01/2014
Questions posées dans le cahier d'acteurs n°108 de Mme Elisabeth Breniere : Quelles sont toutes les hypothèses envisageables pour le nucléaires : arrêt rapide, arrêt à moyen terme, prolongation? Quelles natures et quantités de déchets radioactifs faudra-t-il gérer à terme dans chaque hypothèse? Quelles sont les solutions actuellement utilisées pour la gestion des déchets radioactifs, leurs avantages, leurs inconvénients, leurs coûts? Dans l'hypothèse d'un arrêt très rapide du nucléaire, est-ce qu'un stockage géologique pourrait être évité? Quelles sont les conséquences prévisibles de la mise en oeuvre de Cigéo sur la production future de déchets radioactifs? sur la chaîne actuelle de gestion des déchets? sur la sécurisation des sites de stockage existants? sur la répartition des budgets de gestion des déchets? On sait qu'il y a une limite à la mise en oeuvre de solutions techniques, c'est leur côut. Mais l'arbitrage économique se fera en d'autres temps et d'autres lieux avec les producteurs de déchets, hors la présence du public. Qu'est-ce qui sera privilégié par ces producteurs, la sécurité ou le moindre coût?
Réponse du 13/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Concernant vos questions relatives aux scénarios énergétiques et au lien avec l’inventaire de Cigéo
Le projet de stockage profond Cigéo est conçu pour mettre en sécurité définitive les déchets dont le niveau de radioactivité et la durée de vie ne permettent pas de les stocker, de manière sûre à long terme, en surface ou à faible profondeur. Cigéo est conçu pour prendre en charge les déchets produits par les installations nucléaires passées et actuelles. Le stockage est en premier lieu destiné aux déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue déjà produits depuis plus de 50 ans ainsi qu’aux déchets qui seront inévitablement produits quels que soient les choix énergétiques futurs.
Concernant les déchets qui seront produits dans les années à venir par les installations actuelles, différents scénarios ont été étudiés afin d’anticiper les conséquences sur la nature et les volumes de déchets qui seraient à stocker (d’une part poursuite de la production électronucléaire avec recyclage complet des combustibles usés*, avec une durée de fonctionnement des réacteurs de 40, 50, 60 ans, d’autre part arrêt de la production de l’industrie électronucléaire et stockage direct des combustibles usés). Ces scénario sont présentés dans le chapitre 1 du Dossier du maître d’ouvrage : ../docs/dmo/chapitres/DMO-Andra-chapitre-1.pdf. A la demande du Ministère en charge de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, l’Andra, EDF et Areva ont étudié l’impact des différents scénarios établis dans le cadre du débat national sur la transition énergétique sur la production de déchets radioactifs et sur le projet Cigéo : ../docs/rapport-etude/20130705-courrier-ministere-ecologie.pdf
Par ailleurs, des volumes supplémentaires de déchets sont prévus par précaution en réserve dans Cigéo, correspondant en particulier aux déchets qui, le cas échéant, ne pourraient pas être stockés dans le stockage à faible profondeur aujourd’hui à l’étude par l’Andra pour le stockage de déchets de faible activité à vie longue (réserve d’environ 20 % du volume de déchets de moyenne activité à vie longue à stocker).
Cigéo est ainsi conçu pour être flexible afin de pouvoir s’adapter à d’éventuels changements de la politique énergétique. L’inventaire détaillé des déchets radioactifs pris en compte dans les études de conception de Cigéo est disponible sur le site du débat public (../docs/rapport-etude/dechets-pris-en-compte-dans-etudes-conception-cigeo.pdf). La nature et les quantités de déchets autorisés pour un stockage dans Cigéo seront fixées par le décret d’autorisation de création du Centre. Toute évolution notable de cet inventaire devra faire l’objet d’un nouveau processus d’autorisation, comprenant notamment une enquête publique et un nouveau décret d’autorisation.
* Les déchets produits par un éventuel futur parc de réacteurs ne sont pas pris en compte.
Concernant votre question relative aux coûts
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne directement rattaché à l’Etat, l’Andra, qui est indépendante des producteurs de déchets radioactifs. Si Cigéo est autorisé, il est effectivement important que l’Andra dispose des ressources nécessaires pour exploiter en toute sécurité le site pendant toute sa durée.
Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat. Les provisions sont constituées dès aujourd’hui pour couvrir les charges à financer par les producteurs, et sont sanctuarisées dans des placements qui ne peuvent être sujets à des coupes budgétaires. Pour un nouveau réacteur nucléaire, sur l’ensemble de sa durée de fonctionnement, le coût du stockage des déchets radioactifs est de l’ordre de 1 à 2 % du coût total de la production d’électricité.
Le cadre législatif et réglementaire qui s’applique à l’Andra, futur exploitant du stockage s’il est autorisé, est très clair et donne la priorité à la sûreté. Outre les limites strictes imposées par les textes, ceux-ci imposent également aux exploitants d’abaisser autant que possible le niveau d’exposition des populations au-delà des limites fixées par la réglementation. L’Andra, comme tous les exploitants, est soumise à ces exigences réglementaires, qui sont de plus complètement cohérentes avec sa mission, qui est de mettre en sécurité les déchets radioactifs, afin de protéger l’homme et l’environnement sur le long terme.
QUESTION 1500
Posée par GLOBAL CHANCE (MEUDON), le 16/01/2014
Questions posées dans le cahier d'acteurs n°138 de Global Chance : Qui va prendre les décisions de récupération de colis et sur quelles bases? Quelles garanties sont apportées aux population riveraines, à la société, d'avoir un pouvoir d'influencer les décisions? Quelles mesures de protection des populations riveraines en cas d'exhaure de colis plus ou moins abîmés?
Réponse du 11/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement dans une future loi. Les propositions de l’Andra sur la réversibilité sont consultables sur le site du débat public (../informer/les-etudes-preparatoires.html).
L’Andra prévoit dès la conception de Cigéo des dispositifs techniques destinés à faciliter le retrait éventuel de colis de déchets stockés. Les tunnels pour stocker les colis de déchets seront ainsi revêtus d’une paroi en béton ou en acier pour éviter les déformations, avec des espaces ménagés entre les colis et les parois pour permettre leur retrait. Des capteurs permettront de surveiller le comportement des ouvrages. Des essais de retrait de colis pourront être réalisés périodiquement dans le stockage pendant son exploitation. S’il était nécessaire de récupérer un colis contaminé ou détérioré, des précautions particulières seraient prises pour son transfert dans les installations et des opérations spécifiques seraient mises en œuvre (par exemple décontamination ou reconditionnement).
Dans l’hypothèse d’une évolution de la politique en matière de gestion des déchets radioactifs qui conduirait à envisager une opération de retrait d’un nombre important de colis de déchets, de nouvelles installations devraient être créées pour prendre en charge ces déchets (reconditionnement éventuel, expédition, entreposage, traitement…). Une opération importante de retrait de colis de déchets stockés constituerait ainsi une modification notable de l’installation et devrait faire l’objet d’une autorisation spécifique de l’Etat, après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et enquête publique.
Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de ces déchets. Grâce à la réversibilité, les générations suivantes garderont la possibilité de faire évoluer cette solution si elles le souhaitent. L’Andra propose que des rendez-vous réguliers soient organisés avec l’ensemble des acteurs (riverains, collectivités, associations, scientifiques, évaluateurs, État…) pour contrôler le déroulement du stockage et préparer les prochaines étapes. Ces discussions seront alimentées par la surveillance du stockage et les résultats des réexamens de sûreté (l’Autorité de sûreté nucléaire impose un réexamen périodique de sûreté, au moins tous les 10 ans, pour toutes les installations nucléaires). Ces rendez-vous offriront aussi aux générations suivantes la possibilité de réexaminer périodiquement les conditions de réversibilité.
QUESTION 1499
Posée par GLOBAL CHANCE (MEUDON), le 16/01/2014
Questions posées dans le cahier d'acteurs n°138 de Global Chance : Quels coûts pour l'ensemble de ces opérations à partir de quelques scénarios incidentels ou accidentels? Quel peut être le coût de la réversibilité si elle porte sur une fraction importante (10%, 20%, 50%) des colis stockés?
Réponse du 28/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le projet Cigéo est conçu pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets français les plus radioactifs et ne pas reporter leur charge sur les générations futures. Il est également important de laisser aux générations suivantes la possibilité de faire évoluer cette solution si elles le souhaitent. C’est pourquoi le Parlement a demandé que le stockage, prévu pour être définitif, soit réversible pendant au moins 100 ans. Les conditions de réversibilité seront définies par une future loi avant que la création de Cigéo ne puisse être autorisée. Les générations suivantes pourront ainsi contrôler le déroulement du stockage et récupérer les déchets si elles le souhaitent.
L’Andra prévoit dès la conception de Cigéo des dispositifs techniques destinés à faciliter le retrait éventuel de colis de déchets stockés. Les tunnels pour stocker les colis de déchets seront ainsi revêtus d’une paroi en béton ou en acier pour éviter les déformations, avec des espaces ménagés entre les colis et les parois pour permettre leur retrait. Des capteurs permettront de surveiller le comportement des ouvrages. Des essais de retrait de colis pourront être réalisés périodiquement dans le stockage pendant son exploitation.
Le coût d’une opération de retrait de déchets stockés dépend de la situation considérée (volume de déchets concernés, date de mise en œuvre, devenir des colis retirés du stockage…). Au coût de l’opération de retrait proprement dite, qui serait a priori d’un ordre de grandeur analogue à celui des opérations de mise en stockage des déchets, il conviendrait d’ajouter celui des nouvelles installations à construire pour accueillir les déchets et celui du transfert des déchets dans ces nouvelles installations.
Pour en savoir plus sur les propositions faites par l’Andra en matière de réversibilité du stockage, voir : ../docs/rapport-etude/fiche-reversibilite-cigeo.pdf
QUESTION 1498
Posée par GLOBAL CHANCE (MEUDON), le 16/01/2014
Questions posées dans le cahier d'acteurs n°138 de Global Chance :
Exhaure des colis à inspecter et à remettre éventuellement en état : A quel rythme journalier peut-on sortir des colis en cas d'urgence? Ce rythme dépend-il de la date à laquelle on a besoin de l'effectuer, entre 2030 et 2130? Ce rythme dépend-il de l'état d'endommagement éventuel des colis?
Entreposage sur les sites et atelier de réparation éventuelle des colis : Quel type d'installation et quel dimensionnement su site d'entreposage des colis sortis des galeries? Quelle capacité, quelle surface, quels aménagements de sûreté?
Réintroduction éventuelle des colis dans les galeries : La réintroduction des colis inspectés et, ou remis en état dans les galeries souterraines est-elle possible?
Réponse du 13/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les déchets radioactifs seront placés dans des conteneurs épais, en acier ou en béton, prévus pour résister aux incidents d’exploitation qui pourraient survenir dans l’installation de stockage (par exemple une chute ou un incendie). En cas d’accident, l’installation sera remise en sécurité par la pose rapide d’équipements provisoires (ventilation, barrière de confinement…) et non par une opération de retrait de colis. Une fois la mise en sécurité réalisée, l’exploitant examinera les dispositions à mettre en œuvre pour reprendre l’exploitation normale. Le maintien en stockage de colis, même endommagés, ou leur retrait éventuel pourra alors être décidé sans caractère d’urgence. S’il était nécessaire de récupérer un colis contaminé ou détérioré, des précautions particulières seraient prises pour son transfert dans les installations et des opérations spécifiques seraient mises en œuvre (par exemple décontamination ou reconditionnement).
La réversibilité n’impose pas de disposer de capacités d’entreposage dans l’attente d’un retrait éventuel de colis de déchets. En effet, au plan technique, il suffirait de quelques années (trois à cinq ans) pour créer, éventuellement par tranches successives, de nouvelles installations capables de gérer les colis que l’on aurait décidé de retirer du stockage. Le dimensionnement des installations à réaliser dépend de la situation de retrait considérée : famille de colis concernée, volumes, dates de retrait, devenir des colis retirés du stockage… Dans l’hypothèse d’un transfert de colis de déchets d’une alvéole vers une autre alvéole de stockage, le délai nécessaire pour construire et équiper une alvéole de stockage est de l’ordre de 2 ans (cas d’une alvéole pour des déchets de moyenne activité à vie longue).
QUESTION 1497
Posée par CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA MEUSE (BAR-LE-DUC CEDEX), le 16/01/2014
Questions posées dans le cahier d'acteurs n°136 de la Chambre d'Agriculture de la Meuse : Des interrogations sont posées sur la mise en place d'un périmètre de sécurité autour de la zone définie : Est-il prévu? Quel pourrait en être la surface et l'incidence sur l'utilisation de ces surfaces? Quelles dispositions d'indemnisation sont prévues en cas d'accident? Nos productions locales sont-elles assurables contre de tels risques?
Réponse du 11/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La réglementation en matière de maîtrise des activités autour des installations nucléaires ne concerne que celles nécessitant un plan particulier d’intervention (PPI), définies par le décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005. Ce plan est décidé par le préfet, autour des installations pouvant nécessiter des actions de protection des populations à mettre en œuvre pour limiter les conséquences d’un accident éventuel. Elle vise essentiellement à ne pas remettre en cause la faisabilité des actions de mise à l’abri et d’évacuation.
L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels montre que leurs conséquences resteraient limitées, et nettement en deçà du seuil réglementaire qui imposeraient des mesures de protection des populations (mise à l’abri, évacuation). Cigéo ne serait donc pas concerné par ces règles de maîtrise des activités.
Pour Cigéo, comme tout industriel, l’Andra contractera des assurances destinées à couvrir les risques industriels classiques. De plus, Cigéo étant une installation nucléaire, elle est soumise au régime de responsabilité civile nucléaire. En cas d’accident nucléaire survenant sur le site de l’Andra, la responsabilité de cette dernière sera mise en cause sans que les victimes n’aient à prouver une faute de l’Andra. Ce régime a notamment pour intérêt de simplifier les recours des victimes qui ne sont pas obligées de multiplier les procédures à l’encontre des autres acteurs intervenant sur le site.
QUESTION 1496
Posée par GLOBAL CHANCE (MEUDON), le 16/01/2014
Question posée dans le cahier d'acteurs n°137 de Global Chance : Le risque d'inflitration d'eau dans des couches géologiques est probablement le principal risque "technique" à long terme, sans doute inévitable : au bout de combien de temps des eaux chargées d'éléments radioactifs pourraient remonter à la surface? Et cela quelle que soit la nature de la couche géologique concernée, l'argile étant toutefois plus favorable que le granite selon ce critère.
Réponse du 28/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Pendant l’exploitation du stockage, de nombreuses mesures seront prises pour prévenir d’éventuelles arrivées d’eau accidentelles dans Cigéo :
- Protection des puits et de la descenderie contre les intempéries,
- Etanchéification des puits et des descenderies au niveau des couches de roche aquifères traversées au-dessus de la couche d’argilite,
- Systèmes de drainage des eaux issues des couches de roche supérieures peu productives et pompage de ces eaux jusqu’à la surface,
- Protection des canalisations d’eau interne et mécanismes de fermeture automatique en cas de rupture.
Par précaution, des scénarios accidentels d’arrivées d’eau (par exemple suite à la défaillance d’une canalisation ou suite à une panne dans le système de drainage des eaux provenant des couches de roche supérieures) sont pris en compte dans les études de sûreté menées pour Cigéo, au même titre que pour n’importe quelle installation nucléaire. Compte tenu des origines possibles, ce débit sera nécessairement limité (pour mémoire le débit drainé par chacun des puits du Laboratoire souterrain est de l’ordre de 10 m3/jour en moyenne, ou moins, ce qui est très faible par comparaison à certains sites miniers). Un tel évènement resterait très localisé dans le stockage et n’aurait qu’un effet très limité sur l’argile qui sera protégée par les revêtements. En tout état de cause, ce type d’incident ne remettra pas en cause la sûreté du stockage.
Après la fermeture du stockage, au-delà de la durée de vie des ouvrages industriels, la couche d’argile très peu perméable, de plus de 130 mètres d’épaisseur, dans laquelle sera installé le stockage souterrain, servira de barrière naturelle pour retenir les radionucléides contenus dans les déchets et freiner leur déplacement. Le stockage permet ainsi de garantir leur confinement sur de très longues échelles de temps. Seuls quelques radionucléides mobiles et dont la durée de vie est longue pourront migrer jusqu’aux limites de la couche d’argile qu’ils atteindront après plusieurs dizaines de milliers d’années, puis potentiellement atteindre en quantités extrêmement faibles ensuite la surface et les nappes phréatiques, après plus de 100 000 ans. Leur impact radiologique serait alors plusieurs dizaines de fois inférieur à la radioactivité naturelle (qui est de 2,4 mSv par an en moyenne en France).
QUESTION 1495
Posée par SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT (GAILLON), le 16/01/2014
Question posée dans le cahier d'acteurs n°109 de Sauvegarde de l'Environnement : Y a-t-il urgence? Et pourquoi? Les citoyens qui devraient être associés aux décisions ont la très nette impression qu'on les méprise et que l'on sacrifie plus à un rite de communication qu'à la recherche d'un consensus fondé sur la respect.
Réponse du 28/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
On peut toujours remettre à demain ce que l’on pourrait commencer à faire aujourd’hui. Mais nos enfants pourraient nous reprocher de ne pas avoir préparé de solution pour gérer les déchets les plus radioactifs produits par les activités dont nous avons bénéficié au quotidien. De nombreuses solutions pour gérer les déchets radioactifs ont été imaginées depuis 50 ans : les envoyer dans l’espace, au fond des océans ou dans le magma, les entreposer plusieurs centaines d’années en surface ou à faible profondeur, les transmuter… seul le stockage profond est aujourd’hui reconnu comme une solution robuste pour mettre en sécurité ces déchets à très long terme.
C’est justement pour ne pas laisser aux générations suivantes la charge de la gestion des déchets radioactifs et les risques associés que le Parlement a fait le choix du stockage réversible profond, après 15 années de recherches et leur évaluation sur le plan scientifique et de la sûreté. Plus de 40 000 m3 de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue ont déjà été produits en France depuis une cinquantaine d’années. Ces déchets sont actuellement entreposés de manière provisoire dans l’attente d’une solution de gestion à long terme, notamment sur les sites de La Hague, Marcoule et Cadarache. A l’inverse de l’entreposage, le stockage permet de mettre en sécurité ces déchets de manière définitive.
Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de ces déchets. Grâce à la réversibilité, ces générations garderont la possibilité de faire évoluer cette solution. L’Andra propose ainsi que des rendez-vous réguliers soient programmés pendant une centaine d’années pour faire le point sur l’exploitation du stockage et préparer les étapes suivantes. Ces rendez-vous seront notamment alimentés par les résultats des recherches menées en France et à l’étranger sur la gestion des déchets radioactifs et les avancées technologiques. A chaque étape, il sera possible de décider de poursuivre le processus de stockage tel qu’initialement prévu ou de le modifier, par exemple si des solutions alternatives sont identifiées.
La décision éventuelle de créer Cigéo sera fondée sur les résultats de près de 25 années de recherches. Elle ne sera donc pas prise dans la précipitation ou sans que le projet ait été suffisamment affiné. Cette décision reviendra à l’État après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo. Ce processus comprendra notamment l’évaluation de la sûreté par l’Autorité de sûreté nucléaire, l’évaluation des recherches scientifiques par la Commission nationale d’évaluation, l’avis des collectivités territoriales, le vote d’une nouvelle loi fixant les conditions de réversibilité et une enquête publique.
QUESTION 1494
Posée par SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT (GAILLON), le 16/01/2014
Question posée dans le cahier d'acteurs n°109 de Sauvegarde de l'Environnement : N'aurait-on pas pu (ou dû) attendre qu'on puisse y voir plus clair dans les décisions politiques de limitation de la part du nucléaire dans le mix énergétique total?
Réponse du 30/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
A ce jour, environ 43 000 m3 de déchets de haute-activité (HA) et de moyenne activité à vie longue (MA-VL) sont actuellement entreposés de manière provisoire, principalement sur les sites de La Hague (Manche), de Marcoule (Gard) et de Cadarache (Bouches-du-Rhône), dans l’attente d’une solution de gestion à long terme. Ces déchets ont été produits depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires aujourd’hui arrêtées et par les installations nucléaires actuelles. Quels que soient les choix énergétiques futurs, ces déchets sont déjà produits et il est nécessaire de mettre en œuvre une solution pour protéger l’homme et l’environnement sur le très long terme de la dangerosité de ces déchets.
De plus, d’autres déchets HA et MAVL seront inévitablement produits par le parc électronucléaire actuel dans les années à venir, toujours indépendamment des choix énergétiques futurs. Cigéo, s’il est autorisé, permettra également de prendre en charge ces déchets « engagés ».
L’Andra conçoit alors l’architecture du projet Cigéo de façon à ce qu’elle soit flexible pour pouvoir s’adapter à des évolutions de la politique énergétique française.
Pour plus d’information sur les hypothèses retenues pour le dimensionnement de Cigéo, vous pouvez consulter le dossier du maître d’ouvrage (chapitre 1.5 – Les volumes de déchets prévus dans Cigéo) : ../docs/dmo/chapitres/DMO-Andra-chapitre-1.pdf
Ainsi, on peut toujours remettre à demain ce que l’on pourrait commencer à faire aujourd’hui. Mais il est de la responsabilité des générations actuelles de proposer une solution pour mettre en sécurité de manière définitive ces déchets et ne pas reporter leur charge sur les générations futures.
QUESTION 1493
Posée par SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT (GAILLON), le 16/01/2014
Questions posées dans le cahier d'acteurs n°109 de Sauvegarde de l'Environnement :
Peut-on parler de l'argile de Bure comme rempart infranchissable lorsque l'on visionne cette vidéo? http://www.dailymotion.com/video/x1562ck_l-argilite-de-bure-dure-dure-comme-du-beton-5-mn-54_news
Quelle influence sur le gainage métallique des alvéoles auront les inclusions de pyrite, présentes dans l'argilite de Bure, si de l'eau parvient à les humidifier et générer de l'acide sulfurique?
Quid des possibilités de pénétration de l'eau par les descenderies et les puits?
Réponse du 11/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Concernant les propriétés de l’argile
Le phénomène de délitement d’un échantillon d’argile placé dans un verre d’eau est connu de tous. Il ne peut être transposé aussi simplement à un massif de roche d’argile de 130 mètres d’épaisseur à 500 mètres de profondeur : la roche argileuse est solide alors qu’elle contient environ 10 % d’eau en masse (18 % en volume). Cette propriété est d’ailleurs clairement indiquée dans le dossier 2005 publié par l’Andra (référentiel du site de Meuse/Haute-Marne – tome 2, chapitre 25 ).
Compte tenu de son volume très important, le massif argileux ne pourrait se déliter en présence de venues d’eau externes que de façon très localisée. Dans Cigéo, les parois des galeries seront recouvertes d’un soutènement en béton qui protège la roche, avec des caniveaux pour drainer les éventuelles venues d’eau vers des points de collecte. La roche sera à nu uniquement au niveau des fronts de creusement.
Concernant les inclusions de pyrite
L’oxydation de l’argilite, plus particulièrement de la pyrite qu’elle contient, en paroi des alvéole peut être à l’origine d’un transitoire acide au moment de l’arrivée d’eau dans l’alvéole. Ce processus est observé et il est pris en compte dans l’évaluation de la corrosion du chemisage métallique, notamment l’évolution des vitesses de corrosion dans le temps.
Concernant l’arrivée d’eau dans le stockage
De nombreuses mesures seront prises pour prévenir d’éventuelles arrivées d’eau accidentelles dans Cigéo :
- Protection des puits et de la descenderie contre les intempéries,
- Etanchéification des puits et des descenderies au niveau des couches de roche aquifères traversées au-dessus de la couche d’argilite,
- Systèmes de drainage des eaux issues des couches de roche supérieures peu productives et pompage de ces eaux jusqu’à la surface,
- Protection des canalisation d’eau interne et mécanismes de fermeture automatique en cas de rupture.
Ces dispositions sont largement éprouvées dans l’industrie minière.
Par précaution, des scénarios accidentels d’arrivées d’eau (par exemple suite à la défaillance d’une canalisation ou suite à une panne dans le système de drainage des eaux provenant des couches de roche supérieures) sont pris en compte dans les études de sûreté menées pour Cigéo, au même titre que pour n’importe quelle installation nucléaire. Compte tenu des origines possibles, ce débit sera nécessairement limité (pour mémoire le débit drainé par chacun des puits du Laboratoire souterrain est de l’ordre de 10 m3/jour en moyenne, ou moins, ce qui est très faible par comparaison à certains sites miniers). Un tel évènement resterait très localisé dans le stockage et n’aurait qu’un effet très limité sur l’argile qui sera protégée par les revêtements. En tout état de cause, ce type d’incident ne remettra pas en cause la sûreté du stockage.
QUESTION 1492
Posée par SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT (GAILLON), le 16/01/2014
Question posée dans le cahier d'acteurs n°109 de Sauvegarde de l'Envrionnement : Quelle crédit peut-on accorder à la notion de réversibilité (parlons plutôt de récupérabilité) ?
Réponse du 10/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le projet Cigéo est conçu pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets français les plus radioactifs et ne pas reporter leur charge sur les générations futures. Il est également important de laisser aux générations suivantes la possibilité de faire évoluer cette solution si elles le souhaitent. C’est pourquoi le Parlement a demandé que le stockage, prévu pour être définitif, soit réversible pendant au moins 100 ans. Les conditions de réversibilité seront définies par une future loi avant que la création de Cigéo ne puisse être autorisée. La notion de réversibilité ne comprend donc pas uniquement la notion de récupérabilité mais se décline en trois points :
- Pouvoir récupérer les colis de déchets stockés (récupérabilité)
- Choisir le calendrier de fermeture du stockage
- Préparer les décision ensemble et organiser le passage de relais entre les générations.
Ainsi grâce à la réversibilité, les générations suivantes garderont la possibilité de faire évoluer cette solution si elles le souhaitent. L’Andra place cette demande de la société au cœur du projet. Elle a ainsi fait des propositions concrètes pour pouvoir récupérer les colis de déchets si besoin et laisser des choix possibles aux générations suivantes (../docs/rapport-etude/fiche-reversibilite-cigeo.pdf) :
1) Contrôler le déroulement du processus de stockage
Pendant au moins 100 ans, les générations suivantes pourront contrôler le déroulement du stockage et récupérer des déchets stockés si elles le souhaitent. L’Andra propose que des rendez-vous réguliers soient organisés avec l’ensemble des acteurs (riverains, collectivités, évaluateurs, État…) pour faire le point sur l’exploitation du stockage et les prochaines étapes. Ces discussions seront alimentées par la surveillance du stockage et les résultats des réexamens de sûreté (l’Autorité de sûreté nucléaire impose un réexamen périodique de sûreté, au moins tous les 10 ans, pour toutes les installations nucléaires). Ces rendez-vous offriront aussi aux générations suivantes la possibilité de réexaminer périodiquement les conditions de réversibilité.
2) Préserver la possibilité de mettre en œuvre d’autres modes de gestion
De nombreuses solutions pour gérer les déchets radioactifs ont été imaginées depuis 50 ans : les envoyer dans l’espace, au fond des océans ou dans le magma, les entreposer plusieurs centaines d’années en surface ou à faible profondeur, les transmuter… Seul le stockage profond est aujourd’hui reconnu en France et à l’étranger comme une solution robuste pour mettre en sécurité ces déchets à très long terme. Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de ces déchets.
Grâce à la réversibilité, les générations suivantes garderont la possibilité de faire évoluer cette solution. Les rendez-vous proposés par l’Andra seront notamment alimentés par les résultats des recherches qui continueront à être menées sur la gestion des déchets radioactifs et les avancées technologiques. A chaque étape, il sera possible de décider de poursuivre le processus de stockage tel qu’initialement prévu ou de le modifier, par exemple si des solutions alternatives sont identifiées.
3) Conserver une possibilité d’intervention en cas d’évolution anormale
Les expérimentations menées au Laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne ont permis de qualifier in situ les propriétés de la roche argileuse, d’étudier les perturbations qui seraient induites par la réalisation d’un stockage (effets du creusement, de la ventilation, de la chaleur apportée par certains déchets…), de mettre au point des méthodes d’observation et de surveillance et de tester les procédés de réalisation qui pourraient être utilisés si Cigéo est mis en œuvre.
L’étape suivante sera d’acquérir une expérience complémentaire lors de la réalisation des premiers ouvrages de stockage. Si Cigéo est autorisé, le démarrage de l’exploitation se fera de manière progressive. Des premiers colis de déchets radioactifs pourraient être pris en charge à l’horizon 2025. Dans son avis du 16 mai 2013, l’Autorité de sûreté nucléaire a recommandé une phase de « montée en puissance » progressive de l’exploitation du stockage. L’évolution du stockage sera surveillée tout au long de l’exploitation de Cigéo. Les rendez-vous proposés par l’Andra seront alimentés par les résultats de la surveillance du stockage.
4) Pouvoir récupérer des colis de déchets
L’Andra prévoit dès la conception de Cigéo des dispositifs techniques destinés à faciliter le retrait éventuel de colis de déchets stockés. Les tunnels pour stocker les colis de déchets seront ainsi revêtus d’une paroi en béton ou en acier pour éviter les déformations, avec des espaces ménagés entre les colis et les parois pour permettre leur retrait. Des capteurs permettront de surveiller le comportement des ouvrages. Des essais de retrait de colis pourront être réalisés périodiquement dans le stockage pendant son exploitation. Dans l’hypothèse d’une évolution de la politique en matière de gestion des déchets radioactifs qui conduirait à envisager une opération de retrait d’un nombre important de colis de déchets, de nouvelles installations devraient être créées pour prendre en charge ces déchets (reconditionnement éventuel, expédition, entreposage, traitement…).
5) Ne pas abandonner le site
Après fermeture, la sûreté du stockage sera assurée de manière passive, c’est-à-dire sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique, qui sert de barrière naturelle à très long terme, et sur la conception du stockage. Une surveillance sera néanmoins maintenue après la fermeture du stockage aussi longtemps que la société le souhaitera et des actions seront menées pour conserver et transmettre sa mémoire. Le Parlement a d’ores et déjà décidé que seule une loi pourrait autoriser la fermeture définitive du stockage. Cette future loi pourra fixer les conditions dans lesquelles le site restera contrôlé, sa surveillance maintenue et la mémoire conservée.
QUESTION 1491
Posée par SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT (GAILLON), le 15/01/2014
Questions posée dans le cahier d'acteurs n°109 de Sauvegarde de l'Environnement : Comment évaluer la masse de déchets qu'engendrons les choix s'offrant aux décideurs? Et comment déterminer la taille du site Cigéo qui en résultera? En cas de prolongation de la durée de vie des réacteurs? Dans le cas du passage de 75% à 50% pour l'électricité d'origine nucléaire? Ce qui conduirait à arrêter le retraitement de (et non pas des) combustibles usés en 2019 pour respecter la date de 2025? Dans le cas de l'abandon du nucléaire comme l'a fait l'Allemagne? Dans le cas d'une catastrophe nucléaire comme celle qui a frappé le Japon? (30 millions de m3 de déchets...) Sans parler des coûts financiers insupportables alors que nous cherchons partout de l'argent? Qu'en sera-t-il des stocks de déchets en provenance d'autres pays européens?
Réponse du 30/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le projet de stockage Cigéo est conçu pour accueillir les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue produits par les installations nucléaires françaises actuelles jusqu’à leur démantèlement ainsi que les déchets produits par les installations qui sont aujourd’hui arrêtées (Brennilis, Bugey, Chinon, Saint-Laurent, Superphénix…). Si Cigéo est autorisé, le stockage sera construit de manière progressive, au fur et à mesure des besoins. L’évaluation du coût du stockage correspond ainsi à des dépenses réparties pendant plus de 100 ans. L’Andra conçoit l’architecture du projet Cigéo de façon à ce qu’elle soit flexible pour pouvoir s’adapter à des évolutions de la politique énergétique française. Pour plus d’information sur les hypothèses retenues pour le dimensionnement de Cigéo, vous pouvez consulter le dossier du maître d’ouvrage (chapitre 1.5 – Les volumes de déchets prévus dans Cigéo) : ../docs/dmo/chapitres/DMO-Andra-chapitre-1.pdf
Enfin précisons qu’aucuns déchets étrangers ne seront stockés dans Cigéo. Depuis la loi de 1991, le Parlement a interdit le stockage en France de déchets radioactifs en provenance de l’étranger. Cette interdiction figure aujourd’hui à l’article L. 542-2 du Code de l’environnement. Cette législation est cohérente avec la directive européenne du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre des combustibles usés et des déchets radioactifs, qui réaffirme la responsabilité de chaque État dans la gestion de ses déchets radioactifs.
QUESTION 1490
Posée par Yves BERTHELEMY (COURSAN-EN-OTHE), le 14/01/2014
Questions posées dans le cahier d'acteurs n°129 de M. Yves Berthélémy : L'Andra doit assurer la réversibilité pendant la durée de la phase d'exploitation. Comment la gèrera t-elle si des erreurs de calculs (d'une façon générale, de telle ou telle entreprise) ou des malfaçons apparaissent comme on a pu en voir sur le chantier le l'EPR à Flamanville? Comment un groupe comme SNC LAVALIN a t-il pu obtenir ce contrat, alors qu'il est attaqué dans son propre pays pour corruption, la loi française ne permet-elle pas de faire fonctionner le bénéfice du doute en ce sens? Certainement pas, et la présomption d'innocence est reine en France. Et c'est bien ainsi pour de nombreux cas. Mais la question reste légitime sur ce type de dossier ultra sensible. D'ici quelques mois, l'étude sera lancée. Supposons que l'entreprise mandatée soit condamnée dans son pays pour les faits reprochés. Quelle incidence sur la pérennité du projet français et quelle assurance de qualité pourra t-elle fournir? D'ici quelques années, la construction sera lancée. Quelles incidences sur le chantier occasionnerait l'éventuelle disparition de l'entreprise? Quelle solution l'Andra aura-t-elle si l'entreprise, comme à Vatry, décide de se retirer avant le terme du contrat? Qui osera reprendre le chantier, et assumer les éventuelles erreurs? Cela soulève aussi les problèmes de sous-traitance : sur un chantier comme à Flamanville, la sous-traitance pendant longtemps n'a pu être gérée sainement, cachant même des blessés, des morts, et bien sûr des malfaçons... Qui est le responsable? Que se serait-il passé à Flamanville si les malfaçons n'avaient pas été reperées sur l'enceinte de confinement du réacteur? Une catastrophe nucléaire, sans aucun doute. Que se passerait-il à Bure dans un cas identique? Une catastrophe nucléaire, sans aucun doute. Sauf que dans ce cas, nous n'avons auncune référence vécue pour la modéliser... Nous sommes donc dans un flou fou...
Réponse du 13/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’Andra est un établissement public dont les procédures d’achat sont soumises à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 et à son décret d’application n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié. Les achats de l’Andra reposent sur trois principes fondamentaux : liberté d’accès à la commande publique, transparence des procédures, égalité de traitement des candidats. Au-delà d’un certain montant, la réglementation européenne impose aux maîtres d’ouvrage publics d’organiser des appels d’offres européens. Les contrats en cours concernent les études pour concevoir Cigéo et non les travaux, qui ne sont pas autorisés.
Si Cigéo est autorisé, il appartiendra à l’Andra de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour garantir la qualité de la réalisation des ouvrages du stockage, sous le contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire. Il convient de rappeler que Cigéo n’est pas une centrale nucléaire mais un centre de stockage situé à 500 mètres de profondeur, qui sera peu vulnérable aux activités humaines comme aux catastrophes naturelles. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade des études, de l’impact des scénarios accidentels montre que leurs conséquences resteraient limitées, et nettement en-deçà du seuil réglementaire qui imposerait des mesures de protection des populations (mise à l’abri, évacuation).
QUESTION 1489
Posée par Jean-Dominique BOUTIN, le 14/01/2014
Questions posées dans le cahier d'acteurs n°107 de M. Jean-Dominique Boutin :
Membre du CA de l'ANCCLI, j'adhère aux questions exposées à la page 5 de son livre blanc III, sur les déchets radioactifs. Comment peut-on parler de "débat public" quand nombre d'interrogations n'ont pas été posées et que la réponse est déjà "unique"? L'ensemble des débats, celui-ci, mais aussi tous les autres dans les instances de concertation et de dialogue (IRSN, ASN, HCTISN, voire en Région sur la Transition énergétique) montre que, même sereines, les conclusions restent floues. L'explication est que tous les acteurs ne jouent pas dans la même cour. Pourtant publics avertis, nous 'avons aucune clef d'infléchissement d'une politique arrêtée par un groupuscule (Commission PEON, par exple). Tiendra-t-elle compte de nos avis aussi pertinents soient-ils? Malgré le respect dû aux Parlementaires, leur connaissance était-elle suffisante pour décider du "choix unique" proposé? Lors de journées de "dialogue ANCCLI/IRSN", ouvertes et réalisées dans de bonnes conditions de fonctionnement (écoutes mutuelles, échanges clames, confrontation d'idées...) la question d'un plan B, pour la gestion des déchets sur le long terme, a été abordée à plusieurs reprises. Pourquoi, ce qui apparait possible entre "citoyens avertis" et "structures dédiées", ne peut être ré-abordé ici? N'était-ce pas de nature à ce que nombre de citoyens, d'associations et d'élus refusent de participer voire manifestent, au-delà même des "locaux", qui évidemment, pour ou contre, ne peuvent avoir un avis neutre sur le sujet?
Réponse du 13/02/2014,
Réponse apportée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
La France s’est dotée d’un cadre législatif favorisant la transparence dans le domaine du nucléaire et de plusieurs structures de concertation, d ‘information et de débat. Ainsi, des Commissions Locales d’information (CLI) ont été créées auprès des installations nucléaires. Elles sont chargées d’une mission générale de suivi, d’information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d’impact des installations nucléaires sur les personnes et l’environnement. Ces CLI sont regroupées en une Association Nationale des Comités et Commissions Locales d’Information (ANCCLI). Le Haut Comité pour la Transparence et l’Information sur la Sécurité Nucléaire (HCTISN) a été créé par la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (dite "loi TSN"). C’est une instance d’information, de concertation et de débat sur les risques liés aux activités nucléaires et l’impact de ces activités sur la santé des personnes, sur l’environnement et sur la sécurité nucléaire. De plus, la loi du 13 juin 2006 instaure un droit d’accès à l’information en matière nucléaire directement auprès des exploitants, qui permet à tout un chacun de s’informer.
Concernant le projet Cigéo, le débat public est une étape essentielle permettant de recueillir les avis, propositions et contributions de l’ensemble des citoyens sur le projet.
QUESTION 1488
Posée par Jean-Dominique BOUTIN, le 14/01/2014
Questions posées dans le cahier d'acteurs n°107 de M. Jean-Dominique Boutin : Au sein du PNGMDR, il apparait peu d'adhésion des producteurs de déchets radioactifs que sont AREVA, EDF et CEA, au projet. Certes ils seront "obligés" de déposer leurs déchets-matières en ce lieu. Mais avec quelle autorité, quel mode de dérogations et surtout quels recours juridiques en cas de refus? Le PNGMDR démontre que l'inventaire des déchets n'est pas abouti. Quel stockage réel faut-il prévoir? Arrêt ou non? Prolongement à 30, 40 ou 50 ans des réacteurs? On parle de souplesse : quis? In "Les essentiels", l'Andra s'interroge elle-même, sur cet état de fait. Comment pouvoir conclure? A supposer que le projet soit acté, quel sera le dimensionnement exact au vu de ces incertitudes chiffrées? Prévoir des extensions incertaines? Des annexes moins qualifiées? Des "avenants" d'opportunités? L'origine française exclusive des déchets semblait actée. Or, un précédent "ridicule" mais fâcheux vient d'apparaitre : la gestion des déchets monégasques serait acceptée sur le territoire national. N'est-ce pas la porte ouverte à des produits d'origines diverses? L'argumentation est déjà audible : entrée de devises, amortissement de l'installation, "notoriété" de la filière nucléaire française, sans entrer dans des considérations plus polémiques? L'Europe et ses directives n'obligeront-elles pas à "l'ouverture du marché"? La France pourrait-elle s'opposer à une telloe "obligation"?
Réponse du 11/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
A propos de l’inventaire considéré par l’Andra
Le projet de stockage profond Cigéo est conçu pour mettre en sécurité définitive les déchets dont le niveau de radioactivité et la durée de vie ne permettent pas de les stocker, de manière sûre à long terme, en surface ou à faible profondeur. L’inventaire détaillé des déchets radioactifs susceptibles d’être stockés dans Cigéo a été établi en lien avec les producteurs de déchets. Le document est disponible sur le site du débat public : ../docs/rapport-etude/dechets-pris-en-compte-dans-etudes-conception-cigeo.pdf.
Les déchets concernés proviennent principalement du secteur de l’industrie électronucléaire et des activités de recherche associées ainsi que, dans une moindre part, des activités liées à la Défense nationale. Les déchets vitrifiés dits de « haute activité » (HA) correspondent principalement aux résidus hautement radioactifs issus du traitement des combustibles nucléaires usés utilisés pour la production d’électricité. Les déchets dits de « moyenne activité à vie longue » (MA-VL) ont des origines variées : résidus issus du traitement des combustibles nucléaires usés et de la fabrication de certains combustibles, composants (hors combustible) ayant séjournés dans les réacteurs nucléaires, déchets technologiques issus de la maintenance des installations nucléaires, de laboratoires, d’installations liées à la Défense nationale, du démantèlement...
Cigéo est conçu pour prendre en charge les déchets produits par les installations nucléaires existantes. Les volumes de déchets HA et MA-VL sont estimés à environ 10 000 m3 pour les déchets HA (soit environ 60 000 colis de déchets) et environ 70 000 m3 pour les déchets MA-VL (soit environ 180 000 colis de déchets) dans l’hypothèse d’une poursuite de la production électronucléaire* et d’une durée de fonctionnement des installations nucléaires existantes de 50 ans. Dans cette hypothèse, 30 % des déchets HA et 60 % des déchets MA-VL sont déjà produits. Par précaution, des volumes supplémentaires (environ 20 % du volume de déchets MA-VL à stocker) sont prévus en réserve dans Cigéo pour certains déchets de faible activité à vie longue qui, le cas échéant, ne pourraient pas être stockés dans le stockage à faible profondeur à l’étude par l’Andra.
Cigéo est conçu pour être flexible afin de pouvoir s’adapter à d’éventuels changements de la politique énergétique. En cas d’arrêt de la production électronucléaire et d’arrêt du traitement des combustibles nucléaires usés, l’inventaire des déchets de haute activité à stocker serait alors d’environ 20 000 colis de déchets vitrifiés (suite à l’arrêt du traitement) et 57 000 assemblages de combustibles usés (selon les hypothèses présentées au chapitre 1 du dossier du maître d’ouvrage ../docs/dmo/chapitres/DMO-Andra-chapitre-1.pdf). A la demande du Ministère en charge de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, l’Andra, EDF et Areva ont étudié l’impact des différents scénarios établis dans le cadre du débat national sur la transition énergétique sur la production de déchets radioactifs et sur le projet Cigéo : ../docs/rapport-etude/20130705-courrier-ministere-ecologie.pdf
* Les déchets produits par un éventuel futur parc de réacteurs ne sont pas pris en compte.
A propos des déchets étrangers dans Cigéo
Depuis la loi de 1991, le Parlement a interdit le stockage en France de déchets radioactifs en provenance de l’étranger. Cette interdiction figure aujourd’hui à l’article L. 542-2 du Code de l’environnement. Cette législation est cohérente avec la directive européenne du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre des combustibles usés et des déchets radioactifs, qui réaffirme la responsabilité de chaque État dans la gestion de ses déchets radioactifs.
Toutefois, ainsi que cela est indiqué en page 14 du rapport réalisé par le HCTISN pour le débat public de Cigéo (../docs/docs-complementaires/docs-avis-autorites-controle-evaluations/rapport-hctisn-gt-cigeo.pdf), certains contrats de traitement de combustibles usés passés dans les années 1970 avec des pays étrangers ne prévoyaient pas de clause de retour des déchets issus du traitement. Ces déchets représentent un volume limité. Ils ont été pris en compte pour établir l’inventaire prévisionnel du projet Cigéo. Depuis 1980, les contrats de traitement de combustibles usés étrangers prévoient systématiquement le renvoi des déchets issus du traitement dans le pays d’origine.
A propos du cas des déchets monégasques
Compte-tenu de l’exigüité particulière de son territoire, enclavée sur le territoire français, la Principauté de Monaco n’est pas en mesure de se doter d’un centre de stockage satisfaisant sur le plan des normes de sécurité et de sûreté. La loi française n° 2013-580 du 4 juillet 2013 autorise l’introduction d’une exception à l’article 8 de la loi du 28 juin 2006 interdisant le stockage de déchets radioactifs en provenance de l’étranger. Elle autorise le Gouvernement à mettre en œuvre un accord signé entre la France et Monaco en novembre 2010. Cet accord ne concerne qu'un volume très limité de déchets TFA, FMA et FA-VL (une très petite quantité de sels de radium), soit environ 165 kg par an. Ces déchets sont tous produits dans le cadre d'activités médicales ou de recherche. L’accord entre la France et la principauté de Monaco ne constitue pas pour autant une obligation car la France peut refuser les déchets produits aux conditions qu’elle définit : toute prise en charge de déchets radioactifs monégasques est soumise au préalable à une autorisation des autorités françaises et doit respecter les spécifications définies par l’Andra.
Cet accord, à caractère exceptionnel, traduit la relation d’amitié particulière qu’entretiennent la France et la Principauté de Monaco, marquée par une proximité et un esprit de confiance exemplaire et unies dans une « communauté de destin ».
QUESTION 1487
Posée par Jean-Dominique BOUTIN, le 14/01/2014
Questions posées dans le cahier d'acteurs n°107 de M. Jean-Dominique Boutin : Les appréciations tomographiques de la microfissuration par l'IRSN démontrent que toutes autres méthodes sont insuffisantes. Ces technicités semblent ignorées à Bure. Comment dès lors assurer qu'il n'existe pas de fissuration si on n'utilise pas la méthode la plus performante pour la déceler? Le site serait d'une grande homogénéité de matériaux. Or, en qualifiant LA strate du Callovo-oxfordien on affirme le contraire : deux strates distinguées ne puvent pas être "homogènes". La réponse fournie semble prouver le contraire. Sur le site du labo, peut-être, mais latéralement l'incertitude de la continuité des faciés latéraux n'est-elle pas à craindre? Faut-il commenter l'information récurrente de l'Andra convcernant l'absence de ressources géothermiques des trates inférieures s'opposant ainsi fortement aux connaissances des organismes ad hoc et notamment de notre expert national, le BRGM? Erreur d'appréciation ou mensonge avéré? Dans les deux cas, il y a une véritable dépréciation de la chose géologique insinuant un doute majeur sur les autres affirmations. Géologiquement, si le site semble présenter des capacités de haut niveau, de grands flous persistent ne permettant pas de conclure à la faisabilité. Les aléas naturels de grande ampleur doivent inciter à plus de méfiance et à une capacité d'adaptation au fil du temps. Par eilleurs, combien de géologues sur la question? Quel regard pluraliste sur le site (Cf cahier d'acteurs scandinaves? sur la sismicité)? Quelle indépendance des chercheurs dédiés? Après manipulation, le foisonnement naturel, caractéristique des marnes, laisse perplexe sur le retour de la qualité première. Insuffisament technicien pour juger pleinement des technologies retenues, je considère que l'aléa géotechnique est majeur par le fait que l'aléa naturaliste est inimaginable. Les évènements japonais l'ont rappelé, hélas! Impossible d'envisager toutes les "anormalités" du milieu naturel : les roches, trop souvent qualifiées d'"inertes", n'échappent pas au concept "positif" de biodiversité. Pour preuve, les réflexions non unanimes sur les diagénèses éventuelles. Quant aux scellements proposés seront-ils jamais validés? Induration liée à un "cuisson" des argiles par la chaleur dégagée? Fragilisation face aux petits mouvements déjà enregistrés dans les cavités réalisées? Cette fissuration "tardive" est sous-évaluée. Les technologies utilisées innovantes, semblent aller dans le bon sens, mais aucune certitude ne peut s'en dégager. D'ailleurs le concept même d'"innovation" suffit pour affirmer qu'aucune technologie éprouvée ne répond à la question posée. Peut-on dès lors engager autant de responsabilités pour le futur?
Réponse du 13/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Concernant les propriétés de la couche argileuse :
Afin de reconnaitre de manière précise la structure multicouche du milieu géologique sur la zone d’implantation de Cigéo (ZIRA – 37 km²), l’Andra a mis en œuvre en 2010 une sismique réflexion haute-résolution 3D: cette méthode qui permet de détecter des failles présentant un décalage vertical faible (supérieur à quelques mètres) n’a détecté aucune faille de cette dimension, ni dans la couche du Callovo-Oxfordien, ni dans ses encaissants carbonatés de l’Oxfordien et du Dogger. Une sismique 3D menée sur le site du laboratoire souterrain de Bure avait conduit au même constat. L’analyse avait été confortée par des forages déviés réalisés à l’aplomb du site du laboratoire souterrain : traversant la couche du Callovo-Oxfordien (longueur totale de carotte : 1478 m) avec une trajectoire sub-horizontales ces forages n’ont rencontré aucune fracture traversant la couche.
La méthode de tomographie a été mise en œuvre dans le laboratoire souterrain afin de caractériser la fracturation autour des galeries expérimentales ; aucune structure naturelle de type micro-fracture entre les galeries du laboratoire n’a été observée.
La couche du Callovo-Oxfordien présente une variation litho-stratigraphique verticale, avec au toit un facies plus carbonaté et ailleurs, notamment à la profondeur où serait implanté Cigéo, un facies argileux. Les forages et les interprétations des données sismiques ont montré que l’on retrouve cette organisation de facies aux échelles de la ZIRA et de la zone de transposition. Les mesures des paramètres de transfert des solutés en verticale et en latéral montrent leur faible variation soulignant le caractère globalement homogène de la couche du point de vue des propriétés de transfert.
Concernant le potentiel géothermique du site :
L’Andra n’a jamais nié le potentiel géothermique du site étudié. Comme partout ailleurs en France, la géothermie dite de surface (qui permet d’alimenter des maisons individuelles et des immeubles collectifs ou tertiaires via des pompes à chaleur) est réalisable localement. L’exploitation de ces ressources en surface ne serait d’ailleurs pas incompatible avec Cigéo, même au droit des installations souterraines de Cigéo, qui seraient situées à 500 mètres de profondeur.
Les études et les conclusions de l’Andra portent sur le potentiel géothermique profond du site mesuré grâce à un forage à 2000 mètres de profondeur dans les grès du Trias (Forage EST 433, Montiers-sur-Saulx) réalisé lors d’une campagne de reconnaissance menée en 2007-2008. Les caractéristiques habituellement recherchées pour déterminer s’il existe un potentiel géothermique (salinité, température et productivité) ont été mesurées. Il en ressort que le sous-sol dans la zone étudiée pour l’implantation de Cigéo ne présente pas un caractère exceptionnel en tant que ressource potentielle pour une exploitation géothermique profonde. Dans son rapport n°4 de juin 2010, la CNE aboutit aux mêmes conclusions : « Le trias de la région de Bure ne représente pas une ressource géothermique potentielle attractive dans les conditions technologiques et économiques actuelles. »
Par ailleurs, même si le sous-sol de Bure ne présente aucun caractère exceptionnel, il est tout à fait possible de réaliser des projets de géothermie profonde dans la région en dehors de l’installation souterraine de Cigéo (qui serait implantée à l’intérieur d’une zone de 30 km²). Par précaution, l’Andra a tout de même envisagé que l’on puisse exploiter le sous-sol au niveau du stockage et qu’une intrusion puisse avoir lieu. Les analyses ont montré que même dans ce cas, le stockage conserverait de bonnes capacités de confinement. Comme dans le dossier 2005, l’Andra présentera dans le dossier de demande d’autorisation de création de tels scénarios d’intrusion, incluant des doublets de forage comme ceux pratiqués pour l’exploitation de la géothermie.
Concernant la fiabilité des études :
Les recherches menées depuis 1994 sur le site étudié en Meuse/Haute-Marne ont permis aux scientifiques de reconstituer de manière détaillée son histoire géologique, depuis plus de 150 millions d’années. Le site étudié se situe dans la partie Est du bassin de Paris qui constitue un domaine géologiquement simple, avec une succession de couches de calcaires, de marnes et de roches argileuses qui se sont déposées dans d’anciens océans. Les couches de terrain ont une géométrie simple et régulière. Cette zone géologique est stable et caractérisée par une très faible sismicité. La couche argileuse étudiée pour l’implantation éventuelle du stockage, qui s’est déposée il y a environ 155 millions d’années, est homogène sur une grande surface et son épaisseur est importante (plus de 130 mètres).
Aucune faille affectant cette couche n’a été mise en évidence sur la zone étudiée.
Cette analyse s’appuie sur des investigations géologiques approfondies : plus de 40 forages profonds ont été réalisés, complétés par l’analyse de plus de 300 kilomètres de géophysique 2D et de 35 km² de géophysique 3D. Environ 50 000 échantillons de roche ont été prélevés.
La roche argileuse a une perméabilité très faible, ce qui limite fortement les circulations d’eau à travers la couche et s’oppose au transport éventuel des radionucléides par convection (c’est-à-dire par l’entraînement de l’eau en mouvement). Cette très faible perméabilité s’explique par la nature argileuse, la finesse et le très petit rayon des pores de la roche (inférieur à 1/10 de micron). L’observation de la distribution dans la couche d’argile des éléments les plus mobiles comme le chlore ou l’hélium confirme qu’ils se déplacent majoritairement par diffusion et non par convection. Cette « expérimentation », à l’œuvre depuis des millions d’années, confirme que le transport des éléments chimiques se fait très lentement (plusieurs centaines de milliers d’années pour traverser la couche). Les études menées par l’Andra ont montré que l’impact du stockage serait nettement inférieur à celui de la radioactivité naturelle à l’échelle du million d’années.
L’ensemble de ces travaux font l’objet de publications dans des revues à comités de lecture (50 à 70 publications scientifiques internationales par an depuis 10 ans) et sont évalués par des instances indépendantes, en particulier la Commission nationale d’évaluation, mise en place par le Parlement, et l’Autorité de sûreté nucléaire qui s’appuie sur l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Les grands dossiers scientifiques et techniques que l’Andra remet dans le cadre de la loi font l’objet, à la demande de l’Etat, de revues internationales sous l’égide de l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’OCDE. L’Andra a également été évaluée en 2012 par l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES). Enfin, des expertises sont régulièrement commandées par le Comité local d’information et de suivi du Laboratoire souterrain sur les grands dossiers de l’Andra ou sur des sujets plus ciblés.
Dans son cahier d’acteur (n°150), l’association SGF (Société Géologique de France), qui réunit 1 400 membres issus des milieux académiques et professionnels, a souhaité apporter son éclairage au débat public, suite à une consultation de ses membres. Elle considère ainsi que, dans l’état des connaissances scientifiques actuelles, l’option du stockage géologique profond réversible de déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue est, sur le plan technique, le moyen le plus sûr et le mieux adapté pour gérer ces éléments. Elle souligne la nécessité de mettre en place une surveillance géologique du site à une large échelle, de poursuivre des programmes de recherche, enrichis par les observations du suivi, pour réduire sans cesse les incertitudes et minimiser les risques et de pérenniser des filières de formation permettant d’accéder aux compétences nécessaires à la sûreté du site de stockage et à ses impacts sur l’environnement.
Concernant les études menés sur les scellements :
Conformément à la demande des évaluateurs, l’Andra met en œuvre un programme d’essais pour apporter les éléments nécessaires à la démonstration de la faisabilité industrielle des scellements. En particulier, l’essai FSS (Full Scale Seal) vise à démontrer d’ici 2015 les modalités de construction d’un noyau à base d’argile gonflante et de massifs d’appui en béton en conditions opérationnelles. La qualité de réalisation de l’ouvrage est contrôlée. Le diamètre utile de l’ouvrage considéré est de 7,60 m environ. Compte tenu des contraintes opérationnelles que représente un ouvrage d’une telle taille, l’essai est réalisé en surface dans une « structure d’accueil » construite à cet effet. Des conditions de température et d’hygrométrie représentatives des conditions du stockage sont maintenues autour de l’essai et les conditions qui seraient induites par la réalisation d’un scellement en souterrain sont appliquées (ventilation et délai de transport du béton notamment) pour que cet essai soit représentatif des conditions de Cigéo. Les interfaces avec le revêtement laissé en place et les argilites dans les zones de dépose du revêtement sont représentées par des simulations d’alternances de portions de revêtement maintenues et déposées et de hors-profils (jusqu’à 1 m de profondeur) avec une surface représentative de la texture de l’argilite. Des massifs de confinement en béton bas pH sont également construits de part et d’autre du noyau avec deux méthodes distinctes (béton coulé et béton projeté). Cet essai fait partie du projet européen DOPAS (Demonstration Of Plugs And Seals) qui réunit quatorze organisations issues de huit pays européens et teste quatre concepts de scellement développés en Finlande, en Suède, en République Tchèque et en France.
QUESTION 1486
Posée par Madeleine CORRE (PLOURIN-LES-MORLAIX), le 14/01/2014
Questions posées dans le cahier d'acteurs n°134 de Mme Madeleine Corre : Comment croire les concepteurs d'ASSE et de Cigéo quand ils affriment qu'une infiltration d'eau, voire une inondation est impossible? Ce n'est pas parce que argile et sel sont stables depuis des millions d'années qu'il ne peut pas y avoir des mouvements de terrain et des infiltrations d'eau. L'inondation possible, pourquoi aucun processus pour lutter contre l'inondation, et pour y remédier n'est prévu? Le coffre fort de sel d'ASSE devait être étanche pour des milliers de siècles. Or, il y a eu infiltrations de 12.000 litres/par jour au bout de 15 années. Qu'en sera t-il à Bure où le stockage est pris en sandwich entre deux immenses réservoirs d'eau? Il y a obligation de garantie pour le futur. Comment les ingénieurs peuvent-ils certifier que leurs recherches aboutiront à coup sûr, alors que rien ne permet de le garantir? Sans vouloir comparer la vitesse de migration des radionucléides dans le sel et dans l'argilite, donc le nombre d'années au bout desquelles la radioactivités atteindra la biosphère, se pose le problème des normes d'acceptabilité pour la santé. Quelles seront les normes dans 100.000 ans? Chacun sait qu'au vu des effets négatifs réguilièrement découverts de la radioactivité, ces normes (seuils) ont régulièrement été abaissées tout au long de ces dernières décennies. Et si dans 100.000 ans elles etaient abaissées au point de rendre inacceptable les résultats de la modélisation de l'Andra? Si un sérieuse arrivée d'eau devait se produire à Bure : Que ferait-on? Qui fabriquerait les robots, qui devront savoir nager pour aller rechercher des colos? Qui paierait? Qui serait responsable? Pourquoi ne pas reconnaître qu'à ASSE, ou bien on a menti, ou bien on s'est trompé? Et la question est transposable pour Bure. Alors, menti ou trompé? Les deux, lorsqu'on apprend que l'Andra est partie prenante dans le projet ASSE!
Réponse du 13/02/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
En aucun cas la mine de Asse en Allemagne ne peut être comparée au projet Cigéo. Le stockage à Asse a été réalisé au titre du droit minier et non des réglementations de la sûreté nucléaire telles qu’elles existent aujourd’hui. Il s’agit d’une ancienne mine de sel qui a été reconvertie en un stockage de déchets radioactifs en 1967. Lors du creusement de la mine, aucune précaution n’avait été prise pour préserver le confinement assuré par le milieu géologique. Le stockage n’avait pas non plus été conçu au départ pour être réversible. Les difficultés rencontrées aujourd’hui à Asse illustrent pleinement l’importance d’une démarche d’étude scientifique et d’évaluation préalablement à la décision de mettre en œuvre un projet de stockage.
Cigéo ne pourra être autorisé qu'après un long processus d’études et de recherches, initié il y a plus de 20 ans par la loi de 1991. Les phénomènes induits par le creusement du stockage sur la roche argileuse sont étudiés au moyen du Laboratoire souterrain. La réversibilité est prise en compte dès la conception du stockage et des essais ont été réalisés pour confirmer sa faisabilité. Des autorités indépendantes (Commission nationale d’évaluation, Autorité de sûreté nucléaire, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire…) contrôlent l’avancement du projet à chaque étape. Les acteurs locaux sont impliqués notamment au travers du Comité local d’information et de suivi qui s’appuie également sur des expertises indépendantes.
Si Cigéo est autorisé, il sera construit progressivement. L’Andra propose que des rendez-vous soient programmés régulièrement avec l’ensemble des acteurs (riverains, collectivités, évaluateurs, État…) pour contrôler le déroulement du stockage. Ces rendez-vous seront notamment alimentés par les résultats des réexamens périodiques de sûreté, conduits au moins tous les 10 ans par l’Autorité de sûreté nucléaire, et par la surveillance du stockage. Le premier de ces rendez-vous pourrait avoir lieu cinq ans après le démarrage du centre.
Concernant l’arrivée d’eau dans le stockage
De nombreuses mesures seront prises pour prévenir d’éventuelles arrivées d’eau accidentelles dans Cigéo :
- Protection des puits et de la descenderie contre les intempéries,
- Etanchéification des puits et des descenderies au niveau des couches de roche aquifères traversées au-dessus de la couche d’argilite,
- Systèmes de drainage des eaux issues des couches de roche supérieures peu productives et pompage de ces eaux jusqu’à la surface,
- Protection des canalisation d’eau interne et mécanismes de fermeture automatique en cas de rupture.
Ces dispositions sont largement éprouvées dans l’industrie minière.
Par précaution, des scénarios accidentels d’arrivées d’eau (par exemple suite à la défaillance d’une canalisation ou suite à une panne dans le système de drainage des eaux provenant des couches de roche supérieures) sont pris en compte dans les études de sûreté menées pour Cigéo, au même titre que pour n’importe quelle installation nucléaire. Compte tenu des origines possibles, ce débit sera nécessairement limité (pour mémoire le débit drainé par chacun des puits du Laboratoire souterrain est de l’ordre de 10 m3/jour en moyenne, ou moins, ce qui est très faible par comparaison à certains sites miniers). Un tel évènement resterait très localisé dans le stockage et n’aurait qu’un effet très limité sur l’argile qui sera protégée par les revêtements. En tout état de cause, ce type d’incident ne remettra pas en cause la sûreté du stockage .
Concernant l’évolution des normes
La réglementation impose aux installations nucléaires de ne pas dépasser la norme de 1 mSv par an pour l’impact que pourraient engendrer leurs rejets sur la population. L’Autorité de sûreté nucléaire impose au stockage profond un seuil de 0,25 mSV par an, soit un quart de cette norme réglementaire. Si les normes réglementaires sont susceptibles d’évoluer, la comparaison à l’irradiation d’origine naturelle (2,5 mSv en moyenne en France, soit dix fois plus que la valeur applicable à Cigéo) restera quant à elle toujours pertinente.
La couche d’argile très peu perméable, de plus de 130 mètres d’épaisseur, dans laquelle serait installé le stockage souterrain à 500 mètres de profondeur s’il est autorisé, servira de barrière naturelle pour retenir les radionucléides contenus dans les déchets et freiner leur déplacement. Le stockage permettra ainsi de garantir leur confinement sur de très longues échelles de temps. Seuls quelques-uns de ces radionucléides, les plus mobiles et dont la durée de vie est longue, pourront migrer jusqu’aux limites de la couche argileuse - de manière très étalée dans le temps (plus d’une centaine de milliers d’années) - et atteindre en quantités extrêmement faibles les couches géologiques situées au-dessus et en-dessous de l’argile et dans lesquelles l’eau peut circuler. Dans son évaluation d’impact sur l’homme et l’environnement à long terme, l’Andra suppose que les eaux de ces couches pourraient être captées par forage et utilisées pour des usages du type de ceux qui peuvent être pratiqués aujourd’hui (jardin, boisson, abreuvement des animaux). Les études montrent que même dans ce cas, l’impact du stockage reste inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire et ne présente pas de risque pour la santé.
QUESTION 1485
Posée par Emmanuelle BORDON (JOSSELIN), le 14/01/2014
Questions posées dans le cahier d'acteurs n°130 d'Emmanuelle Bordon : Qui voudra boire de l'eau issue d'un sol dans lequel sont enterrés des déchets radioactifs? Qui voudra consommer un produit provenant d'un endroit où on manipule et concerve des matières radioactives?
Réponse du 27/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
Sur le long terme, la couche d’argile dans laquelle est implantée le stockage garantit l’éloignement des déchets radioactifs de la surface. Seuls quelques radionucléides mobiles et dont la durée de vie est longue pourront migrer jusqu’aux limites de la couche d’argile qu’ils atteindront après plusieurs dizaines de milliers d’années, puis potentiellement atteindre en quantités extrêmement faibles ensuite la surface et les nappes phréatiques, après plus de 100 000 ans. Leur impact radiologique serait alors plusieurs dizaines de fois inférieur à la radioactivité naturelle.
QUESTION 1484
Posée par Emmanuelle BORDON (JOSSELIN), le 14/01/2014
Questions posées dans le cahier d'acteurs n°130 d'Emmanuelle Bordon : Quelles solutions de réinstallation prévues pour les agriculteurs qui, forcément, seront expropriés? Quelles compensations financières pour eux? Quelles compensations en termes de surfaces agricoles? Quelles mesures préventives, quelles compensations ont été prévues pour les producteurs, les transformateurs, les maisons de Champagne, toute la filière de l'AOC Champagne?
Réponse du 27/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
En tant qu’exploitant de Cigéo, si celui-ci est autorisé, l’Andra devra être propriétaire des terrains où seraient implantées les installations de surface du Centre et où seraient aménagées les voies d’accès nécessaires. L’Andra est consciente que cette obligation pourrait engendrer la disparition ou la déstructuration d’exploitations agricoles. Afin d’éviter toute expropriation, l’Andra a engagé des acquisitions foncières en Meuse et en Haute-Marne (exploitations, terres agricoles et terrains boisés) lui permettant de constituer une réserve pour procéder à des échanges (par des actes notariés ou par des actes administratifs amiables) ou pour restructurer les exploitations concernées si besoin. Cette démarche a déjà été conduite pour la construction du Centre industriel de regroupement, d’entreposage et de stockage (Cires) ouvert dans l'Aube en août 2003. Ce système avait correctement fonctionné et permis d'obtenir les terrains nécessaires par de simples actes de ventes ou d'échanges.
Afin de ne pas remettre en cause la viabilité des exploitations et proposer des modalités appropriées, l’Andra sera d’autant plus vigilante concernant les élevages dont les contraintes sont les plus fortes (notamment en ce qui concerne l’alimentation ou l’abreuvement des animaux). Rappelons également que l’emprise des installations de surface de Cigéo, occuperait environ 300 hectares, soit un peu plus que la superficie d’une exploitation agricole moyenne en Meuse, ce qui ne déstabilisera pas la production agricole locale. Concernant les prix, l’Andra achète systématiquement au prix du marché, ce qui est régulé et contrôlé par les Safer et France Domaine.
Cigéo est conçu pour protéger l’Homme et l’environnement. L’impact du centre en termes de radioactivité sera très inférieur à celui de la radioactivité naturelle et n’aura donc aucun impact sur la qualité des productions agricoles. L’Andra a créé l’Observatoire pérenne de l’environnement, qui a pour mission d’assurer un suivi détaillé de l’évolution de l’environnement du stockage. Cela permettra de lever ainsi toute inquiétude en démontrant que le stockage n’a pas d’impact sur les activités agricoles de proximité. Cet observatoire labellisé s’inscrit dans un grand nombre de réseaux scientifiques nationaux ou internationaux. Par ailleurs, le retour d’expérience de l’Andra sur l’implantation de ses installations depuis 20 ans, montre que la présence d’un centre de stockage de déchets radioactifs n’est en aucun cas incompatible, même en termes d’image, avec des activités agricoles de premier choix (lait, viande, légumes, viticulture...). L'industrie et l’agriculture ont toujours coexisté et de nombreuses installations industrielles y compris nucléaires sont installées en France à proximité de zones de production agricoles dont des zones géographiques protégées ou encore des zones d'appellation contrôlée.
QUESTION 1483
Posée par Jérôme DUMONT, le 14/01/2014
Question posée dans le cahier d'acteurs n°132 de M. Jérôme Dumont : Sur la réversibilité, évolution de la nature des déchets (la science a déjà montré par le passé que l'on pouvait réutiliser certains déchets et réduire ainsi les déchets ultimes. Qu'en sera-t-il à l'avenir car la recherche avance dans ce domaine?)
Réponse du 07/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les recherches menées depuis plus de 20 ans sur la transmutation montrent qu’elle ne supprime pas la nécessité d’un stockage profond car elle ne serait applicable qu’à certains radionucléides contenus dans les déchets, ceux de la famille de l’uranium, appelés actinides mineurs (américium, curium, neptunium). Par ailleurs, les installations nucléaires nécessaires à la mise en œuvre d’une telle technique produiraient des déchets qui nécessiteraient aussi d’être stockés en profondeur pour des raisons de sûreté. Fin 2012, le CEA a remis au Gouvernement un dossier sur les perspectives industrielles de cette technique. Ce dossier, ainsi que les avis de l’ASN et de la CNE sont consultables sur le site du débat public.
../informer/documents-complementaires/rapports-autorites-evaluations-ponctuelles.html
../informer/documents-complementaires/avis-autorites-controle-et-evaluations-permanentes.html
L’Andra est favorable à la poursuite des recherches sur les techniques de réduction des volumes et de la nocivité des déchets radioactifs. Dans ses propositions sur la réversibilité, l’Andra propose de faire régulièrement le point sur les résultats des recherches qui continueront à être menées sur la gestion des déchets radioactifs. Si les générations suivantes le souhaitent, elles pourront ainsi faire évoluer leur stratégie de gestion des déchets radioactifs, en fonction des avancées des recherches.
../docs/rapport-etude/fiche-reversibilite-cigeo.pdf
QUESTION 1482
Posée par Jérôme DUMONT, le 14/01/2014
Question posée dans le cahier d'acteurs n°132 de M. Jérôme Dumont : En quoi le projet Cigéo peut-il changer l'image de notre département et de notre région et contribuer à son développement économique?
Réponse du 30/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’Andra mène depuis plusieurs années une politique volontariste visant le développement des relations avec le tissu économique local. En 2011, les deux régions ont émis 10 % du montant total des facturations (HT) liées au projet Cigéo. Cela représente une collaboration avec plus de 250 établissements locaux (publics ou privés), implantés pour 60 % d’entre eux en Lorraine et 40 % en Champagne-Ardenne. Les départements de Meuse et de Haute-Marne regroupent chacun 30 % du total des établissements concernés.
Dans le cadre du projet Cigéo, des incitations à recruter localement seront demandées aux entreprises impliquées pendant la phase de construction du Centre tout en respectant les dispositions règlementaires de passation des marchés. Ainsi, au niveau de ses commandes et de ses contrats, l’Andra prévoit des règles d’équité sous forme de clauses destinées à juger de la valeur sociale des offres qui lui permettront notamment de prendre en compte le recours à l’emploi local et la formation des acteurs locaux.
Ces mesures ont déjà fait leurs preuves pour le Laboratoire souterrain et les Centres de l’Andra dans l’Aube. Leurs activités ont généré annuellement plusieurs millions d’euros de commandes à des entreprises locales (Meuse, Haute-Marne, Aube). En 2012, dans les Centres de l’Aube, plus de 35% des commandes ont été passées à des entreprises locales. Il en résulte que le nombre d’entreprises locales capables de travailler avec l’Andra à l’avenir augmente. La pratique montre également que les grands groupes qui répondent à nos appels d’offres ont souvent recours à des co-traitants, antennes ou filiales locaux.
Si Cigéo est autorisé, il constituera un projet industriel structurant pour le territoire. Entre 1 300 et 2 300 personnes travailleront à la construction des premières installations de Cigéo. Après la mise en service du Centre, entre 600 et 1 000 personnes travailleront de manière pérenne sur le site. Cigéo contribuera au développement de l’activité des entreprises locales et, grâce à la garantie d’une activité sur plus d’un siècle, certaines entreprises feront très vraisemblablement la démarche de s’implanter localement, créant à leur tour une activité nouvelle sur le territoire. A titre de comparaison, le Centre de l’Andra en Meuse/Haute-Marne (Laboratoire souterrain, Espace technologique, Carothèque, Observatoire pérenne de l’environnement, Ecothèque) comprend d’ores et déjà plus de 300 emplois directs.
On peut encore évoquer les deux groupements d’intérêt public qui ont été créés en Meuse et en Haute-Marne pour gérer les équipements de nature à favoriser et faciliter l’installation et l’exploitation du Laboratoire ou de Cigéo, pour mener des actions d’aménagement du territoire et de développement économique et pour soutenir les actions de formation et de diffusion des connaissances scientifiques et technologiques. Ils ont été dotés de 30 millions d’euros par département en 2012. Par ailleurs, EDF, le CEA et Areva mènent une politique active en faveur du développement local.
Le Gouvernement a également demandé l’élaboration d’un schéma de développement du territoire à l’échelle des deux départements de Meuse et de Haute-Marne. Ce schéma est élaboré sous l’égide du préfet de la Meuse, préfet coordinateur, en concertation avec les acteurs locaux (collectivités, chambres consulaires…). L’Andra et les entreprises de la filière nucléaire contribuent également à son élaboration. Il y est par exemple question de l’accueil des travailleurs. L’hébergement en structures provisoires à proximité du chantier, en gîtes ou en logements meublés est proposé parmi les services pouvant être mis à leur disposition. Le schéma permettra de coordonner les acteurs du logement pour mettre à disposition une offre locative adaptée aux besoins. Le retour d’expérience d’autres grands chantiers, tels que celui de Flamanville, pourra être approfondi pour veiller à mettre en œuvre des modalités d’accueil qui permettent des relations harmonieuses avec les riverains. Pour accéder à ce schéma : ../docs/docs-complementaires/docs-planification/SIDT-Final.pdf
Concernant votre questions sur l’image, sachez que le retour d’expérience de l’Andra sur l’implantation de ses installations depuis 20 ans, montre que la présence d’un centre de stockage de déchets radioactifs n’est en aucun cas incompatible, même en termes d’image, avec des activités agricoles de premier choix (lait, viande, légumes, viticulture...). L'industrie et l’agriculture ont toujours coexisté et de nombreuses installations industrielles y compris nucléaires sont installées en France à proximité de zones de production agricoles dont des zones géographiques protégées ou encore des zones d'appellation contrôlée.
QUESTION 1481
Posée par Nicolas LANGLOIS (SAINT-AMAND SUR ORNAIN), le 14/01/2014
Questions posées dans le cahier d'acteurs n°122 de M. Nicolas Langlois : La descenderie ne compromet-elle pas la mise en sécurité de l'acheminement du site par rapport à un puit vertical? De plus, la percée des couches géologiques sur une grande longueur ne va-t-elle pas compromettre le confirnement du stockage des déchets?
Réponse du 13/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Avant leur transfert en souterrain, les conteneurs de stockage de déchets radioactifs seront placés dans une hotte blindée assurant leur protection ainsi que celle des opérateurs pendant les opérations de transfert. Pour certains déchets, les masses à transférer seront importantes (plus de 100 tonnes).
Le transfert des hottes dans la descenderie sera réalisé au moyen d’un funiculaire. Ce type d’équipement, de haute fiabilité, dispose d’un large retour d’expérience dans le domaine du transport de personnes et la faisabilité industrielle du transfert de charges importantes par funiculaire est acquise.
Un transfert par puits vertical n’offrirait pas d’avantage en termes de sécurité ; en particulier le retour d’expérience de la manutention de charges aussi importantes dans des puits de grande hauteur est limité.
A l’issue de l’exploitation du stockage, les liaisons surface-fond (puits et descenderies) seront remblayées et scellées avec des massifs peu perméables en bentonite (argile gonflante) de façon à éviter que ces ouvrages ne constituent un court-circuit hydraulique. Les études ont montré que l’adoption de descenderies en complément des puits n’impacte pas la sûreté après fermeture du stockage.
QUESTION 1480
Posée par Gérard LACROIX (BOIS-DE-GAND), le 14/01/2014
Question posée dans le cahier d'acteurs n°121 de M. Gérard Lacroix : La protection à long terme des populations exposées aux conséquences des déchets qui seront enfouis à Bure suppose la constitution d'un ORDRE, DU GENRE MONASTIQUE, formé de spécialistes hautement qualifiés, chargés exclusivement de veiller, de surveiller, de protéger l'accès aux déchets engendrés par UNE SEULE GENERATION d'êtres humains dans notre pays! Quel serait le coût de cette structure? Nous ne pouvons pas demander à nos descendants d'assumer cette charge qui nous revient de droit !
Réponse du 27/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage. C’est une des raisons qui a conduit, en 2006, le Parlement à retenir la solution du stockage profond.
Malgré cette robustesse du stockage même en cas d’oubli, l’Andra conçoit Cigéo avec l’objectif d’en conserver la mémoire et de la transmettre aux générations futures le plus longtemps possible. Des solutions d’archivage de long terme existent pour les centres de stockage de surface exploités par l’Andra et font l’objet de revues périodiques. Le retour d’expérience montre que ces solutions paraissent robustes pour au moins les 500 premières années. Ainsi, pour Cigéo, l’Andra prévoit qu’un centre de la mémoire perdurera sur le site. Il pourra accueillir le public et comprendra notamment les archives du Centre.
De manière générale, le maintien de la mémoire doit aussi impliquer les acteurs locaux, qui peuvent prendre le relai en cas de défaillance de l’Andra ou de l’État. L’Andra veille d’ores et déjà à les informer sur les enjeux associés à la mémoire et étudie avec des anthropologues, des philosophes ou encore des artistes les facteurs qui peuvent favoriser la transmission de la mémoire. La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
L’Andra a lancé en 2010 un programme d’études pour proposer des outils qui rendent cette transmission plus robuste sur une échelle de temps millénaire. Des pistes se dessinent tels des marqueurs de surface, mais aussi des rendez-vous réguliers à mettre en place au niveau des populations locales.
En tout état de cause, comme il est impossible de garantir notre capacité à communiquer avec des êtres vivant dans plusieurs milliers d’années, c’est chaque génération qui aura la responsabilité de contribuer à transmettre cette mémoire aux générations suivantes.
QUESTION 1479
Posée par Gérard LACROIX (BOIS-DE-GAND), le 14/01/2014
Question posée dans le cahier d'acteurs n°121 de M. Gérard Lacroix : Sur le plan médical, un gramme de plutonium suffit, quelle que soit le "méthode" pour "tuer" à court, moyen et long terme 10.000 pesonnes, environ. Combien de tonnes de plutonium seront entassées à Bure? Faites le calcul !
Réponse du 13/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé.
Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
La connaissance des quantités des différents radionucléides qui seront présents au sein du stockage et de l’évolution de leur radioactivité permet d’évaluer l’impact du projet de centre de stockage et de vérifier sa conformité aux règles de sûreté fixées par l’Autorité de sûreté nucléaire. Ainsi, les données correspondant aux études de faisabilité réalisées par l’Andra en 2005 sont détaillées dans le « Dossier 2005 argile - Référentiel de connaissance et modèle d’inventaire des colis de déchets à haute activité et à vie longue » (voir notamment les pages 318 à 331 dans lesquelles des bilans globaux sont présentés). Cet inventaire radiologique sera mis à jour pour élaborer le dossier de demande d’autorisation de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 1478
Posée par Philippe PORTE (CHALONS-EN-CHAMPAGNE), le 13/01/2014
Questions posées dans le cahier d'acteurs n°113 de M. Philippe PORTE : Eau de Paris, dans sa communication et dans son action sur son site, est activement engagée dans une politique multiple de préservation de la ressource, avec la mise en valeur d'espaces naturels, avec le soutien d'une agriculture biologique pour préserver les zones de captages, avec une attention particulière aux emergences naturelles alimentées par la nappe de la craie présente jusqu'en Champagne. Pourquoi cette agence ne prend pas toute la mesure de la menace qui pèse sur le cinquième de l'alimentation en eau de l'agglomération parisienne? Pourquoi un projet présentant de tels risques et avec de tels impacts environnementaux, ne soit pas plus étudié, médiatisé, et interrogé par les franciliens?
Réponse du 11/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années et sont actuellement entreposés dans des bâtiments de surface situés en Normandie et dans la vallée du Rhône.
Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’Observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Cet observatoire labellisé s’inscrit dans un grand nombre de réseaux scientifiques nationaux ou internationaux. Les mesures réalisées permettront de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité et donc de démontrer l'absence d'impact du stockage sur les ressources en eau. Des mesures indépendantes pourront être diligentées par l’Autorité de sûreté nucléaire ou la Commission locale d’information pour confirmer les résultats.
QUESTION 1477
Posée par ASSOCIATION SERENES SEREINES ! (SANVENSA), le 13/01/2014
Questions posées dans le cahier d'acteurs n°114 de l'Association Serenes Sereines! : S'agit-il d'un projet de stockage ou y aura-t-il de l'entreposage de longue durée pour le refroidissement des colis? Est ce que les matières que devra accueillir Cigéo seront issues du retraitement ou bien est-il prévu de stocker des combustibles usés?
Réponse du 28/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
En réponse à votre première question
Dans l’hypothèse où Cigéo serait autorisé, les bâtiments de surface du Centre auront pour unique fonction l’accueil, la réception, le contrôle et la préparation des colis avant leur transfert vers l’installation souterraine. A ce stade des études, la durée moyenne de ces opérations pour un colis de déchet est estimée de l’ordre de 2 semaines.
Les installations réalisées sur Cigéo n’auront pas vocation à se substituer aux entreposages sur les sites des producteurs de déchets. Le refroidissement des déchets les plus chauds continuera ainsi à être réalisé à La Hague, où une extension de l’entrepôt accueillant les déchets vitrifiés vient d’être mise en service par Areva.
En réponse à votre seconde question
La nécessité de stocker des combustibles usés dépendra de la politique énergétique qui sera mise en œuvre par la France dans le futur.
Dans le cadre de la politique énergétique actuelle en France, les combustibles usés issus de la production électronucléaire ne sont pas considérés comme des déchets mais comme des matières pouvant être valorisées, notamment dans les réacteurs de quatrième génération. A ce titre, ils ne sont pas destinés à être stockés dans Cigéo. Seuls les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue, issus du traitement de combustibles usés, sont destinés à Cigéo.
Dans l’hypothèse où les combustibles usés devraient être stockés directement, après refroidissement, ils pourraient être stockés dans Cigéo, qui a été conçu pour être flexible afin de pouvoir s’adapter à d’éventuels changements de la politique énergétique et à ses conséquences sur la nature et les volumes de déchets qui devront alors être stockés. A la demande du Ministère en charge de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, l’Andra, EDF et Areva ont étudié l’impact des différents scénarios établis dans le cadre du débat national sur la transition énergétique sur la production de déchets radioactifs et sur le projet Cigéo : ../docs/rapport-etude/20130705-courrier-ministere-ecologie.pdf
La faisabilité de principe et la sûreté du stockage profond des combustibles usés ont par ailleurs été démontrées par l’Andra en 2005. Dans le cadre du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, l’État a demandé à l’Andra de vérifier par précaution que les concepts de stockage de Cigéo restent compatibles avec l’hypothèse d’un stockage direct de combustibles usés si ceux-ci étaient un jour considérés comme des déchets. L’Andra a remis fin 2012 un rapport d’étape. Dans l’hypothèse d’un stockage direct des combustibles usés, compte tenu du temps nécessaire de refroidissement, comme pour l’essentiel des déchets HA, leur stockage n’interviendrait pas avant l’horizon 2070/2080.
La nature et les quantités de déchets autorisés pour un stockage dans Cigéo seront fixées par le décret d’autorisation de création du centre. Toute évolution notable de cet inventaire devra faire l’objet d’un nouveau processus d’autorisation, comprenant notamment une enquête publique et un nouveau décret d’autorisation.
QUESTION 1476
Posée par Geoffroy MARX (VERDUN), le 30/01/2014
Question posée dans le cahier d'acteurs n°139 de M. Geoffroy Marx : Au regard du passé, comment l'Andra peut-elle s'engager sur le fait que la sécurité du site Cigéo sera toujours une priorité pour les régimes à venir?
Réponse du 06/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les déchets destinés à Cigéo resteront dangereux plusieurs dizaines de milliers d’années. C’est justement parce qu’on ne peut pas assurer la pérennité de notre société sur cette très longue échelle de temps que le Parlement a fait le choix du stockage profond comme solution de référence. En effet, l’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas de bouleversements au sein de la société ou d’oubli du site contrairement à l’entreposage. De plus du fait de son implantation à 500 mètres de profondeur le stockage sera peu vulnérable aux activités humaines.
Une surveillance du site pourra néanmoins être maintenue aussi longtemps que les générations futures le souhaiteront et des actions seront menées pour conserver et transmettre sa mémoire.
Pour que le projet puisse être autorisé, l’Andra doit démontrer à l’Autorité de sûreté nucléaire qu’elle maîtrise les risques liés à l’installation, que ce soit pendant son exploitation ou après sa fermeture. Ainsi, conformément au principe de défense en profondeur, tous les dangers potentiels qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation sont identifiés en amont de la conception. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels (dont ceux liés à une erreur humaine ou à des défaillances techniques) et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels montre que leurs conséquences resteraient limitées, et nettement en deçà des normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire.
QUESTION 1475
Posée par ASSOCIATION SERENES SEREINES ! (SANVENSA), le 13/01/2014
Question posée dans le cahier d'acteurs n°114 de l'Association Serenes Sereines ! : Centrer le débat sur les hypothétiques retombées économiques et le développement qui découleraient de Cigéo c'est le détourner de la question qui est sa raison d'être : A-t-on le droit de léguer un tel risque à nos descendants?
Réponse du 17/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’éthique et la responsabilité vis-à-vis des générations futures ont justement contribué à retenir le stockage profond.
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestions sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage en surface ou en sub-surface qui impliquerait pour les générations futures de renouveler périodiquement les bâtiments où sont placés ces déchets, de contrôler ces installations et de les maintenir.
Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs produits en France depuis plus d’un demi-siècle. Grâce à la réversibilité, ces générations garderont la possibilité de faire évoluer cette solution pendant au moins 100 ans. La fermeture du stockage leur permettra si elles le souhaitent de ne plus avoir à intervenir pour assurer la protection de l’homme et de l’environnement contre la dangerosité de ces déchets.
QUESTION 1474
Posée par A.V.E.N.I.R (AVIGNON), le 13/01/2014
Question posée dans le cahier d'acteurs n°117 de l'A.V.E.N.I.R : Qui sera responsable de Cigéo dans 100 ans, 1.000 ans, 10.000 ans, ... ?
Réponse du 17/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestions sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1473
Posée par A.V.E.N.I.R (AVIGNON), le 13/01/2014
Questions posées dans le cahier d'acteurs n°117 de l'A.V.E.N.I.R : L'étude d'impact social-économique indépendante sur la zone territoriale de Bure. Qui garantit que ce cimetière radioactif n'induira pas une désertification de la région, sans même attendre l'accident irréversible? L'étude d'impact en terme d'emplois. Qui peut garantir que Cigéo va créer plus d'emplois qu'il n'en détruira?
Réponse du 11/02/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
Non, Cigéo ne va pas induire une désertification de la région, au contraire si Cigéo est autorisé, il constituera un projet industriel structurant pour le territoire. Entre 1 300 et 2 300 personnes travailleront à la construction des premières installations de Cigéo. Après la mise en service du Centre, entre 600 et 1 000 personnes travailleront de manière pérenne sur le site. Cigéo contribuera au développement de l’activité des entreprises locales et, grâce à la garantie d’une activité sur plus d’un siècle, certaines entreprises feront très vraisemblablement la démarche de s’implanter localement, créant à leur tour une activité nouvelle sur le territoire. L’Andra mène depuis plusieurs années une politique volontariste visant le développement des relations avec le tissu économique local. En 2011, les deux régions ont émis 10 % du montant total des facturations (HT) liées au projet Cigéo. Cela représente une collaboration avec plus de 250 établissements locaux (publics ou privés), implantés pour 60 % d’entre eux en Lorraine et 40 % en Champagne-Ardenne. Les départements de Meuse et de Haute-Marne regroupent chacun 30 % du total des établissements concernés.
A titre d’illustration, observez les zones d'activité créées il y a moins de 20 ans sur les communes autour des centres de l’Andra dans l’Aube qui accueillent aujourd'hui plusieurs entreprises de secteurs d'activité variés et qui génèrent plusieurs dizaines d'emplois. Des entreprises se sont implantées et certaines ont pu et continuent à se développer en travaillant pour l'Andra dans les domaines du BTP, du génie civil, de la mécanique, de l'électricité, etc. Certaines entreprises nationales ont même fait le choix d'implanter des antennes ou bureaux localement.
QUESTION 1472
Posée par A.V.E.N.I.R (AVIGNON), le 13/01/2014
Question posée dans le cahier d'acteurs n°117 de l'A.V.E.N.I.R : Pourquoi un Débat Public en 2013 alors que le décret autorisant la construction du laboratoire de recherche de Bure a été signé en 2000?
Réponse du 30/01/2014,
le débat public n'a pas porté sur le laboratoire de recherche de BURE effectivement autorisé il y a de nombreuses années, mais sur le projet de centre indutriel de stockage Cigeo; ce projet, sera soumis après le débat public à une longue suite de procédures (avis de sureté avis scientifique, examen par le Parlement, avis des collectivités locales, enquête publique).
QUESTION 1471
Posée par Denis BAUPIN, Député de Paris (PARIS), le 13/01/2014
Question posée dans le cahier d'acteurs n°131 de M. Denis Baupin : A quoi cela sert-il de vider les silos de La Hague pour reconcentrer les risques en surface à Bure après avoir traversé une bonne moitié de la France? Non seulement cette solution est très onéreuse mais d'une efficience toute relative.
Réponse du 13/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La protection de l’homme et de l’environnement et la prise en compte des générations futures fondent la politique de gestion des déchets radioactifs définie par le Parlement. L’article L. 542-1 du code de l’environnement stipule ainsi :
« La gestion durable des matières et des déchets radioactifs de toute nature, résultant notamment de l’exploitation ou du démantèlement d’installations utilisant des sources ou des matières radioactives, est assurée dans le respect de la protection de la santé des personnes, de la sécurité et de l’environnement.
La recherche et la mise en œuvre des moyens nécessaires à la mise en sécurité définitive des déchets radioactifs sont entreprises afin de prévenir ou de limiter les charges qui seront supportées par les générations futures. »
Compte tenu de la durée pendant laquelle les déchets les plus radioactifs resteront dangereux (plusieurs centaines de milliers d’années), l’entreposage - qu’il soit en surface ou à faible profondeur - ne peut être qu’une solution provisoire dans l’attente d’une solution définitive. L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité de ces déchets. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à une installation d’entreposage.
Dans l’hypothèse où Cigéo serait autorisé, les bâtiments de surface du Centre auront pour unique fonction l’accueil, la réception, le contrôle et la préparation des colis avant leur transfert vers l’installation souterraine. Les capacités de ces bâtiments seront limitées pour répondre à ces besoins et n’auront pas vocation à se substituer aux bâtiments de surface présents sur les sites des producteurs de déchets, dont les capacités d’entreposage sont beaucoup plus importantes.
Le coût global du stockage couvre la mise en sécurité définitive de tous les déchets français de haute activité et de moyenne activité à vie longue, produits par les installations nucléaires françaises depuis les années 1960 et qui seront produits par les installations nucléaires actuelles jusqu’à leur démantèlement. Pour un nouveau réacteur nucléaire, sur l’ensemble de sa durée de fonctionnement, le coût du stockage des déchets radioactifs est de l’ordre de 1 à 2 % du coût total de la production d’électricité.
QUESTION 1470
Posée par Jean-Paul REGNIER (VAL D'ORNAIN), le 13/01/2014
Questions posées dans le cahier d'acteurs n°133 de M. Jean-Paul Regnier : La descenderie ne compromet-elle pas la mise en sécurité de l'acheminement du site par rapport à un puit vertical? De plus, la percée des couches géologiques sur une grande longueur ne va-t-elle pas compromettre le confinement du stockage des déchets?
Réponse du 13/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Avant leur transfert en souterrain, les conteneurs de stockage de déchets radioactifs seront placés dans une hotte blindée assurant leur protection ainsi que celle des opérateurs pendant les opérations de transfert. Pour certains déchets, les masses à transférer seront importantes (plus de 100 tonnes).
Le transfert des hottes dans la descenderie sera réalisé au moyen d’un funiculaire. Ce type d’équipement, de haute fiabilité, dispose d’un large retour d’expérience dans le domaine du transport de personnes et la faisabilité industrielle du transfert de charges importantes par funiculaire est acquise.
Un transfert par puits vertical n’offrirait pas d’avantage en termes de sécurité ; en particulier le retour d’expérience de la manutention de charges aussi importantes dans des puits de grande hauteur est limité.
A l’issue de l’exploitation du stockage, les liaisons surface-fond (puits et descenderies) seront remblayées et scellées avec des massifs peu perméables en bentonite (argile gonflante) de façon à éviter que ces ouvrages ne constituent un court-circuit hydraulique. Les études ont montré que l’adoption de descenderies en complément des puits n’impacte pas la sûreté après fermeture du stockage.
QUESTION 1469
Posée par A.P.P.E.L.S (LEROUVILLE), le 12/01/2014
Question posée dans le cahier d'acteurs n°110 d'A.P.P.E.L.S :
Trop de questions restent en suspens, comment peut-on garantir la protection de l'environnement (risques de pollution de l'air, de l'eau, des sols), la sécurité et la santé des personnes, l'image de marque des denrées agricoles dans ces conditions?
Réponse du 31/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
Enfin, cette surveillance permettra de lever ainsi toute inquiétude en démontrant que le stockage n’a pas d’impact sur les activités agricoles de proximité. Le retour d’expérience de l’Andra sur l’implantation de ses installations depuis 20 ans montre que la présence d’un centre de stockage de déchets radioactifs n’est en aucun cas incompatible, même en termes d’image, avec des activités agricoles de premier choix (lait, viande, légumes, viticulture...). L'industrie et l’agriculture ont toujours coexisté et de nombreuses installations industrielles y compris nucléaires sont installées en France à proximité de zones de production agricoles dont des zones géographiques protégées ou encore des zones d'appellation contrôlée.
QUESTION 1468
Posée par A.P.P.E.L.S (LEROUVILLE), le 12/01/2014
Questions posées dans le cahier d'acteurs n°110 d'A.P.P.E.L.S : Le projet de Bure est critiqué par les pays voisins, n'est-ce pas le moment de mutualiser nos moyens? La géothermie semble présente dans le sous-sol de Bure, l'Andra répond par un communiué de presse. Peut-on réellement exploiter une telle ressource sans nuire à la solidité du stockage?
Réponse du 30/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le projet de Bure est critiqué par les pays voisins, n'est-ce pas le moment de mutualiser nos moyens ?
Concernant les déchets des pays voisins, il convient de rappeler tout d’abord qu’aucun déchet étranger ne sera stocké dans Cigéo. Depuis la loi de 1991, le Parlement a interdit le stockage en France de déchets radioactifs en provenance de l’étranger. Cette interdiction figure aujourd’hui à l’article L. 542-2 du Code de l’environnement. Cette législation est cohérente avec la directive européenne du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre des combustibles usés et des déchets radioactifs, qui réaffirme la responsabilité de chaque État dans la gestion de ses déchets radioactifs.
Cependant, l’Andra est fortement impliquée dans des coopérations internationales, notamment avec ses homologues étrangers, au travers de collaborations ou d’instances internationales. 24 accords de R&D existent actuellement entre l’Andra et des partenaires étrangers et, dans le cadre du VIIe PCRD (Programme cadre de recherche et développement) de l’Union européenne, l’Andra a participé à 14 programmes européens. Par ailleurs, en 2009, en considérant que, d’ici 2025, les premiers stockages géologiques pour les combustibles usés et les déchets HA-MAVL seront en exploitation en Europe, la Communauté européenne a souhaité créer la plateforme technologique IGD-TP (Implementing Geological Disposal of radioactive waste Technological Platform) pour mobiliser les meilleures compétences (19 pays impliqués) et organiser leur coopération.
La géothermie semble présente dans le sous-sol de Bure, l'Andra répond par un communiqué de presse. Peut-on réellement exploiter une telle ressource sans nuire à la solidité du stockage ?
Comme partout ailleurs en France, la géothermie dite de surface (qui permet d’alimenter des maisons individuelles et des immeubles collectifs ou tertiaires via des pompes à chaleur) est réalisable localement. L’exploitation de ces ressources en surface ne serait d’ailleurs pas incompatible avec Cigéo, même au droit des installations souterraines de Cigéo, qui seraient situées à 500 mètres de profondeur.
La géothermie profonde nécessite des investissements importants et est aujourd’hui mise en œuvre dans les zones avec à la fois des conditions géologiques favorables et des perspectives d’utilisation importante de la chaleur extraite. Concernant les conditions géologiques, un forage à 2000 mètres de profondeur dans les grès du Trias (Forage EST 433, Montiers-sur-Saulx) a été réalisé lors d’une campagne de reconnaissance menée en 2007-2008 afin de mesurer le potentiel du site. Les caractéristiques habituellement recherchées pour déterminer s’il existe un potentiel géothermique (salinité, température et productivité) ont été mesurées. Il en ressort que le sous-sol dans la zone étudiée pour l’implantation de Cigéo ne présente pas un caractère exceptionnel en tant que ressource potentielle pour une exploitation géothermique profonde. Dans son rapport n°4 de juin 2010, la CNE aboutit aux mêmes conclusions : « Le trias de la région de Bure ne représente pas une ressource géothermique potentielle attractive dans les conditions technologiques et économiques actuelles. »
Par précaution, l’Andra a tout de même envisagé que l’on puisse exploiter le sous-sol au niveau du stockage et qu’une intrusion puisse avoir lieu. Les analyses ont montré que même dans ce cas, le stockage conserverait de bonnes capacités de confinement. Comme dans le dossier 2005, l’Andra présentera dans le dossier de demande d’autorisation de création de tels scénarios d’intrusion, incluant des doublets de forage comme ceux pratiqués pour l’exploitation de la géothermie.
Enfin, même si le sous-sol de Bure ne présente aucun caractère exceptionnel, il est tout à fait possible de réaliser des projets de géothermie profonde dans la région en dehors de l’installation souterraine de Cigéo (qui serait implantée à l’intérieur d’une zone de 30 km²).
QUESTION 1467
Posée par A.P.P.E.L.S (LEROUVILLE), le 12/01/2014
Questions posées dans le cahier d'acteurs n°110 d'A.P.P.E.L.S : Alors que Bure était déjà le seul site retenu dans les années 80/90, les conclusions du débat public de 2005 préconisant la mise en place d'un laboratoire d'études sur l'entreposage pérennisé en surface ou subsurface afin de comparer les avantages et inconvénients de cette alternative au stockage géologique profond, cela pour se donner le temps de mieux prendre en compte les considérations éthiques. Pourquoi cette éventualité a-t-elle été écartée de la loi de 2006? Enfouir, n'est-ce pas oublier trop facilement et nous "débarasser" d'une réalité trop visible?
Réponse du 27/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
Les résultats des 15 années de recherches menées sur la gestion des déchets les plus radioactifs dans le cadre de la loi « Bataille » de 1991 ont montré que :
- La séparation-transmutation ne supprime pas la nécessité d’un stockage profond car elle ne serait applicable qu’à certains radionucléides contenus dans les déchets (ceux de la famille de l’uranium, appelés les actinides mineurs). Par ailleurs, les installations nucléaires nécessaires à la mise en œuvre d’une telle technique produiraient des déchets qui nécessiteraient aussi d’être stockés en profondeur pour des raisons de sûreté.
- L’entreposage de longue durée, qu’il soit en surface ou en subsurface, ne peut assurer le confinement à long terme de la radioactivité. Il ne constitue donc pas une solution de gestion définitive et reporte la charge de la gestion des déchets radioactifs sur les générations futures. Dans son avis du 1er février 2006, l’Autorité de sûreté nucléaire a notamment appelé l’attention sur le fait que l’entreposage de longue durée supposerait le maintien d’un contrôle de la part de la société et la reprise des déchets par les générations futures, ce qui semble difficile à garantir sur des périodes de plusieurs centaines d’années.
- Le stockage profond permet de mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs. A l’inverse de l’entreposage, cette solution permet de mettre en place une protection pour le très long terme. Les générations suivantes auront la possibilité de contrôler sa mise en œuvre grâce à la réversibilité. Dans son avis du 1er février 2006, l’Autorité de sûreté nucléaire a estimé que des résultats majeurs relatifs à la faisabilité et à la sûreté d’un stockage avaient été acquis sur le site de Bure et a identifié les points à approfondir pour établir le dossier de sûreté qui serait à associer à une éventuelle demande de création d’une installation de stockage.
Dans le cadre de la loi de programme du 28 juin 2006, le Parlement a fait le choix de la solution du stockage profond pour mettre en sécurité définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter leur charge sur les générations futures. Le Parlement a demandé que le stockage soit réversible pendant au moins 100 ans pour laisser des choix aux générations suivantes. Cela leur permettra notamment de faire évoluer cette solution si elles le souhaitent (par exemple si des progrès scientifiques et technologiques futurs venaient à offrir de nouvelles possibilités). Le Parlement a demandé à l’Andra de poursuivre les études et recherches en vue de remettre en 2015 le dossier support à l’instruction de la demande d’autorisation de création du stockage.
Le Parlement a également décidé la poursuite des études et recherches sur l’entreposage et la séparation-transmutation, en complémentarité avec le stockage. Le bilan des études menées par l’Andra sur l’entreposage et par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives sur la séparation-transmutation sont disponibles sur le site du débat public :
../docs/decisions/Rapport-2012-Andra-entreposage.pdf
../docs/decisions/dossier-CESA-separ-transmut/Tome-2.pdf
QUESTION 1466
Posée par EUROPE ECOLOGIE LES VERTS (REIMS), le 12/01/2014
Questions posées dans le cahier d'acteurs n°116 d'Europe Ecologie Les Verts : Quelles entreprises gagneront les appels d'offre? On peut imaginer, au vu du coût prévisible de Cigéo (35 milliards à 200 milliards d'€, total estimé), que de nombreuses tâches seront externalisées et que les entreprises sous-traitantes les moins disantes gagneront les marchés qui échapperont alors aux entreprises locales ou même nationales. Comment croire à un eldorado économique alors que 200 millions d'euros ont déjà été distribués au département de la Haute-Marne (autant pour la Meuse) sans que l'on constate une amélioration significative? Dans cette perspective, combien d'emplois menacés? Comment expliquer que ce risque de dégradation de l'image ait été totalement occulté dans le schéma de développement territorial? "Dans un contexte de déprise démographique et de diminution des postes de travail, quelle sera la capacité du territoire à capitaliser sur les retombées économiques du projet alors même qu'il en subira les conséquences? Quel impact aura Cigéo en termes d'activités, d'emplois, d'accueil de population, d'infrastructures de transports et de mobilités, et quel impact également sur l'image du département?
Réponse du 06/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Pour mesurer l’impact que pourra avoir Cigéo sur l’activité de son territoire d’accueil, regardez ce qui se passe actuellement sur les territoires où l’Andra est déjà implantée. L’Andra mène depuis plusieurs années une politique volontariste visant le développement des relations avec le tissu économique local. En 2011, les deux régions ont émis 10 % du montant total des facturations (HT) liées au projet Cigéo. Cela représente une collaboration avec plus de 250 établissements locaux (publics ou privés), implantés pour 60 % d’entre eux en Lorraine et 40 % en Champagne-Ardenne. Les départements de Meuse et de Haute-Marne regroupent chacun 30 % du total des établissements concernés.
Dans le cadre du projet Cigéo, des incitations à recruter localement seront demandées aux entreprises impliquées pendant la phase de construction du Centre tout en respectant les dispositions règlementaires de passation des marchés. Ainsi, au niveau de ses commandes et de ses contrats, l’Andra prévoit des règles d’équité sous forme de clauses destinées à juger de la valeur sociale des offres qui lui permettront notamment de prendre en compte le recours à l’emploi local et la formation des acteurs locaux.
Ces mesures ont déjà fait leurs preuves pour le Laboratoire souterrain et les Centres de l’Andra dans l’Aube. Leurs activités ont généré annuellement plusieurs millions d’euros de commandes à des entreprises locales (Meuse, Haute-Marne, Aube). En 2012, dans les Centres de l’Aube, plus de 35% des commandes ont été passées à des entreprises locales. Il en résulte que le nombre d’entreprises locales capables de travailler avec l’Andra à l’avenir augmente. La pratique montre également que les grands groupes qui répondent à nos appels d’offres ont souvent recours à des co-traitants, antennes ou filiales locaux.
Si Cigéo est autorisé, il constituera un projet industriel structurant pour le territoire. Entre 1 300 et 2 300 personnes travailleront à la construction des premières installations de Cigéo. Après la mise en service du Centre, entre 600 et 1 000 personnes travailleront de manière pérenne sur le site. Cigéo contribuera au développement de l’activité des entreprises locales et, grâce à la garantie d’une activité sur plus d’un siècle, certaines entreprises feront très vraisemblablement la démarche de s’implanter localement, créant à leur tour une activité nouvelle sur le territoire. A titre de comparaison, le Centre de l’Andra en Meuse/Haute-Marne (Laboratoire souterrain, Espace technologique, Carothèque, Observatoire pérenne de l’environnement, Ecothèque) comprend d’ores et déjà plus de 300 emplois directs.
Le Gouvernement a également demandé l’élaboration d’un schéma de développement du territoire à l’échelle des deux départements de Meuse et de Haute-Marne. Ce schéma est élaboré sous l’égide du préfet de la Meuse, préfet coordinateur, en concertation avec les acteurs locaux (collectivités, chambres consulaires…). L’Andra et les entreprises de la filière nucléaire contribuent également à son élaboration. Il y est par exemple question de l’accueil des travailleurs. L’hébergement en structures provisoires à proximité du chantier, en gîtes ou en logements meublés est proposé parmi les services pouvant être mis à leur disposition. Le schéma permettra de coordonner les acteurs du logement pour mettre à disposition une offre locative adaptée aux besoins. Le retour d’expérience d’autres grands chantiers, tels que celui de Flamanville, pourra être approfondi pour veiller à mettre en œuvre des modalités d’accueil qui permettent des relations harmonieuses avec les riverains.
Pour accéder à ce schéma : ../docs/docs-complementaires/docs-planification/SIDT-Final.pdf
Concernant l’impact du projet sur l’image du territoire d’accueil, il convient de rappeler que Cigéo est conçu pour protéger l’Homme et l’environnement. L’impact du centre en termes de radioactivité sera très inférieur à celui de la radioactivité naturelle et n’aura donc aucun impact sur la qualité des productions agricoles. L’Andra a créé l’Observatoire pérenne de l’environnement, qui a pour mission d’assurer un suivi détaillé de l’évolution de l’environnement du stockage. Cela permettra de lever ainsi toute inquiétude en démontrant que le stockage n’a pas d’impact sur les activités agricoles de proximité. Cet observatoire labellisé s’inscrit dans un grand nombre de réseaux scientifiques nationaux ou internationaux. Par ailleurs, le retour d’expérience de l’Andra sur l’implantation de ses installations depuis 20 ans, montre que la présence d’un centre de stockage de déchets radioactifs n’est en aucun cas incompatible, même en termes d’image, avec des activités agricoles de premier choix (lait, viande, légumes, viticulture...). L'industrie et l’agriculture ont toujours coexisté et de nombreuses installations industrielles y compris nucléaires sont installées en France à proximité de zones de production agricoles dont des zones géographiques protégées ou encore des zones d'appellation contrôlée.
QUESTION 1465
Posée par Thierry DE LAROCHELAMBERT (BELFORT), le 11/01/2014
Question posée dans le cahier d'acteurs n°119 de M. Thierry De Larochelambert : Les colis vitrifiés HA émettent des isotopes radioactifs de gaz rares de fission (Kr, Xe) qui ne sont pas piégés chimiquement dans la matrice amorphe : quelle contamination l'accumulation de ces isotopes pourrait-elle induire dans les installations et la population?
Réponse du 06/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le krypton et xenon, gaz rares de fission présents au sein du combustible usé, sont libérés lors du traitement du combustible usé. Ils ne sont donc pas présents dans les déchets vitrifiés.
Les déchets vitrifiés dégagent uniquement de l’hélium issu des radionucléides émetteurs alpha qui reste piégé dans la matrice de verre dans laquelle ils sont conditionnés.
QUESTION 1464
Posée par Jacques LERAY (BEURVILLE), le 11/01/2014
Question posée dans le cahier d'acteurs n°120 de M. Jacques Leray : Dégradation du marché de l'immobilier, qui veut s'installer près de ces centres mortifères? Image du territoire dégradée comment expliquer à la population mondaile que le champagne n'est pas produit près de ces centres localisés en CHAMPAGNE?
Réponse du 10/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Contrairement à ce que vous pouvez penser, la présence des centres de stockage de l’Andra dans l’Aube ou dans la Manche a un effet positif sur l’activité locale, stimulant la construction ou la rénovation, permettant le maintien et le développement de services et la création d'emplois. Pour être convaincu de ce dernier point, il suffit de se rendre sur l'une ou l'autre des zones d'activité créées il y a moins de 20 ans sur les communes autour des centres de l’Andra dans l’Aube qui accueillent aujourd'hui plusieurs entreprises de secteurs d'activité variés et qui génèrent plusieurs dizaines d'emplois. Des entreprises se sont implantées et certaines ont pu et continuent à se développer en travaillant pour l'Andra dans les domaines du BTP, du génie civil, de la mécanique, de l'électricité, etc. Certaines entreprises nationales ont même fait le choix d'implanter des antennes ou bureaux localement.
Concernant l’impact du projet sur l’image du territoire d’accueil, il convient de rappeler que Cigéo est conçu pour protéger l’Homme et l’environnement. L’impact du centre en termes de radioactivité sera très inférieur à celui de la radioactivité naturelle et n’aura donc aucun impact sur la qualité des productions agricoles. L’Andra a créé l’Observatoire pérenne de l’environnement, qui a pour mission d’assurer un suivi détaillé de l’évolution de l’environnement du stockage. Cela permettra de lever ainsi toute inquiétude en démontrant que le stockage n’a pas d’impact sur les activités agricoles de proximité. Cet observatoire labellisé s’inscrit dans un grand nombre de réseaux scientifiques nationaux ou internationaux. Par ailleurs, le retour d’expérience de l’Andra sur l’implantation de ses installations depuis 20 ans, montre que la présence d’un centre de stockage de déchets radioactifs n’est en aucun cas incompatible, même en termes d’image, avec des activités agricoles de premier choix (lait, viande, légumes, viticulture...). L'industrie et l’agriculture ont toujours coexisté et de nombreuses installations industrielles y compris nucléaires sont installées en France à proximité de zones de production agricoles dont des zones géographiques protégées ou encore des zones d'appellation contrôlée.
QUESTION 1463
Posée par Jacques LERAY (BEURVILLE), le 11/01/2014
Question posée dans le cahier d'acteurs n°120 de M. Jacques Leray : Abrogation de la règle fondamentale RFS III.2.f du 01/06/1991 rédigée par l'Autorité de sûreté nucléaire, visant à sauvegarder des richesses du sous-sol (ici la Géothermie) remplacée par le guide de l'ASN du 12/02/2008 beaucup moins contraignant. Lois de 2006 autorisant les rejets de Soulaines qui en produisant impunément depuis son ouverture la Communauté de communes de Soulaines hors la loi sur le critère de seuil de population (Loi sur l'intercommunalité n°2010-1563 du 16 décembre 2010). Pourquoi cette exception alors que l'Andra prospecte sur ce territoire pour implanter le centre de stockage des déchets atomiques FAVL? Des critères de choix d'implantation des installations : faible densité de population, économiquement fragile, géologiquement compatible.
Réponse du 13/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’élaboration des guides de sûreté relève de la responsabilité de l’Autorité de sûreté nucléaire et la mise en œuvre de la loi sur l’intercommunalité des services de l’Etat.
Concernant les rejets du centre de stockage de surface exploité par l’Andra à Soulaines, nous souhaitons vous apporter les précisions suivantes :
- Le décret du 4 septembre 1989 autorisant la création du Centre spécifiait que l’installation devait être conçue afin de ne pas rejeter d’effluents radioactifs. Selon les normes alors en vigueur, une installation était considérée comme « sans rejets » si ses rejets étaient inférieurs à certaines valeurs, fixées par le Service central de protection contre les rayonnements ionisants du ministère de la santé (ce qui était le cas du Centre).
- En 1995, soit 6 ans après la création du Centre, un décret, pris en application de la loi sur l’eau de 1992, a entraîné une modification de la réglementation en matière de rejets radioactifs. Comme toute INB, l’Andra a établi une demande pour le Centre de stockage de Soulaines associée à une demande de modification du décret de création. Après enquêtes publiques, l’Autorité de sûreté nucléaire a fixé de nouvelles limites. Celles-ci sont inférieures aux limites établies lors de la création du Centre (divisée par 40 par exemple pour les rejets liquides de tritium).
- Depuis la mise en service du CSFMA en janvier 1992, les rejets du Centre ont toujours été bien inférieurs aux limites réglementaires, quelles que soient ces limites. Les mesures de surveillance effectuées par l’Andra permettent d’évaluer l’impact maximal que pourrait recevoir une personne séjournant en permanence à proximité du Centre, du fait des rejets. Cet impact est plus de 1000 fois inférieur à l’impact de la radioactivité naturelle.
La démarche d’implantation du projet FAVL se fonde d’une part sur les études et recherches qui visent à s’assurer que les conditions géologiques sont favorables et d’autre part sur la concertation avec les acteurs locaux. Ces démarches sont menées sous le contrôle de l’Etat et de l’Autorité de sûreté nucléaire.
QUESTION 1462
Posée par Emmanuelle BORDON (JOSSELIN), le 11/01/2014
Questions posées dans le cahier d'acteurs n°123 de Emmanuelle Bordon :
Comment avertir nos lointains descendants du danger potentiel qui se trouve dans ces déchets? Quelles précautions ont été prises pour prévenir les risques d'intruson à Bure? Même avec la meilleure volonté du monde aujourd'hui, qui peut être sûr qu'à la faveur d'un conflit violent, d'une crise économique grave ou d'un manque de volonté politique assorti d'une coupe budgétaire, ce conservatoire ne disparaitrait pas?
Réponse du 17/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage. C’est une des raisons qui a conduit, en 2006, le Parlement à retenir la solution du stockage profond.
Malgré cette robustesse du stockage même en cas d’oubli, l’Andra conçoit Cigéo avec l’objectif d’en conserver la mémoire et de la transmettre aux générations futures le plus longtemps possible. Des solutions d’archivage de long terme existent pour les centres de stockage de surface exploités par l’Andra et font l’objet de revues périodiques. Le retour d’expérience montre que ces solutions paraissent robustes pour au moins les 500 premières années. Ainsi, pour Cigéo, l’Andra prévoit qu’un centre de la mémoire perdurera sur le site. Il pourra accueillir le public et comprendra notamment les archives du Centre.
De manière générale, le maintien de la mémoire doit aussi impliquer les acteurs locaux, qui peuvent prendre le relai en cas de défaillance de l’Andra ou de l’État. L’Andra veille d’ores et déjà à les informer sur les enjeux associés à la mémoire et étudie avec des anthropologues, des philosophes ou encore des artistes les facteurs qui peuvent favoriser la transmission de la mémoire. La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
L’Andra a lancé en 2010 un programme d’études pour proposer des outils qui rendent cette transmission plus robuste sur une échelle de temps millénaire. Des pistes se dessinent tels des marqueurs de surface, mais aussi des rendez-vous réguliers à mettre en place au niveau des populations locales.
En tout état de cause, comme il est impossible de garantir notre capacité à communiquer avec des êtres vivant dans plusieurs milliers d’années, c’est chaque génération qui aura la responsabilité de contribuer à transmettre cette mémoire aux générations suivantes.
QUESTION 1461
Posée par Pierre BENOIT, le 23/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de M. Pierre BENOIT :
Le site dégagera des composés radioactifs volatils. Sont-ils quantifiés?
Réponse du 28/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Effectivement, comme présenté dans le Dossier du maître d’ouvrage page 57, Cigéo sera à l’origine de très faibles quantités de rejets radioactifs provenant pour la quasi-totalité d'émanation de carbone 14, tritium ou krypton 85 contenus dans certains colis de déchets de moyenne activité à vie longue (MA-VL). Ces rejets seront canalisés, mesurés et strictement contrôlés avant d’être relachés dans l'atmosphère.
L'Autorité de sûreté nucléaire fixera les limites autorisées pour ces rejets et en assurera un contrôle strict. Une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que leur impact serait de l’ordre de 0,01 milliSievert par an (mSv/an) à proximité du Centre, soit très largement inférieur à la norme règlementaire (1mSv/an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv/an en moyenne en France).
Ces rejets dureront uniquement le temps de l’exploitation du site. En effet, après la fermeture du stockage, les alvéoles dans lesquelles les déchets seront stockés auront été fermées et il n’y aura plus de rejets de ce type.
QUESTION 1460
Posée par EUROPE ECOLOGIE LES VERTS, le 23/12/2013
Questions posées dans le cahier d'acteurs d'Europe Ecologie Les Verts :
Comment serait-il alors envisageable de soutenir financièrement des investissements supplèmentaires pour construire le réseau complèmentaire nécessaire? Comment peut-on demander à une collectivité d'assumer des investissements sans lui demander son avis au départ, et sans l'impliquer?
Réponse du 31/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le réseau ferré existant est géré par Réseau Ferré de France (RFF). Les aménagement éventuels à réaliser sur ce réseau (renforcement des voies existantes…) pour les besoins du projet Cigéo ou d’autres activités relèvent de la maîtrise d’ouvrage de RFF.
S’il est décidé de créer un raccordement ferroviaire pour la desserte de Cigéo (d’environ 15 kilomètres), celui-ci serait réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de l’Andra et sa gestion serait ensuite assurée par l’Andra.
Les modalités de financement de ces aménagements sont à traiter dans le cadre du schéma interdépartemental de développement du territoire.
Ces investissements ne seront donc pas a la charge des collectivités
QUESTION 1459
Posée par EUROPE ECOLOGIE LES VERTS, le 23/12/2013
Questions posées dans le cahier d'acteurs d'Europe Ecologie Les Verts : Quelle cohérence entre des politiques publiques qui mettent des moyens dans le soutien à l'emploi, l'attractivité, l'environnement... d'un côté et un projet qui les compromettrait de l'autre? Où est la cohérence politique entre un Etat qui délègue des compétences aux collectivités sans même les associer ensuite aux décisions les impactant?
Réponse du 11/02/2014,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
La loi du 28 juin 2006 a fait le choix du stockage réversible profond pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations futures. C’est l’objectif premier du projet Cigéo.
Afin de favoriser l’insertion du projet Cigéo dans le territoire, un important travail de concertation a été mené par l’État, notamment avec les exécutifs locaux, pour élaborer un projet de schéma interdépartemental du territoire (SIDT). L’État entend associer étroitement les collectivités territoriales aux réflexions et aux décisions relatives au territoire, afin de préparer efficacement l’accueil du projet Cigéo. Afin de renforcer cette action au plus près des territoires, un sous-préfet vient d’être nommé auprès de la préfète de la Meuse, préfète coordonnatrice du projet.
QUESTION 1458
Posée par EUROPE ECOLOGIE LES VERTS, le 23/12/2013
Questions posées dans le cahier d'acteurs d'Europe Ecologie Les Verts : Quelle logique y-a-t-il à engager des recherches sur diverses soltuions, si en meêm temps, on autorise d'ores et déjà le stockage profond? Déni de démocratie, absence de réponses techniques solides...A ce jour, le débat focalise sur la question Cigéo. Qu'est-ce qui pousse à s'engager absolument et maintenant dans ce projet? Mais la question ici n'est pas "contruit-on ou non ce centre?" mais bien plus largement, que faisons-nous de nos déchets radioactifs?
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
On peut toujours remettre à demain ce que l’on pourrait commencer à faire aujourd’hui. Mais nos enfants pourraient nous reprocher de ne pas avoir préparé de solution pour gérer les déchets les plus radioactifs produits par les activités dont nous avons bénéficié au quotidien. De nombreuses solutions pour gérer les déchets radioactifs ont été imaginées depuis 50 ans : les envoyer dans l’espace, au fond des océans ou dans le magma, les entreposer plusieurs centaines d’années en surface ou à faible profondeur, les transmuter… seul le stockage profond est aujourd’hui reconnu comme une solution robuste pour mettre en sécurité ces déchets à très long terme.
C’est justement pour ne pas laisser aux générations suivantes la charge de la gestion des déchets radioactifs et les risques associés que le Parlement a fait le choix du stockage réversible profond, après 15 années de recherches et leur évaluation sur le plan scientifique et de la sûreté. Plus de 40 000 m3 de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue ont déjà été produits en France depuis une cinquantaine d’années. Ces déchets sont actuellement entreposés de manière provisoire dans l’attente d’une solution de gestion à long terme, notamment sur les sites de La Hague, Marcoule et Cadarache. A l’inverse de l’entreposage, le stockage permet de mettre en sécurité ces déchets de manière définitive.
Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de ces déchets. Grâce à la réversibilité, ces générations garderont la possibilité de faire évoluer cette solution. L’Andra propose ainsi que des rendez-vous réguliers soient programmés pendant une centaine d’années pour faire le point sur l’exploitation du stockage et préparer les étapes suivantes. Ces rendez-vous seront notamment alimentés par les résultats des recherches menées en France et à l’étranger sur la gestion des déchets radioactifs et les avancées technologiques. A chaque étape, il sera possible de décider de poursuivre le processus de stockage tel qu’initialement prévu ou de le modifier, par exemple si des solutions alternatives sont identifiées.
La décision éventuelle de créer Cigéo sera fondée sur les résultats de près de 25 années de recherches. Elle ne sera donc pas prise dans la précipitation ou sans que le projet ait été suffisamment affiné. Cette décision reviendra à l’État après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo. Ce processus comprendra notamment l’évaluation de la sûreté par l’Autorité de sûreté nucléaire, l’évaluation des recherches scientifiques par la Commission nationale d’évaluation, l’avis des collectivités territoriales, le vote d’une nouvelle loi fixant les conditions de réversibilité et une enquête publique.
QUESTION 1457
Posée par ALORIS, le 23/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de ALORIS : Pourquoi ne pas développer sur notre territoire le projet, de "Vallée Européenne de l'Energie et des Matériaux"? A nous Industriels, prenant appui justement sur le projet Cigéo, d'affirmer nos spécificités et de redonner une identité forte à notre région?
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par le Directeur du schéma interdépartemental de développement du territoire :
Cette ambition est tout à fait viable, surtout de la part d'industriels.
L'ambition affichée dans le projet de Schéma est de "tirer parti du développement en captant la plus grande part des activités et des emplois".
Le domaine du transfert de technologies et de la recherche appliquée a en effet été identifié comme l'un des domaines permettant de concentrer activités, et en particuliers entreprises innovantes dans les domaines de la mécanique, et du contrôle environnemental. La présence du laboratoire, infrastructure unique, de rayonnement international, devrait d'ores et déjà capitaliser la concentration de ces activités.
Les recherches menées aujourd'hui sont d'ordre académique (autour de la géologie), d'ordre industriel (recherches collaboratives menées dans le cadre des pôles de compétitivités) ou transferts de technologies via le CRIT. Par ailleurs, la grappe d'entreprises ENERGIC ST 55/52 a également pour vocation de constituer l'écosystème entreprenarial autour des marchés de l'énergie. A termes, les besoins et les performances exigés par Cigéo ne manqueront pas de concentrer en Meuse et en Haute-Marne, l'excellence requise.
L'objectif est triple:
- satisfaire aux exigences d'une performance industrielle d'un équipement qui ne se délocalisera pas,
- développer activités et emplois dans les départements de Meuse et de Haute-Marne,
- développer une économie résidentielle qui permette le développement de nouvelles activités économiques ici générées et qui permette le meilleur accueil à de nouveaux ménages.
La stratégie à mettre en œuvre dans les prochaines années passe par :
- une concentration des moyens, ceux des entreprises de la filière énergie (dans leurs propres stratégies de marchés et de développement) et ceux de l'accompagnement économique,
- la mise en synergie des PME avec les donneurs d'ordre,
- le renforcement de certaines compétences et fonctions, comme l'ingénierie,
- une offre d'excellence pour l'accueil d'activités.
QUESTION 1456
Posée par Jean-Jacques RENNESSON, le 23/12/2013
Questions posées dans le cahier d'acteurs de M. RENNESSON Jean-Jacques : Avons-nous le droit de laisser à nos petits-enfants une telle bombe à retardement économique et écologique? Avons nous le droit de leur laisser une biosphère empoisonnée? Ne vaudrait-il pas mieux revoir nos modèles de développement et de gaspillage? Lorsque les archéologues de l'avenir, s'ils existent, decouvriront les vestiges de nos crimes environnementaux notamment les monstrueux coprolithes industriels de Bure, ne seront-ils pas sidérés de la perversité de notre "civilisation" parvenue au plus haut degré d'immoralité autodestructrice.
Réponse du 06/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestions sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 1455
Posée par Jean-Jacques RENNESSON, le 23/12/2013
Questions posées dans le cahier d'acteurs de M. RENNESSON Jean-Jacques : A-t-on pesé le risque d'attentat? Enfin, comment garantir l'absence d'erreurs humaines? Que se passera-t-il lorsque le souvenir aura disparu et que des hommes, y feront des forages?
Réponse du 06/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Pour que le projet puisse être autorisé, l’Andra doit démontrer à l’Autorité de sûreté nucléaire qu’elle maîtrise les risques liés à l’installation, que ce soit pendant son exploitation ou après sa fermeture. Ainsi, conformément au principe de défense en profondeur, tous les dangers potentiels qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation sont identifiés en amont de la conception. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels (dont ceux liés à une erreur humaine ou à des défaillances techniques) et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels montre que leurs conséquences resteraient limitées, et nettement en deçà des normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire.
Comme toutes les installations nucléaires, Cigéo fera l’objet régulièrement de réexamens complets de sûreté, en accord avec les exigences de l’ASN qui impose un réexamen périodique de sûreté au moins tous les 10 ans. Tout au long de l’exploitation du stockage, l’ASN pourra imposer des prescriptions supplémentaires voire mettre à l’arrêt l’installation si elle considère qu’un risque n’est pas maîtrisé correctement, comme c’est le cas pour toute installation nucléaire placée sous son contrôle.
Du fait de son implantation à 500 mètres de profondeur, le stockage est une installation peu vulnérable. En particulier, après sa fermeture, le stockage sera complètement inaccessible à toute agression depuis la surface. Les installations de surface, nécessaires pendant la phase d'exploitation pour le contrôle et la préparation des colis de stockage, sont conçues pour protéger les opérateurs et les riverains des différents risques qui peuvent survenir. En particulier, le risque de malveillance est pris en compte par l'Andra. Des dispositions appropriées (contrôle des accès, gardiennage, résistance des bâtiments…) sont prévues pour assurer la protection des installations. Comme pour toute installation nucléaire, ces dispositions sont contrôlées par le Haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère en charge de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Pour être autorisées, les installations de Cigéo - en surface et en souterrain - devront répondre aux exigences des autorités de contrôle, qui ont été renforcées suite aux attentats de 2001.
En cas de perte complète de la mémoire du stockage, une intrusion inopinée à 500 mètres sous terre apparaît peu plausible, du moins sans un minimum d’investigations préalables. L’Andra évalue cependant par précaution dans son analyse de sûreté les conséquences d’un forage à travers le stockage pour vérifier que le stockage resterait sûr.
Malgré cette robustesse du stockage même en cas d’oubli, l’Andra conçoit Cigéo avec l’objectif d’en conserver la mémoire et de la transmettre aux générations futures le plus longtemps possible. Des solutions d’archivage de long terme existent pour les centres de stockage de surface exploités par l’Andra et font l’objet de revues périodiques. Le retour d’expérience montre que ces solutions paraissent robustes pour au moins les 500 premières années. Ainsi, pour Cigéo, l’Andra prévoit qu’un centre de la mémoire perdurera sur le site. Il pourra accueillir le public et comprendra notamment les archives du Centre.
De manière générale, le maintien de la mémoire doit aussi impliquer les acteurs locaux, qui peuvent prendre le relai en cas de défaillance de l’Andra ou de l’État. L’Andra veille d’ores et déjà à les informer sur les enjeux associés à la mémoire et étudie avec des anthropologues, des philosophes ou encore des artistes les facteurs qui peuvent favoriser la transmission de la mémoire. La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
L’Andra a lancé en 2010 un programme d’études pour proposer des outils qui rendent cette transmission plus robuste sur une échelle de temps millénaire. Des pistes se dessinent tels des marqueurs de surface, mais aussi des rendez-vous réguliers à mettre en place au niveau des populations locales.
En tout état de cause, comme il est impossible de garantir notre capacité à communiquer avec des êtres vivant dans plusieurs milliers d’années, c’est chaque génération qui aura la responsabilité de contribuer à transmettre cette mémoire aux générations suivantes.
QUESTION 1454
Posée par Jean-Jacques RENNESSON, le 23/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de M. RENNESSON Jean-Jacques : On oublie le transport : 100 convois par an pendant 100 ans : les "châteaux" de déchets sont fort irradiant : à 1 mètre, en 30 minutes, 500 fois la dose annuelle "admissible". Et en cas d'accident et d'incendie? Qui assumerait les conséquences? Les responsables? Les assurances? Les contribuables?
Réponse du 10/02/2014,
Réponse apportée par EDF, AREVA et le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) :
Comme indiqué dans le Cahier d'Acteur N°11 publié sur le site du débat public en juin 2013, auquel vous pouvez vous reporter pour plus de détails, les matières et déchets radioactifs de Haute Activité (HA) et Moyenne Activité à Vie Longue (MAVL) sont transportés dans des « emballages » de haute technologie agréés par l’Autorité de Sûreté Nucléaire. Ils sont conçus pour être étanches et le rester même en cas d'accident (collision, incendie, immersion…) afin de prévenir tout risque de contamination. Par ailleurs, ces emballages sont composés de plusieurs types de matériaux permettant de réduire les niveaux d'exposition aux rayonnements et les rendre inferieurs aux limites fixées par la réglementation. Celle-ci établit que la quantité de rayonnements reçus par une personne qui resterait à 2 m du véhicule pendant une heure n’excède pas la limite de 0,1 mSv quel que soit le type de déchets transportés. A titre de comparaison, l’exposition moyenne annuelle de la population française à la radioactivité naturelle est de 2,4 mSv. Le transport de ces substances radioactives est assuré par des sociétés spécialisées habilitées par l'Etat (Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie).
Le niveau de rayonnement et la non-contamination des emballages sont vérifiés à chaque étape du transport, y compris lors de changements de modes de transport. Ces mesures peuvent être vérifiées à tout moment et sur le terrain par l’ASN. Les véhicules transportant les substances radioactives sont par définition en mouvement : les durées d’exposition du public sont donc très courtes (de l’ordre de quelques secondes à quelques minutes). Les arrêts prolongés se font dans des zones gardiennées en dehors de la zone publique. Les personnes qui interviennent lors de la manutention des emballages et lors du transport reçoivent une formation appropriée sur la radioprotection. La limite annuelle de dose est fixée à 20 mSv pour les personnes travaillant dans le secteur nucléaire. Pour les autres, les personnels de la SNCF ou les forces de l’ordre par exemple, la limite applicable au public de 1 mSv/an est appliquée. Pour faciliter la perception de l’importance en matière de sûreté des incidents et accidents de transport, une échelle de gravité a été mise au point par l’AIEA, l’Agence Internationale de l’Energie Atomique. Elle est graduée du niveau 0 (événement sans importance pour la sûreté) au niveau 7 (accident majeur). Un bilan des événements de transport de matières radioactives à usage civil survenues en France est publié par l’IRSN. Les événements relatifs aux transports des substances radioactives du cycle du combustible répertoriés dans ce bilan sur la période 1999-2011, sont de niveau 0 et 1 et n’ont eu aucun impact radiologique.
Il existe un cadre juridique établi par les conventions internationales qui définissent les règles d'un régime spécifique de responsabilité civile nucléaire (RCN) en cas d'accident nucléaire, notamment lors d'un transport de substances nucléaires. En effet, le régime RCN applique un certain nombre de principes directeurs qui ont vocation à permettre une indemnisation efficace et rapide des victimes éventuelles en cas d'accident nucléaire. Parmi ces principes, l'exploitant nucléaire a notamment l'obligation de maintenir une assurance ou autre garantie financière à concurrence, par accident, du montant de sa responsabilité.
QUESTION 1453
Posée par Jean-Jacques RENNESSON, le 23/12/2013
Questions posées dans le cahier d'acteurs de M. RENNESSON Jean-Jacques : On admettait il y a peu 7.000 becquerels de tritium par litre d'eau et il est question de réduire la norme à 20 voire 7 becquerels! Où est l'erreur? Pourquoi cache-t-on l'important potentiel géothermique situé sous la région de Bure? Qui peut imaginer que l'eau polluée et les gaz resteront piégés dans ce "coffre fort" fuyard comme en sont temps le nuage de Tchernobyl? La modélisation hydrogéologique en cours ne peut calculer la vitesse de transfert de radio nucléides, "à très long terme depuis le stockage vers les aquifères encaissant" (rapport de la commission Nationale d'Evaluation 2. Nov. 2011). Ce transfert se fera, peut-être beaucoup plus rapidement que ne le prétendent lers experts d'Andra qui tablent sur 100.000 ans... mais après? Nos descendants devront gérer cet heritage empoisonné. A quel prix? On annonce pour la construction 15 milliards d'€ puis 25, puis 35... et ensuite?
Réponse du 11/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Concernant votre question relative à la géothermie
Votre question fait référence au débat sur l’interprétation des résultats du forage référencé EST 433 réalisé en 2007/2008 à Montiers-sur-Saulx, à 2 000 mètres de profondeur, dans le cadre de l’évaluation du potentiel géothermique du site étudié pour l’implantation de Cigéo. Des associations ont contesté les méthodes techniques utilisées lors de la réalisation du forage. L’Andra rappelle que les études relatives au forage EST433 se sont déroulées en toute transparence et ont fait l’objet d’évaluations indépendantes (expert du Clis, CNE, IRSN). Les caractéristiques habituellement recherchées (salinité, température et productivité) pour caractériser un potentiel géothermique ne présentent pas un caractère exceptionnel en tant que ressource potentielle pour une exploitation géothermique profonde dans la zone étudiée. Pour plus d’informations : http://www.andra.fr/download/andra-meuse-fr/document/presse/2013-01-31_cp_andra_geothermie.pdf
La CNE a pris position dans son rapport n°4 de juin 2010, estimant que « La Commission adhère, comme l’Andra, à la conclusion que le Trias dans la région de Bure ne représente pas une ressource géothermique potentielle attractive dans les conditions technologiques et économiques actuelles. Cependant cette considération repose plus sur la modestie de la température et l’incertitude qui demeure sur les possibilités de réinjecter l’eau que sur la productivité de l’aquifère du Trias inférieur dont il n’est pas pour l’instant démontré qu’elle soit inférieure à celle constatée dans les installations géothermiques au Dogger existantes dans le centre du Bassin parisien. »
L’IRSN a également rappelé sa position sur le potentiel géothermique du site de Meuse/Haute-Marne (http://www.irsn.fr/dechets/cigeo/Documents/Fiches-thematiques/IRSN_Debat-Public-Cigeo_Fiche-Geothermie.pdf).
Concernant votre question relative à la durée des transferts de radionucléides
Dans son avis du 2 septembre 2012 sur la gestion des matières et des déchets radioactifs, la Commission nationale d’évaluation indique que « le site géologique de Meuse/Haute-Marne a été retenu pour des études poussées, parce qu’une couche d’argile, de plus de 130 m d’épaisseur et à 500 m de profondeur, a révélé d’excellentes capacités de confinement : stabilité depuis 100 millions d’années au moins, circulation de l’eau très lente, capacité de rétention élevée des éléments » (../docs/docs-complementaires/docs-avis-autorites-controle-evaluations/avis-cne-gestion-matieres-et-dechets-radioactifs.pdf).
La roche argileuse a une perméabilité très faible, ce qui limite fortement les circulations d’eau à travers la couche et s’oppose au transport éventuel des radionucléides par convection (c’est-à-dire par l’entraînement de l’eau en mouvement). Cette très faible perméabilité s’explique par la nature argileuse, la finesse et le très petit rayon des pores de la roche (inférieur à 1/10 de micron). L’observation de la distribution dans la couche d’argile des éléments les plus mobiles comme le chlore ou l’hélium confirme qu’ils se déplacent majoritairement par diffusion et non par convection. Cette « expérimentation », à l’œuvre depuis des millions d’années, confirme que le transport des éléments chimiques se fait très lentement (plusieurs centaines de milliers d’années pour traverser la couche). Ces durées de transport constatées sont cohérentes avec celles estimées par simulation.
Seuls des radionucléides mobiles et à vie longue, plus particulièrement l’iode 129 et le chlore 36, pourront traverser la couche d’argile du Callovo-Oxfordien sur une durée d’un million d’années. Cette migration s’effectuant majoritairement par diffusion dans une forte épaisseur d’argile, ces radionucléides parviendront aux limites de la couche argileuse de façon très étalée dans le temps et très atténuée. Les études ont montré que le stockage n’aura pas d’impact avant 100 000 ans et que celui-ci sera très inférieur à l’impact de la radioactivité naturelle.
Concernant votre question relative aux coûts
Le coût global du stockage couvre la mise en sécurité définitive de tous les déchets français de haute activité et de moyenne activité à vie longue, produits par les installations nucléaires françaises depuis les années 1960 et qui seront produits par les installations nucléaires actuelles jusqu’à leur démantèlement. Pour un nouveau réacteur nucléaire sur l’ensemble de sa durée de fonctionnement, le coût du stockage des déchets radioactifs est de l’ordre de 1 à 2 % du coût total de production de l’électricité.
QUESTION 1452
Posée par L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE HAUTE-MARNE, le 23/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de L'Union Départementale des Associations Familiales de Haute-Marne : Monsieur le Président, vous avez en charge le débat public Cigéo. En vérité de quel débat s'agit-il? Quand on débat, on présente une alternative. Pour être juste un débat organisé par les pouvoirs publics devrait être équilibré et les options diverses disposer de moyens comparables. Cet équilibre n'est manifestement pas respecté. Aucune alternative (comme en attendant des solutions plus fiables) n'est mise au débat.
Réponse du 06/01/2014,
Le débat public sur le projet de stockage de déchets radioactifs en Meuse/Haute-Marne vise à permettre aux citoyens de s'exprimer sur l'opportunité de réaliser ou non ce stockage et si oui, sur les modalités de sa réalisation.
Il est organisé dans un cadre juridique précis, celui de l’article 12 de la loi du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, qui précise qu’il doit précéder le dépôt de la demande d’autorisation de création du centre de stockage.
Le cadre du débat est fixé comme suit : « le débat public portera sur le projet de création d’un stockage réversible profond de déchets radioactifs en Meuse/Haute-Marne : le projet Cigéo. Ce débat doit permettre à l'Andra de présenter les avancées du projet depuis 2006, en particulier les aspects liés à la conception industrielle de Cigéo, sa sûreté, sa réversibilité, son implantation, sa surveillance » (cf. site de la CNDP / Décisions concernant le débat public sur le projet Cigéo).
La question de la faisabilité d’autres modes de gestion des déchets nucléaires n’entre donc pas directement dans le cadre du présent débat. Toutefois des opinions à ce sujet ont émises dans les documents reçus par la Cpdp (cahiers d’acteurs, contributions, questions et avis), et elles seront reprises dans le compte rendu de la Cpdp
QUESTION 1451
Posée par L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE HAUTE-MARNE, le 23/12/2013
Questions posées dans le cahier d'acteurs de L'Union Départementale des Associations Familiales de Haute-Marne : Tous les jours, on nous rappelle la lourdeur du montant des dettes qu'on laisse aux générations futures. Que penser alors des déchets radioactifs à vie "longue", TRES longue, en faisant plus confiance à la géologie qu'aux hommes? Pour revenir au sujet de l'enfouissement des déchets hautement radioactifs en couche géologique profonde, certains termes utilisés sont source d'ambiguïté comme celui de la réversibilité, qui de fait, est très partielle puisqu'elle ne concerne qu'une période de 100 ans pour un projet d'une durée de vie que nous n'osons préciser. Cette notion est-elle bien comprise par la population? Ne serait-il pas plus transparent d'annoncer un enfouissement définitif après 100 ans d'exploitation. Nous nous demandions également comment on pouvait être sûr de la surveillance du site et de la capacité de prendre en charge des difficultés non prévues pendant plusieurs siècles, plusieurs millénaires. Mais nous avions tort car, en fait, le pari est que la terre soit plus rigoureuse que les hommes, puisqu'il est prévu de "boucher" les issues à la fin de l'exploitation... Même si on a travaillé pendant trente ans à cette anticipation, peut-on être sûr de ce qui se passera dans un avenir lointain? Sans mettre en cause la bonne volonté et la sincérité de qui que ce soit, ne peut-on se tromper sur les effets à long terme d'une concentration de 10.000 m3 de déchets Hautement radioactifs d'une période de 16 millions d'années? Enfin sur ce sujet quelle aletrnative économique assurant des revenus au même niveau est-elle proposée par les pouvoirs publics aux populations locales sur un territoire qui souffre et perd de la population d'année en année? Les habitants sont-ils encore en capacité de critiquer un tel projet apportant une telle manne financière? La questions de "l'achat des consciences" doit être posée.
Réponse du 11/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La protection de l’homme et de l’environnement et la prise en compte des générations futures fondent la politique française de gestion des déchets radioactifs définie par le Parlement. L’article L. 542-1 du code de l’environnement stipule ainsi :
« La gestion durable des matières et des déchets radioactifs de toute nature, résultant notamment de l’exploitation ou du démantèlement d’installations utilisant des sources ou des matières radioactives, est assurée dans le respect de la protection de la santé des personnes, de la sécurité et de l’environnement.
La recherche et la mise en œuvre des moyens nécessaires à la mise en sécurité définitive des déchets radioactifs sont entreprises afin de prévenir ou de limiter les charges qui seront supportées par les générations futures. »
En France, le débat public de 2005/2006 s’était conclu sur la question : faut-il faire confiance à la géologie ou à la société ? La conviction de l’Andra est qu’il faut faire confiance à la géologie ET à la société : c’est notre définition du stockage réversible. La géologie permet de protéger l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs à l’échelle du million d’années. La réversibilité permet à la société de contrôler le déroulement du stockage.
Dans le cadre de ses propositions sur la réversibilité, l’Andra propose ainsi que des rendez-vous réguliers soient programmés avec l’ensemble des acteurs (riverains, collectivités, associations, scientifiques, évaluateurs, État…) pour contrôler le déroulement du stockage et pour préparer chaque décision importante concernant les étapes suivantes, notamment les décisions de fermeture progressive du stockage. Pour plus d’informations sur les propositions de l’Andra : ../docs/rapport-etude/fiche-reversibilite-cigeo.pdf.
Le seul objectif du stockage est de créer de la sûreté pour le très long terme. Si Cigéo est autorisé, il sera peu vulnérable à toutes les agressions externes. Il sera implanté à 500 mètres de profondeur, dans une couche géologique spécialement choisie en raison de ses propriétés de confinement. Ce double niveau de protection ne peut pas être atteint par un entreposage, qu’il soit en surface ou en subsurface. Après la fermeture du stockage, sa sûreté doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines, pour ne pas reporter la charge des déchets sur les générations futures. Celles-ci pourront continuer à assurer une surveillance du site aussi longtemps qu’elles le souhaiteront. Néanmoins, le stockage restera sûr à long terme même si le site venait à être oublié, contrairement à un entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Les acteurs locaux expriment leurs avis sur le projet Cigéo en toute indépendance. Il est normal que les territoires qui acceptent de s’engager depuis une vingtaine d’années dans une démarche visant à mettre en œuvre un projet d’intérêt national en tirent un bénéfice concret. L’accompagnement économique a été décidé par le Parlement. Deux groupements d’intérêt public ont ainsi été constitués en Meuse et en Haute-Marne en vue de gérer des équipements nécessaires à l’installation du Laboratoire souterrain ou du Centre de stockage s’il est mis en œuvre, de mener des actions d’aménagement du territoire et de développement économique et de soutenir des actions de formation et la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques. Ils sont financés par les producteurs de déchets radioactifs au moyen d’une taxe sur les installations nucléaires.
QUESTION 1450
Posée par PARTI DE GAUCHE, le 23/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs du Parti de Gauche :
L'Andra ne répond pas de manière probante à deux risques : l'un d'accident majeur par explosion dans les galeries durant leur remplissage, dû au dégagement d'hydrogène de certains colis. Et peut-il exister une réponse efficace envers un tel risque dans de telles conditions et avec les moyens technoques à disposition? L'autre, est la contamination de l'eau potable du bassin parisien?
Réponse du 31/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Concernant le risque d’explosion
Comme pour l’ensemble des risques pouvant remettre en cause la sûreté de Cigéo, qu’ils soient d’origine naturelle ou industrielle, le risque d’explosion est pris en compte dans la conception du Centre
Ce risque d’explosion est lié à la présence d’hydrogène qui, au-delà d'une certaine quantité, peut présenter un risque d'explosion en présence d'oxygène. Seulement certains déchets MA-VL, notamment ceux contenant des composés organiques, dégagent de l'hydrogène produit par radiolyse : les ¾ des colis de déchets MA-VL destinés à Cigéo dégagent peu d’hydrogène (moins de 3 litres par an et par colis), voire pas du tout. Pour maîtriser ce risque, l’Andra fixe une limite stricte aux quantités d’hydrogène émises par chaque colis. Des contrôles seront mis en place et aucun colis ne sera accepté s’il ne respecte pas cette limite. Pour éviter l’accumulation de ce gaz, les installations souterraines et de surface seront ventilées en permanence pendant leur exploitation, comme le sont les installations d’entreposage dans lesquelles se trouvent actuellement ces déchets. Le système de ventilation du stockage fait l’objet de dispositions pour réduire le risque de panne (redondance des équipements, maintenance..) et des dispositifs de surveillance seront mis en place pour détecter toute anomalie sur son fonctionnement. Des situations de perte de la ventilation sont étudiées malgré tout. Les études montrent que, dans le pire des cas, on disposera de plus d’une dizaine de jours pour rétablir la ventilation, ce qui permettra de mettre en place une ventilation de secours. Les conséquences d’une explosion sont tout de même évaluées afin d’envisager tous les scénarios possibles : les résultats montrent que les colis concernés ne seraient que faiblement endommagés, sans aucune perte de confinement des substances qu’ils contiennent.
Concernant la contamination de l’eau potable
Pendant l’exploitation du Centre, afin d’éviter tout risque de contamination des nappes phréatiques, les effluents liquides susceptibles d’être contaminés seront systématiquement collectés et contrôlés.
Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement afin de contrôler l’impact de ses activités. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, il permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement et l’absence de contamination des nappes phréatiques. L’Andra a déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
De plus, Cigéo sera en permanence soumis au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
Après la fermeture du stockage, au-delà de la durée de vie des ouvrages industriels, la couche d’argile très peu perméable, de plus de 130 mètres d’épaisseur, dans laquelle sera installé le stockage souterrain, servira de barrière naturelle pour retenir les radionucléides contenus dans les déchets et freiner leur déplacement. Le stockage permet ainsi de garantir leur confinement sur de très longues échelles de temps. Seuls quelques radionucléides mobiles et dont la durée de vie est longue pourront migrer jusqu’aux limites de la couche d’argile qu’ils atteindront après plusieurs dizaines de milliers d’années, puis potentiellement atteindre en quantités extrêmement faibles ensuite la surface et les nappes phréatiques, après plus de 100 000 ans. Leur impact radiologique serait alors plusieurs dizaines de fois inférieur à la radioactivité naturelle (qui est de 2,4 mSv par an en moyenne en France.
QUESTION 1449
Posée par FEDERATION DU PARTI SOCIALISTE DE HAUTE-MARNE, le 23/12/2013
Questions posées dans le cahier d'acteurs de la Fédération du Parti Socialiste de Haute-Marne : Pour des déchets qui vont durer plusieurs millions d'années, acter une réversibilité de 100 ans, est-ce répondre à l'exigence citoyenne? Sur la période d'enfouissement, à 6 colis par jour descendus, il sera vite impossible de revenir en arrière, d'autant plus qu'aucun budget n'est prévu pour le retrait des colis. Même à court terme, peut-on parler de réversibilité?
Réponse du 10/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le projet Cigéo est conçu pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets français les plus radioactifs et ne pas reporter leur charge sur les générations futures. Le Parlement a également demandé que ce stockage, prévu pour être définitif, soit réversible pendant au moins 100 ans pour laisser des choix aux générations suivantes et notamment la possibilité de récupérer des déchets stockés. Les conditions de cette réversibilité seront définies dans une future loi.
La réversibilité suppose effectivement de pouvoir récupérer des colis de déchets stockés. L’Andra intègre dans la conception du stockage des dispositions techniques pour faciliter une opération éventuelle de retrait : alvéoles et colis de stockage en béton ou en acier pour éviter les déformations, robots capables de retirer ces colis de déchets stockés, surveillance des ouvrages...
La définition de la réversibilité inclut également la possibilité d’organiser le processus de stockage, qui se déroulera sur une centaine d’années, par étapes successives. A chaque étape, il sera possible de décider de poursuivre le processus tel qu’initialement prévu ou de le modifier. L’Andra propose que les décisions à prendre tout au long du processus puissent être préparées par des rendez-vous réguliers avec l’ensemble des acteurs (riverains, collectivités, associations, scientifiques, évaluateurs, État…).
L’Andra propose un partage équitable du financement de la réversibilité entre les générations. Les générations actuelles provisionnent l’ensemble des coûts nécessaires pour permettre la mise en sécurité définitive des déchets radioactifs qu’elles produisent, ainsi que des déchets anciens qui ont été produits depuis le début des années 1960. Ces provisions couvrent également les propositions techniques retenues pour assurer la réversibilité de Cigéo pendant le siècle d’exploitation. Si les générations suivantes décidaient de faire évoluer leur politique de gestion des déchets radioactifs, par exemple si elles décidaient de récupérer des déchets stockés, elles en assureraient le financement. La prise en compte de la réversibilité dès la conception du stockage permet de limiter cette charge potentielle.
Pour en savoir plus sur les propositions de l’Andra sur la réversibilité de Cigéo : ../docs/rapport-etude/fiche-reversibilite-cigeo.pdf
QUESTION 1448
Posée par FEDERATION DU PARTI SOCIALISTE DE HAUTE-MARNE, le 23/12/2013
Questions posées dans le cahier d'acteurs de la Fédération du Parti Socialiste de Haute-Marne : En Haute-Marne, ce sont 721 emplois entre les entreprises agro-alimentaires Bongrain (Caprice des Dieux) et Entremont (Emmental). Quel impact sur l'image du Champagne, notamment à l'étranger et sur ses 30.000 emplois? Sur les sources voisines de Contrexéville, Vittel et Hépar où plus de 2.000 emplois oncernée?
Réponse du 10/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Cigéo est conçu pour protéger l’Homme et l’environnement. L’impact du centre en termes de radioactivité sera très inférieur à celui de la radioactivité naturelle et n’aura donc aucun impact sur la qualité des productions agricoles. L’Andra a créé l’Observatoire pérenne de l’environnement, qui a pour mission d’assurer un suivi détaillé de l’évolution de l’environnement du stockage. Cela permettra de lever ainsi toute inquiétude en démontrant que le stockage n’a pas d’impact sur les activités agricoles de proximité. Cet observatoire labellisé s’inscrit dans un grand nombre de réseaux scientifiques nationaux ou internationaux. Par ailleurs, le retour d’expérience de la présence de l’Andra dans l’Aube depuis 20 ans montre que l’implantation d’un centre de stockage de déchets radioactifs n’est en aucun cas incompatible, même en termes d’image, avec des activités agricoles de premier choix (lait, viande, légumes, viticulture...). L'industrie et l’agriculture ont toujours coexisté et de nombreuses installations industrielles y compris nucléaires sont installées en France à proximité de zones de production agricoles dont des zones géographiques protégées ou encore des zones d'appellation contrôlée.
QUESTION 1447
Posée par FEDERATION DU PARTI SOCIALISTE DE HAUTE-MARNE, le 23/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de la Fédération du Parti Socialiste de Haute-Marne : Comment être sûr qu'aucune infiltration d'eau, profitant des fissures de la couche argileuse, ne pénètrera dans les zones de stockage entrainant la détèrioration des colis avant d'aller contaminer les nappes souterraines?
Réponse du 30/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Concernant le danger de pollution de la nappe phréatique
La protection à très long terme de l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Les générations futures pourront continuer à assurer une surveillance du site aussi longtemps qu’elles le souhaiteront. Néanmoins, le stockage restera sûr même si le site venait à être oublié, contrairement à un entreposage, qu’il soit en surface ou en subsurface.
Les recherches menées depuis 1994 sur le site étudié en Meuse/Haute-Marne ont permis aux scientifiques de reconstituer de manière détaillée son histoire géologique, depuis plus de 150 millions d’années. Le site étudié se situe dans la partie Est du bassin de Paris qui constitue un domaine géologiquement simple, avec une succession de couches de calcaires, de marnes et de roches argileuses qui se sont déposées dans d’anciens océans. Les couches de terrain ont une géométrie simple et régulière. Cette zone géologique est stable et caractérisée par une très faible sismicité. La couche argileuse étudiée pour l’implantation éventuelle du stockage, qui s’est déposée il y a environ 155 millions d’années, est homogène sur une grande surface et son épaisseur est importante (plus de 130 mètres). Aucune faille affectant cette couche n’a été mise en évidence sur la zone étudiée.
Cette analyse s’appuie sur des investigations géologiques approfondies : plus de 40 forages profonds ont été réalisés, complétés par l’analyse de plus de 300 kilomètres de géophysique 2D et de 35 km² de géophysique 3D. Environ 50 000 échantillons de roche ont été prélevés.
La roche argileuse a une perméabilité très faible, ce qui limite fortement les circulations d’eau à travers la couche et s’oppose au transport éventuel des radionucléides par convection (c’est-à-dire par l’entraînement de l’eau en mouvement). Cette très faible perméabilité s’explique par la nature argileuse, la finesse et le très petit rayon des pores de la roche (inférieur à 1/10 de micron). L’observation de la distribution dans la couche d’argile des éléments les plus mobiles comme le chlore ou l’hélium confirme qu’ils se déplacent majoritairement par diffusion et non par convection. Cette « expérimentation », à l’œuvre depuis des millions d’années, confirme que le transport des éléments chimiques se fait très lentement (plusieurs centaines de milliers d’années pour traverser la couche). Les études menées par l’Andra ont montré que l’impact du stockage serait nettement inférieur à celui de la radioactivité naturelle à l’échelle du million d’années.
QUESTION 1446
Posée par Thierry COURILLON, le 23/12/2013
Questions posées dans le cahier d'acteurs de M. COURILLON Thierry :
Quels sont les effectifs prévus pour les travaux de génie civil annexes? train? Canal? Pourquoi limiter le très haut débit seulement aux communes limitrophes? demande de l'étendre jusque Montier en Der et Neufchâteau. Pourquoi ne pas utiliser le Retour d'Expérience de l'EPR pour estimer au mieux les besoins? Sur quelles bases les chiffres données ont-ils été déterminés? Gestion des déchets sur le site? Mise en place d'un compte pro-rata pour gérer les toilettes, la cantine, parkings, la sécurité des bases vies...
Réponse du 06/02/2014,
Réponse apportée par le Directeur du schéma interdépartemental de développement du territoire :
En ce qui concerne les infrastructures et les modes de transports nécessaires au chantier, le Projet de Schéma a analysé l'ensemble des modes de transports en fonction des frets, colis de déchets ou transports de chantiers. L'approche des investissements nécessaires en infrastructures (fluviales, ferroviaires ou routières) nécessite, pour leur meilleure rentabilité mais aussi pour maîtriser les impacts des transports dans le territoire, que soient envisagées toutes les solutions, et en particulier les solutions combinant plusieurs modes, les infrastructures fluviales et ferroviaires ne desservant pas à ce jour le site de Bure-Saudron . Les transports ferroviaires et fluviaux sont particulièrement adaptés aux transports des matériaux de chantier et ils ont été privilégiés dans les analyses produites. A ce stade, le Projet de Schéma de Développement du Territoire soumet au débat public 3 scénarios de transports (incluant les matériaux de chantier) et il reviendra à l'Andra, maître d'ouvrage des investissements industriels, de tenir compte, au fil de la conception industrielle de Cigéo, des objectifs et de l'ambition affichée de "permettre la desserte de Bure-Saudron, en maîtrisant les impacts des transports" (ambition II du projet de Schéma). La gouvernance du projet que l'Etat entend mettre en place, conformément aux annonces de la ministre en charge de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, lors du dernier Comité de Haut Niveau, sera l'occasion de suivre et d'évaluer les engagements et les orientations prises par l'Andra dans la gestion du chantier.
En ce qui concerne la desserte en infrastructures numériques du territoire. A ce jour, le laboratoire est desservi par la fibre que l'Andra a demandé à l'opérateur France Telecom de mettre en place. Les départements de Meuse et de Haute-Marne conduisent également la mise à disposition et le raccordement du territoire aux infrastructures numériques, via leurs Schéma Départementaux d'Aménagement Numérique du Territoire (SDANT). La mise en place d'un poste transformateur électrique, nécessaire aux besoins des industriels, présente l'opportunité d'offrir une infrastructure supplémentaire.
Comme pour d'autres aménités, (la desserte en eau, notamment), le bénéfice de la mise en place d'infrastructures doit pouvoir profiter au territoire, en particulier le territoire proche des installations. C'est également un enjeu d'attractivité pour leurs développements, devant les perspectives d'accueil de nouvelles populations.
La vocation des SDANT est également de faire coïncider l'offre et les investissements des opérateurs avec les besoins locaux. Leurs révisions, au fil des développements territoriaux permettra une meilleure adaptation de l'offre en infrastructures numériques avec la demande.
La gestion des déchets de chantier a également été abordée dans le cadre du Projet de Schéma pour évaluer les besoins, les objectifs de valorisation des déchets (au regard des objectifs réglementaires, a minima)
QUESTION 1445
Posée par Thierry COURILLON, le 23/12/2013
Questions posées dans le cahier d'acteurs de M. COURILLON Thierry :
L'impact sur les ressources en eau, estimé par le préfet entre 500 et 1.000 m3, est également sous évalué, une personne consommant entre 100 et 150 litres par jour, nous pouvons estimer que la consommation du site serait comprise entre 220 et 405 m3 par jour, et ce pour les seuls besoins humains, besoins auxquels nous devront ajouter les besoins de nettoyage, de préparartion de repas, ... Et si nous prenons les chiffres extrapolés à partir de l'EPR, nous les doublons, ce qui fera exactement les besoins estimés, et que restera-t-il pour les travaux? pour le génie civil? Autre question : pourquoi ne pas avoir pris en compte les capacités des Vosges?
Réponse du 06/02/2014,
Réponse apportée par le Directeur du schéma interdépartemental de développement du territoire :
A partir de l'estimation des besoins en eau, formulée par les industriels (Cigéo et Syndièse) et en tenant compte de leur propres dispositifs en matière de recyclage et de limitation des consommations, le Projet de Schéma Interdépartemental de Développement du Territoire a analysé la manière dont l'approvisionnement pourrait être réalisé. Ces estimations constituent le minimum des besoins en eau, auquel il conviendra d'ajouter, les consommations liées à la modernisation des réseaux d'approvisionnement des zones voisines. Plusieurs incidents dans les réseaux d'approvisionnements communaux attestent de la faiblesse des réseaux et des possibilités d'alimentation. L'objectif est en effet de faire bénéficier à l'ensemble du territoire les possibilités de modernisation des infrastructures, et particulièrement pour les approvisionnements en eau et les infrastructures numériques.
Ces estimations ont été croisées avec les capacités des captages les plus proches . Comme pour tous les domaines qui touchent les infrastructures, plusieurs scénarios ont été définis. Dans le cas de l'approvisionnement en eau, ces scénarios peuvent être combinés.
En parallèle, les capacités d'accueil d'activités économiques dans la zone de proximité de Cigéo, doivent pouvoir être estimées en fonction des capacités du territoire à traiter l'assainissement et l'évacuation des eaux usées. Les estimations de besoins en eau seront alors augmentées des besoins liés aux développements envisagés. Une étude de faisabilité a d'ores et déjà été lancée pour définir le périmètre de restructuration des réseaux d'approvisionnement en eau et mesurer les capacités d'assainissement, tout en maîtrisant les impacts sur l'environnement et en privilégiant les solutions et les techniques innovantes de ce point de vue.
QUESTION 1444
Posée par Thierry COURILLON, le 23/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de M. COURILLON Thierry : L'impact concernant les véhicules légers est estimé à 1.000 voitures/jour, or cela est insuffisant si l'on considère les chiffres initiaux de 2.200, puis 2.700 personnes, à moins de très bien développer le covoiturage, alors qu'en sera-t-il si ces effectifs sont doublés?
Réponse du 06/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Si la création du projet Cigéo est autorisée, selon les estimations au stade de l’esquisse du projet industriel, de 1 300 à 2 300 personnes travailleraient à la construction des premières installations de Cigéo. Après 2025, de l’ordre de 600 à 1 000 personnes travailleraient de manière pérenne sur le site. Le plan de déplacement visera à encourager les possibilités de transport collectif, en lien avec les collectivités locales, et les possibilités de covoiturage. Les estimations de flux seront précisées dans la suite des études.
QUESTION 1443
Posée par COORDINATION LUBERSACOISE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, le 23/12/2013
Questions posées dans le cahier d'acteurs de la Coordination Lubersacoise de Défense de l'Environnement :
Qu'en est-il en termes de sûreté géologique à longue échéance et de charges incombant à nos lointains descendants? Et quel est ce délai précisément, le débat évoquant une durée peu justifiée de 100.000 ans? Allons-nous léguer, comme prix des quelques dizaines d'années de confort électrique dont nous jouissons de manière insouciante, des déchets toxiques et létaux à la charge de nos descendants pendant des milliers d'années?
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’impossibilité de garantir la capacité de la société à surveiller les déchets radioactifs pendant des milliers d’années est justement une des raisons qui a conduit au choix de la solution du stockage profond pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs. Contrairement à un entreposage de longue durée, le stockage dans une couche géologique assurant le confinement des éléments radioactifs à l’échelle de plusieurs centaines de milliers d’années permet de protéger l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets sans nécessité d’action humaine. La géologie prend ainsi le relais de l’homme pour garantir la sûreté sur le très long terme. La surveillance du site pourra néanmoins être maintenue aussi longtemps que les générations futures le souhaiteront et contribuera au maintien de la mémoire du stockage.
Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de ces déchets. Grâce à la réversibilité, les générations suivantes garderont la possibilité de faire évoluer cette solution. Les rendez-vous proposés par l’Andra seront notamment alimentés par les résultats de la surveillance et par les recherches qui continueront à être menées sur la gestion des déchets radioactifs et les avancées technologiques. A chaque étape, il sera possible de décider de poursuivre le processus de stockage tel qu’initialement prévu ou de le modifier, par exemple si des solutions alternatives sont identifiées.
QUESTION 1442
Posée par Patricia ANDRIOT (ESNOMS AU VAL), le 11/01/2014
Question posée dans le cahier d'acteurs n°124 de Mme Patricia Andriot : Comment expliquer que la Région, collectivité qui a des compétences de par la loi en matière de développement économique, en matière de formation professionnelle, et de transport ferroviaire, ne soit sur aucun de ces points associée aux prises de décisions en cours, et encore moins aux retombées financières engrangées par les territoires?
Réponse du 11/02/2014,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Dans le cadre des travaux relatifs au Schéma de Développement du Territoire Meuse-Haute-Marne, des groupes de travail ont été mis en place afin de traiter des différentes thématiques du développement du territoire et de son aménagement (transport, approvisionnement en eau, habitat, etc.). Ils associent les acteurs concernés du territoire en fonction des thèmes abordés. En particulier, les régions participent au travail en cours sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour le projet Cigéo, piloté par la Maison de l'emploi de la Meuse et la CCI de la Haute-Marne.
Il est essentiel que les régions puissent être associées aux questions relevant de leurs compétences, de la façon la plus pertinente, aux travers des travaux de concertation menés dans le cadre du schéma de territoire, mais également, par exemple, au travers des contrats de projet Etat-Région (CPER). Dans cet esprit, un projet visant à bénéficier de la dynamique scientifique autour des installations de l'Andra pour l'accueil d'étudiants a été déposé pour la prochaine contractualisation CPER.
QUESTION 1441
Posée par Véronique MARCHANDIER, le 23/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de Mme Véronique MARCHANDIER : Cigéo est donc un projet pour 240.000 colis en cas de poursuite de l'électronucléaire. Si l'électronucléaire s'arrêtait dans moins de 10 ans, il faudrait ajouter 694.000 colis soit un total de 934.000 colis, presque le quadruple! Il faudrait donc plus de 350 km de galeries mais 1.400 kms ; non plus de 15 millions de m3 de roche excavée mais 60 millions de m3. Sachant que l'argile se dissout avec la pluie, où iront ces millions de m3 de boue non fertile?
Réponse du 28/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le dossier du maître d’ouvrage présente page 17 le nombre d’assemblages à stocker dans un scénario d’arrêt du nucléaire. Chaque combustible usé placé dans un étui représente un colis primaire, soit environ 57 000 colis primaires de combustibles usés. Le nombre de colis de déchets vitrifiés de haute activité serait réduit (environ 20 000 colis au lieu de 60 000) compte tenu de l’arrêt du traitement des combustibles usés.
Cigéo est conçu pour mettre en sécurité définitive les déchets les plus radioactifs déjà produits ou en cours de production par les installations nucléaires existantes. L’Andra a vérifié que l’architecture de Cigéo serait suffisamment flexible pour s’adapter aux différents scénarios envisagés dans le cadre du débat national sur la transition énergétique. Les conséquences de ces scénarios sur la nature et le volume de déchets sont présentées dans un document réalisé par l’Andra et les producteurs de déchets à la demande du ministère en charge de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (../docs/rapport-etude/20130705-courrier-ministere-ecologie.pdf). Suivant les scénarios, l’emprise de l’installation souterraine de Cigéo varierait entre 15 et 25 km2. En revanche, Cigéo n’est pas conçu pour gérer les déchets qui seraient produits par un éventuel futur parc de réacteurs.
Dans un scénario de stockage direct des combustibles usés suite à une évolution de la politique énergétique, leur stockage n’interviendrait pas avant l’horizon 2070/2080 compte tenu du temps nécessaire de refroidissement avant leur stockage.
Les déblais issus du creusement seront stockés à proximité des installations de surface et feront l’objet d’un traitement paysager. Environ 40 % des déblais seront réutilisés pour la fermeture du stockage.
QUESTION 1440
Posée par Véronique MARCHANDIER, le 23/12/2013
Questions posées dans le cahier d'acteurs de Mme Véronique MARCHANDIER : Un point sur lequel promoteurs et opposants à Cigéo sont d'accord : laisser aux générations futures des "colis" qui les mettent en danger est totalement immoral. Cette infamie, cette transgression existe et augmente depuis plusieurs dizaines. L'enfouissement des colis pourrait-il réparer ce scandale ou bien les bonnes intentions ne sont-elles que le pavage vers l'enfer? Quand on a crée un prblème qui va durer des centaines de milliers d'années, pourquoi faudrait-il décider en quelques dizaines d'années d'une solution définitive? A qui profite le projet d'enfouissement?
Réponse du 21/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’Andra n’a absolument aucun intérêt financier à concevoir le projet Cigéo plutôt qu’une autre solution. L’Andra est un établissement public qui a pour mission de concevoir des centres capables de protéger l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets. Elle est placée sous la tutelle des ministères en charge de l’environnement, de l’énergie et de la recherche.
En France et à l’étranger, le stockage profond est considéré actuellement comme la solution la plus sûre et la plus durable en tant qu’étape finale de la gestion des déchets les plus radioactifs (voir par exemple la directive européenne du 19 juillet 2011 ainsi que le débat du 23 septembre 2013 sur la comparaison des expériences internationales). Le stockage ne fait pas disparaître les déchets radioactifs, mais il permet de ne pas reporter leur charge sur les générations futures en leur donnant la possibilité de les mettre en sécurité de manière définitive.
Notre génération a la responsabilité de mettre en place des solutions de gestion sûres pour les déchets radioactifs produits depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Le but étant de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, tous les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation sont identifiés par l’Andra en amont de la conception. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de ces déchets. Grâce à la réversibilité, les générations suivantes garderont la possibilité de faire évoluer cette solution. Les rendez-vous proposés par l’Andra seront notamment alimentés par les résultats des recherches qui continueront à être menées sur la gestion des déchets radioactifs et les avancées technologiques. A chaque étape, il sera possible de décider de poursuivre le processus de stockage tel qu’initialement prévu ou de le modifier, par exemple si des solutions alternatives sont identifiées.
QUESTION 1439
Posée par Jean-Pierre LEFEVRE, le 23/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de M. Jean-Pierre LEFEVRE :
Conserver la mémoire du site, avec quels moyens et quelle durée?
Réponse du 08/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif fondamental de Cigéo est de protéger l’homme et l’environnement des déchets radioactifs sur de très longues échelles de temps. La sûreté à long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. C’est une des raisons qui a conduit, en 2006, le Parlement à retenir la solution du stockage profond. En effet, cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli, contrairement à l’entreposage. En cas de perte complète de la mémoire du stockage, une intrusion inopinée à 500 mètres sous terre apparaît peu plausible, du moins sans un minimum d’investigations préalables. L’Andra évalue cependant par précaution dans son analyse de sûreté les conséquences d’un forage à travers le stockage pour vérifier que le stockage resterait sûr.
Malgré cette robustesse du stockage même en cas d’oubli, l’Andra conçoit Cigéo avec l’objectif d’en conserver la mémoire et de la transmettre aux générations futures le plus longtemps possible. Des solutions d’archivage de long terme existent pour les centres de stockage de surface exploités par l’Andra et font l’objet de revues périodiques. Le retour d’expérience montre que ces solutions paraissent robustes pour au moins les 500 premières années. Ainsi, pour Cigéo, l’Andra prévoit qu’un centre de la mémoire perdurera sur le site. Il pourra accueillir le public et comprendra notamment les archives du Centre.
De manière générale, le maintien de la mémoire doit aussi impliquer les acteurs locaux, qui peuvent prendre le relai en cas de défaillance de l’Andra ou de l’État. L’Andra veille d’ores et déjà à les informer sur les enjeux associés à la mémoire et étudie avec des anthropologues, des philosophes ou encore des artistes les facteurs qui peuvent favoriser la transmission de la mémoire. La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
L’Andra a lancé en 2010 un programme d’études pour proposer des outils qui rendent cette transmission plus robuste sur une échelle de temps millénaire. Des pistes se dessinent tels des marqueurs de surface, mais aussi des rendez-vous réguliers à mettre en place au niveau des populations locales.
En tout état de cause, comme il est impossible de garantir notre capacité à communiquer avec des êtres vivant dans plusieurs milliers d’années, c’est chaque génération qui aura la responsabilité de contribuer à transmettre cette mémoire aux générations suivantes.
QUESTION 1438
Posée par Jean-Pierre LEFEVRE, le 23/12/2013
Questions posées dans le cahier d'acteurs de M. Jean-Pierre LEFEVRE :
Pour quel motif et quelle modalité ces colis seraient-ils récupérés? Qui aura l'autorité pour décider de leur remonter ou non? Quoi qu'il en soit, l'unique perspective proposée par Cigéo est bien un stockage profond destiné à être définitif avec des accès rebouchés. Le coût selon les dires très importants pourrait être compris entre 15 milliards et plus de 100 milliards. Est-ce en fonction de la qualité du processus envisagé de réversibilité? Cette absence de certitude sur son coût n'est-elle pas liée à une imprécision sur les moyens à mettre en oeuvre pour éviter tous risques?
Réponse du 06/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Concernant votre question « Pour quel motif et quelle modalité ces colis seraient-ils récupérés ? »
La réversibilité est une demande sociétale et politique. Elle a émergé progressivement dans le cadre du processus d’études et de recherches mis en place par la loi du 30 décembre 1991, qui envisageait « l’étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formations géologiques profondes ». Lorsqu’il a autorisé la création et l’exploitation du Laboratoire souterrain (décret du 3 août 1999), le gouvernement a demandé à l’Andra d’inscrire dorénavant ses études dans la « logique de réversibilité ». La réversibilité a ensuite été imposée au projet par la loi du 28 juin 2006. Les conditions de réversibilité seront fixées par une future loi.
Les échanges avec les parties prenantes montrent que la demande de réversibilité peut être motivée par différents types de préoccupations, en particulier : contrôler le déroulement du processus de stockage, préserver la possibilité de mettre en œuvre d’autres modes de gestion, conserver une possibilité d’intervention en cas d’évolution anormale, pouvoir récupérer des colis si les déchets qu’ils contiennent devenaient valorisables, ne pas abandonner le site. Ces attentes sont illustrées au travers de différentes questions posées sur le site du débat public.
Ces attentes ont conduit l’Andra à proposer une approche de la réversibilité reposant sur des dispositions techniques destinées à faciliter le retrait éventuel de colis et sur un processus décisionnel permettant de piloter le processus de stockage :
1) Contrôler le déroulement du processus de stockage
Si Cigéo est autorisé, l’Andra propose que des rendez-vous soient programmés régulièrement pendant une centaine d’années avec l’ensemble des acteurs (riverains, collectivités, évaluateurs, État…) pour contrôler le déroulement du stockage et préparer les étapes suivantes. Le premier de ces rendez-vous pourrait avoir lieu cinq ans après le démarrage du centre. Compte tenu de leur importance, l’Andra propose également que le franchissement des étapes de fermeture du stockage fasse l’objet d’une autorisation spécifique.
2) Préserver la possibilité de mettre en œuvre d’autres modes de gestion
De nombreuses solutions pour gérer les déchets radioactifs ont été imaginées depuis 50 ans : les envoyer dans l’espace, au fond des océans ou dans le magma, les entreposer plusieurs centaines d’années en surface ou à faible profondeur, les transmuter… Seul le stockage profond est aujourd’hui reconnu en France et à l’étranger comme une solution robuste pour mettre en sécurité ces déchets à très long terme. Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de ces déchets.
Grâce à la réversibilité, les générations suivantes garderont la possibilité de faire évoluer cette solution. Les rendez-vous proposés par l’Andra seront notamment alimentés par les résultats des recherches qui continueront à être menées sur la gestion des déchets radioactifs et les avancées technologiques. A chaque étape, il sera possible de décider de poursuivre le processus de stockage tel qu’initialement prévu ou de le modifier, par exemple si des solutions alternatives sont identifiées.
3) Conserver une possibilité d’intervention en cas d’évolution anormale
Les expérimentations menées au Laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne ont permis de qualifier in situ les propriétés de la roche argileuse, d’étudier les perturbations qui seraient induites par la réalisation d’un stockage (effets du creusement, de la ventilation, de la chaleur apportée par certains déchets…), de mettre au point des méthodes d’observation et de surveillance et de tester les procédés de réalisation qui pourraient être utilisés si Cigéo est mis en œuvre.
L’étape suivante sera d’acquérir une expérience complémentaire lors de la réalisation des premiers ouvrages de stockage. Si Cigéo est autorisé, le démarrage de l’exploitation se fera de manière progressive. Des premiers colis de déchets radioactifs pourraient être pris en charge à l’horizon 2025. Dans son avis du 16 mai 2013, l’Autorité de sûreté nucléaire a recommandé une phase de « montée en puissance » progressive de l’exploitation du stockage. L’évolution du stockage sera surveillée tout au long de l’exploitation de Cigéo. Les rendez-vous proposés par l’Andra seront alimentés par les résultats de la surveillance du stockage.
La sûreté de l’installation doit être acquise quelle que doit sa réversibilité. Dans la logique de la réversibilité, l’Andra conçoit néanmoins le stockage afin de faciliter la récupération éventuelle de colis de déchets stockés. Les dispositions mises en œuvre par l’Andra prennent en compte le retour d’expérience d’autres installations, en France et à l’étranger. Les colis utilisés pour le stockage des déchets, en béton ou en acier, sont indéformables. Des espaces suffisants sont ménagés entre les colis pour permettre leur retrait. Les tunnels de stockage (alvéoles de stockage) ont un revêtement en béton ou en acier pour éviter les déformations. L’exploitant disposera d’une connaissance précise de l’emplacement de chaque colis et de ses conditions de stockage. Des essais de retrait de colis ont d’ores et déjà été réalisés à l’échelle 1. Des nouveaux tests de retrait seront réalisés dans le stockage avant que la mise en service de Cigéo ne puisse être autorisée, puis pendant toute l’exploitation de Cigéo.
4) Pouvoir récupérer des colis si les déchets qu’ils contiennent devenaient valorisables
Conformément à la loi du 28 juin 2006, les déchets radioactifs destinés à Cigéo sont des déchets ultimes, c’est-à-dire qui « ne peuvent plus être traités dans les conditions économiques du moment, notamment par extraction de leur part valorisable ou par réduction de leur caractère polluant ou dangereux ». A l’inverse, une matière radioactive est une « substance radioactive pour laquelle une utilisation ultérieure est prévue ou envisagée, le cas échéant après traitement ». Les combustibles usés, qui sont aujourd’hui considérés comme des matières valorisables, ne sont ainsi pas inclus dans l’inventaire du projet Cigéo, même si la faisabilité de leur stockage est étudiée par précaution.
Par ailleurs, les déchets radioactifs sont conditionnés par leurs producteurs pour les solidifier ou les immobiliser sous une forme non dispersable. Plusieurs modes de conditionnement sont mis en œuvre suivant la nature des déchets (vitrification, cimentation, bitumage). Ces conditionnements, dont le but est d’améliorer le confinement des déchets, rendent corollairement plus complexes la récupération des éléments radioactifs. Il n’apparaît pas aujourd’hui pertinent de chercher à récupérer les radionucléides contenus dans les déchets une fois conditionnés. Néanmoins, un suivi des éventuels progrès scientifiques et technologiques pourra être réalisé dans le cadre des rendez-vous réguliers proposés par l’Andra.
5) Ne pas abandonner le site
Après fermeture, la sûreté du stockage sera assurée de manière passive, c’est-à-dire sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique, qui sert de barrière naturelle à très long terme, et sur la conception du stockage. Une surveillance sera néanmoins maintenue après la fermeture du stockage aussi longtemps que la société le souhaitera et des actions seront menées pour conserver et transmettre sa mémoire. Le Parlement a d’ores et déjà décidé que seule une loi pourrait autoriser la fermeture définitive du stockage. Cette future loi pourra fixer les conditions dans lesquelles le site restera contrôlé, sa surveillance maintenue et la mémoire conservée.
Concernant votre question « Qui aura l'autorité pour décider de leur remonter ou non? »
L’Andra propose que le décret d’autorisation de création de Cigéo couvre des opérations de retrait limité et temporaire de colis de déchets stockés. Ces opérations seront décrites dans le rapport de sûreté et dans les règles générales d’exploitation. L’Andra considère que toute opération notable de retrait de colis de déchets stockés devra faire l’objet d’une autorisation spécifique.
Ainsi, dans l’hypothèse d’une évolution de la politique en matière de gestion des déchets radioactifs qui conduirait à envisager une opération de retrait d’un nombre important de colis de déchets, l’Etat demanderait à l’Andra d’étudier l’opération. L’étude devrait comprendre une analyse détriments-bénéfices. L’opération pourrait nécessiter des modifications notables de l’installation, notamment en surface : l’Andra définirait la nature de ces modifications en fonction de la situation de retrait considérée : famille de colis concernée, volumes, dates de retrait, devenir des colis retirés du stockage…
Ce type d’opérations nécessiterait ensuite le dépôt d’une demande de modification du décret d’autorisation de création par l’Andra, évaluée par l’Autorité de sûreté nucléaire et soumise à enquête publique. L’autorisation demandée devrait couvrir les opérations envisagées sur Cigéo (opérations de retrait, de reconditionnement éventuel, d’expédition…) et l’ensemble des modifications d’installations à apporter (construction éventuelle d’entreposages, de nouveaux ateliers…). Le dossier support à la demande devrait présenter une démonstration complète et justifiée de la sûreté des opérations projetées.
Concernant vos questions relatives au coût du stockage :
Le but du stockage est de ne pas reporter indéfiniment la charge des déchets radioactifs sur les générations futures. Le coût global du stockage permet la mise en sécurité définitive de tous les déchets français de haute activité et de moyenne activité à vie longue, produits par les installations nucléaires françaises depuis les années 1960 et qui seront produits par les installations nucléaires actuelles jusqu’à leur démantèlement.
Pour un nouveau réacteur nucléaire, sur l’ensemble de sa durée de fonctionnement, le coût du stockage des déchets radioactifs est de l’ordre de 1 à 2 % du coût total de la production d’électricité. Au stade des études de faisabilité scientifique et technique, le chiffrage arrêté par l’Etat en 2005 était d’environ 15 milliards d’euros, répartis sur une centaine d’années (coût brut non actualisé). En 2009, l’Andra a réalisé une estimation préliminaire d’environ 35 milliards d’euros, répartis également sur une centaine d’années (coût brut incluant une mise à jour de l’inventaire des déchets et des conditions économiques), avant le lancement des études de conception industrielle. A titre de comparaison, le coût de la gestion des autres déchets en France (déchets ménagers, entreprises, nettoyage des rues) est de l’ordre de 15 milliards d’euros par an.
L’Andra a lancé en 2012 les études de conception industrielle de Cigéo avec l’appui de maîtres d’œuvre spécialisés qui apportent leur retour d’expérience sur d’autres projets industriels (construction de tunnels, d’ateliers nucléaires, d’usines…). L’Etat a demandé à l’Andra de finaliser son nouveau chiffrage d’ici l’été 2014, après prise en compte des suites du débat public et des études d’optimisation en cours. Sur cette base, le ministre chargé de l’énergie pourra arrêter une nouvelle estimation et la rendre publique après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et observations des producteurs de déchets, conformément au processus défini par la loi du 28 juin 2006.
Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de ces déchets. Grâce à la réversibilité, ces générations garderont la possibilité de faire évoluer cette solution. L’Andra propose un partage équitable entre les générations du financement de la réversibilité :
- Les générations actuelles provisionnent l’ensemble des coûts nécessaires pour permettre la mise en sécurité définitive des déchets radioactifs produits depuis les années 1960 ainsi que ceux qu’elles produisent. Ces provisions couvrent également les propositions techniques retenues par l’Andra pour assurer la réversibilité de Cigéo pendant le siècle d’exploitation.
- Si les générations suivantes décidaient de faire évoluer leur politique de gestion des déchets radioactifs, par exemple si elles décidaient de récupérer des déchets stockés, elles en assureraient le financement. La prise en compte de la réversibilité dès la conception du stockage permet de limiter cette charge.
Le cadre législatif et réglementaire qui s’applique à l’Andra, futur exploitant du stockage s’il est autorisé, est très clair et donne la priorité à la sûreté. Outre les limites strictes imposées par les textes, ceux-ci imposent également aux exploitants d’abaisser autant que possible le niveau d’exposition des populations au-delà des limites fixées par la réglementation. L’Andra, comme tous les exploitants, est soumise à ces exigences réglementaires, qui sont de plus complètement cohérentes avec sa mission, qui est de mettre en sécurité les déchets radioactifs, afin de protéger l’homme et l’environnement sur le long terme.
QUESTION 1437
Posée par Irène GUNEPIN, le 23/12/2013
Questions posées dans le cahier d'acteurs de Mme GUNEPIN Irène :
Comment aujourd'hui faire confiance en la capacité d'évaluation de Pierre-BEREST et d'Emmanuel LEDOUX? Comment aujourd'hui faire confiance en la capacité de décision de Pierre-Franck Chevet aujourd'hui président de l'ASN. L'ASN qui va autoriser la contruction de Cigéo?
Réponse du 04/02/2014,
Réponse apportée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
La loi du 28 juin 2006 a fait le choix du stockage réversible profond pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations futures. Elle demande à l’Andra d’étudier et d’implanter un Centre de stockage réversible profond de déchets radioactifs (Cigéo) en indiquant que « la demande d'autorisation de création [d’un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs] doit concerner une couche géologique ayant fait l'objet d'études au moyen d'un laboratoire souterrain ». L’Andra poursuit donc ses études en vue d’élaborer pour 2015 le dossier support à l’instruction de la demande d’autorisation de création de Cigéo en Meuse/Haute-Marne.
La décision d’autoriser ou non la création de Cigéo en Meuse/Haute-Marne n’est donc pas encore prise. Elle reviendra à l’Etat après l’évaluation du dossier remis par l’Andra en 2015 par l'Autorité de sûreté nucléaire et la Commission nationale d'évaluation, l’avis des collectivités territoriales, le vote d’une nouvelle loi fixant les conditions de réversibilité et une enquête publique.
Le projet Cigéo suit la procédure décrite à l’article L. 542-10 du Code de l’Environnement. Plusieurs procédures de consultation sont organisées afin de recueillir l’avis des populations locales et nationales (débat public, avis des collectivités territoriales, enquête publique).
Le Parlement fixe périodiquement les choix relatifs à la mise en œuvre de ce projet :
- loi du 30 décembre 1991, dite loi « Bataille », fixant un programme d’études et recherches de 15 années d’études et recherches sur les déchets radioactifs ;
- loi du 28 juin 2006, définissant le stockage géologique profond comme solution de référence pour les déchets les plus radioactifs et demandant sa mise en service en 2025 ;
- loi à venir sur la réversibilité du projet.
En outre, l’Etat est en contact permanent avec les parties prenantes locales. Un important travail de concertation a été mené, notamment avec les exécutifs locaux, pour élaborer un projet de schéma interdépartemental du territoire.
La Commission nationale d'évaluation, CNE, a été créée par la loi du 30 décembre 1991 et confirmée par la loi du 28 juin 2006 pour évaluer annuellement l'état d'avancement des recherches et études relatives à la gestion des matières et des déchets radioactifs. Cette évaluation donne lieu à un rapport annuel, destiné au Parlement français, qui est transmis à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST).
La Commission est composée de douze membres, choisis sur propositions de l'Académie des sciences, de l'Académie des sciences morales et politiques, et de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques. Sa composition est renouvelée par moitié tous les trois ans. Le dernier renouvellement date en fin d’année 2013.
L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), Autorité administrative indépendante créée par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (dite "loi TSN", désormais codifiée aux livres Ier et V du code de l'environnement par l'ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012), est chargée de contrôler les activités nucléaires civiles en France.
Réponse apportée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) :
L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), Autorité administrative indépendante créée par la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire est chargée de contrôler les activités nucléaires civiles en France.
L’ASN est dirigée par un collège qui définit la politique générale de l'ASN en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Il est composé de cinq commissaires, dont le président de l’ASN.
Ces commissaires sont nommés pour six ans, trois par le président de la République et un par le président de chaque assemblée parlementaire. Ils sont irrévocables et ne peuvent recevoir d’instruction de quiconque, ni du gouvernement, ni des industriels, ni d’aucune autre instance.
Leur mandat n’est pas renouvelable. Le collège bâtit la stratégie et la doctrine de l’ASN pour le contrôle de la sûreté nucléaire et la radioprotection. Il prend les décisions les plus importantes et rend compte au Parlement.
Les décisions et avis du collège sont publiés dans le Bulletin officiel de l’ASN.
L’ASN exerce ses missions dans le respect de 4 valeurs fondamentales : la compétence, l’indépendance, la rigueur et la transparence.
Son ambition est d’assurer un contrôle du nucléaire performant, impartial, légitime et crédible, reconnu par les citoyens et qui constitue une référence internationale.
Pour certaines de ses décisions, l’ASN s’appuie sur des expertises techniques extérieures, notamment celles de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). L’ASN sollicite également les avis et les recommandations de groupes permanents d'experts rassemblant des spécialistes venant de milieux diversifiés (universités, associations, organismes d’expertise et de recherche, industriels…). Depuis 2008, l’ASN publie les avis de ces groupes permanents sur son site internet.
Dans le cadre de la loi dite « Bataille » de 1991 jusqu’en 2006 et depuis dans le cadre de la loi de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs du 28 juin 2006 et du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs (PNGMDR), l’Andra a mené des études et remis des rapports et dossiers sur le stockage en couche géologique profonde qui ont fait l’objet d’avis de l’ASN. Par exemple, l’Andra a remis un dossier dit « Jalon 2009 » sur lequel l’ASN a rendu l’avis n°2011-AV-129 du 26 juillet 2011. Les différents dossiers déposés par l’Andra ont été examinés en prenant notamment appui sur le « Guide de sûreté relatif au stockage définitif des déchets radioactifs en formation géologique profonde » publié par l’ASN en 2008.
Dans ces différents avis, l’ASN a pu se prononcer sur des propositions partielles de conception ou sur des options proposées par l’Andra pour assurer la sûreté d’une telle installation et a pu préciser les éléments et avancées identifiés à ce stade comme nécessaires pour obtenir une éventuelle autorisation. Ils sont disponibles sur le site internet de l'ASN.
Pour autant, le processus d’instruction d’une demande d’autorisation d’une installation de stockage en couche géologique profonde n’a pas débuté et ne débutera qu’avec le dépôt d’une demande d’autorisation par l’Andra. Selon le calendrier prévu par la loi de programme du 28 juin 2006, ce dossier devrait être remis en 2015.
La création du centre de stockage en couche géologique profonde ne sera alors autorisée que si l'Andra démontre que les dispositions techniques ou d'organisation prises ou envisagées aux stades de la conception, de la construction et de l'exploitation ainsi que les principes généraux proposés pour la fermeture et la surveillance sont de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients que l’installation présente. Pour cela, l’ASN vérifiera notamment s’il se conforme aux orientations décrites dans le « Guide de sûreté relatif au stockage définitif des déchets radioactifs en formation géologique profonde » publié par l’ASN en 2008.
L’ASN instruira le cas échéant la demande d’autorisation de mise en service permettant son exploitation. L’ASN contrôlera alors le centre de stockage en couche géologique profonde pendant toute la durée de sa phase d'exploitation et de sa phase de surveillance.
L’ASN continue de s’assurer, par des visites de suivi dans le laboratoire souterrain de Bure, que les expérimentations conduites au titre des recherches prévues par la loi du 28 juin 2006 sont réalisées selon des processus garantissant la qualité des résultats obtenus.
QUESTION 1436
Posée par Irène GUNEPIN, le 23/12/2013
Questions posées dans le cahier d'acteurs de Mme GUNEPIN Irène : Comment se fait-il que la catastrophe Stocamine ne serve pas d'exemple au Projet Cigéo? D'autant plus qu'on prend les mêmes et que l'on recommence? Comment se fait-il qu'une catastrophe comme celle de Stocamine ne serve pas de leçons à la communauté des hommes de bon sens? Comment le discours de l'Andra peut-il être crédible si le déstockage de Stocamine n'est pas mis en oeuvre tel que prévu par la loi et l'arrêté d'autorisation?
Réponse du 10/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les dispositions mises en œuvre par l’Andra pour le projet Cigéo prennent en compte le retour d’expérience de Stocamine.
La sûreté de Cigéo devra être acquise quelle que soit sa réversibilité. Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
L’Andra prévoit dès la conception de Cigéo des dispositifs techniques destinés à faciliter le retrait éventuel de colis de déchets stockés. Les tunnels de stockage (alvéoles de stockage) ont un revêtement en béton ou en acier pour éviter les déformations. Les colis utilisés pour le stockage des déchets, en béton ou en acier, sont indéformables. Des espaces suffisants sont ménagés entre les colis pour permettre leur retrait. L’exploitant disposera d’une connaissance précise de l’emplacement de chaque colis et de ses conditions de stockage. Les tunnels de stockage seront équipés de capteurs pour suivre leur évolution dans le temps. Des essais de retrait de colis ont d’ores et déjà été réalisés à l’échelle 1. Des nouveaux tests de retrait seront réalisés dans le stockage avant que la mise en service de Cigéo ne puisse être autorisée, puis pendant toute l’exploitation de Cigéo.
Pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets radioactifs, Cigéo devra être refermé après son exploitation. C’est aux générations qui nous succèderont qu’il reviendra de décider de procéder aux opérations de fermeture (fermeture et scellement des alvéoles, remblaiement des galeries d’accès...). L’Andra conçoit Cigéo pour qu’il puisse être refermé de manière progressive, depuis l’obturation des alvéoles jusqu’au scellement des puits et des descenderies. Chaque étape de fermeture permettra d’ajouter des dispositifs de sûreté passive. Néanmoins, elle rendra plus complexe le retrait éventuel des colis stockés. L’Andra propose donc que le franchissement de chaque nouvelle étape de fermeture, notamment le scellement des alvéoles de stockage, fasse l’objet d’une autorisation spécifique. Le Parlement a d’ores et déjà décidé que seule une loi pourrait autoriser la fermeture définitive du stockage.
La synthèse des propositions de l’Andra relatives à la réversibilité est consultable sur le site du débat public : ../docs/rapport-etude/fiche-reversibilite-cigeo.pdf
QUESTION 1435
Posée par Hélène NEGRO (LOYETTES), le 14/12/2013
A quoi a servi la pétition qui a recueilli 40.000 signatures? Dans quelques années, un accident mécanique, un mouvement de terrain, une infiltration d'eau ou autre incident conduiront à des fuites et donc un retour à des radionucléides en surface, dans l'eau des rivières, celle du robinet, avec les conséquences qu'on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA. Qui sera responsable? Comment pouvez-vous oser dire que vous maîtrisez les risques de sismicité, de mouvements de terrain, de pénétration d'eau? Quel héritage pour les générations futures?
Réponse du 10/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 1434
Posée par Estelle TOUZIN (ORLÉANS), le 14/12/2013
Nous ne sommes pas à l'abri d'une catastrophe naturelle et/ou d'une erreur humaine. Comment ferons-nous quand les radionucléides s'infiltreront dans les nappes phréatiques? Que dira-t-on à nos enfants? Qui sera responsable?
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 1433
Posée par Bertrand GUILLMOT (SCHILTIGHEIM), le 23/12/2013
Madame,
En cas d’accidents dans un site d’enfouissement des déchets nucléaires –
ce que, mathématiquement et scientifiquement, vous ne pouvez absolument
pas exclure- que vont faire les responsables de cette décision ? Rien, je pense
puisque là aussi il y a une très forte probabilité pour qu’ils ne soient plus
aux « affaires ».
Qui alors sera responsable des dégâts occasionnés et de la pollution nucléaire ?
Tout comme à Fukushima, même si on désigne des responsables ou s’ils
s’auto-désignent, cela ne sert plus à rien. Le mal est fait et continue. Qui va
payer ou porter la responsabilité de, par exemple, le taux élevé de
radioactivité qu’on commence à constater dans les poissons ? Personne.
Cette décision est donc irresponsable vis-à-vis de l’humanité tout
comme vis-à-vis de la Terre qui nous accueille.
Cordialement
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 1432
Posée par Olivier CLAEYS, le 23/12/2013
Alors c'est qui qui va assumer la responsabilité pendant 100 OO ans ?
C'est vous ?
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 1431 - qui sera responsable?
Posée par Mathieu DEFRANCE, ASSOCIATION (DIEPPE), le 14/12/2013
Quand, dans quelques dizaines années ou plusieurs milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites, une erreur aux conséquences graves et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA. Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1430 - Qui sera responsable ?Titre de votre question *
Posée par benoît EGLOFF, L'organisme que vous représentez (option) (BAYONNE), le 14/12/2013
Quand, dans 20 ans ou dans mille d’ans, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine...conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIM, Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1429 - Qui sera responsable ?
Posée par Christophe JOBARD, L'organisme que vous représentez (option) (LANGRES), le 14/12/2013
Quand, dans quelques dizaines années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1428 - le décisionnaire va-t-il assumer?
Posée par marie FAURE, L'organisme que vous représentez (option) (AUCH), le 14/12/2013
Alors, qui va ,en toute bonne conscience, soulever le tapis et, d'un coup de balai, mettre les "saletés" dessous...comme si de rien n'était....????? Qui va prendre cette décision et endosser cette énorme responsabilité? Il faut impérativement le savoir avant car un gros problème surgira forcément un jour ou l'autre et il va falloir assumer ses décisions........... Et que l'on ne nous resserve plus le "responsable mais pas coupable"!!
Réponse du 10/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le projet Cigéo est un projet industriel ambitieux, qui va au-delà du « coup de balai sous le tapis ». Et c’est en effet en conscience et avec un souci de responsabilité vis-à-vis des générations futures que la France a fait le choix de s’engager dans la voie du stockage profond, solution qui reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
En effet, l’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
QUESTION 1427 - qui sera responsable ?
Posée par annick DUCRET, MES PETITS ET ARRIÈRES ARRIÈRES PETITS ENFANTS ET MOI-MÊME (VARENNES SUR AMANCE), le 14/12/2013
lorsqu'il se produira un incident majeur type tremblement de terre, inondation, bug informatique qui sera responsable ? et qu'est-ce qui est prévu pour sauvegarder les humains, la faune, la flore ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1426 - qui sera responsable ?
Posée par florence LAMAZE, L'organisme que vous représentez (option) (NEUFCHATEAU), le 14/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans x dizaines années ou y milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1425 - QUI SERA RESPONSABLE ?
Posée par Bernadette HAZOUARD, MOI-MÊME (TROYES), le 14/12/2013
Quand, dans des milliers d’années,un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine..... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA ... Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1424 - qui sera responsable ?
Posée par Françoise GOERG, L'organisme que vous représentez (option), le 14/12/2013
Quand, dans quelques dizaines ou centaines d'années un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduiront à des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface et donc en contact avec les populations, avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA : qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1423 - Qui sera responsable ?
Posée par Jean-Claude BRESSON, L'organisme que vous représentez (option) (CHAVIGNY), le 14/12/2013
Quand, dans des dizaines années ou des milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou je ne sais quoi ... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM , TCHERNOBYL et FUKUSHIMA. Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1422 - Qui sera responsable ?
Posée par Olivier MAUREL, L'organisme que vous représentez (option) (LE PRADET), le 14/12/2013
Quand, dans des dizaines années ou des milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1421 - dans 100 ans, 500 ans qui sera responsable?
Posée par edith BUFFET, L'organisme que vous représentez (option) (MENNEVAL), le 14/12/2013
Dans 100 ans, 500 ans qui sera responsable?
j'habite dans une région où se trouve de nombreuses marnières, crèees il y a bien longtemps; certaines ne sont pas connues et la terre soudain s'affaisse, entraînant parfois la destruction de maisons. Ainsi dans de nombreuses années, lors de modifications géologiques, les roches se modifieront et les générations futures pourront ainsi bénéficier de nos inconséquences. Certes l'homme contemporain a su effectuer des merveilles, mais l'Histoire ne se résume pas au 20 et 21ème siècle. Pensez à nos descendants, merci, cordialement Edith Buffet
Réponse du 06/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestions sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 1420 - qui sera responsable?
Posée par nonucleaire CHALMETON, L'organisme que vous représentez (option) (NARBONNE), le 14/12/2013
Dans 50 ans ou plusieurs milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau tant de choses inconnues ce jour .... conduiront à une explosion, une fuite... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans les prés,l’eau des rivières, enfin dans la nature où vivent les humains , où vivront mes petits ou arrieres petits enfants avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ? vous n'aurez plus qu'à classer le site en IBN ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1419 - qui sera responsable?
Posée par Emilien HANTZ, L'organisme que vous représentez (option) (RAMONCHAMP), le 14/12/2013
Quand, dans quelques dizaines années ou quelques milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou une crise économique sévère... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1418 - Qui sera responsable
Posée par G CALTOT, L'organisme que vous représentez (option) (DIEPPE), le 14/12/2013
Qui sera responsable pour nos générations à venir ???
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1417 - Qui sera responsable ?
Posée par Jean SADOUX, L'organisme que vous représentez (option) (MONTREUIL-JUIGNE), le 14/12/2013
Quand, dans une dizaines années ou dans un millier d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet... avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA, qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1416 - Rigueur scientifique et Responsabilité
Posée par Bernard NICOLLE, CITOYEN (FRANCE), le 14/12/2013
Les scientifiques qui déclarent qu'il y a aucun danger, même à très très long terme à enfouir les déchets nucléaires à Bure devraient s'engager personnellement -signature devant la population- mais aussi financièrement en alimentant une caisse de compensation au cas où !!!! Car qui sera responsable si un incident ou accident survenait à Bure dans 100, 500 ou mille ans ? Ces scientifiques ne seront plus de ce monde !!! Et à Kychtym, les déchets ont explosé et contaminé des milliers de Km², à Asse le sous-sols bouge après moins de 100 ans d'entreposage, à Fukushima le traitement des eaux est clairement impossible. Aussi qui sera responsable -pénalement et financièrement- d'une contamination aérienne, des sols -pouvant aller jusqu'à l'interdiction de cultiver- voire d'une explosion qui pourra entrainer le déplacement de population?
Réponse du 07/02/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
C’est justement à cause du danger que représentent les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue qui ont vocation à être stockés dans Cigeo que le choix du stockage profond a été fait, parce qu’il offre de meilleures garanties en termes de sûreté sur le très long terme que l’entreposage en surface.
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1415 - Qui sera responsable
Posée par Jean-Marie MAIRE, L'organisme que vous représentez (option) (METZ), le 14/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans plusieurs dizaines années un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1414 - réversibilité et responsabilité
Posée par Jean-Sébastien GUITTON, L'organisme que vous représentez (option) (ORVAULT), le 14/12/2013
N'avons nous pas assez d'exemples, dans l'histoire industrielle française ou mondiale, de situations dans lesquelles nous nous rendons compte que tout ne se passe pas comme prévu ? Il suffit de se souvenir de toutes les fois où on a entendu les responsables nous dire que "nous allons en tirer toutes les leçons", pour que "ça ne se reproduise plus jamais", que "nous allons rédiger une nouvelle loi' ou 'un nouveau règlement". Et puis se souvenir des cas où, pour rassurer tout le monde et montrer que cela ne reste pas sans conséquence, on a "renvoyé le dirigeant technique" ou "sanctionné le responsable technique". Est ce que, précisément, "tirer les leçons", ça ne consisterait pas à ne rien faire qui ne soit pas réversible ? Est ce que l'on a déjà décidé "qui sera responsable" en cas de problème ? Est ce que quelqu'un croit que le limogeage d'un responsable compensera ne serait-ce qu'en partie de drame qui se déroulera si, par hasard, pour une raison que nous ignorons comme nous ignorions toutes les causes d'accidents précédents, un problème imprévu survient et contamine gravement l'environnement de ce projet, et ses habitants ?
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1413 - Qui sera responsable ?
Posée par Gérard POTIER, L'organisme que vous représentez (option) (VILLEURBANNE), le 14/12/2013
Quand, dans quelques dizaines ou milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou un évènement quelconque conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet ,avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ? *
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1412 - Qui sera responsable?????
Posée par Jean Luc DELMOTTE, ECODOMAINE DES GILATS (TOUCY), le 14/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans quelques dizaines années ou milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou bien d'autres imprévus comme il en arrive toujours dans tout accident, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet la nourriture de nos enfants avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1411 - QUI SERA RESPONSABLE ?
Posée par Claude PHILIPPOT, L'organisme que vous représentez (option) (BAR LE DUC), le 14/12/2013
Quand, dans des dizaines années ou des milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA, Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1410 - quelle responsabilité ultérieure?
Posée par Patrick LAFON, SIMPLE CITOYEN (CHERBOURG-OCTEVILLE), le 14/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans des dizaines d' années ou des milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou autre chose non prévisible conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1409 - Qui sera responsable, réparera, soignera, paiera ?
Posée par Michel L. ÉQ. DR.-ING. GUÉRIN VON EICKERN, L'organisme que vous représentez (option) (BAUDONCOURT), le 14/12/2013
Quand, dans x années, probablement plus tôt que craint, un accident mécanique ou électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, etc. conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites...et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet, nos corps avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable, qui réparera, qui saura soigner, qui paiera ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1408 - responsabilité et indemnisation
Posée par MIREILLE BASTARD, L'organisme que vous représentez (option) (EGUILLES), le 14/12/2013
Je suis contre en raison de tous les arguments développés mais comme on n'arrive pas à être entendus, je demande qui sera responsable en cas d'accident et les personnes qui participent à ce crime pour les générations futures sont-elles prêtes à gager dès à présent leurs biens personnels pour pouvoir indemniser ceux qui en souffriront dans quelques années? Puisqu'il n'y a aucun risque, tous devraient être d'accord...
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
QUESTION 1407 - Qui sera responsable, qui aura la solution ?
Posée par Franck RIFFET, L'organisme que vous représentez (option) (TOULOUSE), le 14/12/2013
Quand, dans x dizaines ou milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, que sais-je... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... Et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet, avec les conséquences qu’on a connues et que l'on connaîtra à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA... QUI SERA RESPONSABLE ? QUI AURA LA SOLUTION POUR REVENIR EN ARRIERE ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1406 - qui sera responsable d'avoir mis en place ces technologies de mort ?
Posée par Aline MARZIN, L'organisme que vous représentez (option) (BRETAGNE), le 14/12/2013
Qui sera responsable quand, dans quelques dizaines années ou milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, ou une intrusion humaine conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera coupable d'avoir mis en place, en toute connaissance de cause, cette technologie de mort ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1405 - Qui sera responsable ?
Posée par Monique PLANTÉ, L'organisme que vous représentez (option) (AUCH), le 14/12/2013
Quand une erreur humaine, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un accident conduiront à une explosion, un incendie, et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1403 - Responsables ?
Posée par Fred LECOQ, L'organisme que vous représentez (option), le 14/12/2013
Quand, dans 50 ou 100 ans, voir bien plus , un accident mécanique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1402 - Responsabilité !
Posée par Patrick GIERTS, L'organisme que vous représentez (option) (CHAMPLEMY), le 14/12/2013
Quand, dans une dizaines années ou un milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou un acte terroriste conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet ou simplement dans l’atmosphère, avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1401 - qui est responsable?
Posée par pierre VIEILLEFOSSE, PERSONNEL (TALENCE), le 14/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans 100 ans ou 2000 ans, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, la ruine du pays chargé de l'entretien et des financements ... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites, un abandon de l'entretien,... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet,.. avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA . Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1400 - Qui sera responsable?
Posée par Christophe TERRIER, L'organisme que vous représentez (option) (SUISSE), le 14/12/2013
Si un accident survient et que des radionucleides viennent â proliférer en surface, pollue nos eaux, qui sera responsable? Et une fois tout enfoui, le puits sera-t-il oublié ou non? Comment assurez-vous que la présence du site soit oublié pour 100'000 ans ou qu'on se rappelle dans 100'000 ans qu'il est là...
Réponse du 07/02/2014,
Réponse aportée par L'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
C’est une des raisons qui a conduit, en 2006, le Parlement à retenir la solution du stockage profond.
Malgré cette robustesse du stockage même en cas d’oubli, l’Andra conçoit Cigéo avec l’objectif d’en conserver la mémoire et de la transmettre aux générations futures le plus longtemps possible. Des solutions d’archivage de long terme existent pour les centres de stockage de surface exploités par l’Andra et font l’objet de revues périodiques. Le retour d’expérience montre que ces solutions paraissent robustes pour au moins les 500 premières années. Ainsi, pour Cigéo, l’Andra prévoit qu’un centre de la mémoire perdurera sur le site. Il pourra accueillir le public et comprendra notamment les archives du Centre.
De manière générale, le maintien de la mémoire doit aussi impliquer les acteurs locaux, qui peuvent prendre le relai en cas de défaillance de l’Andra ou de l’État. L’Andra veille d’ores et déjà à les informer sur les enjeux associés à la mémoire et étudie avec des anthropologues, des philosophes ou encore des artistes les facteurs qui peuvent favoriser la transmission de la mémoire. La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
L’Andra a lancé en 2010 un programme d’études pour proposer des outils qui rendent cette transmission plus robuste sur une échelle de temps millénaire. Des pistes se dessinent tels des marqueurs de surface, mais aussi des rendez-vous réguliers à mettre en place au niveau des populations locales.
En tout état de cause, comme il est impossible de garantir notre capacité à communiquer avec des êtres vivant dans plusieurs milliers d’années, c’est chaque génération qui aura la responsabilité de contribuer à transmettre cette mémoire aux générations suivantes.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement, y compris sur les ressources en eaux. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 1399 - Qui sera responsable ?
Posée par Marc ISOARD, SDN DIOIS (DIE), le 14/12/2013
Quand, dans 10 années ou 1 millier d’années, , un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou chépakoi... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1398 - qui sera responsable
Posée par Martine ROUILLARD, L'organisme que vous représentez (option) (ST AMAND EN PUISAYE), le 14/12/2013
dans le nucléaire les problèmes ne peuvent pas être réglés par le lobby. Il est impossible de prévoir l'inimaginable et dès maintenant de répondre aux questions de réversibilité, aux possibilités d'accident mécanique, d'accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine... qui peuvent conduire à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1397 - Qui sera responsable ?
Posée par Jean-François MICHEL, CONFLUENCE POUR SORTIR DU NUCLÉAIRE (ANDRÉSY), le 14/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans l'avenir plus ou moins proche un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, un acte de terrorisme, pourquoi pas une guerre sur le territoire national etc. conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites et donc à un retour des radionucléides en surface qui contamineront l’herbe des vaches, l’eau des rivières et du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ? Qui rendra des compte ? Qui paiera ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1396 - Enfouissement des déchets nucléaires
Posée par Bernadette MENUT, L'organisme que vous représentez (option) (GUIDEL), le 14/12/2013
Qui sera responsable, dans 50 000 ans, quand il y aura des fuites à la suite d'un glissement de terrain ???? Qui en pâtira ????
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1395 - Qui sera le/les responsables ?
Posée par Lucie RUIZ, L'organisme que vous représentez (option) (MONTPELLIER), le 14/12/2013
Qui sera responsable ? Qui sera responsable quand dans des dizaines voire des milliers d’années, un accident mécanique, ou électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine etc. conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet, les poumons des enfants, l'utérus des femmes, avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA ? Qui sera responsable sinon cette génération égoïste qui a mis en place une énergie IN-HUMAINE et qui joue à l'apprenti sorcier ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1394 - accident ?
Posée par karen LABORIE, L'organisme que vous représentez (option) (GRENOBLE), le 14/12/2013
Qui sera responsable, si dans 30 ans une erreur humaine survient et que cette erreur conduise à une fuite radioactive qui contamine la surface avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA ? Merci de votre réponse.
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1393 - Qui sera responsable ?
Posée par Jean LAPORTE, L'organisme que vous représentez (option) (MEZIERES EN BRENNE), le 14/12/2013
Quand, dans quelques dizaines d'années un accident imprevu conduira à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, dans l’eau des rivières, l’eau du robinet ..... avec les conséquences que l'on connait a KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1392 - Qui sera responsable ?
Posée par Paul BECQUET, PARTICULIER (THYEZ), le 14/12/2013
Quand, dans des dizaines ou des milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou chépakoi...conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1391 - Qui sera responsable ?
Posée par Antoine RONZON, L'organisme que vous représentez (option) (GRENOBLE), le 14/12/2013
Quand, dans 10 milliers d’années, un mouvement de terrain conduiront à une explosion, et donc à un retour des radionucléides en surface avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1390 - Qui sera responsable ?
Posée par François HUMMEL, L'organisme que vous représentez (option) (CHÂTEAUROUX), le 14/12/2013
Quand, dans des dizaines ou des milliers d'années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d'eau, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement des fuites et donc à retour des radionucléides en surface, dans l'herbe des vaches, le pied des girolles et la végétation en général et l'eau du robinet avec les conséquences que l'on a connues à KYCHTYM, Tchernobyl, Fukushima, qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1389 - Qui sera responsable ?
Posée par Jean-Luc FAUCHE, L'organisme que vous représentez (option) (AVIGNON), le 14/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans quelques dizaines années ou plusieurs milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou un essai militaire conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface et dans l'alimentation humaine et animale, avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1388 - Qui sera responsable ?
Posée par MN S, PARTICULIER ET ASSOCIATION 4A (MOSELLE), le 14/12/2013
Quand dans le futur proche ou lointain il arrivera une catastrophe ou même un incident mineur, infiltration, explosion, accident électrique, fuite avec des conséquences sur l'eau, l'air, le sol, comme à Fukushima, Tchernobyl ? Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1387 - Qui sera responsable ? Et qui paiera ?
Posée par David CHRISTOPHE JOSEPH, L'organisme que vous représentez (option) ( PARIS), le 14/12/2013
Quand, dans150 années ou 1 millier d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou je ne sais quoi.... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet, les sources, avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA. Qui sera responsable ? Qui paiera ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1386 - Qui sera responsable ?
Posée par michel PEYROTTES, L'organisme que vous représentez (option) (GIGEAN), le 14/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans x dizaines années ou y milliers d’années, (vous mettez le chiffre que vous voulez), un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou chépakoi... (vous choisissez ce que vous voulez) conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... (vous choisissez ce que vous voulez) et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet (vous choisissez ce que vous voulez) avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA (désolé, là vous n’avez pas le choix) Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1385 - QUI ?
Posée par François JOLLY, L'organisme que vous représentez (option) (COURCY), le 14/12/2013
De tous temps, les hommes ont tenté de faire disparaitre sous terre ce qui, à la surface, sentait mauvais, les gênait, leur rappelait un mauvais souvenir, les culpabilisait... De tous temps, ils ont repris un jour ou l'autre, sous des formes diverses, en pleine poire ce qu'ils pensaient rayé de leurs pensées... Alors, cette fois, qui sera responsable ?
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le principe de Cigeo n’est pas de rayer de nos pensées les déchets les plus radioactifs comme on ferait disparaitre un mauvais souvenir, mais bien de mettre les hommes et l’environnement à l’abri d’un danger, celui de leur radioactivité. Aussi ce n‘est pas par culpabilité mais avec le souci d’abord de la sûreté et ensuite de la responsabilité qui consiste à gérer les déchets produits par nos générations, que l’Andra travaille à mettre en œuvre cette solution.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
QUESTION 1384 - QUI SERA RESPONSABLE ?
Posée par rachel MAUGUET, L'organisme que vous représentez (option) (MAUBEC), le 14/12/2013
Quand, dans des dizaines années ou des milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites...et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1383 - Qui sera responsable ?
Posée par Laurence DUVAL, L'organisme que vous représentez (option) (MONTARGIS), le 14/12/2013
Qui sera responsable, quand dans quelques dizaines années, quelques centaines d'années ou quelques milliers d'années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, l’eau des rivières, l’eau du robinet,avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1382 - qui sera responsable ????
Posée par Chantal MASSON, L'organisme que vous représentez (option) (AUBE), le 14/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans x dizaines années ou y milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine....... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites...et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet ....avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA ...Qui sera responsable ?????? ription *
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1381 - Qui sera responsable ?
Posée par sylvia BONNET, L'organisme que vous représentez (option) (HERBLAY), le 14/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou ... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1380 - Serez-vous responsable ?
Posée par Domenja LEKUONA, L'organisme que vous représentez (option) (ST FAUST), le 14/12/2013
Quand, dans plusieurs milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou ... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet, la peau des êtres vivants avec les conséquences qu’on connaît à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA. Qui sera responsable ? Vous serez tenu pour responsable devant vous-même. Pensez-y.
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1379 - Qui sera responsable ?
Posée par alexandre EVRARD, L'organisme que vous représentez (option) (HERBLAY), le 14/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1378 - A qui profite le crime ?
Posée par Isabelle AUBRY, MOI MÊME (SAINT JEAN DES CHAMPS), le 14/12/2013
Dans les milliers d'année, quand les concepteurs des centrales nucléaires et des centres d'enfouissements seront tous morts de leur belle mort et qu'un évènement naturel (tremblement de terre par exemple) se produira et entrainera des fuites radioactives, qui sera responsable ? Qui "profitera" de ces fuites ? Et qui, aujourd'hui, profite de ce crime organisé qu'est le développement de l'industrie nucléaire ?
Réponse du 10/02/2014,
Réponse apportée par le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
En France, le nucléaire occupe une place prépondérante dans le mix électrique, assurant près de 75% de la production française d’électricité. Compte tenu de la durée nécessaire à la construction de moyens de production d’électricité de substitution, un arrêt à court terme de l’ensemble du parc nucléaire n’est pas envisageable sans remettre en cause l’approvisionnement électrique du pays, c’est-à-dire sans coupures très importantes d’électricité pour les consommateurs. Il apparaît donc extrêmement difficile de ne plus produire de nouveaux déchets radioactifs provenant de l’industrie électronucléaire à très court terme.
Depuis plusieurs dizaines d’années, la France a mis en place une politique de gestion responsable de ses déchets radioactifs. En 2006, après quinze années de recherches encadrées par la loi « Bataille », d’avis des évaluateurs et d’un débat public, le Parlement a fait le choix du stockage réversible profond pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations futures.
Enfin, en matière de mix électrique, le Président de la République a fixé le cap suivant pour la France : réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% d'ici 2025. Parallèlement, le Président de la République a indiqué que la transition énergétique serait fondée sur deux principes : l'efficacité énergique d'une part, et la priorité donnée aux énergies renouvelables d'autre part. Cette mutation prendra du temps et supposera des étapes d’évaluation en fonction des progrès technologiques et scientifiques et des prix relatifs de chaque source d’énergie.
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit les choix énergétiques futurs. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
QUESTION 1377 - Qui sera responsable ?
Posée par Michel COTTET, L'organisme que vous représentez (option) (POULIGNEY), le 14/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans 200 000 années (avant l'achèvement des 10 périodes du radio-isotope du Plutonium - dont la période est de 24 000 ans - nécessaires au retour à une radioactivité "acceptable" pour l'environnement naturel accueillant des êtres vivants), un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe consommée par les vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet ... avec les conséquences que l’on connait à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA . Quelle résilience osez-vous garantir ? Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1376 - Qui EST responsable, Qui sera responsable ?
Posée par jerome DRUCKER, L'organisme que vous représentez (option) (TARN), le 14/12/2013
Quand, dans 5 dizaines années ou 10 milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou autre catastrophe... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... ou autre conséquences dépassant la gestion humaine et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet, etc... avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ? Qui EST Responsable si il arrive un accident demain dimanche 15 décembre 2013? Et cette responsabilité va-t-elle en annihiler toutes conséquences? J'ai bien peur que cette soi-disant responsabilité ne soit que du vent... nucléaire.
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1375 - Qui sera responsable ?
Posée par jean-yves LE HOUEZEC, L'organisme que vous représentez (option) (RENNES), le 14/12/2013
Quand, dans 5 dizaines années ou 3 milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1374 - qui sera responsable?
Posée par olivier CABANEL, ADEC (CHIMILIN), le 14/12/2013
Quand, dans plusieurs dizaines d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou 20 000 autres raisons, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... etc et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL ou FUKUSHIMA , Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1373 - Qui sera responsable ?
Posée par Jean PIERRARD, L'organisme que vous représentez (option) (CHEHERY), le 14/12/2013
Quand dans une cinquantaine d'années un accident mécanique , un accident électrique ou une erreur humaine conduiront à une explosion ,un incendie ou des fuites et donc un retour des radionucleides en surface avec les conséquences qu'on a connu à KYCHTYM , THERNOBYL et FUKUSHIMA. Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1372 - Pourquoi ?
Posée par Virginie PODEVIN, L'organisme que vous représentez (option) (SARRAZAC), le 14/12/2013
Qui sera responsable des pertes humaines et environnementales suite aux fuites, ou tremblements de terre, ou bombe ou que sais-je ? Pourquoi faire prévaloir l'horreur des déchets nucléaires sur la Vie ? Quelle conscience avez-vous de ce que vous voulez faire ?
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, tous les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation sont identifiés par l’Andra en amont de la conception. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1371 - Qui sera responsable ?
Posée par jean-pierre MEVEL, L'organisme que vous représentez (option) (ST NAZAIRE), le 14/12/2013
Quand, dans des dizaines années ou des milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine,... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... , et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet, avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA ,qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1370 - Qui sera responsable ?
Posée par rené DOUSSE, L'organisme que vous représentez (option) (CAZILHAC), le 14/12/2013
Quand, dans x dizaines années ou y milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou autre évènement imprévu conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA ou pire encore Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1369 - Qui sera responsable ?
Posée par daniel PLAISANTIN, L'organisme que vous représentez (option) (LYON), le 14/12/2013
Quand, dans 100 milliers d’années, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille conduiront à une explosion, un incendie, et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1368 - Enfouissement CIGEO : Qui sera responsable ?
Posée par Pascal LLUCH, L'organisme que vous représentez (option), le 14/12/2013
Quand, dans des dizaines années ou des milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le jardin de nos enfants avec les conséquences qu’on a connues et que l'on va connaitre : Qui sera responsable ? Qui assumera ce choix d'aujourd'hui ? Merci
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1367 - responsabilité
Posée par patrice FREYMOND, L'organisme que vous représentez (option) (ARCHAMPS), le 14/12/2013
Quelque soit la sophistication du système mis en place si ce projet se fait, il ne sera pas parfait. Dès lors, si un accident mécanique, électrique, informatique, une erreur humaine, un incident naturel ou même une malveillance humaine a des consequences graves et provoques un retour des radionucléides en surface, avec les conséquences qu’on a connues à tchernobyl et Fukushima, Qui sera RESPONSABLE ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1366 - Qui sera responsable ?
Posée par ADELINE GINESTE, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 14/12/2013
Quand, dans x dizaines années ou y milliers d’années, (vous mettez le chiffre que vous voulez),un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou chépakoi... (vous choisissez ce que vous voulez) conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... (vous choisissez ce que vous voulez) et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet(vous choisissez ce que vous voulez)avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMAQUI SERA RESPONSABLE????
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1365 - qui sera responsable?
Posée par monique BAUDOIN, GRESIVAUDAN SUD ECOLOGIE (SAINT LATTIER), le 14/12/2013
Quand, dans des dizaines années ou des milliers d’années,un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou une guerre nouvelle formule, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1364 - Responsabilité
Posée par François DAVOUST, L'organisme que vous représentez (option) (MANCHE), le 14/12/2013
Description *Les scénaris que nous démontrent les scientifiques et ingénieurs qui prèchent en faveur du nucléaire et donc en faveur de l'accumulation des déchets sont bien sur toujours, selon eux, fiables à 100%. Qu"en est-il de la part du doute, de l'accident possible, imprévu et inévitable ? Qui en portera la responsabilité ?
Réponse du 07/02/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1363 - Qui sera désigné comme responsable ? Des indemnisations sont-elles prévues ?
Posée par Michel ICHANJOU, L'organisme que vous représentez (option) (AUZEVILLE-TOLOSANE), le 14/12/2013
Dans des milliers d'années, il se peut que survienne : - un accident quelconque ( mécanique, électrique, électronique, informatique, ... ) - une erreur quelconque ( de conception, de manipulation, ... ) - un accident de la nature ( glissement de terrain, tremblement de terre, .... ) qui pourra provoquer : - des fuites, une explosion, un incendie, .... avec des conséquences aussi dramatiques que ce qui s'est passé à KYCHTYM, à TCHERNOBYL et plus récemment à FUKUSHIMA, QUI SERA RESPONSABLE ? DES INDEMNISATIONS SONT6ELLES PREVUES ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1362 - Qui donc sera responsable ??
Posée par Frederic MANALT, L'organisme que vous représentez (option) (MARGES), le 14/12/2013
Quand, dans des dizaines ou des milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou je ne sais quoi d'autre conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites, et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet, avec les conséquences que cela comporte. Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1361 - qui sera responsable?
Posée par mat CHILE, L'organisme que vous représentez (option) (FRANCE), le 14/12/2013
qui sera responsable si un quelconque accident venait endommagé votre solution d'enfouissement, provocant des mutations génétique en libérant toutes ses ondes radio-active à travers la terre?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1360 - Qui sera responsable ?
Posée par Dominique CHAUVIN, L'organisme que vous représentez (option) (POLIGNY), le 14/12/2013
Quand, dans une dizaine ou un millier d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet ...avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ???
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1359 - qui sera responsable en cas d'accident?
Posée par Néli BUSCH, L'organisme que vous représentez (option) (CAMPS SUR L'AGLY), le 14/12/2013
Qui sera responsable ? Supposons que dans X années, pour une raison accidentielle quelconque, tremblement de terre au autre, se produisent des fuites, une explosion, un incendie, une perte de confinement, menant à une pollution incontrôlable, avec des conséquences sur la santé public catastrophique qu'on a vu à Tchernobyl ou Fukushima, qui sera tenu pour responsable? Qui sera capable d'assumer les conséquences des décisions prises?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1358 - Assurance sur la pérennité du confinement
Posée par Jean-Paul BLUGEON, L'organisme que vous représentez (option) (ROCHEFORT/MER), le 14/12/2013
Dans 100 ans ou 1000 ans, quand un mouvement de terrain ou un tremblement de terre conduiront à une perte de confinement et donc à un retour des radionucléides en surface avec les conséquences qu’on a connues à Kychtym, Tchernobyl et Fukushima, qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1357 - Qui sera responsable ?
Posée par Jeannine BLANDIOT, L'organisme que vous représentez (option) (CONFLANS STE HONORINE), le 14/12/2013
Quand un accident mécanique ou électrique, une erreur humaine ou informatique, un mouvement de terrain, tremblement de terre ou agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine ... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites ... etc. et donc à un retour des radionucléides en surface avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1356 - Qui sera responsable ?
Posée par Marie Christine BÀDENAS, L'organisme que vous représentez (option), le 14/12/2013
Quand, dans quelques dizaines années ou y milliers d’années, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, une intrusion humaine, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites...et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA. Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1355 - Qui sera responsable ?
Posée par marcel FOUTOYET, L'organisme que vous représentez (option) (SOISYS SUR SEINE), le 14/12/2013
Quand, dans 100 ans ,100 ans ,10 000ans , un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet et donc les légumes cultivés avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1354 - Qui sera responsable ?
Posée par Christiane CLAVEL, L'organisme que vous représentez (option) (AUBAGNE), le 14/12/2013
Quand, dans 70 ans ou 1000 d’ans, ...(ou + ou -) un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou ... on ne sait quoi conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet ,enfin de partout, quoi, avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA. Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1353 - le temps, ces conséquences...
Posée par Cédric LEPICIER, L'organisme que vous représentez (option) (LYON), le 14/12/2013
En tant que citoyen éduqué et informé, je sais qu'il à fallut 2013 années pour passer de Jésus Christ à aujourd'hui et bientôt 2014. L'histoire nous apprends que l'espèce humaine et la planète ont beaucoup évolués depuis ce temps et je ne remonte pas à l'age de pierre. Pourtant l'échelle de vie des déchets radioactifs que vous souhaitez ensevelir est bien plus importante que cela! Qui sera responsable ? Qui connaîtra encore ce type primitif d'énergie fossile? Quand, dans 8 dizaines années ou 300 000 milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou chépakoi... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites...et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet, le génome humain, avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ? Sur qu'elle planète faudra t'il fuir?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1352 - Quelle garantie aurons nous?
Posée par Annie GELENNE, L'organisme que vous représentez (option) (TOUCY), le 14/12/2013
Quand, dans quelques dizaines années, un accident ou un imprévu conduiront à une explosion ou des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1351 - Qui sera responsable ?
Posée par Vincent HERBUVAUX, L'organisme que vous représentez (option) (NANCY), le 14/12/2013
Quand, dans quelques dizaines années ou plusieurs milliers d’années, un bug informatique ou autre chose d'imprévu conduiront à une perte de confinement ou des fuites et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’eau des rivières avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1350 - Quelle avenir pour nos enfants?
Posée par Cécile DELMOTTE, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 14/12/2013
Quand un quelconque accident ou catastrophe conduiront à une explosion ou a des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1349 - Avons nous conscience de nos responsabilités ?
Posée par Jérôme BERRIT, L'organisme que vous représentez (option) (GRANDCHAMP DES FONTAINES), le 14/12/2013
Comment peut-on se permettre de laisser des marges d'erreur aussi importantes dans un geste qui engage l'avenir de façon aussi dramatique ? Quel personne suffisamment responsable peut-elle faire à ce point abstraction du poids de ses actes, si modestes soient-ils, dans la mise en place de cette inéluctable catastrophe future ? La conscience a-t-elle encore une place dans le présent, ou n'est-ce qu'un objet cyniquement délégué aux historiens ou aux "idéalistes" ? Nous vivons en France, nous ne survivons pas dans quelqu'endroit sur terre où seule le faim nous donne encore le courage d'avancer... Que chacun prenne la peine de s'interroger. Merci de la part de nos si lointains descendants.
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
De quelles marges d’erreur parlez-vous ?
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, tous les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation sont identifiés par l’Andra en amont de la conception. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1348 - Responsable?
Posée par monique PAILHES, L'organisme que vous représentez (option) (BERVILLE), le 14/12/2013
Description *Pas de responsabilité pour faire fonctionner une industrie nucléaire dont on ne sait pas neutraliser les déchets, pas de responsabilité dans quelques centaines d'années quand tout pétera?
Réponse du 21/01/2014,
Réponse apportée par Edf :
La loi du 28 juin 2006 a fixé de manière très claire les responsabilités de l'exploitant des centrales nucléaires françaises (EDF), en ce qui concerne les déchets radioactifs produits par leur fonctionnement, puis par leur déconstruction : l'exploitant reste responsable de ces déchets, sans limite de durée, y compris après leur transfert dans les installations de stockage gérées par l'Andra. Toutes ces activités industrielles (exploitation des centrales nucléaires, gestion des déchets, déconstruction....) sont placées sous le contrôle permanent de l'Autorité de Sûreté Nucléaire.
La loi impose par ailleurs que chaque industriel dispose de placements sécurisés qui soient à tout moment supérieurs ou égaux aux provisions nécessaires pour faire face aux charges nucléaires de long terme. Ces charges incluent celles liées à la gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs ainsi que les charges de démantèlement des installations nucléaires.
Ce dispositif financier est placé sous le contrôle de l'Etat et du Parlement, et permet de garantir que les futurs coûts de stockage sont bien intégrés dans les coûts de productions, et donc dans les prix actuels de l'électricité. La loi a en outre créé une Commission nationale d’évaluation du financement (CNEF) des charges nucléaires de long terme, pour évaluer les contrôles mis en œuvre par l’Etat.
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1347 - Où seront les responsables quand cela tournera mal?
Posée par Alain BUFERNE, L'organisme que vous représentez (option) (CLAYE SOUILLY), le 14/12/2013
Ceux qui sont sur d'eux, qui maitrisent si bien les techniques et qui prévoient tout même ce qui va se passer dans des centaines, des milliers d'années ont-ils prévenus leurs enfants et leurs petits enfants qu'ils enterraient une bombe dans leur jardin….. Et ont-ils prévu un volet sanitaire et un volet financier (réversible qu'ils disent et avec quel budget?), leurs ont-ils dit à quoi s'attendre?
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage:
C’est bien parce que nous ne voulons pas que ce soient nos enfants et nos petits enfants qui aient la charge de la gestion de nos déchets qu’est conçu le projet Cigéo. Car les laisser en surface, ce n’est pas avancer vers une solution définitive et cela ne permet pas d’assurer la sûreté sur le très long terme, comme l’a rappelé l’Autorité de Sûreté Nucléaire.
L’objectif fondamental de Cigéo est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement des risques liés aux déchets radioactifs. Une première évaluation, faite sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact des rejets pendant l’exploitation du site serait de l’ordre de 0,01 mSv par an à proximité du Centre, soit très largement inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France). A titre de comparaison, lors d’un scanner de l’abdomen, les doses reçues sont de l’ordre de 10 mSv.
Malgré ce très faible impact, et pour répondre à la demande exprimée à plusieurs reprises par les acteurs locaux et notamment le Clis (Comité local d’information et de suivi du Laboratoire souterrain), l’Andra s’est rapprochée des organismes de santé publique (Institut national de veille sanitaire, Observatoires régionaux de la santé de Lorraine et de Champagne-Ardenne) pour étudier les modalités possibles d’une surveillance de la santé autour du stockage. L’Andra a saisi ses ministères de tutelle pour que la gouvernance et l’organisation d’un tel dispositif soient précisées.
Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1346 - Qui sera responsable ?
Posée par Jean-Claude GONDET, L'organisme que vous représentez (option) (GERGY), le 14/12/2013
Quand, dans des milliers d’années ( càd : des générations humaines ), un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine ( volontaire ou involontaire)......conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... avec retour des radionucléides de longues vies en surface, et notamment dans l’eau des nappes phréatiques , des rivières, dans l’eau du robinet ..... Qui sera responsable, sachant que l'âge des pyramides des pharaons n'est que de 5000 ans !!! et que les civilisations sont mortelles.
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1345 - Comment peut-on prendre de tels risques ? Quand cessera-t-on de créer des bombes à retardement de plus en plus ravageuses ? Quand l'eau, la terre, l'environnement auront pris les allures qu'ils ont déjà à Tchernobyl et Fukushima, qui sera responsable ???
Posée par Florence MAÎTRE, L'organisme que vous représentez (option) (FRANCE), le 14/12/2013
Comment peut-on prendre de tels risques ? Quand cessera-t-on de créer des bombes à retardement de plus en plus ravageuses ? Quand l'eau, la terre, l'environnement auront pris les allures qu'ils ont déjà à Tchernobyl et Fukushima, qui sera responsable ??? RAS
Réponse du 15/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 1344 - Qui sera responsable ?
Posée par Claude ROSSIGNOL, L'organisme que vous représentez (option) (CASTRES), le 14/12/2013
Quand, dans x dizaines années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou ... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet ... avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1343 - Qu'est-ce que nous, les gens, deviendrons quand l'irrémédiable sera arrivé ?
Posée par Clémence SAGET, L'organisme que vous représentez (option) (REIMS), le 14/12/2013
Quand, dans quelques dizaines d'années ou beaucoup moins, un accident, un bug informatique, une erreur humaine, dont on croit que ça n'arrive jamais (comme à Tchernobyl ou Fukushima) conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites et/ou autres et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA vers qui les populations pourront-elles se tourner ?Qui endossera les responsabilités ?Qui sera là pour les aider ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1342 - Pourquoi cette confiance aveugle en la technologie ?
Posée par julie MOUNAUD, L'organisme que vous représentez (option) (NARBONNE), le 14/12/2013
Quand, dans le futur, un incident technique ou humain conduira à un Tchernobyl ou un Fukushima d'ampleur systèmique (eau, sol, plantes, animaux, humains... ) et planétaire avec mise en danger de l'espèce humaine, est-ce qu'il ne sera pas trop tard pour questionner le sens de cette confiance aveugle en la technologie? Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1341 - Qui sera responsable ?
Posée par nathalie CHOLLET, L'organisme que vous représentez (option) (JUJURIEUX), le 14/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans x dizaines années ou y milliers d’années, (vous mettez le chiffre que vous voulez), un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou chépakoi... (vous choisissez ce que vous voulez) conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... (vous choisissez ce que vous voulez) et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet (vous choisissez ce que vous voulez) avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA (désolé, là vous n’avez pas le choix) Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1340 - qui sera responsable ?
Posée par Claudine REBOUX, L'organisme que vous représentez (option) (BESANÇON), le 14/12/2013
Si un accident se produit dans le stockage, contaminant sol, rivières, nappes phréatiques ? ou si dans 50 000 ou 100000 ans une entreprise ou des personnes décident de creuser ou pénétrer dans la zone ne comprenant pas les avertissements donner dans les langues d'aujourd'hui ? au fait quel signalement prévoyez-vous à l'entrée de la zone ?
Réponse du 10/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
C’est une des raisons qui a conduit, en 2006, le Parlement à retenir la solution du stockage profond.
Malgré cette robustesse du stockage même en cas d’oubli, l’Andra conçoit Cigéo avec l’objectif d’en conserver la mémoire et de la transmettre aux générations futures le plus longtemps possible. Des solutions d’archivage de long terme existent pour les centres de stockage de surface exploités par l’Andra et font l’objet de revues périodiques. Le retour d’expérience montre que ces solutions paraissent robustes pour au moins les 500 premières années. Ainsi, pour Cigéo, l’Andra prévoit qu’un centre de la mémoire perdurera sur le site. Il pourra accueillir le public et comprendra notamment les archives du Centre.
De manière générale, le maintien de la mémoire doit aussi impliquer les acteurs locaux, qui peuvent prendre le relai en cas de défaillance de l’Andra ou de l’État. L’Andra veille d’ores et déjà à les informer sur les enjeux associés à la mémoire et étudie avec des anthropologues, des philosophes ou encore des artistes les facteurs qui peuvent favoriser la transmission de la mémoire. La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
L’Andra a lancé en 2010 un programme d’études pour proposer des outils qui rendent cette transmission plus robuste sur une échelle de temps millénaire. Des pistes se dessinent tels des marqueurs de surface, mais aussi des rendez-vous réguliers à mettre en place au niveau des populations locales.
En tout état de cause, comme il est impossible de garantir notre capacité à communiquer avec des êtres vivant dans plusieurs milliers d’années, c’est chaque génération qui aura la responsabilité de contribuer à transmettre cette mémoire aux générations suivantes.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement, y compris sur les ressources en eaux. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 1339 - Qui sera responsable ?
Posée par Régine CHARDEL, CITOTENNE DE BASE, le 14/12/2013
Quand, dans 50 ans, un bug informatique, une erreur humaine, ou une autre cause conduiront à un incendie ou une perte de confinement, ou autre cas de figure, et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l'eau ou le sol, avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA. Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1338 - responsabilité
Posée par fabrice CLERC, L'organisme que vous représentez (option) (LANGRES), le 14/12/2013
bonjour, je suis agriculteur biologique à dommarien (52) en cas de problème dans le stockage des déchets entraînant une pollution, qui sera responsable? cordialement
Réponse du 08/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage:
Que ce soit pendant son exploitation ou après sa fermeture, l’impact de Cigéo sera nettement inférieur à celui de la radioactivité naturelle présente dans l’environnement. Comme c’est le cas aujourd’hui dans les régions où sont déjà implantées des centres de stockage de l’Andra ou des installations nucléaires, l’implantation de Cigéo restera compatible avec les activités du terroir et n’aura pas de conséquences sur les productions locales ni leur qualité.
Les responsabilités pour garantir la sûreté du stockage sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’expert sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra à l’État après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
L’Observatoire pérenne de l’environnement, mis en place par l’Andra en 2007, permettra de suivre l’évolution de l’environnement du stockage pendant sa construction et toute sa durée d’exploitation. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, il permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Par ailleurs, comme toutes les exploitations nucléaires, Cigéo sera en permanence soumis au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire, qui fait faire régulièrement par des laboratoires indépendants des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant.
Pour en savoir plus sur l’Observatoire pérenne de l’environnement (OPE) :
http://www.andra.fr/ope
QUESTION 1337 - Qui sera responsable ?
Posée par Pascal HOUDART, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 14/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans 5 dizaines années ou 1 millier d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1336 - qui sera responsable ?
Posée par Thomas DUVAL, L'organisme que vous représentez (option) (CHORGES), le 14/12/2013
qui sera responsable quand d'ici 100 000 ans un inévitable incident ( peut -on prévoir et prévenir tout ce qui est susceptible de se passer dans de telles échelles de temps supérieures à celui de nos civilisations humaines ?) conduira à une contamination radioactive du sous-sol et de la surface équivalente aux catastrophes kychtym , Tchernobyl ou Fukushima ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1335 - qui se souviendra dans 1000 ou 10000 ans?
Posée par demuynck BENOIT, L'organisme que vous représentez (option) (LEVALLOIS), le 14/12/2013
qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1334 - Qui sera responsable?
Posée par Claude ROCHAT, L'organisme que vous représentez (option) (CHALON-SUR-SAÔNE), le 14/12/2013
Qui sera responsable des décisions prises dont les conséquences ne se verront que dans quelques décénies, centaines ou milliers d'années?Actuellement la solution de l'enfouissement est certainement la plus mauvaise car elle échappera très vite à tout contrôle. Exigeons la fermeture des centrales nucléaires qui sont la cause du problème!
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les déchets les plus radioactifs destinés à Cigéo sont des déchets dangereux, qui le resteront plusieurs dizaines à centaines de milliers d’années. Ces déchets, produits en France depuis les années 1960, sont actuellement entreposés de manière sûre mais provisoire dans des bâtiments sur leurs sites de production, dans l’attente d’une solution de gestion à long terme. Ces installations d’entreposage ne sont pas conçues pour confiner la radioactivité à très long terme. En cas de perte de contrôle de telles installations, les conséquences radiologiques sur l’homme et l’environnement ne seraient pas acceptables.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Conformément au principe de défense en profondeur, tous les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation sont identifiés par l’Andra en amont de la conception. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Les responsabilités sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
QUESTION 1333 - Qui sera responsable ?
Posée par Pierre BORD, L'organisme que vous représentez (option) (SAINT LEU LA FORÊT), le 14/12/2013
Quand, dans une centaine d'années ou plusieurs milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou tout autre raison conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet ou autre, avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ? et que pourrons nous faire?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1332 - Qui sera responsable?
Posée par Marisa LABRUIESSA, L'organisme que vous représentez (option) (LIMOGES), le 14/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans des dizaines ou des milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou autre aléa conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, ou l’eau des rivières, avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1331 - QUI SERA RESPONSABLE ?
Posée par claude THIERY, L'organisme que vous représentez (option) (MONTSEVEROUX), le 15/12/2013
Quand, dans quelques milliers d’années, un accident mécanique, une erreur humaine, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites...et donc à un retour des radionucléides en surface, dans le sol où sont cultivés nos légumes, dans l'herbe que mangent nos vaches, dans les champignons que nous consommons, dans l’eau des rivières, dans l'eau l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA , qui sera responsable ? QUI SERA RESPONSABLE ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1330 - qui sera responsable ?
Posée par Anne PARLANGE, L'organisme que vous représentez (option) (MENS), le 14/12/2013
Cacher la poussière sous le tapis n'a jamais constitué une façon durable de faire le ménage. Quand un bug électrique ou informatique, une erreur humaine ou un mouvement géophysique provoqueront un retour des radionucléides en surface, avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA , qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1329 - RESPONSABILITE
Posée par Albert CORMARY, L'organisme que vous représentez (option) (SIGEAN), le 14/12/2013
Bonjour Je suis voisin d'une usine d'AREVA, près de Narbonne dans l'Aude. Depuis des dizaines d'années, des déchets nucléaires y sont déposés et une enquête publiques est en cours. On nous dit que ces déchets sont là pour 30 ans. Bien entendu, peu croient à cette fable. Par contre, le fait qu'ils soient stockés en surface, à l'intérieur de bassins protégés et surveillés est un gage minimum de pérennité sur de longues périodes. A Bure, le projet CIGEO est tout le contraire, un enfouissement pour se faire oublier. La géologie nous enseigne ce qu'est l'histoire de la terre mais n'est pas prédictive quant à son avenir. Dès lors, comment être sur que ces déchets ne vont jamais remonter à la surface et se répandre dans la nature, de manière insidieuse ? Ce jour là, qui peut très bien se produire dans 30 ans, du fait de l'homme ou 30 siècles, du fait de la géologie, qui en assumera la responsabilité ? Merci de m'apporter une réponse claire et argumentée Albert CORMARY
Réponse du 07/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Avec Cigéo, l’objectif n’est pas de placer les déchets en profondeur pour les oublier.
L’objectif premier du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
En effet, l’entreposage des déchets des déchets implique de renouveler périodiquement les bâtiments où ils sont placés, avec les opérations associées de transferts de déchets radioactifs, de contrôler ces installations et de les maintenir. En cas de perte de contrôle de ces installations, les conséquences radiologiques sur l’homme et l’environnement ne seraient pas acceptables. Compte tenu de la durée pendant laquelle ces déchets resteront dangereux (plusieurs centaines de milliers d’années), l’entreposage - qu’il soit en surface ou à faible profondeur - ne peut être qu’une solution provisoire dans l’attente d’une solution définitive.
Le choix du site de Meuse/Haute/Marne est le résultat de nombreuses années de recherches scientifiques et de reconnaissances géologiques qui ont permis de démontrer qu’il présentait des caractéristiques favorables à l’implantation d’un tel stockage. En s’appuyant sur l’ensemble des recherches menées sur le site depuis 1994, l’Andra a montré qu’il présente des caractéristiques favorables pour assurer la sûreté à long terme du stockage. La Commission nationale d’évaluation mise en place par le Parlement pour évaluer sur le plan scientifique les travaux de l’Andra souligne ainsi dans son rapport 2012 : « le site géologique de Meuse/Haute-Marne a été retenu pour des études poussées, parce qu’une couche d’argile de plus de 130 m d’épaisseur et à 500 m de profondeur, a révélé d’excellentes qualités de confinement : stabilité depuis 100 millions d’années au moins, circulation de l’eau très lente, capacité de rétention élevée des éléments ».
Après la fermeture du stockage, au-delà de la durée de vie des ouvrages industriels, la couche d’argile dans laquelle sera installé le stockage souterrain, servira de barrière naturelle pour retenir les radionucléides contenus dans les déchets et freiner leur déplacement. Le stockage permet ainsi de garantir leur confinement sur de très longues échelles de temps. Seuls quelques radionucléides mobiles et dont la durée de vie est longue pourront migrer jusqu’aux limites de la couche d’argile qu’ils atteindront après plusieurs dizaines de milliers d’années, puis potentiellement atteindre en quantités extrêmement faibles ensuite la surface et les nappes phréatiques, après plus de 100 000 ans. Leur impact radiologique serait alors plusieurs dizaines de fois inférieur à la radioactivité naturelle (qui est de 2,4 mSv par an en moyenne en France).
Le stockage sera implanté dans la couche d’argile qui garantit l’éloignement des déchets radioactifs de la surface.
Toutefois, en application du régime de responsabilité civile nucléaire qui s’appliquera à l’exploitation de Cigéo, en cas d’accident nucléaire survenant sur le site de l’Andra, la responsabilité de cette dernière sera mise en cause sans que les victimes n’aient à prouver une faute de l’Andra. Ce régime a notamment pour intérêt de simplifier les recours des victimes qui ne sont pas obligées de multiplier les procédures à l’encontre des autres acteurs intervenant sur le site. Plusieurs tranches de garanties sont prévues : une première à la charge de l'exploitant (qui doit faire l'objet d'une garantie financière, un contrat d'assurance par exemple), une seconde à la charge de l'Etat et enfin une dernière à la charge d'un fonds international.
QUESTION 1328 - Le nom d'un responsable
Posée par bertram JAGOSON, MOI MÊME, MA FAMILLE, LES FAMILLES DE MA FAMILLE À VENIR (EUROPE, MONDE), le 14/12/2013
Bonjour, Soit, nous allons stocker les déchets nucléaires sous nos pieds. Très bien. Combien de temps ? 10.000 ans me semble un minimum. 1000.000 ans ??? OK. Il y a 4000 ans, des Egyptiens nous ont laissé des hiéroglyphes dans des tombes censées durer pour l'éternité Elles ont été pillées, OK, elles n'étaient pas aussi étanches que Bure. Mais qui est capable de lire des hiéroglyphes aujourd'hui ? Combien de personnes ? Vous pouvez prouver que vos documents, papier informatiques, tout ce que vous voulez... seront encore lisibles dans 10.000 ans. Je ne vous crois pas. Je voudrais savoir le nom de la personne qui est responsable, c'est à dire qui portera la responsabilité dans 10.000 ans, du truc quand il va foirer. Je suis soucieux de ce qui arrivera dans 10.000 ans, voyez vous. Et je vous trouve légers... Légers. J. B.
Réponse du 07/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Concernant la transmission de la mémoire du site aux générations futures, l’objectif fondamental de Cigéo est de protéger l’homme et l’environnement des déchets radioactifs sur de très longues échelles de temps. La sûreté à long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. C’est une des raisons qui a conduit, en 2006, le Parlement à retenir la solution du stockage profond. En effet, cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli, contrairement à l’entreposage. En cas de perte complète de la mémoire du stockage, une intrusion inopinée à 500 mètres sous terre apparaît peu plausible, du moins sans un minimum d’investigations préalables. L’Andra évalue cependant par précaution dans son analyse de sûreté les conséquences d’un forage à travers le stockage pour vérifier que le stockage resterait sûr.
Malgré cette robustesse du stockage même en cas d’oubli, l’Andra conçoit Cigéo avec l’objectif d’en conserver la mémoire et de la transmettre aux générations futures le plus longtemps possible. Des solutions d’archivage de long terme existent pour les centres de stockage de surface exploités par l’Andra et font l’objet de revues périodiques. Le retour d’expérience montre que ces solutions paraissent robustes pour au moins les 500 premières années. Ainsi, pour Cigéo, l’Andra prévoit qu’un centre de la mémoire perdurera sur le site. Il pourra accueillir le public et comprendra notamment les archives du Centre. De manière générale, le maintien de la mémoire doit aussi impliquer les acteurs locaux, qui peuvent prendre le relai en cas de défaillance de l’Andra ou de l’État. L’Andra veille d’ores et déjà à les informer sur les enjeux associés à la mémoire et étudie avec des anthropologues, des philosophes ou encore des artistes les facteurs qui peuvent favoriser la transmission de la mémoire. La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
L’Andra a lancé en 2010 un programme d’études pour proposer des outils qui rendent cette transmission plus robuste sur une échelle de temps millénaire. Des pistes se dessinent tels des marqueurs de surface, mais aussi des rendez-vous réguliers à mettre en place au niveau des populations locales.
En tout état de cause, comme il est impossible de garantir notre capacité à communiquer avec des êtres vivant dans plusieurs milliers d’années, c’est chaque génération qui aura la responsabilité de contribuer à transmettre cette mémoire aux générations suivantes.
QUESTION 1327 - Et dans quelques siècles ?
Posée par Chourave LE SOUS-CONCOMBRE MASQUÉ, L'organisme que vous représentez (option) (MONTREUIL), le 14/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans 2 dizaines années ou 2 milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou autre catastrophe conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1326 - QUI SERA RESPONSABLE?
Posée par valerie RAMEAUX, L'organisme que vous représentez (option) (VERS EN MONTAGNE), le 14/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans quelques dizaines d' années ou milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuite .... et donc à un retour des radionucléides en surface, avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1325 - Qui sera responsable ?
Posée par Joel GUILLOU, L'organisme que vous représentez (option) (FÉREL), le 14/12/2013
Qui sera responsable ? En cas de tremblement de terre, qui conduirait à une explosion et qui répandrait de la radioactivité dans toute la région la rendant inhabitable.
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 1324 - Qui sera responsable
Posée par Ariel BRIANÇON, L'organisme que vous représentez (option) (METTRAY), le 14/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans 57 ans,un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA (désolé, là vous n’avez pas le choix) Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1323 - Qui sera responsable ?
Posée par MATHIEU YVES, L'organisme que vous représentez (option) (AUBE), le 14/12/2013
Quand, dans plusieurs dizaines années ou y milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou une guerre (nucléaire)... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet , du champagne, avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ? votre inconscience ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1322 - qui sera responsable et qui en paiera aussi les dommages
Posée par CHRIS DUSSERT, L'organisme que vous représentez (option) (VERNOUX EN VIVARAIS), le 14/12/2013
Quand, dans des dizaines années voire centaines d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau.... conduiront à une perte de confinement, des fuites...et donc à un retour des radionucléides en surface, dans la terre ou l’eau des rivières par exemple, avec les conséquences évaluées ou en cours d'évaluation qu’on a connues à KYCHTYM ou TCHERNOBYL ou FUKUSHIMA ?) Qui sera responsable et qui en paiera aussi les dommages?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1321 - QUI sera responsable ?
Posée par gisèle FERON, L'organisme que vous représentez (option) (ST MAURICE DU DÉSERT), le 14/12/2013
Quand, dans 10 ans ou dans 2 milliers d'années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique,une erreur humaine, un mouvement de terrain, un tremblement de terre ou une intrusion humaine conduiront à une explosion, un incendie ou à des fuites et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l'herbe des vaches et dans l'eau du robinet avec les conséquences qu'on a connues à Kychtym, Tchernobyl et Fukushima QUI SERA RESPONSABLE ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1320 - Qui sera responsable ?
Posée par Georges REULIER, L'organisme que vous représentez (option) (LA MÉNITRÉ), le 14/12/2013
Quand, dans quelques dizaines années ou plusieurs milliers d’années,un accident mécanique ou un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches ou le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1319 - Perte de contrôle et conséquences...
Posée par Georges DAVID, L'organisme que vous représentez (option) (LHUIS), le 14/12/2013
En cas de perte de contrôle de l'installation, suite à un tremblement de terre, acte terroriste,..., et dissémination conséquente de la radioactivité dans l'environnement (eaux, sols, etc...) à qui incombera la responsabilité du désastre? Au plan comptable, les provision légales seront elles suffisantes ? Le risque est-il assuré, assurable et avec une couverture vraiment à la hauteur?
Réponse du 28/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestions sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
A propos des provisions, le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Les risques nucléaires sont couverts par un régime spécifique de responsabilité civile nucléaire régie en France par les conventions de Paris et de Bruxelles. Celles-ci définissent notamment les dommages rattachés à ces risques, l'indemnisation des victimes et les niveaux de garanties requis. Plusieurs tranches de garanties sont prévues : une première à la charge de l'exploitant (qui doit faire l'objet d'une garantie financière, un contrat d'assurance par exemple), une seconde à la charge de l'Etat et enfin une dernière à la charge d'un fonds international.
QUESTION 1318 - Responsabilités
Posée par G B, L'organisme que vous représentez (option) (V), le 14/12/2013
Certain(e)s ont pensé que l'enfouissement des déchets étaient LA SOLUTION miracle. Qui sera responsable si dans quelques années cela s'avère être une erreur majeure ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1317 - Qui sera responsable ?
Posée par Lou VEYHER, A TITRE PERSONNEL (VERSAILLES), le 14/12/2013
Qui sera responsable quand, dans des dizaines d'années ou des milliers d’années, un accident mécanique ou électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou tout autre accident possible, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet, etc... avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA, Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1316 - Mais qui sera responsable ?
Posée par Janick MAGNE, L'organisme que vous représentez (option) (TOKYO, JAPON), le 14/12/2013
Quand, dans quelques dizaines ou quelques milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine ou pas humaine, ou tout événement que nous ne pouvons prévoir aujourd'hui conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, ou à des fuites et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet et tout le reste.... avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,TCHERNOBYL et FUKUSHIMA, qui , mais qui sera responsable ??????
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1315 - Precaution et Responsabilité
Posée par eric PLOQUIN, L'organisme que vous représentez (option) (L'HOUMEAU), le 14/12/2013
Qui se soucie dans des dossiers aussi sensibles de diffuser l'information sur la dangerosité de ce qui sera stocké au lieu de nous vendre à tout crin que tout se passera bien ? Bref, ma question 1 : qui est garant du principe de précaution ? ma question 2 : qui est responsable en cas de dysfonctionnement ? (sachant que les éventuelles générations futures n'auront vraisemblablement plus personne à attaquer, et n'auront que leurs 3 ou 4 yeux pour pleurer !)
Réponse du 27/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
C’est bien parce que les déchets dont il est question sont dangereux que nous ne voulons pas que nos enfants et nos petits enfants en aient la charge et qu’est conçu le projet Cigéo. Car les laisser en surface, ce n’est pas avancer vers une solution définitive et cela ne permet pas d’assurer la sûreté sur le très long terme, comme l’a rappelé l’Autorité de Sûreté Nucléaire.
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestions sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de déchets radioactifs. Grâce à la réversibilité, les générations suivantes garderont la possibilité de faire évoluer cette solution. Les rendez-vous proposés par l’Andra seront notamment alimentés par les résultats de la surveillance et par les recherches qui continueront à être menées sur la gestion des déchets radioactifs et les avancées technologiques. A chaque étape, il sera possible de décider de poursuivre le processus de stockage tel qu’initialement prévu ou de le modifier, par exemple si des solutions alternatives sont identifiées.
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Les risques nucléaires sont couverts par un régime spécifique de responsabilité civile nucléaire régie en France par les conventions de Paris et de Bruxelles. Celles-ci définissent notamment les dommages rattachés à ces risques, l'indemnisation des victimes et les niveaux de garanties requis. Plusieurs tranches de garanties sont prévues : une première à la charge de l'exploitant (qui doit faire l'objet d'une garantie financière, un contrat d'assurance par exemple), une seconde à la charge de l'Etat et enfin une dernière à la charge d'un fonds international.
QUESTION 1314 - Qui sera responsable ?
Posée par Charles ABÉCASSIS, L'organisme que vous représentez (option) (BAGNEUX), le 14/12/2013
Quand, dans 2 dizaines années ou dans 10 milliers d’années, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, ou une infiltration d’eau conduiront à une perte de confinement et donc à un retour des radionucléides en surface avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1313 - qui sera responsable ?
Posée par chantal BENACCHIO, L'organisme que vous représentez (option) (DOUVRES), le 14/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans 5 dizaines années ou 5 milliers d’années, un accident mécanique, une erreur humaine ou un mouvement de terrain conduiront à, un incendie, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières ou l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1312 - Jamais de responsable ni de coupable pour combien de temps ?
Posée par Jean pierre METAUD, L'organisme que vous représentez (option) (COLONZELLE), le 14/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans x dizaines années ou y milliers d’années, (vous mettez le chiffre que vous voulez), un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou chépakoi... (vous choisissez ce que vous voulez) conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... (vous choisissez ce que vous voulez) et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet (vous choisissez ce que vous voulez) avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA (désolé, là vous n’avez pas le choix) Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1311 - Qui sera responsable ?
Posée par Martin MÉTAYER, L'organisme que vous représentez (option) (CHAUMONT), le 14/12/2013
Quand, dans 10 ans, ou 100 ans un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique ou une erreur humaine conduiront à une explosion ou une perte de confinement,et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’eau des rivières, avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA. Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1310 - Qui sera responsable ?
Posée par Claude MESNAGE, L'organisme que vous représentez (option) (L'HOUMEAU), le 14/12/2013
Quand, une erreur humaine, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, conduiront à une perte de confinement, des fuites et donc à un retour des radionucléides en surface avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1309 - Qui sera responsable ?
Posée par Patrice HOLLEBECQUE, L'organisme que vous représentez (option) (CHÉLAN (GERS)), le 14/12/2013
Quand, dans x dizaines d'années ou y milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou chépakoi... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1308 - Qui sera responsable ?
Posée par Edouard MOUTON, L'organisme que vous représentez (option) (CHERBOURG), le 14/12/2013
Quand, dans 200 ans, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou chépakoi... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Aurons-nous un jour la capacité technique ou financière pour aller rechercher ce que l'on aura stocké pour le retraiter ? C'est faire preuve d'optimisme que de penser cela et d'un optimisme forcené qui laisse plus à penser à une fuite en avant, à un renoncement de non assumé, à un rejet de la responsabilité sur d'autres que l'on ne connait pas et que l'on ne connaitra jamais. Les constructions humaines hors sol donc visibles peinent à être entretenues et cela juste pour des raisons économiques et sociales. Celles qui résistent au temps sont celle que l'on entretien régulièrement car elles sont plaisantes au regard et présentent un intérêt touristique. Ce qui n'est pas visible finira par être oublié et il ne faut pas longtemps pour cela. Combien de décharges industrielles ont disparu de notre mémoire collective, de nos archives. Le site de stockage des déchets de la Manche est un bel exemple pour cela. Il est hors sol, on peine à l'entretenir et la mémoire des décjets qui y sont stockées est incomplète. Donc oui qui sera responsable d'un accident sur le site d'enfouissement des déchets quand nous serons morts ? Assumons un peu notre façon de vivre et cessons à tout pris de vous enterrer ce qui nous dérange en imaginement que plus tard peut-être nous trouverons une solution.
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1307 - qui sera responsable ?
Posée par S GAZENGEL, PARTICULIER (ELVEN), le 14/12/2013
Quand, dans 200 années , une erreur ou intrusion humaine, ou un évènement naturel, conduiront à des fuites et donc à un retour des radionucléides en surface avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA ... Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1306 - Qui sera responsable ?
Posée par Stéphane BIENVENU, L'organisme que vous représentez (option) (FRANCE), le 14/12/2013
Quand, dans des dizaines années ou 1 milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou catastrophne géologique,conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites radioactives et contamination des nappes phréatiques et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet ,...avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1305 - Qui sera responsable ?
Posée par Hubert LERAY, L'organisme que vous représentez (option) (LIMOGES), le 14/12/2013
Quand, dans soixante ans ou dans des milliers d’années, un accident mécanique ou électrique, une erreur humaine, un mouvement de terrain ou un tremblement de terre, une infiltration d’eau, une intrusion humaine ou un commando terroriste provoqueront une explosion, un incendie, une fuite gigantesque... et donc un retour des radionucléides en surface, dans les prairies, les céréales, l’eau du robinet, avec les conséquences qu’on a connues à Kychtym, Tchernobyl et Fukushima. Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1304 - Qui sera responsable ?
Posée par Guillaume NONUCLEAIRE, L'organisme que vous représentez (option) (AVEYRON), le 14/12/2013
Quand, dans 5 dizaines années, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre ou une infiltration d’eau, conduiront à une explosion ou une perte de confinement et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches et l’eau des rivières avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA, Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1303 - Quid de la responsabilité hic et nunc et ad vitaem eternaem ?
Posée par netoyens INFO, L'organisme que vous représentez (option) (MONDEVILLE), le 14/12/2013
D'ores et déjà il est impossible de tenir pour responsable une autre entité que le Peuple lui même pour assumer la responsabilité des choix industriels en matière de nucléaire (filière) qui ont été effectués alors que nous n'étions pour la plupart pas nés ou trop jeunes pour être conscients de cette réalité. Depuis, la prise de conscience a fait son oeuvre : il faut arrêter immédiatement, sans conditions et de manière irréversible de produire des déchets radioactifs. Le projet d'enfouissement est, au contraire, une fuite en avant pour la poursuite de la même logique inacceptable compte tenu des quantités de déchets qui ont déjà été produits par la filière et de ce qu'elle entend continuer de produire quitte à prolonger dangereusement de 30 ans l'exploitation de réacteurs pour la plupart déjà périmés et bons à réformer. Qui nous dit qu'après un CIGeo entériné par la voie pseudo démocratique que le CNDP se charge de conduire (faut bien gagner sa vie), il n'y aura pas un CIGeo 2, 3, 4, etc entériné sans vergogne, dans l'urgence et de manière discrétionnaire voire autoritaire ? La question qui se pose à nous alors est celle de la responsabilité de tous ces choix passés et à venir : qui d'ores et déjà est responsable ? Qui répondra dans 2, 10 ou 50 siècles des choix que les maîtres d'ouvrages entendent arrêter au terme de ce débat public douteux qui accepte sans vergogne de passer la démocratie à la moulinette d'un guichet froid numérisé ? Et au delà, qu'est-il prévu pour établir cette responsabilité, pour dire qui d'autre que le Peuple sera encore responsable sur ses biens et sur sa Vie inconscient du fait qu'il devra passer sous les fourches caudines de la statistique sanitaire acceptable ? Un referendum ? Une décision discrétionnaire sous couvert d'intérêt supérieur de l'Etat ? L'intérêt de l'Etat coincide-t-il avec l'intérêt général, le bien commun, la défense des Communs désirables ?
Réponse du 17/01/2014,
Réponse apportée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
La loi du 28 juin 2006 a fait le choix du stockage réversible profond pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations futures. Elle demande à l’Andra d’étudier et d’implanter un Centre de stockage réversible profond de déchets radioactifs (Cigéo) en indiquant que « la demande d'autorisation de création [d’un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs] doit concerner une couche géologique ayant fait l'objet d'études au moyen d'un laboratoire souterrain ». L’Andra poursuit donc ses études en vue d’élaborer pour 2015 le dossier support à l’instruction de la demande d’autorisation de création de Cigéo en Meuse/Haute-Marne.
La décision d’autoriser ou non la création de Cigéo en Meuse/Haute-Marne n’est donc pas encore prise. Elle reviendra à l’Etat après l’évaluation du dossier remis par l’Andra en 2015 par l'Autorité de sûreté nucléaire et la Commission nationale d'évaluation, l’avis des collectivités territoriales, le vote d’une nouvelle loi fixant les conditions de réversibilité et une enquête publique.
Le projet Cigéo suit la procédure décrite à l’article L. 542-10 du Code de l’Environnement. Plusieurs procédures de consultation sont organisées afin de recueillir l’avis des populations locales et nationales (débat public, avis des collectivités territoriales, enquête publique).
Le Parlement fixe périodiquement les choix relatifs à la mise en œuvre de ce projet :
- loi du 30 décembre 1991, dite loi « Bataille », fixant un programme d’études et recherches de 15 années d’études et recherches sur les déchets radioactifs ;
- loi du 28 juin 2006, définissant le stockage géologique profond comme solution de référence pour les déchets les plus radioactifs et demandant sa mise en service en 2025 ;
- loi à venir sur la réversibilité du projet.
En outre, l’Etat est en contact permanent avec les parties prenantes locales. Un important travail de concertation a été mené, notamment avec les exécutifs locaux, pour élaborer un projet de schéma interdépartemental du territoire.
QUESTION 1302 - Qui sera responsable ?
Posée par Claude ATTIA, L'organisme que vous représentez (option) (AVIGNON), le 14/12/2013
Quand, dans 5 dizaines années ou 1 milliers d¹années, , un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d¹eau, une intrusion humaine, ou une guerre conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites ou une perte de contrôle totale des réacteurs donc à un retour des radionucléides en surface, dans l¹herbe des vaches, le pied des girolles, l¹eau des rivières, l¹eau du robinet, l'air avec les conséquences qu¹on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA. Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1301 - Qui sera responsable ?
Posée par Louise CROVETTI, L'organisme que vous représentez (option) (FRANCE), le 14/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans une centaine d'années ou un millier d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine..., (ou qui sait quoi parmi les millions d'accidents possibles), conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, l’eau des rivières, et donc l’eau du robinet , avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA, Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1300 - Qui sera responsable ?
Posée par lou PERDU, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 14/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, demain ou dans x dizaines ou y milliers d’années , un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou etc... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA. Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1299 - Qui sera responsable ?
Posée par Jacques SAVIN, L'organisme que vous représentez (option) (YVELINES), le 14/12/2013
Quand, dans quelques années ou 200 ans ou 1 siècle, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, un acte terroriste conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, les espaces cultivés, au pied de ma maison, les forêts et le pied des girolles, l’eau des rivières et de la mer, l’eau du robinet et celle des piscines,avec les conséquences qu’on a connues et que l'on connaît encore à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA... (mais tout ça c'est loin de chez moi) Que direz-vous ? que ferez vous ? Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1298 - Qui sera responsable ?
Posée par Jacqueline BOIVIN, MOI-MÊME ET MA FAMILLE (MOISSAC), le 14/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans 1 dizaine années ou 100 milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou chépakoi... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA ... Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1297 - Qui sera responsable ?
Posée par bernadette BOUCHARD, L'organisme que vous représentez (option) (NICE), le 14/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans dizaines années ou des milliers d’année, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou chépakoi... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet, dans l'air que nous respirons, avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA et qu'on continue à sublr, Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1296 - Qui sera responsable?
Posée par Isabelle BRETON, L'organisme que vous représentez (option) (CHAUMONT), le 14/12/2013
Quand dans quelques centaines d'années, une infiltration d'eau conduira à des fuites et donc à un retour des radionucléides en surface et jusqu'à l'eau du robinet, avec les conséquences qu'on a connues à Kychtym, Tchernobyl ou Fukushima... Qui sera responsable? Quelles actions seront alors possibles pour enrayer ce fléau? Qui les prendra?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1295 - Responsabilité
Posée par anne DEBIESSE, L'organisme que vous représentez (option) (PERS), le 14/12/2013
Monsieur, Madame, Quand, dans des dizaines années ou des milliers d’années, un accident mécanique, ou un accident électrique, ou un bug informatique, ou une erreur humaine, ou une erreur de conception, ou un mouvement de terrain, ou un tremblement de terre, ou un agrandissement de faille, ou une infiltration d’eau, ou une intrusion humaine, ... conduira à une explosion, ou un incendie, ou une perte de confinement, ou des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA , QUI SERA RESPONSABLE? VOUS qui avez fait ce choix.
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1294 - Combustible nucléaire
Posée par Michel BRUN, EDF (AUZAT), le 14/12/2013
Dans le stockage de Bure y aura t'il du combustible irradié? EDF en tout cas l'envisage.
Réponse du 31/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La nécessité de stocker des combustibles usés dépendra de la politique énergétique qui sera mise en œuvre par la France dans le futur.
Dans le cadre de la politique énergétique actuelle en France, les combustibles usés issus de la production électronucléaire ne sont pas considérés comme des déchets mais comme des matières pouvant être valorisées, notamment dans les réacteurs de quatrième génération. A ce titre, ils ne sont pas destinés à être stockés dans Cigéo. Seuls les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue, issus du traitement de combustibles usés, sont destinés à Cigéo.
Dans l’hypothèse où les combustibles usés devraient être stockés directement, après refroidissement, ils pourraient être stockés dans Cigéo, qui a été conçu pour être flexible afin de pouvoir s’adapter à d’éventuels changements de la politique énergétique et à ses conséquences sur la nature et les volumes de déchets qui devront alors être stockés. A la demande du Ministère en charge de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, l’Andra, EDF et Areva ont étudié l’impact des différents scénarios établis dans le cadre du débat national sur la transition énergétique sur la production de déchets radioactifs et sur le projet Cigéo : ../docs/rapport-etude/20130705-courrier-ministere-ecologie.pdf
La faisabilité de principe et la sûreté du stockage profond des combustibles usés ont par ailleurs été démontrées par l’Andra en 2005. Dans le cadre du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, l’État a demandé à l’Andra de vérifier par précaution que les concepts de stockage de Cigéo restent compatibles avec l’hypothèse d’un stockage direct de combustibles usés si ceux-ci étaient un jour considérés comme des déchets. L’Andra a remis fin 2012 un rapport d’étape. Dans l’hypothèse d’un stockage direct des combustibles usés, compte tenu du temps nécessaire de refroidissement, comme pour l’essentiel des déchets HA, leur stockage n’interviendrait pas avant l’horizon 2070/2080. Si le stockage direct de combustibles usés était décidé, l’Autorité de sûreté nucléaire recommande la réalisation, au préalable, de tests industriels in situ afin de qualifier les systèmes de manutention des colis dans l’alvéole.
La nature et les quantités de déchets autorisés pour un stockage dans Cigéo seront fixées par le décret d’autorisation de création du centre. Toute évolution notable de cet inventaire devra faire l’objet d’un nouveau processus d’autorisation, comprenant notamment une enquête publique et un nouveau décret d’autorisation.
QUESTION 1293 - Qui sera responsable ?
Posée par Flora-Louise CELLIER, MOI-MÊME (BAR-SUR-AUBE), le 14/12/2013
Quand, dans une dizaine d'années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, -etc et les exemples sont quotidiens - conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA. Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1292 - Qui sera responsable ?
Posée par Catherine PEYRE, L'organisme que vous représentez (option) (SEGNY), le 14/12/2013
Quand, dans 3 dizaines années ou y milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou un imprévu... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1291 - Qui est responsable du futur ?
Posée par hugues DARNET, L'organisme que vous représentez (option) (CHAMOUX), le 14/12/2013
Quand, dans une dizaines années ou 1 million d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou un pipi de rat conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites ou autres petits problèmes qui en cascades finiront par une catastrophe et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA... Qui sera responsable ? Que penseront les vivants d'alors de cet héritage bien pourri qu'on leur aura délibérément laissé ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1290 - Qui sera responsable et quelles seront les solutions ?
Posée par marc JOSEPH, L'organisme que vous représentez (option) (EURE), le 14/12/2013
Quand, dans des dizaines années ou des milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable et quelles seront les solutions ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1289 - France, la poubelle radioactive de l'Europe ? Les décideurs face à leurs responsabilités
Posée par am PRILLARD, L'organisme que vous représentez (option) (ECLANS), le 14/12/2013
Si, dans des dizaines d’années, un accident arrive, (quel qu’en soit l’origine : mécanique, électrique, erreur humaine, ou mouvement de terrain, tremblement de terre, agrandissement de faille), et permet un retour des radionucléides en surface, puis dans la chaine alimentaire avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA, Qui sera responsable ????... Le Titanic était déclaré insubmersible par son concepteur et pourtant...
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1288 - Qui sera responsable ?
Posée par Jérôme VIT, NÉANT (ANGERS), le 14/12/2013
Quand, dans des années, peu importe le nombre étant donné le type de déchets potentiellement stockés, un accident mécanique, électrique, un bug informatique, une erreur humaine, de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou que sais je encore arrivera, car sur des centaines ou des milliers d'années c'est statistiquement inévitable, et que cela conduira à une explosion, un incendie, une perte de confinement ou des fuites... Et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet, avec les conséquences qu’on connait dans les provinces où des accidents nucléaires ont eu lieu (TCHERNOBYL et FUKUSHIMA notament). Qui sera responsable ? Une chose est sur, c'est qu'aujourd'hui les personnes qui autoriserons cela seront responsable devant l'histoire. Mais qui sera responsable lors de la contamination - invisible, inodore et mortel - qui statistiquement ne peut qu'arriver ???? Qui est, et qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1287 - Qui sera responsable
Posée par Léo BLANC, L'organisme que vous représentez (option) (MONTPELLIER), le 14/12/2013
Quand, dans dans des centaines d'années, un accident mécanique ou électrique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau conduiront à une perte de confinement et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches et l'eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA. Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1286 - Risque pour l'enfouissement des déchets nucléaires
Posée par Grégoire PONSETIS DHOMS, L'organisme que vous représentez (option) (PAU), le 14/12/2013
Qui sera responsable en cas de remontée radio-active suite à un temblement de terre ou un mouvement mécanique du sol ou une infiltration d'eau?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1285 - Qui sera responsable et qui payera?
Posée par Yves FRUCHON, L'organisme que vous représentez (option) (DARDILLY), le 14/12/2013
Quand, dans x dizaines années ou y milliers d’années, (vous mettez le chiffre que vous voulez), un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou ...... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites........ et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet ........ avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ? Et qui payera sinon l'éternel contribuable
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1284 - Qui sera responsable ?
Posée par Christophe COLLARD, L'organisme que vous représentez (option) (SAINT-ETIENNE), le 14/12/2013
Qui sera responsable lorsque un événement majeur ou non prévu provoquera une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites à Bure / CIGEO avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1283 - Qui sera responsable
Posée par Christian BOIRON, L'organisme que vous représentez (option) (VALLIERES LES GRANDES), le 14/12/2013
Description * Qui sera responsable ? > > Quand, dans 15 dizaines années ou 4 milliers d’années > un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine > conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... > et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet > avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA > Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1282 - Qui sera responsable ?
Posée par Romain LESCHIUTTA, L'organisme que vous représentez (option) (SCY-CHAZELLES), le 14/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans 2 dizaines années ou 2 milliers d’années un mouvement de terrain conduira à des fuites et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA. Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1281 - Qui sera responsable ?
Posée par lucas COMTE, L'organisme que vous représentez (option) (ST PERAY), le 14/12/2013
Quand, dans x dizaines années ou y milliers d’années un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille conduiront à une explosion. et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches. avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA) Qui sera responsable?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1280 - qui sera responsable ?
Posée par Mireille BEZIAUD, L'organisme que vous représentez (option) (BRESSOLLES), le 14/12/2013
Quand, dans10 dizaines années ou 1 millier d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1279 - qui sera responsable?
Posée par annick BUREL, L'organisme que vous représentez (option) (LE BOURG), le 14/12/2013
Quand, dans quelques dizaines années ou milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou quelque chose d'autre..... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet,les cultures maraîchères et autres..... avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1278 - responsabilité
Posée par robert LAMAZE, L'organisme que vous représentez (option) (NEUFCHATEAU), le 14/12/2013
qui sera responsable en cas d'accident quelqu'il soit secousse sysmique par exemple ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1277 - qui sera responsable?
Posée par roni HEPP, L'organisme que vous représentez (option) (BAYONNE), le 14/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans des dizaines années ou des milliers d’années un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou chépakoi... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA merci pour les enfants du futur!
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1276 - qui sera responsable ??
Posée par nicole PELLÉ, L'organisme que vous représentez (option) (SAINT MALO), le 14/12/2013
Quand, dans des dizaines années ou un millier d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine...... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues TCHERNOBYL et FUKUSHIMA .... Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1275 - Enfin
Posée par Eve PÈLERINS, L'organisme que vous représentez (option) (HAUTS DE SEINE), le 14/12/2013
Qui sera responsable ? Quelle(s) compagnie(s) d'assurance couvriront les risques éventuels ? Quel organisme supervisera les contrôles ?
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Les risques nucléaires sont couverts par un régime spécifique de responsabilité civile nucléaire régie en France par les conventions de Paris et de Bruxelles. Celles-ci définissent notamment les dommages rattachés à ces risques, l'indemnisation des victimes et les niveaux de garanties requis. Plusieurs tranches de garanties sont prévues : une première à la charge de l'exploitant (qui doit faire l'objet d'une garantie financière, un contrat d'assurance par exemple), une seconde à la charge de l'Etat et enfin une dernière à la charge d'un fonds international.
QUESTION 1274 - Qui sera responsable ?
Posée par Jérôme UHRING, L'organisme que vous représentez (option) (ROMANS), le 14/12/2013
Quand, dans cent ans ou plus, un accident mécanique, ou un accident électrique, ou un bug informatique, ou une erreur humaine, ou une erreur de conception, ou un mouvement de terrain, ou un tremblement de terre, ou un agrandissement de faille, ou une infiltration d’eau, ou une intrusion humaine... conduiront à une explosion, ou un incendie, ou une perte de confinement, ou des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, ou l’eau des rivières, avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA, qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1273 - Qui pourra faire quoi ?
Posée par Claude BOUDROT, L'organisme que vous représentez (option) (DANNEVOUX), le 14/12/2013
Quand mes petits-enfants auront mon âge, dans une 50aine d’années, quand les petits-enfants de mes petits-enfants auront mon âge, dans 100 ans peut-être, et quand un quelconque un accident, ou/et des fuites conduiront à une perte de confinement,... et donc à un retour en surface, de produits toxiques issus des déchets, qu’on les retrouvera dans l’eau des rivières, donc dans l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connait à FUKUSHIMA, après l’horrible TCHERNOBYL, Qui pourra faire quoi ? qui sera responsable ? où les Meusiens et leurs voisins se réfugieront-ils ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1272 - Qui Payera les pots cassés ?
Posée par françoise URBAN, L'organisme que vous représentez (option) (ST JULIEN), le 14/12/2013
Le jour où, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites ou autres réjouissances ,favorisant un retour des radionucléides en surface, dans les champs et l’eau des rivières, et de fait dans l’eau des robinets, avec les conséquences déjà vues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA QUI SERA RESPONSABLE et QUI TRINQUERA ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1271 - Qui sera responsable ?
Posée par ANNE MARIE FORET, L'organisme que vous représentez (option) (AMBERIEU), le 14/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans x dizaines années ou y milliers d’années un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1270 - Qui sera responsable ?
Posée par pierre-yves POULET, L'organisme que vous représentez (option) (BREUILLET), le 14/12/2013
Quand, dans 100 ans ou des milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine,... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1269 - Responsabilité
Posée par Gérard HUBERT, L'organisme que vous représentez (option) (DRAVEIL), le 14/12/2013
Avez vous pu souscrire des assurances responsabilité en cas d'incident grave… et quid si cela intervient dans les 1000 ans à suivre… ? Qui sera jugé responsable en cas d'accident géologique ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1268 - Conséquences au niveau de l'eau du fleuve et potable si accident
Posée par claire AUDEJEAN, L'organisme que vous représentez (option) (LOYETTES ), le 14/12/2013
S'il survient un accident sur la centrale du Bugey ou un dysfonctionnement dans le contrôle centre du stockage des déchets quelles seront les incidences dans toutes les communes, sinon jusqu'à Lyon et plus quant à la contamination de l'eau- pollution du Rhône ! (et de l'air bien sûr) ainsi pouvant toucher un bassin de population extrêmement vaste? Qui sera responsable?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1267 - Que se passera-t-il ensuite ?
Posée par René PETITJEAN, L'organisme que vous représentez (option) (GUYANCOURT), le 14/12/2013
En cas de fuite importante des installations de CIGEO, ou d'accident, qui sera responsable, dans 100 dizaines d'années des fuites d'éléments radioactifs en surface ? Et que deviendra la vie au dessus de déchets nucléaires lorsque les matériaux utilisés seront usagés, dans 2 millions d'années ? Il serait peut-être judicieux d'arrêter les centrales nucléaires dans les deux années qui arrivent !!!!
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Le Président de la République a décidé d’engager la transition énergétique, cette transition reposant d'une part sur la sobriété et l’efficacité énergétique, et d'autre part sur la diversification des sources de production et d'approvisionnement.
Concernant la diversification de nos sources d’énergies, le Président de la République a fixé un cap : réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% d'ici 2025. Parallèlement, le Président de la République a indiqué que la transition énergétique serait fondée sur deux principes : l'efficacité énergétique d'une part, et la priorité donnée aux énergies renouvelables d'autre part. Cette mutation prendra du temps et supposera des étapes d’évaluation en fonction des progrès technologiques et scientifiques et des prix relatifs de chaque source d’énergie.
Un arrêt immédiat ou dans les deux années qui viennent de l’ensemble du parc nucléaire français n’est pas envisageable sans remettre en cause l’approvisionnement électrique du pays. La France ne dispose pas de moyens de production alternatifs capables de se substituer intégralement au parc nucléaire dès aujourd’hui.
QUESTION 1266 - Qui sera responsable ?
Posée par Dominique MATHIEU-VÉRITÉ, L'organisme que vous représentez (option) (LOUPIAC), le 14/12/2013
Pendant les 100 années que devrait durer le remplissage du centre avec des matières radioactives, si la ventilation indispensable au bon déroulement des opérations est défaillante, si un incendie se produit, qui sera responsable de la catastrophe qui s'en suivra pour l'environnement ?
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le risque incendie est pris en compte dès la conception de Cigéo : pour réduire le risque d’incendie, une première mesure consiste à limiter la quantité de produits combustibles ou inflammables dans les équipements du stockage. Par exemple, si Cigéo est réalisé, les câbles électriques seront ignifugés et les véhicules à moteur thermique seront interdits dans l’installation nucléaire souterraine de Cigéo. De plus, des dispositifs de détection incendie seront répartis dans les installations pour détecter rapidement et localiser tout départ de feu. Plusieurs systèmes d’extinction automatiques seront installés dans l’installation souterraine. Des systèmes embarqués d’extinction automatique (gaz, poudre...) seront placés sur les engins de transfert des colis de déchets et sur les engins de manutention en alvéole, afin d’éteindre tout départ de feu. Des systèmes d’extinction automatique seront également disposés dans certaines zones de l’installation souterraine telles que les locaux électriques et les zones de soutien logistique. Ces dispositifs seront mis en place en complément de moyens de lutte contre l’incendie plus traditionnels de types extincteurs, points de raccordement à un réseau d’alimentation en agent extincteur (eau, mousse…) etc.
Malgré toutes ces dispositions, une situation d'incendie est quand même considérée par prudence. Dans les installations de surface, les mêmes principes seront appliqués que dans les installations nucléaires de base : en cas d’incendie, les locaux concernés seraient isolés du reste de l’installation, les moyens d’extinction et d’intervention seraient déclenchés et le personnel serait évacué. Dans l’installation souterraine, compte tenu de sa géométrie spécifique, ces dispositions sont adaptées dès la conception. Des systèmes de compartimentage et de ventilation sont prévus pour limiter la propagation du feu. Des équipements d’intervention seront prépositionnés dans l’installation souterraine en permanence. L'architecture souterraine retenue pour le stockage permettra aux secours d'intervenir dans des galeries à l'abri des fumées et facilite l'évacuation du personnel.
Outre la mise à l’abri du personnel, la maîtrise du risque incendie vise aussi à protéger les colis contenant les substances radioactives des effets de l’incendie afin de maintenir le confinement de ces substances. Pour cela, les colis seront disposés dans des équipements qualifiés pour résister au feu (cellules résistantes au feu munies de portes coupe-feu, hotte de protection pour le transfert dans l’installation souterraine). Les conteneurs de stockage sont également conçus pour assurer une protection contre l’incendie. Ces dispositions permettent d’exclure tout effet domino entre les colis stockés.
La définition de l’ensemble de ces dispositifs associe les services compétents des sapeurs-pompiers et fait l’objet de contrôle par l’Autorité de sûreté nucléaire. Cigéo ne sera jamais autorisé si l’Andra ne démontre pas qu’elle maîtrise tous les risques, dont le risque d’incendie.
QUESTION 1265 - Qui sera responsable?
Posée par Lolita LESAGE, L'organisme que vous représentez (option) (CONDÉ SUR RISLE), le 14/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans x dizaines années ou y milliers d’années, un accident mécanique, un bug informatique, une erreur humaine, un mouvement de terrain, un tremblement de terre,une infiltration d’eau, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, leau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à FUKUSHIMA et Tchernobyl: Qui sera responsable?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1264 - Qui sera responsable ?
Posée par Christine FRANQUET, L'organisme que vous représentez (option) (BRESLES), le 14/12/2013
Qui sera responsable, quand, dans 10 ans, 100 ans ou 1000 ans, un mouvement de terrain ou un tremblement de terre conduiront à une perte de confinement et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’eau des rivières et l’eau du robinet, avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA. Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1263 - Qui sera responsable?
Posée par Gilles DARPENTIGNY, L'organisme que vous représentez (option) (SILHAC), le 14/12/2013
Quand, dans 200 ans, un accident mécanique ou un accident électrique ou un bug informatique ou une erreur humaine ou une erreur de conception ou un mouvement de terrain ou un tremblement de terre ou un agrandissement de faille ou une infiltration d’eau ou une intrusion humaine, conduiront à une explosion ou un incendie ou une perte de confinement ou des fuites et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA . Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1262 - QUI SERA RESPONSABLE ?
Posée par jean louis DAL FERRO, L'organisme que vous représentez (option) (SARREGUEMINES ), le 14/12/2013
quand dans 10 ans , 30 , 50 ans, 500 ans ,5000 ans ,18700 ans, c 'est à dire à des echelles de temps depassant de plusieurs fois la durée de la civilisation humaine jusqu'à aujourd'hui , lorsque les hommes, les états les cultures, les langues auront changés ,un accident mecanique , electrique, informatique, une erreur humaine , de conception, un mouvement geologique , un tremblement de Terre un mouvement de faille, une infiltration d' eau , une intrusion humaine , conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement , des fuites , et donc à un retour de radionucleïdes en surface , entrainant IRREMEDIABLEMENT les consequences DEJA CONNUES de Tchernobyl , Fukushima , Mururoa , QUI SERA RESPONSABLE ? déjà aujourd'hui , l'on se sait pas démanteler un réacteur : çà fait plus de 20 ans et plus de 10 ans à Brennilis et Chooz que l'on y travaille et l'on y arrive pas du fait de l 'intensité persistante de la radioactivité , alors dans 5000 ans quand tout le savoir de notre epoque aura disparu QUI ? et COMMENT ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1261 - Qui sera responsable ?
Posée par Gilles FLEURY, L'organisme que vous représentez (option) (BOISSY LAMBERVILLE), le 14/12/2013
Quand, dans 2 milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau ou une intrusion humaine, conduiront à une explosion ou un incendie et des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’eau des rivières et celle du robinet avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1260 - Qui sera responsable ?
Posée par Monique BALLARD, L'organisme que vous représentez (option) (ANGERS), le 14/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans des centaines d' années ou des milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA . Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1259 - Qui sera responsable ?
Posée par Isabelle GEORGES, L'organisme que vous représentez (option), le 14/12/2013
Quand, dans 50 dizaines années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites...et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA ... Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1258 - Certitude et responsabilité ?
Posée par Renaud NIEPCERON, L'organisme que vous représentez (option) (LYON), le 14/12/2013
Comment les experts en charge de conseiller les décideurs peuvent ils avoir des certitudes sur la stabilité du site sur une période de plus de 1000 ans lorsque l'on fait un retour d'expérience sur la "capacité" de notre civilisation moderne à prévoir des événements simples (Type Tsunami) ou défaillances humaines (Type Tchernobyl) sur une période relativement courte... Et quid de la responsabilité en cas de problème d'ici 50 / 100 ans ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1257 - Qui sera responsable ?
Posée par denis MASSE, L'organisme que vous représentez (option) (TROYES), le 14/12/2013
Quand, dans des dizaines années un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduiront à une explosion, un incendie ou une perte de confinement, et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA. Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1256 - Qui sera responsable ?
Posée par Marie-Line DEPUISET, L'organisme que vous représentez (option) (METZ), le 14/12/2013
Quand, dans x dizaines années ou y milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou chépakoi...conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA. Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1255 - Qui sera responsable ?
Posée par cath HEBRARD, L'organisme que vous représentez (option) (MIREPOIX), le 14/12/2013
Quand, dans x dizaines années ou y milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, un cause à laquelle personne n'avait pensé, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites,etc...... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet , avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1254 - et en cas de probleme
Posée par serge VANTALON, L'organisme que vous représentez (option) (TERCILLAT), le 14/12/2013
en cas de probleme car c'est sur qu'il y en aura pendant les 100.000 ans de stockage, en fait tout ce que j'ai pu lire est plutot vague , considerant que tout ira bien pendant l'éternité il n' y a pas vraiment de solution concrete et surtout réalisable; par exemple il sear en pratique impossible de resortir les dechets; qui sera responsable de la catstrophe majeur qui va couver sous nos pieds puisque chaque probleme possible n'a pas de solution applicable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1253 - Qui sera responsable ?????
Posée par Mick MOREAU, L'organisme que vous représentez (option) (SARLAT), le 14/12/2013
Quand, dans des dizaines années ou des milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine ... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet ... avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA... Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1252 - Responsabilité ?
Posée par Aymeric DE VALON, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 14/12/2013
Qui est et sera responsable vis-à-vis des générations futures en cas de fuites et de contamination radioactive ce qui est malheureusement le plus probable ???
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1251 - qui sera responsable ?
Posée par jaquier JEAN-FRANÇOIS, L'organisme que vous représentez (option) (PLOUAY), le 14/12/2013
qui sera responsable des dégâts, s'il y en avait ? qui sera responsable du financement ? on voit que Tepco n'était pas assuré pour ses centrales: les compagnies d'assurance ne prennent pas le nucléaire en charge. qui sera responsable de la sécurité des personnes habitant dans les alentours de la centrale ? deux ans et demi plus tard, personne des 160 000 déplacés n'a pu retrouver de foyer.
Réponse du 31/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Cigéo n’est pas une centrale nucléaire mais un centre de stockage de déchets (stabilisés et conditionnés dans des fûts en béton ou en acier) qui du fait de son implantation à 500 mètres de profondeur sera peu vulnérable aux activités humaines comme aux catastrophes naturelles à l’inverse d’une centrale comme celle de Fukushima au Japon. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels montre que leurs conséquences resteraient limitées, et nettement en deçà du seuil réglementaire qui imposeraient des mesures de protection des populations (mise à l’abri, évacuation).
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestions sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Les risques nucléaires sont couverts par un régime spécifique de responsabilité civile nucléaire régie en France par les conventions de Paris et de Bruxelles. Celles-ci définissent notamment les dommages rattachés à ces risques, l'indemnisation des victimes et les niveaux de garanties requis. Plusieurs tranches de garanties sont prévues : une première à la charge de l'exploitant nucléaire (qui doit faire l'objet d'une garantie financière, un contrat d'assurance par exemple), une seconde à la charge de l'Etat et enfin une dernière à la charge d'un fonds international.
QUESTION 1250 - Qui sera responsable ?
Posée par Linda MAZÉ, L'organisme que vous représentez (option) (RENNES), le 14/12/2013
Quand, dans des dizaines années ou milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites, et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet, avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA, qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1249 - Qui sera responsable
Posée par Hussenot JACQUELINE, L'organisme que vous représentez (option) (PAU ), le 14/12/2013
Quand, dans des dizaines années ou mieux des milliers d’années, si intervient un accident électrique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, qui conduiront à une explosion, une perte de confinement, voire des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe, l’eau des rivières et donc du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA. Qui sera responsable devant VOS enfants et VOS petits enfants et aussi les NÔTRES ????? La sagesse est d'arrêter de produire ces déchets immédiatement.
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1248 - Qui sera responsable ?
Posée par Marine DRAPIER, L'organisme que vous représentez (option) (MALZÉVILLE), le 14/12/2013
Quand un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau ou une intrusion humaine par exemples conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement ou des fuites, et donc à un retour des radionucléides en surface, dans notre eau puis notre alimentation avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA, qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1247 - Qui sera responsable ?
Posée par Georges BIRAULT, L'organisme que vous représentez (option) (ILE D'YEU), le 14/12/2013
Quand, dans 10 dizaines années ou 2 milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou une erreur insoupçonnable aujourd'hui conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet ou ailleurs dans la vie des humains avec les conséquences qu’on a connues àTCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1246 - Responsabilité
Posée par Eric GOVIN, L'organisme que vous représentez (option) (ST REMY LA VARENNE 49250), le 14/12/2013
Qui sera responsable Quand, dans un siècle un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement,avec les terribles conséquences qui en découleront.Ou seront ceux qui aujourd'hui font la promotion d'une si folle ineptie?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1245 - Le problème du nucléaire n'est-il pas la création de déchets plutôt que leur traitement et enfouissement ?
Posée par Jean-Louis JARRY, L'organisme que vous représentez (option) (CORTAMBERT), le 14/12/2013
Le passage de l'Homme sur terre, je veux dire l'Humanité, ne représente qu'une très petite fraction du temps depuis la création de la Terre. Nous ne sommes pas maître des déchets produits par l'industrie nucléaire, au regard de leur durée de vie face à celle de la nôtre, individu et même civilisation. Combien de civilisations depuis seulement 6000 ans, début de notre histoire, se sont épanouies et ont disparues. Qu'adviendra-t-il à la fin de la nôtre ? Qui peut garantir sur une échelle de temps aussi longue (plusieurs milliers d'années) la pérennité d'un système de confinement tel que celui prévu ? Personne. Ce n'est pas d'un problème technique qu'il s'agit, mais plus sérieusement d'une question philosophique. Le reste n'est que détail, sans intérêt. Cessons de produire ce genre de déchets, c'est l'unique solution au problème posé. Quant aux déchets déjà produits ... qui est responsable ?
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Vous proposez une autre voie pour aborder la question des déchets : ne plus en produire. Il n’appartient pas à l’Andra de se positionner sur la politique énergétique de la France.
Le travail de l’Andra est de s’assurer que, quels que soient les choix énergétiques futurs, notre génération propose aux générations suivantes une solution permettant de mettre définitivement en sécurité les déchets produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles.
QUESTION 1244 - Qui sera responsable ?
Posée par Anne ZZ, L'organisme que vous représentez (option) (AUBAGNE), le 14/12/2013
Quand, dans x dizaines années ou y milliers d’années, (vous mettez le chiffre que vous voulez), un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou chépakoi... (vous choisissez ce que vous voulez) conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... (vous choisissez ce que vous voulez) et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet (vous choisissez ce que vous voulez) avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA (désolé, là vous n’avez pas le choix) Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1243 - Qui sera responsable ?
Posée par Yvette LOUCHART, L'organisme que vous représentez (option) (PROVIN ( NORD)), le 14/12/2013
Quand, dans plusieurs dizaines d'années ou quelques milliers d'années, un accident mécanique, un accident électronique, un bug informatique,un mouvement de terrain, un tremblement de terre, une infiltration d'eau etc...conduiront à une explosion, un incendie ou une perte de confinement, des fuites se produiront , apportant des radionucléides en surface, c'est à dire dans l'herbe des vaches ou la terre des champs, dans l'eau des rivières ou l'eau du robinet...avec les conséquences qu'on a connues à Kychtym, Tchernobyl et Fukushima. Qui sera alors responsable ? Et qui peut aujourd'hui certifier qu'aucun de ces évènements ne se produira ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1242 - Qui sera responsable ?
Posée par Gérard CHABERT, L'organisme que vous représentez (option) (AUBAGNE), le 14/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans des dizaines d'années ou des milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA, qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1241 - Qui sera responsable?
Posée par DIDIER REGEON, FRONT DE GAUCHE (PAREMPUYRE ), le 14/12/2013
Quand, dans 5 dizaines d'années un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d'eau, une intrusion humaine ou tout autre événement fortuit conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites d'ordres divers et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l'herbe des vaches, le pied des girolles, l'eau des rivières, l'eau du robinet avec les conséquences qu'on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA : qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1240 - Qui sera responsable ?
Posée par Pierre et Monique GUETH, L'organisme que vous représentez (option) (ORSCHWIHR), le 14/12/2013
Quand, dans 100 000 ans, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... (et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1239 - Qui sera responsable ?
Posée par Gécko JLAABEGUIOP, L'organisme que vous représentez (option) (ST-LAURENT/SALANQUE), le 14/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans plusieurs dizaines années ou même plusieurs milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou tout autre incident conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet, l'air que nous respirons avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA : Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1238 - Qui sera responsable ?
Posée par isabelle SAULNIER, L'organisme que vous représentez (option) (GARD), le 14/12/2013
Quand, dans des dizaines années ou des milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine..... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet ........ avec les conséquences qu’on connait à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1237 - Qui sera responsable ?
Posée par Paul BURET, SORTIR DU NUCLÉAIRE (ANGERS), le 14/12/2013
Quand, dans 10 dizaines années ou 1 milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou je ne sais quelle catastrophe conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites, un gigantesque séisme et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet ou de la baignoire de nos arrières, arrières petits enfants, avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?.........
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1236 - qui sera, qui est responsable?
Posée par Martine BILLIE, CITOYENNE (FRANCE), le 14/12/2013
Ma fille est née le 6 avril 1986. 20 jours plus tard il y a eut l'accident de Tchernobyl. Dans quelques jours sa fille, donc ma petite fille doit naître et vous décidez de maintenir voire d'augmenter l'incertitude de son avenir et celui de toutes les générations à venir. Quand, dans des d'années, le changement climatique, les mouvements naturels de la croûte terrestre, la pénurie de matière première , un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, une corrosion, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine ou autre... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ? Que vous dis votre bon sens?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1235 - Qui sera responsable ?
Posée par jf TAMBOLONI, L'organisme que vous représentez (option) (GY), le 14/12/2013
Quand, dans une dizaines années ou des milliers d’années,un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA qui ce rappel du la panacée annoncées par nos brillants scientifiques après le choix de la fosse abyssale comme solution définitives pour nos déchets nucléaires? Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1234 - qui sera responsable?
Posée par Bernrad LIEUTONT, L'organisme que vous représentez (option) (TONLIEUX), le 14/12/2013
Qui sera responsable des accidents au CIGEO?
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 1233 - pourquoi
Posée par mosser ELISABETH, L'organisme que vous représentez (option) (HAUTE MARNE), le 14/12/2013
quand dans un avenir de x années il pourra se produire un accident ou un incident que vous ne voulez pas envisager (comme à fukushima ou tchernobyl) qui sera responsable des fuites , de la contamination etc .. la population de la région ... mes enfants seront sacrifiés à votre trop grand aveuglement .
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1232 - Qui sera responsable ?
Posée par Antoine BEAUDONNAT, L'organisme que vous représentez (option) (EURE), le 14/12/2013
Quand, dans 100 ans, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1231 - Qui sera responsable ?
Posée par Pierre-Alain DUCASSE, L'organisme que vous représentez (option) (TALENCE), le 14/12/2013
Quand, dans des dizaines années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1230 - Qui sera responsable ?
Posée par bernadette BRICARD, L'organisme que vous représentez (option) (NEUFCHÂTEAU ), le 14/12/2013
Quand, dans 15 ans, à la suite d' un accident mécanique, ou électrique (ou les deux combinés), un bug informatique ou une erreur humaine (causes de l' accident électrique ou mécanique), surviendra une perte de confinement, permettant des fuites... et donc la présence de radionucléides en surface, dans la terre, l' eau, l' eau du robinet et tous les produits agricoles avec les conséquences indéniables qu' on connaît à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA...Qui sera responsable , Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1229 - Dangerosité du stockage des déchets nucléaires
Posée par camille DAME, L'organisme que vous représentez (option), le 14/12/2013
Qui est responsable pour maintenant et pour l'avenir de la production des déchets nucléaires qui détruisent la planète et ses habitants. dc.
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1228 - Qui sera responsable ?
Posée par Olivier CLAVAUD, L'organisme que vous représentez (option) (RIOM), le 14/12/2013
Quand, dans 1 ou 2 dizaines années un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, une chute d'avion conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1227 - Qui est responsable de la mort de mon père
Posée par Jean-Yves PEILLARD, WWW.INDEPENDENTWHO.ORG (DIENVILLE), le 14/12/2013
Bonjour, mon père était adjoint au maire de Dienville, il était paysan et mort d'un cancer du grand colon à l'âge de 55ans. Il était deux fois plus fort que moi, on ne meurt pas à l'âge de 55ans. La question pour moi et que je vous pose aussi est qui est responsable de la mort de mon père? Est-ce les pesticides ? je me suis engagé avec les faucheurs volontaire pour lutter contre Monsanto et son monde depuis 10ans et suis dans plusieurs procès en cours. Est-ce le nucléaire? je me suis engagé avec les vigies devant l'OMS depuis 7ans pour lutter contre le nucléaire et son monde. Est-ce qu'il y a un registre des cancers et autres pathologies qui soient en place depuis plus de vingt ans et ouvert au public , intègre, indépendant etc? J'ai vécu 6ans devant le Vercors et je vis maintenant depuis 12ans devant les Glières. Nous ne reculerons pas, c'est notre culture. Notre culture ce n'est pas le suicide( ni par les pesticides ni par l'immolation par le feu). notre culture c'est la résistance, notre culture c'est la révolte contre la barbarie, Qu'il soit technologique ou non, bureaucratique ou non, c'est toujours du facisme. Je reprend les mots de Tolstoï dans "L'esclavage moderne", il citait la devise des juristes "Que justice soit faite, le monde dut-il en périr. Qui sera responsable ? Quand, dans 50 dizaines années ou des milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, o conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... (vous choisissez ce que vous voulez) et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet a connues à Semipalatinsk, falloudjah, In Eker, Faléa, Arlit, Nevada, KYCHTYM,TCHERNOBYL, FUKUSHIMA Tricastin etc
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1226 - Qui sera responsable ?
Posée par catherine ENGELS, L'organisme que vous représentez (option) (CORNEVILLE SUR RISLE), le 14/12/2013
Quand, dans une centaine années un accident mécanique,ou un accident électrique, ou un bug informatique, ou une erreur humaine, ou une erreur de conception,ou un mouvement de terrain, ou un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites. et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1225 - Qui sera responsable ?
Posée par Jean-Pierre FERTALA, L'organisme que vous représentez (option) (L'ABERGEMENT DE VAREY), le 14/12/2013
Quand, dans 30 dizaines années ou 2 milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou une explosion suite à un "gros" accident industriel conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites...Et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, THREE MILE ISLAND, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1224 - Que laisserons nous aux générations futures ?
Posée par Claire BOUSSARD, L'organisme que vous représentez (option) (GRENOBLE), le 14/12/2013
Quand, dans x dizaines années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduiront à des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1223 - QUI SERA RESPONSABLE ?
Posée par anne JACMAIRE, L'organisme que vous représentez (option) (ARRAS), le 14/12/2013
Quand, dans 3 dizaines années ou 2 milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou un attentat.....conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet .....avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1222 - Qui sera responsable ?
Posée par Mickael MARTIN, L'organisme que vous représentez (option) (MARCELLAZ-ALBANAIS), le 14/12/2013
Quand, dans quelques dizaines d'années ou milliers d’années, un mouvement de terrain, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau ou une intrusion humaine conduiront à une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides dans l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA... Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1221 - Qui sera responsable ?
Posée par Céline PASQUET, L'organisme que vous représentez (option) (ANGERS), le 14/12/2013
Quand, dans 20 ans ou 100 000 ans? un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou chépakoi... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA, Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1220 - Qui sera responsable ?
Posée par Gilbert BELGRANO, L'organisme que vous représentez (option) (VALFLEURY), le 14/12/2013
Quand, dans quelques dizaines ou milliers d’années, un accident mécanique, électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, provoqueront une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites et donc un retour des radionucléides en surface, avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, YCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1219 - nom du responsable
Posée par d BEAL, L'organisme que vous représentez (option) (CESANCEY), le 14/12/2013
Qui assumera la responsabilité d'une fuite radioactive majeure avec dispersion de radio nucléides dans l'écosystème dans 150 ans suite à un séisme ? QUI ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1218 - Comment avez vous prévu de remédier aux incidents à venir?
Posée par Patrick BOULÉ, L'organisme que vous représentez (option) (KERNASCLEDEN), le 14/12/2013
Pendant les travaux de réalisation, pendant la phase d'entreposage des déchets, ainsi que la phase de surveillance, il va forcement y avoir des incidents, des choses non prévues, car a-t-on déjà des retours d'expériences sur des cas similaires. Je ne crois pas, ou des retours négatif sur des cas beaucoup plus simple techniquement (Allemagne). Qu'es-t-il prévu pour remédier à ces incidents? Qui sera responsable des erreurs de conception, des écarts de comportement des sols, des déchets par rapport aux calculs? Et après la phase d'observation, une fois que l'on aura plus accès aux galerie de stockage, on ne pourra plus dire "stockage", puisque ce sera irréversible! Ce n'est donc pas du stockage, c'est de l'ABANDON!
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1217 - Qui sera responsable ?
Posée par Mathilde RIEANT, L'organisme que vous représentez (option) (GONNEVILLE- LA-MALLET), le 14/12/2013
Quand, dans des milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet (vous choisissez ce que vous voulez) avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1216 - Alerte: qui prendra la responsabilité des conséquences d'un accident? 'un accident ?
Posée par Anne-Marie VERNON, L'organisme que vous représentez (option) (VALENCE), le 14/12/2013
Quand, dans quelques dizaines d' années ou 1 millier d’années ou autre , un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine ou ...conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites...et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet, l'air ...avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA, QUI SERA RESPONSABLE ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1215 - QUI ??
Posée par Bernard DURAND, AUCUN (NICORPS), le 14/12/2013
Qui assumera la responsabilité de la catastrophe ou des crimes invisibles dont les responsables actuels savent que ces évènements ne risquent en aucun cas de leur faire mal aux dents. Nous avons déjà la réponse dans le comportement irresponsable et mensonger des responsables des catastrophes nucléaires actuelles.
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Monsieur,
Les personnes de l’Andra qui travaillent sur les sites de stockage et habitent à proximité sont les premières concernées par la sécurité. Croyez-vous qu’elles accepteraient de travailler sur un site dont la sûreté ne serait pas garantie ?
Quels que soient les choix énergétiques futurs, c’est la responsabilité de notre génération de proposer aux générations suivantes une solution permettant de mettre définitivement en sécurité ces déchets, qui sont produits en France depuis plusieurs dizaines d’années. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est justement de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de ces déchets. Grâce à la réversibilité, les générations suivantes garderont la possibilité de faire évoluer cette solution si elles le souhaitent.
QUESTION 1214 - OU seront les responsables de l'enfouissement dans trente ans??
Posée par Jacques MOUGEOT, L'organisme que vous représentez (option) ( ATHESANS), le 14/12/2013
OU seront les responsables de l'enfouissement dans trente ans??
Encore en politique?
Réponse du 06/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestions sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 1213 - qui sera responsable?
Posée par beauquis HELENE, L'organisme que vous représentez (option) (DOUVRES), le 14/12/2013
Quand dans un avenir plus ou moins proche un événement naturel provoquera des fuites avec retour des radionucléides en surface dans l'eau des rivières, qui sera responsable?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1212 - Responsabilité?
Posée par Isabelle THIÉBAUT, L'organisme que vous représentez (option) (RELANGES), le 14/12/2013
Qui sera responsable et que pourra-t-on faire en cas de fuite radioactive?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1211 - Qui sera responsable
Posée par Mario MULÉ, L'organisme que vous représentez (option) ( LA TRINITÉ), le 14/12/2013
Quand, dans 150 ans, un accident mécanique, ou électrique, ou informatique, ou une erreur humaine, ou un acte terroriste ou des mouvement géologiques permettant une infiltration d’eau, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites, ou même un accident de criticité car il est question de stocker des déchets de plutonium, ... provoquant un retour des radionucléides en surface, avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA ! Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1210 - responsabilitées
Posée par Robert MASSENET, L'organisme que vous représentez (option) (COUPRAY), le 14/12/2013
Qui sera responsable en cas de catastrophe du type tchernobyl ou fukushima?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1209 - qui sera responsable dans plusieurs milliers d'années des déchets radioactifs enfouis et peut être
Posée par marie-christine MATHIEU, L'organisme que vous représentez (option) (CHAMBERY), le 14/12/2013
Qui sera responsable dans plusieurs milliers d'années des déchets radioactifs enfouis et peut être en cas de tremblement de terre, d'erreur humaine, de conflit, etc, les déchets seront de toutes façons toujours radioactifs et des infiltrations sont toujours possibles.
Réponse du 31/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestions sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 1208 - qui sera responsable?
Posée par jacqueline FONTAINE, EELV (NANCY), le 14/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans x dizaines années ou y milliers d’années, (vous mettez le chiffre que vous voulez), un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou chépakoi... (vous choisissez ce que vous voulez) conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... (vous choisissez ce que vous voulez) et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet (vous choisissez ce que vous voulez) avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA (désolé, là vous n’avez pas le choix) Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1207 - responsabilitées futures
Posée par j-louis TESTAS, L'organisme que vous représentez (option) (CASTELSAGRAT), le 14/12/2013
Qui assumera la maintenance dans 50 ou 100ans?
Réponse du 30/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maitre d’ouvrage :
La maintenance du site sera assurée par l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, pendant toute la période d’exploitation du centre, prévue pour une centaine d’année.
Le Parlement a justement fait le choix de confier la gestion des déchets radioactifs sur le long terme à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat, et non à une société privée.
QUESTION 1206 - quelle responsabilité?
Posée par armelle GALLOT-LAVALLÉE, L'organisme que vous représentez (option) (FRANCE), le 14/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans des centaines d'années...ou moins, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduiront à une perte de confinement et donc à un retour des radionucléides en surface dans l’eau des rivières et du robinet avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1205 - Qui sera responsable ?
Posée par Maryse ALLARD, L'organisme que vous représentez (option) (LA RIVIÈRE DE CORPS), le 14/12/2013
S'il y a un problème majeur comme à Fukushima avec les déchets radioactifs enfouis, c'est à dire cachés ? Qui sera responsable ? Franchement il n'y a pas de bonne solution avec les déchets radioactifs, alors pourquoi continue t on d'en produire ??? de vendre des centrales à des pays qui n'ont pas encore ce fléau sur leur terre ?
Réponse du 10/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Cigéo n’est pas une centrale nucléaire mais un centre de stockage situé à 500 mètres de profondeur, qui sera peu vulnérable aux activités humaines comme aux catastrophes naturelles. L’objectif du stockage profond n’est pas de cacher les déchets mais de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les déchets dont il est question ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées et nettement en-deçà du seuil réglementaire qui imposerait des mesures de protection des populations (mise à l’abri, évacuation).
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
En France, le nucléaire occupe une place prépondérante dans le mix électrique, assurant près de 75% de la production française d’électricité. Compte tenu de la durée nécessaire à la construction de moyens de production d’électricité de substitution, un arrêt à court terme de l’ensemble du parc nucléaire n’est pas envisageable sans remettre en cause l’approvisionnement électrique du pays, c’est à dire sans coupures très importantes d’électricité pour les consommateurs. Il apparaît donc extrêmement difficile de ne plus produire de nouveaux déchets radioactifs provenant de l’industrie électronucléaire à très court terme.
En matière de mix électrique, le Président de la République a fixé le cap suivant pour la France : réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% d'ici 2025. Parallèlement, le Président de la République a indiqué que la transition énergétique serait fondée sur deux principes : l'efficacité énergique d'une part, et la priorité donnée aux énergies renouvelables d'autre part. Cette mutation prendra du temps et supposera des étapes d’évaluation en fonction des progrès technologiques et scientifiques et des prix relatifs de chaque source d’énergie.
QUESTION 1204 - Qui sera responsable ?
Posée par catherine RECHARD, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 14/12/2013
Quand, dans des dizaines années ou des milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,TCHERNOBYL et FUKUSHIMA, qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1203 - Savez vous qui sera responsable?
Posée par juliette QUIGNON, L'organisme que vous représentez (option), le 14/12/2013
Quand, dans quelques années ou quelques milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, une intrusion humaine, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du ro binet, la terre qui nous nourri avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ? Dès aujourd'hui nous connaissons les listes des responsables qui mettent l'humanité dans cette imposture.
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1202 - Qui sera responsable?
Posée par Guylaine MERHAN, L'organisme que vous représentez (option) (NANTES), le 15/12/2013
Enfouissement, stockage, et le nucléaire en général ... Qui est déjà responsable de tous les accidents nucléaires du passé? Mais qui veut encore nous faire croire que le nucléaire a de l'avenir? Il n'y aura que les dégâts, tous les dégâts, causés directement ou indirectement (toutes les maladies sur plusieurs générations-quand elles n'ont pas tué aussitôt, le gâchis dans la nature, qui se verront encore dans les décennies, dans les siècles à venir. Ne vaut-il pas mieux travailler sur une réflexion ensemble, en toute humilité ?
Réponse du 31/01/2014,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
La loi du 28 juin 2006 a fait le choix du stockage réversible profond pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations futures. Elle demande à l’Andra d’étudier et d’implanter Cigéo en rappelant que « la demande d'autorisation de création [d’un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs] doit concerner une couche géologique ayant fait l'objet d'études au moyen d'un laboratoire souterrain ». L’Andra poursuit donc ses études en vue d’élaborer pour 2015 le dossier support à l’instruction de la demande d’autorisation de création de Cigéo en Meuse/Haute-Marne, dans la couche d’argile dont les propriétés de confinement sont désormais reconnues.
Quelles que soient les orientations en matière de politique nucléaire, les déchets déjà produits devront être gérés de façon sûre et responsable.
Enfin, le Président de la République a décidé d’engager la transition énergétique, cette transition reposant d'une part sur la sobriété et l’efficacité énergétique, et d'autre part sur la diversification des sources de production et d'approvisionnement.
Concernant la diversification de nos sources d’énergies, le Président de la République a fixé un cap : réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% d'ici 2025. Parallèlement, le Président de la République a indiqué que la transition énergétique serait fondée sur deux principes : l'efficacité énergétique d'une part, et la priorité donnée aux énergies renouvelables d'autre part. Cette mutation prendra du temps et supposera des étapes d’évaluation en fonction des progrès technologiques et scientifiques et des prix relatifs de chaque source d’énergie.
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Quels que soient les choix énergétiques futurs, c’est la responsabilité de notre génération de proposer aux générations suivantes une solution permettant de mettre définitivement en sécurité ces déchets, qui sont produits en France depuis plusieurs dizaines d’années. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est justement de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de ces déchets. Grâce à la réversibilité, les générations suivantes garderont la possibilité de faire évoluer cette solution si elles le souhaitent.
QUESTION 1201 - la sécurité est elle totale ?
Posée par albin MOSELE, L'organisme que vous représentez (option) (CHAMBERY), le 15/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans 8 dizaines années ou 2milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA (désolé, là vous n’avez pas le choix) Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1200 - ALORS QUI ???
Posée par FRANCOISE SUTTER, L'organisme que vous représentez (option) (KINGERSHEIM), le 15/12/2013
Imaginons une panne, une erreur (personne n'est parfait, même pas dans le nucléaire, cf Tchernobyl, Fukushima...), un incendie etc .... qui sera tenu pour responsable des conséquences catastrophiques qui en découleront, qui paiera ???
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1199 - Qui sera responsable ?
Posée par Aline LETELLIER, L'organisme que vous représentez (option) (SAUCHAY), le 15/12/2013
Quand dans quelques années, un accident, une erreur humaine ou de conception, un événement météorologique ou autre, conduiront à une explosion, une perte de confinement, des fuites....et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l'eau, la végétation....... avec les conséquences que l'on a connues à Tchernobyl, à Fukushima, qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1198 - Qui sera responsable ?
Posée par Lise MEDINI, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 15/12/2013
Quand, dans quelques dizaines années ou plus tard, un accident mécanique ou électrique, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, ou un agrandissement de faille,conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement ou des fuites et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’eau des rivières, l’eau du robinet, les cultures maraîchères, avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA , qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1197 - qui sera responsable ?
Posée par Eve TRÉMOULIÈRE, L'organisme que vous représentez (option) (METZ), le 15/12/2013
Quand, dans 100 milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduiront à une explosion, et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à ) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA , qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1196 - Qui sera responsable ?
Posée par Jean-Marie VIEILLE, L'organisme que vous représentez (option) (BESANÇON), le 15/12/2013
Si dans la dizaine de milliers d'année à venir un tremblement de terre entrainait une perte de confinement et à des fuites radioactives, avec les conséquences que l'on trouve à Fukushima, qui sera responsable?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1195 - Qui sera responsable ?
Posée par Marc BELUET, L'organisme que vous représentez (option) (FRANCE), le 15/12/2013
Quand, dans x dizaines années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou chépakoi... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1194 - Qui sera responsable à l'avenir?
Posée par Jacques NICOLAS, L'organisme que vous représentez (option) (TOUVRE), le 15/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans 5 dizaines d'années ou 17 milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1193 - Qui sera responsable ?
Posée par Roberto ERNESTI, L'organisme que vous représentez (option) (METZ), le 15/12/2013
Quand, dans des dizaines années ou des milliers d’années, un accident, un bug, une erreur, un mouvement de terrain, une infiltration, une intrusion ou autre conduiront à un incident ou accident et donc à un retour des radionucléides en surface, avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA, qui sera responsable ? Les décisions d'aujourd'hui engagent la vie de nos enfants et petits enfants.
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1192 - Qui sera responsable ?
Posée par Rodolphe ANDRÉ, L'organisme que vous représentez (option) (TOURS), le 15/12/2013
Quand, demain, un accident, une erreur, un mouvement, une infiltration, conduiront à des fuites, et donc à des radionucléides ou des révoltes en surface, avec les conséquences connues déjà dans l'histoire humaine : Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1191 - Responsabilité
Posée par Yves GROSSET-GRANGE, L'organisme que vous représentez (option) (LA ROCHELLE), le 15/12/2013
Qui sera responsable, qui devra assumer, les dommages éventuellement très graves qui pourront se produire dans quelques centaines ou milliers d'année lorsque, à la faveur de mouvemnts de l'écorce terresre ou d'actions humaines de forage, les produits toxiques dont nous sommes auteurs, reviendront dans l'espace vital de gens du futur qui ne nous ont rien fait ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1190 - qui sera responsable
Posée par caherine MERCCION, L'organisme que vous représentez (option) (JAYAT), le 15/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans x dizaines années ou y milliers d’années, ou demain, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ? catherine Merccion
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1189 - QUI SERA RESPONSABLE
Posée par Claude MARTROU, L'AVENIR DE NOS ENFANTS (CLAPIERS), le 15/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans quelques dizaines d'années ou quelques milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou n'importe quel évènement imprévisible,conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA. Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1188 - qui sera responsable ?
Posée par olivier HARQUET, L'organisme que vous représentez (option) (SAINT OUEN LES PAREY), le 15/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans quelques dizaines années ou milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou ..... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1187 - Qui sera responsable ?
Posée par Gérard WECKER, CITOYEN (THIONVILLE), le 15/12/2013
Quand, dans seulement quelques dizaines années ou même jusqu'à 100 milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1186 - Quelles garanties à long terme?
Posée par Carl WAROQUIERS, L'organisme que vous représentez (option) (VIENNE), le 15/12/2013
Bonjour La gestion à long et très long terme des déchets pourra-t-elle être prise en charge par les générations futures? Quelles garanties avons-nous là-dessus? Et de quel droit leur laissons-nous en héritage ces déchets? En cas d'accident dans 10.000 ans dans le centre de stockage, qui sera tenu pour responsable, et qui devra gérer (techniquement, financièrement) les fuites radioactives dans l'environnement? Parmi les personnes qui soutiennent Cigéo, qui a vécu de manière durable dans des lieux contaminés (ex. zones contaminées par Tchernobyl) et mesure le poids insoutenable de cette contamination sur sa santé et sur celle de ses enfants? Qui, parmi les adeptes de Cigéo, resterait vivre avec sa famille dans une région contaminée? et qui quitterait la région? Combien de régions, de forêts, de villes, sommes-nous disposés à sacrifier? En définitive, l'enfouissement des déchets en profondeur n'est pas simplement un report irresponsable de nos choix sociétaux et technologiques sur l'avenir de l'humanité et de la planète? Carl Waroquiers
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1185 - Question de responsabilité, et de conscience
Posée par Corine NGUYEN-KHANH, L'organisme que vous représentez (option) (FRANCE), le 15/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans quelques dizaines années ou milliers d’années,un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduiront à des fuites et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ? Si par le plus grand des hasards vous aviez le courage d'endosser l' iresponsabilité flagrante de vos actes, peut-être que l'humain ferait un premier pas en arrière dans cette course à la destruction de notre planète.
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1184 - responsabilité pour l'avenir
Posée par sabine SICARD, L'organisme que vous représentez (option) (BEAUCOUZÉ), le 15/12/2013
qui sera responsable, si dans quelques siècles la radioactivité remonte à la surface ? qui connaît l'ampleur des risques de pollution nucléaire liés à l'enfouissement des déchets ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1183 - Qui sera responsable?
Posée par Lucien ANDRE, L'organisme que vous représentez (option) (AMBERT), le 15/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans2 dizaines d'années ou des milliers d’'années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou ... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites...et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l'’herbe des vaches, le pied des girolles, l'’eau des rivières, l'’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1182 - Qui sera responsable ?
Posée par anna MOAL, L'organisme que vous représentez (option) (PLOUNEOUR-TREZ), le 15/12/2013
Quand, dans 50 ans ou 100 milliers d'années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d'eau, une intrusion humaine, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l'herbe des vaches, le pied des girolles, l'eau des rivières, l'eau du robinet ... avec les conséquences qu'on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1181 - engagez vous votre propre responsabilité vis à vis de l'humanité ?
Posée par Jean-François LAMAISON, L'organisme que vous représentez (option) (RUEIL-MALMAISON), le 15/12/2013
Engagez vous votre propre responsabilité vis à vis de l'humanité ?
Rien ne peut assurer à 100% la fiabilité de l'enfouissement des déchets nucléaires. Le nucléaire reste la production d'énergie la plus polluante et les risques sont intolérables à l'échelle humaine. Êtes-vous prêt personnellement à vous engager comme responsable lors du prochain accident lié à cette technologie. Moi non, et c'est pourquoi j'ai banni l'utilisation de l'énergie nucléaire depuis plus de deux ans.
Réponse du 06/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestions sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 1180 - Qui sera responsable ?
Posée par Jacques LE ROUX, L'organisme que vous représentez (option) (POUSSAN), le 15/12/2013
Quand, dans des dizaines années ou des milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, etc. conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites, etc. et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet, etc., avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1179 - Qui sera responsable ?
Posée par thomas COUSINOU, L'organisme que vous représentez (option) (LEZIGNAN CORBIERES), le 15/12/2013
Quand, dans 1 dizaines années ou plusieurs milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, etc conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA : Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1178 - A qui donnons nous les clés ?
Posée par Jean-Paul BRAUN, AUBE ECOLOGIE (LA CHAPELLE SAINT LUC), le 15/12/2013
Qui sera responsable des conséquences d'un accident, d'un incendie, d'une erreur humaine, d'une catastrophe naturelle....dans 10, 20 ou 50 ans? Comment alors seront détectés les accidents, comment seront gérées les mesures de radioactivité et l'évaluation des risques pour les populations. A qui donnons nous les clés de notre protection et de celle de nos enfants et petits enfants ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1177 - QUI SERA RESPONSABLE ?
Posée par Marie-Claude OZANNE, L'organisme que vous représentez (option) (MONTÉLIER), le 15/12/2013
Quand, dans quelques dizaines, centaines, milliers d’années, se produira un accident mécanique ou électrique, un bug informatique, une erreur humaine, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un mouvement de failles, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou que se révèlera tout simplement une erreur de conception, il est certain que s'ensuivront une explosion et/ou un incendie et/ou une perte de confinement et/ou des fuites... D'où une remontée des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet... avec les conséquences qu’on a déjà connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA... Alors là QUI sera responsable ??...
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1176 - Qui sera responsable ?
Posée par Jean-Marie VAYSSIERES, L'organisme que vous représentez (option) (BIONVILLE SUR NIED), le 15/12/2013
Quand, dans des milliers d’années, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduiront à un retour des radionucléides en surface, dans l’eau des rivières, avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1175 - QUI SERA RESPONSABLE ?
Posée par CORINNE JOSSERAND, L'organisme que vous représentez (option) (MOLLON), le 15/12/2013
Quand, dans x dizaines années ou y milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou AUTRE conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet ... avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1174 - QUI EST RESPONSABLE EN CAS DE CATASTROPHE
Posée par ERICK DALLA-PRIA, L'organisme que vous représentez (option) (JOIGNY), le 15/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans 50 ans ou 50 milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1173 - perrenite dans le temps
Posée par christine RINGEISEN, L'organisme que vous représentez (option) (METZ), le 15/12/2013
Description *Quand, dans des dizaines d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine,conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA : Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1172 - Qui sera responsable ?
Posée par Gérard DIET, L'organisme que vous représentez (option) ( DOUVRES), le 15/12/2013
Quand, dans des dizaines ou des milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, etc. conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet etc. avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1171 - qui sera responsable?
Posée par Roselyne PASSAQUIN, L'organisme que vous représentez (option) (VILLEURBANNE), le 15/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans une dizaines années ou des milliers d’années, peu importe,un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1170 - Qui sera responsable ?
Posée par Manuela RIBEIRO, L'organisme que vous représentez (option) (BRAINVILLE), le 15/12/2013
Quand, dans des dizaines années, voire des milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou tout autre événement ou transformation de l’environnement, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites… et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA. Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1169 - qui sera responsable?
Posée par Vérane TOUILLET, L'organisme que vous représentez (option) (LA RONDE), le 15/12/2013
Quand, dans des dizaines années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille ou une infiltration d’eau conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... qui feront remonter à la surface des radionucléides enfouis, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA, qui sera responsable ? merci de la considération que vous apporterez à ma question.
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1168 - En cas d'accident, qui serait responsable devant les régions et populations touchées ?
Posée par Grégory MENDOUSSE, L'organisme que vous représentez (option) (CHAUMONT), le 15/12/2013
Personnellement je suis contre l’exploitation de l’énergie nucléaire, qui présente des risques innombrables et sans comparaison avec les autres secteurs industriels ; sans doute que le risque zéro n’existe pas, mais le moindre risque nucléaire est inacceptable étant donné le niveau de gravité des incidents et accidents potentiels et avérés. Ceci dit, je suis conscient que nous avons des déchets nucléaires et que nous en produisons encore : il nous faut donc bien les gérer. Il est ainsi important de se pencher sérieusement sur ce problème ; au passage, il est quand même aberrant que le monde se soit lancé dans cette industrie nucléaire sans avoir résolu par avance ce problème ; en tout cas, cela montre bien que les responsables de projets n’anticipent pas tout. Alors le projet Cigéo est-il aussi abouti que ses concepteurs veulent bien le dire ? Par le passé, d’autres sites de stockage ont été présentés comme absolument sûrs (Asse, en Allemagne, par exemple) pour se retrouver en situation critique après quelques années seulement. Une fois de plus : les concepteurs et décideurs n’anticipent pas tout. En fait, personne ne peut tout anticiper : il y a toujours des circonstances qui défient les prévisions. Combien d’autres exemples ces dernières années ? Alors que penser des prévisions de l’Andra dans ce projet ? Si l’on se réfère au cahier d’acteurs n°17 présenté par le CLIS, il y a diverses incohérences ou insuffisances : - dans le calendrier du projet : comment la loi fixant les conditions de réversibilité peut-elle être étudiée et votée après que l’Andra dépose sa demande d’autorisation ? L’Andra n’aurait donc pas à tenir compte du contenu de cette loi ? - manque d’expérimentations : de nombreuses expériences restent à mener et ce sur plusieurs années ; comment se prononcer sur le projet avant de connaître les résultats de ces expériences ? - de nombreuses questions subsistent quant aux risques d’incendie, aux risques d’explosion, à l’impact radiologique en surface… - l’inventaire des déchets stockés est parfois flou : comment concevoir un espace de stockage pour des déchets non identifiés précisément ? De plus, certains déchets seraient même à exclure d’après la CNE ; qu’en sera-t-il ? Si l’on se réfère au cahier d’acteurs n°57 présenté par l’ingénieur Serge Grünberg, beaucoup de décisions seraient prises uniquement pour minimiser des coûts (on espèrerait plutôt une attitude qui vise à maximiser la sécurité). Certaines méthodes de construction (plus avantageuses financièrement) ébranleraient même les couches de terrain : il semble logique de penser qu’un terrain perd certaines de ses qualités ou caractéristiques quand on vient le perturber par des constructions massives. Tout cela laisse penser que le projet n’est pas abouti. J’espère que les responsables politiques verront qu’il faut bien plus de temps pour se prononcer sérieusement sur le projet Cigéo, afin d’en corriger les aspects problématiques, de revoir si besoin les principes mêmes, le lieu et la conception du site de stockage, de mieux appréhender l’ensemble des risques et de mieux décider de la façon dont ils doivent être gérés, pour le bien de tous et des générations à venir. Les risques en jeu sont suffisamment graves pour que l'on ne précipite pas le processus décisionnel ; une mauvaise décision pourrait avoir des conséquences catastrophiques, et j'en arrive à ma question : en cas d'accident sur cet éventuel site de stockage, quelles personnes et quels organismes seraient responsables devant les régions et populations touchées ?
Réponse du 28/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestions sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
Un peu d’histoire
La question des déchets radioactifs a été abordée dès les années 1950 et les débuts de la production d’électricité d’origine nucléaire. C’est au cours des années 1960 et 1970 que le stockage a commencé à être considéré comme une possibilité de gestion au sein de la communauté scientifique internationale et notamment le stockage profond pour les déchets de haute activité et à vie longue. Dans les années 1980, des investigations étaient prévues pour rechercher des sites susceptibles d’accueillir des laboratoires souterrains. Mais les discussions sont restées limitées aux experts techniques et scientifiques et l’opinion publique s’est opposée aux projets. Le Parlement s’est alors saisi de la question des déchets radioactifs et a voté en 1991 une première loi qui a défini un programme de recherche pour les déchets de haute activité et à vie longue. Après 15 ans de recherche, leur évaluation et un débat public, une seconde loi a été votée en 2006. Elle a retenu le stockage profond comme solution de gestion à long terme de ces déchets pour protéger l’homme et l’environnement sur le très long terme et afin de limiter la charge de leur gestion sur les générations futures.
D’autres solutions ont été étudiées en France et à l’étranger depuis plus de 50 ans : envoi dans l’espace, au fond des océans, dans le magma, séparation-transmutation… Le stockage est aujourd’hui considéré dans tous les pays comme la meilleure solution pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs sur le très long terme. La directive européenne du 19 juillet 2011 considère ainsi que le stockage géologique constitue actuellement la solution la plus sûre et la plus durable en tant qu’étape finale de la gestion des déchets de haute activité.
Parallèle avec Asse
En aucun cas la mine de Asse en Allemagne ne peut être comparée au projet Cigéo. Le stockage à Asse a été réalisé au titre du droit minier et non des réglementations de la sûreté nucléaire telles qu’elles existent aujourd’hui. Il s’agit d’une ancienne mine de sel qui a été reconvertie en un stockage de déchets radioactifs en 1967. Lors du creusement de la mine, aucune précaution n’avait été prise pour préserver le confinement assuré par le milieu géologique. Le stockage n’avait pas non plus été conçu au départ pour être réversible. Les difficultés rencontrées aujourd’hui à Asse illustrent pleinement l’importance d’une démarche d’étude scientifique et d’évaluation préalablement à la décision de mettre en œuvre un projet de stockage.
L’inventaire des déchets destinés à Cigéo
Cigéo est conçu pour être flexible afin de pouvoir s’adapter à d’éventuels changements de la politique énergétique. L’inventaire détaillé des déchets radioactifs pris en compte dans les études de conception de Cigéo est disponible sur le site du débat public (../docs/rapport-etude/dechets-pris-en-compte-dans-etudes-conception-cigeo.pdf).
La nature et les quantités de déchets autorisés pour un stockage dans Cigéo seront fixées par le décret d’autorisation de création du Centre. Toute évolution notable de cet inventaire devra faire l’objet d’un nouveau processus d’autorisation, comprenant notamment une enquête publique et un nouveau décret d’autorisation.
Optimisation des coûts / sûreté
L’Andra a le souci permanent d’optimiser le coût du stockage, mais sans réduire le niveau de sûreté qui reste notre priorité absolue. Les études de conception industrielle du projet Cigéo ont démarré en 2012. L’Andra s’attache à identifier les risques techniques, qui pourraient augmenter le coût du projet, mais aussi les opportunités, qui peuvent être sources d’économies. Les essais réalisés au Laboratoire souterrain ont permis de réaliser des avancées significatives. Par exemple des essais ont permis de montrer la faisabilité d’alvéoles d’une centaine de mètres de longueur pour le stockage de déchets de haute activité. Cet allongement est favorable pour la sûreté à long terme et permet de réduire le nombre d’alvéoles.
Calendrier du projet et décision publique
La loi du 28 juin 2006 prévoit que l’Andra dépose un dossier support à l’instruction de la demande d’autorisation de création de Cigéo en 2015. Ce dossier devra contenir les résultats des études permettant de montrer la faisabilité et la sûreté de Cigéo pendant son exploitation et après sa fermeture. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra à l’État après un long processus qui durera plusieurs années. Ce processus comprendra notamment l’évaluation de la sûreté par l’Autorité de sûreté nucléaire, l’évaluation des recherches scientifiques par la Commission nationale d’évaluation l’avis des collectivités territoriales, le vote d’une nouvelle loi fixant les conditions de réversibilité, la mise à jour du dossier déposé par l’Andra suite à cette loi et une enquête publique. S’il s’avère que les études sont insuffisantes pour autoriser le stockage, l’Etat demandera à l’Andra de compléter ses études.
QUESTION 1167 - Qui sera responsable ?
Posée par Daniel CANO, L'organisme que vous représentez (option) (MONT SAINT MARTIN), le 15/12/2013
Description *Qui sera responsable ? Quand dans 100 000 ans un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine..., conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet, avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA. Qui sera responsable ? Daniel Cano.
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1166 - Qui sera responsable ?
Posée par François VECHART, A TITRE INDIVIDUEL (METZ), le 15/12/2013
Quand, dans 300 000 ans un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou chépakoi, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites, et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet , avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA, QUI SERA RESPONSABLE ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1165 - Qui sera responsable ?
Posée par Jean Claude LE MEUR, L'organisme que vous représentez (option) (PAVIE), le 15/12/2013
Quand, dans 10 000 ans ou moins, un accident quelconque conduira à une perte de confinement et donc à un retour des radionucléides en surface avec les conséquences que l'on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1164 - Déchets nucléaires
Posée par Kiffer DOMINIQUE, L'organisme que vous représentez (option) (NANCY), le 15/12/2013
Qui sera responsable dans quelques années quand on ne sera qu'une gigantesque poubelle et que tout va crever autour de nous, que les accidents déjà présents des centrales se multiplieront...Et qu'on n'aura plus de lopin de terre pour cultiver sans pollution nucléaire. Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1163 - qui sera responsable ?
Posée par lucile BIGAND, L'organisme que vous représentez (option) (BEYNAT), le 15/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans des dizaines années ou des milliers d’'années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou ..... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l'’herbe des vaches, le pied des girolles, l’'eau des rivières, l’'eau du robinet, avec les conséquences que l'’on a connues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA . Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1162 - Quelle responsabilité pour qui ?
Posée par Christophe BAUDELOT, L'organisme que vous représentez (option) (NOISY-LE-SEC), le 15/12/2013
Qui sera responsable quand un accident technique, un mouvement de terrain, une erreur humaine, une infiltration d'eau, conduiront à une perte de confinement entrainant un retour des radionucléides en surface, avec les conséquences qu'on a connues à Kytchtym, Tchernobyl, Fukushima ? Qui peut promettre que ces déchets seront surveillés d'ici un siècle, un millénaire, 50000 ans et plus ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1161 - Qui sera responsable ?
Posée par Valérie POUGHEON, L'organisme que vous représentez (option) (TRONGET), le 15/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans quelques dizaines ou centaines d’années un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, etc. conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet... avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA : Qui sera responsable ? Valérie Pougheon
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1160 - responsabilité en cas d'accident ?
Posée par martine BOURRE, L'organisme que vous représentez (option) (EVREUX), le 15/12/2013
Quand, dans des dizaines ou des centaines d'années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, conduiront à une explosion, un incendie,une perte de confinement, des fuites, et donc à un retour des radionucléides en surface, au sol et dans l’eau des rivières, donc l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA, qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1159 - Qui sera responsable?
Posée par Claudine FRANCOIS WILSER, L'organisme que vous représentez (option) (THANN), le 15/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans quelques dizaines années ou quelques milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet (vous choisissez ce que vous voulez) avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1158 - Cadeau empoisonné aux générations futures
Posée par Michel LOPEZ, L'organisme que vous représentez (option) (RUEIL MALMAISON), le 15/12/2013
Madame, Monsieur, L'enfouissement des déchets radioactifs est la pire des techniques, après la construction des centrales nucléaires, car elle a l'apparence d'une solution pérenne à un enjeu qui concerne l'humanité présente et les générations futures, alors qu'elle n'en maîtrise aucun des paramètres à court, moyen ou long terme. La pérennité de ce stockage souterrain est tributaire, entre autres, du bon vouloir de la croûte terrestre (elle n'a pas signé d'engagement envers l'humanité), de terroristes (qui n'ont rien signé, bien au contraire)... L'Homme croit pouvoir modéliser tous les paramètres mais tous ses modèles sont contredits un jour ou l'autre par l'expérience. L'Homme "moderne" actuel doit reconnaître qu'il apprend tous les jours et renoncer à sa carrière d'apprenti sorcier, aux dépens ds générations futures. Comment les éléments ci-dessus sont-il pris en compte dans le projet CIGEO? Qui sera responsable des dégâts inévitables?
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
QUESTION 1157 - Qui sera responsable?
Posée par Alain SIMON, L'organisme que vous représentez (option), le 15/12/2013
Bonjour. Quand, dans "x" dizaines ou milliers d’années, un accident mécanique ou électrique, un bug informatique, une erreur humaine ou de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou un inimaginable autre problème... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites, etc... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’eau des rivières et du robinet, avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,TCHERNOBYL et FUKUSHIMA ??? Qui sera responsable ? Merci de me répondre, cordialement, A.Simon.
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1156 - qui sera responsable ?
Posée par damien BERTHAUD, L'organisme que vous représentez (option) (FRANCE), le 15/12/2013
bonjour, Quand, dans quelques dizaines années , un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau ou une intrusion humaine peuvent conduire à une explosion, un incendie, une perte de confinement ou des fuites et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières et l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA. Qui sera responsable ? Merci d'en discuter avec toute votre conscience en pensant aux générations futures et d'informer la population actuelle de tout ces risques. salutations Un citoyen concerné
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1155 - Qui sera responsable ?
Posée par gerard GASSIOT, L'organisme que vous représentez (option) (BOSDARROS), le 15/12/2013
Quand, dans quelques dizaines, centaines ou milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, etc. conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites...et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet, avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1154 - Qui sera responsable ?
Posée par Elodie SANTAGIULIANA, L'organisme que vous représentez (option) (METZ), le 15/12/2013
Quand, dans des dizaines d'années ou milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduiront à une explosion, un incendie et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1153 - Qui sera responsable ?
Posée par Patrice HOLLEBECQUE, L'organisme que vous représentez (option) (CHÉLAN (GERS)), le 15/12/2013
Quand, dans x dizaines d'années ou y milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou chépakoi... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1152 - Quel cadeau pour nos petits enfants ... Après nous le déluge ?
Posée par richard KOEHLER, L'organisme que vous représentez (option) (MERTZWILLER), le 15/12/2013
non à l'enfouissement des déchets nucléaires car si, dans des dizaines ou des centaines d’années, un accident , une erreur humaine, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, une guerre conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, contaminant la terre, l'eau avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1151 - Qui sera responsable?
Posée par JEAN-PAUL MASSIER, L'organisme que vous représentez (option) (REIMS), le 15/12/2013
Quand, dans des dizaines années une infiltration d’eau conduira à des fuites et donc à un retour des radionucléides en surface dans l’eau des rivières ou dans l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1150 - Qui sera responsable ?
Posée par Marie Claude MARÉCHAL, L'organisme que vous représentez (option) (LE HAVRE), le 15/12/2013
Quand, dans quelques dizaines années un accident mécanique ou un mouvement de terrain, conduira à des fuites et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches ou dans l’eau des rivières avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA , Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1149 - qui sera responsables ?
Posée par pousse DENIS, L'organisme que vous représentez (option) (GERS), le 15/12/2013
Quand, dans 10 dizaines années ou 10 milliers d’années,un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine ,conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ????
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1148 - Pollution de l'eau par infiltration ?
Posée par Cyril CUISIN, CITOYEN (TOULOUSE), le 15/12/2013
Que se passera-t-il si dans le futur une infiltration d’eau transportera des radionucléides dans les nappes et les eaux de surface surtout avec les conséquences que l'on constate actuellement à Fukushima et à Tricastin. Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1147 - Qui sera responsable ?
Posée par christel FERRÉ, L'organisme que vous représentez (option) (DIGNE LES BAINS ), le 15/12/2013
Quand, un jour, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou n'importe quoi d'autre "pas prévu", conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet etc., avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA... Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1146 - Déchets nucléaires...
Posée par Dominique CHANTELOUP, L'organisme que vous représentez (option), le 15/12/2013
Madame,Monsieur, Quand un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe dans l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ? Je vous remercie pas avance de votre réponse. Cordialement
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1145 - Sécurité environnementale
Posée par benjamin RICHARD, L'organisme que vous représentez (option) (LYON), le 15/12/2013
On a le recul nécessaire aujourd'hui pour voir qu'aucune garantie en terme de sécurité n'est possible quand on parle de nucléaire : Tchernobyl, Fukushima, mais aussi plus pres de chez nous le tricastin... Quelle garantie pouvez-vous apporter ? qui sera responsable quand il y aura un problème ? comment les populations locales vont être indemnisées (perte de valeur du foncier notamment) ? comment avoir de la transparence sur le fonctionnement du site quand on voit qu'un Japon, le gouvernement et tepco cache la vérité aux populations locales ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1144 - QUI SERA RESPONSABLE
Posée par Robert DELBOS, L'organisme que vous représentez (option) (METZ), le 15/12/2013
Quand, dans des dizaines années ou des milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou quelque événement que ce soit conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet… avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA : Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1143 - QUI SERA RESPONSABLE ?
Posée par Christian BESSELLERE, L'organisme que vous représentez (option) (LODÈVE ), le 15/12/2013
QUI SERA RESPONSABLE ? J'ai vu le documentaire "Into Eternity", ... alors je suis inquiet, et c'est un euphémisme.... l'agriculture a 12 000 ans, ... les pyramides 5 000, Alors quand, dans des milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, .... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites et donc à un retour des radionucléides en surface, avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA QUI SERA RESPONSABLE ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1142 - Qui sera responsable ?
Posée par Philippe CLAVIERE, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 15/12/2013
Quand, dans quelques dizaines ou quelques centaines (ou milliers) d’années un accident mécanique, électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, etc, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites, ou toute chose actuellement inconcevable, et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières et donc du robinet (vous choisissez ce que vous voulez) avec les conséquences qu’on a connues à Kychtym, Tchernobyl et Fukushima... QUI SERA RESPONSABLE ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1141 - QUI EST RESPONSABLE ?
Posée par Damien DEMARSON, L'organisme que vous représentez (option) (CHAVANGES), le 15/12/2013
Quand, dans plusieurs dizaines années ou quelques milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou autre situation conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA . Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1140 - qui se souviendra, se rappellera, saura où sont enfouis ....
Posée par brigitte BILLET, L'organisme que vous représentez (option) (COSNE SUR LOIRE), le 15/12/2013
si : un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d'eau, une intrusion humaine, ou chépakoi... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l'herbe des vaches, le pied des girolles, l'eau des rivières, l'eau du robine avec les conséquences qu'on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1139 - Qui sera responsable ?
Posée par Stéphanie AGRINIER, L'organisme que vous représentez (option) (FRANCE), le 15/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans x dizaines années ou y milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet, avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1138 - enfouissement des déchets pour toute notre descendance
Posée par mireille JUBERT, L'organisme que vous représentez (option) (GRENOBLE ), le 15/12/2013
Qui sera responsable s'il se produit dans x années un tremblement de terre ou bien un envahissement par les eaux de l'endroit où seront confinés les déchets ? lequel d'entre vous, les décideurs, peut assurer que la vie de nos descendants ne sera pas impactée par une quelconque catastrophe que vous refusez d'imaginer? Après moi le déluge......
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1137 - Qui sera responsable
Posée par Yannick RACAPÉ, A TITRE PERSONNEL (SONGY), le 15/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans des dizaines d’années ou des milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou autre situation « IMPOSSIBLE » conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet, la douce rosée du matin avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1136 - dans la durée
Posée par veronique WEBER, L'organisme que vous représentez (option) (ETAMPES), le 15/12/2013
Bonjour, Le durée des déchets nucléaires et de plusieurs dizaines de milliers d'années. Comment peut -on garantir, meme dans quelques centaines d'années, que les déchets seront toujours bien confinés ? Comment peut-on guarantir que quelqu'un surveillera, ou meme se souviendra de ce lieu d'enfouissement dans 50 ans, 150ans, 1500, 15 000 ans ? Si il y une fuite (à cause par exemple d'un mouvement de terrain) comment cela sera t-il detecté ? Qui surveillera encore cette fuite dans 150 ans ? Quelle seront les conséquences en cas de fuite dans 50 ans , 150 ans, 1500 ans....? Enfin, qui sera responsable en cas de fuite dans 150 ou 1500 ans.... ? Merci de vos réponses . Ce sont les générations futures qui seront concernées de façon potentiellement dramatiques, si ces questions non pas de réelles réponses. Cordialement. Véronique WEBER.
Réponse du 21/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
C’est une des raisons qui a conduit, en 2006, le Parlement à retenir la solution du stockage profond.
Malgré cette robustesse du stockage même en cas d’oubli, l’Andra conçoit Cigéo avec l’objectif d’en conserver la mémoire et de la transmettre aux générations futures le plus longtemps possible. Des solutions d’archivage de long terme existent pour les centres de stockage de surface exploités par l’Andra et font l’objet de revues périodiques. Le retour d’expérience montre que ces solutions paraissent robustes pour au moins les 500 premières années. Ainsi, pour Cigéo, l’Andra prévoit qu’un centre de la mémoire perdurera sur le site. Il pourra accueillir le public et comprendra notamment les archives du Centre.
De manière générale, le maintien de la mémoire doit aussi impliquer les acteurs locaux, qui peuvent prendre le relai en cas de défaillance de l’Andra ou de l’État. L’Andra veille d’ores et déjà à les informer sur les enjeux associés à la mémoire et étudie avec des anthropologues, des philosophes ou encore des artistes les facteurs qui peuvent favoriser la transmission de la mémoire. La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
L’Andra a lancé en 2010 un programme d’études pour proposer des outils qui rendent cette transmission plus robuste sur une échelle de temps millénaire. Des pistes se dessinent tels des marqueurs de surface, mais aussi des rendez-vous réguliers à mettre en place au niveau des populations locales.
En tout état de cause, comme il est impossible de garantir notre capacité à communiquer avec des êtres vivant dans plusieurs milliers d’années, c’est chaque génération qui aura la responsabilité de contribuer à transmettre cette mémoire aux générations suivantes.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Les responsabilités pour atteindre l’objectif de protection des hommes et de l’environnement à long terme sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 1135 - Qui sera responsable
Posée par Geneviève LEMAITRE, L'organisme que vous représentez (option) (L'UNION), le 15/12/2013
Quand, dans quelques années ou quelques milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ...etc conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA. Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1134 - qui sera responsable
Posée par mireille GRYGIEL, L'organisme que vous représentez (option) (ST CLAIR DE HALOUZE), le 15/12/2013
Qui sera responsable avec les conséquences qu' on a connu à Tchernobyl et Fukushima?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1133 - une fuite un jour
Posée par Patirck MONNET, JE SUIS UN PARTICULIER CITOYEN (LYON), le 15/12/2013
Quand, dans deux dizaines années ou trois milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, où un autre faits générateur, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites radioactives et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, l’eau des rivières, l’eau des nappes phréatique, avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA , qui sera responsable d’une contamination générale ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1132 - Qui sera responsable???
Posée par Marie-Claude BELLANGER, SDN38 (TULLINS), le 15/12/2013
Dans X années ou dizaines d'années, à l'occasion d'une erreur humaine, d'un tremblement de terre ou autre catastrophe naturelle, qui sera responsable de ce qui va remonter en surface, dans l'herbe des vaches, au pied des champignons et dans nos poumons, comme à Tchernobyl ou Fukushima????
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1131 - Responsabilité
Posée par Lionel FRIEDRICH, L'organisme que vous représentez (option) (BEAUCHASTEL), le 15/12/2013
Quand, dans quelques dizaines années ou y milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ? Ceux qui promeuvent l'atome devraient avoir une cart de liquidateur et être envoyés en premier en cas d'accident. Cordialement, Lionel Friedrich
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1130 - Qui sera responsable ?
Posée par lisbeth STEYGER, L'organisme que vous représentez (option) (AUBENAS), le 15/12/2013
Description *Quand, dans x dizaines années ou y milliers d’années, (vous mettez le chiffre que vous voulez), un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou chépakoi... (vous choisissez ce que vous voulez) conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... (vous choisissez ce que vous voulez) et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet (vous choisissez ce que vous voulez) avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA (désolé, là vous n’avez pas le choix) Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1129 - Qui paiera
Posée par Pierre-Eloi BRIS, L'organisme que vous représentez (option) (ROUAIROUX), le 15/12/2013
Si d'aventure une fuite survenait au cours des 100 000 prochaines années, qui en assumerait la responsabilité, qui paierait pour réparer les dégâts, qui irait en prison pour empoisonnement?
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Les responsabilités sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
QUESTION 1128 - Qui sera responsable ?
Posée par lisbeth STEYGER, L'organisme que vous représentez (option) (AUBENAS), le 15/12/2013
Quand, dans x dizaines années ou y milliers d’années, , un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou ... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet à ... TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1127 - Qui sera responsable ?
Posée par Matthieu BALLÉ, L'organisme que vous représentez (option) (NOELLET), le 15/12/2013
Quand, dans 20 ans ou 1 milliers d’années, (vous mettez le chiffre que vous voulez), un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou autre que sais-je conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1126 - QUI SERA RESPONSABLE ?
Posée par Luseta CELLO, L'organisme que vous représentez (option) (AIX EN PCE), le 15/12/2013
Quand, dans des dizaines années ou des milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou ... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’eau des rivières, l’eau du robinet, avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ? Il n'est possible d'ignorer cette question.
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1125 - RESPONSABILITE en cas de catastrophe
Posée par Léa ALTMAN, L'organisme que vous représentez (option) (DIE), le 15/12/2013
Qui va être responsable en cas de seisme, tremblement de terre etc... Des mesures ont elles été pensé?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1124 - QUI SERA RESPONSABLE
Posée par georges GRIOT, L'organisme que vous représentez (option) (BOURG LES VALENCE), le 15/12/2013
quand dans deux dizaines d années un bug informatique,une erreur humaine,une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre,un agrandissement de faille,une infiltration d eau, une intrusion humaine conduiront a une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites et donc a un retour des radionucleides en surfacedans l herbe des vaches, le pied des girolles^l eau des rivieres et du robinet avec des conséquences connues a kychtym, TCHERNOBYL,FUKUSHIMA: QUI SERA RESPONSABLE?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1123 - Qui sera responsable ?
Posée par alain GRENIER, L'organisme que vous représentez (option) (BELEYMAS), le 15/12/2013
Quand, dans quelques dizaines années, une erreur de conception ou une infiltration d’eau conduira à une perte de confinement et donc à un retour des radionucléides en surface ou dans l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1122 - Responsabilité
Posée par Vincent PORTIER, L'organisme que vous représentez (option) (CREST), le 15/12/2013
Este vous prêt a rendre public votre responsabilité dans une décision positive a l'enfouissement des déchets nucléaire? A transmettre cette responsabilité sur vos descendants?
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de ces déchets. Grâce à la réversibilité, ces générations garderont la possibilité de faire évoluer cette solution. L’Andra propose ainsi que des rendez-vous réguliers soient programmés pendant une centaine d’années pour faire le point sur l’exploitation du stockage et préparer les étapes suivantes.
QUESTION 1121 - dans x millions d' années
Posée par marie GALLICE, LA SOCIÉTÉ CIVILE (ROCLES), le 15/12/2013
que se passera t'il dans x millions d'années s'il y a une fuite et que la radioactivité se retrouve dans l'eau , dans la terre cultivée dans l'air que l'on respire ? que fera t-on et qui sera responsable ????
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1120 - Responsabilité
Posée par christian VILLAUME, ASVPP (THIAVILLE/MEURTHE), le 15/12/2013
Qui sera responsable d'un quelconque problème nucléaire dans 500, 1000, 10.000 ans ou 4 périodes du plutonium 239? Qui paiera? Qui saura où se situe le site? Qui gèrera, avec quel personnel, payé par qui et avec quel argent, au cours des mêmes périodes de temps? C'est un pari sur l'avenir d'une folie incommensurable!
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1119 - Qui sera responsable?
Posée par arnaud GAUTHIER, L'organisme que vous représentez (option) (MALAINCOURT), le 15/12/2013
Quand, dans 30 dizaines d'années, un accident mécanique ou un accident électrique voire un bug informatique conduiront à une explosion et donc à un retour des radionucléides dans l'eau du robinet ou le pied des girolles avec les conséquences que l'on a connues à Kychtym, tchernobyl et fukushima, qui sera responsable?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1118 - Responsabilité
Posée par V DEFAIX, L'organisme que vous représentez (option) (AUBE), le 15/12/2013
Lorsqu'un incident technique, une erreur humaine, un mouvement ou une catastrophe naturelle conduiront à un accident nucléaire, avec des conséquences comparables à celles de TCHERNOBYL ou FUKUSHIMA, qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1117 - Qui garantit la sécurité de la zone ?
Posée par francine RAFFIN, L'organisme que vous représentez (option) (LA ROCHELLE), le 15/12/2013
De quel droit peut on faire prendre un risque aux générations futures ? Quel sera l'impact en cas de fuite ? ( le risque zéro n'existant pas) Qui sera responsable ? Qui paiera ?
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Les responsabilités sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1116 - Qui sera responsable ?
Posée par Philipe LAMBERSENS, L'organisme que vous représentez (option) (QUAIX EN CHARTREUSE), le 15/12/2013
La France est bien un Etat de droit, non ?Et elle espère le rester ?! Et dans un Etat de droit, on cherche à juger les responsables d'un acte nuisible à la société?! Alors,quand, dans quelques dizaines années ou milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine ...ou toute cause non prévue par les brillants ingénieurs du 21° siècle conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, avec les conséquences qu’on a déjà connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA , alors qui seront les responsables ? Morts depuis longtemps... à moins de transmettre à leur descendance au fil des siècles la capacité juridique d'être redevable des actes de leurs ancêtres ?... Bref, y a-t il moyen de rendre historiquement responsable les irresponsables d'aujourd'hui ?
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Les responsabilités sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1115 - Qui sera responsable ?
Posée par Rodolphe DEVALCOURT, L'organisme que vous représentez (option) (NARBONNE), le 15/12/2013
Quand , dans des dizaines de milliers d'années, les contenants ne seront plus étanches et que les contenus radionucléides se répandront dans nos sous-sols, avec les conséquences connues des catastrophes du type Tchernobyl et Fukushima, qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1114 - Qui sera responsable?
Posée par ambre THIEMONGE, L'organisme que vous représentez (option) (BRIEY), le 15/12/2013
Quand, dans une dizaine d'années une erreur de construction conduira à des fuites et donc un retour des radionucléides en surface dans l'herbe des vaches avec les conséquences qu'on a connu à Tchernobyl et Fukushima, qui sera responsable?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1113 - Qui sera responsable ?
Posée par Philippe MIAUX, MA FAMILLE ET MES FUTURS DESCENDANTS (BIOT ), le 15/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans plusieurs dizaines années voire des milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA, qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1112 - QUI sera responsable ???
Posée par émile PEYRINS, L'organisme que vous représentez (option) (CREST), le 15/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans x dizaines années ou y milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou chépakoi... conduira à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1111 - Responsabilité
Posée par Cyril CHARRUE, L'organisme que vous représentez (option) (GENTILLY), le 15/12/2013
si dans quelques dizaines années, un accident intervenait et conduit à une perte de confinement, donc à un retour des radionucléides en surface qui sera responsable ? Merci
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1110 - QUI SERA RESPONSABLE ?
Posée par Claude TERRASSON, L'organisme que vous représentez (option) (BREST), le 15/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dès la mise en place des déchets radioactifs ou dans des dizaines années ou y milliers d’années, vous un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou autres actions imprévues conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, ou des fuites radioactives et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1109 - Qui sera responsable ...
Posée par linda SHERWOOD, L'organisme que vous représentez (option) (VALENCE), le 15/12/2013
quand, dans les années à venir un accident mécanique, ou électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau ou encore une intrusion humaine conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1108 - Qui sera responsable ?
Posée par marie joelle POUILLON, MOI-MÊME (PUY ST MARTIN), le 15/12/2013
Quand, dans plusieurs dizaines ou milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou autre incident/accident imprévisible conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA QUI SERA RESPONSABLE ? MJP
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1107 - Qui sera responsable ?
Posée par brigitte GINESTE, L'organisme que vous représentez (option) (VALENCE), le 15/12/2013
Quand, dans 5 ans ou moins, un accident électrique, un bug informatique, ,ou une infiltration d’eau, conduiront à une perte de confinement, des fuites. et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1106 - Qui sera responsable ?
Posée par Pauline MOTTET, L'organisme que vous représentez (option) (LYON), le 15/12/2013
Oui Messieurs, je pose la question. Qui sera responsable ; quand dans 3 dizaines d'années ou 3 milliers d'années ; une erreur humaine, un bug informatique généralisé ou une catastrophe naturelle ; conduira à une perte de contrôle de ces déchets radioactifs enfouis sous nos pieds ? Qui sera responsable du retour à la surface des particules radioactives dans l'herbe de nos vaches ? Le lait de ces dernières ? Le biberon de nos enfants ? Et chaque cellule de vie qui nous entoure ? Comment une telle décision peut-elle être en adéquation avec la survie de l'espèce humaine ? Comment peut-elle être même seulement envisagée, en connaissance de causes telles que Tchernobyl ou Fukushima ? Cette dernière étant bien récente et montrant donc, encore aujourd'hui, l'incapacité de l'Homme à contrôler totalement cette énergie si puissante, imprévisible et dévastatrice ... Comment imaginer un futur pour nos vies, dans un monde où la situation économique n'est déjà pas propice à l'élaboration de projets ? Pourquoi rajouter une incertitude supplémentaire, pouvant affecter notre santé, et notre existence toute entière ? Où est passé notre droit à la santé, présent dans la Constitution de notre pays ? Que direz-vous aux jeunes générations ? "Vous vivez dans un monde gangrené jusque sous vos pieds. Vos prédécesseurs vous ont amputé vos espoirs de vie prospère." Quand il sera trop tard, qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1105 - qUI SERA RESPONSABLE,
Posée par Lionel JOSSE, COTENTIN NATURE (THEVILLE), le 15/12/2013
DQuand, dans 100 ans ou 2 milliers d’années, une erreur humaine causant un accident mécanique ou électrique, une intrusion terroriste, un tremblement de terre, ou toute autre raison inimaginable actuellement conduiront à une explosion, à une perte de confinement, à des fuites radioactives... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, l’eau des rivières,l'air respiré tout simplement, avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA , oui , à ce moment précis .....qui sera responsable ? Et où seront les "décideurs inconscients" d' aujourd'hui ?escription *
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1104 - QUI sera responsable ?Ou seront les têtes brûlées d'aujourd'hui?
Posée par Marité JOSSE, ARTS ET JARDINS DU COTENTIN (THEVILLE), le 15/12/2013
Quand, dans 100 ans ou 2 milliers d’années, une erreur humaine causant un accident mécanique ou électrique, une intrusion terroriste, un tremblement de terre, ou toute autre raison inimaginable actuellement conduiront à une explosion, à une perte de confinement, à des fuites radioactives... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, l’eau des rivières,l'air respiré tout simplement, avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA , oui , à ce moment précis .....qui sera responsable ? Et où seront les "décideurs inconscients" d' aujourd'hui ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1103 - type de stockage et éthique
Posée par Maxime BEAULIEU, L'organisme que vous représentez (option) (VILLEMAUR SUR VANNE), le 15/12/2013
Quand, dans 100 000 ans, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou une guerre conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites et donc à un retour des radionucléides en surface, avec les conséquences qu’on a connues à comme à TCHERNOBYL ou FUKUSHIMA Qui sera responsable ? A t'on le droit, au nom de l'éthique, de cacher la poussière sous le tapis ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1102 - Qui sera responsable?
Posée par Jacques BERTHET, L'organisme que vous représentez (option) (NARC), le 15/12/2013
Qui sera responsable ? Quand un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l'air, dans le sol, l’eau des nappes et des rivières, avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA . Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1101 - qui sera responsable?
Posée par FREDERIUQE MUSSARD, L'organisme que vous représentez (option) (ETAIN), le 15/12/2013
Quand, dans 5dizaines années un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ? Que dirais je à mes petits enfants???
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1100 - Qui sera responsable ???
Posée par Gilles FOL , L'organisme que vous représentez (option) (CRAPONNE ), le 15/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans quelques dizaines années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau ou une intrusion humaine, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement ou des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières ou l’eau du robinet, avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA, qui sera responsable ? Qui sera responsable ???
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1099 - Qui sera responsable
Posée par Julie CHABERT, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 15/12/2013
Quand, dans x dizaines années ou y milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA...Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1098 - Quel cadeau faisons-nous à la vie future sur terre ?
Posée par Véronique RATAT, L'organisme que vous représentez (option) (ISÈRE), le 15/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans des dizaines années ou des milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites...et donc à un retour des radionucléides en surface, avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA qui n'ont pas servi d'exemple à l'humain, Qui sera responsable et comment les générations futures pourront-elles lutter contre la radioactivité inodore, invisible, non palpable et inaudible ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1097 - Qui sera responsable ?
Posée par AnaPis GOREL, L'organisme que vous représentez (option) (BRUXELLES), le 15/12/2013
Quand, dans quelques dizaines années ou milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou chépakoi.. conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1096 - responsabilité
Posée par jean-louis ROLLY, L'organisme que vous représentez (option) (GRENOBLE), le 15/12/2013
Dans 30 ans un accident électrique conduit à une explosion et donc à un retour des radionucléides en surface ,dans l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA .Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1095 - Qui sera responsable ?question *
Posée par Franck PALLIER, L'organisme que vous représentez (option) (VEYRAS), le 15/12/2013
Quand, dans quelques dizaines années ou plusieurs milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine...conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet ...avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1094 - Qui sera responsable ?
Posée par Karen P, L'organisme que vous représentez (option), le 15/12/2013
Quand, dans quelques dizaines années ou plusieurs milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou toute autre raison...conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... ou tout autre accident, et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet, etc. avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1093 - QUI assumera la responsabilité dans 50000 ans
Posée par Françoise WILLMANN, L'organisme que vous représentez (option) (NANCY), le 15/12/2013
Les déchets ont une durée de vie sans commune mesure avec celle d'un être humain. Comment assurer la sécurité de l'enfouissement à une telle échelle ? Qui sera responsable dans 50 ans, 100 ans, 1000 ans, si les choses ne se passent pas comme les experts l'imaginent aujourd'hui ? QUI peut s'engager dans ces conditions ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1092 - Qui sera responsable ?
Posée par sandrine LE FRANÇOIS, L'organisme que vous représentez (option) (AVIGNON), le 15/12/2013
Quand, dans des dizaines, centaines ou milliers d’années un mouvement de terrain une infiltration d’eau, une donnée non prévue par les concepteurs conduiront à une perte de confinement des déchêts radioactifs et donc à un retour des radionucléides en surface avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA , qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1091 - Qui serait responsable ?
Posée par remi MUSARD , L'organisme que vous représentez (option) (PREMIAN), le 15/12/2013
Quand, dans 2 ou 20 ans , un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou terrorisme conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites et donc à un retour des radionucléides en surface avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable et qui paiera ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1090 - Responsabilité ?
Posée par BRUNO ESCOFFIER, AUCUN (NIMES), le 15/12/2013
Qui sera responsable... quand, dans des dizaines années ou des milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, etc... car rien n'est infaillible... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites ou autre chose encore que l'on ne peut prévoir, et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, l’eau des rivières, l’eau du robinet, avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ? Vous par intérêt financier, politicien, vision à court terme, inconséquence ? Nous par lâcheté, faiblesse, réflexe de l'autruche, choix d'un confort immédiat ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1089 - Qui accusera-t-on ?
Posée par Marlène ESCOFFIER, L'organisme que vous représentez (option) (NÎMES), le 15/12/2013
Qui sera responsable ?Quand, dans des dizaines années ou y milliers d’années, un accident mécanique, électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites, et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ? Merci de me répondre...
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1088 - Qui sera responsable ?
Posée par FREDERIC GOBERT, L'organisme que vous représentez (option) (FLAVIAC), le 15/12/2013
Nous savons qu'un jour, la radioactivité stockée sortira. Toute la question est de savoir quand ? Ce n'est donc pas ma question, puisque cela arrivera. Ma question est : Quand, dans des dizaines ou des milliers d’années, un accident quelconque, un bug informatique, une erreur humaine (conception, gestion, etc.), un mouvement de terrain, un tremblement de terre, une infiltration d’eau, conduiront à une perte de confinement, des fuites, et donc à un retour des radionucléides en surface, avec les conséquences qu’on a connues à Kychtym, Tchernobyl et Fukushima, qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1087 - Qui sera responsable ?
Posée par Bertrand TUAL, L'organisme que vous représentez (option) (CHAMPIGNÉ), le 15/12/2013
Quand, dans x dizaines années ou y milliers d’années, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou quelque autre imprévu conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA, qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1086 - QUI sera RESPONSABLE ?
Posée par dominique REYNAUD, L'organisme que vous représentez (option) (SAINT JEAN EN ROYANS), le 15/12/2013
> Quand, dans des dizaines années un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau,une intrusion humaine conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement ou des fuites et donc à un RETOUR des radionucléides en surface, dans l’herbe ,dans l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL et à FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1085 - Qui sera (ir)responsable ?
Posée par Laurence GAY-PARA, L'organisme que vous représentez (option) (ARDÈCHE - FLAVIAC), le 15/12/2013
Quand, dans des dizaines ou des milliers d’années, un accident quelconque, un bug informatique, une erreur humaine (conception, gestion, etc.), un mouvement de terrain, un tremblement de terre, une infiltration d’eau, conduiront à une perte de confinement, des fuites, et donc à un retour des radionucléides en surface, avec des conséquences pires que celles qu’on a connues à Kychtym, Tchernobyl et Fukushima, - pires car la quantité stockée sera bien plus grande -qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1084 - Qui sera responsable ?
Posée par Marie-Laure VERGAIN, L'organisme que vous représentez (option) (AIX-LES-BAINS), le 15/12/2013
Quand, dans 9 dizaines années ou 4 milliers d’années, (vous mettez le chiffre que vous voulez), un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d'’eau, une intrusion humaine ou un autre imprévu, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites ..., et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’'herbe des vaches, le pied des girolles, l’'eau des rivières, les fruits et légumes, l'’eau du robinet, avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM , TCHERNOBYL et FUKUSHIMA. Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1083 - Qui sera responsable ?
Posée par Béatrice PELUAU, L'organisme que vous représentez (option) (BRÉHÉMONT), le 15/12/2013
Quand, dans quelques dizaines années, une erreur de conception, un mouvement de terrain, ou une intrusion humaine conduiront à une perte de confinement et donc à un retour des radionucléides en surface avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM(2), TCHERNOBYL et FUKUSHIMA, Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1082 - que deviendront les déchets nucléaires enfouis comme de simples résidus alimentaires ???????
Posée par danielle GRANDIN, L'organisme que vous représentez (option) (ORANGE), le 15/12/2013
Dans les temps a venir, à la faveur d'incidents comme l'on en vit tous les jours : failles, inondations, intrusion humaine ou autres, que se passera-t-il avec ces bombes à retardement gisant sous les pieds de nos enfants ? QUI SERA RESPONSABLE et où se planqueront-ils les responsables de ces scandaleuses décisions? Comment peuvent-ils encore dormir en paix ? Honte sur eux mais qu'ont-ils donc dans la tête à part des intérêts financiers monstrueux qui leur font oublier jusqu'aux catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima ?NE FAITES PAS CELA, PAR PITIE,STOPPEZ CE PROCESSUS TANT QU'IL EST ENCORE TEMPS
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1081 - Qui sera responsable ? Les élus actuels ou les compagnies d'assurance ou les responsables d'exploitation ? ?
Posée par Christine ELLISON-MASSOT, L'organisme que vous représentez (option) (VARENGEVILLE -SUR-MER), le 15/12/2013
Quand ,dans une dizaine d'années ou un millier d'années ,un accident mécanique ou électrique ,un bug informatique ,une erreur humaine et/ou de conception ,un mouvement de terrain ,un tremblement de terre un agrandissement de faille ,une infiltration d'eau ,une intrusion humaine ...ou animale ...conduiront à une explosion ,un incendie , une perte de confinement ,des fuites...et donc à un retour des radionucléides en surface ,dans les nappes phréatiques ,les racines des plantes ...QUI sera responsable ???
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1080 - Qui sera responsable ?
Posée par Emmanuel GUERRAZ, L'organisme que vous représentez (option) (FELINES), le 15/12/2013
Quand, dans une dizaines années ou un milliers d’années, un accident mécanique ou un accident électrique ou un bug informatique ou une erreur humaine ou une erreur de conception ou un mouvement de terrain ou un tremblement de terre ou un agrandissement de faille ou une infiltration d’eau, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1079 - Qui sera responsable ?
Posée par michel JEANNÈS, L'organisme que vous représentez (option) (LYON), le 15/12/2013
Quand, dans quelques dizaines années , un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d'eau, etc... conduiront à une perte de confinement et donc à un retour des radionucléides en surface, avec les conséquences qu'on a connues à KYCHTYM,*(2)*TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1078 - Responsabilité
Posée par Monique VÉRILLON, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 15/12/2013
SI un accident ou une catastrophe conduisent à un déconfinement des déchets nucléaires enfouis, avec toutes les conséquences qui en résulteraient, qui sera responsable ? Et qui dédommagera les victimes ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1077 - qui sera responsable ?
Posée par marie-aude JAUZE, L'organisme que vous représentez (option) (EN COURBIERES LE CABANIAL), le 15/12/2013
DescriptionQuand, dans 10 dizaines années ou 100 milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou je ne sais conduiront à une explosion, a un incendie, a une perte de confinement, a des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet , les fleurs que butinent les abeilles , les carottes que je croque… avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,TCHERNOBYL et FUKUSHIMA …..Qui sera responsable ? *
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1076 - Qui sera responsable ?
Posée par René THIBAUD, L'organisme que vous représentez (option) (ROMANS SUR ISÈRE), le 15/12/2013
Quand, dans x dizaines années ou y milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou autre chose conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet ... avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1075 - Qui sera responsable dans 1000 ans ou après ?
Posée par Bernard DUGAS, MON PROPRE ORGANISME CITOYEN, ENCORE EN BONNE SANTÉ (MARSAT), le 15/12/2013
Bonjour, Nous savons tous aujourd'hui qu'un fonctionnaire n'a aucune responsabilité pénale en cas d'erreur manifeste voire en cas de tromperie. Comment envisagez-vous de désigner des responsables quand les fuites de cigéo deviendront manifestes dans 1000 ans, voire moins ? Pensez-vous que légalement la responsabilité pénale puisse être transmise à vos descendants, car je refuse que mes descendants subissent la moindre conséquence de vos erreurs, que je dénonce aujourd'hui ?
Réponse du 11/02/2014,
Réponse apportée l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
Le seul objectif du stockage est de créer de la sûreté pour le très long terme. Si Cigéo est autorisé, il sera peu vulnérable à toutes les agressions externes. Il sera implanté à 500 mètres de profondeur, dans une couche géologique spécialement choisie en raison de ses propriétés de confinement. Ce double niveau de protection ne peut pas être atteint par un entreposage, qu’il soit en surface ou en subsurface. Après la fermeture du stockage, sa sûreté doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines, pour ne pas reporter la charge des déchets sur les générations futures. Celles-ci pourront continuer à assurer une surveillance du site aussi longtemps qu’elles le souhaiteront. Néanmoins, le stockage restera sûr à long terme même si le site venait à être oublié, contrairement à un entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Derrière ce projet, ce sont des hommes et des femmes, de l’Andra mais également d’autres institutions ou organismes de recherche, en France et à l’étranger, qui s’investissent de manière responsable depuis plus de 20 ans avec un seul et même objectif : développer les solutions les plus sûres pour nos enfants, nos petits-enfants et les générations futures. Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de ces déchets. Grâce à la réversibilité, ces générations garderont la possibilité de faire évoluer cette solution. L’Andra propose ainsi que des rendez-vous réguliers soient programmés avec l’ensemble des acteurs (riverains, collectivités, scientifiques, évaluateurs, État…) pour contrôler le déroulement du stockage et pour préparer chaque décision importante concernant les étapes suivantes.
A l’inverse, comment les générations futures nous jugeront-elles si nous reportons sur elles la gestion des déchets radioactifs produits par les activités dont notre génération a bénéficié ?
QUESTION 1074 - Qui sera responsable dans l'un des cas suivants ?
Posée par Patrick HUBERT, L'organisme que vous représentez (option) (ST GENGOUX DE SCISSÉ), le 15/12/2013
Si un jour, même très lointain - et plus encore s'il est si lointain que nos descendants auront "perdu la mémoire" de ce qui est enfoui sous leurs pieds -, un accident géologique (mouvement de terrain, tremblement de terre, etc.) ou une infiltration d'eau importante conduisent à une perte de confinement ou à des fuites radioactives importantes et donc à un retour des radionucléides en surface, avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA , qui sera responsable ? Peut-être me répondrez-vous : "les responsables ne seront plus là, donc il n'y aura pas d'autres responsables que ... la nature bien ingrate à l'égard de l'Homme !". N'est-il pas grave et irresponsable aujourd'hui de prendre le risque de faire courir à nos lointains descendants une telle catastrophe ? Poser la question est peut-être y répondre....
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1073 - responsabilité
Posée par babou BAB, L'organisme que vous représentez (option) (FRANCE), le 15/12/2013
qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1072 - Titre de votre question *Qui sera responsable ?
Posée par bruno JALABERT, L'organisme que vous représentez (option) (ST ANTOINE L'ABBAYE), le 15/12/2013
Description *Quand, dans trente ans ou deux cents ans un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou chépakoi... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites.et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1071 - Qui sera responsable ?
Posée par Robert JOHNSON, L'organisme que vous représentez (option) (LYON), le 15/12/2013
Quand, dans 1 an ou 10 milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1070 - Qui de nous sera responsable ?
Posée par Christian PASSERI, L'organisme que vous représentez (option) (CHAMILLY), le 15/12/2013
Qui de nous sera considéré comme responsable quand dans plusieurs dizaines d'années (ou + ou -), une mouvement de terrain ou une erreur humaine ou ..., conduiront à une perte de confinement (ou tout autre accident) ???
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1069 - Responsable
Posée par Sylvain BEGUE, L'organisme que vous représentez (option), le 15/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans plusieurs dizaines années voire milliers d’années,un accident mécanique ou électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1068 - Qui est // sera responsable ?
Posée par Jean-Marc CONVERS, L'organisme que vous représentez (option) (ANCEY), le 15/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans 19, 50 ou 99 ans, ou x milliers d’années, dès qu'un accident mécanique, électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou tout ce qui est humaine possible, probable voir assuré d'arriver ... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet, l'air que les humains et êtres vivants respirent , avec les conséquences que l'ont connait et subit déjà à TCHERNOBYL, FUKUSHIMA et les mines de sel avec déchets radioactifs en Allemagne, ... Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1067 - Qui sera responsable?
Posée par Viviane LECLERC, L'organisme que vous représentez (option) (REFFROY), le 15/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans une dizaine d' années ou des milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA . Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1066 - Qui sera responsable?
Posée par Huguette BOURRON, MOI-MÊME (VALENCE), le 15/12/2013
Quand, dans des milliers d’années,un accident mécanique, un accident électrique,un bug informatique, une erreur humaine ou de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau,ou une intrusion humaine, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1065 - qui sera responsable ?
Posée par D S, L'organisme que vous représentez (option) (NANCY), le 15/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans 2 dizaines années ou 50 milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou tout autre évènement climatique à conséquences en cascade, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet, la terre des potagers... avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA : Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1064 - Pourquoi empoisonner la terre de nos arrières petite enfants
Posée par Benoît BROUSSOLLE, L'organisme que vous représentez (option) (DIJON), le 15/12/2013
Quand, dans des centaines d'années, un incident (quel qu'il soit) conduira à une perte de confinement, incendie, infiltration etc. et a un retour à la surface des radionucléides , dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet, ) avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA. Qui sera responsable ? Alors Pourquoi empoisonner la terre de nos arrières petite enfants ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1063 - Qui sera responsable ?
Posée par Rémi VERDET, L'organisme que vous représentez (option) (NEUVILLER LA ROCHE), le 15/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans 10 milliers d’années un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1062 - responsabilite
Posée par enora WADOUX, L'organisme que vous représentez (option) (VANNES), le 15/12/2013
En cas d'accidents, d'incidents peu importe son origine, dans 10 ans, dans 100 ans ou plus..qui sera responsable d'avoi fait ce choix criminel qu'est d'enfouir les dechets? Je suis contre, donc en tout cas je ne serai pas responsable.Merci de me repondre: Qui sera responsable?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1061 - qui sera responsable ?
Posée par Maëlle PETITEAU, L'organisme que vous représentez (option) (ANGERS), le 15/12/2013
Quand, dans quelques dizaines ou milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, un attentat ou autre évènement... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet, le paillasson des maisons voisines avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA pour les enfants des enfants des enfants ... de NOS enfants, QUI sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1060 - Qui sera responsable ?
Posée par Nathanaël BASTID, L'organisme que vous représentez (option) (BAGNOLET), le 15/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans deux milliers d’années, un tremblement de terre conduira à une perte de confinement et donc à un retour des radionucléides à l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL ou encore FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1059 - QUI SERA RESPONSABLE?
Posée par JEFF PETIT, L'organisme que vous représentez (option) (TOUL), le 15/12/2013
Quand, dans 10 dizaines années ou 1 milliers d’années, (vous mettez le chiffre que vous voulez), un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, OU TOUT SIMPLEMENT LE TEMPS QUI AURA FAIT SON EFFET conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet ?AU VIGNOBLE DU cHAMPAGNE OU AU PARISIEN avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1058 - Qui sera responsable ?
Posée par eric VALOMET, L'organisme que vous représentez (option), le 15/12/2013
Quand, dans cent années ou milles années, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, ou une infiltration d’eau, conduiront a une perte de confinement, des fuites... et donc à une perte de controle des radionucléides qui se propagerons dans l'environement contaminent les sols , les nappes phréatiques , l’eau des rivières, avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1057 - Qui assure ?
Posée par Sylvie ., L'organisme que vous représentez (option) (ANGERS), le 15/12/2013
Qui sera responsable dans l'avenir en cas fuites ? Quid des tremblements de terres ? Cigé0/20
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1056 - Comment peut-on faire un pari aussi risqué, incertain, dangereux, terrible, mortel sur l'avenir
Posée par Raymond MAGUET, L'organisme que vous représentez (option), le 15/12/2013
Quand, dans quelques centaines d'années années ou milliers d’années, un accident, un bug informatique, une erreur humaine, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou tout autre évènement imprévisible voire inconcevable aujourd'hui.conduiront à une explosion, une fuite, ou tout autre accident inconcevable aujourd'hui... et donc à un retour des radionucléides en surface, l’eau des rivières, les cultures, ... conséquences qu’on a connues à KYTCHYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ? Pas ceux qui imposent aujourd'hui à la majorité de la population une telle décision irresponsable. Faites donc un référendum sur une question aussi décisive !
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1055 - Que fera t on si ?
Posée par Marie ROUSSIER, L'organisme que vous représentez (option), le 15/12/2013
Gérons ce qui nous a été légué, mais essayons de ne pas faire porter à nos successeurs nos erreurs. Qui pourra trouver une solution en cas d'accident majeur qui provoquera une fuite de radioactivité? Qui assumera les vies déformées par la radioactivité ? Qui assume les vies qui ne sont pas secourues, ceux qui meurent de ne pouvoir utiliser les technologies connues pour améliorer leur repas quotidiens, leur santé, tandis que nous jettons des millions pour nfouir des déchets qui font et feront mal par leur radioactivité? qui connait l'histoire, et ce qui se passera dans les années futures? Le monde a changé en 200 ans plus que dans toute l'évolution humaine auparavent, que croyons nous maintenir pour 300 000 années à venir Qui sera responsable ? Quand, dans2 ou 40 milliers d’années, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception,, une infiltration d’eau, conduiront à une perte de confinement, et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1054 - avenir
Posée par annie LEROY, L'organisme que vous représentez (option) (SAINTE ADRESSE), le 15/12/2013
Quand, dans quelques dizaines années ou milliers d’années un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou chépakoi... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1053 - QUI SERA RESPONSABLE
Posée par CATHERINE BOUILLOT, L'organisme que vous représentez (option) (PIMBO), le 16/12/2013
Quand, dans 100 dizaines années ou PLUSIEURS milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduira à une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1052 - Qui sera responsable ?
Posée par Jacques LUBAC, L'organisme que vous représentez (option) (ST GENIS LES OLLIERES), le 16/12/2013
Quand, dans une dizaine d' années ou des milliers d’années, un accident mécanique, ou une intrusion humaine, conduiront à une explosion,ou à des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ? Vous avez aussi le droit de poser la question que vous voulez. Vous avez même une liste des thèmes (3) Avan
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1051 - QUI SERA RESPONSABLE?
Posée par Thierry STASICA, le 19/12/2013
Bonjour,
Tant que citoyen planétaire, j'ai une question à vous poser :
Quand, dans x dizaines d'années ou y milliers d’années,
un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique,
une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain,
un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau,
une intrusion humaine pourrait conduire à une explosion, un incendie, une perte de confinement,
des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles,
l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2)
TCHERNOBYL et FUKUSHIMA : QUI SERA RESPONSABLE ?
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 1050
Posée par Merlin FILS DE LA TERRE, MOI MÊME (BOUISSE), le 15/12/2013
Bonjour Qui sera responsable ? Si en 2014, ou 2015, ou 2016, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, une combinaison de ces événements survenait ou chépakoi... et conduisait à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... ou chépakoi encore ... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet, sur Paris, Lyon, ou Marseille et/ou les vallées environnantes et/ou chez les voisins, Allemagne, Italie, Espagne ou chépakoi encore ... avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA ... Qui sera responsable ? Comment se fait-il, en tant que citoyen, que je sois mis en esclavage, pris en otage à l'utilisation de cette technologie mortifère qui peut-être remplacée par d'autres technologies à notre disposition et/ou qui sont planquées dans des tiroirs !? Ce qui n'est jamais abordé est : qu'un accident survienne à un an, dix ans, vingt ans, etc, dans le processus des réincarnations, les enfants de demain c'est nous, chacun de nous. Je ne me vois pas renaître sans bras ni jambes ... Mon intention n'est pas de créer un processus de peur, mais au même titre que des études sont pratiquées sur le plan technologique, de terrain, d'eau, de conception, pourquoi la dimension spirituelle n'est-elle pas abordée. Je n'ai pas parlé de religion, mais de spirituel. Pourquoi cet élément est-il écarté !? Pourquoi ne fait-il pas partie des éléments de recherche !? Je demande à ce qu'il fasse partie des éléments de recherche. Fraternellement.
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 1049
Posée par Bernard DEJOS (FRANCE), le 15/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans x dizaines années ou y milliers d’années, , un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou ???? conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet , etc avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 1048
Posée par bruno POTHIER (JOIGNY), le 15/12/2013
Quand, dans des dizaines années ou des milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA (désolé, là vous n’avez pas le choix) Qui sera responsable ?
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 1047
Posée par Marie-Pascale VENEAU (MONTPELLIER), le 15/12/2013
Quand dans des dizaines ou centaines d'années un bug informatique ou une erreur humaine, ou bien encore un tremblement de terre auront conduit à une explosion ou une perte de confinement et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, l’eau des rivières et du robinet, avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA , Qui sera responsable ?
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 1046
Posée par Monique SANCIAUD (ESPARROS), le 15/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans des dizaines années ou des milliers d’années,un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou un drone guidé par des terroristes pour penser au pire, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites.et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches et leur lait, les légumes et fruits des jardins, les champignons, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ? Et comment fera-t-on ? Alors que si ces déchets étaient stockés en surface on pourrait les surveiller au lieu de faire la politique de l'autruche et de dormir sur un volcan.
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 1045
Posée par Christine FAURIS (GARCHES), le 15/12/2013
Quand, dans x dizaines années ou y milliers d’années, (vous mettez le chiffre que vous voulez), un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites, et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA : Qui sera responsable ?
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 1044
Posée par Rodolphe ANDRÉ (TOURS), le 15/12/2013
Quand, demain, un accident, une erreur, un mouvement, une infiltration, conduiront à des fuites, et donc à des radionucléides ou des révoltes en surface, avec les conséquences connues déjà dans l'histoire humaine : Qui sera responsable !
Réponse du 09/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 1043
Posée par raynald RIGOLOT (NANCY), le 14/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans 4 ou 500 ans un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine,.... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... que se passera-t-il ? Dans l’herbe puis le lait des vaches, les champignons, les eaux de ruissellement, des ruisseaux et rivières, l’eau du robinet, l'air que nous respirerons....avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ? Comment peut-on mépriser le débat public et ne pas reconnaître des avis de scientifiques alertant sur des dangers réels et sérieux que votre projet fera courir ? Votre responsabilité posthume ne m'intéresse pas !
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 1042
Posée par Robert BORDIN (DRAGUIGNAN), le 14/12/2013
Quand, dans quelques dizaines années ou y milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, un tremblement de terre, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou chépakoi... conduiront à une explosion ou un incendie, et donc à un retour des radionucléides en surface, avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA ( Qui sera responsable ?
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 1041
Posée par Laurienne BERNARD-MAZURE (REVEL), le 14/12/2013
Quand, dans des dizaines années ou des milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,TCHERNOBYL et FUKUSHIMA... Qui sera responsable ?
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 1040
Posée par David AMMAR (ESSONNE), le 14/12/2013
Quand, dans des dizaines années voir des milliers d’années ,un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, enfin un accident qui conduira à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 1039
Posée par SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT (GAILLON), le 16/01/2014
Question posée dans le cahier d'acteurs n°109 de Sauvegarde de l'Envrionnement : Quelles sont les procédures d'intervention de l'Andra, à 500m dans le sol, dans chacun des cas suivants : incendie, accident nucléaire ?
Réponse du 30/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les activités de chantier et les activités nucléaires seront séparées sur les installations de Cigéo, et seront donc exploitées comme deux entités indépendantes. Pour cela :
- dans l’installation souterraine, la zone d’exploitation et la zone chantier seront physiquement séparées,
- l’accès aux différentes zones se fera par des accès distincts : par la descenderie pour la zone en exploitation, par les puits verticaux pour la zone chantier,
- chaque zone aura un circuit de ventilation dédié.
Dans la zone d’exploitation, les colis de déchets radioactifs seront transférés en souterrain dans des hottes qui feront écran aux radiations émises par les déchets. Ainsi le personnel pourra circuler dans les galeries souterraines pendant l’exploitation notamment pour assurer la surveillance de l’installation et la maintenance des équipements.
Cigéo n’est pas une centrale nucléaire mais un centre de stockage de déchets (stabilisés et conditionnés dans des fûts en béton ou en acier). Selon le principe de défense en profondeur, pour éviter toute dispersion incontrôlée, l’objectif dès le début de la conception de Cigéo est d’identifier l’ensemble des défaillances et des agressions potentielles d’origine interne (chute, collision, incendie, explosion…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourrait remettre en cause le confinement des colis de stockage. Pour chaque défaillance et agression, l’Andra met en place un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles. Ainsi, conformément à la demande formulée par l’Autorité de sûreté nucléaire, l’Andra conçoit Cigéo de sorte que l’on puisse exclure un accident de grande ampleur, comme l’incendie d’un grand nombre de colis dans une alvéole.
Malgré ces dispositions, selon le même principe de défense en profondeur, les situations accidentelles sont envisagées, pour vérifier que les conséquences en termes radiologiques restent limitées. Au stade actuel de la conception et de l’analyse des risques, les accidents les plus significatifs qui pourraient conduire à une dispersion de la radioactivité sont la chute d’un colis de déchets, une collision ou un départ de feu sur un engin de transfert transportant un colis. Cela s’explique par la nature des activités nucléaires de Cigéo qui sont principalement de la manipulation de colis de déchets.
Concernant le risque incendie en particulier
Une équipe de pompiers sera présente en permanence sur place, mais de nombreuses autres mesures sont prises pour maîtriser le risque incendie.
Le risque incendie est pris en compte dès la conception de Cigéo : pour réduire le risque d’incendie, une première mesure consiste à limiter la quantité de produits combustibles ou inflammables dans les équipements du stockage. Par exemple, si Cigéo est réalisé, les câbles électriques seront ignifugés et les véhicules à moteur thermique seront interdits dans l’installation nucléaire souterraine de Cigéo. De plus, des dispositifs de détection incendie seront répartis dans les installations pour détecter rapidement et localiser tout départ de feu. Plusieurs systèmes d’extinction automatiques seront installés dans l’installation souterraine. Des systèmes embarqués d’extinction automatique (gaz, poudre...) seront placés sur les engins de transfert des colis de déchets et sur les engins de manutention en alvéole, afin d’éteindre tout départ de feu. Des systèmes d’extinction automatique seront également disposés dans certaines zones de l’installation souterraine telles que les locaux électriques et les zones de soutien logistique. Ces dispositifs seront mis en place en complément de moyens de lutte contre l’incendie plus traditionnels de types extincteurs, points de raccordement à un réseau d’alimentation en agent extincteur (eau, mousse…) etc.
Malgré toutes ces dispositions, une situation d'incendie est quand même considérée par prudence. Dans les installations de surface, les mêmes principes seront appliqués que dans les installations nucléaires de base : en cas d’incendie, les locaux concernés seraient isolés du reste de l’installation, les moyens d’extinction et d’intervention seraient déclenchés et le personnel serait évacué. Dans l’installation souterraine, compte tenu de sa géométrie spécifique, ces dispositions sont adaptées dès la conception. Des systèmes de compartimentage et de ventilation sont prévus pour limiter la propagation du feu. Des équipements d’intervention seront prépositionnés dans l’installation souterraine en permanence. L'architecture souterraine retenue pour le stockage permettra aux secours d'intervenir dans des galeries à l'abri des fumées et facilite l'évacuation du personnel.
Outre la mise à l’abri du personnel, la maîtrise du risque incendie vise aussi à protéger les colis contenant les substances radioactives des effets de l’incendie afin de maintenir le confinement de ces substances. Pour cela, les colis seront disposés dans des équipements qualifiés pour résister au feu (cellules résistantes au feu munies de portes coupe-feu, hotte de protection pour le transfert dans l’installation souterraine). Les conteneurs de stockage sont également conçus pour assurer une protection contre l’incendie. Ces dispositions permettent d’exclure tout effet domino entre les colis stockés.
La définition de l’ensemble de ces dispositifs associe les services compétents des sapeurs-pompiers et fait l’objet de contrôle par l’Autorité de sûreté nucléaire. Cigéo ne sera jamais autorisé si l’Andra ne démontre pas qu’elle maîtrise tous les risques, dont le risque d’incendie.
QUESTION 1038
Posée par Annette MULLER (SAINT-BERNARD), le 14/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans des centaines d'années, voire des milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine ou un tremblement de terre conduiront à une explosion et une perte de confinement et donc à un retour des radionucléides en surface avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA ? Qui ? Qui sera responsable ?
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 1037
Posée par marie VENEAU (AUXERRE), le 14/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans des dizaines années ou y milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites...et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à YCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ? Les criminels anonymes
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 1036
Posée par Emile VENEAU (SAINT JULIEN DU SAULT), le 14/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans des dizaines années ou y milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites...et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à YCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 1035
Posée par rené VENEAU (MONTPELLIER), le 14/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans x dizaines années ou y milliers d’années, (vous mettez le chiffre que vous voulez), un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou chépakoi... (vous choisissez ce que vous voulez) conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... (vous choisissez ce que vous voulez) et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet (vous choisissez ce que vous voulez) avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA (désolé, là vous n’avez pas le choix) Qui sera responsable ?
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 1034
Posée par Fulcieri MALTINI (ALAIRAC), le 14/12/2013
Quand, dans 100 milliers d’années et même plus tôt, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet, la nourriture avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA et des dizaines d'autres accidents notamment en Union Soviétique Qui sera responsable ?
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 1033
Posée par jean SCHIERANO (ANTIBES), le 15/12/2013
Quand, dans 30 ans par exemple, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, etc...conduiront à une explosion gravissime et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches et l’eau des rivières ou du robinet avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 1032
Posée par Michel MARZIN (MORLAIX), le 14/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans des dizaines années ou des millions d'années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d'eau, une intrusion humaine, conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l'eau des rivières, l'eau du robinet avec les conséquences qu'on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ? Nous, la générations qui aura décidé de ce crime envers nos descendants Car c’est aussi un stockage souterrain en couche argileuse qui accueillera des déchets contenant du plutonium à Bure. Et avec une région parisienne de plusieurs millions d’habitants à proximité, c’est une apocalypse en préparation à l’image de Kytchym en 1957 car on ne commence pas par examiner la question fondamentale. Enfouir ces déchets se révèle être la pire des options Et c’est un crime, notamment envers les générations à venir, car c’est ne leur laisser aucune possibilité de choix d’agir sur leur confinement ou leur transmutation. Sans parler de la contamination inéluctable des nappes phréatiques ou pire comme cela vient d’être exposé, le risque de criticité débouchant sur l’explosion nucléaire comme l’a connu Kytchym. Le bilan catastrophique du site d’enfouissement allemand d’Asse II et le coup d’arrêt porté au projet d’enfouissement de Yucca Mountain (Etats-Unis) par le président Obama montrent que l’expérience de Bure (Meuse) doit être arrêtée, et l’option de l’enfouissement des déchets radioactifs définitivement proscrite. La question fondamentale préalable, incontournable et impérative Avant d’aborder la question « quoi faire des déchets nucléaires ? », une question préalable évidente aurait du se poser et présider déjà le tout premier débat sur le sujet en 2005 : Sachant qu’en l’état actuel des connaissances et des techniques, personne n’est capable de confiner des déchets radioactifs pendant des millions d’années ni de les transmuter rapidement en éléments stables, doit-on continuer à produire des déchets radioactifs ? La réponse est évidente pour toute personne sensée : NON. Il faut donc arrêter la production de déchets radioactifs. Certains sont si dangereux comme le plutonium qu’un millionième de gramme inhalé suffit à déclencher un cancer du poumon dans la décennie suivante. Il faut 24 000 ans pour que le plutonium perde la moitié de sa radioactivité. Les opposants au nucléaire dans les années 70 soulignaient déjà l’absence de solution pour les déchets radioactifs et le risque élevé de catastrophe. Quarante ans plus tard, 2 catastrophes nucléaires ont eu lieu en plus de celle enfin révélée, Kytchym. Et il n’y a aucune avancée pour les déchets radioactifs. Dans de telles conditions, un entêtement ne peut être que criminel.
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 1031
Posée par Benoît LARRADET (PAU), le 14/12/2013
Qui sera responsable ? Quand, dans plusieurs dizaines années ou des milliers d’années un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou autres problèmes non prévus conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ? Nous n'avons pas le droit de faire de tel pari sur l'avenir.
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 1030
Posée par nonucleaire CHALMETON (NARBONNE (PROCHE DE COMURHEX)), le 14/12/2013
Dans 50 ans ou plusieurs milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau tant de choses inconnues ce jour .... conduiront à une explosion, une fuite... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans les prés,l’eau des rivières, enfin dans la nature où vivent les humains , où vivront mes petits ou arrieres petits enfants avec les conséquences qu’on a connues à TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ? vous n'aurez plus qu'à classer le site en IBN ?
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 1029
Posée par Pierre FERRANDON, - (ANNECY), le 14/12/2013
Monsieur, Quand, dans x dizaines années ou y milliers d¹années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d¹eau, une intrusion humaine, ou chépakoi conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l¹herbe des vaches, le pied des girolles, l¹eau des rivières, l¹eau du robinet avec les conséquences qu¹on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA. Qui sera responsable ? Cordialement Pierre Ferrandon -----------------------------------------------
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 1028
Posée par Chantal FRANCHE (TURSAC), le 15/12/2013
Comment pouvez-vous être certains qu'il n'y a aucun danger pour l'avenir ? Avez-vous l'absolue assurance qu'aucun sinistre n'affectera les installations ? Qui sera responsable en cas de problème ? Qui paiera ? Qui réparera les dégâts ? Seront-ils réparables ? Quelles populations seront affectées en premier lieu ? Et après ? Comment & quelle aide leur parviendra-t-elle ? Nous avons pourtant déjà de récentes malheureuses expériences: Tchernobyl, Fukushima ... On n'a absolument pas le droit de jouer ainsi avec les populations, avec les êtres vivants,. Et tout cela pour quoi ? Pour du profit ?
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’Andra n’a absolument aucun intérêt financier à concevoir le projet Cigeo plutôt qu’une autre solution. L’Andra est un établissement public qui a pour mission de concevoir des centres capables de protéger l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets. Elle est placée sous la tutelle des ministères en charge de l’environnement, de l’énergie et de la recherche.
En France et à l’étranger, le stockage profond est considéré actuellement comme la solution la plus sûre et la plus durable en tant qu’étape finale de la gestion des déchets les plus radioactifs (voir par exemple la directive européenne du 19 juillet 2011 ainsi que le débat du 23 septembre 2013 sur la comparaison des expériences internationales). Le stockage ne fait pas disparaître les déchets radioactifs, mais il permet de ne pas reporter leur charge sur les générations futures en leur donnant la possibilité de les mettre en sécurité de manière définitive.
Notre génération a la responsabilité de mettre en place des solutions de gestion sûres pour les déchets radioactifs produits depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Le but étant de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, tous les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation sont identifiés par l’Andra en amont de la conception. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
QUESTION 1027
Posée par Jacques LE ROUX (POUSSAN ), le 15/12/2013
Quand, dans des dizaines années ou des milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, etc. conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites, etc., et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet, etc....
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 1026 - Froid dans le dos
Posée par Jacqueline FIHEY (EVREUX), le 20/12/2013
Oui, cela me fait froid dans le dos de lire ces nombreux avis qui invoquent le bien fondé de la CONFIANCE en la science et en la DEMOCRATIE qui présiderait ce débat . Nous citoyens avons nous choisi d'avoir à se confronter au problème du devenir des déchets nucléaires ? Avons nous choisi le nucléaire? Avons nous été informés que la science n'avait pas trouvé de solution au problème des déchets nucléaires,alors que les centrales étaient déjà prêtes à fonctionner et qure 40ans plus tard, après des décennies de recherches très onéreuses , la science n'a toujours pas trouvé ! Et maintenant, on nous ferait croire que c'est le summum de la DEMOCRATIE que de nous faire approuver le projet CIGEO comme peut être la moins mauvaise des solutions ? Hélas...
Réponse du 21/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
Sachez que le Parlement s’est saisi de la question des déchets radioactifs dès 1991. Il se saisira à nouveau du sujet pour définir les conditions de réversibilité. Depuis plus de 20 ans, l’ensemble des recherches menées sur la gestion des déchets radioactifs sont évaluées de manière indépendante sur le plan scientifique et de la sûreté. Ces évaluations sont publiques et consultables sur le site du débat public. Les acteurs locaux, en particulier le Comité local d’information et de suivi, sont associés à chaque étape du projet. A ce jour, près de 100 000 personnes ont fait la démarche de venir visiter le site du Laboratoire souterrain où sont menées les recherches sur le projet de stockage.
QUESTION 1025 - Viscéralement opposé à l'enfouissement
Posée par Luc DELMOTTE (LA ROCHELLE), le 20/12/2013
souvenez-vous du proverbe qui dit que la terre ne nous appartient pas, ce sont nos enfants qui nous la prêtent. Avons-nous le droit de la leur piéger ainsi ?
Réponse du 30/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Avons-nous le droit de faire reporter continuellement la charge de la gestion de ces déchets sur les générations suivantes ? Nos enfants pourraient nous reprocher de ne pas avoir préparé de solution pour gérer les déchets radioactifs produits par les activités dont nous bénéficions au quotidien.
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestions sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
QUESTION 1024 - Stockage des déchets
Posée par Saima NAH, L'organisme que vous représentez (option), le 15/12/2013
Le problème de la gestion des déchets nucléaires s'étant posé dès le début, plus ou moins, pourquoi poursuivons-nous dans la voie du nucléaire alors que nous n'avons pas de solution satisfaisante ? La plupart des déchets étant à vie longue et radioactivité élevée, leur enfouissement n'est pas une solution satisfaisante. En effet, allons-nous polluer tout le sous-sol français puis étranger, sachant qu'on ne peut pas éliminer ces déchets rapidement pour faire de la place aux suivants ? Pourquoi les autorités ne mettent pas tout simplement un terme à cette aberration tant environnementale qu'économique ?? On dépense des sommes astronomiques pour pourrir notre terre, nos responsables politiques n'ont-ils donc pas de conscience environnementale, sociale, humaine ?
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
La loi du 28 juin 2006 a fait le choix du stockage réversible profond pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations futures. Elle demande à l’Andra d’étudier et d’implanter Cigéo en rappelant que « la demande d'autorisation de création [d’un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs] doit concerner une couche géologique ayant fait l'objet d'études au moyen d'un laboratoire souterrain. » L’Andra poursuit donc ses études en vue d’élaborer pour 2015 le dossier support à l’instruction de la demande d’autorisation de création de Cigéo en Meuse/Haute-Marne, dans la couche d’argile dont les propriétés de confinement sont désormais reconnues.
Quelles que soient les orientations en matière de politique nucléaire, les déchets déjà produits devront être gérés de façon sûre et responsable. Il est par conséquent nécessaire de consacrer de l’argent à la construction et à l’exploitation des centres de stockage. En vertu de la loi, ces sommes qui ont été mises de côté par les producteurs de déchets ne peuvent pas être détournées à d’autres fins. Cela conduirait à reporter intégralement sur les générations futures les charges de long terme liées à la gestion des déchets radioactifs.
Enfin, le président de la République a décidé d’engager la transition énergétique, cette transition reposant d'une part sur la sobriété et l’efficacité énergétique, et d'autre part sur la diversification des sources de production et d'approvisionnement.
Concernant la diversification de nos sources d’énergies, le Président de la République a fixé un cap : réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% d'ici 2025. Parallèlement, le Président de la République a indiqué que la transition énergétique serait fondée sur deux principes : l'efficacité énergétique d'une part, et la priorité donnée aux énergies renouvelables d'autre part. Cette mutation prendra du temps et supposera des étapes d’évaluation en fonction des progrès technologiques et scientifiques et des prix relatifs de chaque source d’énergie.
QUESTION 1023 - Mémoire des lieux et des procédures
Posée par Monique VÉRILLON, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 15/12/2013
Etant donné la durée de vie de certains éléments enfouis, comment ne pas douter de la bonne transmission des informations et des procédures alors que la récente catastrophe de Fukishima a montré les défaillances de Tepco dans ce domaine, et sur un temps très court ?
Réponse du 10/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif fondamental de Cigéo est de protéger l’homme et l’environnement des déchets radioactifs sur de très longues échelles de temps. La sûreté à long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. C’est une des raisons qui a conduit, en 2006, le Parlement à retenir la solution du stockage profond. En effet, cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli, contrairement à l’entreposage. En cas de perte complète de la mémoire du stockage, une intrusion inopinée à 500 mètres sous terre apparaît peu plausible, du moins sans un minimum d’investigations préalables. L’Andra évalue cependant par précaution dans son analyse de sûreté les conséquences d’un forage à travers le stockage pour vérifier que le stockage resterait sûr.
Malgré cette robustesse du stockage même en cas d’oubli, l’Andra conçoit Cigéo avec l’objectif d’en conserver la mémoire et de la transmettre aux générations futures le plus longtemps possible. Des solutions d’archivage de long terme existent pour les centres de stockage de surface exploités par l’Andra et font l’objet de revues périodiques. Le retour d’expérience montre que ces solutions paraissent robustes pour au moins les 500 premières années. Ainsi, pour Cigéo, l’Andra prévoit qu’un centre de la mémoire perdurera sur le site. Il pourra accueillir le public et comprendra notamment les archives du Centre.
De manière générale, le maintien de la mémoire doit aussi impliquer les acteurs locaux, qui peuvent prendre le relai en cas de défaillance de l’Andra ou de l’État. L’Andra veille d’ores et déjà à les informer sur les enjeux associés à la mémoire et étudie avec des anthropologues, des philosophes ou encore des artistes les facteurs qui peuvent favoriser la transmission de la mémoire. La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
L’Andra a lancé en 2010 un programme d’études pour proposer des outils qui rendent cette transmission plus robuste sur une échelle de temps millénaire. Des pistes se dessinent tels des marqueurs de surface, mais aussi des rendez-vous réguliers à mettre en place au niveau des populations locales.
En tout état de cause, comme il est impossible de garantir notre capacité à communiquer avec des êtres vivant dans plusieurs milliers d’années, c’est chaque génération qui aura la responsabilité de contribuer à transmettre cette mémoire aux générations suivantes.
QUESTION 1022 - cout de l'enfouissement
Posée par Christo MICHE, L'organisme que vous représentez (option) (STRASBOURG), le 15/12/2013
Bonjour, en tant que citoyen, je m'interroge sur le cout de l'enfouissement des déchets nucléaires pour des centaines, des milliers d'année avec l'obligation (?) de surveiller le site, de le ventiler en permanence, de sécuriser les environs ... il me semble que nous engageons le pays dans des dépenses considérables qui ne sont pas comprises dans le cout actuel de l'électricité nucléaire et donc qui faussent les informations que l'on donne actuellement sur "l'avantage" du nucléaire par rapport aux autres énergies notamment en voulant en exporter partout dans le monde.
Réponse du 13/02/2014,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
La question des coûts de long terme du nucléaire et du mécanisme de leur financement a été traitée dans le rapport de la Cour des Comptes de janvier 2012 (../docs/docs-complementaires/docs-avis-autorites-controle-evaluations/rapport-thematique-filiere-electronucleaire.pdf), le rapport de la Commission nationale d'évaluation du financement des charges de long terme (CNEF) de juillet 2012 (http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/1207_10_Rapport_de_la_CNEF.pdf) et le rapport de la commission d'enquête du Sénat sur les coûts réels de l'électricité de juillet 2012 (http://www.senat.fr/commission/enquete/cout_electricite/).
Pour un nouveau réacteur nucléaire sur l’ensemble de sa durée de fonctionnement, le coût du stockage des déchets radioactifs est de l’ordre de 1 à 2 %.
La Cour des Comptes a estimé dans son rapport de 2012 sur les coûts de la filière électronucléaire que le coût de production de l’électricité nucléaire par les centrales nucléaires en exploitation était d'environ 50€ par MWh
A titre de comparaison, voici ci-dessous les coûts de production de différentes formes d'énergies :
- énergie hydraulique : 15-20 €/MWh
- éolien terrestre : 80-90 €/MWh
- éolien en mer : plus de 220 €/MWh
- photovoltaïque : entre 230 et 370 €/Mwh selon la taille de l'installation
- charbon et gaz : entre 70 et 100 €/MWh (pour les nouveaux projets de centrales)
QUESTION 1021 - Combustibles
Posée par Régis GAUGUIER, L'organisme que vous représentez (option) (LE PERDIGAL FIRMI), le 15/12/2013
Est ce que l'ANDRA prévoit de stocker des assemblages de combustible usé ? Si oui, est ce que cette possibilité s'étendra aux combustibles mox ?
Réponse du 31/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La nécessité de stocker des combustibles usés dépendra de la politique énergétique qui sera mise en œuvre par la France dans le futur.
Dans le cadre de la politique énergétique actuelle en France, les combustibles usés issus de la production électronucléaire ne sont pas considérés comme des déchets mais comme des matières pouvant être valorisées, notamment dans les réacteurs de quatrième génération. A ce titre, ils ne sont pas destinés à être stockés dans Cigéo. Seuls les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue, issus du traitement de combustibles usés, sont destinés à Cigéo.
Dans l’hypothèse où les combustibles usés devraient être stockés directement, après refroidissement, ils pourraient être stockés dans Cigéo, qui a été conçu pour être flexible afin de pouvoir s’adapter à d’éventuels changements de la politique énergétique et à ses conséquences sur la nature et les volumes de déchets qui devront alors être stockés. A la demande du Ministère en charge de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, l’Andra, EDF et Areva ont étudié l’impact des différents scénarios établis dans le cadre du débat national sur la transition énergétique sur la production de déchets radioactifs et sur le projet Cigéo : ../docs/rapport-etude/20130705-courrier-ministere-ecologie.pdf
La faisabilité de principe et la sûreté du stockage profond des combustibles usés a par ailleurs été démontrée par l’Andra en 2005. Dans le cadre du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, l’État a demandé à l’Andra de vérifier par précaution que les concepts de stockage de Cigéo restent compatibles avec l’hypothèse d’un stockage direct de combustibles usés si ceux-ci étaient un jour considérés comme des déchets. L’Andra a remis fin 2012 un rapport d’étape. Dans l’hypothèse d’un stockage direct des combustibles usés, compte tenu du temps nécessaire de refroidissement, comme pour l’essentiel des déchets HA, leur stockage n’interviendrait pas avant l’horizon 2070/2080. Si le stockage direct de combustibles usés était décidé, l’Autorité de sûreté nucléaire recommande la réalisation, au préalable, de tests industriels in situ afin de qualifier les systèmes de manutention des colis dans l’alvéole.
La nature et les quantités de déchets autorisés pour un stockage dans Cigéo seront fixées par le décret d’autorisation de création du centre. Toute évolution notable de cet inventaire devra faire l’objet d’un nouveau processus d’autorisation, comprenant notamment une enquête publique et un nouveau décret d’autorisation.
QUESTION 1020 - Echelle de civilisation
Posée par André HATZ, MEMBRE DE STOP FESSENHEIM (GERTWILLER), le 15/12/2013
En enfouissant des déchets à BURE, dont la durée de vie sera supérieure au temps qui nous sépare de Ramses II, comment ferez-vous concrètement pour être certains de pouvoir communiquer à nos descendants, je veux dire aux civilisations futures, du caractère DANGEREUX des déchets que vous allez y déposer ? Quelle garanties apportez-vous ?
Réponse du 08/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage:
L’objectif fondamental de Cigéo est de protéger l’homme et l’environnement des déchets radioactifs sur de très longues échelles de temps. La sûreté à long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. C’est une des raisons qui a conduit, en 2006, le Parlement à retenir la solution du stockage profond. En effet, cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli, contrairement à l’entreposage. En cas de perte complète de la mémoire du stockage, une intrusion inopinée à 500 mètres sous terre apparaît peu plausible, du moins sans un minimum d’investigations préalables. L’Andra évalue cependant par précaution dans son analyse de sûreté les conséquences d’un forage à travers le stockage pour vérifier que le stockage resterait sûr.
Malgré cette robustesse du stockage même en cas d’oubli, l’Andra conçoit Cigéo avec l’objectif d’en conserver la mémoire et de la transmettre aux générations futures le plus longtemps possible. Des solutions d’archivage de long terme existent pour les centres de stockage de surface exploités par l’Andra et font l’objet de revues périodiques. Le retour d’expérience montre que ces solutions paraissent robustes pour au moins les 500 premières années. Ainsi, pour Cigéo, l’Andra prévoit qu’un centre de la mémoire perdurera sur le site. Il pourra accueillir le public et comprendra notamment les archives du Centre. De manière générale, le maintien de la mémoire doit aussi impliquer les acteurs locaux, qui peuvent prendre le relai en cas de défaillance de l’Andra ou de l’État. L’Andra veille d’ores et déjà à les informer sur les enjeux associés à la mémoire et étudie avec des anthropologues, des philosophes ou encore des artistes les facteurs qui peuvent favoriser la transmission de la mémoire. La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
En tout état de cause, comme il est impossible de garantir notre capacité à communiquer avec des êtres vivant dans plusieurs milliers d’années, c’est chaque génération qui aura la responsabilité de contribuer à transmettre cette mémoire aux générations suivantes.
QUESTION 1019 - Le contre-exemple de Asse
Posée par Monique VÉRILLON, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 15/12/2013
Comment oser encore nous parler d'enfouissement des déchets après les problèmes scandaleux de la mine de Asse en Allemagne où, aujourd’hui, la contamination dépasse dans certaines zones huit fois les normes autorisées pour le césium 137 ?
Réponse du 31/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
En aucun cas la mine de Asse en Allemagne ne peut être comparée au projet Cigéo. Le stockage à Asse a été réalisé au titre du droit minier et non des réglementations de la sûreté nucléaire telles qu’elles existent aujourd’hui. Il s’agit d’une ancienne mine de sel qui a été reconvertie en un stockage de déchets radioactifs en 1967. Lors du creusement de la mine, aucune précaution n’avait été prise pour préserver le confinement assuré par le milieu géologique. Le stockage n’avait pas non plus été conçu au départ pour être réversible. Les difficultés rencontrées aujourd’hui à Asse illustrent pleinement l’importance d’une démarche d’étude scientifique et d’évaluation préalablement à la décision de mettre en œuvre un projet de stockage.
Cigéo ne pourra être autorisé qu'après un long processus d’études et de recherches, initié il y a plus de 20 ans par la loi de 1991. Les phénomènes induits par le creusement du stockage sur la roche argileuse sont étudiés au moyen du Laboratoire souterrain. La réversibilité est prise en compte dès la conception du stockage et des essais ont été réalisés pour confirmer sa faisabilité. Des autorités indépendantes (Commission nationale d’évaluation, Autorité de sûreté nucléaire, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire…) contrôlent l’avancement du projet à chaque étape. Les acteurs locaux sont impliqués notamment au travers du Comité local d’information et de suivi qui s’appuie également sur des expertises indépendantes.
Si Cigéo est autorisé, il sera construit progressivement. L’Andra propose que des rendez-vous soient programmés régulièrement avec l’ensemble des acteurs (riverains, collectivités, évaluateurs, État…) pour contrôler le déroulement du stockage. Ces rendez-vous seront notamment alimentés par les résultats des réexamens périodiques de sûreté, conduits au moins tous les 10 ans par l’Autorité de sûreté nucléaire, et par la surveillance du stockage. Le premier de ces rendez-vous pourrait avoir lieu cinq ans après le démarrage du centre.
QUESTION 1018 - la sagesse humaine et respect de notre planète
Posée par j-jacques VALLIENNE, L'organisme que vous représentez (option) (BERNAY ), le 15/12/2013
Comment maitriserez vous l'évolution géologique, la gestion de ce site sur ds centaines d'années voir plus? quel situation laisserez-vous à vos descendants? Comment gérerez-vous un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau ds les nappes souterraines ? Comment prévoyez-vous gérer les vapeurs radioactives extraites et leurs retombées ds les environs sur les herbages et la nature? Merci de votre réponse et salutations
Réponse du 07/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Votre question interroge sur l’approche générale de l’Andra en matière de risque et d’impact.
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Sur le long terme, la couche d’argile dans laquelle est implantée le stockage garantit l’éloignement des déchets radioactifs de la surface. Seuls quelques radionucléides mobiles et dont la durée de vie est longue pourront migrer à travers la couche d’argile après plusieurs dizaines de milliers d’années, puis potentiellement atteindre ensuite la surface et les nappes phréatiques, après plus de 100 000 ans et en quantités extrêmement faibles. Leur impact radiologique serait alors plusieurs dizaines de fois inférieur à la radioactivité naturelle.
Cigéo sera soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 1017 - quelle compagnie d'assurance acceptera de couvrir les risques du site d'enfouissement ?
Posée par Christine ELLISON-MASSOT, L'organisme que vous représentez (option) (VARENGEVILLE -SUR-MER), le 15/12/2013
quelle compagnie d'assurance acceptera de couvrir les risques liés à l'exploitation du site d'enfouissement ? Quelle compagnie d'assurance acceptera d'indemniser les riverains d'un tel site ?
Réponse du 27/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’Andra est un établissement public placé sous la tutelle de l’État. Pour Cigéo, comme tout industriel, l’Andra contractera des assurances destinées à couvrir les risques industriels classiques. De plus, Cigéo étant une installation nucléaire, elle est soumise au régime de responsabilité civile nucléaire. En cas d’accident nucléaire survenant sur le site de l’Andra, la responsabilité de cette dernière sera mise en cause sans que les victimes n’aient à prouver une faute de l’Andra. Ce régime a notamment pour intérêt de simplifier les recours des victimes qui ne sont pas obligées de multiplier les procédures à l’encontre des autres acteurs intervenant sur le site.
QUESTION 1016 - Par quels signes seront indiqués les lieux où seront entérrés les déchets nucléaires à vie longue ?
Posée par Christine ELLISON-MASSOT, L'organisme que vous représentez (option) (VARENGEVILLE -SUR-MER), le 15/12/2013
Par quels signes faut-il indiquer les lieux où seront enterrés les déchets nucléaires à vie longue pour que les générations futures ne les exhument pas par erreur ,à l'occasion d'un forage par exemple ? cf, l'édito paru dans le n°49 de Philosophie magazine ,paru en mai 2011 : "..au cours de l'Histoire ,aucun langage humain, aucun symbole n'a survécu plus de quelques millénaires ..."
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
L’objectif fondamental de Cigéo est de protéger l’homme et l’environnement des déchets radioactifs sur de très longues échelles de temps. La sûreté à long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. C’est une des raisons qui a conduit, en 2006, le Parlement à retenir la solution du stockage profond. En effet, cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli, contrairement à l’entreposage. En cas de perte complète de la mémoire du stockage, une intrusion inopinée à 500 mètres sous terre apparaît peu plausible, du moins sans un minimum d’investigations préalables. L’Andra évalue cependant par précaution dans son analyse de sûreté les conséquences d’un forage à travers le stockage pour vérifier que le stockage resterait sûr.
Malgré cette robustesse du stockage même en cas d’oubli, l’Andra conçoit Cigéo avec l’objectif d’en conserver la mémoire et de la transmettre aux générations futures le plus longtemps possible. Des solutions d’archivage de long terme existent pour les centres de stockage de surface exploités par l’Andra et font l’objet de revues périodiques. Le retour d’expérience montre que ces solutions paraissent robustes pour au moins les 500 premières années. Ainsi, pour Cigéo, l’Andra prévoit qu’un centre de la mémoire perdurera sur le site. Il pourra accueillir le public et comprendra notamment les archives du Centre.
De manière générale, le maintien de la mémoire doit aussi impliquer les acteurs locaux, qui peuvent prendre le relai en cas de défaillance de l’Andra ou de l’État. L’Andra veille d’ores et déjà à les informer sur les enjeux associés à la mémoire et étudie avec des anthropologues, des philosophes ou encore des artistes les facteurs qui peuvent favoriser la transmission de la mémoire. La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
L’Andra a lancé en 2010 un programme d’études pour proposer des outils qui rendent cette transmission plus robuste sur une échelle de temps millénaire. Des pistes se dessinent tels des marqueurs de surface, mais aussi des rendez-vous réguliers à mettre en place au niveau des populations locales.
En tout état de cause, comme il est impossible de garantir notre capacité à communiquer avec des êtres vivant dans plusieurs milliers d’années, c’est chaque génération qui aura la responsabilité de contribuer à transmettre cette mémoire aux générations suivantes.
QUESTION 1015 - Enfouissement des déchets radioactifs
Posée par Brigitte FLAHAULT, L'organisme que vous représentez (option) (SAINT MALO), le 15/12/2013
Enfouir des déchets, radioactifs pendant 100 000 ans, alors qu'une modification géologique imprévue ou qu'une défaillance technique peuvent toujours survenir : qui peut être assez irresponsable pour laisser cet héritage à nos survivants ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1014 - Après moi le déluge
Posée par michel BENQUET, L'organisme que vous représentez (option) (RENNES), le 15/12/2013
Qui, parmi les décisionnaires sera encore là pour assumer les conséquences de cette irresponsabilité le jour où il faudra payer l'addition ?
Réponse du 21/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Il n’est pas question d’avoir un jour à payer l’addition. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestions sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de déchets radioactifs. Grâce à la réversibilité, les générations suivantes garderont la possibilité de faire évoluer cette solution. Les rendez-vous proposés par l’Andra seront notamment alimentés par les résultats de la surveillance et par les recherches qui continueront à être menées sur la gestion des déchets radioactifs et les avancées technologiques. A chaque étape, il sera possible de décider de poursuivre le processus de stockage tel qu’initialement prévu ou de le modifier, par exemple si des solutions alternatives sont identifiées.
QUESTION 1013 - étanchéité des fûts ?
Posée par Christine ELLISON-MASSOT, L'organisme que vous représentez (option) (VARENGEVILLE -SUR-MER), le 15/12/2013
Comment les défenseurs du projet d'enfouissement à Bure peuvent -ils prétendre que les fûts contenant les déchets nucléaires à vie longue sont étanches ...sachant que de tels fûts ,transportés par CASTOR , émettent de la radioactivité ,mesurée par des labos indépendants ou par des militants ?
Réponse du 27/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
En se désintégrant, les atomes radioactifs émettent des rayonnements. Parmi ces rayonnements, le rayonnement gamma est le plus pénétrant. Ainsi, même un colis étanche de déchets radioactifs en acier ou en béton émet un rayonnement qui peut être mesuré. Lors des opérations de transport des déchets les plus irradiants, des emballages spécifiques sont utilisés pour atténuer ce rayonnement. Des contrôles de radioprotection sont systématiquement effectués pour s’assurer du respect des exigences réglementaires. Dans les installations nucléaires, la protection des opérateurs contre les risques d’irradiation est assurée par des écrans de protection (parois en béton, hottes blindées…).
QUESTION 1012 - localisation et identification des déchets
Posée par magali REUNBOT, L'organisme que vous représentez (option) (LOPERHET), le 15/12/2013
Comment envisager d'identifier et localiser durant des centaines ou des milliers d'années les déchets que nous enfouissons aujourd'hui? On ne sait déjà pas à quoi ressemblera la société humaine dans 200 ans.
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif premier du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Malgré cette robustesse du stockage même en cas d’oubli, l’Andra conçoit Cigéo avec l’objectif d’en conserver la mémoire et de la transmettre aux générations futures le plus longtemps possible. Des solutions d’archivage de long terme existent pour les centres de stockage de surface exploités par l’Andra et font l’objet de revues périodiques. Le retour d’expérience montre que ces solutions paraissent robustes pour au moins les 500 premières années. Ainsi, pour Cigéo, l’Andra prévoit qu’un centre de la mémoire perdurera sur le site. Il pourra accueillir le public et comprendra notamment les archives du Centre.
De manière générale, le maintien de la mémoire doit aussi impliquer les acteurs locaux, qui peuvent prendre le relai en cas de défaillance de l’Andra ou de l’État. L’Andra veille d’ores et déjà à les informer sur les enjeux associés à la mémoire et étudie avec des anthropologues, des philosophes ou encore des artistes les facteurs qui peuvent favoriser la transmission de la mémoire. La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
L’Andra a lancé en 2010 un programme d’études pour proposer des outils qui rendent cette transmission plus robuste sur une échelle de temps millénaire. Des pistes se dessinent tels des marqueurs de surface, mais aussi des rendez-vous réguliers à mettre en place au niveau des populations locales.
En tout état de cause, comme il est impossible de garantir notre capacité à communiquer avec des êtres vivant dans plusieurs milliers d’années, c’est chaque génération qui aura la responsabilité de contribuer à transmettre cette mémoire aux générations suivantes.
QUESTION 1011 - surveillant
Posée par jp GUILLERME, L'organisme que vous représentez (option) (QUEVEN), le 15/12/2013
Pouvez vous me donner le nom du surveillant dans 332 ans?
Réponse du 30/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les déchets destinés à Cigéo resteront dangereux plusieurs dizaines de milliers d’années. Donner le nom du surveillant dans 300, 500 ou 100 000 ans est bien sûr impossible et c’est justement parce qu’on ne peut pas assurer la surveillance de bâtiments d’entreposage en surface ou encore la pérennité de la société sur cette très longue échelle de temps que le Parlement a fait le choix du stockage profond comme solution de référence pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs. En effet, le principe du stockage profond est que sa sûreté à long terme ne repose pas sur des actions humaines, notamment sur une surveillance du site pendant des milliers d’années, mais sur le milieu géologique. Après la fermeture du stockage, la sûreté sera assurée de manière passive et ne nécessitera aucune action humaine. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Une surveillance du site pourra néanmoins être maintenue aussi longtemps que les générations futures le souhaiteront et des actions seront menées pour conserver et transmettre sa mémoire.
QUESTION 1010 - Pourquoi ne pas tirer les leçons des expériences passées ?
Posée par Christine ELLISON-MASSOT, L'organisme que vous représentez (option) (VARENGEVILLE-SUR-MER), le 15/12/2013
Pourquoi ne pas tirer les leçons des expériences passées ( Stocamine ,ASSE II , Yucca Mountain , Soulaines , Moivilliers , La Hague , Pontfarger-Morronvilliers ,Valduc ...) ? Il suffit de regarder les émissions de "C'est pas sorcier " sur les déchets nucléaires pour mesurer l'effet "bombe à retardement " qu'implique le projet d'enfouissement ...
Réponse du 21/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de déchets radioactifs. Grâce à la réversibilité, les générations suivantes garderont la possibilité de faire évoluer cette solution. Les rendez-vous proposés par l’Andra seront notamment alimentés par les résultats de la surveillance et par les recherches qui continueront à être menées sur la gestion des déchets radioactifs et les avancées technologiques. A chaque étape, il sera possible de décider de poursuivre le processus de stockage tel qu’initialement prévu ou de le modifier, par exemple si des solutions alternatives sont identifiées.
QUESTION 1009 - l'homme est il infaillible?
Posée par MICHELE CETRE, L'organisme que vous représentez (option) (ST MARCEL LES SAUZET), le 15/12/2013
comment pouvez vous, avec certitude , affirmer que dans qq milliers d'années, les déchets enfouis ne seront pas remis à l'air libre soit par un séisme, soit par des fouilles diverses? les gens oublieront forcément un jour que des déchets sont enterrés là.. L'HOMME N'EST PAS PLUS FORT QUE LA NATURE.
Réponse du 21/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le risque zéro n’existe pas et l’Andra ne prétend pas que le projet Cigeo ferait exception à la règle. Cependant la profondeur retenue pour le stockage, environ 500 mètres, permet de garantir que les colis de déchets ne reviendront jamais à l’air libre.
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestions sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Sur le long terme, la couche d’argile dans laquelle est implantée le stockage garantit l’éloignement des déchets radioactifs de la surface. Seuls quelques radionucléides mobiles et dont la durée de vie est longue pourront migrer à travers la couche d’argile après plusieurs dizaines de milliers d’années, puis potentiellement atteindre ensuite la surface et les nappes phréatiques, après plus de 100 000 ans et en quantités extrêmement faibles. Leur impact radiologique serait alors plusieurs dizaines de fois inférieur à la radioactivité naturelle.
Cigéo sera soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
A propos de la mémoire
Malgré la robustesse du stockage même en cas d’oubli, l’Andra conçoit Cigéo avec l’objectif d’en conserver la mémoire et de la transmettre aux générations futures le plus longtemps possible. Des solutions d’archivage de long terme existent pour les centres de stockage de surface exploités par l’Andra et font l’objet de revues périodiques. Le retour d’expérience montre que ces solutions paraissent robustes pour au moins les 500 premières années. Ainsi, pour Cigéo, l’Andra prévoit qu’un centre de la mémoire perdurera sur le site. Il pourra accueillir le public et comprendra notamment les archives du Centre.
De manière générale, le maintien de la mémoire doit aussi impliquer les acteurs locaux, qui peuvent prendre le relai en cas de défaillance de l’Andra ou de l’État. L’Andra veille d’ores et déjà à les informer sur les enjeux associés à la mémoire et étudie avec des anthropologues, des philosophes ou encore des artistes les facteurs qui peuvent favoriser la transmission de la mémoire. La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
L’Andra a lancé en 2010 un programme d’études pour proposer des outils qui rendent cette transmission plus robuste sur une échelle de temps millénaire. Des pistes se dessinent tels des marqueurs de surface, mais aussi des rendez-vous réguliers à mettre en place au niveau des populations locales.
En tout état de cause, comme il est impossible de garantir notre capacité à communiquer avec des êtres vivant dans plusieurs milliers d’années, c’est chaque génération qui aura la responsabilité de contribuer à transmettre cette mémoire aux générations suivantes.
QUESTION 1008 - Remboursement en cas de catastrophe
Posée par Philippe LEROY, L'organisme que vous représentez (option) (PEU IMPORTE VU LA PORTÉE D'UNE CONTAMINATION NUCLÉAIRE), le 15/12/2013
Bonjour, Je viens de vendre ma maison et j'hésite beaucoup à en racheter une. En effet, en cas de catastrophe nucléaire qui rendrait dangereux le fait de rester dans ma région, qui me remboursera la perte de valeur de ma maison ? Je me retrouverais alors sans le sou (voire même endetté auprès des banques...). Et de toute manière, je préfère sans doute être sans attache trop importante à une région pour pouvoir fuir dans un autre pays si une catastrophe devait arriver... Pouvez-vous indiquer quel est le montant garanti en cas de catastrophe majeure ? Et qui pourrait payer toutes les personnes ruinées ? Merci pour votre réponse. Philippe Leroy
Réponse du 30/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Pour que le projet puisse être autorisé, l’Andra doit démontrer à l’Autorité de sûreté nucléaire qu’elle maîtrise les risques liés à l’installation, que ce soit pendant son exploitation ou après sa fermeture. Ainsi, conformément au principe de défense en profondeur, tous les dangers potentiels qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation sont identifiés en amont de la conception. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels montre que leurs conséquences resteraient limitées, et nettement en deçà des normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire.
Comme toutes les installations nucléaires, Cigéo fera l’objet régulièrement de réexamens complets de sûreté, en accord avec les exigences de l’ASN qui impose un réexamen périodique de sûreté au moins tous les 10 ans. Tout au long de l’exploitation du stockage, l’ASN pourra imposer des prescriptions supplémentaires voire mettre à l’arrêt l’installation si elle considère qu’un risque n’est pas maîtrisé correctement, comme c’est le cas pour toute installation nucléaire placée sous son contrôle.
Toutefois, en application du régime de responsabilité civile nucléaire qui s’appliquera à l’exploitation de Cigéo, en cas d’accident nucléaire survenant sur le site de l’Andra, la responsabilité de cette dernière sera mise en cause sans que les victimes n’aient à prouver une faute de l’Andra. Ce régime a notamment pour intérêt de simplifier les recours des victimes qui ne sont pas obligées de multiplier les procédures à l’encontre des autres acteurs intervenant sur le site. Plusieurs tranches de garanties sont prévues : une première à la charge de l'exploitant (qui doit faire l'objet d'une garantie financière, un contrat d'assurance par exemple), une seconde à la charge de l'Etat et enfin une dernière à la charge d'un fonds international.
QUESTION 1007 - Qui se souviendra de l'emplacement des déchets dans 300 ans ?
Posée par Nadine SORET, L'organisme que vous représentez (option) (REIMS), le 15/12/2013
Dans 300 ans ou plus, qui se souviendra que des déchets radioactifs ont été enfouis à tel ou tel endroit ? Quelle est la durée maximale d'étanchéité des colis ? Une fois que les colis auront été fissurés et abîmés par la corrosion, comment empêcher que les particules radioactives se répandent dans le sol et dans les nappes phréatiques ? Est-il acceptable de compromettre ainsi les possibilités de vivre sur terre de nos descendants ?
Réponse du 21/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
A propos de l’impact de Cigéo
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
A propos de la mémoire du site
Malgré la robustesse du stockage même en cas d’oubli, l’Andra conçoit Cigéo avec l’objectif d’en conserver la mémoire et de la transmettre aux générations futures le plus longtemps possible. Des solutions d’archivage de long terme existent pour les centres de stockage de surface exploités par l’Andra et font l’objet de revues périodiques. Le retour d’expérience montre que ces solutions paraissent robustes pour au moins les 500 premières années. Ainsi, pour Cigéo, l’Andra prévoit qu’un centre de la mémoire perdurera sur le site. Il pourra accueillir le public et comprendra notamment les archives du Centre.
De manière générale, le maintien de la mémoire doit aussi impliquer les acteurs locaux, qui peuvent prendre le relai en cas de défaillance de l’Andra ou de l’État. L’Andra veille d’ores et déjà à les informer sur les enjeux associés à la mémoire et étudie avec des anthropologues, des philosophes ou encore des artistes les facteurs qui peuvent favoriser la transmission de la mémoire. La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
L’Andra a lancé en 2010 un programme d’études pour proposer des outils qui rendent cette transmission plus robuste sur une échelle de temps millénaire. Des pistes se dessinent tels des marqueurs de surface, mais aussi des rendez-vous réguliers à mettre en place au niveau des populations locales.
En tout état de cause, comme il est impossible de garantir notre capacité à communiquer avec des êtres vivant dans plusieurs milliers d’années, c’est chaque génération qui aura la responsabilité de contribuer à transmettre cette mémoire aux générations suivantes.
A propos des colis de déchets
Plusieurs modes de conditionnement sont mis en œuvre suivant la nature des déchets (vitrification, cimentation, bitumage). Le conditionnement des déchets consiste à les solidifier et à les immobiliser sous une forme non dispersable et à les placer dans un conteneur qui en facilite la manutention et l’entreposage.
La sureté du stockage profond s’appuie dans un premier temps sur les matériaux utilisés pour conditionner les déchets. Ces matériaux sont choisis pour leur robustesse et leur capacité à limiter ou ralentir le relâchement des radionucléides contenus dans les déchets. Il s’agit par exemple d’acier, utilise pour la fabrication des conteneurs de stockage dans lesquels sont places les déchets les plus radioactifs (déchets HA), qui reste étanche pendant plusieurs centaines d’années. Ces déchets sont également incorpores dans un verre qui se dissout très lentement, retardant ainsi le relâchement des radionucléides qui s’étale sur plusieurs centaines de milliers d’années. Le béton, utilise pour les déchets MA-VL, contribue également à ralentir la migration des radionucléides.
A propos de notre responsabilité vis-à-vis de nos descendants
Comme mentionné plus haut, notre génération se doit de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets afin de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes.
Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de ces déchets. Grâce à la réversibilité, les générations suivantes garderont la possibilité de faire évoluer cette solution. Les rendez-vous proposés par l’Andra seront notamment alimentés par les résultats de la surveillance et par les recherches qui continueront à être menées sur la gestion des déchets radioactifs et les avancées technologiques. A chaque étape, il sera possible de décider de poursuivre le processus de stockage tel qu’initialement prévu ou de le modifier, par exemple si des solutions alternatives sont identifiées.
QUESTION 1006 - au nom de quoi ?
Posée par Laura TOUTLEMONDE, L'organisme que vous représentez (option) (FRANCE), le 15/12/2013
au nom de quoi, allez-vous souiller la Terre à jamais ? que direz-vous à vos petits-enfants ? devant un miroir, osez-vous dire qu'il n'existe aucune autre alternative que le nucléaire pour le bien de l'humanité ? devant un miroir, oserez-vous dire : on ne savait pas ? quel respect avez-vous de vous-même, en tant qu'être humain faisant partie des êtres vivants de cette Terre, pour vous imposer à vous et à ceux que vous aimez (en même temps que tous les autres, bien sûr) cette épée de Damoclès terrible ? Qu'arrive-t-il donc au genre humain pour devenir suicidaire à ce point là ? quelle valeur accordez-vous à la vie ? êtes-vous à l'aise dans le rôle de pourvoyeur de mort ?
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestions sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
D’autres solutions ont été étudiées en France et à l’étranger depuis plus de 50 ans : envoi dans l’espace, au fond des océans, dans le magma, séparation-transmutation… Le stockage est aujourd’hui considéré dans tous les pays comme la meilleure solution pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter leur charge sur les générations suivantes. La directive européenne du 19 juillet 2011 considère ainsi que le stockage géologique constitue actuellement la solution la plus sûre et la plus durable en tant qu’étape finale de la gestion des déchets de haute activité.
QUESTION 1005 - des emplois
Posée par jean LE GORJU, L'organisme que vous représentez (option) (MONTHAULT), le 15/12/2013
Des emplois créés pour des milliers d'années. Et pour simplement surveiller des déchets. Bravo. Mais on ne sait faire que surveiller car en cas de problème, c'est la cata. on ne sait même pas démanteler la petite centrale de Brennilis. Avec l''énergie nucléaire, Areva apprentie sorcière ?
Réponse du 06/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestions sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 1004 - Que deviendrons nos enfantsou les enfants de nos enfants quand toute cette radioactivité remontera ??
Posée par Cécile VIVANT, L'organisme que vous représentez (option) (CHATILLON LA PALUD), le 15/12/2013
Que deviendrons nos enfants ou les enfants de nos enfants quand toute cette radioactivité remontera ??
Réponse du 21/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 1003 - Problèmes géologiques
Posée par Jean-Jacques MARAND, L'organisme que vous représentez (option) (COULANGES LES NEVERS), le 15/12/2013
Quand, dans quelques milliers d’années, un mouvement de terrain ou un tremblement de terre ou un agrandissement de faille se produiront, que se passera t-il ? Si une infiltration d’eau provoque une explosion ou un incendie, quels moyens seront disponibles pour éviter une catastrophe du type de TCHERNOBYL ou FUKUSHIMA ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 1002 - Pourquoi?
Posée par caroline RÉPÉCAUD, L'organisme que vous représentez (option), le 15/12/2013
Pourquoi n'y a t il pas de principe de précaution systématiquement, ceci pour nos enfants? Pourquoi n'y a t il pas de grands débats nationaux et citoyens pour tous ces sujets critiques? Qui sera responsable un jour de tout cela?
Réponse du 06/01/2014,
Vos interrogations ont été largement au cœur du débat public ; des opinions nombreuses et diverses ont été émises, dont le compte rendu du débat rendra compte, notamment dans le chapitre qui sera consacré aux aspects éthiques du projet.
QUESTION 1001 - Pourquoi pas Gorleben?
Posée par Philippe SÉGUIN, L'organisme que vous représentez (option) (NANCY), le 15/12/2013
Pourquoi ne pas envoyer ces déchets à Gorleben, Allemagne? L'Allemagne se dépeuple très rapidement, cette région se videra très vite.
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Dès 1991, le Parlement français a mis en place une politique nationale responsable pour préparer la mise en sécurité sur le territoire national des déchets les plus radioactifs produits en France depuis plus de 50 ans. Cette législation est cohérente avec la directive européenne du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre des combustibles usés et des déchets radioactifs, qui réaffirme la responsabilité de chaque État dans la gestion de ses déchets radioactifs.
QUESTION 1000 - transports dangereux des déchets
Posée par cécile LIEFOOGHE, L'organisme que vous représentez (option) (ST SERNIN DU PLAIN), le 15/12/2013
Le centre d'enfouissement va générer pendant 100 ans des flux routiers et ferroviaires pour rallier Bure. Au vu de l'importance du trafic programmé, la probabilité d'accidents en tous genres sera forcément très élevée. Peut-on imposer à nos descendants d'assumer autant de risques?
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) :
La sûreté des transports de substances radioactives à usage civil est contrôlée en France par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), sur la base d’inspections et de l’instruction de demandes d’agrément d’emballages. Ce contrôle vise à assurer la protection des personnes et de l’environnement. Il porte sur la conception des emballages et les opérations de transports qui sont soumises à des contraintes réglementaires rigoureuses.
Les emballages doivent notamment assurer un confinement des substances radioactives transportées et fortement réduire le rayonnement à l’extérieur du colis.
De façon plus spécifique, le débit de dose à proximité du véhicule ne doit pas dépasser certains plafonds. En pratique, les niveaux relevés sont en général beaucoup plus faibles que ces plafonds. Même si ces plafonds étaient atteints, une personne devrait rester 10 heures à deux mètres du véhicule pour que le rayonnement reçu atteigne la limite annuelle d’exposition du public.
Concernant les risques en cas d’accident, les modèles de colis sont soumis à des épreuves réglementaires destinées à démontrer leur résistance lors du transport. Le niveau d’exigence de ces épreuves est proportionné à la dangerosité des substances transportées. À titre d’exemple, les modèles de colis correspondant aux substances les plus dangereuses doivent conserver leurs fonctions de sûreté, y compris en cas d’accident (simulé par une chute de 9 m sur une surface indéformable, une chute de 1 m sur un poinçon, un incendie d’hydrocarbure totalement enveloppant de 800° C minimum pendant 30 mn, une immersion dans l’eau à une profondeur de 200 m).
Les autorités se sont naturellement interrogées depuis plusieurs années sur le comportement des colis agréés dans des cas d’agressions allant au-delà de ces épreuves réglementaires décrites précédemment.
Des études ont été menées en France et à l’étranger, notamment par l’IRSN, AREVA, l’autorité allemande BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung) et le laboratoire national américain SANDIA, afin d’évaluer le comportement des colis contenant des substances radioactives dans des conditions réalistes d’impact mécanique et de feu et pouvant aller au-delà des sollicitations prévues par les épreuves réglementaires. Ainsi, la tenue de ces types de colis dans des conditions de feu plus contraignantes (en termes de durée et de température) et dans des conditions de chute plus contraignants (en matière de surface d’impact et de hauteur de chute) a été étudiée. Par exemple, une étude de l’IRSN consultable sur le site Internet de l’institut permet de comparer l’écrasement du colis sur une surface indéformable, comme prévu dans les épreuves réglementaires et sur des surfaces représentatives de cibles réelles : par exemple des sols en sable, argile ou des cibles métalliques représentatives de l’environnement des emballages durant le transport dont l’essieu de wagon et le longeron de wagon. Cette étude a montré que les colis considérés dans l’étude conserveraient leur capacité de confinement en cas d’accident réel et que leurs équipements additionnels (châssis et râtelier) ainsi que les cibles absorberaient une part importante de l’énergie d’impact et augmenteraient ainsi les marges de sûreté.
En France, aucun accident ferroviaire ayant impliqué des colis de combustible usé n’a à ce jour été relevé. Néanmoins, cette éventualité est envisagée par les pouvoirs publics.
Ainsi, la dernière ligne de défense de la sûreté des transports de substances radioactives repose sur les moyens d’intervention mis en œuvre face à un incident ou un accident. Les pouvoirs publics, l’ASN et les exploitants se préparent donc à la gestion des situations de crise impliquant un transport de substances radioactives à travers les plans ORSEC et au moyen d’exercices.
Réponse apportée par AREVA :
Les déchets radioactifs HA/MA-VL sont transportés dans des « emballages » de haute technologie et agréés par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN). Le retour d’expérience de plusieurs dizaines d’années confirme le haut niveau de sûreté mis en œuvre : aucun accident ayant eu des conséquences radiologiques n’est à déplorer. La résistance des emballages est testée en conditions extrêmes. En effet, pour les opérations de transport, la sûreté nucléaire repose d’abord sur l’emballage. Les emballages utilisés sont conçus pour assurer la protection des personnes et de l’environnement en toutes circonstances, tant dans des conditions normales que dans des situations accidentelles.
Les emballages destinés aux transports des déchets radioactifs de type HA/MA-VL sont conçus pour être étanches et le rester même en cas d’accident (collision, incendie, immersion…). Leur étanchéité maintenue même en situation extrême permet de prévenir le risque de contamination. Par ailleurs, ces emballages sont composés de plusieurs types de matériaux permettant de réduire les niveaux d’exposition aux rayonnements pour les rendre inferieurs aux limites fixées par la réglementation. Celle-ci établit que la quantité de rayonnements reçus par une personne qui resterait à 2 m du véhicule pendant une heure n’excède pas la limite de 0,1 mSv quel que soit le type de déchets transporté. A titre de comparaison, l’exposition moyenne annuelle de la population française à la radioactivité naturelle est de 2,4 mSv.
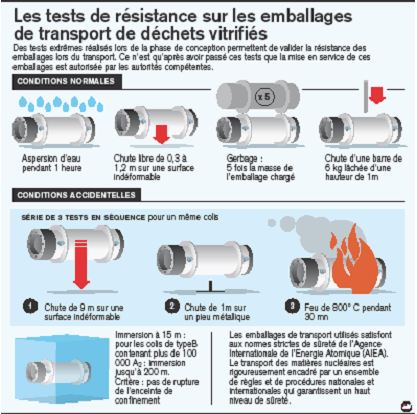
Les transports sont réalisés dans le cadre des réglementations internationales (AIEA, ADR, RID…) et nationales en vigueur. Ces réglementations sont établies en fonction de la nature de la matière transportée et du mode de transport utilisé. En France, l’ASN est responsable du contrôle de la sûreté des transports de substances radioactives pour les usages civils.
Le transport de substances radioactives est assuré par des sociétés spécialisées et autorisées par les autorités compétentes.
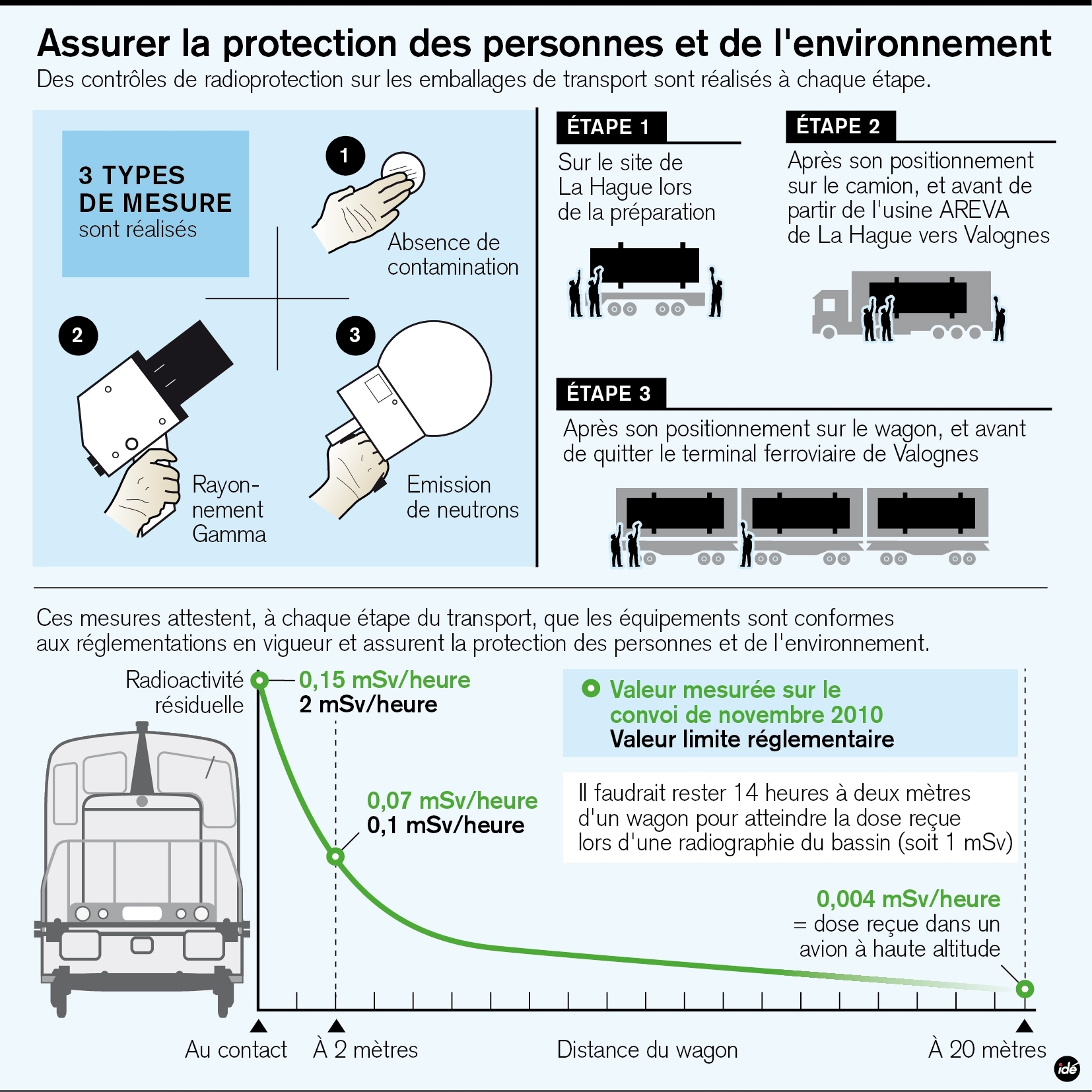
Le niveau de rayonnement et la non-contamination des emballages sont vérifiés par les exploitants et des organismes indépendants à chaque étape du transport, y compris lors de changements de modes de transport. Ces mesures attestent, à chaque étape du transport (cf. figure ci-contre), que les équipements sont conformes aux réglementations en vigueur et assurent la protection des personnes et de l’environnement. Elles peuvent être vérifiées à tout moment et sur le terrain par l’ASN. Le transport en toute sûreté de plus 6000 colis de déchets de Haute Activité et Moyenne activité à vie Longue, principalement par le rail illustre la maîtrise des risques de contamination et d’exposition aux rayonnements.
En complément de ce dispositif de prévention éprouvé, la France a mis en place un dispositif national pour gérer de potentiels accidents. Les autorités s’appuient sur les dispositifs mis en place dans le cadre des plans ORSEC et à leur déclinaison départementale. Les Préfectures sont averties par le Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle de Crises (COGIC) des transports transitant par leur département ; ce dernier assure, entre autres missions, sous l’autorité du Ministère de l’Intérieur, des responsabilités opérationnelles dans le domaine de la gestion et du suivi des transports. AREVA au travers de sa filiale AREVA TN dispose, par ailleurs, d’un plan d’urgence interne spécifique appelé PUI-T. Celui-ci couvre les phases d’alerte, d’analyse de la situation et d’intervention sur le terrain suite à un incident ou un accident de transport de matières radioactives. Il permet à AREVA TN de mettre à la disposition des autorités compétentes des moyens humains spécialisés et des matériels spécifiques. L’ensemble de ce dispositif est testé, en moyenne, chaque année à l’échelon national avec les principaux acteurs et notamment les autorités compétentes.
Les schémas de transport envisagés pour Cigéo sont assez proches de ceux mis en œuvre avec succès depuis plus de 30 ans. En effet, le réseau ferré national est actuellement utilisé pour l’acheminement des emballages de combustibles usés depuis les centrales du parc EDF, jusqu’au terminal ferroviaire de Valognes, situé à 40 km de l’usine de la Hague, puis par la route ; les emballages y sont alors transférés sur des camions pour transport jusqu’au site. Ce flux correspond à environ 200 transports de combustible usé par an. Par ailleurs les déchets HA, MAVL issus du traitement des combustibles usés étrangers transitent également par le terminal ferroviaire de Valognes avant d’être retournés vers leur pays d’origine.
Ce sont ainsi de l’ordre de 800 emballages transférés chaque année au terminal ferroviaire de Valognes correspondant à environ 1 train/par semaine.
QUESTION 999 - signalisation du danger.
Posée par mikael MARCHALAND, L'organisme que vous représentez (option) (LOPERHET), le 15/12/2013
Comment signaler de façon sûre la dangerosité des déchets aux générations futures et ce durant des milliers d'années?
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
L’objectif fondamental de Cigéo est de protéger l’homme et l’environnement des déchets radioactifs sur de très longues échelles de temps. La sûreté à long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. C’est une des raisons qui a conduit, en 2006, le Parlement à retenir la solution du stockage profond. En effet, cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli, contrairement à l’entreposage. En cas de perte complète de la mémoire du stockage, une intrusion inopinée à 500 mètres sous terre apparaît peu plausible, du moins sans un minimum d’investigations préalables. L’Andra évalue cependant par précaution dans son analyse de sûreté les conséquences d’un forage à travers le stockage pour vérifier que le stockage resterait sûr.
Malgré cette robustesse du stockage même en cas d’oubli, l’Andra conçoit Cigéo avec l’objectif d’en conserver la mémoire et de la transmettre aux générations futures le plus longtemps possible. Des solutions d’archivage de long terme existent pour les centres de stockage de surface exploités par l’Andra et font l’objet de revues périodiques. Le retour d’expérience montre que ces solutions paraissent robustes pour au moins les 500 premières années. Ainsi, pour Cigéo, l’Andra prévoit qu’un centre de la mémoire perdurera sur le site. Il pourra accueillir le public et comprendra notamment les archives du Centre. De manière générale, le maintien de la mémoire doit aussi impliquer les acteurs locaux, qui peuvent prendre le relai en cas de défaillance de l’Andra ou de l’État. L’Andra veille d’ores et déjà à les informer sur les enjeux associés à la mémoire et étudie avec des anthropologues, des philosophes ou encore des artistes les facteurs qui peuvent favoriser la transmission de la mémoire. La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
En tout état de cause, comme il est impossible de garantir notre capacité à communiquer avec des êtres vivant dans plusieurs milliers d’années, c’est chaque génération qui aura la responsabilité de contribuer à transmettre cette mémoire aux générations suivantes.
QUESTION 998 - comment Comment les responsables du projet Cigéo peuvent-ils parier sur les toutes petites probabilités ?
Posée par Christine ELLISON-MASSOT, L'organisme que vous représentez (option) (VARENGEVILLE -SUR-MER), le 15/12/2013
Comment les responsables du Projet Cigéo peuvent-ils parier sur les très faibles probabilités d'accident ou de fuite alors que la survie des employés et des populations locales ,voire plus, dépend de la non-occurence de tels évènements ?(cf: Nassim Nicholas Taleb ,spécialiste en épistémologie ,statistique et psychologie des risques /CNRS ), L'homme "animal doué de raison ",n'apprendrait-il rien de ses erreurs passées ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 997 - Independance des expert francais
Posée par Franz BOTENS, MONTAGSSPAZIERGANG MAINZ ( MAINZ), le 15/12/2013
Est ce que en France il existe des experts nucléaires indépendantes? Ne sont pas tous les salariés de l'industrie nucléaire française? Comme par exemple le professeur Bernd Grambow.
Réponse du 28/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les recherches menées par l’Andra font appel à une large communauté scientifique (10 organismes et établissements universitaires partenaires, 70 laboratoires académiques, participation à 12 programmes de recherche européens depuis 2006…). L’ensemble de ces travaux font l’objet de publications dans des revues à comités de lecture (50 à 70 publications scientifiques internationales par an depuis 10 ans) et sont évalués par des instances indépendantes, en particulier la Commission nationale d’évaluation, mise en place par le Parlement, et l’Autorité de sûreté nucléaire qui s’appuie sur l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Les grands dossiers scientifiques et techniques que l’Andra remet dans le cadre de la loi font l’objet, à la demande de l’Etat, de revues internationales sous l’égide de l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’OCDE. Des expertises sont régulièrement commandées par le Comité local d’information et de suivi du Laboratoire souterrain sur les grands dossiers de l’Andra ou sur des sujets plus ciblés.
Enfin, l’Andra a été évaluée en 2012 par l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) qui, dans son rapport d’évaluation a considéré que « l’Andra est probablement l’un des établissements les plus évalués de France y compris et surtout dans son activité de recherche. »
QUESTION 996 - Guerre d'usure
Posée par Jean-François ANDRIOT, L'organisme que vous représentez (option) (CHAUMONT), le 15/12/2013
Quand on reçoit une personne inquiète, apeurée ou dépressive que l'on veut aider il convient tout d'abord de l'écouter, d'accorder une grande attention à ses paroles, de l'aider à s'exprimer et de faire en sorte quelle ressente la grande qualité d'écoute et de compréhension dont on fait preuve aussi longtemps que nécessaire pour tarir le flot de paroles et renverser les rôles. La personne finissant par se taire devient réceptive aux arguments "aidants" que l'on aura fort judicieusement choisi en fonction de ce qu'on vient d'entendre. C'est le B, A, BA. Avec ce soit disant débat où vous prétendez être à l'écoute, ne recherchez vous pas tout simplement l'usure, l'épanchement final avant d'asséner vos arguments où, plus exactement d'asséner la mise en route définitive de votre projet ?
Réponse du 06/01/2014,
Réponse apportée par la CPDP :
Le « soit disant débat » a permis de recueillir sur Cigéo plus de 1.430 questions, 480 avis, 150 cahiers d’acteur et 23 contributions. Toutes les personnes qui ont souhaité s’exprimer l’ont pu, aucune restriction ni censure n’a été apportée ; la grande diversité des opinions ainsi recueillies peut se constater sur le site de la Cpdp, puisque toutes ont été (ou vont l’être prochainement pour les dernières reçues) publiées.
L’organisation du débat public n’a pas été une question d’opportunité qui entrerait dans le cadre d’une guerre d’usure conduite par le maître d’ouvrage (l’ANDRA) : il était prévu par l’article 12 la loi du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, qui précisait qu’il devait précéder le dépôt de la demande d’autorisation de création du centre de stockage.
La phase qui se termine n’épuise d’ailleurs pas les procédures de consultation du public, puisque :
- Le maître d'ouvrage (l’ANDRA) doit décider dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public, du principe et des conditions de la poursuite de son projet. Il doit préciser, le cas échéant, les principales modifications apportées au projet. La décision de l’ANDRA sera transmise à la CNDP et publiée.
- Une concertation postérieure au débat public est prévue dans le code de l’environnement à l’article L.121-131 : « Le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable du projet informe la commission nationale du débat public, pendant la phase postérieure au débat public jusqu’à l’enquête publique, des modalités d’information et de participation du public mises en œuvre ainsi que de sa contribution à l’amélioration du projet. La commission peut émettre des avis et recommandations sur ces modalités et leur mise en œuvre. Le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable du projet peut demander à la commission de désigner un garant chargé de veiller à la mise en œuvre des modalités d’information et de participation du public.».
- Il y aura, comme indiqué ci-dessus, tout à fait en fin de parcours, une enquête publique.
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra à l’État et non à l’Andra, après un processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande d’autorisation de création du stockage. Ce processus comprendra notamment l’évaluation de la sûreté par l’Autorité de sûreté nucléaire, l’évaluation des recherches scientifiques par la Commission nationale d’évaluation, l’avis des collectivités territoriales, le vote d’une loi fixant les conditions de réversibilité et une enquête publique.
Même si les réunions publiques ont été empêchées, les très nombreuses contributions pendant le débat public (questions, cahiers d’acteurs, interventions dans les médias…) montrent l’implication de nos concitoyens sur les enjeux liés à la gestion des déchets radioactifs et donnent à l’Andra des orientations pour la suite du projet. L’Andra se prononcera d’ici mi-mai sur l’ensemble des suites à donner au débat public après la publication du compte-rendu du débat de la Commission particulière du débat public et du bilan de la Commission nationale du débat public, prévue mi-février.
La concertation se poursuivra pendant toute la durée du projet. Si Cigéo est autorisé, l’Andra propose que des rendez-vous réguliers soient programmés avec l’ensemble des acteurs (riverains, collectivités, associations, scientifiques, évaluateurs, État…) pour contrôler le déroulement du stockage et pour préparer chaque décision importante concernant les étapes suivantes.
QUESTION 995 - Subventions
Posée par Michele BRISSON, L'organisme que vous représentez (option) (LONGEAUX), le 15/12/2013
Quand des dizaines d'entreprises meusiennes/haut-marnaises reçoivent des subventions pour financer l'achat de matériels, ne sont-elles par hors la loi lorsqu'elles répondent aux appel d'offres qui eux sont parfaitement réglementés. N'y a t'il pas concurrence déloyale? Ne s'agit-il pas d'une forme de collusion? Comment l'Andra peut-elle accepter un tel comportement qui s'apparenterait à un achat des consciences?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 994 - Possibilités d'intervention en cas de fuites radioactives
Posée par Gérard SIMON, L'organisme que vous représentez (option) (MEYNES), le 15/12/2013
Si dans 100 ans, 1000 ans ou plus, des fuites étaient détectées, quelles seraient les possibilités d'intervention ?
Réponse du 21/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 993 - Qui sera responsable ?
Posée par Fab DEL, L'organisme que vous représentez (option) (ALBERT), le 15/12/2013
Comment pouvez-vous garantir la fiabilité d'une telle installation pour les prochains millénaires? Et sa sécurité? Qui sera chargé de son entretien? signé: FD citoyen vigilant
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 992 - Normalisation de la déviance
Posée par Bernard GONDOUIN, L'organisme que vous représentez (option) (BALLANCOURT), le 15/12/2013
Diane Vaughan, dans un excellent livre consacré à l’accident du lanceur spatial Challenger en janvier 1986 – The Challenger Launch Decicion – écrivait : « Mon analyse a montré que, pendant les années qui ont précédé l'accident, les ingénieurs et managers de la NASA ont progressivement instauré une situation qui les autorisait à considérer que tout allait bien, alors qu'ils disposaient d'éléments montrant au contraire que quelque chose allait mal. C'est ce que j'ai appelé une NORMALISATION DE LA DEVIANCE : il s'agit d'un processus par lequel des individus sont amenés au sein d'une organisation à accomplir certaines choses qu'ils ne feraient pas dans un autre contexte. Mais leurs actions ne sont pas délibérément déviantes. Elles sont au contraire rendues normales et acceptables par la culture de l'organisation. Si vous voulez vraiment comprendre comment une erreur est générée au sein d'un système complexe et résoudre le problème, il ne faut pas se contenter d'analyser la situation au niveau individuel, c'est l'organisation dans son ensemble qu'il faut considérer et, au-delà de l'organisation elle-même, son contexte politique et économique. On a vu dans le cas de Challenger que les conclusions auxquelles on aboutit alors sont bien différentes de celles délivrées par une analyse des actions individuelles. » Comment les responsables scientifiques de l’ANDRA et de tous les organismes porteurs du projet d’enfouissement de Bure se sont ils prémunis de cette « normalisation de la déviance » ? Quelles vérités détiennent-ils que les autres interlocuteurs n’ont pas à leur disposition ? Et comment pourront ils expliquer aux milliers de générations futures qui devront assumer la gestions de ces déchets que leurs vérités valaient pour une "petite" éternité ?
Réponse du 06/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le Parlement a créé l’Andra en 1991 pour assurer la gestion à long terme des déchets radioactifs. Agence publique chargée de cette seule mission, indépendante des producteurs de déchets, ses projets ne sont pas dictés par un impératif de production mais par le seul souci de protéger de la manière la plus robuste possible l’environnement et les générations futures.
Tous les moyens techniques, organisationnels, humains et financiers nécessaires à la sûreté sont mis en œuvre, aussi bien pour la conception des projets que pour leur mise en œuvre. Au sein de l’Andra, la culture de sûreté est l’affaire de tous. Cette culture s’appuie sur le professionnalisme et la compétence des équipes en interne. La prise en compte du retour d’expérience fait aussi partie de notre culture et l’expérience acquise pendant toutes les phases de vie des installations est analysée et capitalisée.
De plus, l’Andra ne travaille pas seule. Les études et recherches menées par l’Andra sont évaluées par des instances indépendantes, en particulier la Commission nationale d’évaluation, mise en place par le Parlement, et l’Autorité de sûreté nucléaire qui s’appuie sur l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et le groupe permanent d’expert sur les déchets. Pendant tout le déroulement du projet, ces autorités analysent avec un œil extérieur les travaux menés par l’Andra et émettent des avis. L’Andra rend compte de la mise en œuvre de leurs recommandations. Si Cigéo est autorisé, l’ASN effectuera des inspections portant sur les conditions de construction et d’exploitation de l’installation. Lors de ces inspections, l’ASN examinera aussi l’organisation mise en place par l’Andra pour garantir la sûreté à toutes les étapes de développement du stockage, la prise en compte des facteurs humains et organisationnels ainsi que la culture de sûreté de l’exploitant. Tout au long de l’exploitation du stockage, l’ASN pourra imposer des prescriptions supplémentaires voire mettre à l’arrêt l’installation si elle considère qu’un risque n’est pas maîtrisé correctement, comme c’est le cas pour toute installation nucléaire placée sous son contrôle.
Tous ces éléments sont des gages de la robustesse de la démarche qui est mise en œuvre pour garantir la sûreté du projet.
QUESTION 990 - pérennité et réversibilité
Posée par Hermine HUOT, L'ORGANISME QUE VOUS REPRÉSENTEZ (OPTION) (NANCY), le 15/12/2013
Comment peut-on s'assurer de la surveillance et de la gestion d'un tel site de stockage à l'échelle de temps que nécessite la décroissance radioactive des déchets entreposés ? Comment peut-on s'assurer de la réversibilité d'un tel site ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 989 - Responsabilité et lucidité
Posée par Jean-Pierre LAFFORT, L'organisme que vous représentez (option) (TOULON), le 15/12/2013
Il n'y a pas d'exemple où une technologie n'ait pas été la cause ou l'objet d'un accident. Avec le nucléaire, la différence est que les accidents qui ont eu lieu ont eu des conséquences humaines, économiques et planétaires beaucoup plus lourdes que les accidents de technologies antérieures. Dans ces conditions comment continuer dans cette voie irresponsable si l'on reste lucide et honnête?
Réponse du 31/01/2014,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
En France, les dispositions relatives à la sécurité nucléaire sont définies par la loi du 13 juin 2006. Cette loi a instauré une autorité de sûreté nucléaire indépendante et renforcé le droit à l’information sur les installations nucléaires. L’accident survenu à Fukushima en mars 2011 a remis en lumière la nécessité d’une exigence absolue en matière de sûreté nucléaire et de transparence.
Le Président de la République a décidé d’engager la transition énergétique, cette transition reposant d'une part sur la sobriété et l’efficacité énergétique, et d'autre part sur la diversification des sources de production et d'approvisionnement.
Concernant la diversification de nos sources d’énergies, le Président de la République a fixé un cap : réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% d'ici 2025. Parallèlement, le Président de la République a indiqué que la transition énergétique serait fondée sur deux principes : l'efficacité énergétique d'une part, et la priorité donnée aux énergies renouvelables d'autre part. Cette mutation prendra du temps et supposera des étapes d’évaluation en fonction des progrès technologiques et scientifiques et des prix relatifs de chaque source d’énergie.
Les risques nucléaires sont couverts par un régime spécifique de responsabilité civile nucléaire régie en France par les conventions de Paris et de Bruxelles. Celles-ci définissent notamment les dommages rattachés à ces risques, l'indemnisation des victimes et les niveaux de garanties requis. Plusieurs tranches de garanties sont prévues : une première à la charge de l'exploitant (qui doit faire l'objet d'une garantie financière, un contrat d'assurance par exemple), une seconde à la charge de l'Etat et enfin une dernière à la charge d'un fonds international.
QUESTION 988 - acheminement et stockage
Posée par Hermine HUOT, L'organisme que vous représentez (option) (NANCY), le 15/12/2013
Est-ce que le fait d'acheminer ces déchets dangereux et de les stocker tous ensemble dans un espace limité ne va engendrer des risques supplémentaires ?
Réponse du 10/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L'entreposage actuel des déchets sur leurs sites de production est une solution provisoire qui ne peut être pérennisée. En effet, elle nécessite l’intervention régulière de l’homme pour contrôler, maintenir et reconstruire les installations, ce qui ne peut être garanti sur le long terme. En cas de perte de contrôle de telles installations, les conséquences radiologiques sur l’homme et l’environnement ne seraient pas acceptables.
Le stockage à 500 mètres de profondeur dans une couche géologique assurant le confinement à l’échelle de plusieurs centaines de milliers d’années permet de protéger l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue et de ne pas reporter indéfiniment la charge de leur gestion sur les générations futures. Ce type de stockage doit être implanté dans un milieu géologique favorable (stabilité géologique, très faible sismicité…) et une couche de roche dont les propriétés permettent le confinement des déchets sur de très longues échelles de temps (profondeur et épaisseur suffisante, stabilité, faible perméabilité, propriétés de rétention…). C’est pour cela que le site choisi en Meuse/Haute-Marne est étudié pour l’implantation de Cigéo.
L’inventaire des déchets destinés à Cigéo est présenté au chapitre 1 du dossier du maître d’ouvrage. La sûreté du stockage de ces déchets sur le site étudié en Meuse/Haute-Marne a été démontrée par les études qui ont été menées par l’Andra ainsi que par les évaluations indépendantes qui en ont été faites. L’impact du stockage restera très largement inférieur à l’impact de la radioactivité naturelle (impact de l’ordre de 0,01 milliSievert/an, à comparer avec l’impact de la radioactivité naturelle de 2,4 mSv/an en moyenne en France).
Les risques potentiels liés à l’activité industrielle sont examinés (incendie, chute de colis, désordres mécaniques induits par un séisme…). L’Andra prend systématiquement des mesures pour supprimer les risques ou réduire leur probabilité, détecter tout dysfonctionnement et maîtriser leur impact dans l’hypothèse où des situations accidentelles interviendraient malgré les précautions prises. Après la fermeture du stockage, la sûreté sera assurée de manière passive grâce au milieu géologique. L’évolution à long terme du stockage et de l’environnement sont analysés de manière détaillée. Des situations altérées (forage intrusif, défaut de construction d’un ouvrage du stockage, séisme...) sont prises en compte dans l’évaluation de sûreté.
QUESTION 987 - coût
Posée par Hermine HUOT, L'organisme que vous représentez (option) (NANCY), le 15/12/2013
A-t-on les moyens financiers nécessaires à la construction, à l'acheminement des déchets et à la gestion à long terme d'un tel site de stockage ?
Réponse du 06/02/2014,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Le financement de la gestion des matières et déchets radioactifs est assuré, sous le contrôle de l’État, par les exploitants nucléaires, selon le principe « pollueur-payeur ». Le projet Cigéo est donc entièrement financé par les exploitants nucléaires producteurs de déchets : EDF, Areva, CEA. Cela comprend donc les coûts des recherches, des études, de la construction, de l’exploitation, des transports, de la surveillance et de la fermeture.
Un dispositif de sécurisation du financement des charges nucléaires de long terme, est institué dans la loi du 28 juin 2006 codifiée au code de l'environnement. Il prévoit la constitution d'un portefeuille d'actifs dédiés par les exploitants nucléaires au cours de l'exploitation. Pour cela, les exploitants sont tenus d'évaluer l’ensemble de leurs charges de long terme parmi lesquelles figurent les charges liées au projet Cigéo. Ils doivent assurer dès à présent, la couverture de ces charges à venir par la constitution d'actifs dédiés qui doivent présenter un haut niveau de sécurité.
Ces opérations sont étroitement contrôlées par l’État. Pour exercer son contrôle, l'autorité administrative reçoit notamment des exploitants un rapport triennal sur l'évaluation des charges de long terme, les méthodes et les choix retenus pour la gestion des actifs dédiés, ainsi qu'un inventaire trimestriel des actifs dédiés. De plus, une Commission extraparlementaire (la CNEF) évalue le contrôle effectué par l'autorité administrative et remet un rapport triennal sur ses évaluations au Parlement, ainsi qu'au Haut Comité pour la Transparence et l'Information sur la Sécurité Nucléaire (HCTISN).
QUESTION 986 - Certitudes et doutes
Posée par Michel VAN DER MEERSCH, L'organisme que vous représentez (option) (MONTELEGER), le 15/12/2013
Mesdames, Messieurs, Quand je comprend que le projet prévoit d'enfouir des produits qui vont rester radioactifs et potentiellement dangereux pour certains, pour des dizaines de siècles, et que j'examine les risques, j'ai le vertige. J'aime mes enfants, on se chauffe à l'électricité, on n'a pas eu pas eu le choix, on ne nous a jamais demandé notre avis. Mais aujourd'hui on veut poser la question de ce choix irréversible. Que penseront de nous nos arrières-arrières-arrières... petits-enfants? Comme le risque zéro n'existe pas, qu'est-il prévu pour limiter les dégâts, réparer, indemniser les victimes de nos paris technologiques? Des garanties de surveillance, de sécurité, de contrôle et de secours ont-elles été prévues pour plusieurs siècles ou laisse-t-on cyniquement ce cadeau empoisonné? Avez-vous prévu le terrorisme, Carlos, le fanatisme, un dictateur, Kim Jong Un,un fou, G.W.Bush,un changement climatique, Hitler, une modification géologique, Staline, une fracturation hydraulique, Saddam Hussein, une éruption volcanique, Khadaffi... Merci de vos réponses sans langue de poids.
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, tous les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation doivent être identifiés par l’Andra en amont de la conception. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
QUESTION 985 - Risques technologiques
Posée par Tonny MONARI, L'organisme que vous représentez (option) (NOMPATELIZE), le 15/12/2013
La concomitance envisagée des travaux de construction et de l'exploitation du projet d'enfouissement à partir de 2015 implique de nombreux risques technologiques qui apparemment n'ont pas encore été étudiés. Pendant 100 ans des travaux miniers pourraient être effectués à proximité de galeries dans lesquelles des déchets hautement radioactifs seraient entreposés, et cela à des centaines de mètres sous terre. La chaleur émise par les premiers déchets aura quel effet sur la poursuite des travaux d'enfouissement ?
Réponse du 27/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Si Cigéo est autorisé, les activités de chantier et les activités nucléaires seront séparées sur les installations du Centre, et seront donc exploitées comme deux entités indépendantes. Pour cela :
- dans l’installation souterraine, la zone d’exploitation et la zone chantier seront physiquement séparées,
- l’accès aux différentes zones se fera par des accès distincts : par la descenderie pour la zone en exploitation, par les puits verticaux pour la zone chantier,
- chaque zone aura un circuit de ventilation dédié.
La chaleur émise par les déchets de haute-activité (HA) n’aura pas d’effet sur la poursuite des travaux d’enfouissement.
Dans les zones de stockage, la chaleur dégagée par les déchets de haute activité s’évacuera majoritairement dans la roche.

QUESTION 984 - réversible ?????????
Posée par Maëlle PETITEAU, L'organisme que vous représentez (option) (ANGERS), le 15/12/2013
quand et comment cela, ce centre de stockage sera-t-il "réversible" ??!????
Réponse du 31/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
Le Parlement a demandé que le stockage soit réversible pendant au moins 100 ans afin de laisser aux générations suivantes la possibilité de faire évoluer le stockage si elles le souhaitent. En réponse à cette demande, l’Andra propose des conditions de réversibilité, durant le siècle d’exploitation, qui ne compromettent pas la sûreté du stockage et qui sont réalisables sur le plan technique. Ces propositions concernent à la fois la technique et le pilotage du stockage.
Pouvoir récupérer les colis de déchets après leur stockage :
De nombreuses dispositions techniques sont mises en œuvre pour faciliter une opération éventuelle de retrait de colis du stockage. Ces dispositions prennent en compte le retour d’expérience d’autres installations, en France et à l’étranger. Les colis utilisés pour le stockage des déchets, en béton ou en acier, sont indéformables. Des espaces suffisants sont ménagés entre les colis pour permettre leur retrait. Les tunnels de stockage (alvéoles de stockage) ont un revêtement en béton ou en acier pour éviter les déformations. L’exploitant disposera d’une connaissance précise de l’emplacement de chaque colis et de ses conditions de stockage. Des essais de retrait de colis ont d’ores et déjà été réalisés à l’échelle 1. Des nouveaux tests de retrait seront réalisés dans le stockage avant que la mise en service de Cigéo ne puisse être autorisée, puis pendant toute l’exploitation de Cigéo.
Un calendrier de fermeture progressif et révisable dans le temps :
Pour assurer la mise en sécurité définitive des déchets radioactifs, le stockage devra être fermé. La conception de Cigéo offre la possibilité d’une fermeture progressive des alvéoles de stockage, des galeries souterraines puis des puits et des descenderies. Chaque étape de fermeture rendra plus complexe le retrait de colis (nécessité de rouvrir l’alvéole et de réinstaller les équipements de manutention) mais permettra d’ajouter des dispositifs de sûreté passive. Compte tenu de leur importance, l’Andra propose que le franchissement de ces étapes fasse l’objet d’une autorisation spécifique. Le Parlement a d’ores et déjà décidé que seule une loi pourrait autoriser la fermeture définitive du stockage.
Des rendez-vous réguliers avec l’ensemble des acteurs pour décider ensemble :
L’Andra propose que des rendez-vous soient programmés régulièrement avec l’ensemble des acteurs (riverains, collectivités, évaluateurs, État…) pour contrôler le déroulement du stockage et préparer les étapes suivantes. Ces rendez-vous seront alimentés par les résultats des réexamens périodiques de sûreté, fixés au moins tous les 10 ans par l’Autorité de sûreté nucléaire, de la surveillance du stockage et par les progrès scientifiques et technologiques. Le premier de ces rendez-vous pourrait avoir lieu cinq ans après le démarrage du centre.
Les conditions de réversibilité constituent l’un des sujets majeurs discutés dans le cadre du débat public. Les échanges alimenteront la préparation de la future loi qui fixera les conditions de réversibilité du stockage. Cette loi sera votée avant que la création de Cigéo ne puisse être décidée.
Pour en savoir plus sur les propositions faites par l’Andra en matière de réversibilité du stockage, voir ../docs/rapport-etude/fiche-reversibilite-cigeo.pdf
QUESTION 983 - Peut-on considérer ce projet comme moral?
Posée par Agathe BASTID, L'organisme que vous représentez (option) (BAGNOLET), le 15/12/2013
Les conséquences du projet pour l'avenir à moyen et long terme seront fatales aux générations prochaines. Peut-on laisser un tel héritage à nos descendants?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 982 - radioactivité accidentelle: qui sera responsable?
Posée par Bernard GUILLOUX, CITOYEN FRANÇAIS (RENNES), le 15/12/2013
Dans quelques centaines d'années quels sont les risques en cas de perte de confinement ?. En cas de problème, pourquoi une solution technique n'est elle pas envisageable afin de récupérer ce qui aura été stocké ? Une industrie qui génère et stocke des déchets aussi nocifs pour des milliers d'années est ce raisonnable ?
Réponse du 28/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées. Ainsi en situation dégradée (intrusion humaine, défaut d’un composant du stockage…), les études montrent que l’impact du stockage resterait inférieur à 0,25 millisievert.
Enfin, la sûreté de l’installation doit être acquise indépendamment de la réversibilité. Si un accident devait survenir, l’installation sera mise en sécurité par la pose rapide d’équipements provisoires (ventilation, barrière de confinement…) et non par une opération de retrait de colis. Une fois la mise en sécurité réalisée, l’exploitant examinera les dispositions à mettre en œuvre pour reprendre l’exploitation normale en tout sûreté. Le maintien en stockage de colis, même endommagés, ou leur retrait éventuel pourra être décidé sans caractère d’urgence. S’il était décidé de retirer un grand nombre de colis du stockage, des installations spécifiques seraient alors à construire en surface pour les gérer (pour leur entreposage, leur réexpédition, leur traitement…). Toute opération notable de retrait de colis de déchets devra faire l’objet d’une autorisation spécifique.
Pour plus d’informations sur les propositions de l’Andra en matière de réversibilité : http://www.cigéo.com/images/cigeo/site/pdf/499.pdf
QUESTION 981 - combien de temps ?
Posée par Michèle BAUDOIN, ASSOCIATION LES COLOCATERRE (IRODOUËR), le 15/12/2013
J'aimerais savoir combien de temps il s'écoulera avant que les fûts radioactifs ne soient tellement dégradés qu'ils laissent échapper leur radioactivité. Pensez-vous que lorsque cela se produira, l'Humanité aura disparu de cette planète ?
Réponse du 21/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La dégradation des colis dans le stockage est bien prise en compte dans l’évolution du stockage. Il en ressort que seuls quelques radionucléides mobiles et dont la durée de vie est longue pourront migrer jusqu’aux limites de la couche d’argile qu’ils atteindront après plusieurs dizaines de milliers d’années, puis potentiellement atteindre en quantités extrêmement faibles ensuite la surface et les nappes phréatiques, après plus de 100 000 ans. Leur impact radiologique serait alors plusieurs dizaines de fois inférieur à la radioactivité naturelle (qui est de 2,4 mSv par an en moyenne en France).
QUESTION 980 - Responsabilité/éthique
Posée par Michèle COSTE, L'organisme que vous représentez (option) (FRANCE ), le 15/12/2013
Pour un projet aussi dangereux pour les générations futures, pour une question aussi grave, pourquoi l'Assemblée nationale n'est-elle pas jugée compétente ? Quelques députés et quelques sénateurs en commission ne représentent pas la France entière.
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Le projet Cigéo suit la procédure décrite à l’article L. 542-10 du Code de l’Environnement.
Plusieurs procédures de consultation sont organisées afin de recueillir l’avis des populations locales et nationales (débat public, avis des collectivités territoriales, enquête publique).
Le Parlement fixe périodiquement les choix relatifs à la mise en œuvre de ce projet :
- loi du 30 décembre 1991, dite loi « Bataille », fixant un programme d’études et recherches de 15 années d’études et recherches sur les déchets radioactifs ;
- loi du 28 juin 2006, définissant le stockage géologique profond comme solution de référence pour les déchets les plus radioactifs et demandant sa mise en service en 2025 ;
- loi à venir sur la réversibilité du projet.
La décision d’autoriser ou non la création de Cigéo en Meuse/Haute-Marne n’est pas encore prise. Elle reviendra à l’Etat après l’évaluation du dossier remis par l’Andra en 2015 par l'Autorité de sûreté nucléaire, la Commission nationale d'évaluation et l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, l’avis des collectivités territoriales, et le vote d’une nouvelle loi fixant les conditions de réversibilité et une enquête publique.
QUESTION 979 - Bure sans eau sera un désert ??
Posée par Tonny MONARI, L'organisme que vous représentez (option) (NOMPATELIZE), le 15/12/2013
Les 275.000 mètres cubes de béton par an à fabriquer demanderont l'apport de quantités énormes d'eau. Est-ce-qu'il y a une étude de faite sur l'effet "désertification" des environs de Bure ? Comment comptez-vous indemniser la population et les agriculteurs des effets d'assèchements des puits fermiers et/ou des sources d'eau?
Réponse du 13/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Pendant la phase initiale du chantier, les besoins sont estimés de l’ordre de 500 m3 par jour (équivalent de la consommation moyenne d’une ville de 3 500 habitants). Une fois le Centre mis en service, les besoins en eau sont estimés de l’ordre de 100 m3 par jour (équivalent de la consommation moyenne de 700 habitants). Cigéo nécessitera la création d’infrastructures spécifiques pour assurer son alimentation en eau, qui font l’objet d’études dans le cadre du schéma interdépartemental de développement du territoire.
QUESTION 978 - Pertinence du débat public
Posée par Philippe RICHÉ, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 15/12/2013
Sur quels critères le débat public peut-il fonder un avis concernant la poursuite du programme Cigéo vu le caractère hautement technique et incertain des risques encourus
Réponse du 06/01/2014,
Tel que défini par les textes qui le régissent, un débat public n’a pas pour objectif d’émettre un avis sur le projet soumis à débat public (en l’occurrence Cigéo); il doit seulement permettre de recueillir tous les arguments, souhaits, interrogations, doutes, etc. émanant du public sur le projet en question, qui fourniront la matière du compte rendu établi in fine par la Cpdp.
QUESTION 977 - Qui sera le responsable et Quel est le montant des provisions prévues pour dédommager la région de Bure en cas de disfonctionnement
Posée par marie FOUILLOUZE, L'organisme que vous représentez (option) (CROMEY LE HAUT), le 15/12/2013
L'enfouissement de nos déchets HAVL est si périlleux, si couteux, si complexe, qu'il risque de polluer gravement de vastes étendues. Pourquoi les conclusions de la consultation de 2005/2006 qui étaient plutôt favorables à un stockage en subsurface n'ont pas été entendues? Pourquoi ne pas abandonner cette filière comme le font les autres pays, pour se tourner enfin vers des énergies propres et renouvelables, qui, elles ne ruineront pas la France et ne compromettront pas la vie sur terre.
Réponse du 06/01/2014,
Un débat public ne fournit pas de conclusions mais retranscrit les principales opinions exprimées sur le projet ainsi que les arguments échangés. La loi de 2006 au travers de son article 3 a cherché à répondre aux préoccupations exprimées lors du débat public notamment à la demande de poursuite des recherches sur les trois axes que sont : la séparation- transmutation, le stockage réversible en couche géologique profonde et l’entreposage. Un débat sur la transition énergétique vient d’avoir lieu qui doit se traduire en 2014 par le vote d’une loi. Les données relatives à ce débat sont disponibles sur le site du ministère de l’écologie.
QUESTION 976 - Qui assure les risques ?
Posée par Christian BONNET, L'organisme que vous représentez (option) (SORGUES), le 15/12/2013
Qui assure les risques que nos assurances ne veulent pas assurer en cas de préjudice causés accidentellement par la transmutation d'atome ?
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Les risques nucléaires sont couverts par un régime spécifique de responsabilité civile nucléaire régie en France par les conventions de Paris et de Bruxelles. Celles-ci définissent notamment les dommages rattachés à ces risques et les niveaux de garanties requis. A ce jour les assureurs et réassureurs, regroupés au sein d'un pool spécifique, sont en mesure de couvrir la totalité de ces risques.
QUESTION 975 - Où serez-vous ?
Posée par Guillaume HENRY, L'organisme que vous représentez (option) (IFS), le 15/12/2013
Dans 10, 20, 30 années, dans 100, 200, 300 ans, quand une erreur humaine, une intrusion (terroriste ou légaliste) humaine, un accident géologique, une corrosion des conteneurs, amèneront des fuites et donc un retour de radioactivité au sol, dans l'herbe des vaches, dans les champignons, dans l'eau (même non potable) avec les conséquences que l'on connaî déjà à Tchernobyl, Fukushima et autres ? Où serez-vous ? Quelques pieds sous terre ? Mais où seront vos descendants ? Après vous le déluge ?????
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 974 - fiabilité des modèles géologiques
Posée par Gildas CHERBONNIER, L'organisme que vous représentez (option) (ANGERS), le 15/12/2013
Bonjour, Comment peut-on assurer que les couches géologiques d'argile, où seront entreposés les déchets nucléaires, seront stables jusqu'à la fin de durée de vie de ces derniers (environ 2 fois leur demi-vie)? Je pense qu'aujourd'hui, aucun géologue ne peut l'affirmer, sauf ceux peut-être rétribués par l'Andra. Cordialement,
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La couche argileuse du Callovo-Oxfordien, qui pourrait accueillir le stockage Cigéo en Meuse/Haute-Marne, est une couche sédimentaire épaisse (140 à 160 m environ) située à une profondeur d’environ 500 m sur la zone d’intérêt pour l’implantation de Cigéo. Elle s’est formée il y a 160 millions d’années en milieu marin, et est restée dans ce milieu pendant presque 100 millions d’années. Elle appartient à l’ensemble géologique du Bassin Parisien qui repose sur un socle cristallin profondément enfoui, vieux de plus de 500 millions d’années. A grande échelle, le bassin Parisien est considéré comme stable sur le plan géologique, ce qui ne signifie pas qu’il n’a pas été dans le passé et ne puisse pas être affecté dans le futur, par des phénomènes naturels (grands changements climatiques, mouvements tectoniques).
C’est par rapport aux effets de ces phénomènes naturels, susceptibles d’intervenir sur le prochain million d’années, sur sa capacité de confinement que la couche du Callovo-Oxfordien est qualifiée de stable.
Suite aux études menées depuis plus de quinze ans, notamment l’analyse de son passé géologique et l’évaluation de son évolution sur le prochain million d’années, cette couche est considérée comme stable pour les raisons suivantes :
- Les mouvements tectoniques, parfois importants, qu’elle a subis au cours des 160 millions d’années de son histoire n’ont pas créé de failles sur la zone d’intérêt pour le stockage et les processus physico-chimiques qu’ils ont induits ont même conduit au renforcement de ses propriétés par la diminution de sa porosité. Les mouvements tectoniques possibles sur le prochain million d’années, qui resteront limités, ne sont pas susceptibles de créer de nouvelles failles.
- Elle est suffisamment profonde pour ne pas avoir été ni être atteinte dans le futur par les processus liés à l’évolution climatique (gel lors des périodes glaciaires, érosion des formations superficielles).
QUESTION 973 - Fiabilité des études de l'Andra
Posée par Gildas CHERBONNIER, L'organisme que vous représentez (option) (ANGERS), le 15/12/2013
Bonjour, Quel crédit accordé aux études de l'Andra, quand on voit que cet organisme propose encore en 2013 des thèses (thème de recherche) sur la propagation des radio-nucléides dans les argiles? Le débat public n'est pas trop tôt ?
Réponse du 13/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’Andra dispose d’un grand nombre de données sur les propriétés de transfert des radionucléides dans les argiles du Callovo-Oxfordien. Dans le cadre de sa politique scientifique, l’Andra a choisi de soutenir la poursuites d’études académiques dans les domaines scientifiques intéressant le stockage, tel que le transfert des radionucléides dans les milieux argileux. Cela permet de maintenir les connaissances au meilleur de l’état de l’art scientifique, conformément aux bonnes pratiques en matière de sûreté : la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire stipule dans son article 29 que l’exploitant d’une installation nucléaire de base procède périodiquement au réexamen de la sûreté de son installation en tenant compte notamment de l’évolution des connaissances.
QUESTION 972 - Qu'est ce que pour vous l'hônnèteté, l'éthique?
Posée par Jean LEFÈVRE, L'organisme que vous représentez (option) (BREST), le 16/12/2013
Le choix de Bure pour son argilite ultra solide, quand tout le monde sait que c'est tout simplement parceque vous vous êtes fait chasser des autres sites prévus, par la population qui ne voulait pas de déchets chez eux. Une vidéo sur internet montre un bloc d'argilite de Bure qui se dissous dans l'eau en 17mn. Les autorités françaises championnes des débats publics, alors que les décisions sont déja prises(ex:l'EPR). Comment peut on appeler ça? La gestion faite de mépris, d'arrogance envers les populations victimes de Fukushima est accablante pour le lobby nucléocrate. Construire dans l'urgence des villages de réfugié(e)s dans des zones contaminées, ou le taux d'alcoolisme et de suicide a fortement grimpé. Comment peut on appeler ça? Le nucléaire n'est pas une source d' énergie démocratique et les pays ou elle s'est le plus développée le montre bien, les Etats unis, l'ex URSS, le Japon, la Chine et la France ou à part Plogoff et une quasi guerre civile pour empêcher la construction d'une centrale nucléaire, la plupart des 58 centrales françaises ce sont imposées par la force répressive (un mort VITAL MICHALON et des dixaines de bléssé(e)s, mains arrachées, pieds arrachés etc), une corruption qui ne dit pas son nom sous la forme d'une manne financière qui innonde les alentours des centrales, des gros mensonges aussi avec le grossissement démesuré des futurs besoins en électricité en imposant par exemple le chauffage électrique. Il fallait aussi faire de l'anti nucléaire un archaique, un anti tout, au comportement proche de la maladie mentale
Réponse du 28/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestions sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site
L’histoire du choix du stockage géologique
La question des déchets radioactifs a été abordée dès les années 1950 et les débuts de la production d’électricité d’origine nucléaire. C’est au cours des années 1960 et 1970 que le stockage a commencé à être considéré comme une possibilité de gestion au sein de la communauté scientifique internationale et notamment le stockage profond pour les déchets de haute activité et à vie longue. Dans les années 1980, des investigations étaient prévues pour rechercher des sites susceptibles d’accueillir des laboratoires souterrains. Mais les discussions sont restées limitées aux experts techniques et scientifiques et l’opinion publique s’est opposée aux projets. Le Parlement s’est alors saisi de la question des déchets radioactifs et a voté en 1991 une première loi qui a défini un programme de recherche pour les déchets de haute activité et à vie longue. Après 15 ans de recherche, leur évaluation et un débat public, une seconde loi a été votée en 2006. Elle a retenu le stockage profond comme solution de gestion à long terme de ces déchets pour protéger l’homme et l’environnement sur le très long terme et afin de limiter la charge de leur gestion sur les générations futures.
D’autres solutions ont été étudiées en France et à l’étranger depuis plus de 50 ans : envoi dans l’espace, au fond des océans, dans le magma, séparation-transmutation… Le stockage est aujourd’hui considéré dans tous les pays comme la meilleure solution pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs sur le très long terme. La directive européenne du 19 juillet 2011 considère ainsi que le stockage géologique constitue actuellement la solution la plus sûre et la plus durable en tant qu’étape finale de la gestion des déchets de haute activité.
L’histoire du choix de Bure
La loi de recherche du 30 décembre 1991 prévoyait la réalisation de laboratoires souterrains pour l’étude des possibilités de stockage dans les formations géologiques profondes. Suite à une mission de concertation lancée fin 1992 et à des premières analyses géologiques, quatre sites candidats avaient été identifiés dans les départements du Gard, de la Meuse, de la Haute-Marne (couches argileuses) et de la Vienne (couche granitique). L’Andra a été autorisée par le Gouvernement à mener des investigations géologiques sur ces sites dans le but de savoir s’il était intéressant d’y construire un laboratoire souterrain pour continuer les études. En 1996, l’Andra a déposé trois dossiers de demandes d’installation de laboratoires souterrains. Les résultats des investigations géologiques ont montré que la géologie du site en Meuse/Haute-Marne (les deux sites ont été fusionnés en une seule zone en raison de la continuité de la couche argileuse étudiée) était particulièrement favorable. Concernant le Gard, le site présentait une plus grande complexité scientifique liée à son évolution géodynamique à long terme et faisait l’objet d’oppositions locales. L’instruction du dossier relatif au site étudié dans la Vienne n’a pas abouti à un consensus scientifique sur la qualité hydrogéologique du massif granitique.
En 1998, le Gouvernement a décidé la construction d’un laboratoire de recherche souterrain en Meuse/Haute-Marne et la poursuite des études pour trouver un autre site dans une roche granitique. La recherche d’un site dans une roche granitique a finalement été abandonnée, la mission de concertation n’ayant pas abouti. L’Andra a toutefois poursuivi ses recherches sur le milieu granitique jusqu’en 2005, en s’appuyant notamment sur les connaissances déjà disponibles sur les massifs granitiques français et sur les travaux menés dans les laboratoires souterrains d’autres pays (Suède, Canada, Suisse). Ces recherches ont conduit l’Andra à conclure en 2005 qu’un stockage dans les massifs granitiques ne présenterait pas de caractère rédhibitoire mais que la principale incertitude porte sur l’existence de sites en France avec un granite ne présentant pas une trop forte densité de fractures.
En s’appuyant sur l’ensemble des recherches menées sur le site de Meuse/Haute-Marne depuis 1994, l’Andra a montré que ce site présente des caractéristiques favorables pour assurer la sûreté à long terme d’un éventuel stockage. La Commission nationale d’évaluation mise en place par le Parlement pour évaluer sur le plan scientifique les travaux de l’Andra souligne ainsi dans son rapport 2012 : « le site géologique de Meuse/Haute-Marne a été retenu pour des études poussées, parce qu’une couche d’argile de plus de 130 m d’épaisseur et à 500 m de profondeur, a révélé d’excellentes qualités de confinement : stabilité depuis 100 millions d’années au moins, circulation de l’eau très lente, capacité de rétention élevée des éléments. »
La « manne financière » dans le cas de Cigéo
L’accompagnement économique du projet a été décidé par le Parlement. Il est normal que les territoires qui acceptent de s’engager depuis une vingtaine d’années dans une démarche visant à mettre en œuvre un projet d’intérêt national en tirent un bénéfice concret. Deux groupements d’intérêt public ont été constitués en Meuse et en Haute-Marne en vue de gérer des équipements nécessaires à l’installation du Laboratoire souterrain ou du centre de stockage s’il est mis en œuvre, de mener des actions d’aménagement du territoire et de développement économique et de soutenir des actions de formation et la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques. Contrairement à ce que vous indiquez, l’accompagnement économique n’est pas versé par l’Andra. Il est financé par les producteurs de déchets au moyen d’une taxe sur les installations nucléaires.
L’expérience de l’argilite mise dans l’eau
Le phénomène de délitement d’un échantillon d’argile placé dans un verre d’eau est connu de tous. Il ne peut être transposé aussi simplement à un massif de roche d’argile de 130 mètres d’épaisseur à 500 mètres de profondeur : la roche argileuse est solide alors qu’elle contient environ 10 % d’eau en masse (18 % en volume). Cette propriété est d’ailleurs clairement indiquée dans le dossier 2005 publié par l’Andra (référentiel du site de Meuse/Haute-Marne – tome 2, chapitre 25 ).
Compte tenu de son volume très important, le massif argileux ne pourrait se déliter en présence de venues d’eau externes que de façon très localisée. Dans Cigéo, les parois des galeries seront recouvertes d’un soutènement en béton qui protège la roche, avec des caniveaux pour drainer les éventuelles venues d’eau vers des points de collecte. La roche sera à nu uniquement au niveau des fronts de creusement.
De nombreuses mesures seront prises pour prévenir d’éventuelles arrivées d’eau accidentelles dans Cigéo :
- Protection des puits et de la descenderie contre les intempéries,
- Etanchéification des puits et des descenderies au niveau des couches de roche aquifères traversées au-dessus de la couche d’argilite,
- Systèmes de drainage des eaux issues des couches de roche supérieures peu productives et pompage de ces eaux jusqu’à la surface,
- Protection des canalisations d’eau interne et mécanismes de fermeture automatique en cas de rupture.
Ces dispositions sont largement éprouvées dans l’industrie minière.
Par précaution, des scénarios accidentels d’arrivées d’eau (par exemple suite à la défaillance d’une canalisation ou suite à une panne dans le système de drainage des eaux provenant des couches de roche supérieures) sont pris en compte dans les études de sûreté menées pour Cigéo, au même titre que pour n’importe quelle installation nucléaire. Compte tenu des origines possibles, ce débit sera nécessairement limité (pour mémoire le débit drainé par chacun des puits du Laboratoire souterrain est de l’ordre de 10 m3/jour en moyenne, ou moins, ce qui est très faible par comparaison à certains sites miniers). Un tel évènement resterait très localisé dans le stockage et n’aurait qu’un effet très limité sur l’argile qui sera protégée par les revêtements. En tout état de cause, ce type d’incident ne remettra pas en cause la sûreté du stockage.
QUESTION 971 - Accident de train
Posée par Tonny MONARI, L'organisme que vous représentez (option) (NOMPATELIZE), le 16/12/2013
Le transport des déchets nucléaires venant de toute la France vers Bure donnera une grosse augmentation du trafique ferroviaire vers Bure.Les accidents de train n'arrivent pas seulement en Espagne,voire Bretigny-sur-Orge ( 7 morts ) Les risques d'un accident de train chargé de matières hautement radioactives sera estimés à combien dans vos statistiques ?
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) :
La sûreté des transports de substances radioactives à usage civil est contrôlée en France par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), sur la base d’inspections et de l’instruction de demandes d’agrément d’emballages. Ce contrôle vise à assurer la protection des personnes et de l’environnement. Il porte sur la conception des emballages et les opérations de transports qui sont soumises à des contraintes réglementaires rigoureuses.
Les emballages doivent notamment assurer un confinement des substances radioactives transportées et fortement réduire le rayonnement à l’extérieur du colis.
De façon plus spécifique, le débit de dose à proximité du véhicule ne doit pas dépasser certains plafonds. En pratique, les niveaux relevés sont en général beaucoup plus faibles que ces plafonds. Même si ces plafonds étaient atteints, une personne devrait rester 10 heures à deux mètres du véhicule pour que le rayonnement reçu atteigne la limite annuelle d’exposition du public.
Concernant les risques en cas d’accident, les modèles de colis sont soumis à des épreuves réglementaires destinées à démontrer leur résistance lors du transport. Le niveau d’exigence de ces épreuves est proportionné à la dangerosité des substances transportées. À titre d’exemple, les modèles de colis correspondant aux substances les plus dangereuses doivent conserver leurs fonctions de sûreté, y compris en cas d’accident (simulé par une chute de 9 m sur une surface indéformable, une chute de 1 m sur un poinçon, un incendie d’hydrocarbure totalement enveloppant de 800° C minimum pendant 30 mn, une immersion dans l’eau à une profondeur de 200 m).
Les autorités se sont naturellement interrogées depuis plusieurs années sur le comportement des colis agréés dans des cas d’agressions allant au-delà de ces épreuves réglementaires décrites précédemment.
Des études ont été menées en France et à l’étranger, notamment par l’IRSN, AREVA, l’autorité allemande BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung) et le laboratoire national américain SANDIA, afin d’évaluer le comportement des colis contenant des substances radioactives dans des conditions réalistes d’impact mécanique et de feu et pouvant aller au-delà des sollicitations prévues par les épreuves réglementaires. Ainsi, la tenue de ces types de colis dans des conditions de feu plus contraignantes (en termes de durée et de température) et dans des conditions de chute plus contraignants (en matière de surface d’impact et de hauteur de chute) a été étudiée. Par exemple, une étude de l’IRSN consultable sur le site Internet de l’institut permet de comparer l’écrasement du colis sur une surface indéformable, comme prévu dans les épreuves réglementaires et sur des surfaces représentatives de cibles réelles : par exemple des sols en sable, argile ou des cibles métalliques représentatives de l’environnement des emballages durant le transport dont l’essieu de wagon et le longeron de wagon. Cette étude a montré que les colis considérés dans l’étude conserveraient leur capacité de confinement en cas d’accident réel et que leurs équipements additionnels (châssis et râtelier) ainsi que les cibles absorberaient une part importante de l’énergie d’impact et augmenteraient ainsi les marges de sûreté.
En France, aucun accident ferroviaire ayant impliqué des colis de combustible usé n’a à ce jour été relevé. Néanmoins, cette éventualité est envisagée par les pouvoirs publics.
Ainsi, la dernière ligne de défense de la sûreté des transports de substances radioactives repose sur les moyens d’intervention mis en œuvre face à un incident ou un accident. Les pouvoirs publics, l’ASN et les exploitants se préparent donc à la gestion des situations de crise impliquant un transport de substances radioactives à travers les plans ORSEC et au moyen d’exercices.
Réponse apportée par AREVA :
Les déchets radioactifs HA/MA-VL sont transportés dans des « emballages » de haute technologie et agréés par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN). Le retour d’expérience de plusieurs dizaines d’années confirme le haut niveau de sûreté mis en œuvre : aucun accident ayant eu des conséquences radiologiques n’est à déplorer. La résistance des emballages est testée en conditions extrêmes. En effet, pour les opérations de transport, la sûreté nucléaire repose d’abord sur l’emballage. Les emballages utilisés sont conçus pour assurer la protection des personnes et de l’environnement en toutes circonstances, tant dans des conditions normales que dans des situations accidentelles.
Les emballages destinés aux transports des déchets radioactifs de type HA/MA-VL sont conçus pour être étanches et le rester même en cas d’accident (collision, incendie, immersion…). Leur étanchéité maintenue même en situation extrême permet de prévenir le risque de contamination. Par ailleurs, ces emballages sont composés de plusieurs types de matériaux permettant de réduire les niveaux d’exposition aux rayonnements pour les rendre inferieurs aux limites fixées par la réglementation. Celle-ci établit que la quantité de rayonnements reçus par une personne qui resterait à 2 m du véhicule pendant une heure n’excède pas la limite de 0,1 mSv quel que soit le type de déchets transporté. A titre de comparaison, l’exposition moyenne annuelle de la population française à la radioactivité naturelle est de 2,4 mSv.
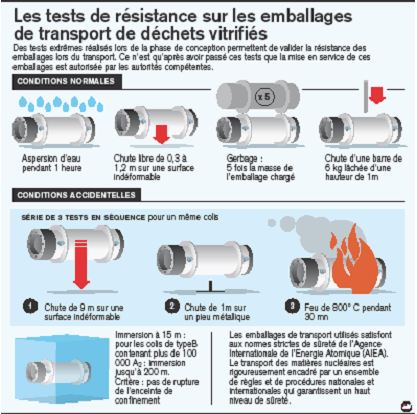
Les transports sont réalisés dans le cadre des réglementations internationales (AIEA, ADR, RID…) et nationales en vigueur. Ces réglementations sont établies en fonction de la nature de la matière transportée et du mode de transport utilisé. En France, l’ASN est responsable du contrôle de la sûreté des transports de substances radioactives pour les usages civils.
Le transport de substances radioactives est assuré par des sociétés spécialisées et autorisées par les autorités compétentes.
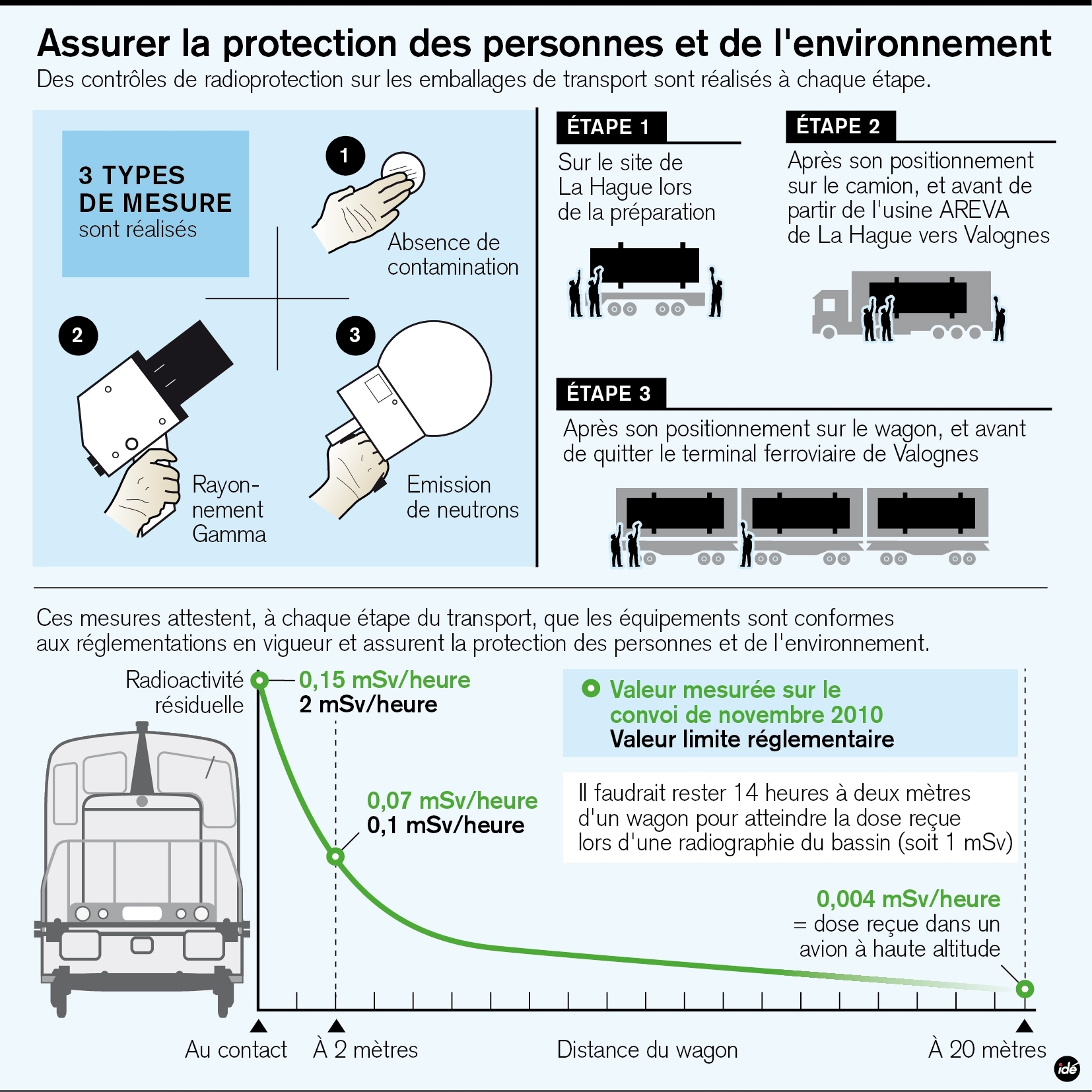
Le niveau de rayonnement et la non-contamination des emballages sont vérifiés par les exploitants et des organismes indépendants à chaque étape du transport, y compris lors de changements de modes de transport. Ces mesures attestent, à chaque étape du transport (cf. figure ci-contre), que les équipements sont conformes aux réglementations en vigueur et assurent la protection des personnes et de l’environnement. Elles peuvent être vérifiées à tout moment et sur le terrain par l’ASN. Le transport en toute sûreté de plus 6000 colis de déchets de Haute Activité et Moyenne activité à vie Longue, principalement par le rail illustre la maîtrise des risques de contamination et d’exposition aux rayonnements.
En complément de ce dispositif de prévention éprouvé, la France a mis en place un dispositif national pour gérer de potentiels accidents. Les autorités s’appuient sur les dispositifs mis en place dans le cadre des plans ORSEC et à leur déclinaison départementale. Les Préfectures sont averties par le Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle de Crises (COGIC) des transports transitant par leur département ; ce dernier assure, entre autres missions, sous l’autorité du Ministère de l’Intérieur, des responsabilités opérationnelles dans le domaine de la gestion et du suivi des transports. AREVA au travers de sa filiale AREVA TN dispose, par ailleurs, d’un plan d’urgence interne spécifique appelé PUI-T. Celui-ci couvre les phases d’alerte, d’analyse de la situation et d’intervention sur le terrain suite à un incident ou un accident de transport de matières radioactives. Il permet à AREVA TN de mettre à la disposition des autorités compétentes des moyens humains spécialisés et des matériels spécifiques. L’ensemble de ce dispositif est testé, en moyenne, chaque année à l’échelon national avec les principaux acteurs et notamment les autorités compétentes.
Les schémas de transport envisagés pour Cigéo sont assez proches de ceux mis en œuvre avec succès depuis plus de 30 ans. En effet, le réseau ferré national est actuellement utilisé pour l’acheminement des emballages de combustibles usés depuis les centrales du parc EDF, jusqu’au terminal ferroviaire de Valognes, situé à 40 km de l’usine de la Hague, puis par la route ; les emballages y sont alors transférés sur des camions pour transport jusqu’au site. Ce flux correspond à environ 200 transports de combustible usé par an. Par ailleurs les déchets HA, MAVL issus du traitement des combustibles usés étrangers transitent également par le terminal ferroviaire de Valognes avant d’être retournés vers leur pays d’origine.
Ce sont ainsi de l’ordre de 800 emballages transférés chaque année au terminal ferroviaire de Valognes correspondant à environ 1 train/par semaine.
QUESTION 970 - Ventilation des puits
Posée par Joel BRISSON, L'organisme que vous représentez (option) (LONGEAUX), le 15/12/2013
600 m3 par seconde, ça fait quand même 19 milliards de m3 d'air par an rejetés dans notre atmosphère locale. Cet air contiendra des poussières et gaz radioactifs. Que deviendront nos cultures locales? Quel air va-t-on respirer alors qu'aujourd'hui on mange encore des aliments qui contiennent du césium de Tchernobyl? On vient de me déceler cette semaine un nodule à la thyroïde!!! Et demain qui va être contaminé par cet enfouissement ??
Réponse du 11/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
L’objectif fondamental de Cigéo est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement des risques liés aux déchets radioactifs. Une première évaluation, faite sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact des rejets pendant l’exploitation du site serait de l’ordre de 0,01 mSv par an à proximité du Centre, soit très largement inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France). A titre de comparaison, lors d’un scanner de l’abdomen, les doses reçues sont de l’ordre de 10 mSv.
Malgré ce très faible impact, et pour répondre à la demande exprimée à plusieurs reprises par les acteurs locaux et notamment le Clis (Comité local d’information et de suivi du Laboratoire souterrain), l’Andra s’est rapprochée des organismes de santé publique (Institut national de veille sanitaire, Observatoires régionaux de la santé de Lorraine et de Champagne-Ardenne) pour étudier les modalités possibles d’une surveillance de la santé autour du stockage. L’Andra a saisi ses ministères de tutelle pour que la gouvernance et l’organisation d’un tel dispositif soient précisées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement afin de contrôler l’impact de ses activités. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, il permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement et l’absence de contamination des nappes phréatiques. L’Andra a déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. Mais également, Cigéo sera en permanence soumis au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
QUESTION 969 - FUITES
Posée par Marine LONCHAMPT, L'organisme que vous représentez (option) (ROGNA), le 15/12/2013
Comment ferez-vous face aux fuites radioactives ?
Réponse du 21/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 968 - que se passera- t-il en cas d'accident
Posée par Denise BORDOZ, L'organisme que vous représentez (option) (CLERMONT FERRAND ), le 15/12/2013
Dans le cas d'un scénario qui conduit à une catastrophe, perte de confinement, explosion, incendie, quels seront les moyens de lutte? Quel périmètre devra être évacué? Faudra t il construire un sarcophage tous les 25 ans comme à Tchernobyl et enfin qui interviendra pour contenir la catastrophe???
Réponse du 21/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs est au cœur du projet Cigéo. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées. De telles situations ne nécessiteraient donc aucune intervention comparable à la catastrophe de Tchernobyl, ni aucune évacuation des populations voisines.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 967 - STOP
Posée par yvette FISCHER, L'organisme que vous représentez (option) (ILE DE FRANCE), le 15/12/2013
Comment envisagez-vous l'avenir de notre terre, de notre campagne, de la diversité de la faune et de la flore si fragile ????? Que ferez vous de vos bénéfices quand la haute marne sera polluée pendant des dizaines d'années ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 966 - Payer quoi et à qui, et pourquoi ?
Posée par Pascale VINCENT, CITOYEN DU MONDE (DOMREMY), le 15/12/2013
Comment allez-vous justifier votre inconséquence, votre étroitesse d'esprit, votre irresponsabilité, votre avidité morbide, auprès de l'humanité lorsque l'incontournable et irrémédiable catastrophe arrivera ? Je m'oppose totalement au projet cigéo et à toute activité nucléaire et guerrière en général. Et si l'Etat continue de soutenir ce projet, je m'engage à ne plus payer mes impôts au Trésor Public mais aux associations anti-nuclaires, anti-ogm, anti-obsolescence programmée, anti-guerre, pro-paix, pro-biodiversité, pro-respect de la Vie. Je m'engage à payer mon écot à une cause que je respecte. Car je ne sais pas comment faire entendre valablement et pacifiquement ma voix autrement.
Réponse du 11/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 965 - Que deviennent les déchets?
Posée par Jean-louis CHABERT, L'organisme que vous représentez (option) (HERBEYS), le 15/12/2013
Quelles est la durée de vie des déchets nucléaires?
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
Les déchets destinés à Cigéo resteront dangereux plusieurs centaines de milliers d’années. Un indicateur de cette dangerosité peut être donné par le rayonnement que produisent les déchets. Pour les déchets de haute activité, les plus radioactifs, au moment de leur mise en stockage, le rayonnement qui serait reçu à un mètre d’un colis sans protection est de plusieurs sieverts (Sv) par heure. La dangerosité de ces déchets radioactifs diminuera au fil du temps du fait de la décroissance naturelle de la radioactivité qu’ils contiennent. Le rayonnement des déchets de haute activité sera ainsi divisé par environ mille dans mille ans.
Cigéo est justement conçu pour protéger à très long terme l’Homme et l’environnement de la dangerosité de ces déchets. Le stockage est situé à 500 mètres de profondeur pour isoler les déchets des activités humaines et des événements naturels de surface, comme l’érosion. Il est implanté dans une couche d’argile épaisse qui permet le confinement à très long terme de la radioactivité. Les études menées par l’Andra ont montré que le stockage n’aura pas d’impact avant 100 000 ans et que celui-ci restera significativement inférieur à l’impact de la radioactivité naturelle*.
*La radioactivité naturelle est de 2,4 millisievert (mSv) par an en moyenne en France (le millisievert correspond à un millième de sievert). Les normes européennes et françaises de radioprotection imposent aux industries une exposition limitée du public à 1 mSv par an et par personne du fait de leurs rejets dans l’environnement. Cette dose-limite d’exposition correspond à l’équivalent de la dose reçue en trois radios pulmonaires.
QUESTION 964 - Pourquoi ne pense-t-on pas à ceux qui vont suivre ?
Posée par François VETTER, CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ASSOCIATIONS FAMILIALES LAÏQUES 70 (PLANCHER-BAS), le 15/12/2013
Que le site puisse présenter des garanties de sécurité pour quelques décennies, voire quelques siècles, pourquoi pas. Mais comment imaginer qu'il n'adviendra pas d'événement politique, climatique ou sismique grave durant les milliers d'années où ces produits seront dangereux ? A-t-on le droit de faire un tel leg aux générations à venir ? Plus immédiatement, qui va payer la surveillance et la maintenance du site ? Nos descendants, évidemment. Est-ce acceptable ? Qui va assister à la pollution des sous-sols sans pouvoir intervenir en cas de problème ? Toujours nos descendants. Pourquoi ne pas leur laisser au moins la possibilité d'intervenir sur le cet héritage en cas de besoin, en le laissant accessible au lieu de l'enfouir ?
Réponse du 31/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 963 - adjudication des travaux
Posée par raymond JOANNESSE, CITOYEN (REIMS), le 15/12/2013
Alors que l'ANDRA clame partout que les travaux seront fait par des entreprises locales, donc vont permettre le développement économique du département, comment cela se fait il que ce soit une entreprise canadienne (SNC Lavallin) qui s'est vue attribuée la première tranche de travaux??
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les contrats en cours concernent les études pour concevoir Cigéo et non les travaux, qui ne sont pas autorisés.
L’Andra est un établissement public dont les procédures d’achat sont soumises à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 et à son décret d’application n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié. Les achats de l’Andra reposent sur trois principes fondamentaux : liberté d’accès à la commande publique, transparence des procédures, égalité de traitement des candidats. Au-delà d’un certain montant, la réglementation européenne impose aux maîtres d’ouvrage publics d’organiser des appels d’offres européens.
Si SNC-Lavalin est un groupe canadien, il n’en demeure pas moins que son implantation européenne se situe principalement en France (où elle a son siège Europe). Les prestations dont elle a la charge pour Cigéo (étude d’installations de surface) seront en l’occurrence réalisées totalement en France avec l’implication notamment de son agence située à Reims. SNC-Lavalin SAS emploie de manière permanente 1.500 personnes en France et plus de 200 personnes dans les régions Champagne-Ardenne et Lorraine où le groupe est implanté depuis plusieurs décennies.
QUESTION 962 - Contamination du Bassin parisien
Posée par Thibaud LEPAGE, L'organisme que vous représentez (option) (SEVRES), le 15/12/2013
Je suis Sèvrien, ville bordée par la Seine en aval de Paris. Mon fils est membre du Club Nautique. Je suis très inquiet quant à cette histoire d'eau contaminée autour de BURE, et qui pourrait arriver dans la capitale par la succession des ruisseaux, rivières et fleuves, et ainsi condamner le bassin parisien. J'ai été très impressionné par le cahier d'acteurs n°64, De BURE au ZOUAVE. Est-ce que ce scénario catastrophe est possible ?
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
Pour ce qui concerne la ressource en eau
Pendant l’exploitation du Centre, afin d’éviter tout risque de contamination des nappes phréatiques, les effluents liquides susceptibles d’être contaminés seront systématiquement collectés et contrôlés.
Sur le long terme, la couche d’argile dans laquelle est implantée le stockage garantit l’éloignement des déchets radioactifs de la surface. Seuls quelques radionucléides mobiles et dont la durée de vie est longue pourront migrer à travers la couche d’argile après plusieurs dizaines de milliers d’années, puis potentiellement atteindre ensuite la surface et les nappes phréatiques, après plus de 100 000 ans et en quantités extrêmement faibles. Leur impact radiologique serait alors plusieurs dizaines de fois inférieur à la radioactivité naturelle (qui est de 2,4 milliSievert par an en moyenne en France).
QUESTION 961 - Utilité de l'enfouissement
Posée par Raymond JOANNESSE, L'organisme que vous représentez (option) (REIMS), le 15/12/2013
Bonjour En quoi est ce plus pertinent de faire des recherches sous le sol qu'en surface?? déjà d'un ^point de vue budgétaire, ce sera moins chère de faire des recherches en surface que dans un laboratoire sous terrain. D'autres n'est ce pas plutôt afin que l'ANDRA communique sur le thème " ca y est on a résolu le problème du retraitement des déchets souterrains avec notre laboratoire de Bure" Alors que c'est plutôt un cercueil pour déchets nucléaires que l'ANDRA prépare, mais cela elle ne peut pas le dire ouvertement
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage en surface. En effet, laisser les déchets dans des installations en surface impliquerait de renouveler périodiquement les bâtiments où ils seraient placés, de contrôler ces installations et de les maintenir. En cas de perte de contrôle de ces installations, les conséquences radiologiques sur l’homme et l’environnement ne seraient pas acceptables. Compte tenu de la durée pendant laquelle ces déchets resteront dangereux (plusieurs centaines de milliers d’années), l’entreposage - qu’il soit en surface ou à faible profondeur - ne peut être qu’une solution provisoire dans l’attente d’une solution définitive
D’autres solutions ont été étudiées en France et à l’étranger depuis plus de 50 ans : envoi dans l’espace, au fond des océans, dans le magma, séparation-transmutation… Le stockage est aujourd’hui considéré dans tous les pays comme la meilleure solution pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs sur le très long terme. La directive européenne du 19 juillet 2011 considère ainsi que le stockage géologique constitue actuellement la solution la plus sûre et la plus durable en tant qu’étape finale de la gestion des déchets de haute activité.
QUESTION 960 - qui sera responsable?
Posée par martine THOREL, L'organisme que vous représentez (option) (MONTMAIN), le 15/12/2013
Qui sera responsable quand un accident provoquera des fuites..
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 959 - il faut faire Cigéo
Posée par Etienne DURAND, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 15/12/2013
Personne ne peut parier sur le fait que l’on trouvera demain une solution miracle qui n’existe sûrement pas sinon la science l’aurait trouvé ! je suis pour l’enfouissement. Qui décidera de le fermer à la fin ?
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le Parlement a demandé à l’Andra que le stockage soit réversible pendant au moins 100 ans pour laisser des portes ouvertes aux générations qui nous succéderons et la possibilité de faire évoluer cette solution si elles souhaitent. L’Andra place cette demande de la société au cœur du projet. Elle a ainsi fait des propositions concrètes pour pouvoir récupérer les colis de déchets si besoin et laisser des choix possibles aux générations suivantes. Dans le cadre de la réversibilité, l’Andra propose d’organiser des points de rendez-vous réguliers qui permettront notamment de suivre les avancées des recherches sur la gestion des déchets radioactifs. Si d’autres solutions étaient découvertes dans le futur, les générations concernées pourront décider de faire évoluer leur politique de gestion des déchets.
Les conditions de réversibilité seront définies par une future loi avant que la création de Cigéo ne puisse être autorisée. Pendant au moins 100 ans, les générations suivantes pourront contrôler le déroulement du stockage et récupérer les déchets si elles le souhaitent. En fonction de l’expérience acquise lors de l’exploitation de Cigéo, elles pourront décider de commencer la fermeture par étapes du stockage. Après une centaine d’années d’exploitation, si elles décident de fermer définitivement le stockage, la sûreté sera assurée de manière passive, sans nécessité d’action humaine. Conformément à la loi du 28 juin 2006 sur la gestion durable des matières et déchets radioactifs, la décision finale de fermeture du stockage sera prise par le Parlement.
Pour en savoir plus sur les propositions faites par l’Andra en matière de réversibilité du stockage, voir : ../docs/rapport-etude/fiche-reversibilite-cigeo.pdf
QUESTION 958 - il faut faire Cigéo
Posée par Etienne DURAND, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 15/12/2013
S’il y a une guerre ou n’importe quel problème de société, comment garantir que les entreposages dans lesquels certains veulent laisser les déchets restent sûrs aussi longtemps que les déchets resteront dangereux ?
Réponse du 28/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Effectivement, à l'inverse du stockage, l’entreposage des déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue implique de renouveler périodiquement les bâtiments où sont placés ces déchets, avec les opérations associées de transferts de déchets radioactifs, de contrôler ces installations et de les maintenir. Ces déchets étant dangereux pendant des centaines de milliers d'années, il est légitime de s’interroger sur la capacité à garantir que les hommes auront les moyens humains, techniques, financiers de les gérer, sans parler des instabilités politiques ou des guerres. En cas de perte de contrôle de ces installations, les conséquences radiologiques sur l’homme et l’environnement ne seraient pas acceptables. Compte tenu de la durée pendant laquelle ces déchets resteront dangereux (plusieurs centaines de milliers d’années), l’entreposage - qu’il soit en surface ou à faible profondeur - ne peut être qu’une solution provisoire dans l’attente d’une solution définitive.
Le projet Cigéo propose une solution pour protéger sur le très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs produits en France depuis plus d’un demi-siècle. S’il est mis en œuvre, cela permettra de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations futures, alors qu’elles n’auront pas bénéficié de l’électricité procurée par la production de ces déchets. La réversibilité leur laissera la possibilité de contrôler la mise en œuvre de cette solution et de l’adapter si elles le souhaitent.
De manière générale le stockage est aujourd’hui considéré dans tous les pays comme la meilleure solution pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs. La directive européenne du 19 juillet 2011 considère ainsi que le stockage géologique constitue actuellement la solution la plus sûre et la plus durable en tant qu’étape finale de la gestion des déchets de haute activité.
QUESTION 957 - question
Posée par Georges FRANÇOIS, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 15/12/2013
Il faut enfouir ! Il faut faire quelque chose de ces déchets et quelque chose bien. Comment être sûr qu’aucun déchet ne sera refusé dans Cigéo et laissé sans solution ? merci
Réponse du 28/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le projet de stockage profond Cigéo est conçu pour mettre en sécurité définitive les déchets dont le niveau de radioactivité et la durée de vie ne permettent pas de les stocker, de manière sûre à long terme, en surface ou à faible profondeur. L’inventaire détaillé des déchets radioactifs susceptibles d’être stockés dans Cigéo a été établi en lien avec les producteurs de déchets. Le document est disponible sur le site du débat public : ../docs/rapport-etude/dechets-pris-en-compte-dans-etudes-conception-cigeo.pdf.
Les déchets concernés proviennent principalement du secteur de l’industrie électronucléaire et des activités de recherche associées ainsi que, dans une moindre part, des activités liées à la Défense nationale. Les déchets vitrifiés dits de « haute activité » (HA) correspondent principalement aux résidus hautement radioactifs issus du traitement des combustibles nucléaires usés utilisés pour la production d’électricité. Les déchets dits de « moyenne activité à vie longue » (MA-VL) ont des origines variées : résidus issus du traitement des combustibles nucléaires usés et de la fabrication de certains combustibles, composants (hors combustible) ayant séjournés dans les réacteurs nucléaires, déchets technologiques issus de la maintenance des installations nucléaires, de laboratoires, d’installations liées à la Défense nationale, du démantèlement...
Cigéo est conçu pour prendre en charge les déchets produits par les installations nucléaires existantes. Les volumes de déchets HA et MA-VL sont estimés à environ 10 000 m3 pour les déchets HA (soit environ 60 000 colis de déchets) et environ 70 000 m3 pour les déchets MA-VL (soit environ 180 000 colis de déchets) dans l’hypothèse d’une poursuite de la production électronucléaire* et d’une durée de fonctionnement des installations nucléaires existantes de 50 ans. Dans cette hypothèse, 30 % des déchets HA et 60 % des déchets MA-VL sont déjà produits. Par précaution, des volumes supplémentaires (environ 20 % du volume de déchets MA-VL à stocker) sont prévus en réserve dans Cigéo pour certains déchets de faible activité à vie longue qui, le cas échéant, ne pourraient pas être stockés dans le stockage à faible profondeur à l’étude par l’Andra.
Cigéo est conçu pour être flexible afin de pouvoir s’adapter à d’éventuels changements de la politique énergétique. En cas d’arrêt de la production électronucléaire et d’arrêt du traitement des combustibles nucléaires usés, l’inventaire des déchets de haute activité à stocker serait alors d’environ 20 000 colis de déchets vitrifiés (suite à l’arrêt du traitement) et 57 000 assemblages de combustibles usés (selon les hypothèses présentées au chapitre 1 du dossier du maître d’ouvrage ../docs/dmo/chapitres/DMO-Andra-chapitre-1.pdf). A la demande du Ministère en charge de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, l’Andra, EDF et Areva ont étudié l’impact des différents scénarios établis dans le cadre du débat national sur la transition énergétique sur la production de déchets radioactifs et sur le projet Cigéo : ../docs/rapport-etude/20130705-courrier-ministere-ecologie.pdf
* Les déchets produits par un éventuel futur parc de réacteurs ne sont pas pris en compte.
QUESTION 956 - -
Posée par Stéphane DEMERC, L'organisme que vous représentez (option) (ESSONNE), le 15/12/2013
J’ai lu quelque part que Bure était peu sismique. Est-ce vrai ?
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
C’est le jeu des failles présentes dans la croute terrestre qui produit les tremblements de terre. Ces jeux sont la conséquence de la tectonique des plaques et des contraintes mécaniques engendrées au sein de la croûte terrestre. Il n’existe pas de failles sous le site Cigéo, et la création de nouvelles failles (liée à la tectonique des plaques, qui est très bien comprise aujourd’hui) au cours des prochains millions d’années, sur la durée de vie des déchets radioactifs, n’est pas envisageable.
Le site d’implantation de Cigéo (située à l’Est du Bassin de Paris) est à l’écart des zones actives où se produisent les jeux de failles qui absorbent le rapprochement des continents Afrique et Europe. Les mouvements tectoniques de grande amplitude et forts séismes qui en découlent se localisent pour l’essentiel en Méditerranée et dans les chaines de montagnes qui la bordent, et pour le reste (résidu) au niveau des grandes failles qui affectent la plaque européenne, comme les failles du fossé d’Alsace et des Vosges en bordure Est du bloc stable que constitue le Bassin de Paris. Ce dernier compte parmi les régions les plus stables du globe. Il est quasiment asismique avec des taux de déformations extrêmement faibles à l’échelle des temps géologiques, comptés en millions d’années.
L’analyse des directions et vitesses de déplacements relatifs des stations GPS installées en Europe, confirme que le Bassin de Paris constitue un bloc rigide et que les déformations (de faible amplitude) se font à ses frontières, comme le souligne la répartition des séismes. En conséquence, seules les failles majeures qui existent déjà sont susceptibles de glisser, avec des mouvements de très faible amplitude, par à-coups séparés dans le temps par plusieurs dizaines à centaines de milliers d’années.
C’est ainsi que la zone de 30 km² étudiée pour l’implantation de l’installation souterraine est, au plus proche, à 1,5 km du fossé de Gondrecourt, et à 6 km du segment le plus proche du système des failles de la Marne (le fossé de la Marne étant lui-même est à 14 km). Les analyses cartographiques montrent l’absence de mouvements de ces failles au cours des derniers millions d’années. Les derniers mouvements tectoniques du fossé de Gondrecourt datent de 20 à 25 millions d’années (datations de cristaux de calcite) ; les derniers mouvements des failles de la Marne sont du même âge ou plus anciens. La réalisation d’une écoute sismique dont le seuil de détection est très bas, et qui discrimine sans ambiguïté séismes naturels et tirs de carrières, permet d’affirmer l’absence de toute activité sur ces failles. En accord avec la réglementation en vigueur concernant la sûreté des installations nucléaires, les ouvrages de stockage sont toutefois dimensionnés pour résister aux séismes maxima physiquement possibles que pourraient générer ces failles si elles redevenaient actives dans le futur.
QUESTION 955 - Comment informer la population locale malgré les opposants?
Posée par Joseph PRODHOMME, L'organisme que vous représentez (option) (RUEIL), le 15/12/2013
Lors du débat public qui se termine, aucune réunion publique n'a pu être organisée, du fait des actions d'une petite minorité bien organisée, parfois ceinte de l'écharpe tricolore. La CPDP n'a engagé aucune poursuite ni déposé aucune plainte, à ma connaissance, alors que ces agissements ont empèché les habitants de Bure, Bar le Duc, etc d'avoir accès de vive voix aux représentants de l'Andra, de l'Etat, d'EDF, etc... Comment l'Etat entend il garantir l'accès de la population à l'information après la fin du débat, et protéger celle-ci des agissements de perturbateurs qui empèchent la tenue de réunions au mépris de toute démocratie?
Réponse du 11/02/2014,
REPONSE APPORTEE PAR LA CPDP :
L’impossibilité de tenir les 8 réunions publiques prévues localement a bien entendu créé un vide ; toutefois la Cpdp a veillé tout au long de la période du débat à ce que l’information des populations concernées ne soit pas entravée :
A) Dispositions qui ont prévalu tout au long de la période du débat :
* Le site internet de la Cpdp a fonctionné, prévu et organisé à la fois pour informer et recueillir toutes questions, tous avis et commentaires du public, il a recueilli plus de 1 400 questions, 440 avis, 150 cahiers d’acteur et 23 contributions.
* Toute personne qui en a fait la demande a reçu gratuitement le dossier du maitre d’ouvrage, le Journal du Débat rédigé par la Cpdp, les cahiers d’acteurs publiés ; elle pouvait également s’abonner à la Lettre électronique du Débat (soit 750 personnes).
- De juillet à fin novembre 2013 ont été organisés sur internet 9 débats contradictoires visant à permettre à tout citoyen d’approfondir en liaison directe avec des experts indépendants, français et étrangers, les questions qui le préoccupaient concernant le projet Cigéo (400 questions reçues, 3397 connexions en direct et 5937 consultations en différé).
B) La phase qui va se terminer avec la publication du compte rendu du débat public n’épuise pas les procédures de consultation du public, puisque :
- Le maître d'ouvrage (l’ANDRA) doit décider dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public, du principe et des conditions de la poursuite de son projet. Il doit préciser, le cas échéant, les principales modifications apportées au projet. La décision de l’ANDRA sera transmise à la CNDP et publiée.
- Une concertation postérieure au débat public est prévue dans le code de l’environnement à l’article L.121-131 : « Le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable du projet informe la commission nationale du débat public, pendant la phase postérieure au débat public jusqu’à l’enquête publique, des modalités d’information et de participation du public mises en œuvre ainsi que de sa contribution à l’amélioration du projet. La commission peut émettre des avis et recommandations sur ces modalités et leur mise en œuvre. Le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable du projet peut demander à la commission de désigner un garant chargé de veiller à la mise en œuvre des modalités d’information et de participation du public.».
- Il y aura, comme indiqué ci-dessus, tout à fait en fin de parcours, une enquête publique.
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Le débat public national sur Cigéo, qui s’est tenu du 15 mai au 15 décembre 2013 vient de s’achever. Tout au long de cette période, la CPDP et la CNDP ont mis en place des moyens permettant au public de s’informer et s’exprimer, malgré l’impossibilité de tenir les réunions publiques :
- le site Internet participatif du débat a reçu plus de nombreuses visites et a consigné un grand nombre d’avis, de questions et de cahiers d'acteurs, en particulier issus des acteurs locaux ;
- les 9 débats contradictoires interactifs, permettant au public de poser les questions et de suivre en direct les débats ;
- une conférence de citoyens.
Par définition, une réunion publique est ouverte à tous, et en l’état actuel du droit, la force publique n’intervient que lorsque la sécurité des biens ou des personnes est menacée.
Dans les deux mois qui suivent la clôture du débat le 15 décembre 2013, la CPDP en publiera le compte-rendu et la CNDP en rédigera le bilan. L'Andra, maître d’ouvrage du projet, sera alors tenue, dans un délai de trois mois, d’indiquer les suites qu’elle entend donner à son projet au regard des enseignements du débat public et d’annoncer de quelle manière elle entend assurer l’information et la participation du public tout au long du projet.
En outre, pour l’ensemble des questions relatives au nucléaire, la France s’est dotée d’un cadre législatif favorisant la transparence et de plusieurs structures de concertation, d’information et de débat. Ainsi, des Commissions Locales d’information (CLI) ont été créées auprès des installations nucléaires et un comité local d’information et de suivi a été mis en place, il y a près de 15 ans, lors de la création du laboratoire souterrain de Bure. Ces instances sont chargées d’une mission générale de suivi, d’information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d’impact des installations nucléaires sur les personnes et l’environnement. Ces CLI sont regroupées en une Association Nationale des Comités et Commissions Locales d’Information (ANCCLI). Le Haut Comité pour la Transparence et l’Information sur la Sécurité Nucléaire (HCTISN) a été créé par la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (dite "loi TSN"). C’est une instance d’information, de concertation et de débat sur les risques liés aux activités nucléaires et l’impact de ces activités sur la santé des personnes, sur l’environnement et sur la sécurité nucléaire. De plus, la loi du 13 juin 2006 instaure un droit d’accès à l’information en matière nucléaire directement auprès des exploitants, qui permet à tout un chacun de s’informer.
QUESTION 954 - -
Posée par Stephane DEMERC, - (ESSONNE), le 15/12/2013
Je ne suis pas contre le projet mais où sont les captages autour de la zone ou serait enfouis les déchets ? seront-ils surveillés ? merci
Réponse du 11/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
On dénombre 15 captages destinés à l’alimentation en eau potable (AEP) dans un rayon de 10 km autour de la zone étudiée pour l’implantation souterraine de Cigéo (ZIRA). Ces captages sont réalisés à des profondeurs allant de 3 à 330 mètres selon leur localisation (cf. carte jointe). Les captages les plus proches de la zone étudiée sont peu profonds. Aucun de ces captages n'atteint la couche d'argile étudiée pour l'implantation du stockage, qui ne présente pas de ressource en eau exploitable.
Les analyses des eaux potables issues des captages sont réalisées par des laboratoires agréés par le ministère chargé de la santé. L’ensemble des informations sur ces captages sont disponibles auprès des agences régionales de santé (ARS) de la Meuse et de la Haute-Marne.
Les limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine sont fixées par un arrêté du 11 janvier 2007. Concernant, la radioactivité, la référence de qualité porte sur la dose totale indicative (DTI), qui correspond à l’exposition annuelle résultant d’une consommation régulière de l’eau. Cette référence de qualité est fixée à 0,1 mSv.
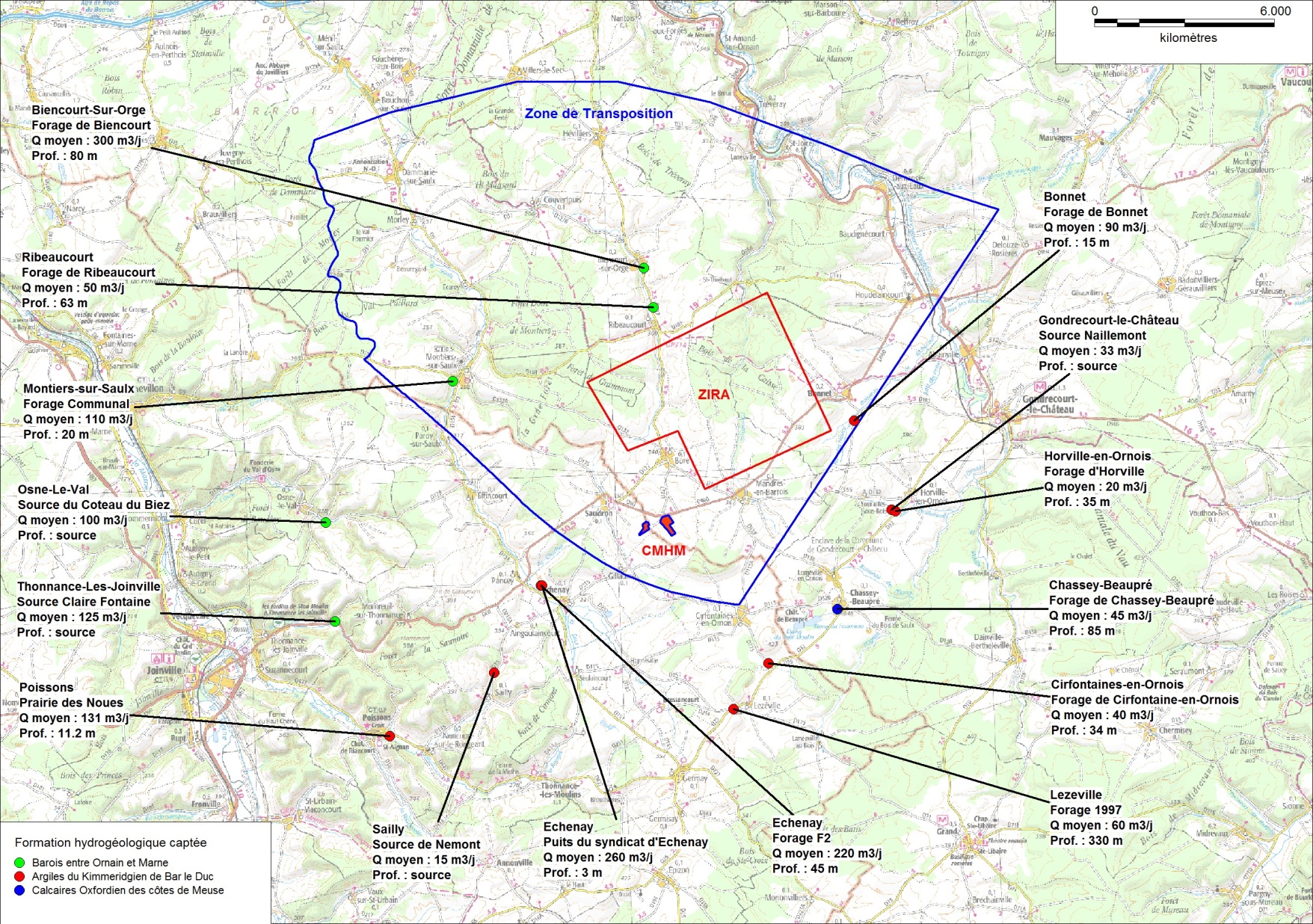
QUESTION 953
Posée par Geoffroy MARX (VERDUN), le 30/01/2014
Questions posées dans le cahier d'acteurs n°139 de M. Geoffroy Marx : Quels sont les differents scénarios que l'Andra envisage à cette echelle en termes d'évolutions sociétales, technologiques et environnementales? Quels seront les impacts de ces évolutions sur la construction et l'exploitation du site de Cigéo puis sur sa sécurité après sa fermeture?
Réponse du 10/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
Les déchets destinés à Cigéo resteront dangereux plusieurs dizaines de milliers d’années. C’est justement parce qu’on ne peut pas assurer la pérennité de notre société, la stabilité technologique et environnementales sur cette très longue échelle de temps que le Parlement a fait le choix du stockage profond comme solution de référence pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs. En effet, le principe du stockage profond est que sa sûreté à long terme ne repose pas sur des actions humaines, mais sur le milieu géologique pour lequel les modèles d’évolution sont prévisibles. Après la fermeture du stockage, la sûreté sera assurée de manière passive et ne nécessitera aucune action humaine. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, de bouleversements sociétaux ou environnementaux contrairement à l’entreposage. De plus, du fait de son implantation à 500 mètres de profondeur le stockage sera peu vulnérable aux activités humaines comme aux catastrophes naturelles.
Une surveillance du site pourra néanmoins être maintenue aussi longtemps que les générations futures le souhaiteront et des actions seront menées pour conserver et transmettre sa mémoire.
Enfin, si le projet Cigéo est accepté, celui-ci est conçu pour être réversible afin d’accompagner les différentes évolutions sociétales, technologiques et environnementales tout au long de son exploitation jusqu’à sa fermeture définitive. Ainsi, grâce à la réversibilité, les générations suivantes garderont la possibilité de faire évoluer cette solution. L’Andra propose que des rendez-vous réguliers soient organisés avec l’ensemble des acteurs (riverains, collectivités, évaluateurs, État…) pour contrôler le déroulement du stockage et pour préparer chaque décision importante concernant les étapes suivantes. Ces rendez-vous permettront de faire le bilan de l’exploitation du stockage, de discuter des perspectives à venir, de faire un point sur l’avancement des recherches en France et à l’étranger et sur les avancées technologiques. A chaque étape, il sera possible de décider de poursuivre le processus de stockage tel qu’initialement prévu ou de le modifier, par exemple si des solutions alternatives sont identifiées.
QUESTION 952 - Et demain??
Posée par Paul MICHALON, L'organisme que vous représentez (option) (SAINT-PERAY ), le 15/12/2013
Messieurs, car je pense qu'il y a peu de femmes parmi vous, elles ont plus le sens des réalités et de l'avenir... Qui va prendre en charge les accidents à venir sur un site d’enfouissement, avec quelle compétence (on voit à Fukushima qu'on ne maîtrise pas la question), quels moyens financiers (à la lumière d'aujourd'hui...) et quelle responsabilité juridique??? Nous avons impérativement besoin de réponses à ces questions. PM
Réponse du 21/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestions sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Les risques nucléaires sont couverts par un régime spécifique de responsabilité civile nucléaire régie en France par les conventions de Paris et de Bruxelles. Celles-ci définissent notamment les dommages rattachés à ces risques, l'indemnisation des victimes et les niveaux de garanties requis. Plusieurs tranches de garanties sont prévues : une première à la charge de l'exploitant (qui doit faire l'objet d'une garantie financière, un contrat d'assurance par exemple), une seconde à la charge de l'Etat et enfin une dernière à la charge d'un fonds international.
QUESTION 951 - a titre personnel
Posée par bernard ALBERICI, L'organisme que vous représentez (option) (MANCIEULLES), le 15/12/2013
en enfouissant de tels déchets ne fait on pas courir un grand risque aux générations futures? quelle terre leur laissera t-on?
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
Non, nous ne leur ferons pas courir un grand risque, bien au contraire. L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage en surface.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montre que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 950 - Comment protègera t on les populations et l'environnement proche du site ?
Posée par Anne THIRY, L'organisme que vous représentez (option) (SERMÉRIEU), le 15/12/2013
Comment protègera t on les populations et l'environnement proche du site d'enfouissement quand, dans quelques dizaines ou centaines d' années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou un acte malveillant conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites, et donc à un retour des radionucléides en surface, rendant impossible l' agriculture et la vie humaine et avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM, TCHERNOBYL et FUKUSHIMA. Comment la population locale pourra-t-elle alors continuer à vivre sur ce site sans risque pour sa santé ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 949 - Infiltration d'eau et mouvements de terrain
Posée par David ROBELET, CLUB ALPIN DE PONCIN ET CLUB DE TENNIS DE TABLE D'AMBÉRIEU EN BUGEY, SOU DES ÉCOLES DE CHATILLON LA PALUD, COLLÈGE LE GRAND CHAMP (CHATILLON LA PALUD), le 15/12/2013
Que se passe t il lors des remontées d'eau, des mouvements de terrain ? Comment peut on garantir une stabilité du sous sol sur des échelles de temps aussi longue que la demi vie des matériaux enfouis ? Merci de votre réponse, David Robelet
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
La stabilité et la très faible sismicité de la zone d’implantation du laboratoire souterrain est confirmée par les scientifiques qui ont travaillé sur ce site depuis plus de 20 ans. Le site de Meuse/Haute-Marne appartient à un domaine géologique stable (voir carte), particulièrement favorable pour l’installation d’un stockage. L’activité sismique est en effet extrêmement faible, comme le prouvent les enregistrements de sismicité instrumentale (écoute sismique depuis 1961 à l’échelle de la France) qui sont capables de détecter des microséismes, et les chroniques historiques (séismes ayant été ressentis et/ou ayant occasionné des dégâts au cours des derniers 1 000 ans). Au-delà de ces données, la stabilité et la très faible sismicité du site s’expliquent par sa situation géographique dans le bassin parisien qui est protégé des mouvements liés à la tectonique des plaques (collision du continent africain avec l’Europe).
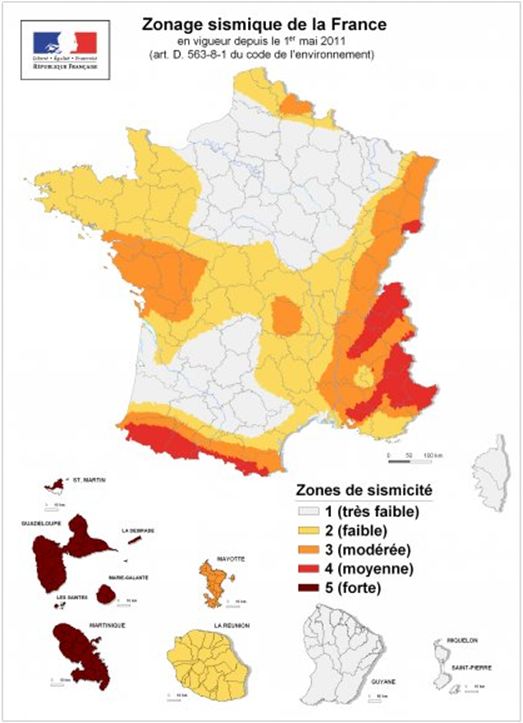
QUESTION 948 - Contrôle des eaux souterraines
Posée par Jean-Arsène JOSSEN, L'organisme que vous représentez (option) (ALLE, SUISSE), le 15/12/2013
Dans un ouvrage souterrain comme le projet de Bure, qui s'apparente à une mine, les eaux souterraines doivent être pompées en permanence. Lorsque le site sera abandonné à lui même il sera rapidement noyé et à plus ou moins long terme les différentes barrières artificielles seront détruites ou dégradées, conteneurs métalliques, scellements des galeries et remplissage à la bentonite. Tous les essais portent sur la barrière naturelle des argilites alors que c'est bien les barrières artificielles qui seront les maillons faibles du système et que c'est la garantie donnée sur l'élément le plus faible qui importe. Ceci est d'autant plus inquiétant que des aquifères importants sont situés au-dessus et au-dessous des argilites et qu'il y aura alors des risques réels de propagation de la pollution par les eaux souterraines, puis les eaux de surface. Comment pouvez-vous garantir sans risque de vous tromper que le système sera sans danger?
Réponse du 11/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Pendant l’exploitation du stockage, les eaux issues des couches de roche supérieures seront effectivement drainées et pompées jusqu’à la surface. A titre indicatif, le débit drainé par chacun des puits du Laboratoire souterrain est de l’ordre de 10 mètres cubes par jour en moyenne, ce qui est très faible par comparaison à certains sites miniers.
La fermeture du stockage comprendra plusieurs étapes. Les tunnel de stockage seront fermés par un scellement de faible perméabilité en argile gonflante (bentonite), argile naturelle connue pour sa capacité d’étanchéité. Des scellements seront également réalisés dans les galeries de liaison souterraines ainsi que dans les puits et les descenderies. Ces dispositions contribueront au maintien de conditions d’écoulements très lents dans l’installation et au confinement au plus près des déchets. Les phénomènes de resaturation après la fermeture seront très lents.
L’Andra met en œuvre un programme important d’essais sur les scellements. Il permettra d’apporter, lors de la demande d’autorisation de création de Cigéo, les éléments probants justifiant la faisabilité de ces scellements et une évaluation prudente de leur performance. Ainsi, l’essai Full Scale Seal, réalisé à l’échelle industrielle, fait partie du projet européen DOPAS (Demonstration Of Plugs And Seals) qui réunit quatorze organisations issues de huit pays européens et teste quatre concepts de scellement développés en Finlande, en Suède, en République Tchèque et en France.
Le stockage permet de garantir le confinement sur de très longues échelles de temps. Seuls quelques radionucléides mobiles et dont la durée de vie est longue pourront migrer jusqu’aux limites de la couche d’argile qu’ils atteindront après plusieurs dizaines de milliers d’années, puis potentiellement atteindre en quantités extrêmement faibles ensuite la surface et les nappes phréatiques. Leur impact radiologique serait alors plusieurs dizaines de fois inférieur à la radioactivité naturelle (qui est de 2,4 milliSievert par an en moyenne en France). Dans une démarche prudente, l’Andra dans son évaluation d’impact sur l’homme et l’environnement à long terme suppose que les eaux de nappes phréatiques au-dessus du stockage pourraient être captées par forage et utilisées pour des usages du type de ceux qui peuvent être pratiqués aujourd’hui (jardin, boisson, abreuvement des animaux). Les études montrent que l’impact du stockage, même en cas de défaillance des scellements, restera inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire et ne présentera pas de risque pour la santé.
QUESTION 947 - Pourquoi enfouir ces déchets si dangereux ?
Posée par Marie-Neige HOUCHARD, L'organisme que vous représentez (option) (DOMBASLE SUR MEURTHE), le 15/12/2013
Enfouir c'est oublier à jamais , quelque soit les précautions prises - ici et maintenant !!! Qui peut me garantir qu'il ne se produira aucun accident humain ou météorologique ..dans 200 ...350 ...500 ans ? Qui peut m'assurer qu'on a trouvé le moyen de communiquer pour les siècles à venir sur la teneur de ces déchets ? et de toutes les précautions indispensables à leur traitement ? Je suis tellement inquiète ! Pouvez vous me rassurer, s'il vous plait ?
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
Malgré la robustesse du stockage même en cas d’oubli, l’Andra conçoit Cigéo avec l’objectif d’en conserver la mémoire et de la transmettre aux générations futures le plus longtemps possible. Des solutions d’archivage de long terme existent pour les centres de stockage de surface exploités par l’Andra et font l’objet de revues périodiques. Le retour d’expérience montre que ces solutions paraissent robustes pour au moins les 500 premières années. Ainsi, pour Cigéo, l’Andra prévoit qu’un centre de la mémoire perdurera sur le site. Il pourra accueillir le public et comprendra notamment les archives du Centre.
De manière générale, le maintien de la mémoire doit aussi impliquer les acteurs locaux, qui peuvent prendre le relai en cas de défaillance de l’Andra ou de l’État. L’Andra veille d’ores et déjà à les informer sur les enjeux associés à la mémoire et étudie avec des anthropologues, des philosophes ou encore des artistes les facteurs qui peuvent favoriser la transmission de la mémoire. La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre. L’Andra a lancé en 2010 un programme d’études pour proposer des outils qui rendent cette transmission plus robuste sur une échelle de temps millénaire. Des pistes se dessinent tels des marqueurs de surface, mais aussi des rendez-vous réguliers à mettre en place au niveau des populations locales.
En tout état de cause, comme il est impossible de garantir notre capacité à communiquer avec des êtres vivant dans plusieurs milliers d’années, c’est chaque génération qui aura la responsabilité de contribuer à transmettre cette mémoire aux générations suivantes.
QUESTION 946 - Conséquences des rejets dans l'atmosphère et risques liés au volume des déchets
Posée par Robert FERNBACH, L'organisme que vous représentez (option) (HOUDELAINCOURT (MEUSE)), le 15/12/2013
La mise en exploitation d'un éventuel stockage de déchets hautement radioactifs va nécessiter la ventilation des galeries durant toute la durée de l'exploitation de CIGEO. Les populations locales seront soumises à un dégagement de radioactivité dans l'atmosphère durant un siècle, rejets de faible dose, inférieurs au seuil de danger, mais à très faible dose, sur un siècle, quelle incidence sur l'environnement, les cultures, les forêts, la population. L'OPE fournira-t-il ses mesures à la population, à quel rythme, sous le contrôle de quelle autorité ? Le fait de stocker, sur 15 ou 30 km2 l'ensemble des déchets HA et MAVL issus des 52 réacteurs actuellement en service, soit 98% de la radioactivité totale dans une couche soumise à des poussées tectoniques, n'y a-t-il pas un risque de rapprochement des colis entraînant le déclenchement d'une réaction chimique ou nucléaire ayant des effets incontrôlables.
Réponse du 13/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Si Cigéo est autorisé, il sera à l’origine de très faibles quantités de rejets radioactifs, pendant son exploitation, provenant pour la quasi-totalité d'émanation de carbone 14, tritium ou krypton 85 contenus dans certains colis de déchets de moyenne activité à vie longue. Ces rejets seront canalisés, mesurés et strictement contrôlés avant d’être relâchés dans l'atmosphère. L'Autorité de sûreté nucléaire fixera les limites autorisées pour ces rejets et en assurera un contrôle strict. Une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que leur impact serait de l’ordre de 0,01 milliSievert par an (mSv/an) à proximité du Centre, soit très largement inférieur à la norme réglementaire (1 mSv/an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv/an en moyenne en France).
Si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses Centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a déjà initié, au travers de l’Observatoire pérenne de l’environnement (OPE), la mise en place de cette surveillance de l’environnement. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Cet observatoire labellisé s’inscrit dans un grand nombre de réseaux scientifiques nationaux ou internationaux. Les résultats de la surveillance feront l’objet d’un rapport annuel rendu public et présenté à la Commission locale d’information. Par ailleurs, des mesures indépendantes pourront être diligentées par l’Autorité de sûreté nucléaire ou la Commission locale d’information pour confirmer les résultats.
L’intérêt montré par de nombreuses partie prenantes au travaux de l’OPE conduit l’Andra à réfléchir à élargir sa gouvernance en incluant une participation de la société civile. La démarche Apprios (« approche pluraliste pour la priorisation des substances ») constitue une première expérimentation en ce sens. Cette démarche a été mise en place au niveau national par l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) dans le cadre du plan national santé-environnement. L’objectif est la construction d'un outil de hiérarchisation des substances dont les rejets dans l'environnement doivent être gérés en priorité. Cette démarche est actuellement mise en œuvre par l’Andra en Meuse/Haute-Marne sur le milieu aquatique. C’est l’une des toutes premières fois que cette démarche est appliquée à un cas réel en France. Elle consiste demander à un panel composé d’experts mais également de représentants du public ou d’organisations professionnelles d’établir de façon concertée la liste des substances qu’il leur semblerait pertinent de suivre dans le cadre de l’OPE sur le long terme. Si cette première phase donne satisfaction au panel, il est prévu de continuer le travail de concertation progressivement sur les autres milieux (sol, air, …).
Concernant votre question relative au risque de criticité : la criticité correspond au déclenchement non contrôlé de fissions au sein de matières fissiles telles que l’uranium 235 ou le plutonium. Un tel risque ne peut survenir qu’en présence d’une concentration suffisante de matière fissile. Dans le stockage profond, les déchets contiennent des quantités faibles de matières fissiles. Le risque de criticité est cependant systématiquement évalué par précaution, et il est vérifié que la géométrie des colis et leur disposition dans le stockage excluent tout risque de criticité.
QUESTION 945 - Tout est prévu ?
Posée par Eve CHARRIER, L'organisme que vous représentez (option) (CHARENTE MARITIME), le 15/12/2013
Comment prendre un tel risque aujourd'hui en hypothéquant l'avenir, face à toutes les catastrophes qui pourraient subvenir ? Aucune liste ne peut être exaustive à ce sujet, les risques sont immenses et on ne peut être sûr à 100% d'avoir envisagé et mis en place toutes les parades efficaces...que ferons nous après avoir joué à l'apprenti sorcier...quand la catastrophe sera là ?
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 944 - Pourquoi l'ANDRA ou les acteurs du nucléaire banalisent-ils le nucléaire et ses conséquences ?
Posée par guy FOUILLOUZE, L'organisme que vous représentez (option) (SAINT-SERNIN DU PLAIN), le 15/12/2013
Présent à une conférence du directeur adjoint de l'ANDRA à l'IUT de Chalon sur Saône en novembre, je suis étonné qu'un responsable de ce niveau tienne un discours lénifiant à l'assemblée, en minimisant et en banalisant les rejets de gaz et de radionucléides qui s'échapperont du centre de stockage en projet. Comment le croire, quand il ose affirmer que le taux de radioactivité naturelle ne sera pas dépassé...!
Réponse du 21/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’Andra ne souhaite pas tenir des discours lénifiants mais dire les choses comme elles sont. Toutes les personnes qui travaillent à l’Andra partagent une même valeur : la responsabilité. Nous sommes responsables de la sûreté de nos installations. Nous sommes également responsables devant les générations futures.
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 943 - pourquoi ne pas ...
Posée par yves THOUVENEL, L'organisme que vous représentez (option) (JURY ( MOSELLE )), le 15/12/2013
entreposer les déchets dans la grotte des demoiselles qui n'a pas bougé depuis des millions d'années , à preuve les stalactites et stalagmites qui s'y sont formées ?
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le stockage profond devant assurer la protection de l’homme et de l’environnement sur le très long terme, ce sont les caractéristiques géologiques qui sont considérées pour la recherche de site. Ainsi, le choix du site de Meuse/Haute/Marne est le résultat de nombreuses années de recherches scientifiques et de reconnaissances géologiques qui ont permis de démontrer qu’il présentait des caractéristiques favorables à l’implantation d’un tel stockage. Suite au vote de la loi de 1991, des recherches ont été menées en France pour implanter un laboratoire souterrain. Plusieurs sites se sont portés candidats et ont été étudiés, dont les départements de Meuse et de Haute-Marne. En 1999, après l’évaluation scientifique du site, la consultation des collectivités locales et une enquête publique, le Gouvernement a autorisé l’Andra à construire un laboratoire souterrain à la limite entre les deux départements de Meuse et de Haute-Marne pour étudier la couche d’argile du Callovo-Oxfordien. En s’appuyant sur l’ensemble des recherches menées sur le site depuis 1994, l’Andra a montré qu’il présente des caractéristiques favorables pour assurer la sûreté à long terme du stockage. La Commission nationale d’évaluation mise en place par le Parlement pour évaluer sur le plan scientifique les travaux de l’Andra souligne ainsi dans son rapport 2012 : « le site géologique de Meuse/Haute-Marne a été retenu pour des études poussées, parce qu’une couche d’argile de plus de 130 m d’épaisseur et à 500 m de profondeur, a révélé d’excellentes qualités de confinement : stabilité depuis 100 millions d’années au moins, circulation de l’eau très lente, capacité de rétention élevée des éléments ».
QUESTION 941 - Quels sont les risques d'un tel projet?
Posée par Laura BIEWESCH, L'organisme que vous représentez (option) (TOULOUSE), le 15/12/2013
Quels sont les risques d'un tel projet en surface et en profondeur (contamination de l'eau, des sols, etc) ? Est-on sûr de maitriser ces techniques d'enfouissement sur le long terme ? Qui sera responsable dans un siècle s'il y a un problème ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 940 - De quel droit ?
Posée par Monique OBERLÉ, L'organisme que vous représentez (option) (ST DIÉ), le 15/12/2013
De quel droit enfouir les nucléaires radioactifs dans notre terre nourricière ? Je m'inquiète et pense aux générations à venir. Il est urgent de contrôler notre consommation d'énergie en arrêtant tous les abus. Je crains une catastrophe.
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Toutes les personnes qui travaillent à l’Andra partagent une même valeur : la responsabilité. Nous sommes responsables de la sûreté de nos installations. Nous sommes également responsables devant les générations futures. La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestions sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
Enfin, il n’appartient pas à l’Andra de se positionner sur la politique énergétique de la France. Son travail est de s’assurer que, quels que soient les choix énergétiques futurs, notre génération propose aux générations suivantes une solution permettant de mettre définitivement en sécurité les déchets produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles.
QUESTION 939 - Dimension des alvéoles
Posée par Grünberg WLADIMIR, L'organisme que vous représentez (option) (SAINT AUBIN SUR GAILLON), le 15/12/2013
Les alvéoles concernant les déchets HAVL, prévues par l'ANDRA dans le dossier du maître d'ouvrage soumis à l'examen du public (page 42) donnent le chiffre de 70cm de diamètre et d'une CENTAINE de mètres de longueur. Or le rapport de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques écrit par les députés Bataille et Birraux rappelle bien (page 235) que les économies réalisables (visées par les industriels) portent sur le creusement des galeries. Le rapport mentionne que "la longueur des alvéoles destinées aux déchets de haute activité est limitée à QUARANTE mètres, dimension dont la faisabilité est DEMONTREE" Pourquoi ce passage de 40m à plus de 100m ? Si on n'a pas démontré, par un test à la même profondeur, au même endroit que la sécurité n'est pas sacrifiée, et ce, AVANT que soit demandée par l'ANDRA l'autorisation de démarrer le projet, cela ne revient-il pas à donner un feu vert administratif à un projet sans s'assurer qu'il ne présente pas le danger qu'il prétendait éviter aux générations futures ? Pourquoi ne dit-on nulle part que l'on vise à utiliser un tunnelier, parce que beaucoup plus rapide, et donc plus rentable, nonobstant le fait qu'on considérait cela comme risqué dans les études préalables ? Les considérations économiques l'ont elles donc emporté sur toutes celles tentant de préserver plus ou moins la sécurité de ceux qui viendront après nous ?
Réponse du 07/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Pour que la création de Cigéo puisse être autorisée, l’Andra devra démontrer à l’Autorité de sûreté nucléaire la sûreté de l’installation et sa faisabilité.
Un essai a été réalisé en 2012 au Laboratoire souterrain pour démontrer la faisabilité du creusement d’alvéoles de stockage de 100 mètres de longueur pour les déchets HA. Des essais de mise en place et de retrait de colis ont également été réalisés en surface sur des alvéoles de cette longueur.
La méthode de creusement au tunnelier est très largement utilisée depuis plus de 20 ans pour réaliser des tunnels. L’Andra étudie les dispositions à mettre en œuvre pour utiliser ce procédé dans le contexte géologique particulier étudié pour le stockage en Meuse/Haute-Marne. Un programme d’essais au Laboratoire souterrain est en cours pour tester la mise en place de voussoirs.
Le cadre législatif et réglementaire qui s’applique à l’Andra est très clair et donne la priorité à la sûreté. Outre les limites strictes imposées par les textes, ceux-ci imposent également aux exploitants d’abaisser autant que possible le niveau d’exposition des populations au-delà des limites fixées par la réglementation. L’Andra, comme tous les exploitants, est soumise à ces exigences réglementaires, qui sont de plus complètement cohérentes avec sa mission, qui est de mettre en sécurité les déchets radioactifs, afin de protéger l’homme et l’environnement sur le long terme.
QUESTION 938 - Démocratie
Posée par BARBIER ALICE, L'organisme que vous représentez (option) (LA BOLLÈNE VÉSUBIE), le 15/12/2013
De quel droit mettez-vous nos vies ou notre santé en danger, par la production de déchets radioactifs dont on ne sait que faire ? Vous ne pouvez garantir qu'il n'y aura aucun tremblement de terre avant la fin de la radioactivité de ces éléments. Comment protégerez-vous les personnes, ou les dédommagerez vous si elles doivent quitter les lieux ?
Réponse du 31/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Toutes les personnes qui travaillent à l’Andra partagent une même valeur : la responsabilité. Nous sommes responsables de la sûreté de nos installations. Nous sommes également responsables devant les générations futures. La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs est au cœur des préoccupations du projet Cigéo. Les déchets dont il est question ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
Ainsi, l’objectif du stockage profond est donc de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France). Il n’est donc pas question d’évacuer les personnes, parmi lesquelles les personnes qui travaillent sur le site, qui vivront à proximité de Cigéo.
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
En ce qui concerne le risque sismique, le site d’implantation de Cigéo (située à l’Est du Bassin de Paris) est à l’écart des zones actives où se produisent les jeux de failles qui absorbent le rapprochement des continents Afrique et Europe. Les mouvements tectoniques de grande amplitude et forts séismes qui en découlent se localisent pour l’essentiel en Méditerranée et dans les chaines de montagnes qui la bordent, et pour le reste (résidu) au niveau des grandes failles qui affectent la plaque européenne, comme les failles du fossé d’Alsace et des Vosges en bordure Est du bloc stable que constitue le Bassin de Paris. Ce dernier compte parmi les régions les plus stables du globe. Il est quasiment asismique avec des taux de déformations extrêmement faibles à l’échelle des temps géologiques, comptés en millions d’années.
L’analyse des directions et vitesses de déplacements relatifs des stations GPS installées en Europe, confirme que le Bassin de Paris constitue un bloc rigide et que les déformations (de faible amplitude) se font à ses frontières, comme le souligne la répartition des séismes. En conséquence, seules les failles majeures qui existent déjà sont susceptibles de glisser, avec des mouvements de très faible amplitude, par à-coups séparés dans le temps par plusieurs dizaines à centaines de milliers d’années.
C’est ainsi que la zone de 30 km² étudiée pour l’implantation de l’installation souterraine est, au plus proche, à 1,5 km du fossé de Gondrecourt, et à 6 km du segment le plus proche du système des failles de la Marne (le fossé de la Marne étant lui-même est à 14 km). Les analyses cartographiques montrent l’absence de mouvements de ces failles au cours des derniers millions d’années. Les derniers mouvements tectoniques du fossé de Gondrecourt datent de 20 à 25 millions d’années (datations de cristaux de calcite) ; les derniers mouvements des failles de la Marne sont du même âge ou plus anciens. La réalisation d’une écoute sismique dont le seuil de détection est très bas, et qui discrimine sans ambiguïté séismes naturels et tirs de carrières, permet d’affirmer l’absence de toute activité sur ces failles. En accord avec la réglementation en vigueur concernant la sûreté des installations nucléaires, les ouvrages de stockage sont toutefois dimensionnés pour résister aux séismes maxima physiquement possibles que pourraient générer ces failles si elles redevenaient actives dans le futur.
QUESTION 937 - Mépriser le futur
Posée par françois-xavier LOUIS, L'organisme que vous représentez (option) (BIARRITZ), le 15/12/2013
N'est-ce pas un mépris (criminel ?) de ceux qui nous succéderont (dans 100, 1000, 10 000, etc. ans) que de risquer leur environnement, leur santé et leur vie du haut de nos faibles connaissances actuelles et au prétexte de satisfaire égoïstement à des petits quotidiens cupides et mesquins ? N'en avons-nous, donc, jamais assez d'étaler ainsi notre médiocrité aux générations futures ?
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
Où voyez-vous un mépris des générations futures dans le fait de vouloir mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas leur en faire porter la charge ? Car c’est l’objectif du stockage géologique.
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
QUESTION 936 - Quels sont les risques de perte de confinement ?
Posée par Philippe CLAVIERE, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 15/12/2013
Quels sont les risques de perte de confinement qui seraient dûs aux risques de sismicité, de mouvement de terrain, de pénétration d’eau et du comportement de l'argilite en présence d'eau ?
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
La stabilité et la très faible sismicité de la zone d’implantation du laboratoire souterrain est confirmée par les scientifiques qui ont travaillé sur ce site depuis plus de 20 ans. Le site de Meuse/Haute-Marne appartient à un domaine géologique stable (voir carte), particulièrement favorable pour l’installation d’un stockage. L’activité sismique est en effet extrêmement faible, comme le prouvent les enregistrements de sismicité instrumentale (écoute sismique depuis 1961 à l’échelle de la France) qui sont capables de détecter des microséismes, et les chroniques historiques (séismes ayant été ressentis et/ou ayant occasionné des dégâts au cours des derniers 1 000 ans). Au-delà de ces données, la stabilité et la très faible sismicité du site s’expliquent par sa situation géographique dans le bassin parisien qui est protégé des mouvements liés à la tectonique des plaques (collision du continent africain avec l’Europe).
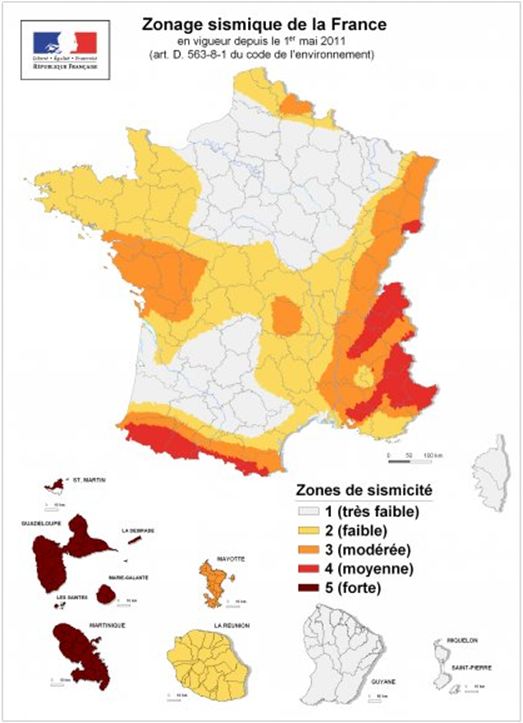
Concernant l’eau et l’argilite
Pendant l’exploitation du stockage, de nombreuses mesures seront prises pour prévenir d’éventuelles arrivées d’eau accidentelles dans Cigéo :
- Protection des puits et de la descenderie contre les intempéries,
- Etanchéification des puits et des descenderies au niveau des couches de roche aquifères traversées au-dessus de la couche d’argilite,
- Systèmes de drainage des eaux issues des couches de roche supérieures peu productives et pompage de ces eaux jusqu’à la surface,
- Protection des canalisations d’eau interne et mécanismes de fermeture automatique en cas de rupture.
Ces dispositions sont largement éprouvées dans l’industrie minière.
Par précaution, des scénarios accidentels d’arrivées d’eau (par exemple suite à la défaillance d’une canalisation ou suite à une panne dans le système de drainage des eaux provenant des couches de roche supérieures) sont pris en compte dans les études de sûreté menées pour Cigéo, au même titre que pour n’importe quelle installation nucléaire. Compte tenu des origines possibles, ce débit sera nécessairement limité (pour mémoire le débit drainé par chacun des puits du Laboratoire souterrain est de l’ordre de 10 m3/jour en moyenne, ou moins, ce qui est très faible par comparaison à certains sites miniers). Un tel évènement resterait très localisé dans le stockage et n’aurait qu’un effet très limité sur l’argile qui sera protégée par les revêtements. En tout état de cause, ce type d’incident ne remettra pas en cause la sûreté du stockage.
Après la fermeture du stockage, au-delà de la durée de vie des ouvrages industriels, la couche d’argile très peu perméable, de plus de 130 mètres d’épaisseur, dans laquelle sera installé le stockage souterrain, servira de barrière naturelle pour retenir les radionucléides contenus dans les déchets et freiner leur déplacement. Le stockage permet ainsi de garantir leur confinement sur de très longues échelles de temps. Seuls quelques radionucléides mobiles et dont la durée de vie est longue pourront migrer jusqu’aux limites de la couche d’argile qu’ils atteindront après plusieurs dizaines de milliers d’années, puis potentiellement atteindre en quantités extrêmement faibles ensuite la surface et les nappes phréatiques, après plus de 100 000 ans. Leur impact radiologique serait alors plusieurs dizaines de fois inférieur à la radioactivité naturelle (qui est de 2,4 mSv par an en moyenne en France).
QUESTION 935 - Quel est le potentiel géothermique réel de Bure ?
Posée par Philippe CLAVIERE, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 15/12/2013
Quel est le potentiel géothermique réel de Bure ?
Réponse du 27/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Comme partout ailleurs en France, la géothermie dite de surface (qui permet d’alimenter des maisons individuelles et des immeubles collectifs ou tertiaires via des pompes à chaleur) est réalisable localement. L’exploitation de ces ressources en surface ne serait d’ailleurs pas incompatible avec Cigéo, même au droit des installations souterraines de Cigéo, qui seraient situées à 500 mètres de profondeur.
La géothermie profonde nécessite des investissements importants et est aujourd’hui mise en œuvre dans les zones avec à la fois des conditions géologiques favorables et des perspectives d’utilisation importante de la chaleur extraite. Concernant les conditions géologiques, un forage à 2000 mètres de profondeur dans les grès du Trias (Forage EST 433, Montiers-sur-Saulx) a été réalisé lors d’une campagne de reconnaissance menée en 2007-2008 afin de mesurer le potentiel du site. Les caractéristiques habituellement recherchées pour déterminer s’il existe un potentiel géothermique (salinité, température et productivité) ont été mesurées. Il en ressort que le sous-sol dans la zone étudiée pour l’implantation de Cigéo ne présente pas un caractère exceptionnel en tant que ressource potentielle pour une exploitation géothermique profonde. Dans son rapport n°4 de juin 2010, la CNE aboutit aux mêmes conclusions : « Le trias de la région de Bure ne représente pas une ressource géothermique potentielle attractive dans les conditions technologiques et économiques actuelles. »
Par précaution, l’Andra a tout de même envisagé que l’on puisse exploiter le sous-sol au niveau du stockage et qu’une intrusion puisse avoir lieu. Les analyses ont montré que même dans ce cas, le stockage conserverait de bonnes capacités de confinement. Comme dans le dossier 2005, l’Andra présentera dans le dossier de demande d’autorisation de création de tels scénarios d’intrusion, incluant des doublets de forage comme ceux pratiqués pour l’exploitation de la géothermie.
Enfin, même si le sous-sol de Bure ne présente aucun caractère exceptionnel, il est tout à fait possible de réaliser des projets de géothermie profonde dans la région en dehors de l’installation souterraine de Cigéo (qui serait implantée à l’intérieur d’une zone de 30 km²).
QUESTION 934 - Pourquoi les nucléocrates de la France sont tellement pressé ?
Posée par Irma NIJENHUIS, L'organisme que vous représentez (option) ( LUBERSAC), le 15/12/2013
Nulle part au monde les gouvernements des états nucléaires ont pu réaliser l'enfouissement des déchets hautement radioactifs. Ces gouvernements repoussent leurs programmes à enfouir même plusieurs fois. J'ai toute une liste des délais, jusque à 50 ans, avant que ces pays décident à enfouir les déchets HA-VL….OU PAS !!! Ad interim les déchets doivent rester sur place, où ils sont produits, bien contrôlés et surveillés. Les transports radiants et la concentration de tout ces déchets à seulement un endroit comme le propose CIGéo, va générer une catastrophe nucléaire...ou même plusieurs... en France !!! Alors: POURQUOI PAS UN GRAND MORATOIRE POUR CIGéo ??? Et : POURQUOI LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS A CETTE HÂTE AVEC SON PROGRAMME D'ENFOUISSEMENT ???
Réponse du 21/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le stockage est aujourd’hui considéré dans tous les pays comme la meilleure solution pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter leur charge sur les générations suivantes. Aux Etats-Unis, le WIPP (Waste Isolation Pilot Plant) stocke depuis une dizaine d’années, à environ 700 m de profondeur dans une formation géologique de sel, des déchets de moyenne activité à vie longue (MA-VL) issus des activités de défense américaines. En Finlande et en Suède, les demandes d’autorisation de création de centres de stockage dans le granite pour les combustibles usés sont en cours d’instruction. De nombreux autres pays mènent également des recherches en vue de la mise en œuvre d’un stockage profond (Allemagne, Belgique, Canada, Chine, Japon, Royaume-Uni, Suisse…). L’Union européenne considère également que le stockage géologique constitue actuellement la solution la plus sûre et la plus durable en tant qu’étape finale de la gestion des déchets de haute activité (directive européenne du 19 juillet 2011).
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestions sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
Aujourd’hui, la décision de créer Cigéo n’est pas encore prise. L’Andra a justement souhaité que le débat public intervienne en 2013, quand le projet n’est pas encore finalisé, pour prendre en compte le débat public dans la suite de ses études en vue d’établir le dossier de demande d’autorisation de création du centre de stockage. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra à l’État après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé le dossier support à la demande de création de Cigéo. Ce processus comprendra notamment une évaluation de sûreté par l’Autorité de sûreté nucléaire et une évaluation scientifique par la Commission nationale d’évaluation, l’avis des collectivités territoriales, le vote d’une nouvelle loi fixant les conditions de réversibilité et une enquête publique.
QUESTION 933 - Pourquoi l'industrie nucléaire est-elle une industrie privilégiée ?
Posée par Philippe CLAVIERE, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 15/12/2013
Pourquoi l'industrie nucléaire est-elle une industrie privilégiée ?
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
La part de nucléaire dans le mix électrique en France est proche de 75%. Il s’agit du résultat du choix de la politique énergétique fait par la France depuis plus de 30 ans.
Le Président de la République a décidé d’engager la transition énergétique, cette transition reposant d'une part sur la sobriété et l’efficacité énergétique, et d'autre part sur la diversification des sources de production et d'approvisionnement.
Concernant la diversification de nos sources d’énergies, le Président de la République a fixé un cap : réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% d'ici 2025. Parallèlement, le Président de la République a indiqué que la transition énergétique serait fondée sur deux principes : l'efficacité énergétique d'une part, et la priorité donnée aux énergies renouvelables d'autre part. Cette mutation prendra du temps et supposera des étapes d’évaluation en fonction des progrès technologiques et scientifiques et des prix relatifs de chaque source d’énergie.
QUESTION 932 - l'enfouissement, une solution pérenne ?
Posée par Corine FAUGERON, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 15/12/2013
Que préconisez-vous pour résoudre de manière juste et pérenne la question des déchets nucléaires et radioactifs?
Réponse du 06/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestions sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 931 - Quelles sont les menaces réelles pour l'économie régionale ?
Posée par Philippe CLAVIERE, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 15/12/2013
Quelles sont les menaces réelles pour l'économie régionale : l’image des productions agricoles intensives, l’image des productions bio, l'impact sur le champagne, sur le fromage Brie de Meaux, sur les eaux de Vittel et de Contrexéville, sur le tourisme, sur l'immobilier ?
Réponse du 10/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Cigéo est conçu pour protéger l’Homme et l’environnement. L’impact du centre en termes de radioactivité sera très inférieur à celui de la radioactivité naturelle et n’aura donc aucun impact sur la qualité des productions agricoles. L’Andra a créé l’Observatoire pérenne de l’environnement, qui a pour mission d’assurer un suivi détaillé de l’évolution de l’environnement du stockage. Cela permettra de lever ainsi toute inquiétude en démontrant que le stockage n’a pas d’impact sur les activités agricoles de proximité. Cet observatoire labellisé s’inscrit dans un grand nombre de réseaux scientifiques nationaux ou internationaux. Par ailleurs, le retour d’expérience de la présence de l’Andra dans l’Aube depuis 20 ans montre que l’implantation d’un centre de stockage de déchets radioactifs n’est en aucun cas incompatible, même en termes d’image, avec des activités agricoles de premier choix (lait, viande, légumes, viticulture...). L'industrie et l’agriculture ont toujours coexisté et de nombreuses installations industrielles y compris nucléaires sont installées en France à proximité de zones de production agricoles dont des zones géographiques protégées ou encore des zones d'appellation contrôlée.
Au contraire, Cigéo est un projet industriel structurant pour son territoire d’accueil car au-delà de l’emploi généré par son activité, il contribuera au développement de l’activité des entreprises locales et, grâce à la garantie d’une activité sur plus d’un siècle, certaines entreprises feront très vraisemblablement la démarche de s’implanter localement, créant à leur tour une activité nouvelle sur le territoire.
QUESTION 930 - Quelles solutions pour les déchets nucléaires
Posée par Corine FAUGERON, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 15/12/2013
Vous est-il possible d'affirmer que l'enfouissement de ces déchets ne présente aucun risque à la fois pour les populations, pour l'agriculture et les nappes phréatiques ?
Réponse du 31/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le risque zéro n’existe pas et l’Andra ne prétend pas que le projet Cigeo ferait exception à la règle.
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestions sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 929 - Quel compte a-t-il été tenu de la pétition de 40.000 signatures contre le projet ?
Posée par Philippe CLAVIERE, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 15/12/2013
Quel compte a-t-il été tenu de la pétition de 40.000 signatures contre le projet ?
Réponse du 10/02/2014,
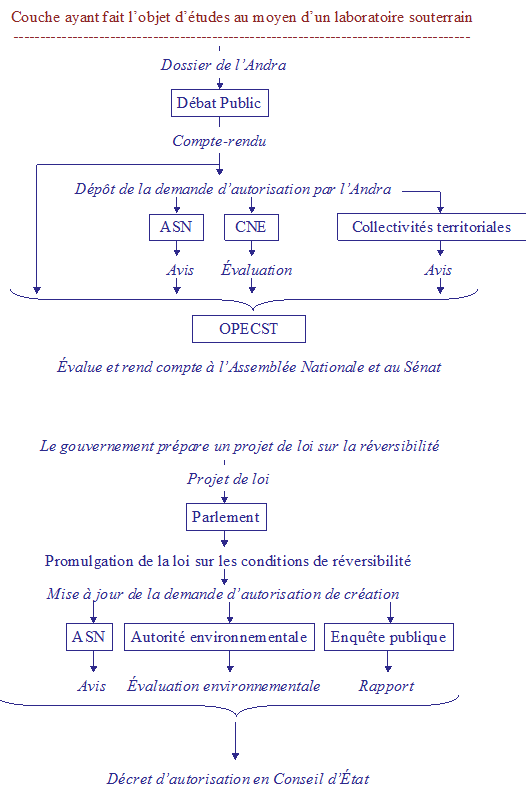
REPONSE APPORTEE PAR LA CPDP :
Lors de la réunion publique organisée à Bar-le-Duc des représentants élus ont remis au président de la CPDP une pétition ancienne ayant recueilli à l’époque plusieurs milliers de signatures. Cette remise solennelle sera mentionnée au compte rendu de la CPDP.
RÉPONSE APPORTÉE LE MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE :
Dans votre question, vous mentionnez une pétition réalisée en Meuse et en Haute-Marne demandant la réalisation d’un référendum dans les deux départements. Les résultats de cette pétition ont été remis officiellement au président de la Commission Particulière du Débat Public le 17 juin 2013 à Bar-le-duc, dans le cadre du débat public de Cigéo.
Plusieurs procédures de consultation sont organisées afin de recueillir l’avis des populations locales et nationales - directement ou par le biais des instances chargées de les représenter - (débat public, avis des collectivités territoriales, enquête publique).
Le Parlement fixe périodiquement les choix relatifs à la mise en œuvre de ce projet :
- loi du 30 décembre 1991, dite loi « Bataille », fixant un programme d’études et recherches de 15 années d’études et recherches sur les déchets radioactifs ;
- loi du 28 juin 2006, définissant le stockage géologique profond comme solution de référence pour les déchets les plus radioactifs et demandant sa mise en service en 2025 ;
- loi à venir sur la réversibilité du projet.
En outre, l’Etat est en contact permanent avec les parties prenantes locales. Un important travail de concertation a été mené, notamment avec les exécutifs locaux, pour élaborer un projet de schéma interdépartemental du territoire.
L’avis des populations locales au travers des procédures de consultation et l’expression de leurs représentants au Parlement est primordiale.
QUESTION 928 - Comment oser faire confiance en des modèles mathématiques ?
Posée par Philippe CLAVIERE, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 15/12/2013
Comment oser faire confiance en des modèles mathématiques ?
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
De manière générale, la démarche scientifique se fonde sur l’observation, puis sur l’expérimentation et enfin sur la modélisation et la simulation numérique qui permettent d’extrapoler des résultats à des échelles inaccessibles via l’expérimentation. Le propre des sciences de la Terre et de l’Univers est que les observations permettent d’appréhender des phénomènes qui se déroulent sur de très longues durées. Cette démarche scientifique est au cœur des études menées par l’Andra depuis une vingtaine d’années pour étudier la faisabilité du stockage profond. Pour mener ces recherches, l’Andra mobilise la communauté scientifique dans de nombreuses disciplines (sciences de la Terre et de l’environnement, chimie, science des matériaux, mathématiques appliquées…) au travers de partenariats avec des organismes de recherche et des établissements universitaires français, ainsi qu’au moyen de coopérations internationales.
Les recherches menées depuis 1994 sur le site étudié en Meuse/Haute-Marne ont permis aux scientifiques de reconstituer de manière détaillée son histoire géologique, depuis plus de 150 millions d’années. Le site étudié se situe dans la partie Est du bassin de Paris qui constitue un domaine géologiquement simple, avec une succession de couches de calcaires, de marnes et de roches argileuses qui se sont déposées dans d’anciens océans. Les couches de terrain ont une géométrie simple et régulière. Cette zone géologique est stable et caractérisée par une très faible sismicité. La couche argileuse étudiée pour l’implantation éventuelle du stockage, qui s’est déposée il y a environ 155 millions d’années, est homogène sur une grande surface et son épaisseur est importante (plus de 130 mètres).
Aucune faille affectant cette couche n’a été mise en évidence sur la zone étudiée.
Cette analyse s’appuie sur des investigations géologiques approfondies : plus de 40 forages profonds ont été réalisés, complétés par l’analyse de plus de 300 kilomètres de géophysique 2D et de 35 km² de géophysique 3D. Environ 50 000 échantillons de roche ont été prélevés.
La roche argileuse a une perméabilité très faible, ce qui limite fortement les circulations d’eau à travers la couche et s’oppose au transport éventuel des radionucléides par convection (c’est-à-dire par l’entraînement de l’eau en mouvement). Cette très faible perméabilité s’explique par la nature argileuse, la finesse et le très petit rayon des pores de la roche (inférieur à 1/10 de micron). L’observation de la distribution dans la couche d’argile des éléments les plus mobiles comme le chlore ou l’hélium confirme qu’ils se déplacent majoritairement par diffusion et non par convection. Cette « expérimentation », à l’œuvre depuis des millions d’années, confirme que le transport des éléments chimiques se fait très lentement (plusieurs centaines de milliers d’années pour traverser la couche). Ces durées de transport constatées sont cohérentes avec celles estimées par simulation.
Les expérimentations menées au Laboratoire souterrain permettent également d’étudier l’impact de la construction et de l’exploitation d’un stockage sur le milieu géologique : impact lié au creusement des galeries, à l’introduction de matériaux exogènes tels que l’acier ou le béton, à l’effet de la chaleur générée par les déchets les plus radioactifs... La conception de Cigéo vise à limiter les perturbations engendrées et l’étude des processus physiques et chimiques permet de vérifier que ces perturbations induites sur la roche restent limitées. Elle fournit également des orientations pour la conception du stockage. L’Andra met également en place des démonstrateurs dans le Laboratoire souterrain, qui permettent notamment de comparer avec les résultats prévus par les simulations (par exemple la répartition du champ de température autour d’une alvéole simulant le stockage de déchets de haute activité) et de s’assurer que les prévisions des modèles sont cohérentes avec ce que l’on observe. Si Cigéo est autorisé, cette démarche sera poursuivie lors de la réalisation progressive du stockage.
Outre l’expérimentation, la validation des modèles passe également par l’étude d’analogues archéologiques ou naturels. Les laitiers de haut-fourneau du XVIe siècle, les blocs de verre issus d’épaves datant de l’Antiquité ou encore les verres basaltiques constituent par exemple des analogues du système « verre/métal/argile » soumis à une altération par l’eau. Bien que la composition chimique et les conditions d’altération de ces verres ne soient pas strictement identiques à celles des matrices utilisées pour vitrifier certains déchets radioactifs, leur étude permet de tester les modèles proposés et de progresser dans la compréhension des mécanismes d’altération. Concernant le comportement des radionucléides, les deux sites de réacteurs nucléaires naturels découverts à Oklo (Gabon) en 1972, celui de Bangombé en surface à 11 m de profondeur et celui d’Okélobondo à 420 m de profondeur, apportent des informations précieuses. Ces réacteurs naturels ont fonctionné il y a 2 milliards d’années, les conditions géologiques, et notamment la teneur du minerai en uranium 235, ayant provoqué une réaction en chaîne spontanée pendant plusieurs centaines de milliers d’années. Les travaux de caractérisation (analyses minéralogiques, chimiques et isotopiques) ont montré la très faible migration des radionucléides dans les conditions chimiques réductrices et en présence d’argile. Ils ont permis d’établir les mécanismes géochimiques qui ont prévalu à ce comportement et de tester les modèles de représentation associés.
La simulation numérique permet d’obtenir des résultats inaccessibles par l’expérience du fait de la complexité et de l’interaction des phénomènes à étudier ou des grandes échelles de temps et d’espace sur lesquelles ils se déroulent. Pour représenter les phénomènes que l’on veut étudier, on utilise des modèles physiques et mathématiques qui sont alimentés par des données acquises sur le terrain, en laboratoire et dans la littérature scientifique. Ces derniers servent à mener des expériences virtuelles qui, en temps réel, se dérouleraient sur des milliers à centaines de milliers d’années, ou à analyser des processus qui intéressent de très grands volumes de roche. Grâce aux outils qu’elle a développés, l’Andra peut étudier différents phénomènes liés, par exemple, à la chaleur, au déplacement de l’eau ou aux échanges chimiques et analyser comment les composants du stockage se comporteraient et évolueraient dans le temps. Ces modèles permettent également de tester des hypothèses de situations dégradées dans l’évolution du stockage. Les différents modèles ainsi que les codes de simulation numérique font l’objet d’inter-comparaisons. Cela contribue à la confiance dans leur validité et permet d’identifier le cas échéant les points de compréhension à approfondir. Ces travaux de comparaison sont menés à l’Andra et dans le cadre de projets internationaux. Les modèles proposés par l’Andra font également l’objet d’une évaluation indépendante par l’IRSN dans le cadre de l’instruction des dossiers de l’Andra. Cela concerne par exemple les modèles d’écoulements hydrogéologiques et de migration des radionucléides, qui sont au cœur des études de sûreté.
L’ensemble de ces travaux font l’objet de publications dans des revues à comités de lecture (50 à 70 publications scientifiques internationales par an depuis 10 ans) et sont évalués par des instances indépendantes, en particulier la Commission nationale d’évaluation, mise en place par le Parlement, et l’Autorité de sûreté nucléaire qui s’appuie sur l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Les grands dossiers scientifiques et techniques que l’Andra remet dans le cadre de la loi font l’objet, à la demande de l’Etat, de revues internationales sous l’égide de l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’OCDE. L’Andra a également été évaluée en 2012 par l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES). Enfin, des expertises sont régulièrement commandées par le Comité local d’information et de suivi du Laboratoire souterrain sur les grands dossiers de l’Andra ou sur des sujets plus ciblés.
C’est la convergence de l’ensemble de ces études qui permet d’apprécier la robustesse du stockage et de préciser les incertitudes résiduelles. L’analyse de sûreté intègre la connaissance acquise et les incertitudes afin de produire une évaluation pénalisante de l’impact du stockage. Les études menées par l’Andra ont montré que l’impact du stockage serait nettement inférieur à celui de la radioactivité naturelle à l’échelle du million d’années.
QUESTION 927 - Prévisibilité
Posée par Christopher POLLMANN, L'organisme que vous représentez (option) (METZ), le 15/12/2013
Bonjour, comment allez-vous organiser et garantir, pendant la durée de désintégration des matières nucléaires entreposées, la gestion, la protection et la mémoire du site ? Pouvez-vous vous appuyer sur l'exemple d'une société présente ou passée stable sur une aussi longue période ? Bonnes fêtes et bien cordialement, Christopher Pollmann, professeur agrégé de droit public, Université de Lorraine - Metz.
Réponse du 08/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif fondamental de Cigéo est de protéger l’homme et l’environnement des déchets radioactifs sur de très longues échelles de temps. La sûreté à long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. C’est une des raisons qui a conduit, en 2006, le Parlement à retenir la solution du stockage profond. En effet, cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli, contrairement à l’entreposage. En cas de perte complète de la mémoire du stockage, une intrusion inopinée à 500 mètres sous terre apparaît peu plausible, du moins sans un minimum d’investigations préalables. L’Andra évalue cependant par précaution dans son analyse de sûreté les conséquences d’un forage à travers le stockage pour vérifier que le stockage resterait sûr.
Malgré cette robustesse du stockage même en cas d’oubli, l’Andra conçoit Cigéo avec l’objectif d’en conserver la mémoire et de la transmettre aux générations futures le plus longtemps possible. Des solutions d’archivage de long terme existent pour les centres de stockage de surface exploités par l’Andra et font l’objet de revues périodiques. Le retour d’expérience montre que ces solutions paraissent robustes pour au moins les 500 premières années. Ainsi, pour Cigéo, l’Andra prévoit qu’un centre de la mémoire perdurera sur le site. Il pourra accueillir le public et comprendra notamment les archives du Centre.
De manière générale, le maintien de la mémoire doit aussi impliquer les acteurs locaux, qui peuvent prendre le relai en cas de défaillance de l’Andra ou de l’État. L’Andra veille d’ores et déjà à les informer sur les enjeux associés à la mémoire et étudie avec des anthropologues, des philosophes ou encore des artistes les facteurs qui peuvent favoriser la transmission de la mémoire. La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
L’Andra a lancé en 2010 un programme d’études pour proposer des outils qui rendent cette transmission plus robuste sur une échelle de temps millénaire. Des pistes se dessinent tels des marqueurs de surface, mais aussi des rendez-vous réguliers à mettre en place au niveau des populations locales.
En tout état de cause, comme il est impossible de garantir notre capacité à communiquer avec des êtres vivant dans plusieurs milliers d’années, c’est chaque génération qui aura la responsabilité de contribuer à transmettre cette mémoire aux générations suivantes.
QUESTION 926 - Comment pouvez-vous dire que vous maîtrisez...?
Posée par Philippe CLAVIERE, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 15/12/2013
...la qualité et la quantité exacte de tous les radioéléments que vous aurez enfouis, la vitesse de migration des radionucléides, le niveau de leur activité sur un million d’années, la réalisation et la tenue des scellements ?
Réponse du 10/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Concernant vos questions relatives aux radionucléides
La connaissance des quantités des différents radionucléides qui seront présents au sein du stockage et de l’évolution de leur radioactivité permet d’évaluer l’impact du projet de centre de stockage et de vérifier sa conformité aux règles de sûreté fixées par l’Autorité de sûreté nucléaire. Ainsi, les données correspondant aux études de faisabilité réalisées par l’Andra en 2005 sont détaillées dans le « Dossier 2005 argile - Référentiel de connaissance et modèle d’inventaire des colis de déchets à haute activité et à vie longue » (voir notamment les pages 318 à 331 dans lesquelles des bilans globaux sont présentés). Cet inventaire radiologique sera mis à jour pour élaborer le dossier de demande d’autorisation de création de Cigéo.
La radioactivité totale décroît en fonction de la période de chacun des radionucléides qui la compose. Après quelques siècles, seule la radioactivité des radionucléides dont la période est supérieure à quelques dizaines d’années demeure. Un exemple de courbe de décroissance sur un million d’années est donné à la page 199 du Rapport de synthèse 2012 de l’Inventaire national des matières et déchets radioactifs.
Seuls des radionucléides mobiles et à vie longue, plus particulièrement l’iode 129 et le chlore 36, parviendront à traverser la couche d’argile du Callovo-Oxfordien sur une durée d’un million d’années. Le transfert des radionucléides dans la couche du Callovo-Oxfordien se fera majoritairement par diffusion depuis le stockage, suivant notamment leurs caractéristiques de rétention (sorption) et de solubilité dans l’argilite : pour les radionucléides mobiles à vie longue, type iode 129, il faut de l’ordre de 300.000 ans pour atteindre la valeur maximale de flux (de l’ordre d’un millième de mole par an) aux limites de la couche d’argile (60 mètres au-dessus des alvéoles de stockage). Les études ont montré que l’impact du stockage sera inférieur à l’impact de la radioactivité naturelle.
Concernant votre question sur les scellements
Conformément à la demande des évaluateurs, l’Andra met en œuvre un programme d’essais pour apporter les éléments nécessaires à la démonstration de la faisabilité industrielle des scellements. En particulier, l’essai FSS (Full Scale Seal) vise à démontrer d’ici 2015 les modalités de construction d’un noyau à base d’argile gonflante et de massifs d’appui en béton en conditions opérationnelles. La qualité de réalisation de l’ouvrage est contrôlée. Le diamètre utile de l’ouvrage considéré est de 7,60 m environ. Compte tenu des contraintes opérationnelles que représente un ouvrage d’une telle taille, l’essai est réalisé en surface dans une « structure d’accueil » construite à cet effet. Des conditions de température et d’hygrométrie représentatives des conditions du stockage sont maintenues autour de l’essai et les conditions qui seraient induites par la réalisation d’un scellement en souterrain sont appliquées (ventilation et délai de transport du béton notamment) pour que cet essai soit représentatif des conditions de Cigéo. Les interfaces avec le revêtement laissé en place et les argilites dans les zones de dépose du revêtement sont représentées par des simulations d’alternances de portions de revêtement maintenues et déposées et de hors-profils (jusqu’à 1 m de profondeur) avec une surface représentative de la texture de l’argilite. Des massifs de confinement en béton bas pH sont également construits de part et d’autre du noyau avec deux méthodes distinctes (béton coulé et béton projeté). Cet essai fait partie du projet européen DOPAS (Demonstration Of Plugs And Seals) qui réunit quatorze organisations issues de huit pays européens et teste quatre concepts de scellement développés en Finlande, en Suède, en République Tchèque et en France.
QUESTION 925 - Quels sont les risques en profondeur ?
Posée par Philippe CLAVIERE, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 15/12/2013
Quels sont les risques en profondeur de la co-activité (ingénierie minière / ingénierie nucléaire), les risques d’accident de convoyage, de gerbage, les risques de chute de colis, les risques d’incendie, les risques d’explosion, les risques de criticité et comment garantir une double ventilation continue (minière et nucléaire) sur un siècle d'exploitation ?
Réponse du 17/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestions sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de déchets radioactifs. Grâce à la réversibilité, les générations suivantes garderont la possibilité de faire évoluer cette solution. Les rendez-vous proposés par l’Andra seront notamment alimentés par les résultats de la surveillance et par les recherches qui continueront à être menées sur la gestion des déchets radioactifs et les avancées technologiques. A chaque étape, il sera possible de décider de poursuivre le processus de stockage tel qu’initialement prévu ou de le modifier, par exemple si des solutions alternatives sont identifiées.
QUESTION 924 - Quels sont les risques en surface du transport des déchets ?
Posée par Philippe CLAVIERE, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 15/12/2013
Quels sont les risques en surface (irradiation, contamination de l'atmosphère, des sols et des nappes phréatiques) dûs à la circulation de 100.000 wagons remplis de déchets pendant 1 siècle et les impacts pour les riverains ?
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) :
La sûreté des transports de substances radioactives à usage civil est contrôlée en France par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), sur la base d’inspections et de l’instruction de demandes d’agrément d’emballages. Ce contrôle vise à assurer la protection des personnes et de l’environnement. Il porte sur la conception des emballages et les opérations de transports qui sont soumises à des contraintes réglementaires rigoureuses.
Les emballages doivent notamment assurer un confinement des substances radioactives transportées et fortement réduire le rayonnement à l’extérieur du colis.
De façon plus spécifique, le débit de dose à proximité du véhicule ne doit pas dépasser certains plafonds. En pratique, les niveaux relevés sont en général beaucoup plus faibles que ces plafonds. Même si ces plafonds étaient atteints, une personne devrait rester 10 heures à deux mètres du véhicule pour que le rayonnement reçu atteigne la limite annuelle d’exposition du public.
Concernant les risques en cas d’accident, les modèles de colis sont soumis à des épreuves réglementaires destinées à démontrer leur résistance lors du transport. Le niveau d’exigence de ces épreuves est proportionné à la dangerosité des substances transportées. À titre d’exemple, les modèles de colis correspondant aux substances les plus dangereuses doivent conserver leurs fonctions de sûreté, y compris en cas d’accident (simulé par une chute de 9 m sur une surface indéformable, une chute de 1 m sur un poinçon, un incendie d’hydrocarbure totalement enveloppant de 800° C minimum pendant 30 mn, une immersion dans l’eau à une profondeur de 200 m).
Les autorités se sont naturellement interrogées depuis plusieurs années sur le comportement des colis agréés dans des cas d’agressions allant au-delà de ces épreuves réglementaires décrites précédemment.
Des études ont été menées en France et à l’étranger, notamment par l’IRSN, AREVA, l’autorité allemande BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung) et le laboratoire national américain SANDIA, afin d’évaluer le comportement des colis contenant des substances radioactives dans des conditions réalistes d’impact mécanique et de feu et pouvant aller au-delà des sollicitations prévues par les épreuves réglementaires. Ainsi, la tenue de ces types de colis dans des conditions de feu plus contraignantes (en termes de durée et de température) et dans des conditions de chute plus contraignants (en matière de surface d’impact et de hauteur de chute) a été étudiée. Par exemple, une étude de l’IRSN consultable sur le site Internet de l’institut permet de comparer l’écrasement du colis sur une surface indéformable, comme prévu dans les épreuves réglementaires et sur des surfaces représentatives de cibles réelles : par exemple des sols en sable, argile ou des cibles métalliques représentatives de l’environnement des emballages durant le transport dont l’essieu de wagon et le longeron de wagon. Cette étude a montré que les colis considérés dans l’étude conserveraient leur capacité de confinement en cas d’accident réel et que leurs équipements additionnels (châssis et râtelier) ainsi que les cibles absorberaient une part importante de l’énergie d’impact et augmenteraient ainsi les marges de sûreté.
En France, aucun accident ferroviaire ayant impliqué des colis de combustible usé n’a à ce jour été relevé. Néanmoins, cette éventualité est envisagée par les pouvoirs publics.
Ainsi, la dernière ligne de défense de la sûreté des transports de substances radioactives repose sur les moyens d’intervention mis en œuvre face à un incident ou un accident. Les pouvoirs publics, l’ASN et les exploitants se préparent donc à la gestion des situations de crise impliquant un transport de substances radioactives à travers les plans ORSEC et au moyen d’exercices.
Réponse apportée par AREVA :
Les déchets radioactifs HA/MA-VL sont transportés dans des « emballages » de haute technologie et agréés par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN). Le retour d’expérience de plusieurs dizaines d’années confirme le haut niveau de sûreté mis en œuvre : aucun accident ayant eu des conséquences radiologiques n’est à déplorer. La résistance des emballages est testée en conditions extrêmes. En effet, pour les opérations de transport, la sûreté nucléaire repose d’abord sur l’emballage. Les emballages utilisés sont conçus pour assurer la protection des personnes et de l’environnement en toutes circonstances, tant dans des conditions normales que dans des situations accidentelles.
Les emballages destinés aux transports des déchets radioactifs de type HA/MA-VL sont conçus pour être étanches et le rester même en cas d’accident (collision, incendie, immersion…). Leur étanchéité maintenue même en situation extrême permet de prévenir le risque de contamination. Par ailleurs, ces emballages sont composés de plusieurs types de matériaux permettant de réduire les niveaux d’exposition aux rayonnements pour les rendre inferieurs aux limites fixées par la réglementation. Celle-ci établit que la quantité de rayonnements reçus par une personne qui resterait à 2 m du véhicule pendant une heure n’excède pas la limite de 0,1 mSv quel que soit le type de déchets transporté. A titre de comparaison, l’exposition moyenne annuelle de la population française à la radioactivité naturelle est de 2,4 mSv.
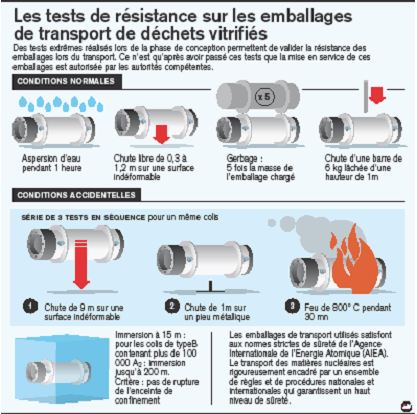
Les transports sont réalisés dans le cadre des réglementations internationales (AIEA, ADR, RID…) et nationales en vigueur. Ces réglementations sont établies en fonction de la nature de la matière transportée et du mode de transport utilisé. En France, l’ASN est responsable du contrôle de la sûreté des transports de substances radioactives pour les usages civils.
Le transport de substances radioactives est assuré par des sociétés spécialisées et autorisées par les autorités compétentes.
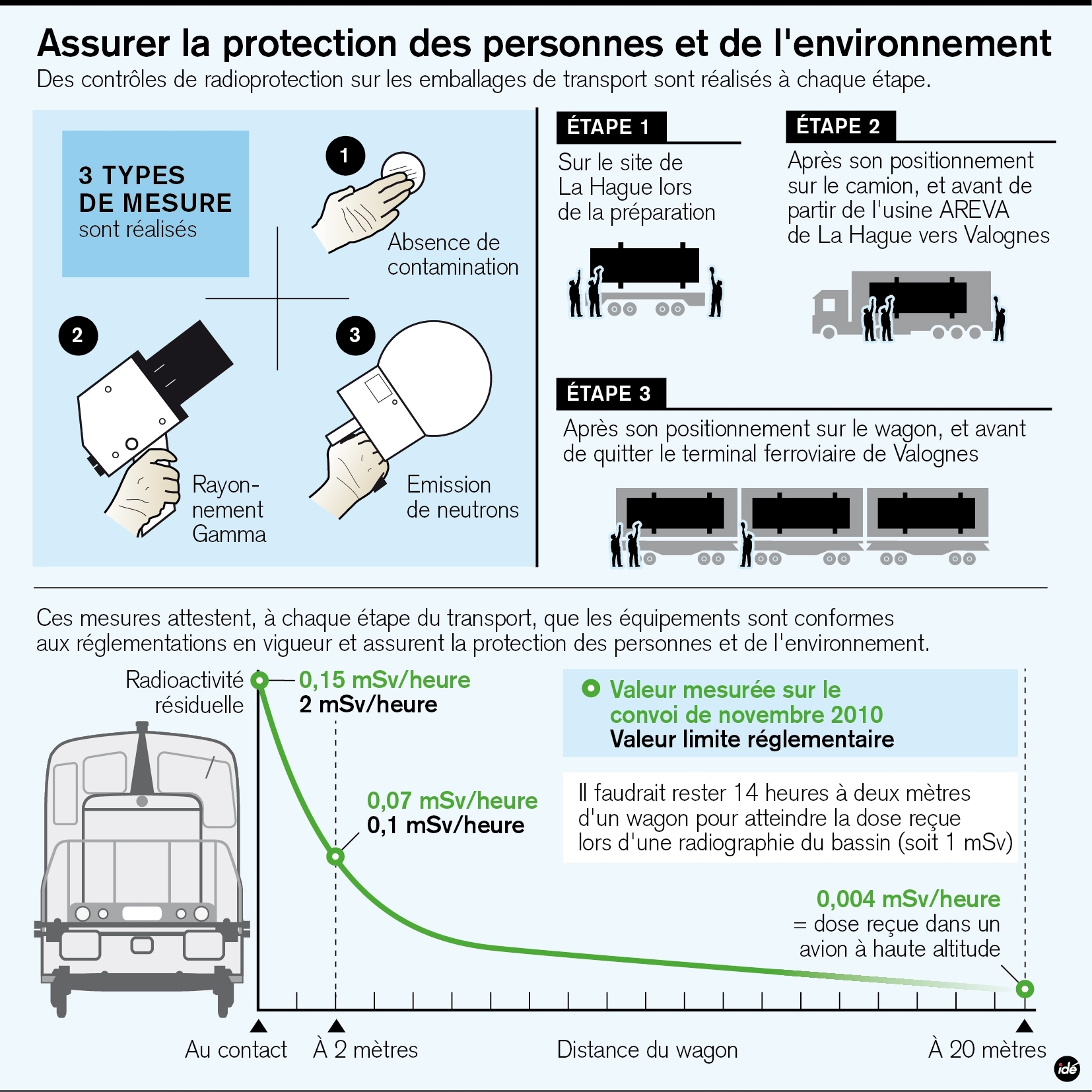
Le niveau de rayonnement et la non-contamination des emballages sont vérifiés par les exploitants et des organismes indépendants à chaque étape du transport, y compris lors de changements de modes de transport. Ces mesures attestent, à chaque étape du transport (cf. figure ci-contre), que les équipements sont conformes aux réglementations en vigueur et assurent la protection des personnes et de l’environnement. Elles peuvent être vérifiées à tout moment et sur le terrain par l’ASN. Le transport en toute sûreté de plus 6000 colis de déchets de Haute Activité et Moyenne activité à vie Longue, principalement par le rail illustre la maîtrise des risques de contamination et d’exposition aux rayonnements.
En complément de ce dispositif de prévention éprouvé, la France a mis en place un dispositif national pour gérer de potentiels accidents. Les autorités s’appuient sur les dispositifs mis en place dans le cadre des plans ORSEC et à leur déclinaison départementale. Les Préfectures sont averties par le Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle de Crises (COGIC) des transports transitant par leur département ; ce dernier assure, entre autres missions, sous l’autorité du Ministère de l’Intérieur, des responsabilités opérationnelles dans le domaine de la gestion et du suivi des transports. AREVA au travers de sa filiale AREVA TN dispose, par ailleurs, d’un plan d’urgence interne spécifique appelé PUI-T. Celui-ci couvre les phases d’alerte, d’analyse de la situation et d’intervention sur le terrain suite à un incident ou un accident de transport de matières radioactives. Il permet à AREVA TN de mettre à la disposition des autorités compétentes des moyens humains spécialisés et des matériels spécifiques. L’ensemble de ce dispositif est testé, en moyenne, chaque année à l’échelon national avec les principaux acteurs et notamment les autorités compétentes.
Les schémas de transport envisagés pour Cigéo sont assez proches de ceux mis en œuvre avec succès depuis plus de 30 ans. En effet, le réseau ferré national est actuellement utilisé pour l’acheminement des emballages de combustibles usés depuis les centrales du parc EDF, jusqu’au terminal ferroviaire de Valognes, situé à 40 km de l’usine de la Hague, puis par la route ; les emballages y sont alors transférés sur des camions pour transport jusqu’au site. Ce flux correspond à environ 200 transports de combustible usé par an. Par ailleurs les déchets HA, MAVL issus du traitement des combustibles usés étrangers transitent également par le terminal ferroviaire de Valognes avant d’être retournés vers leur pays d’origine.
Ce sont ainsi de l’ordre de 800 emballages transférés chaque année au terminal ferroviaire de Valognes correspondant à environ 1 train/par semaine.
QUESTION 923 - êtes-vous responsable ?
Posée par Emmanuelle PETIT, L'organisme que vous représentez (option) (EVREUX), le 15/12/2013
Comment se fait-'il que vous hypothéquiez la vie de nos enfants et de leurs enfants sur un nombre infini de génération future ? avez-vous une conscience si étroite que vous puissiez considérez que l’enfouissement des déchets soit une solution ? Où en est la recherche pou recycler ces déchets mortels ? Où es est la recherche concernant les technologies nouvelles ?
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
D’autres solutions ont été étudiées en France et à l’étranger depuis plus de 50 ans : envoi dans l’espace, au fond des océans, dans le magma, séparation-transmutation… Le stockage est aujourd’hui considéré dans tous les pays comme la meilleure solution pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs sur le très long terme. La directive européenne du 19 juillet 2011 considère ainsi que le stockage géologique constitue actuellement la solution la plus sûre et la plus durable en tant qu’étape finale de la gestion des déchets de haute activité.
QUESTION 922 - Affirmations lors du débat ,sur la sécurité non vérifiées de l'ANDRA
Posée par Danielle GRUNBERG, CITOYEN , le 15/12/2013
Pourquoi n'avez vous pas attendu, comme il eût été logique de le faire, d'avoir à présenter les résultats des tests en vraie grandeur (et sur site) qui vous ont été imposés (manifestement contre votre volonté) par vos autorités de tutelle (ASN et IRSN) comme préalable à leur autorisation d'enfouir vos déchets sur le site CIGEO de Bure ? Pour quelle(s) raison(s) déposez vous la demande d'autorisation AVANT d'être en mesure de prouver (autant que cela puisse-être possible) que vos affirmations sur la sécurité sont crédibles ? Ne pensez-vous pas que ce calendrier, inversé contre toute logique,peut laisser penser aux simples citoyens que nous sommes qu'il y a une volonté délibérée de créer un fait accompli irréversible ?
Réponse du 17/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Cigéo ne sera autorisé que si l’Andra démontre qu’elle maîtrise tous les risques.
Si Cigéo est autorisé, le démarrage de l’exploitation se fera de manière progressive. Des premiers colis de déchets radioactifs pourraient être pris en charge à l’horizon 2025. Le stockage des déchets de moyenne activité à vie longue (MA-VL) débuterait en 2025 et se poursuivrait pendant plusieurs dizaines d’années. Une zone pilote serait également réalisée en 2025 pour stocker une petite quantité de déchets de haute activité (HA). Cette zone serait ainsi observée pendant une cinquantaine d’années et permettrait d’avoir un retour d’expérience important avant de commencer la phase de stockage des déchets HA à l’horizon 2075. Ces déchets sont les plus radioactifs et se caractérisent par un dégagement de chaleur important. Une période d’entreposage de refroidissement sur leur site de production est nécessaire préalablement à leur stockage.
Le Parlement s’est saisi de la question des déchets radioactifs en 1991. Depuis plus de 20 ans, l’ensemble des recherches menées sur la gestion des déchets radioactifs sont évaluées sur le plan scientifique et de la sûreté par des autorités indépendantes, en particulier l’Autorité de sûreté nucléaire et la Commission nationale d’évaluation mise en place par le Parlement. Ces évaluations sont disponibles sur le site du débat public. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra à l’État après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo en 2015. Ce processus comprendra notamment une évaluation de sûreté par l’Autorité de sûreté nucléaire et une évaluation scientifique par la Commission nationale d’évaluation, l’avis des collectivités territoriales, le vote d’une nouvelle loi fixant les conditions de réversibilité et une enquête publique.
QUESTION 921 - Anomalie
Posée par Nicole JACQUIN, L'organisme que vous représentez (option) (TCHERNOBYL), le 15/12/2013
Votre joujou, en plus d'être dangereux est extrêmement coûteux. On nous dit qu'EDF a provisionné les sommes pour le démantèlement et la gestion des déchets (240000 ans concernant le plutonium!), donc que celles-ci sont inclues dans le prix du kWh payé par l'abonné. Comment se fait-il alors que le prix moyen du kWh à 80% d'origine nucléaire vendu par EDF soit de 0,10€, alors qu'abonnée à Énercoop je paye mon kWh d'origine 100% renouvelable (97% petit hydraulique, 5% éolien, 1% photovoltaïque et 1% biogaz) 0,14€, prix qui comprend en plus la CSPE dont seul EDF bénéficie, c'est à dire que sur ma facture Enercoop je paye un impôt révolutionnaire pour que EDF rachète des kWh solaires à 0,50€, en fait pour financer son nucléaire en déroute... J'attends une réponse chiffrée et précise.
Réponse du 17/01/2014,
Réponse apportée par Edf :
Depuis 2007, la loi permet à chaque consommateur de choisir librement son fournisseur d'électricité, ou bien de conserver son contrat de fourniture au tarif règlementé par l'Etat, et appliqué uniquement par le fournisseur historique EDF.
Quel que soit le fournisseur retenu, le prix de l'électricité est composé de trois éléments:
- La fourniture d'énergie proprement dite, dont le prix est fixé librement par le fournisseur, ou par l'Etat pour le tarif règlementé;
- L'acheminement (utilisation des réseaux) dont le prix est fixé par l'état sur proposition de la Commission de Régulation de l'Energie indépendante, identique quel que soit le fournisseur;
- Les taxes et contributions, dont la Contribution au Service Public de l'Electricité (CSPE) qui permet de financer les obligations de service public : surcoût de production d’électricité dans les îles, soutien aux énergies renouvelables, tarif social et la moitié du budget du médiateur national de l’énergie.
La comparaison entre les prix pratiqués par les différents fournisseurs n'a donc de sens que sur le poste "fourniture d'énergie", le prix des deux autres éléments étant identique pour tous les fournisseurs.
Les pouvoirs publics ont créé le site http://www.energie-info.fr/ pour l'information du public sur les offres des différents fournisseurs, et EDF informe ses clients sur ses offres et leur contenu sur le site particuliers.edf.com.
Le montant de la CSPE est proposé annuellement par la Commission de Régulation de l'Energie, puis fixé par le gouvernement. Il s'élève à 1.35 c€/kWh en 2013. Pour 2014, la CRE a proposé, pour couvrir les charges échues et prévues, de le fixer à 2.25 c€/kWh en 2014, et le gouvernement a décidé d'un montant de 1.65 c€/kWh. La Cour des Comptes a publié en 2012 un rapport détaillé sur la CSPE, les charges financées par celle-ci, et leur évolution.
Vous trouverez sur le site http://www.edf.com/, conformément aux directives européennes, la répartition entre les différentes sources utilisées par EDF pour fournir l'électricité à ses clients: il s'agit pour 93% d'électricité produite sans émissions directes de CO2 (nucléaire: 80.4%, renouvelables 12.5% dont hydraulique 7.8%). Les émissions de carbone (50 g/kWh) et les déchets radioactifs associés (9.4 mg/kWh pour les déchets vie courte, 0.9 mg/kWh pour les déchets vie longue) sont également précisés.
EDF garantit en temps réel que les quantités d'énergies qu'il injecte sur le réseau sont égales aux quantités consommées par ses clients. D'autres fournisseurs (dont Enercoop) font appel à un tiers pour assurer cette fonction, si bien qu'une partie de l'électricité réellement consommée par leurs clients peut provenir, sur certaines plages horaires ou certaines périodes de l'année, d'autres fournisseurs ayant un mix de production différent.
Le mix énergétique d'EDF lui permet de proposer à ses clients une électricité à un prix compétitif (les dernières statistiques eurostat montrent que le prix moyen TTC par kWh -abonnement compris- de l'électricité pour les ménages est de 14.7 c€/kWh en France, 21.3 c€/kWh dans la zone Euro et 29.2 c€/kWh en Allemagne), avec un faible contenu en gaz à effets de serre: l'étude annuelle "Facteur Carbone Européen" consultable sur internet (www.pwc.fr/dd) indique que le kWh produit par EDF en France en 2012 occasionne 7 fois moins d'émissions de carbone par kWh produit que la moyenne européenne.
QUESTION 920 - Y aura-t'il la place pour enfouir TOUS LES DECHETS…
Posée par Cahin KÂÂ, L'organisme que vous représentez (option) (GRENOBLE), le 15/12/2013
Y aura-t'il la place pour enfouir TOUS LES DECHETS de TOUTES LES CENTRALES françaises, arrêtées, car aucune n'est en mesure de garantir l'absence d'accident grave possible ? Fukushima et le scandale absolu de la position nucléaire française est pour moi la source d'une désillusion absolue sur le pouvoir politique et la dite démocratie. Méfiez-vous de cette totale désaffection.
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 919 - Du vent ?
Posée par Jean JAGLINE, L'organisme que vous représentez (option) (ST AUBIN D'AUBIGNÉ), le 15/12/2013
Qui peut garantir aujourd'hui que le système de ventilation sera fonctionnel durant des centaines d'années ? Personne.
Réponse du 22/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Cigéo est conçu pour qu’après sa fermeture, la sûreté du stockage soit assurée de manière passive, c’est-à-dire sans dépendre d’actions humaines.
Ainsi, un système de ventilation n’est prévu que pour la période d’exploitation, envisagée pour une centaine d’année. Ce système vise, entre autres, à renouveler l’air pour garantir des ambiances de travail conformes au Code du travail, mais aussi à évacuer l’hydrogène émis en petite quantité par certains colis MAVL.
Le système de ventilation du stockage fait l’objet de dispositions pour réduire le risque de panne (redondance des équipements, maintenance..) et des dispositifs de surveillance seront mis en place pour détecter toute anomalie sur son fonctionnement, notamment la présence d’hydrogène dans l’air à de très faibles concentrations.. Des situations de perte de la ventilation sont étudiées malgré tout. Les études montrent que, dans le pire des cas, on disposera de plus d’une dizaine de jours pour rétablir la ventilation avant qu’un risque d’explosion dû à l’hydrogène n’apparaisse, ce qui permettra de mettre en place une ventilation de secours. Les conséquences d’une explosion sont tout de même évaluées afin d’envisager tous les scénarios possibles : les résultats montrent que les colis concernés ne seraient que faiblement endommagés, sans aucune perte de confinement des substances qu’ils contiennent.
QUESTION 918 - Pourquoi ?
Posée par Vincent O, L'ORGANISME HUMAIN (METZ), le 15/12/2013
Mesdames, Messieurs, Pourquoi choisir de cacher les symptômes sans chercher à résoudre le problème à la base ? Pourquoi faire fi de l'opinion publique ? Pourquoi biaiser le débat en présentant des informations partielles et partiales ? Pourquoi organiser un débat public alors que la décision est déjà prise en haut lieu, bien loin du bas peuple ? Pourquoi êtes-vous croyant (en la technique-qui-nous-sauvera-des-errements-de-la-technologie, en la science-qui-sait-tout, en vous-mêmes, en la parfaite immuabilité des couches d'argiles de la Meuse sur du trèèès long terme...) ? Il paraît que de plus en plus de scientifiques deviennent religieux quand ils se rendent compte qu'ils ont affaire à des choses bien plus grandes qu'eux. Pourquoi ne pas admettre qu'on s'est fourvoyé avec le nucléaire, qu'on continue dans notre erreur et qu'on ajoute aux erreurs passées celle, colossale, de CiGéo ? Pourquoi après vous le déluge ? Pourquoi l'Andra donne-t-elle des millions d'euros aux communes concernées par le projet cigéo ? Les achète-t-elle ? Achète-t-elle leur silence, lors docilité ? Pourquoi la démocratie ? Merci de vos réponses éclairées et éclairantes. Vincent O
Réponse du 30/01/2014,
Réponse apportée par la Commission du débat public :
- des informations partiales et partielles ?
Tous les documents de base (émanant de l’ANDRA, de l’ASN, de l’IRSN, de la CNE, de la Cour des comptes, etc), ainsi que toutes les opinions – favorables ou défavorables - qui ont été exprimées sur le projet Cigéo auprès de la Cpdp ont été rendues publiques sur son site internet; aucune sélection n’a été faite par la Cpdp.
Toutes ces données fournissent la base du compte rendu du débat, en cours de rédaction par les membres de la Cpdp, qui sera rendu public le 15 février 2014, et donc soumis au contrôle des participants.
- un débat public, alors que la décision est déjà prise d’en haut ?
Ce débat public est organisé conformément aux dispositions de la loi de 2002 sur la démocratie participative. Son compte rendu constituera – parmi d’autres - un élément important dans la décision d'autoriser ou non la réalisation du projet Cigéo, que l’Etat devra prendre en 2018.
Avant même cette étape décisive, au vu de tout ce qui aura été dit ou écrit dans le cadre du débat public, le maître d'ouvrage (l’ANDRA) peut décider d’apporter des modifications à son projet. Il dispose d’un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public pour prendre sa décision, la rendre publique et en informer la CNDP.
Parmi ceux qui ont travaillé sur la mise en œuvre de ce débat public, personne n'a le sentiment qu'il serait "pour la forme".
- pourquoi ne pas admettre qu’on s’est fourvoyé avec le nucléaire … et qu’on ajoute aux erreurs passées celle, colossale, de Cigéo ? Pourquoi après vous le déluge ? Pourquoi l’Andra donne t’elle des millions d’euros aux communes concernées par le projet ? Achète t’elle leur silence leur docilité ?
- S’est-on ou non fourvoyé sur le nucléaire ? Il existe à l’évidence un débat national sur ce point, mais il déborde largement le cadre du projet Cigéo, et la Cpdp n’a aucune légitimité pour aborder un tel sujet.
- Les autres interrogations formulées ont été largement au cœur du débat public ; des opinions nombreuses et diverses ont été émises, dont le compte rendu du débat rendra compte, notamment dans le chapitre qui sera consacré aux aspects éthiques du projet.
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
La France s’est dotée d’un cadre législatif favorisant la transparence dans le domaine du nucléaire et de plusieurs structures de concertation, d ‘information et de débat. Ainsi, des Commissions Locales d’information (CLI) ont été créées auprès des installations nucléaires. Elles sont chargées d’une mission générale de suivi, d’information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d’impact des installations nucléaires sur les personnes et l’environnement. Ces CLI sont regroupées en une Association Nationale des Comités et Commissions Locales d’Information (ANCCLI). Le Haut Comité pour la Transparence et l’Information sur la Sécurité Nucléaire (HCTISN) a été créé par la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (dite "loi TSN"). C’est une instance d’information, de concertation et de débat sur les risques liés aux activités nucléaires et l’impact de ces activités sur la santé des personnes, sur l’environnement et sur la sécurité nucléaire. De plus, la loi du 13 juin 2006 instaure un droit d’accès à l’information en matière nucléaire directement auprès des exploitants, qui permet à tout un chacun de s’informer.
Concernant le projet Cigéo, le débat public est une étape essentielle permettant de recueillir les avis, propositions et contributions de l’ensemble des citoyens sur le projet.
Enfin, des taxes prélevées sur les exploitants d’installations nucléaires sont reversées à la Meuse et Haute-Marne afin de réaliser les actions suivantes décrites à l’article L. 542-11 du Code de l’environnement :
1° « gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation du laboratoire ou du centre de stockage » ;
2° « mener, dans les limites de son département, des actions d'aménagement du territoire et de développement économique, particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils généraux concernés » ;
3° « soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques, notamment dans les domaines étudiés au sein du laboratoire souterrain et dans ceux des nouvelles technologies de l'énergie. »
Il s’agit donc de sommes destinées au développement du territoire autour du projet, afin de faciliter son insertion dans le territoire meusien et haut-marnais.
Les sommes issues des taxes d’accompagnement et de diffusion technologique sont gérées par deux groupements d’intérêt public (GIP) en Meuse et en Haute-Marne. Dans le cadre du contrôle de légalité, l’Etat contrôle que l'affectation des ressources fiscales et des dépenses des collectivités respectent la réglementation. De plus, l'Etat, est administrateur ou commissaire du gouvernement des GIP et vérifie dans ce cadre l’utilisation des ressources qui leur sont dévolues.
QUESTION 917 - Perte de mémoire et de financement du lieu de stockage
Posée par Cyril CUISIN, CITOYEN (TOULOUSE), le 15/12/2013
Les civilisations dominantes évoluent, régressent, s'écroulent, naissent ailleurs et changent de territoires dans le temps. Les langages et signes évoluent. La mémoire s'efface au fil du temps. Nous ne sommes pas capables de retrouver certains monuments et de comprendre toute l'histoire d'une grande civilisation comme l'Egypte datant de 5000 ans. Comment peut-on garantir de garder le financement pour la surveillance du lieu de stockage pendant 100 000 ans ? Comment peut on garantir de garder la mémoire du lieu pendant 100 000 ans ? Comment garantir que le lieu ne soit pas oublié et retrouvé accidentellement par les archéologues du futur qui traduiront les signes de "danger" par "trésor" ou "tombeau sacré" ... ?
Réponse du 08/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif fondamental de Cigéo est de protéger l’homme et l’environnement des déchets radioactifs sur de très longues échelles de temps. La sûreté à long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. C’est une des raisons qui a conduit, en 2006, le Parlement à retenir la solution du stockage profond. En effet, cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli, contrairement à l’entreposage. En cas de perte complète de la mémoire du stockage, une intrusion inopinée à 500 mètres sous terre apparaît peu plausible, du moins sans un minimum d’investigations préalables. L’Andra évalue cependant par précaution dans son analyse de sûreté les conséquences d’un forage à travers le stockage pour vérifier que le stockage resterait sûr.
Malgré cette robustesse du stockage même en cas d’oubli, l’Andra conçoit Cigéo avec l’objectif d’en conserver la mémoire et de la transmettre aux générations futures le plus longtemps possible. Des solutions d’archivage de long terme existent pour les centres de stockage de surface exploités par l’Andra et font l’objet de revues périodiques. Le retour d’expérience montre que ces solutions paraissent robustes pour au moins les 500 premières années. Ainsi, pour Cigéo, l’Andra prévoit qu’un centre de la mémoire perdurera sur le site. Il pourra accueillir le public et comprendra notamment les archives du Centre.
De manière générale, le maintien de la mémoire doit aussi impliquer les acteurs locaux, qui peuvent prendre le relai en cas de défaillance de l’Andra ou de l’État. L’Andra veille d’ores et déjà à les informer sur les enjeux associés à la mémoire et étudie avec des anthropologues, des philosophes ou encore des artistes les facteurs qui peuvent favoriser la transmission de la mémoire. La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
L’Andra a lancé en 2010 un programme d’études pour proposer des outils qui rendent cette transmission plus robuste sur une échelle de temps millénaire. Des pistes se dessinent tels des marqueurs de surface, mais aussi des rendez-vous réguliers à mettre en place au niveau des populations locales.
En tout état de cause, comme il est impossible de garantir notre capacité à communiquer avec des êtres vivant dans plusieurs milliers d’années, c’est chaque génération qui aura la responsabilité de contribuer à transmettre cette mémoire aux générations suivantes.
QUESTION 916 - durabilité
Posée par annie AGIER, L'organisme que vous représentez (option) (VALENCE), le 15/12/2013
comment un tel projet peut il engager les générations futures sur 100 ans ? pouvez vous me préciser comment gèrera-t-on les émanations d'hydrogène ?
Réponse du 21/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Comme pour l’ensemble des risques pouvant remettre en cause la sûreté de Cigéo, qu’ils soient d’origine naturelle ou industrielle, le risque d’explosion lié à la présence d’hydrogène (qui, au-delà d'une certaine quantité, peut présenter un risque d'explosion en présence d'oxygène), est pris en compte dans la conception du Centre. Seulement certains déchets MA-VL, notamment ceux contenant des composés organiques, dégagent de l'hydrogène produit par radiolyse : les ¾ des colis de déchets MA-VL destinés à Cigéo dégagent peu d’hydrogène (moins de 3 litres par an et par colis), voire pas du tout. Pour maîtriser ce risque, l’Andra fixe une limite stricte aux quantités d’hydrogène émises par chaque colis. Des contrôles seront mis en place et aucun colis ne sera accepté s’il ne respecte pas cette limite. Pour éviter l’accumulation de ce gaz, les installations souterraines et de surface seront ventilées en permanence pendant leur exploitation, comme le sont les installations d’entreposage dans lesquelles se trouvent actuellement ces déchets. Le système de ventilation du stockage fait l’objet de dispositions pour réduire le risque de panne (redondance des équipements, maintenance..) et des dispositifs de surveillance seront mis en place pour détecter toute anomalie sur son fonctionnement. Des situations de perte de la ventilation sont étudiées malgré tout. Les études montrent que, dans le pire des cas, on disposera de plus d’une dizaine de jours pour rétablir la ventilation, ce qui permettra de mettre en place une ventilation de secours. Les conséquences d’une explosion sont tout de même évaluées afin d’envisager tous les scénarios possibles : les résultats montrent que les colis concernés ne seraient que faiblement endommagés, sans aucune perte de confinement des substances qu’ils contiennent.
Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de ces déchets. Grâce à la réversibilité, les générations suivantes garderont la possibilité de faire évoluer cette solution. Les rendez-vous proposés par l’Andra seront notamment alimentés par les résultats des recherches qui continueront à être menées sur la gestion des déchets radioactifs et les avancées technologiques. A chaque étape, il sera possible de décider de poursuivre le processus de stockage tel qu’initialement prévu ou de le modifier, par exemple si des solutions alternatives sont identifiées.
QUESTION 915 - Conséquences dans le pire des cas
Posée par Bertrand KURTZEMANN, L'organisme que vous représentez (option) (MOULINS-LES-METZ), le 15/12/2013
Lors de tous les débats et dans toutes les lectures concernant ce sujet, je ne me suis pas senti informé sur les conséquences du scénario le pire envisageable. Sachant que le risque zéro n'existe pas, pourriez-vous nous dresser un tableau du scénario le pire envisageable ??
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Au stade actuel de la conception et de l’analyse des risques, les accidents les plus significatifs qui pourraient conduire à une dispersion de la radioactivité sont la chute d’un colis de déchets, une collision ou un départ de feu sur un engin de transfert transportant un colis. Cela s’explique par la nature des activités nucléaires de Cigéo qui sont principalement de la manipulation de colis de déchets.
Ainsi, la situation la pire en termes de conséquences proviendrait de l’accumulation des nombreuses défaillances successives suivantes :
- un départ de feu malgré la minimisation des matériaux inflammables dans l’installation,
- une détection tardive du fait d’une défaillance du réseau de surveillance,
- un système d’extinction inopérant,
- une intervention des pompiers retardée ou empêchée, malgré la présence d’engins de secours disposés dans l’installation,
- la perte de confinement d’un colis de déchets malgré la protection apportée par le conteneur de stockage.
Ceci engendrerait alors un rejet incontrôlé de particules radioactives à l’extérieur de Cigéo. L’évaluation réalisée, à ce stade de la conception, de l’impact d’un tel scénario hautement improbable montre que ses conséquences resteraient limitées, et nettement en deçà du seuil réglementaire qui impose la mise à l’abri des populations (10 millisieverts).
QUESTION 914 - Est-ce bien raisonnable ?
Posée par Christine KERNALEGUEN, L'organisme que vous représentez (option), le 15/12/2013
Il semble tellement évident que sur une longue période (plusieurs milliers d'années), on ne pourra pas toujours maitriser la gestion d'un tel site. Un jour où l'autre, un évènement non prévu surviendra dans la zone de stockage et libérera la radioactivité enfouie, génèrera la contamination par exemple d'eaux souterraines puis provoquera la mort. Comment peut-on ainsi risquer la vie de personnes, peut-être la vôtre ou celle de vos descendants ? N'est-ce pas irresponsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 913 - Controle, Information des populations et plans d'urgence
Posée par Pierre GOREL, L'organisme que vous représentez (option) (EDMONTON, CANADA), le 15/12/2013
Le site entreposera des dechets a haute radioactivite et a vie longue. La qestion n'est donc pas "si", mais "quand" un incident/accident arrivera, avec des consequences directes pour les populations. Il me semble donc important que les dites populations soient informees des risques, qu'elles sachent comment reagir en cas de probleme et qu'elles puissent controler le bon fonctionnement du centre. La question est alors: comment l'information des populations est elle prevue, et comment les plans d'urgence vont etre mis en place? Quel controle possible de la part des populations locales?
Réponse du 31/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. L’Andra met donc tout en œuvre pour qu’il n’y ait pas d’incident. Cela ne la dispense évidemment pas d’obligations d’information des populations. Conformément à la loi du 13 juin 2006 sur la transparence et la sécurité nucléaire, tous les incidents et accidents dans les installations nucléaires font systématiquement l’objet d’une déclaration immédiate à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), organisme de contrôle indépendant, et d’une information du public. Les exploitants des installations nucléaires doivent aussi déclarer à l’ASN les écarts par rapport au fonctionnement normal des installations, même s’ils n’ont aucune importance du point de vue de la sûreté.
La gravité des événements déclarés est évaluée grâce à une échelle internationale de gravité, l’échelle INES, qui comprend 7 niveaux. L’ASN valide l’évaluation de la gravité de chaque événement. Les événements de niveaux 1 à 3, sans conséquence significative sur les populations et l'environnement, sont qualifiés d'incidents. En 2012, sur les installations nucléaires françaises, 110 incidents de niveau 1 ont été recensés, seulement deux de niveau 2 et aucun de niveau supérieur.
C’est le préfet qui peut décider des actions de protection des populations à mettre en œuvre pour limiter les conséquences d’un accident éventuel, au travers d’un PPI (plan particulier d’intervention). Cependant, l’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels montre que leurs conséquences resteraient limitées, et nettement en deçà du seuil réglementaire qui imposeraient des mesures de protection des populations (mise à l’abri, évacuation).
QUESTION 912 - Quelle est la zone de consultation des élus après le débat public ?
Posée par Véronique MARCHANDIER, L'organisme que vous représentez (option) (LANGRES ), le 15/12/2013
Après le débat public, et après les élections municipales de 2014, les conseillers municipaux d'une"zone de consultation" seront sollicités pour donner leurs avis sur la construction de CIGEO. Je voudrais savoir quelles villes et quels villages seront inclus dans cette zone de consultation. A quelle date aura lieu cette consultation?
Réponse du 11/02/2014,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Le projet Cigéo suit la procédure décrite à l’article L. 542-10 du Code de l’Environnement. Plusieurs procédures de consultation sont organisées afin de recueillir l’avis des populations locales et nationales :
- un débat public en 2013, organisé afin de recueillir les avis de l’ensemble de la population au niveau local et national,
- un avis des collectivités territoriales,
- une enquête publique préalable au décret d’autorisation de création.
Le périmètre de consultation des collectivités territoriales sera précisé dans un décret à venir. Il inclura au minimum les communes et les communautés de communes situées autour du projet de centre de stockage ainsi que les conseils généraux de Meuse et de Haute Marne.
QUESTION 911 - pourquoi prendre des risques sans consulter les citoyens?
Posée par thomas ROUSSEL, L'organisme que vous représentez (option) (GREZIEU LA VARENNE), le 15/12/2013
madame, monsieur, il me semble indispensable, lorsque il y a question de risque ou danger, dans le présent ou dans l'avenir, dans une démocratie, la parole des citoyens est indispensable, pas seulement de l'entendre mais aussi de la respecter... aujourd'hui tout les projets de stockage ,de déchet ultime ne garantissent aucune sécurité pour l'avenir, de la protection humaine, au nom de qui vous vous permettez de prendre de tel risques?
Réponse du 17/01/2014,
Réponse apportée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
La loi du 28 juin 2006 a fait le choix du stockage réversible profond pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations futures. Ce choix a été fait après un programme de quinze années d’études et recherches encadrées par la loi « Bataille » de 1991, un débat public en 2005-2006 et les avis des évaluateurs sur ces recherches. Il est conforté au niveau international par la directive européenne du 19 juillet 2011 qui considère que « il est communément admis que sur le plan technique, le stockage en couche géologique profonde constitue, actuellement, la solution la plus sûre et la plus durable en tant qu’étape finale de la gestion des déchets de haute activité et du combustible usé considéré comme déchet. »
Elle demande à l’Andra d’étudier et d’implanter Cigéo en rappelant que « la demande d'autorisation de création [d’un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs] doit concerner une couche géologique ayant fait l'objet d'études au moyen d'un laboratoire souterrain ». L’Andra poursuit donc ses études en vue d’élaborer pour 2015 le dossier support à l’instruction de la demande d’autorisation de création de Cigéo en Meuse/Haute-Marne, dans la couche d’argile dont les propriétés de confinement sont désormais reconnues.
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Quels que soient les choix énergétiques futurs, c’est la responsabilité de notre génération de proposer aux générations suivantes une solution permettant de mettre définitivement en sécurité ces déchets, qui sont produits en France depuis plusieurs dizaines d’années. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est justement de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de ces déchets. Grâce à la réversibilité, les générations suivantes garderont la possibilité de faire évoluer cette solution si elles le souhaitent.
QUESTION 910 - Quid des nappes phréatiques?
Posée par eMM SOMER, L'organisme que vous représentez (option) (FRANCE), le 15/12/2013
Quid des nappes phréatiques dans 100 ans, 200 ans, 1.000 ans? A-t-on vraiment envie de laisser une poubelle pour les générations futures? Aucun contrôle possible sur un chantier aussi colossal. Stop!!!
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestions sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Sur le long terme, la couche d’argile dans laquelle est implantée le stockage garantit l’éloignement des déchets radioactifs de la surface. Seuls quelques radionucléides mobiles et dont la durée de vie est longue pourront migrer à travers la couche d’argile après plusieurs dizaines de milliers d’années, puis potentiellement atteindre ensuite la surface et les nappes phréatiques, après plus de 100 000 ans et en quantités extrêmement faibles. Leur impact radiologique serait alors plusieurs dizaines de fois inférieur à la radioactivité naturelle.
Cigéo sera soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 909 - Quelles garanties, quelle responabilité ?
Posée par Stéphane TERREAUX, L'organisme que vous représentez (option) (PONT-À-MOUSSON), le 15/12/2013
Bonjour, on envisage d'enfouir en profondeur des déchets nucléaires. Je m'interroge sur la soi-disant stabilité du sous-sol, à plusieurs titres : d'abord les mouvements de terrain qui existent même dans l'argile, et puis la vie bactérienne qui va être boostée par la chaleur dégagée, avec quelles conséquences ? Autre interrogation majeure, la question de l'accès aux déchets. Quid de la possibilité de détecter et réparer une fuite, 10 ans, 50 ans ou 200 ans après son dépôt ? Les quelques expériences réalisées en sous-sol sont de très mauvais augure, alors que même en surface les difficultés sont grandes pour gérer des déchets de ce type. J'ajoute que l'on n'a pas encore réellement expérimenté les conséquences d'une éventuelle instabilité politique sur ce type d'équipements... Merci de m'indiquer les réponses à ces questions, ou de prendre en compte ces difficultés dans l'évaluation de la pertinence du projet. Cordialement, Stéphane.
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
A propos des « mouvements de terrain »
En ce qui concerne le risque sismique, le site d’implantation de Cigéo (située à l’Est du Bassin de Paris) est à l’écart des zones actives où se produisent les jeux de failles qui absorbent le rapprochement des continents Afrique et Europe. Les mouvements tectoniques de grande amplitude et forts séismes qui en découlent se localisent pour l’essentiel en Méditerranée et dans les chaines de montagnes qui la bordent, et pour le reste (résidu) au niveau des grandes failles qui affectent la plaque européenne, comme les failles du fossé d’Alsace et des Vosges en bordure Est du bloc stable que constitue le Bassin de Paris. Ce dernier compte parmi les régions les plus stables du globe. Il est quasiment asismique avec des taux de déformations extrêmement faibles à l’échelle des temps géologiques, comptés en millions d’années.
L’analyse des directions et vitesses de déplacements relatifs des stations GPS installées en Europe, confirme que le Bassin de Paris constitue un bloc rigide et que les déformations (de faible amplitude) se font à ses frontières, comme le souligne la répartition des séismes. En conséquence, seules les failles majeures qui existent déjà sont susceptibles de glisser, avec des mouvements de très faible amplitude, par à-coups séparés dans le temps par plusieurs dizaines à centaines de milliers d’années.
C’est ainsi que la zone de 30 km² étudiée pour l’implantation de l’installation souterraine est, au plus proche, à 1,5 km du fossé de Gondrecourt, et à 6 km du segment le plus proche du système des failles de la Marne (le fossé de la Marne étant lui-même est à 14 km). Les analyses cartographiques montrent l’absence de mouvements de ces failles au cours des derniers millions d’années. Les derniers mouvements tectoniques du fossé de Gondrecourt datent de 20 à 25 millions d’années (datations de cristaux de calcite) ; les derniers mouvements des failles de la Marne sont du même âge ou plus anciens. La réalisation d’une écoute sismique dont le seuil de détection est très bas, et qui discrimine sans ambiguïté séismes naturels et tirs de carrières, permet d’affirmer l’absence de toute activité sur ces failles. En accord avec la réglementation en vigueur concernant la sûreté des installations nucléaires, les ouvrages de stockage sont toutefois dimensionnés pour résister aux séismes maxima physiquement possibles que pourraient générer ces failles si elles redevenaient actives dans le futur.
A propos de la sûreté de Cigéo
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestions sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
Les études et recherches menées sur le stockage profond depuis plus de 20 ans ont montré que le site étudié par l’Andra en Meuse/Haute-Marne était particulièrement favorable à la création d’un stockage sûr.
L’objectif du stockage profond est en effet de protéger durablement l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 908 - L'enfouissement de déchets radio-actifs est-il à long terme la meilleure solution???
Posée par Thomas SZABO, L'organisme que vous représentez (option) (SYLVAINS LES MOULINS), le 15/12/2013
L'enfouissement des déchets radio-actifs est-il une solution à long terme garantissant la bonne santé des citoyens du futur???
Réponse du 21/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage en surface. En effet, laisser les déchets dans des installations en surface impliquerait de renouveler périodiquement les bâtiments où ils seraient placés, de contrôler ces installations et de les maintenir. En cas de perte de contrôle de ces installations, les conséquences radiologiques sur l’homme et l’environnement ne seraient pas acceptables. Compte tenu de la durée pendant laquelle ces déchets resteront dangereux (plusieurs centaines de milliers d’années), l’entreposage - qu’il soit en surface ou à faible profondeur - ne peut être qu’une solution provisoire dans l’attente d’une solution définitive.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 907 - et les tremblements de terre?
Posée par laurence HELLE, ATTAC (MOYENMOUTIER), le 15/12/2013
Dans la région de Saint-Dié-des- Vosges où j'habite et très proche à vol d'oiseau de Bure, nous avons déjà eu des secousses sismiques (2 en moins de 30 ans), comment pouvez-vous assurer que 1) il n'y aura pas de fissures à Bure et de radioactivité s'échappant 2) il n'y aura pas dans les prochains siècles un très gros tremblement de terre
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le site d’implantation de Cigéo (située à l’Est du Bassin de Paris) est à l’écart des zones actives où se produisent les jeux de failles qui absorbent le rapprochement des continents Afrique et Europe. Les mouvements tectoniques de grande amplitude et forts séismes qui en découlent se localisent pour l’essentiel en Méditerranée et dans les chaines de montagnes qui la bordent, et pour le reste (résidu) au niveau des grandes failles qui affectent la plaque européenne, comme les failles du fossé d’Alsace et des Vosges en bordure Est du bloc stable que constitue le Bassin de Paris. Ce dernier compte parmi les régions les plus stables du globe. Il est quasiment asismique avec des taux de déformations extrêmement faibles à l’échelle des temps géologiques, comptés en millions d’années.
L’analyse des directions et vitesses de déplacements relatifs des stations GPS installées en Europe, confirme que le Bassin de Paris constitue un bloc rigide et que les déformations (de faible amplitude) se font à ses frontières, comme le souligne la répartition des séismes. En conséquence, seules les failles majeures qui existent déjà sont susceptibles de glisser, avec des mouvements de très faible amplitude, par à-coups séparés dans le temps par plusieurs dizaines à centaines de milliers d’années.
C’est ainsi que la zone de 30 km² étudiée pour l’implantation de l’installation souterraine est, au plus proche, à 1,5 km du fossé de Gondrecourt, et à 6 km du segment le plus proche du système des failles de la Marne (le fossé de la Marne étant lui-même est à 14 km). Les analyses cartographiques montrent l’absence de mouvements de ces failles au cours des derniers millions d’années. Les derniers mouvements tectoniques du fossé de Gondrecourt datent de 20 à 25 millions d’années (datations de cristaux de calcite) ; les derniers mouvements des failles de la Marne sont du même âge ou plus anciens. La réalisation d’une écoute sismique dont le seuil de détection est très bas, et qui discrimine sans ambiguïté séismes naturels et tirs de carrières, permet d’affirmer l’absence de toute activité sur ces failles. En accord avec la réglementation en vigueur concernant la sûreté des installations nucléaires, les ouvrages de stockage sont toutefois dimensionnés pour résister aux séismes maxima physiquement possibles que pourraient générer ces failles si elles redevenaient actives dans le futur.
L’objectif fondamental de Cigéo est de confiner la radioactivité des déchets sur de très longues échelles de temps. Tout est mis en œuvre pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. Tous les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation sont identifiés en amont de la conception. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier.
QUESTION 906 - Comment s'assurer de la non fuite des déchets et par conséquent de la non contamination de l'eau, du sol, de l'air... de NOTRE environnement?
Posée par Mylène T, L'organisme que vous représentez (option), le 15/12/2013
Je ne comprends pas comment des êtres humains peuvent prétendre avoir une solution pour tous les cas de catastrophes ou d'activités naturelles : risques sismiques, mouvements de l'eau, des nappes phréatiques, comportement des roches... D'autant plus sur un laps de temps qui dépasse l'intelligibilité humaine. De plus, qu'en sera-t-il pour l'économie locale, l'agriculture? Qui voudra acheter des produits venant de ce sol?
Réponse du 10/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement afin de contrôler l’impact de ses activités. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, il permettra notamment de vérifier que l’impact du centre sera très inférieur à celui de la radioactivité naturelle et qu’il n’aura donc aucun impact sur la qualité des productions agricoles. L’Andra a créé l’Observatoire pérenne de l’environnement, qui a pour mission d’assurer un suivi détaillé de l’évolution de l’environnement du stockage. Cela permettra de lever ainsi toute inquiétude en démontrant que le stockage n’a pas d’impact sur les activités agricoles de proximité. Cet observatoire labellisé s’inscrit dans un grand nombre de réseaux scientifiques nationaux ou internationaux. Par ailleurs, le retour d’expérience de la présence de l’Andra dans l’Aube depuis 20 ans montre que l’implantation d’un centre de stockage de déchets radioactifs n’est en aucun cas incompatible, même en termes d’image, avec des activités agricoles de premier choix (lait, viande, légumes, viticulture...). L'industrie et l’agriculture ont toujours coexisté et de nombreuses installations industrielles y compris nucléaires sont installées en France à proximité de zones de production agricoles dont des zones géographiques protégées ou encore des zones d'appellation contrôlée.
QUESTION 905 - comment être responsable au-delà d'une génération?
Posée par Arnaud LABÉVIÈRE, ORGANISATION & DÉFENSE DU VIVANT (SISTERON), le 15/12/2013
Bonjour. Les "grands débats" dit "publics" sur les "grandes questions" de choix de société n'engagent pas seulement les Entreprises -publics ou privées- et les "responsables politiques & économiques". Ils concernent les générations à venir, notamment... Ma question: qu'adviendra-t-il des "pseudo-responsabilités" si d'aventure, au cours des ans qui s'égrènent, un problème technique survient comme il s'en est déjà produit ces 20 dernières années, sans que toute la vérité soit dite aux habitants de notre planète Terre? C'est une question à laquelle je crains ne jamais avoir de réponse, & pour cause: "après moi le déluge" semble être un automatisme de raisonnement auprès des "responsables", qui n'ont de "responsable" que le titre dont ils s'affublent mutuellement. En d'autres termes, allez-vous enfin ouvrir les yeux sur les conséquences assassines des décisions que vous prenez- en notre nom!- sous prétexte d'un régime "démocratique"? La Vie sur Terre est une "bénédiction", sans rentrer dans des considérations dogmatiques. La course ou la fuite en avant qui se dessine depuis près d'un siècle... risque de coûter fort aux aspirations les plus saines & vertueuses... Il est encore temps d'ouvrir nos cœurs & nos yeux. Vive la Vie, dans le respect mutuel. Arnaud
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 904 - Prise en compte arguments opposants
Posée par maurice FURSTOSS, L'organisme que vous représentez (option) (SARDAN), le 15/12/2013
Pourquoi ne pas avoir pris en compte les arguments des opposants au projet d'enfouissement, certains de ces arguments étant parfaitement fondés, scientifiquement parlant, et annonciateurs de catastrophes certaines?
Réponse du 27/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le projet Cigéo est le fruit d’un long travail scientifique, mené depuis plus de 20 ans qui est régulièrement évalué de multiples façons (Autorité de sûreté nucléaire et son appui technique l’IRSN, Commission nationale d’évaluation mise en place par le Parlement, publications scientifiques, expertises indépendantes…). L’Andra écoute les arguments développés par les opposants et prend soin d’y apporter des réponses circonstanciées.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
QUESTION 903 - Qu'elle est la vraie raison de l'entêtement nucléaire français ?
Posée par Cecile DELABROY, L'organisme que vous représentez (option) (VALENCE), le 15/12/2013
Statistiquement, le risque 0 n'existe pas : il est sûr qu'un jour ou l'autre sur l'une ou l'autre de nos installations nucléaires un problème surviendra. pourquoi alors continuer dans cette voie ? Pourquoi ne pas investir massivement dans les recherches alternatives ? Pourquoi aller droit dans le mur ? Pourquoi ?
Réponse du 11/02/2014,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
L’utilisation de l’énergie nucléaire a apporté durant plusieurs années un bénéfice important à la France, du point de vue économique tant par une filière industrielle de premier plan mondial que par des prix de l’électricité parmi les plus bas d’Europe et du point de vue environnemental, par des émissions de gaz à effet de serre également parmi les plus basses d’Europe.
L’énergie nucléaire comporte aussi des inconvénients que sont la production de déchets radioactifs à vie longue, qui font l’objet du présent débat public, et le risque d’accident. Le contrôle de la sûreté nucléaire est confié en France à une autorité administrative indépendante, l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), qui a tout pouvoir pour prescrire les mesures techniques nécessaires, afin d’améliorer en permanence la sûreté.
Malgré toutes les précautions qui sont prises, un accident nucléaire ne peut être totalement exclu par principe. C’est pourquoi des mesures de sauvegarde d’urgence sont prévues par les opérateurs et des plans particuliers d’intervention sont préparés par les pouvoirs publics et régulièrement testés au cours d’exercice. Enfin la France est le premier pays à avoir engagé, dès 2005, une réflexion sur la gestion post-accidentelle des territoires contaminés.
Par ailleurs, le Président de la République a décidé d’engager la transition énergétique, cette transition reposant d'une part sur la sobriété et l’efficacité énergétique, et d'autre part sur la diversification des sources de production et d'approvisionnement. Concernant la diversification de nos sources d’énergies, le Président de la République a fixé un cap : réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% d'ici 2025. Parallèlement, le Président de la République a indiqué que la transition énergétique serait fondée sur deux principes : l'efficacité énergétique d'une part, et la priorité donnée aux énergies renouvelables d'autre part. Cette mutation prendra du temps et supposera des étapes d’évaluation en fonction des progrès technologiques et scientifiques et des prix relatifs de chaque source d’énergie.
QUESTION 902 - Quelle assurance de non dangereusité ?
Posée par elvire BONNEAU, L'organisme que vous représentez (option) (L'HOUMEAU), le 15/12/2013
Bonjour ! Pensez-vous vraiment que l'enfouissement des déchets radioactifs soit sans danger ? Si oui, comment affirmer qu'il n'y aura pas à un moment ou à un autre, même si c'est dans plusieurs centaines d'années, un accident, une erreur, un séisme qui mettra en danger tous les habitants de cette région ? Qui contaminerait l'eau, la terre... Si non, comment pouvez-vous prendre une telle responsabilité, faire encourir un tel risque aux générations à venir ? Comment pouvez-vous tranquillement enfouir une bombe à retardement qui pourra éclater à n'importe quel moment ? Quand, au nom d'un soit disant progrès et essort économique qui ne profite qu'aux plus riches et influants cesserait vous de mettre en danger l'avenir de notre planète ? S'il vous plait, pensez à vos enfants, vos petits enfants, au monde que vous voulez leur laisser... Comment pouvez-vous mettre de tels projets en application sans crainte pour notre avenir à tous ?
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montre que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
QUESTION 901 - Enfouir ou Cacher ?
Posée par Jean-Marie SOGNY, L'organisme que vous représentez (option) (RETHEL), le 15/12/2013
Bonjour, Dans le cas présent de ce projet, je crains fort qu'enfouir équivaut à "Cacher"... (Et sans aucune garantie, raisonnable dans le temps, de possibilité de récupérer les colis...) Votre avis ? Cordialement, Jean-Marie SOGNY.
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage en surface. En effet, laisser les déchets dans des installations en surface impliquerait de renouveler périodiquement les bâtiments où ils seraient placés, de contrôler ces installations et de les maintenir. En cas de perte de contrôle de ces installations, les conséquences radiologiques sur l’homme et l’environnement ne seraient pas acceptables. Compte tenu de la durée pendant laquelle ces déchets resteront dangereux (plusieurs centaines de milliers d’années), l’entreposage - qu’il soit en surface ou à faible profondeur - ne peut être qu’une solution provisoire dans l’attente d’une solution définitive.
Et le projet est conçu pour être réversible au moins cent ans, conformément à la demande du Parlement. L’Andra prévoit la mise en œuvre de nombreuses dispositions techniques pour faciliter une opération éventuelle de retrait de colis de déchets après leur stockage (colis indéformables en béton ou en acier utilisés pour le stockage des déchets, espaces ménagés entre les colis pour permettre leur retrait, tunnels de stockage avec un revêtement en béton ou en acier pour éviter les déformations, connaissance précise de l’emplacement de chaque colis et de ses conditions de stockage, surveillance des ouvrages…). Ces dispositions prennent en compte le retour d’expérience d’autres installations, en France et à l’étranger. Des essais de retrait de colis ont d’ores et déjà été réalisés à l’échelle 1. Des nouveaux tests de retrait seront réalisés dans le stockage avant que la mise en service de Cigéo ne puisse être autorisée, puis pendant toute l’exploitation de Cigéo. Les conditions de réversibilité seront fixées par une future loi. Pour en savoir plus sur les propositions faites par l’Andra en matière de réversibilité du stockage, voir ../docs/rapport-etude/fiche-reversibilite-cigeo.pdf
QUESTION 900 - En cas d'accident
Posée par Gilbert TRÉNEL, L'organisme que vous représentez (option) (LAPUGNOY), le 15/12/2013
En cas d'accident dans les galeries, les "colis" seront-ils laissés générer une catastrophe en profondeur, ou remontés à la surface ? Dans ce dernier cas, combien de temps faudra-t-il pour les remonter tous ? Et pendant tout ce temps, la catastrophe n'a-t-elle aucune chance de se produire ?
Réponse du 21/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Si un accident devait survenir, l’installation sera mise en sécurité par la pose rapide d’équipements provisoires (ventilation, barrière de confinement…) et non par une opération de retrait de colis. Une fois la mise en sécurité réalisée, l’exploitant examinera les dispositions à mettre en œuvre pour reprendre l’exploitation normale en tout sûreté. Le maintien en stockage de colis, même endommagés, ou leur retrait éventuel pourra être décidé sans caractère d’urgence. S’il était décidé de retirer un grand nombre de colis du stockage, des installations spécifiques seraient alors à construire en surface pour les gérer (pour leur entreposage, leur réexpédition, leur traitement…). Toute opération notable de retrait de colis de déchets devra faire l’objet d’une autorisation spécifique.
Pour plus d’informations sur les propositions de l’Andra en matière de réversibilité : http://www.cigéo.com/images/cigeo/site/pdf/499.pdf
QUESTION 899 - si un tremblement de terre...
Posée par FAURE LOUISE, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 15/12/2013
quel recours si un tremblement de terre venait à bouleverser toutes les "précautions" que l'andra met en avant et mette à l'air libre les molécules radioactives ? Quelles leçons tirez vous des leçons de fukushima sur la puissance et l'imprévisibilité des aléas naturels ? Merci de votre réponse
Réponse du 09/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Si Cigéo est autorisé, le Centre sera une installation nucléaire de base qui, à ce titre, sera soumise à la réglementation en vigueur concernant ce type d’installation et sera notamment placée sous le contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) comme les autres installations nucléaires de base en France. Conformément à cette réglementation, l’ASN contrôlera très régulièrement le respect des exigences de sûreté mises en œuvre par l’Andra. De nouvelles dispositions pourront être prises à tout moment en cas de retour d’expérience à intégrer ou de changement de normes. Ainsi, les exigences de sûreté ont d’ores et déjà été renforcées notamment suite à la catastrophe de Fukushima. Cigéo n’est cependant pas une centrale nucléaire mais un centre de stockage de déchets radioactifs stabilisés et conditionnés qui du fait de son implantation à 500 mètres de profondeur sera peu vulnérable aux activités humaines comme aux catastrophes naturelles à l’inverse d’une centrale comme celle de Fukushima au Japon.
Enfin, la stabilité et la très faible sismicité de la zone d’implantation du laboratoire souterrain est confirmée par les scientifiques qui ont travaillé sur ce site depuis plus de 20 ans. Le site de Meuse/Haute-Marne appartient à un domaine géologique stable (voir carte), particulièrement favorable pour l’installation d’un stockage. L’activité sismique est en effet extrêmement faible, comme le prouvent les enregistrements de sismicité instrumentale (écoute sismique depuis 1961 à l’échelle de la France) qui sont capables de détecter des microséismes, et les chroniques historiques (séismes ayant été ressentis et/ou ayant occasionné des dégâts au cours des derniers 1 000 ans). Au-delà de ces données, la stabilité et la très faible sismicité du site s’expliquent par sa situation géographique dans le bassin parisien qui est protégé des mouvements liés à la tectonique des plaques (collision du continent africain avec l’Europe).
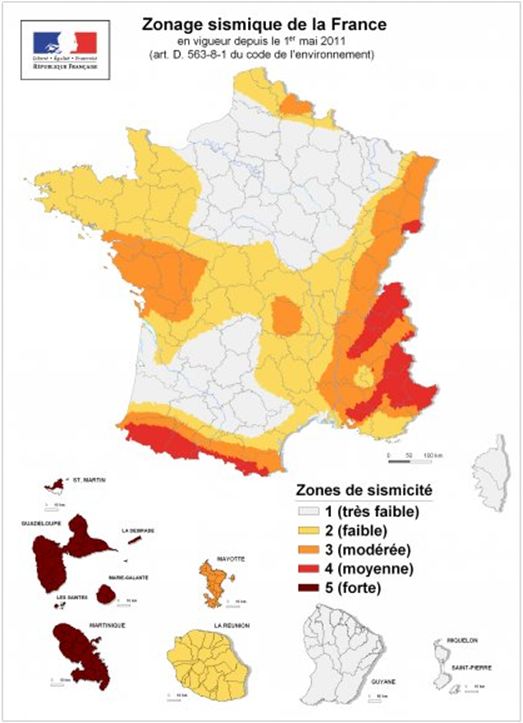
QUESTION 898 - part d'inconnu!!
Posée par yolande SAINT-PAUL, L'organisme que vous représentez (option) (BRAS-SUR-MEUSE), le 15/12/2013
en cas de mouvement de terrain d'infiltation retour de la radioactivite en surface??et alors recrudescence de cancers??n'oublions pas trop rapidement TCHERNOBYL et FUKUSHIMA!!
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 897 - Générations futures et déchets
Posée par Eric VALTOT, L'organisme que vous représentez (option) (VRECOURT), le 15/12/2013
L'homme ne maitrise toujours pas la technique concernant le recyclage des déchets radio actifs puisqu'il continue de les enfouir, augmentant ainsi l'héritage mortel que nous laisserons à nos enfants. Quel intérêt y a t-il à poursuivre l'exploitation d'une énergie dangereuse pour la planète et ses habitants qui conduit à mépriser nos propres enfants ?
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Le choix du stockage géologique réversible a été acté par la loi du 28 juin 2006, car c’est la solution qui est reconnue comme la plus sûre pour la gestion à long terme des déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue. Ce choix a été fait après un programme de quinze années d’études et recherches encadrée par la loi « Bataille » de 1991, un débat public en 2005-2006 et les avis des évaluateurs sur ces recherches. Il est conforté au niveau international par la directive européenne du 19 juillet 2011 qui considère que « il est communément admis que sur le plan technique, le stockage en couche géologique profonde constitue, actuellement, la solution la plus sûre et la plus durable en tant qu’étape finale de la gestion des déchets de haute activité et du combustible usé considéré comme déchet. »
En matière de transition énergétique, le Président de la République a fixé le cap suivant pour le mix électrique français : réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% d'ici 2025. Parallèlement, le Président de la République a indiqué que la transition énergétique serait fondée sur deux principes : l'efficacité énergique d'une part, et la priorité donnée aux énergies renouvelables d'autre part. Cette mutation prendra du temps et supposera des étapes d’évaluation en fonction des progrès technologiques et scientifiques et des prix relatifs de chaque source d’énergie.
QUESTION 896 - Votre conscience ne vous titille pas ?
Posée par Luc BARANGER, CITOYEN DU MONDE (RABLAY SUR LAYON), le 15/12/2013
Moi, citoyen du Monde, je pense aux générations futures Moi, citoyen du Monde, je vois la pollution que nous faisons tous Moi, citoyen du Monde, je sais qu’il est encore temps pour changer Moi, citoyen du Monde, j’aspire à un Monde plus respectueux de la Terre Moi, citoyen du Monde, je crois en la force de l’Humain pour se ressaisir Moi, citoyen du Monde, je sais l’importance de chaque petit geste Moi, citoyen du Monde, j’encourage mon prochain à prendre ses responsabilités Moi, citoyen du Monde, je vous conjure de ne pas faire l’irréparable Moi, citoyen du Monde, je rappelle que l’HISTOIRE nous regarde Moi, citoyen du Monde, je souhaite voir la conscience collective s’éveiller enfin Et CIGEO ne finira-t-il pas comme FUKUSHIMA ? La criticité, la concentration d’hydrogène, le risque d’explosion, la chaleur des colis, l ‘élévation du site sous cette chaleur, le risque de fissures engendré par cette élévation, la désagrégation de l’argile sous l’effet de l’eau, le ruissellement de l’eau au contact des colis radioactifs, la pollution des nappes et cours d’eau, la contamination des humains vivant dans la région, l’augmentation des cas de leucémies et autres cancers autour des sites nucléaires, pour ne citer que ces critères, cela ne vous inquiète pas un petit peu au fond de votre conscience ?
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les chercheurs et ingénieurs qui travaillent depuis de nombreuses années sur le projet ont aussi le sentiment d’être des citoyens responsables agissant pour trouver une solution sûre permettant de protéger les générations actuelles et futures des risques liés aux déchets radioactifs.
Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, tous les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation doivent être identifiés par l’Andra en amont de la conception. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
QUESTION 895 - Justification de la méthode de l'enfouissement
Posée par geneviève PORTES, L'organisme que vous représentez (option) (BIZE), le 15/12/2013
Comment pouvez-vous justifier l'enfouissement des déchets radioactifs autrement que "Après nous le déluge" quand on sait que des déchets ont une demi-vie de quelques milliards d'années ???
Réponse du 21/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage en surface. En effet, laisser les déchets dans des installations en surface impliquerait de renouveler périodiquement les bâtiments où ils seraient placés, de contrôler ces installations et de les maintenir. En cas de perte de contrôle de ces installations, les conséquences radiologiques sur l’homme et l’environnement ne seraient pas acceptables. Compte tenu de la durée pendant laquelle ces déchets resteront dangereux (plusieurs centaines de milliers d’années), l’entreposage - qu’il soit en surface ou à faible profondeur - ne peut être qu’une solution provisoire dans l’attente d’une solution définitive.
QUESTION 894 - Garantissez vous à 100% la sécurité de l'enfouissement ?
Posée par Belle DU HAVRE, L'organisme que vous représentez (option) (LIBOURNE), le 15/12/2013
Garantissez vous à 100% la sécurité de l'enfouissement à 10000 ans? et ce quelque soient les attaques et imprévus envisageables (fuites, tremblement de terre, erreur humaine, faille informatique, ...) ? par ailleurs, est-ce éthique de considérer la terre comme une poubelle au service des inconséquences de l'exploitation des ressources par l'espèce humaine ?
Réponse du 21/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Pour ce qui concerne la sûreté
Le risque zéro n’existe pas et l’Andra ne prétend pas que le projet Cigeo ferait exception à la règle.
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestions sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Sur le long terme, la couche d’argile dans laquelle est implantée le stockage garantit l’éloignement des déchets radioactifs de la surface. Seuls quelques radionucléides mobiles et dont la durée de vie est longue pourront migrer à travers la couche d’argile après plusieurs dizaines de milliers d’années, puis potentiellement atteindre ensuite la surface et les nappes phréatiques, après plus de 100 000 ans et en quantités extrêmement faibles. Leur impact radiologique serait alors plusieurs dizaines de fois inférieur à la radioactivité naturelle.
Cigéo sera soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
Pour ce qui concerne la Terre et les ressources naturelles
La Terre n’est pas considérée comme une poubelle. La couche d’argile dans laquelle est prévue le stockage garantit l’éloignement des déchets radioactifs de la surface. Par ailleurs, il n’existe pas de ressource naturelle exceptionnelle à l’aplomb de la zone étudiée pour le stockage profond.
QUESTION 893 - reversible
Posée par bernard MOLINIER, ORGANISME VIVANT (LA ROCHELLE), le 15/12/2013
REVERSIBLE??? A t-on la prétention de faire disparaître la radioactivité de ce qui est contaminé?...ou bien s'agit-il de faire remonter en surface les déchets radioactifs? NON LA RADIOACTIVITE N'EST PAS REVERSIBLE elle est DEFINITIVE
Réponse du 31/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestions sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 892 - Responsabilité
Posée par Camille VIAL, L'organisme que vous représentez (option) (LES ASSIONS), le 15/12/2013
La décision d'enfouir les déchets a-t-elle bien pris en compte d'impact de cette démarche sur l'environnement ?
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
Oui, c’est même sa vocation première. L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site.
Si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
QUESTION 891 - combien de sacrifice humain encore ?
Posée par billard PHILIPPE, L'organisme que vous représentez (option) (FÉCAMP), le 15/12/2013
Combien de sacrifice humain encore ? vous ne pouvez occulter dans votre débat, la question de la santé au travail. dans le cadre du nucléaire, les salariés sont exposés à des rayonnements ionisants et c'est ça qui porte atteinte à leur santé. nous sommes dans le cadre identique de l'amiante avec de trop nombreux salariés déjà malades et pour certains décédés. comment pouvez-vous vous regarder dans une glace avec les cadavres que vous laissez sur votre chemin. le salarié n'est pas pris en compte dans cette industrie mortifère c'est aussi pour ça que le nucléaire est annoncé comme l'énergie la moins coûteuse. moins de co2, pas sur, sur plus de malade, plus de souffrance, plus de maltraitance. comme pour l'amiante en son temps, nous avons su dire non mais il aura fallu des milliers de morts et il y en a encore à venir et puis maintenant ceux du nucléaire. vous n'êtes pas ignares au point de ne pas savoir que le feu nucléaire tue à petit feu les salariés qui le reçoivent. n'en rajouter pas la coupe est pleine!!!
Réponse du 10/02/2014,
Réponse apportée par EDF :
L’objectif d’EDF est que l’exposition aux rayonnements ionisants soit la plus faible possible au sein de ses installations. Sur les sites nucléaires d’EDF, tous les intervenants, qu’ils soient salariés du groupe ou d’entreprises prestataires, bénéficient des mêmes conditions de radioprotection et de suivi médical. Ils suivent des formations spécifiques en radioprotection tous les 3 ans. Les travailleurs qui interviennent en zone nucléaire sont suivis médicalement à fréquence régulière. Ils font l'objet de contrôles systématiques avant et après chaque intervention en zone nucléaire, afin de s'assurer de l’absence de contamination. Lors des interventions en zone nucléaire, à savoir les zones où les intervenants pourraient être exposés à des rayonnements et dont l’accès est contrôlé, chacun est obligé de porter une tenue de protection. En zone nucléaire, les intervenants doivent être munis de deux dosimètres dont les données sont transmises à l’IRSN, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire : le premier renseigne la dose externe reçue depuis le début de l’intervention, le second renseigne la dose reçue par l’intervenant depuis le début du mois. La dose maximale d’exposition des intervenants dans ses installations a été fixée par EDF à 16 mSv/an, une valeur inférieure à celle retenue par le code du travail (20mSv/an).
Les intervenants dans les installations nucléaires EDF (salariés EDF et sous-traitants) reçoivent en moyenne 1,31 mSv/an, soit moins que la dose de radioactivité naturelle reçue sur la même période (2,4 mSv en France) et moins que la dose reçue au cours d’un scanner abdominal (10 mSv).
Grâce aux efforts engagés ces dernières années par EDF dans le domaine de la radioprotection, la dose moyenne reçue par les intervenants exposés aux rayonnements ionisants est passée de 4,6 mSv/an en 1992 à 1,31 mSv/an en 2011.
La surveillance des travailleurs exposés aux rayonnements en France est assurée par l’IRSN, un organisme public et indépendant. Chaque année, l’IRSN publie le bilan de la surveillance des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants en France. (Disponible sur http://www.irsn.fr )
En 2011, parmi les 12 personnes ayant reçu une dose supérieure à la limite réglementaire, une seule était un travailleur du nucléaire. En effet l’IRSN ne contrôle pas seulement les expositions aux rayonnements ionisants dans le secteur nucléaire, mais aussi dans le domaine médical et vétérinaire, dans l’industrie non nucléaire et dans le domaine de la recherche (343.988 travailleurs surveillés en 2011).
QUESTION 890 - aux enfouisseurs : quels choix , pour votre propre famille ?
Posée par monique HARTMANN, L'organisme que vous représentez (option) ( FRANCE), le 15/12/2013
question aux partisans de l ' enfouissement : actuellement , si vos enfants envisageaient de s ' établir à côté d ' un site d ' enfouissement , est ce que vous ne feriez pas tout pour qu ' ils changent d ' avis ?
Réponse du 31/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site.
Toutes les personnes qui travaillent à l’Andra partagent une même valeur : la responsabilité. Nous sommes responsables de la sûreté de nos installations. Nous sommes également responsables devant les générations futures. Les personnes de l’Andra qui travaillent sur les sites de stockage et habitent à proximité sont les premières concernées par la sécurité. Croyez-vous qu’elles accepteraient de travailler sur un site dont la sûreté ne serait pas garantie ?
QUESTION 889 - lien civil militaire
Posée par Christiane VIDAL, L'organisme que vous représentez (option) (ST SYMPHORIEN SOUS CHOMERAC), le 15/12/2013
est-ce que ce ne sont pas les enjeux guerre et paix qui poussent nos dirigeants à garder le nucléaire civil (parce que lié au militaire pour garantir la relative tranquillité des populations face au danger d'une attaque étrangère) quite à dépenser des sommes folles et à hypothéquer notre santé ?
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
La loi du 28 juin 2006 a fait le choix du stockage réversible profond pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations futures. Elle demande à l’Andra d’étudier et d’implanter Cigéo en rappelant que « la demande d'autorisation de création [d’un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs] doit concerner une couche géologique ayant fait l'objet d'études au moyen d'un laboratoire souterrain ». L’Andra poursuit donc ses études en vue d’élaborer pour 2015 le dossier support à l’instruction de la demande d’autorisation de création de Cigéo en Meuse/Haute-Marne, dans la couche d’argile dont les propriétés de confinement sont désormais reconnues.
Quelles que soient les orientations en matière de politique nucléaire, les déchets déjà produits devront être gérés de façon sûre et responsable. Il est par conséquent nécessaire de consacrer de l’argent à la construction et à l’exploitation des centres de stockage. En vertu de la loi, ces sommes qui ont été mises de côté par les producteurs de déchets ne peuvent pas être détournées à d’autres fins. Cela conduirait à reporter intégralement sur les générations futures les charges de long terme liées à la gestion des déchets radioactifs.
Enfin, le Président de la République a décidé d’engager la transition énergétique, cette transition reposant d'une part sur la sobriété et l’efficacité énergétique, et d'autre part sur la diversification des sources de production et d'approvisionnement.
Concernant la diversification de nos sources d’énergies, le Président de la République a fixé un cap : réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% d'ici 2025. Parallèlement, le Président de la République a indiqué que la transition énergétique serait fondée sur deux principes : l'efficacité énergétique d'une part, et la priorité donnée aux énergies renouvelables d'autre part. Cette mutation prendra du temps et supposera des étapes d’évaluation en fonction des progrès technologiques et scientifiques et des prix relatifs de chaque source d’énergie.
QUESTION 888 - leucémie et cancer
Posée par catherine MERCCION, L'organisme que vous représentez (option) (JAYAT), le 15/12/2013
Autour du centre de la Hague , les cancers ont augmenté..; Dans ma région (quart sud-est ), de plus en plus de problème de thyroïde , que répondez vous à cela...? On continue à faire les autruches ? Catherine Merccion
Réponse du 27/01/2014,
Réponse apportée par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) :
L’exposition à des rayonnements ionisants n’est pas la seule cause connue des cancers. L’incidence des cancers en France varie dans le temps et dans l’espace, et des bilans de ces variations sont régulièrement réalisés par l’Institut National de Veille Sanitaire ou l’Inca sur la base des données des registres de cancer.
Une surveillance régulière des cancers dans le département de la Manche et plus particulièrement dans le Nord-Cotentin est assurée par le registre des cancers de La Manche. Les résultats de cette surveillance ne font pas apparaître d’incidence significativement plus élevée autour du site de La Hague. Nous vous renvoyons pour plus d’information au rapport récemment publié dans le bulletin d’information des CLIs de la Manche (voir document associé n°1).
Une augmentation de l’incidence des cancers de la thyroïde est en effet observée durant les dernières décennies en France, comme dans la plupart des pays industrialisés. En France, cette évolution temporelle a été analysée en détail par l’Institut National de Veille Sanitaire (voir document associé n°2). L’analyse montre que cette évolution est due principalement à l’amélioration des méthodes de diagnostic, qui permettent de détecter des nodules de plus en plus petits, en l’absence de tout signe clinique.
Documents associés
QUESTION 887 - garantie de financement
Posée par Yves GROSSET-GRANGE, L'organisme que vous représentez (option) (LA ROCHELLE), le 15/12/2013
Sachant que les dépenses futures relatives à CIGEO sont censées être financées par des provisions, qui sont elles-mêmes censées rapporter 5% par an pendant très longtemps pour atteindre à échéance les sommes supposées être suffisantes, comment pouvons nous garantir à nos descendants que nous leur laisserons ce qu'il faut pour les payer lorsqu'il y aura du boulot à faire pour leur protection contre nos poisons ?
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Le calcul des provisions correspondantes aux charges de gestion à long terme des déchets radioactifs, qui est sous la responsabilité des exploitants, fait l'objet du contrôle du gouvernement au titre des articles L.594-1 et suivants du code de l'environnement. L'exploitant doit donc montrer annuellement que leur calcul et les actifs financiers dédiés au financement des charges permettront, à terme, de bien couvrir les dépenses futures.
Par ailleurs, le taux d'actualisation, auquel vous faite référence, est plafonné par les textes règlementaires pour s'adapter à l'évolution des taux de marchés. Ainsi, le taux d'actualisation réel était plafonné à environ 2,8% fin 2012.
QUESTION 886 - niveau de sureté de l'installation ?
Posée par Jean-Noël ANTOINE, L'organisme que vous représentez (option) (HIERES SUR AMBY), le 15/12/2013
Bonjour, J'ai bien noté l'intérêt visuel du projet de l'enfouissement des déchets nucléaires et aussi les dangers liés à la radioactivité sur le corps humain. Comment pouvez vous assurer de manière complétement objective et avec bon sens, sans être motivé par quelque lobby que ce soit, que les déchets seront toujours dans les conditions premières de leur entreposage ne serait-ce que dans 30 ans? que la sécurité de l'installation pourra être assurée dans ne serait-ce que 20 ans (gestion des accès, solidité des ouvrages, multiplication d'une chaine d'accidents mineurs,...)? Il est acquis que les décisions requièrent un arbitrage entre le bénéfice et les dommages qui y sont liés. Au risque de le perte de vie humaines, de quelques une à plusieurs dizaines de milliers, car c'est le risque encouru, comment peut-on opposer quelques intérêts électoralistes ou mercantiles? Nous n'avons absolument aucune vision, ne serait-ce que partielle du devenir de cet enfouissement . Son appréciation est à l'image de n'importe quel dépôt de matière inerte sauf que les produits enfouis ne sont pas inertes. Dans l'espoir que mon message fera prendre conscience de la gravité du projet pour notre génération et celles à venir. Cordialement, JN ANTOINE
Réponse du 21/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique, sur la conception du stockage et sur le conditionnement des déchets. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 885 - et demain
Posée par Nicolas URLACHER, L'organisme que vous représentez (option) (VOUTHON HAUT), le 15/12/2013
Est-on certain, si notre technicité évolue, de pouvoir récupérer et retraiter ces matières hautement radio actives?
Réponse du 13/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le projet Cigéo est conçu pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets français les plus radioactifs et ne pas reporter leur charge sur les générations futures. Il est également important de laisser aux générations suivantes la possibilité de faire évoluer cette solution si elles le souhaitent. C’est pourquoi le Parlement a demandé que le stockage, prévu pour être définitif, soit réversible pendant au moins 100 ans. Les conditions de réversibilité seront définies par une future loi avant que la création de Cigéo ne puisse être autorisée. La notion de réversibilité ne comprend donc pas uniquement la notion de récupérabilité mais se décline en trois points :
- Pouvoir récupérer les colis de déchets stockés (récupérabilité)
- Choisir le calendrier de fermeture du stockage
- Préparer les décision ensemble et organiser le passage de relais entre les générations.
Ainsi grâce à la réversibilité, les générations suivantes garderont la possibilité de faire évoluer cette solution si elles le souhaitent. L’Andra place cette demande de la société au cœur du projet. Elle a ainsi fait des propositions concrètes pour pouvoir récupérer les colis de déchets si besoin et laisser des choix possibles aux générations suivantes (../docs/rapport-etude/fiche-reversibilite-cigeo.pdf) :
1) Contrôler le déroulement du processus de stockage
Pendant au moins 100 ans, les générations suivantes pourront contrôler le déroulement du stockage et récupérer des déchets stockés si elles le souhaitent. L’Andra propose que des rendez-vous réguliers soient organisés avec l’ensemble des acteurs (riverains, collectivités, évaluateurs, État…) pour faire le point sur l’exploitation du stockage et les prochaines étapes. Ces discussions seront alimentées par la surveillance du stockage et les résultats des réexamens de sûreté (l’Autorité de sûreté nucléaire impose un réexamen périodique de sûreté, au moins tous les 10 ans, pour toutes les installations nucléaires). Ces rendez-vous offriront aussi aux générations suivantes la possibilité de réexaminer périodiquement les conditions de réversibilité.
2) Préserver la possibilité de mettre en œuvre d’autres modes de gestion
De nombreuses solutions pour gérer les déchets radioactifs ont été imaginées depuis 50 ans : les envoyer dans l’espace, au fond des océans ou dans le magma, les entreposer plusieurs centaines d’années en surface ou à faible profondeur, les transmuter… Seul le stockage profond est aujourd’hui reconnu en France et à l’étranger comme une solution robuste pour mettre en sécurité ces déchets à très long terme. Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de ces déchets.
Grâce à la réversibilité, les générations suivantes garderont la possibilité de faire évoluer cette solution. Les rendez-vous proposés par l’Andra seront notamment alimentés par les résultats des recherches qui continueront à être menées sur la gestion des déchets radioactifs et les avancées technologiques. A chaque étape, il sera possible de décider de poursuivre le processus de stockage tel qu’initialement prévu ou de le modifier, par exemple si des solutions alternatives sont identifiées.
3) Conserver une possibilité d’intervention en cas d’évolution anormale
Les expérimentations menées au Laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne ont permis de qualifier in situ les propriétés de la roche argileuse, d’étudier les perturbations qui seraient induites par la réalisation d’un stockage (effets du creusement, de la ventilation, de la chaleur apportée par certains déchets…), de mettre au point des méthodes d’observation et de surveillance et de tester les procédés de réalisation qui pourraient être utilisés si Cigéo est mis en œuvre.
L’étape suivante sera d’acquérir une expérience complémentaire lors de la réalisation des premiers ouvrages de stockage. Si Cigéo est autorisé, le démarrage de l’exploitation se fera de manière progressive. Des premiers colis de déchets radioactifs pourraient être pris en charge à l’horizon 2025. Dans son avis du 16 mai 2013, l’Autorité de sûreté nucléaire a recommandé une phase de « montée en puissance » progressive de l’exploitation du stockage. L’évolution du stockage sera surveillée tout au long de l’exploitation de Cigéo. Les rendez-vous proposés par l’Andra seront alimentés par les résultats de la surveillance du stockage.
4) Pouvoir récupérer des colis de déchets
L’Andra prévoit dès la conception de Cigéo des dispositifs techniques destinés à faciliter le retrait éventuel de colis de déchets stockés. Les tunnels pour stocker les colis de déchets seront ainsi revêtus d’une paroi en béton ou en acier pour éviter les déformations, avec des espaces ménagés entre les colis et les parois pour permettre leur retrait. Des capteurs permettront de surveiller le comportement des ouvrages. Des essais de retrait de colis pourront être réalisés périodiquement dans le stockage pendant son exploitation. Dans l’hypothèse d’une évolution de la politique en matière de gestion des déchets radioactifs qui conduirait à envisager une opération de retrait d’un nombre important de colis de déchets, de nouvelles installations devraient être créées pour prendre en charge ces déchets (reconditionnement éventuel, expédition, entreposage, traitement…).
5) Ne pas abandonner le site
Après fermeture, la sûreté du stockage sera assurée de manière passive, c’est-à-dire sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique, qui sert de barrière naturelle à très long terme, et sur la conception du stockage. Une surveillance sera néanmoins maintenue après la fermeture du stockage aussi longtemps que la société le souhaitera et des actions seront menées pour conserver et transmettre sa mémoire. Le Parlement a d’ores et déjà décidé que seule une loi pourrait autoriser la fermeture définitive du stockage. Cette future loi pourra fixer les conditions dans lesquelles le site restera contrôlé, sa surveillance maintenue et la mémoire conservée.
QUESTION 884 - referendum
Posée par FAYS BERNARD, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS ), le 15/12/2013
Serait-il possible d'envisager un référendum limité aux électeurs des trois départements concernés (Meuse, Haute Marne et Vosges) sur l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure?
Réponse du 11/02/2014,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Plusieurs procédures de consultation sont organisées afin de recueillir l’avis des populations locales et nationales - directement ou par le biais des instances chargées de les représenter - (débat public, avis des collectivités territoriales, enquête publique).
Le Parlement fixe périodiquement les choix relatifs à la mise en œuvre de ce projet :
- loi du 30 décembre 1991, dite loi « Bataille », fixant un programme d’études et recherches de 15 années d’études et recherches sur les déchets radioactifs ;
- loi du 28 juin 2006, définissant le stockage géologique profond comme solution de référence pour les déchets les plus radioactifs et demandant sa mise en service en 2025 ;
- loi à venir sur la réversibilité du projet.
L’Etat est par ailleurs en contact permanent avec les parties prenantes locales. Un important travail de concertation a été mené, notamment avec les exécutifs locaux, pour élaborer un projet de schéma interdépartemental du territoire.
L’avis des populations locales au travers des procédures de consultation et l’expression de leurs représentants au Parlement est primordiale.
QUESTION 883 - Quel degré de complexité ?
Posée par Michel CHAMPEAU, L'organisme que vous représentez (option) (BESANÇON), le 15/12/2013
Pouvez vous me citer une autre technologie productrice d'énergie qui, dans la totalité de son cycle, atteignent un tel d° de complexité (et par conséquent de risques non maitrisables), et qui oblige à mettre en oeuvre des dispositifs aussi démesurés pour tenter (et avec autant d'inconnues) de se débarrasser de ses déchets et risques de pollutions ? ( = contamination, pour le nucléaire)
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
D’autres formes d’énergie que l’énergie nucléaire peuvent produire des déchets ou des pollutions, qui sont de nature très différente des déchets radioactifs. Par exemple, les centrales thermiques utilisant des énergies fossiles produisent notamment du CO2 (principal gaz à effet de serre).
QUESTION 882 - Pourquoi
Posée par Geoges PROST, L'organisme que vous représentez (option), le 14/12/2013
-Pourquoi les promoteurs de ce projet font ils cela? - Pourront ils se supporter dans quelques temps? - Que diront ils à leurs descendants quand ceux ci les questionneront? -N'ont ils pas le courage de dire non à l'ANDRA?
Réponse du 27/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 881 - Peut-on certifier l'innocuité de l'enfouissement ?
Posée par Colette BURDAIRON, L'organisme que vous représentez (option), le 14/12/2013
Comment pouvez-vous affirmer l'innocuité de l'enfouissement des déchets nucléaire à long, voire très long terme. Si on regarde ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité, rien ni personne n'est sûr qu'un tremblement de terre, une faille qui s'ouvre, une infiltration d'eau, un accident dû à une erreur humaine... ne puisse arriver. Ceux qui auront pris la responsabilité d'une telle décision auront peu de chance d'être encore vivants quand les radionucléides auront refait surface et pollueront irrémédiablement la terre en détruisant la vie de nos descendants. De cette responsabilité, je n'en veux pas et suis donc opposée à cette décision.
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose d’ores et déjà car la plupart des déchets concernés par le projet Cigéo existent. Ils ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 880 - démocratie
Posée par bernadette PRIEUR, L'organisme que vous représentez (option) (SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE), le 14/12/2013
1-Pourquoi me demander mon avis alors que la décision est prise et qu'on ne m'a jamais demandé mon avis sur ce type d'énergie productrice de déchets nucléaires alors que j'ai 73 ans? 2-pourquoi les industriels pour avoir l'autorisation de fonctionner sont obligés de prouver qu'ils peuvent traiter leurs déchets, alors que les centrales nucléaires ont eu l'autorisation sans avoir à prouver qu'ils pouvaient traiter les déchets radioactifs et les abandonnent aux générations futures? 3-pourquoi la science ne peut pas les traiter alors qu'on nous le promet depuis 50 ans? 4-pourquoi créer un nouveau site qui va être contaminé à son tour, alors qu'il y a tous les sites des centrales déjà contaminés? 5- pourquoi ne pas les y laisser sous surveillance en subsurface? 6-pourquoi concentrer tous ces déchets sur un même site en multipliants les transports et les risques inhérents? 7- au nom de quels principes laisser cette gestion aux générations futures? y-a-t-il une fondation pour financer la gestion de ces déchets? si non Est-ce avec les impôts de nos descendants?
Réponse du 10/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
1-Pourquoi me demander mon avis alors que la décision est prise et qu'on ne m'a jamais demandé mon avis sur ce type d'énergie productrice de déchets nucléaires alors que j'ai 73 ans?
Le Parlement s’est saisi de la question des déchets radioactifs en 1991. Depuis plus de 20 ans, l’ensemble des recherches menées sur la gestion des déchets radioactifs sont évaluées sur le plan scientifique et de la sûreté par des autorités indépendantes, en particulier l’Autorité de sûreté nucléaire et la Commission nationale d’évaluation mise en place par le Parlement. Ces évaluations sont disponibles sur le site du débat public. Les élus locaux sont associés de manière continue à l’ensemble de ces travaux et près de 100 000 visiteurs ont fait la démarche de venir visiter le site du Laboratoire souterrain. Deux débats publics ont été organisés. Un Comité local d’information et de suivi a été mis en place auprès du Laboratoire souterrain, avec la participation d’associations opposées au projet de stockage.
Aujourd’hui, la décision de créer Cigéo n’est pas encore prise. L’Andra a justement souhaité que le débat public intervienne en 2013, quand le projet n’est pas encore finalisé, pour prendre en compte le débat public dans la suite de ses études en vue d’établir le dossier de demande d’autorisation de création du centre de stockage. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra à l’État après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo en 2015. Ce processus comprendra notamment une évaluation de sûreté par l’Autorité de sûreté nucléaire et une évaluation scientifique par la Commission nationale d’évaluation, l’avis des collectivités territoriales, le vote d’une nouvelle loi fixant les conditions de réversibilité et une enquête publique.
2-Pourquoi les industriels pour avoir l'autorisation de fonctionner sont obligés de prouver qu'ils peuvent traiter leurs déchets, alors que les centrales nucléaires ont eu l'autorisation sans avoir à prouver qu'ils pouvaient traiter les déchets radioactifs et les abandonnent aux générations futures? Pourquoi la science ne peut pas les traiter alors qu'on nous le promet depuis 50 ans?
La question des déchets radioactifs a été abordée dès les années 1950 et les débuts de la production d’électricité d’origine nucléaire. C’est au cours des années 1960 et 1970 que le stockage a commencé à être considéré comme une possibilité de gestion au sein de la communauté scientifique internationale et notamment le stockage profond pour les déchets de haute activité et à vie longue. Dans les années 1980, des investigations étaient prévues pour rechercher des sites susceptibles d’accueillir des laboratoires souterrains. Mais les discussions sont restées limitées aux experts techniques et scientifiques et l’opinion publique s’est opposée aux projets. Le Parlement s’est alors saisi de la question des déchets radioactifs et a voté en 1991 une première loi qui a défini un programme de recherche pour les déchets de haute activité et à vie longue. Après 15 ans de recherche, leur évaluation et un débat public, une seconde loi a été votée en 2006. Elle a retenu le stockage profond comme solution de gestion à long terme de ces déchets pour protéger l’homme et l’environnement sur le très long terme et afin de limiter la charge de leur gestion sur les générations futures.
D’autres solutions ont été étudiées en France et à l’étranger depuis plus de 50 ans : envoi dans l’espace, au fond des océans, dans le magma, séparation-transmutation… Le stockage est aujourd’hui considéré dans tous les pays comme la meilleure solution pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs sur le très long terme. La directive européenne du 19 juillet 2011 considère ainsi que le stockage géologique constitue actuellement la solution la plus sûre et la plus durable en tant qu’étape finale de la gestion des déchets de haute activité.
3-Pourquoi créer un nouveau site qui va être contaminé à son tour, alors qu'il y a tous les sites des centrales déjà contaminés? Pourquoi ne pas les y laisser sous surveillance en subsurface?
Pourquoi concentrer tous ces déchets sur un même site en multipliant les transports et les risques inhérents?
L'entreposage actuel des déchets sur leurs sites de production est une solution provisoire qui ne peut être pérennisée. En effet, elle nécessite l’intervention régulière de l’homme pour contrôler, maintenir et reconstruire les installations, ce qui ne peut être garanti sur le long terme. En cas de perte de contrôle de telles installations, les conséquences radiologiques sur l’homme et l’environnement ne seraient pas acceptables.
Le stockage à 500 mètres de profondeur dans une couche géologique assurant le confinement à l’échelle de plusieurs centaines de milliers d’années permet de protéger l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue et de ne pas reporter indéfiniment la charge de leur gestion sur les générations futures. Ce type de stockage doit être implanté dans un milieu géologique favorable (stabilité géologique, très faible sismicité…) et une couche de roche dont les propriétés permettent le confinement des déchets sur de très longues échelles de temps (profondeur et épaisseur suffisante, stabilité, faible perméabilité, propriétés de rétention…). C’est pour cela que le site choisi en Meuse/Haute-Marne est étudié pour l’implantation de Cigéo.
4- Au nom de quels principes laisser cette gestion aux générations futures? y-a-t-il une fondation pour financer la gestion de ces déchets? Si non Est-ce avec les impôts de nos descendants?
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 879 - Fuites radioactives et contamination
Posée par Mario MULÉ, L'organisme que vous représentez (option) ( LA TRINITÉ), le 14/12/2013
Le stockage en surface de la Hague, actuellement saturé, s'est rendu responsable de la contamination des nappes phréatiques proches de la villa de Cherbourg et de la rivière Sainte Hélène. Ne pensez vous pas que lors de la perte évidente de confinement 1 siècle après la fin du stockage, la contamination de la nappe phréatique déjà présente lors des forage sera évidente aussi, avec les conséquences qui sont aussi évidentes pour les bassins d'alimentation de la région parisienne ?
Réponse du 30/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
Vous faites sans doute référence au Centre de stockage de la Manche de l’Andra créé en 1969, exploité jusqu’en 1994 et entré en phase de surveillance en 2003. Sachez que tous les contrôles effectués année après année confirment que l’impact de ce centre est très faible, plus de 1 000 fois inférieur à l’impact de la radioactivité naturelle. Les résultats de la surveillance du Centre sont présentés chaque année à la Commission locale d’information et sont consultable sur le site internet de l’Andra (voir le rapport annuel sur http://www.andra.fr/index.php?id=edition_1_3_1&recherche_thematique=1).
Concernant Cigéo, s’il est autorisé, de nombreuses mesures seront prises pendant son exploitation pour prévenir d’éventuelles arrivées d’eau accidentelles dans Cigéo :
- Protection des puits et de la descenderie contre les intempéries,
- Etanchéification des puits et des descenderies au niveau des couches de roche aquifères traversées au-dessus de la couche d’argilite,
- Systèmes de drainage des eaux issues des couches de roche supérieures peu productives et pompage de ces eaux jusqu’à la surface,
- Protection des canalisations d’eau interne et mécanismes de fermeture automatique en cas de rupture.
Par précaution, des scénarios accidentels d’arrivées d’eau (par exemple suite à la défaillance d’une canalisation ou suite à une panne dans le système de drainage des eaux provenant des couches de roche supérieures) sont pris en compte dans les études de sûreté menées pour Cigéo, au même titre que pour n’importe quelle installation nucléaire. Compte tenu des origines possibles, ce débit sera nécessairement limité (pour mémoire le débit drainé par chacun des puits du Laboratoire souterrain est de l’ordre de 10 m3/jour en moyenne, ou moins, ce qui est très faible par comparaison à certains sites miniers). Un tel évènement resterait très localisé dans le stockage et n’aurait qu’un effet très limité sur l’argile qui sera protégée par les revêtements. En tout état de cause, ce type d’incident ne remettra pas en cause la sûreté du stockage.
Après la fermeture du stockage, au-delà de la durée de vie des ouvrages industriels, la couche d’argile très peu perméable, de plus de 130 mètres d’épaisseur, dans laquelle sera installé le stockage souterrain, servira de barrière naturelle pour retenir les radionucléides contenus dans les déchets et freiner leur déplacement. Le stockage permet ainsi de garantir leur confinement sur de très longues échelles de temps. Seuls quelques radionucléides mobiles et dont la durée de vie est longue pourront migrer jusqu’aux limites de la couche d’argile qu’ils atteindront après plusieurs dizaines de milliers d’années, puis potentiellement atteindre en quantités extrêmement faibles ensuite la surface et les nappes phréatiques, après plus de 100 000 ans. Leur impact radiologique serait alors plusieurs dizaines de fois inférieur à la radioactivité naturelle (qui est de 2,4 mSv par an en moyenne en France).
QUESTION 878 - aucun retour d'experience du stockage profond
Posée par michel PRIEUR, ADEPAL (SAINT YRIEIX LA PERCHE), le 14/12/2013
pourquoi ne pas stocker en surface auprès des centrales pour que chacun soit responsable de ses choix? cela garantirait la récupération des déchets si on découvre un recyclage; Il ne devait y avoir qu'un laboratoire et on fait un stockage définitif, c'est un abus de pouvoir. Il est criminel de sacrifier les générations futures. va t-on informer les pays voisins des risques futurs?
Réponse du 07/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Pourquoi voyez-vous dans le projet Cigéo un sacrifice des générations futures ? C’est au contraire un choix responsable que notre génération fait pour elles. La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage en surface. En effet, laisser les déchets dans des installations en surface impliquerait de renouveler périodiquement les bâtiments où ils seraient placés, de contrôler ces installations et de les maintenir. En cas de perte de contrôle de ces installations, les conséquences radiologiques sur l’homme et l’environnement ne seraient pas acceptables. Compte tenu de la durée pendant laquelle ces déchets resteront dangereux (plusieurs centaines de milliers d’années), l’entreposage - qu’il soit en surface ou à faible profondeur - ne peut être qu’une solution provisoire dans l’attente d’une solution définitive.
D’autres solutions ont été étudiées en France et à l’étranger depuis plus de 50 ans : envoi dans l’espace, au fond des océans, dans le magma, séparation-transmutation… Le stockage est aujourd’hui considéré dans tous les pays comme la meilleure solution pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs sur le très long terme. La directive européenne du 19 juillet 2011 considère ainsi que le stockage géologique constitue actuellement la solution la plus sûre et la plus durable en tant qu’étape finale de la gestion des déchets de haute activité.
Dernier point, à propos d’abus de pouvoir. Il convient de rappeler l’histoire de Cigéo :
Le Parlement s’est saisi de la question des déchets radioactifs en 1991. Depuis plus de 20 ans, l’ensemble des recherches menées sur la gestion des déchets radioactifs sont évaluées sur le plan scientifique et de la sûreté par des autorités indépendantes, en particulier l’Autorité de sûreté nucléaire et la Commission nationale d’évaluation mise en place par le Parlement. Ces évaluations sont disponibles sur le site du débat public. Les élus locaux sont associés de manière continue à l’ensemble de ces travaux et près de 100 000 visiteurs ont fait la démarche de venir visiter le site du Laboratoire souterrain. Deux débats publics ont été organisés. Un Comité local d’information et de suivi a été mis en place auprès du Laboratoire souterrain, avec la participation d’associations opposées au projet de stockage. Aujourd’hui, la décision de créer Cigéo n’est pas encore prise. L’Andra a justement souhaité que le débat public intervienne en 2013, quand le projet n’est pas encore finalisé, pour prendre en compte le débat public dans la suite de ses études en vue d’établir le dossier de demande d’autorisation de création du centre de stockage. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra à l’État après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo en 2015. Ce processus comprendra notamment une évaluation de sûreté par l’Autorité de sûreté nucléaire et une évaluation scientifique par la Commission nationale d’évaluation, l’avis des collectivités territoriales, le vote d’une nouvelle loi fixant les conditions de réversibilité et une enquête publique.
QUESTION 877 - Quelle révolution industrielle ?
Posée par JM ZIRANO, L'organisme que vous représentez (option) (LYON), le 14/12/2013
Comme le charbon ou le pétrole lors des 2 précédentes révolutions industrielles, l'uranium est seulement quelque part sur notre planète, en des endroits bien précis, donc assez mal réparti. Autour de sa présence, de sa vente, de sa détention et de sa distribution s'organisent des pouvoirs très puissants, le trésor de certaines nations et de certaines entreprises, mais aussi une économie moribonde. Un peu comme autour du pétrole, en somme, mais à une autre échelle et pour des besoins énergétiques différents. Outre la répartition inéquitable de l'uranium sur Terre, l'énergie nucléaire a aussi la particularité de produire des déchets dont la vie (même la demi-vie !) est incommensurable à la vie humaine. Ce sont les 2 raisons essentielles pour lesquelles l'énergie nucléaire ne peut figurer parmi les composants fondamentaux d'une potentielle 3ème révolution industrielle. Les hommes des 100 années qui viennent ont la responsabilité de livrer au générations qui les suivront une planète viable à long terme, sur laquelle l'énergie est mise à disposition sous une forme mieux répartie, pour s'adapter à une économie mondialisée. Cela n'est-il pas fondamentalement incompatible avec le pari du nucléaire ? Cela n'est-il pas plutôt compatible avec, dès aujourd'hui, des investissements dans le vent et le soleil, qui sont, par définition, partout ?
Réponse du 21/01/2014,
Réponse apportée par le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Le Président de la République a décidé d’engager la transition énergétique, cette transition reposant d'une part sur la sobriété et l’efficacité énergétique, et d'autre part sur la diversification des sources de production et d'approvisionnement.
Concernant la diversification de nos sources d’énergies, le Président de la République a fixé un cap : réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% d'ici 2025. Parallèlement, le Président de la République a indiqué que la transition énergétique serait fondée sur deux principes : l'efficacité énergétique d'une part, et la priorité donnée aux énergies renouvelables d'autre part. Cette mutation prendra du temps et supposera des étapes d’évaluation en fonction des progrès technologiques et scientifiques et des prix relatifs de chaque source d’énergie.
QUESTION 876 - Quelles garanties peut-on avoir sur une très longue période?
Posée par Frédéric FAURÉ, L'organisme que vous représentez (option) (MORLAIX), le 14/12/2013
Madame, Monsieur, Les projets d'enfouissement de matières radioactives n'offrent aucune garantie de préservation de la santé des populations dans plusieurs siècles ou plusieurs millénaires. Comment être sûr qu'il n'y aura pas d'incident technique ou de glissement de terrain, permettant une fuite de la radioactivité dans l'environnement ? (sol, eau, air...) Considérant les dangers que présente le plutonium (entre autres), et l'impossibilité de neutraliser ces dangers sur une très longue période, notre génération ne devrait pas s'autoriser à laisser un tel fardeau peser sur les générations suivantes... Je vous prie, Madame, Monsieur, de bien vouloir prendre en considération ma demande d'abandon du projet de stockage profond des déchets radioactifs, et d'envisager sérieusement de mettre un terme, dans un délai raisonnable, à la production de tels déchets que nous n'avons pas la possibilité de rendre inoffensifs. Frédéric Fauré
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
Vous proposez enfin une autre voie pour aborder la question des déchets : ne plus en produire. Il n’appartient pas à l’Andra de se positionner sur la politique énergétique de la France.
Le travail de l’Andra est de s’assurer que, quels que soient les choix énergétiques futurs, notre génération propose aux générations suivantes une solution permettant de mettre définitivement en sécurité les déchets produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles.
QUESTION 875 - COMMENT OSER PORTER ATTEINTE A LA VIE D'AUTRUI ?
Posée par Denise SCHNEIDER, L'organisme que vous représentez (option) (HASTIÈRE (BELGIQUE)), le 14/12/2013
ayant vécu des années sur un site sinistré par des métaux toxiques, en France, j'ai dû fuir ce site par obligation médicale. Quand donc les politiques deviendront-ils lucides, et intègres ? COMMENT OSER ENCORE AGITER LE SPECTRE DE L'EMPLOI , en tuant toute forme de vie, en condamnant la survie de notre espèce, et celle d'autres espèces ? COMMENT OSER PORTER ATTEINTE à la vie d'autrui, et ne pas même chercher d'autres solutions ?
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
La loi du 28 juin 2006 a fait le choix du stockage réversible profond pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations futures. Ce choix a été fait après un programme de quinze années d’études et recherches encadrée par la loi « Bataille » de 1991, un débat public en 2005-2006 et les avis des évaluateurs sur ces recherches. Il est conforté au niveau international par la directive européenne du 19 juillet 2011 qui considère que « il est communément admis que sur le plan technique, le stockage en couche géologique profonde constitue, actuellement, la solution la plus sûre et la plus durable en tant qu’étape finale de la gestion des déchets de haute activité et du combustible usé considéré comme déchet. ».
Elle demande à l’Andra d’étudier et d’implanter Cigéo en rappelant que « la demande d'autorisation de création [d’un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs] doit concerner une couche géologique ayant fait l'objet d'études au moyen d'un laboratoire souterrain ». L’Andra poursuit donc ses études en vue d’élaborer pour 2015 le dossier support à l’instruction de la demande d’autorisation de création de Cigéo en Meuse/Haute-Marne, dans la couche d’argile dont les propriétés de confinement sont désormais reconnues.
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Madame,
Les personnes de l’Andra qui travaillent sur les sites de stockage et habitent à proximité sont les premières concernées par la sécurité. Croyez-vous qu’elles accepteraient de travailler sur un site dont la sûreté ne serait pas garantie ?
Quels que soient les choix énergétiques futurs, c’est la responsabilité de notre génération de proposer aux générations suivantes une solution permettant de mettre définitivement en sécurité ces déchets, qui sont produits en France depuis plusieurs dizaines d’années. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est justement de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de ces déchets. Grâce à la réversibilité, les générations suivantes garderont la possibilité de faire évoluer cette solution si elles le souhaitent.
QUESTION 874 - Mesure du débit d'eau érroné
Posée par Mario MULÉ, L'organisme que vous représentez (option) (LA TRINITÉ ), le 14/12/2013
Les tests effectués pour mesurer la quantité d'eau lors du creusement des galeries, utilisaient une pompe d'un débit maximum très faible, vous ayant permis de titrer dans le rapport que le débit rencontré était "faible" ! Ne pensez vous pas qu'une mesure impartiale imposerait de refaire cette mesure avec un pompe d'un débit beaucoup plus élevé et de corriger le rapport ?
Réponse du 11/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Votre question fait référence au débat sur l’interprétation des résultats du forage référencé EST 433 réalisé en 2007/2008 à Montiers-sur-Saulx, à 2 000 mètres de profondeur, dans le cadre de l’évaluation du potentiel géothermique du site étudié pour l’implantation de Cigéo. Des associations ont contesté les méthodes techniques utilisées lors de la réalisation du forage. L’Andra rappelle que les études relatives au forage EST433 se sont déroulées en toute transparence et ont fait l’objet d’évaluations indépendantes (expert du Clis, CNE, IRSN). Les caractéristiques habituellement recherchées (salinité, température et productivité) pour caractériser un potentiel géothermique ne présentent pas un caractère exceptionnel en tant que ressource potentielle pour une exploitation géothermique profonde dans la zone étudiée.
Pour plus d’informations : http://www.andra.fr/download/andra-meuse-fr/document/presse/2013-01-31_cp_andra_geothermie.pdf
QUESTION 873 - Quand?
Posée par Jean-Marc DALVAL, PERSONNEL (LA LANTERNE ET LES ARMONTS ), le 14/12/2013
Quand cessera cette mascarade de pseudo-démocratie? A quoi servent ces débats qui n'en sont pas? C'était avant d'entreprendre ces travaux qu'il fallait poser ces questions à la population, qu'il fallait la laisser s'exprimer en présentant les arguments objectivement. On pouvait le faire: il ne faut pas dépenser des milliards d'euros, et faire des pseudo-recherches pour affirmer que personne ne peut assurer que de tels déchets peuvent être confinés pendant des centaines de milliers d'années dans un milieu par nature évolutif. Quand, enfin, les politiques prendront-ils en compte l'avis des populations?
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par la Commission particulière du débat public :
Le débat public est un des moyens que les pouvoirs publics ont à leur disposition pour connaître l’avis des populations, toutes tendances confondues, sur les grands projets d’investissement, avant d’arrêter les choix qui incombent au politique.
Il existe sous sa forme actuelle depuis 11 ans, et il a contribué, souvent avec d'autres faits (prise de conscience des élus, pression des populations interessées, difficultés de financement etc.) à modifier ou à différer des projets. C'est ainsi par exemple que la ligne à très haute tension entre la France et l'Espagne ne sera pas réalisée en aérien, mais en souterrain, ou que la liaison CDG Express pour les passagers de Roissy CDG n'a pas été mise en oeuvre.
Le site www.debatpublic.fr peut vous apporter d'autres informations sur ce point.
Réponse apportée par le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
La loi du 28 juin 2006 a fait le choix du stockage réversible profond pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations futures. Elle demande à l’Andra d’étudier et d’implanter un Centre de stockage réversible profond de déchets radioactifs (Cigéo) en indiquant que « la demande d'autorisation de création [d’un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs] doit concerner une couche géologique ayant fait l'objet d'études au moyen d'un laboratoire souterrain ». L’Andra poursuit donc ses études en vue d’élaborer pour 2015 le dossier support à l’instruction de la demande d’autorisation de création de Cigéo en Meuse/Haute-Marne.
La décision d’autoriser ou non la création de Cigéo en Meuse/Haute-Marne n’est donc pas encore prise. Elle reviendra à l’Etat après l’évaluation du dossier remis par l’Andra en 2015 par l'Autorité de sûreté nucléaire et la Commission nationale d'évaluation, l’avis des collectivités territoriales, le vote d’une nouvelle loi fixant les conditions de réversibilité et une enquête publique.
Le projet Cigéo suit la procédure décrite à l’article L. 542-10 du Code de l’Environnement. Plusieurs procédures de consultation sont organisées afin de recueillir l’avis des populations locales et nationales (débat public, avis des collectivités territoriales, débat public).
Le Parlement fixe périodiquement les choix relatifs à la mise en œuvre de ce projet :
- loi du 30 décembre 1991, dite loi « Bataille », fixant un programme d’études et recherches de 15 années d’études et recherches sur les déchets radioactifs ;
- loi du 28 juin 2006, définissant le stockage géologique profond comme solution de référence pour les déchets les plus radioactifs et demandant sa mise en service en 2025 ;
- loi à venir sur la réversibilité du projet
En outre, l’Etat est en contact permanent avec les parties prenantes locales. Un important travail de concertation a été mené, notamment avec les exécutifs locaux, pour élaborer un projet de schéma interdépartemental du territoire.
QUESTION 872 - reconditionnement tout les 100 ans
Posée par Mario MULÉ, L'organisme que vous représentez (option) (LA TRINITÉ), le 14/12/2013
Sachant que les techniciens admettent à l'heure actuelle qu'aucun matériau connu à la surface de la terre n'est étanche à la radioactivité plus de 100 ans, ne pensez vous pas que la réversibilité du stockage profond de CIGEO qui est donné pour justement 100 ans, soit comme une mauvaise garantie. Les problèmes de fuite radioactives apparaitraient juste au moment ou les cheminées d'accès aux alvéoles seraient scellées, 100 ans après le début du stockage. Ne pensez vous pas que cette réversibilité de juste 100 ans est insuffisante eu égard à la surveillance de 300 ans induite par les stockages en surface de déchets FAVC ?
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Conformément à la demande du Parlement, l’Andra a conçu Cigéo de telle sorte que le stockage soit réversible pour au moins cent ans.
La sûreté de Cigéo devra être acquise quelle que soit sa réversibilité. Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
L’Andra prévoit dès la conception de Cigéo des dispositifs techniques destinés à faciliter le retrait éventuel de colis de déchets stockés. Les tunnels de stockage (alvéoles de stockage) ont un revêtement en béton ou en acier pour éviter les déformations. Les colis utilisés pour le stockage des déchets, en béton ou en acier, sont indéformables. Des espaces suffisants sont ménagés entre les colis pour permettre leur retrait. L’exploitant disposera d’une connaissance précise de l’emplacement de chaque colis et de ses conditions de stockage. Les tunnels de stockage seront équipés de capteurs pour suivre leur évolution dans le temps. Des essais de retrait de colis ont d’ores et déjà été réalisés à l’échelle 1. Des nouveaux tests de retrait seront réalisés dans le stockage avant que la mise en service de Cigéo ne puisse être autorisée, puis pendant toute l’exploitation de Cigéo.
Pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets radioactifs, Cigéo devra être refermé après son exploitation. C’est aux générations qui nous succèderont qu’il reviendra de décider de procéder aux opérations de fermeture (fermeture et scellement des alvéoles, remblaiement des galeries d’accès...). L’Andra conçoit Cigéo pour qu’il puisse être refermé de manière progressive, depuis l’obturation des alvéoles jusqu’au scellement des puits et des descenderies. Chaque étape de fermeture permettra d’ajouter des dispositifs de sûreté passive. Néanmoins, elle rendra plus complexe le retrait éventuel des colis stockés. L’Andra propose donc que le franchissement de chaque nouvelle étape de fermeture, notamment le scellement des alvéoles de stockage, fasse l’objet d’une autorisation spécifique. Le Parlement a d’ores et déjà décidé que seule une loi pourrait autoriser la fermeture définitive du stockage.
La synthèse des propositions de l’Andra relatives à la réversibilité est consultable sur le site du débat public : ../docs/rapport-etude/fiche-reversibilite-cigeo.pdf
QUESTION 871 - Qui se souviendra ?
Posée par Anne TEURTROY, L'organisme que vous représentez (option) (LA BORDERIE), le 14/12/2013
Des personnes et des biens furent enterrés en grande pompe il y a 1000 ans, ou plus ou même moins. Quand on les met au jour c'est une "découverte archéologique". Tout le monde avait oublié. Quelle découverte tragique feront les êtres qui déterreront les déchets radio-actifs ?
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif fondamental de Cigéo est de protéger l’homme et l’environnement des déchets radioactifs sur de très longues échelles de temps. La sûreté à long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. C’est une des raisons qui a conduit, en 2006, le Parlement à retenir la solution du stockage profond. En effet, cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli, contrairement à l’entreposage. En cas de perte complète de la mémoire du stockage, une intrusion inopinée à 500 mètres sous terre apparaît peu plausible, du moins sans un minimum d’investigations préalables. L’Andra évalue cependant par précaution dans son analyse de sûreté les conséquences d’un forage à travers le stockage pour vérifier que le stockage resterait sûr.
Malgré cette robustesse du stockage même en cas d’oubli, l’Andra conçoit Cigéo avec l’objectif d’en conserver la mémoire et de la transmettre aux générations futures le plus longtemps possible. Des solutions d’archivage de long terme existent pour les centres de stockage de surface exploités par l’Andra et font l’objet de revues périodiques. Le retour d’expérience montre que ces solutions paraissent robustes pour au moins les 500 premières années. Ainsi, pour Cigéo, l’Andra prévoit qu’un centre de la mémoire perdurera sur le site. Il pourra accueillir le public et comprendra notamment les archives du Centre.
De manière générale, le maintien de la mémoire doit aussi impliquer les acteurs locaux, qui peuvent prendre le relai en cas de défaillance de l’Andra ou de l’État. L’Andra veille d’ores et déjà à les informer sur les enjeux associés à la mémoire et étudie avec des anthropologues, des philosophes ou encore des artistes les facteurs qui peuvent favoriser la transmission de la mémoire. La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
L’Andra a lancé en 2010 un programme d’études pour proposer des outils qui rendent cette transmission plus robuste sur une échelle de temps millénaire. Des pistes se dessinent tels des marqueurs de surface, mais aussi des rendez-vous réguliers à mettre en place au niveau des populations locales.
En tout état de cause, comme il est impossible de garantir notre capacité à communiquer avec des êtres vivant dans plusieurs milliers d’années, c’est chaque génération qui aura la responsabilité de contribuer à transmettre cette mémoire aux générations suivantes.
QUESTION 870 - crach boursier
Posée par bernard PONS, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 14/12/2013
si, comme c'est probable, notre système financier Dollar s’effondre, qui s'occupera de la maintenance?
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
L'article 20 de la loi du 28 juin 2006 pose le principe de la responsabilité première de l'exploitant d’une installation nucléaire pour le provisionnement des charges de gestion à long terme des déchets radioactifs qu’il produit et la couverture de ces charges par des actifs dédiés à leur financement. La responsabilité de constituer et de gérer ces actifs est à la charge de l'exploitant. Il doit s'assurer à tout moment que leur valeur de marché est supérieure au niveau requis.
Il dispose pour cela d'outils de gestion actif-passif tenant compte de l'historique des rendements de ses actifs, y compris pendant la précédente crise financière.
Tout cela est étroitement contrôlé par l’Etat. A cet égard, en vertu des articles L. 594-1 et suivants du code de l'environnement (articles codifiés correspondants à l'article 20 de la loi du 28 juin 2006), l'exploitant fournit chaque année au gouvernement des documents qui doivent notamment montrer que les actifs dédiés sont suffisamment sûrs, liquides et rentables.
QUESTION 869 - Pourquoi les criminels du nucléaire restent-ils impunis ?
Posée par Françoise BOMAN, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS ), le 14/12/2013
Enterrer les déchets nucléaires revient à autoriser leur production, et la dissémination de radionucléides hautement toxiques pour toute forme de vie sur la terre pendant des milliers d'années. Le projet Bure est donc aussi criminel que toutes les autres étapes des filières nucléaires civiles et militaires. Comment et pourquoi un pays démocratique peut-il laisser agir les criminels du lobby nucléaire, et leurs complices, politiques, médias, scientifiques, en toute impunité ?
Réponse du 21/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Madame,
Vos propos sont insultants pour toutes celles et tous ceux qui travaillent à la mise en œuvre de solutions sûres pour protéger les populations actuelles et futures des risques liés aux déchets radioactifs. Toutes les personnes qui travaillent à l’Andra partagent une même valeur : la responsabilité. Nous sommes responsables de la sûreté de nos installations. Nous sommes responsables devant les territoires qui nous accueillent. Nous sommes également responsables devant les générations futures. Les personnes de l’Andra qui travaillent sur les sites de stockage et habitent à proximité sont les premières concernées par la sécurité. Croyez-vous qu’elles accepteraient de travailler sur un site dont la sûreté ne serait pas garantie ?
Quels que soient les choix énergétiques futurs, c’est la responsabilité de notre génération de proposer aux générations suivantes une solution permettant de mettre définitivement en sécurité ces déchets, qui sont produits en France depuis plusieurs dizaines d’années. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
QUESTION 868 - Justification
Posée par Pascale VINCENT, JUGE, le 14/12/2013
Comment allez-vous justifier votre inconséquence, votre étroitesse d'esprit, votre irresponsabilité, votre avidité morbide, auprès de l'humanité lorsque l'incontournable et irrémédiable catastrophe arrivera ? Je m'oppose totalement au projet cigéo et à toute activité nucléaire et guerrière en général. Et si l'Etat continue de soutenir ce projet, je m'engage à ne plus payer mes impôts au Trésor Public mais aux associations anti-nuclaires, anti-ogm, anti-obsolescence programmée, anti-guerre, pro-paix, pro-biodiversité, pro-respect de la Vie. Je m'engage à payer mon écot à une cause que je respecte. Car je ne sais pas comment faire entendre valablement et pacifiquement ma voix autrement.
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
La loi du 28 juin 2006 a fait le choix du stockage réversible profond pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations futures. Ce choix a été fait après un programme de quinze années d’études et recherches encadrée par la loi « Bataille » de 1991, un débat public en 2005-2006 et les avis des évaluateurs sur ces recherches. Il est conforté au niveau international par la directive européenne du 19 juillet 2011 qui considère que « il est communément admis que sur le plan technique, le stockage en couche géologique profonde constitue, actuellement, la solution la plus sûre et la plus durable en tant qu’étape finale de la gestion des déchets de haute activité et du combustible usé considéré comme déchet. »
Elle demande à l’Andra d’étudier et d’implanter Cigéo en rappelant que « la demande d'autorisation de création [d’un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs] doit concerner une couche géologique ayant fait l'objet d'études au moyen d'un laboratoire souterrain ». L’Andra poursuit donc ses études en vue d’élaborer pour 2015 le dossier support à l’instruction de la demande d’autorisation de création de Cigéo en Meuse/Haute-Marne, dans la couche d’argile dont les propriétés de confinement sont désormais reconnues.
Le financement de la gestion des matières et déchets radioactifs est assuré, sous le contrôle de l’État, par les exploitants nucléaires, selon le principe « pollueur-payeur ». Le projet Cigéo est donc entièrement financé par les exploitants nucléaires producteurs de déchets : EDF, Areva, CEA. Cela comprend donc les coûts des recherches, des études, de la construction, de l’exploitation, de la surveillance et de la fermeture.
QUESTION 867 - Suivi
Posée par Yvonne VACHERON, L'organisme que vous représentez (option) (ALLONNE), le 14/12/2013
Comment contrôlerez-vous le bon état sur le long terme de l'installation?
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’impossibilité de garantir la capacité de la société à gérer et à surveiller les déchets radioactifs pendant des milliers d’années est justement une des raisons qui a conduit au choix de la solution du stockage profond pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs. Contrairement à un entreposage de longue durée, le stockage dans une couche géologique assurant le confinement des éléments radioactifs à l’échelle de plusieurs centaines de milliers d’années permet de protéger l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets sans nécessité d’action humaine. La géologie prend ainsi le relais de l’homme pour garantir la sûreté sur le très long terme. La surveillance du site pourra néanmoins être maintenue aussi longtemps que les générations futures le souhaiteront et contribuera au maintien de la mémoire du stockage.
QUESTION 866 - qui sera responsable, et qui sera coupable?
Posée par Michel DANNEQUIN, L'organisme que vous représentez (option) (AVON), le 14/12/2013
en cas de fuites et autres problèmes demain, dans 30 ans, dans 100 ans?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 865 - durée de protection
Posée par Alain MASSÉ, L'organisme que vous représentez (option) (FRANCE), le 14/12/2013
Bonjour, Pouvez vous jurer, sur la tête de vos enfants et de vos proches, que les déchets seront protégés à 100 pour 100 pendant toute leur durée de vie et qu'il n'y aura aucune fuite ? Pouvez vous affirmer celà?
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le risque zero n’existe pas et l’Andra ne prétend pas que le projet Cigeo ferait exception à la règle.
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Sur le long terme, la couche d’argile dans laquelle est implantée le stockage garantit l’éloignement des déchets radioactifs de la surface. Seuls quelques radionucléides mobiles et dont la durée de vie est longue pourront migrer à travers la couche d’argile après plusieurs dizaines de milliers d’années, puis potentiellement atteindre ensuite la surface et les nappes phréatiques, après plus de 100 000 ans et en quantités extrêmement faibles. Leur impact radiologique serait alors plusieurs dizaines de fois inférieur à la radioactivité naturelle.
Cigéo sera soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 864 - Vous rendez vous compte du cadeau empoisonné que vous laisserez au générations futures?
Posée par Pômme BROGGI, L'organisme que vous représentez (option) (SAINT QUAY PERROS), le 14/12/2013
quand seront le début et la fin de l’enfouissement? quelle sera la durée des rejets radioactifs? quelle sera la durée de la surveillance ? pendant combien de temps l’Andra pense que ses calculs auront un sens? quelle est la durée sur laquelle les déchets sont dangereux? quelle est la durée des rejets gazeux?
Réponse du 28/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra à l’État après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création du centre. Ce processus comprendra notamment l’évaluation de la sûreté par l’Autorité de sûreté nucléaire, l’évaluation des recherches scientifiques par la Commission nationale d’évaluation mise en place par le Parlement, l’avis des collectivités territoriales, le vote d’une nouvelle loi fixant les conditions de réversibilité, la mise à jour de la demande de création de Cigéo par l’Andra suite à cette loi, et une enquête publique. Si Cigéo est autorisé, sa mise en service pourrait intervenir à l’horizon 2025, sous réserve de l’autorisation de l’Autorité de sûreté nucléaire.
La durée prévisionnelle d’exploitation du stockage serait ensuite de l’ordre d’une centaine d’années. C’est le délai qui est nécessaire pour prendre en charge l’ensemble des déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue existants et en cours de production par les installations nucléaires françaises actuelles. Grâce à la réversibilité, les générations suivantes garderont la possibilité de faire évoluer cette solution. L’Andra propose ainsi que des rendez-vous réguliers soient programmés avec l’ensemble des acteurs (riverains, collectivités, scientifiques, évaluateurs, État…) pour contrôler le déroulement du stockage et pour préparer chaque décision importante concernant les étapes suivantes.
Pendant son exploitation, Cigéo sera à l’origine de très faibles quantités de rejets radioactifs provenant pour la quasi-totalité d'émanation de carbone 14, tritium ou krypton 85 contenus dans certains colis de déchets de moyenne activité à vie longue (MA-VL). Ces rejets seront canalisés, mesurés et strictement contrôlés avant d’être relâchés dans l'atmosphère. L'Autorité de sûreté nucléaire fixera les limites autorisées pour ces rejets et en assurera un contrôle strict. Ces rejets dureront uniquement le temps de l’exploitation du site. En effet, après la fermeture du stockage, les alvéoles dans lesquelles les déchets seront stockés auront été fermées et il n’y aura plus de rejets de ce type.
Après fermeture, la sûreté du stockage sera assurée de manière passive, c’est-à-dire sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique, qui sert de barrière naturelle à très long terme, et sur la conception du stockage. Une surveillance sera néanmoins maintenue après la fermeture du stockage aussi longtemps que la société le souhaitera et des actions seront menées pour conserver et transmettre sa mémoire. Le Parlement a d’ores et déjà décidé que seule une loi pourrait autoriser la fermeture définitive du stockage. Cette future loi pourra fixer les conditions dans lesquelles le site restera contrôlé, sa surveillance maintenue et la mémoire conservée.
Les déchets radioactifs destinés à Cigéo sont des déchets dangereux, qui le resteront plusieurs dizaines à centaines de milliers d’années. L’objectif du stockage est de protéger l’homme et l’environnement de la dangerosité de ces déchets sur de très longues durées. Les recherches menées par l’Andra ont pour objectif d’étudier l’évolution du stockage sur le long terme. La démarche des scientifiques se fonde d’abord sur l’observation et l’expérimentation, qui permettent de décrire les phénomènes physiques, de les modéliser et d’identifier les incertitudes. Sur cette base, la simulation numérique permet ensuite d’extrapoler des résultats à des échelles de temps longues. L’analyse de sûreté intègre la connaissance acquise et les incertitudes afin de produire une évaluation pénalisante de l’impact du stockage. Les études menées par l’Andra ont montré que l’impact du stockage serait nettement inférieur à celui de la radioactivité naturelle à l’échelle du million d’années.
QUESTION 863 - Qui va payer et combien cela va t'il couter?
Posée par Pascal MOISON, L'organisme que vous représentez (option) (SAINT QUAY PERROS), le 14/12/2013
s’il faut ressortir des déchets stockés ? Quel en sera le coût ? Quelle solution alternative ?
Réponse du 11/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement dans une future loi. Les propositions de l’Andra sur la réversibilité sont consultables sur le site du débat public (../informer/les-etudes-preparatoires.html) et abordent les questions que vous posez.
L’Andra propose que le décret d’autorisation de création de Cigéo couvre des opérations de retrait limité et temporaire de colis de déchets stockés. Ces opérations seront décrites dans le rapport de sûreté et dans les règles générales d’exploitation.
L’Andra considère que toute opération notable de retrait de colis de déchets stockés devra faire l’objet d’une autorisation spécifique. Ainsi, dans l’hypothèse d’une évolution de la politique en matière de gestion des déchets radioactifs qui conduirait à envisager une opération de retrait d’un nombre important de colis de déchets, l’Etat demanderait à l’Andra d’étudier l’opération. L’étude devrait comprendre une analyse détriments-bénéfices. L’opération pourrait nécessiter des modifications notables de l’installation, notamment en surface : l’Andra définirait la nature de ces modifications en fonction de la situation de retrait considérée : famille de colis concernée, volumes, dates de retrait, devenir des colis retirés du stockage…
Ce type d’opérations nécessiterait ensuite le dépôt d’une demande de modification du décret d’autorisation de création par l’Andra, évaluée par l’Autorité de sûreté nucléaire et soumise à enquête publique. L’autorisation demandée devrait couvrir les opérations envisagées sur Cigéo (opérations de retrait, de reconditionnement éventuel, d’expédition…) et l’ensemble des modifications d’installations à apporter (construction éventuelle d’entreposages, de nouveaux ateliers…). Le dossier support à la demande devrait présenter une démonstration complète et justifiée de la sûreté des opérations projetées.
Le coût de l’opération de retrait dépend de la situation de retrait considérée. Il serait a priori d’un ordre de grandeur analogue à celui des opérations de mise en stockage des déchets, auquel il conviendrait d’ajouter celui des nouvelles installations à construire pour accueillir les déchets et celui du transfert des déchets dans ces nouvelles installations.
L’Andra propose un partage équitable du financement de la réversibilité entre les générations. Les générations actuelles provisionnent l’ensemble des coûts nécessaires pour permettre la mise en sécurité définitive des déchets radioactifs qu’elles produisent, ainsi que des déchets anciens qui ont été produits depuis le début des années 1960. Ces provisions couvrent également les propositions techniques retenues pour assurer la réversibilité de Cigéo pendant le siècle d’exploitation. Si les générations suivantes décidaient de faire évoluer leur politique de gestion des déchets radioactifs, par exemple si elles décidaient de récupérer des déchets stockés, elles en assureraient le financement. La prise en compte de la réversibilité dès la conception du stockage permet de limiter cette charge potentielle.
QUESTION 862 - Sens de la réversibilité
Posée par pascal DUMAINE, L'organisme que vous représentez (option) (MONTGAILHARD), le 14/12/2013
Le projet CIGEO tel qu'il est présenté est clairement en faveur d'un enfouissement profond, à la vue de la justification des éléments techniques relatifs à la mise en oeuvre de ce stokage, il parait assez clair que certains éléments ont été négligés, comme par exemple la non fitration des gas de ventilation des fûts contaminés qui sont eux mêmes "étanches" mais ont quand même été prévus avec des évents de ventillation pour l'hydrogène qui s'en échaperait .... A là la vue des volumes énormes sur ces échelles de temps qui vont s 'échapper de ces futs de stockage Il semble bien que le moindre mal se transforme désormais en éventuelle gestion de crise pour ceux qui auront à gérer ces déchets qui par définition ne seront plus gérables car certains colis auront comme cela s'est passé en Allemagne complétement perdus leur fonction de confinement même avec une vitrification censée stabiliser advitam eternam nos chers déchets. La solution de l'entreposage profond permet elle de garantir un vrai confinement? Permet elle un traitement ultérieur (possibilité d'extraction des colis dans un premier temps) à la vue de la longueur des tunnels d'entreposage et de la nature des transmutations . A la vue de cela, n'est 'il pas possible de soumettre un débat ouvert avec des chiffres transparents et réalistes sur le cout de la filière de retraitement et des budgets afférents a cela venant du CEA ou autres organisations ou l'etat est actionnaire et donc financeur de la recherche pendant que suez et areva auront en "charge" de tenir la facturation a EDF des tonnes a retraiter et du fonctionnement courant qui sera sans aucun doute exempt de tout reproche : securité oblige..;
Réponse du 28/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Concernant la ventilation
Cigéo est conçu pour qu’après sa fermeture, la sûreté du stockage soit assurée de manière passive, c’est-à-dire sans dépendre d’actions humaines.
Ainsi, un système de ventilation n’est prévu que pour la période d’exploitation, envisagée pour une centaine d’année. Ce système vise, entre autres, à renouveler l’air pour garantir des ambiances de travail conformes au Code du travail, mais aussi à évacuer l’hydrogène émis en petite quantité par certains colis MAVL.
Le système de ventilation du stockage fait l’objet de dispositions pour réduire le risque de panne (redondance des équipements, maintenance..) et des dispositifs de surveillance seront mis en place pour détecter toute anomalie sur son fonctionnement, notamment la présence d’hydrogène dans l’air à de très faibles concentrations.. Des situations de perte de la ventilation sont étudiées malgré tout. Les études montrent que, dans le pire des cas, on disposera de plus d’une dizaine de jours pour rétablir la ventilation avant qu’un risque d’explosion dû à l’hydrogène n’apparaisse, ce qui permettra de mettre en place une ventilation de secours. Les conséquences d’une explosion sont tout de même évaluées afin d’envisager tous les scénarios possibles : les résultats montrent que les colis concernés ne seraient que faiblement endommagés, sans aucune perte de confinement des substances qu’ils contiennent.
Concernant l’expérience de Asse en Allemagne
En aucun cas la mine de Asse en Allemagne ne peut être comparée au projet Cigéo. Le stockage à Asse a été réalisé au titre du droit minier et non des réglementations de la sûreté nucléaire telles qu’elles existent aujourd’hui. Il s’agit d’une ancienne mine de sel qui a été reconvertie en un stockage de déchets radioactifs en 1967. Lors du creusement de la mine, aucune précaution n’avait été prise pour préserver le confinement assuré par le milieu géologique. Le stockage n’avait pas non plus été conçu au départ pour être réversible. Les difficultés rencontrées aujourd’hui à Asse illustrent pleinement l’importance d’une démarche d’étude scientifique et d’évaluation préalablement à la décision de mettre en œuvre un projet de stockage.
Concernant la sûreté du stockage profond et la récupérabilité des colis
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage en surface. En effet, laisser les déchets dans des installations en surface impliquerait de renouveler périodiquement les bâtiments où ils seraient placés, de contrôler ces installations et de les maintenir. En cas de perte de contrôle de ces installations, les conséquences radiologiques sur l’homme et l’environnement ne seraient pas acceptables. Compte tenu de la durée pendant laquelle ces déchets resteront dangereux (plusieurs centaines de milliers d’années), l’entreposage - qu’il soit en surface ou à faible profondeur - ne peut être qu’une solution provisoire dans l’attente d’une solution définitive.
Et le projet est conçu pour être réversible au moins cent ans, conformément à la demande du Parlement. L’Andra prévoit la mise en œuvre de nombreuses dispositions techniques pour faciliter une opération éventuelle de retrait de colis de déchets après leur stockage (colis indéformables en béton ou en acier utilisés pour le stockage des déchets, espaces ménagés entre les colis pour permettre leur retrait, tunnels de stockage avec un revêtement en béton ou en acier pour éviter les déformations, connaissance précise de l’emplacement de chaque colis et de ses conditions de stockage, surveillance des ouvrages…). Ces dispositions prennent en compte le retour d’expérience d’autres installations, en France et à l’étranger. Des essais de retrait de colis ont d’ores et déjà été réalisés à l’échelle 1. Des nouveaux tests de retrait seront réalisés dans le stockage avant que la mise en service de Cigéo ne puisse être autorisée, puis pendant toute l’exploitation de Cigéo. Les conditions de réversibilité seront fixées par une future loi. Pour en savoir plus sur les propositions faites par l’Andra en matière de réversibilité du stockage, voir ../docs/rapport-etude/fiche-reversibilite-cigeo.pdf
Concernant la question des coûts
Nous vous invitons à lire le rapport de la Cour des comptes sur « Les coûts de la filière électronucléaire » (janvier 2012), disponible sur le site du débat : ../docs/docs-complementaires/docs-avis-autorites-controle-evaluations/rapport-thematique-filiere-electronucleaire.pdf.
Pour ce qui concerne la gestion des déchets radioactifs
Pour un nouveau réacteur nucléaire sur l’ensemble de sa durée de fonctionnement, le coût du stockage des déchets radioactifs est de l’ordre de 1 à 2 % du coût total de la production d’électricité. La dernière évaluation du coût du stockage validée par le ministère en charge de l’énergie date de 2005. Au stade des études de faisabilité scientifique et technique et selon les hypothèses techniques retenues à ce stade, le coût du stockage avait été estimé entre 13,5 et 16,5 milliards d’euros, répartis sur une centaine d’années. Cette évaluation couvrait notamment le stockage de tous les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue produits par les réacteurs nucléaires français pendant 40 ans. L’Andra a lancé en 2012 les études de conception industrielle du projet Cigéo. Sur cette base, un nouveau chiffrage du coût du stockage sera finalisé en 2014 pour prendre en compte les pistes d’optimisation identifiées en 2013, les recommandations des évaluateurs et pour intégrer les suites du débat public.
QUESTION 861 - enfouissement de nos déchets
Posée par anaïs LESSERTISSEUR, AUCUN (FOUGERES), le 14/12/2013
pourquoi ne pas laisser les déchets radioactifs dans les centrales nucléaires en arrêt de marche et éviter de surcroît le démantèlement de ces dernières????
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Contrairement au stockage profond, les centrales nucléaires ne sont en aucun cas conçues pour confiner la radioactivité pendant plusieurs centaines de milliers d’années.
S’il est autorisé, Cigéo sera implanté dans une couche d’argile très peu perméable dont les propriétés permettent d’assurer le confinement de la radioactivité sur de très longues échelles de temps. Sa profondeur permet de mettre les déchets radioactifs à l’abri des activités humaines et des événements naturels de surface (comme l’érosion) et d’isoler les déchets de l’homme et de l’environnement à très long terme.
QUESTION 860 - Quelques questions
Posée par Laurent VIGNAUD, L'organisme que vous représentez (option) (ANGERS), le 14/12/2013
Bonjour, Je n'habite ni dans la Meuse, ni en Haute-Marne, mais je crains fort que je ne sois obligé de payer (et tous les autres contribuables aussi). Déjà, personne ne peut nous dire combien cela va coûter...., pas seulement sur 20 ans, 50 ans, mais combien de siècles ? Et puis, s'il y a une fuite (on l'a vu avec ce qu'ils ont fait en Allemagne), qui est responsable ? Bref, vous l'avez compris, je suis contre ce gaspillage d'argent (et j'aurais encore plein d'autres questions). Pour résumer, je dirais simplement : puisque tous les citoyens sont concernés (ce sont les impôts qui paient, c'est la sécurité sociale qui paiera pour les dégâts sanitaires lorsque fuites et eaux contaminées, etc.), alors, faisons les choses démocratiquement : les citoyens sont concernés, alors laissons-les décider par référendum. Toute autre manière de décider n'est pas démocratique. L. Vignaud (citoyen en colère)
Réponse du 07/02/2014,
Réponse apportée par le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Le financement de la gestion des matières et déchets radioactifs est assuré, sous le contrôle de l’État, par les exploitants nucléaires, selon le principe « pollueur-payeur ».
Le projet Cigéo est donc entièrement financé par les exploitants nucléaires producteurs de déchets : EDF, Areva, CEA. Cela comprend donc les coûts des recherches, des études, de la construction, de l’exploitation, de la surveillance et de la fermeture.
Un dispositif de sécurisation du financement des charges nucléaires de long terme, est institué dans la loi du 28 juin 2006 codifiée au code de l'environnement. Il prévoit la constitution d'un portefeuille d'actifs dédiés par les exploitants nucléaires au cours de l'exploitation. Pour cela, les exploitants sont tenus d'évaluer l’ensemble de leurs charges de long terme parmi lesquelles figurent les charges liées au projet Cigéo. Ils doivent assurer dès à présent, la couverture de ces charges à venir par la constitution d'actifs dédiés qui doivent présenter un haut niveau de sécurité.
Ces opérations sont étroitement contrôlées par l’État. Pour exercer son contrôle, l'autorité administrative reçoit notamment des exploitants un rapport triennal sur l'évaluation des charges de long terme, les méthodes et les choix retenus pour la gestion des actifs dédiés, ainsi qu'un inventaire trimestriel des actifs dédiés. De plus, une Commission extraparlementaire (la CNEF) évalue le contrôle effectué par l'autorité administrative et remet un rapport triennal sur ses évaluations au Parlement, ainsi qu'au Haut Comité pour la Transparence et l'Information sur la Sécurité Nucléaire (HCTISN).
Le projet Cigéo suit la procédure décrite à l’article L. 542-10 du Code de l’Environnement qui ne prévoit pas la réalisation d’un référendum.
Plusieurs procédures de consultation sont néanmoins organisées afin de recueillir l’avis des populations locales et nationales (débat public, avis des collectivités territoriales, enquête publique).
Le Parlement fixe périodiquement les choix relatifs à la mise en œuvre de ce projet :
- loi du 30 décembre 1991, dite loi « Bataille », fixant un programme d’études et recherches de 15 années d’études et recherches sur les déchets radioactifs ;
- loi du 28 juin 2006, définissant le stockage géologique profond comme solution de référence pour les déchets les plus radioactifs et demandant sa mise en service en 2025 ;
- loi à venir sur la réversibilité du projet.
En outre, l’Etat est en contact permanent avec les parties prenantes locales. Un important travail de concertation a été mené, notamment avec les exécutifs locaux, pour élaborer un projet de schéma interdépartemental du territoire.
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
En aucun cas la mine de Asse en Allemagne ne peut être comparée au projet Cigéo. Le stockage à Asse a été réalisé au titre du droit minier et non des réglementations de la sûreté nucléaire telles qu’elles existent aujourd’hui. Il s’agit d’une ancienne mine de sel qui a été reconvertie en un stockage de déchets radioactifs en 1967. Lors du creusement de la mine, aucune précaution n’avait été prise pour préserver le confinement assuré par le milieu géologique. Le stockage n’avait pas non plus été conçu au départ pour être réversible. Les difficultés rencontrées aujourd’hui à Asse illustrent pleinement l’importance d’une démarche d’étude scientifique et d’évaluation préalablement à la décision de mettre en œuvre un projet de stockage.
Pour que le projet puisse être autorisé, l’Andra doit démontrer à l’Autorité de sûreté nucléaire qu’elle maîtrise les risques liés à l’installation, que ce soit pendant son exploitation ou après sa fermeture. Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Pour un nouveau réacteur nucléaire sur l’ensemble de sa durée de fonctionnement, le coût du stockage des déchets radioactifs est de l’ordre de 1 à 2 % du coût total de la production d’électricité. La dernière évaluation du coût du stockage validée par le ministère en charge de l’énergie date de 2005. Au stade des études de faisabilité scientifique et technique et selon les hypothèses techniques retenues à ce stade, le coût du stockage avait été estimé entre 13,5 et 16,5 milliards d’euros, répartis sur une centaine d’années. Cette évaluation couvrait notamment le stockage de tous les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue produits par les réacteurs nucléaires français pendant 40 ans. L’Andra a lancé en 2012 les études de conception industrielle du projet Cigéo. Sur cette base, un nouveau chiffrage du coût du stockage sera finalisé en 2014 pour prendre en compte les pistes d’optimisation identifiées en 2013, les recommandations des évaluateurs et pour intégrer les suites du débat public. La Cour des comptes a réalisé une analyse des enjeux associés dans son rapport public thématique portant sur « Les coûts de la filière électronucléaire » (janvier 2012) disponible sur le site du débat : ../docs/docs-complementaires/docs-avis-autorites-controle-evaluations/rapport-thematique-filiere-electronucleaire.pdf
QUESTION 859 - Avenir
Posée par Jean Luc MORESTIN, L'organisme que vous représentez (option) (FIGEAC), le 14/12/2013
N'est-il pas criminel de laisser aux générations futures se débrouiller avec un cadeau aussi empoisonné? Les responsables ne seront plus là pour répondre de leurs actes!
Réponse du 30/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 858 - Prévisions et responsabilité
Posée par Françoise CÔTE, L'organisme que vous représentez (option) (SAINTE FOY LES LYON), le 14/12/2013
Qu'avez-vous prévu en cas de remontées accidentelles des radio-nucléides en surface ? Pour combien de temps engagez-vous la responsabilité des promoteurs de l'industrie nucléaire qui produit les déchets à enfouir et les pouvoirs publics qui donnent les autorisations d'enfouissement ? Merci de vos réponses.
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 857 - referendum
Posée par bernard PONS, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 14/12/2013
étant donné que cela concerne tout le monde, il conviendrai de poser la question à tout le monde, pourquoi ne pas organiser un référendum ?
Réponse du 13/02/2014,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Le projet Cigéo suit la procédure décrite à l’article L. 542-10 du Code de l’Environnement qui ne prévoit pas la réalisation d’un référendum.
Plusieurs procédures de consultation sont néanmoins organisées afin de recueillir l’avis des populations locales et nationales (débat public, avis des collectivités territoriales, enquête publique).
Le Parlement fixe périodiquement les choix relatifs à la mise en œuvre de ce projet :
- loi du 30 décembre 1991, dite loi « Bataille », fixant un programme d’études et recherches de 15 années d’études et recherches sur les déchets radioactifs ;
- loi du 28 juin 2006, définissant le stockage géologique profond comme solution de référence pour les déchets les plus radioactifs et demandant sa mise en service en 2025 ;
- loi à venir sur la réversibilité du projet
En outre, l’Etat est en contact permanent avec les parties prenantes locales. Un important travail de concertation a été mené, notamment avec les exécutifs locaux, pour élaborer un projet de schéma interdépartemental du territoire.
QUESTION 856 - pourquoi?
Posée par elisabeth MOSSER, L'organisme que vous représentez (option) (ORGES), le 14/12/2013
Pourquoi vous obstinez vous à implanter une poubelle nucléaire dans notre région sans que tous les éléments à une sécurité totale ne soient réunis ?Pourquoi faites vous peu de cas de notre désir de continuer à vivre dans une région rurale que nous désirons garder intacte de pollution .Tous les décideurs avident d'argent ne viendront surement pas habiter à coté de cette poubelle nucléaire .
Réponse du 21/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
L’objectif fondamental de Cigéo est de confiner la radioactivité des déchets sur de très longues échelles de temps. Tout est mis en œuvre pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. Tous les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation sont identifiés en amont de la conception. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier.
Si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Cet impact restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France). Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, le plan de surveillance de Cigéo permettra notamment de vérifier l’absence de « pollution radioactive ».
Le projet Cigéo est le fruit d’un long travail scientifique, mené depuis plus de 20 ans qui est régulièrement évalué de multiples façons (Autorité de sûreté nucléaire et son appui technique l’IRSN, Commission nationale d’évaluation mise en place par le Parlement, publications scientifiques, expertises indépendantes…).
L’accompagnement économique a été mis en place par le Parlement. Il est normal que les territoires qui acceptent d’accueillir un projet d’intérêt national en tirent un bénéfice concret.
Enfin les personnes de l’Andra sont les premières concernées par la sécurité car elles travaillent sur les sites de stockage et habitent à proximité. Croyez-vous qu’elles accepteraient de travailler sur un site dont la sûreté ne serait pas garantie ?
QUESTION 854 - migration des produits de fission du réacteur naturel d'Oklo
Posée par christian NAZET, L'organisme que vous représentez (option) (ETIOLLES), le 14/12/2013
Peut-on donner les résultats de l'étude, si elle existe, de la migration des produits de fission et isotopes radioactifs dans la couche terrestre à Oklo au Gabon ? Une modélisation numérique restitue-t-elle les résultats d'Oklo ? est-elle transposable et avec quelles incertitudes au cas de Bures ?
Réponse du 22/01/2014,
Réponse apportée par Andra, maître d’ouvrage :
Les sites d’Oklo au Gabon ont fait l’objet de nombreuses études de caractérisation (géologie, minéralogie, géochimie isotopique, géochimie des fluides, hydrogéologie…) et de modélisation-simulation numérique, en France et à l’international. Les travaux de modélisation et de simulation ont notamment porté sur la circulation des fluides et la migration des actinides. Parmi ces travaux, on pourra citer ceux de l’Ecole des Mines de Paris, qui ont permis de reproduire en particulier les processus de mobilisation puis de piégeage des actinides.
- I. Gurban, E. Ledoux, B. Madé et A.-L. Salignac(1) ; A. Winberg et J. Smellie (2) ; D. Louvat et P. Toulhoat (3) (1) École des mines de Paris (France) ; (2) Conterra AB ; (S) (3)CEA/DCC, Cadarache (France), OkÎo, analogue naturel de stockage de déchets radioactifs (phase 1) Volume 3 Caractérisation et modélisation des migrations à distance des zones de réaction (sites d'Okélobondo et de Bangombé), Contrat n° FI2W/CT91/0071, Rapport final, Rapport EUR 16857/3 FR, 1996
- Benoît Madé, Emmanuel Ledoux, Anne-Lise Salignac, Bénédicte Le Boursicaud et Ioana Gurban, Modélisation du transport réactif de l’uranium autour du réacteur nucléaire naturel de Bangombé (Oklo, Gabon), comptes rendus de l’académie des sciences - Series IIA - Earth and Planetary Science, Volume 331, Issue 9, 15 November 2000, Pages 587-594
- Gurban I, Laaksoharju M, Madé B, Ledoux E., Uranium transport around the reactor zone at Bangombé and Okélobondo (Oklo):
examples of hydrogeological and geochemical model integration and data evaluation, J Contam Hydrol. 2003 Mar ;61 (1-4):247-64.
Ces travaux ont permis de caler des modèles de représentation du comportement géochimique des actinides, plus particulièrement les paramètres de leur mobilité et de leur piégeage suivant notamment les conditions oxydo-réductrices et la chimie des fluides de manière plus générale. La transposition de ces résultats au cas du Callovo-Oxfordien porte en premier lieu sur l’application qualitative et quantitative des données géochimiques et de rétention acquises à la chimie de l’eau porale et à la minéralogie de l’argilite du Callovo-Oxfordien sur le site de Meuse/Haute-Marne (eau sodi-calcique, à pH proche de la neutralité et réductrice ; capacité de rétention élevée) : les résultats viennent compléter ceux des travaux expérimentaux menés sur échantillons d’argilite. Les études menées sur les sites d’Oklo contribuent ainsi à l’évaluation de la capacité de piégeage élevée des actinides par la couche du Callovo-Oxfordien
QUESTION 853 - quelle protection pour nos descendants?
Posée par Elisabeth BEGARD, L'organisme que vous représentez (option) (MORLAIX), le 14/12/2013
Un accident peut provoquer une fuite de déchets radioactifs. Si un accident survenait comment pourront agir nos descendants pour protéger les nappes phréatiques, la végétation,les animaux et les humains? L'enfouissement ne permet pas une surveillance optimum des déchets.
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 852 - Quel avenir ?
Posée par Sylvie BEGARDS, AUCUN ORGANISME, JUSTE UNE CITOYENNE (LARROQUE SUR L'OSSE), le 14/12/2013
En écotoxicologie, nous apprenons que les déchets radioactifs ont une durée de vie qui se chiffre en centaine de milliers d'années. Alors quelle planète voulons nous laisser à nos successeur-se-s ? Les caissons sont hermétiques ? Et évidemment les fuites dans les autres pays sont justes dues à des incompétences techniques, comme le nuage qui s'arrête à notre frontière, les cancers qui n'ont rien à voir avec le nucléaire mais sont de la seule responsabilité des personnes qui s'alimentent mal, qui sont stressées par leur seule responsabilité ? Qui pensez vous pouvoir duper ainsi ? combien de temps ? Les fuites dans la terre, les nappes phréatiques produiront quel effet sur les produits de consommation courante ? Certes, survivront les mutants, mais pour combien de temps ?
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Vos propos n’engagent que vous et sont insultants pour toutes celles et tous ceux qui travaillent à la mise en œuvre de solutions sûres pour protéger les populations actuelles et futures des risques liés aux déchets radioactifs. Toutes les personnes qui travaillent à l’Andra partagent une même valeur : la responsabilité. Nous sommes responsables de la sûreté de nos installations. Nous sommes également responsables devant les générations futures.
C’est cette question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs qui est au cœur du projet Cigéo. Les déchets dont il est question ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestions sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est donc de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Sur le long terme, la couche d’argile dans laquelle est implantée le stockage garantit l’éloignement des déchets radioactifs de la surface. Seuls quelques radionucléides mobiles et dont la durée de vie est longue pourront migrer à travers la couche d’argile après plusieurs dizaines de milliers d’années, puis potentiellement atteindre ensuite la surface et les nappes phréatiques, après plus de 100 000 ans et en quantités extrêmement faibles. Leur impact radiologique serait alors plusieurs dizaines de fois inférieur à la radioactivité naturelle (qui est de 2,4 milliSievert par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 851 - risques?
Posée par claudine PEYON, L'organisme que vous représentez (option) (GUÉRANDE), le 14/12/2013
Comment pouvez-vous certifier qu'il n'y aura aucun risque à court et à long terme?......(comme il ne devait y avoir aucun risque dans les centales nucléaires)
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 850 - Quelle gouvernance, quelle participation des citoyens (en bonne et due forme) ?
Posée par Anne AMBLÈS, L'organisme que vous représentez (option) (MAYENNE), le 14/12/2013
Quelle gouvernance, quelle participation des citoyens (en bonne et due forme) ? Pourquoi n'a-t-il pas été organisé de grande conférence citoyenne comme savait si bien les organiser la Commission Française de Développement Durable sous la présidence de Jacques Testart ? Quelle gouvernance pour le présent et l'avenir, quel contrôle citoyen (mondial car le problème est mondial) ?
Réponse du 11/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
En France, le Parlement s’est saisi de la question des déchets radioactifs dès 1991. C’est lui qui définit les orientations de la politique nationale de gestion des déchets radioactifs et qui fixera les conditions de réversibilité du stockage. La loi du 28 juin 2006 a été votée par le Parlement après l’évaluation du programme de recherches mis en place par la loi de 1991 et un débat public sur la politique nationale de gestion des déchets radioactifs. Cette loi prévoyait qu’un nouveau débat public soit organisé sur le projet de stockage profond réversible dont le Parlement a confié l’étude à l’Andra. C’est l’objet du présent débat public sur le projet Cigéo.
Même si les réunions publiques ont été empêchées, les très nombreuses contributions pendant le débat public (questions, cahiers d’acteurs, interventions dans les médias…) montrent l’implication de nos concitoyens sur les enjeux liés à la gestion des déchets radioactifs. La CNDP a également pris l’initiative d’organiser une Conférence de citoyens sur le projet Cigéo (http://www.debatpublic.fr/docs/conf-citoyens-cigeo/avis-citoyen-cigeo-03-02-14.pdf). Un débat contradictoire a été organisé par la Commission particulière du débat public (CPDP) sur la gouvernance, avec la participation d’une responsable de l’Öko Institut (Allemagne). La vidéo et le verbatim sont consultables sur le site du débat public : ../informer/20-11-13-la-gouvernance.html.
Le projet Cigéo doit répondre à de nombreux enjeux, de sûreté, industriels et sociétaux. La gouvernance du projet permet d’impliquer les différents acteurs et parties prenantes liés à ces enjeux et de recueillir leurs points de vue et leurs attentes, sous le contrôle de l’État et des évaluateurs (cf. chapitre 7 du dossier de l’Andra, consacré à la gouvernance et à la réversibilité : ../docs/dmo/chapitres/DMO-Andra-chapitre-7.pdf). Au niveau local, le Comité local d’information et de suivi du Laboratoire de Bure assure une mission générale de suivi, d’information et de concertation depuis une quinzaine d’années (http://www.clis-bure.com/).
Le Comité d’expertise et de suivi de la démarche d’information et de consultation, rattaché au Conseil scientifique de l’Andra, a appelé l’attention sur l’articulation entre gouvernance et réversibilité : « La mise en œuvre de la réversibilité, qui désigne une modalité particulière de prise de décision, implique des structures de gouvernance originales. Celles-ci doivent, d’une part, faciliter l’intégration des progrès techniques et scientifiques dans la conception et la conduite du stockage et, d’autre part, favoriser l’adaptation aux évolutions de la demande sociétale ». Dans le cadre de ses propositions sur la réversibilité, l’Andra propose ainsi que des rendez-vous réguliers soient programmés avec l’ensemble des acteurs (riverains, collectivités, associations, scientifiques, évaluateurs, État…) pour contrôler le déroulement du stockage et pour préparer chaque décision importante concernant les étapes suivantes. Pour plus d’informations sur les propositions de l’Andra : ../docs/rapport-etude/fiche-reversibilite-cigeo.pdf.
Le débat public de 2005/2006 s’était conclu sur la question : faut-il faire confiance à la géologie ou à la société ? La conviction de l’Andra est qu’il faut faire confiance à la géologie ET à la société.
C’est notre définition du stockage réversible.
QUESTION 849 - Assurance
Posée par Yves PEYON, L'organisme que vous représentez (option) (MESQUER), le 14/12/2013
Quelle assurance allez-vous souscrire pour couvrir tous les risques? Sur quelle durée? A quel coût? Qui paiera?
Réponse du 11/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’Andra est un établissement public placé sous la tutelle de l’État. Pour Cigéo, comme tout industriel, l’Andra contractera des assurances destinées à couvrir les risques industriels classiques. De plus, Cigéo étant une installation nucléaire, elle est soumise au régime de responsabilité civile nucléaire. En cas d’accident nucléaire survenant sur le site de l’Andra, la responsabilité de cette dernière sera mise en cause sans que les victimes n’aient à prouver une faute de l’Andra. Ce régime a notamment pour intérêt de simplifier les recours des victimes qui ne sont pas obligées de multiplier les procédures à l’encontre des autres acteurs intervenant sur le site.
QUESTION 848 - quelle assurance scientifique donnez-vous à ce projet ?
Posée par MARYVONNE LEFEVRE, L'organisme que vous représentez (option) (TARBES), le 14/12/2013
Comment pouvez-vous assurer le citoyen sur la fiabilité de ce projet ainsi que sur les conséquences en cas de séisme ou tout simplement au fil du temps vis à vis des citoyens et de la planète en général ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 847 - pourquoi enfouir?
Posée par christophe ROSSI, L'organisme que vous représentez (option) (HARAUCOURT), le 14/12/2013
Pourquoi enfouir les déchets, de toute nature ? Et en particulier, ceux qui sont connus comme dangereux ? Pourquoi ne pas limiter, voir arrêter, l’essor des activités génératrices de tels déchets tant que l’on n’a pas la maîtrise de leurs retraitements ? Pourquoi laisser peser sur les générations futures notre confort d’aujourd’hui ?
Réponse du 28/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
C’est bien parce que les déchets dont il est question sont dangereux que la France a choisi le stockage profond comme solution pour les gérer sur le très long terme.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage en surface. En effet, laisser les déchets dans des installations en surface impliquerait de renouveler périodiquement les bâtiments où ils seraient placés, de contrôler ces installations et de les maintenir. En cas de perte de contrôle de ces installations, les conséquences radiologiques sur l’homme et l’environnement ne seraient pas acceptables. Compte tenu de la durée pendant laquelle ces déchets resteront dangereux (plusieurs centaines de milliers d’années), l’entreposage - qu’il soit en surface ou à faible profondeur - ne peut être qu’une solution provisoire dans l’attente d’une solution définitive.
D’autres solutions ont été étudiées en France et à l’étranger depuis plus de 50 ans : envoi dans l’espace, au fond des océans, dans le magma, séparation-transmutation… Le stockage est aujourd’hui considéré dans tous les pays comme la meilleure solution pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs sur le très long terme. La directive européenne du 19 juillet 2011 considère ainsi que le stockage géologique constitue actuellement la solution la plus sûre et la plus durable en tant qu’étape finale de la gestion des déchets de haute activité.
Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de déchets radioactifs. Grâce à la réversibilité, les générations suivantes garderont la possibilité de faire évoluer cette solution. Les rendez-vous proposés par l’Andra seront notamment alimentés par les résultats de la surveillance et par les recherches qui continueront à être menées sur la gestion des déchets radioactifs et les avancées technologiques. A chaque étape, il sera possible de décider de poursuivre le processus de stockage tel qu’initialement prévu ou de le modifier, par exemple si des solutions alternatives sont identifiées.
Enfin, il n’appartient pas à l’Andra de se positionner sur la politique énergétique de la France. Son travail est de s’assurer que, quels que soient les choix énergétiques futurs, notre génération propose aux générations suivantes une solution permettant de mettre définitivement en sécurité les déchets produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles.
QUESTION 846 - comment peut -on imaginer pouvoir s'engager sur de si longues périodes?
Posée par genevieve MANUELIAN, L'organisme que vous représentez (option), le 14/12/2013
Nous n'avons aucune idée de ce qu'il se passera sur la plan géopolitique, du côté de Bure, dans 100 ans, 1000 ans, 5000 ans. Quelle langue parlerons-nous, quels besoins des populations, quelle situation sanitaires, quelles migrations... Comment peut-on engager l'avenir sur une si longue période, alors qu'il n'y aura plus personne pour en rendre compte? Les garanties données aujourd'hui n'auront aucune valeur, ni aucun sens s'il se pose un problème de détérioration des protections...
Réponse du 27/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le stockage profond est la solution retenue par le Parlement français, comme dans les autres pays, comme solution de gestion à long terme des déchets radioactifs. En effet, la sûreté à très long terme du stockage est assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage en surface. En effet, laisser les déchets dans des installations en surface impliquerait de renouveler périodiquement les bâtiments où ils seraient placés, de contrôler ces installations et de les maintenir. En cas de perte de contrôle de ces installations, les conséquences radiologiques sur l’homme et l’environnement ne seraient pas acceptables. Compte tenu de la durée pendant laquelle ces déchets resteront dangereux (plusieurs centaines de milliers d’années), l’entreposage - qu’il soit en surface ou à faible profondeur - ne peut être qu’une solution provisoire dans l’attente d’une solution définitive.
D’autres solutions ont été étudiées en France et à l’étranger depuis plus de 50 ans : envoi dans l’espace, au fond des océans, dans le magma, séparation-transmutation… Le stockage est aujourd’hui considéré dans tous les pays comme la meilleure solution pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs sur le très long terme. La directive européenne du 19 juillet 2011 considère ainsi que le stockage géologique constitue actuellement la solution la plus sûre et la plus durable en tant qu’étape finale de la gestion des déchets de haute activité.
Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de déchets radioactifs. Grâce à la réversibilité, les générations suivantes garderont la possibilité de faire évoluer cette solution. Les rendez-vous proposés par l’Andra seront notamment alimentés par les résultats de la surveillance et par les recherches qui continueront à être menées sur la gestion des déchets radioactifs et les avancées technologiques. A chaque étape, il sera possible de décider de poursuivre le processus de stockage tel qu’initialement prévu ou de le modifier, par exemple si des solutions alternatives sont identifiées.
QUESTION 845 - Comment seront transportés les déchets à destination de Bure ?
Posée par Perline CREVEAU, L'organisme que vous représentez (option) (LA FREISSINOUSE), le 14/12/2013
Comment seront transportés ces déchets à destination de Bure, à quel rythme (quel tonnage cela représente-t-il par mois, ou par an), et pendant combien de temps ? Merci
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les modalités d’acheminement des colis de déchets radioactifs depuis les sites où ils sont entreposés jusqu’à Cigéo sont étudiées par les producteurs de déchets (Areva, CEA et EDF). Le transport par voie ferroviaire est privilégié. Le réseau ferré national permet d’acheminer les convois jusqu’à proximité de Cigéo.
La desserte locale de Cigéo est étudiée dans le cadre du schéma interdépartemental de développement du territoire. L’arrivée et le déchargement des trains se feraient dans un terminal ferroviaire spécifique.
Le transport des colis de déchets radioactifs représenterait en moyenne deux trains par mois sur la durée d’exploitation de Cigéo (le pic serait au maximum de l’ordre de deux trains par semaine). L’arrivée des trains s’effectuerait dans un terminal ferroviaire dédié. Deux options sont présentées au débat public : ce terminal pourrait être construit soit sur le site de Cigéo, avec la création d’une voie de raccordement au réseau ferré existant par exemple sur l’ancienne ligne entre Gondrecourt-le-Château et Joinville, soit à une vingtaine de kilomètres de Cigéo, sur le réseau ferré existant. Dans ce dernier cas, les emballages de transport contenant les colis de déchets devraient alors être transportés par camions entre le terminal et Cigéo. Pour décharger un train, qui transporte en moyenne une dizaine de wagons, une dizaine de rotations d’un camion entre le terminal ferroviaire et Cigéo seraient nécessaire.
Pour plus d’informations sur les itinéraires étudiés pour le transport des colis de déchets, vous pouvez consulter le chapitre correspondant du dossier du maître d’ouvrage (4.3 – Le transport des colis de déchets): ../docs/dmo/chapitres/DMO-Andra-chapitre-4.pdf
QUESTION 844 - Que se passerait-il si... ?
Posée par Yves BERTHELEMY, L'organisme que vous représentez (option) (AUBE), le 14/12/2013
Bonjour, Pour alimenter le débat: Puisque les spécialistes de l'Andra et de l'INVS sont si sûrs de la sécurité d'un centre comme Cigéo, peuvent ils répondre à ses simples questions: Cigéo est étudié pour répondre à tous les risques actuellement connus. Qu'en sera t-il lorsque un nouveau risque, aujourd'hui inconnu apparaîtra ? Quelles solution d'urgence adopter ? Evacuer les trois quart de la France ? Autre question, imaginons d'ici quelques milliers d'années un tremblement de terre majeur (la région connait régulièrement des mouvements telluriques), entrainant des failles et des ruptures dans les galeries, laissant s’infiltrer de l'eau (nous sommes en région riche en nappes phréatiques), entraînant des réactions chimiques avec hydrogène et chaleur). Comment seront contenues les émanations nucléaires dans l'air, dans l'eau, dans les plantes et animaux que nos descendants mangeront ? Le risque d'explosion majeure à 500m de profondeur, démultipliée par les produits à risque tels que plutonium, hydrogène, bitume, a-t-il ne serait-ce que modélisé, pour ne pas dire envisagé ? comment prédire que cela ne pourra JAMAIS se passer sur les cent mille ans de dangerosité extrême de ces déchets... Merci de me répondre, de répondre à tous. Cordialement
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 843 - Qu'est ce qui doit être stocké et qu'est ce qui ne doit pas l'être ?
Posée par Alain CREVEAU, L'organisme que vous représentez (option) (LA FREISSINOUSE), le 14/12/2013
Pouvez-vous me dire quels types de matériaux, de produits et de déchets doivent être ainsi enfouis, et lesquels ne pourront pas l'être ? En précisant les volumes nets et bruts (non conditionnés et conditionnés) qu'ils représentent par catégorie de déchets, et ce qu'il est prévu pour les déchets qui ne pourront pas être "traités" par enfouissement ? Je vous en remercie.
Réponse du 11/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le projet de stockage profond Cigéo est conçu pour mettre en sécurité définitive les déchets dont le niveau de radioactivité et la durée de vie ne permettent pas de les stocker, de manière sûre à long terme, en surface ou à faible profondeur. L’inventaire détaillé des déchets radioactifs susceptibles d’être stockés dans Cigéo a été établi en lien avec les producteurs de déchets. Le document est disponible sur le site du débat public : ../docs/rapport-etude/dechets-pris-en-compte-dans-etudes-conception-cigeo.pdf.
Les déchets concernés proviennent principalement du secteur de l’industrie électronucléaire et des activités de recherche associées ainsi que, dans une moindre part, des activités liées à la Défense nationale. Les déchets vitrifiés dits de « haute activité » (HA) correspondent principalement aux résidus hautement radioactifs issus du traitement des combustibles nucléaires usés utilisés pour la production d’électricité. Les déchets dits de « moyenne activité à vie longue » (MA-VL) ont des origines variées : résidus issus du traitement des combustibles nucléaires usés et de la fabrication de certains combustibles, composants (hors combustible) ayant séjournés dans les réacteurs nucléaires, déchets technologiques issus de la maintenance des installations nucléaires, de laboratoires, d’installations liées à la Défense nationale, du démantèlement...
Cigéo est conçu pour prendre en charge les déchets produits par les installations nucléaires existantes. Les volumes de déchets HA et MA-VL sont estimés à environ 10 000 m3 pour les déchets HA (soit environ 60 000 colis de déchets) et environ 70 000 m3 pour les déchets MA-VL (soit environ 180 000 colis de déchets) dans l’hypothèse d’une poursuite de la production électronucléaire* et d’une durée de fonctionnement des installations nucléaires existantes de 50 ans. Dans cette hypothèse, 30 % des déchets HA et 60 % des déchets MA-VL sont déjà produits. Par précaution, des volumes supplémentaires (environ 20 % du volume de déchets MA-VL à stocker) sont prévus en réserve dans Cigéo pour certains déchets de faible activité à vie longue qui, le cas échéant, ne pourraient pas être stockés dans le stockage à faible profondeur à l’étude par l’Andra.
Cigéo est conçu pour être flexible afin de pouvoir s’adapter à d’éventuels changements de la politique énergétique. En cas d’arrêt de la production électronucléaire et d’arrêt du traitement des combustibles nucléaires usés, l’inventaire des déchets de haute activité à stocker serait alors d’environ 20 000 colis de déchets vitrifiés (suite à l’arrêt du traitement) et 57 000 assemblages de combustibles usés (selon les hypothèses présentées au chapitre 1 du dossier du maître d’ouvrage ../docs/dmo/chapitres/DMO-Andra-chapitre-1.pdf). A la demande du Ministère en charge de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, l’Andra, EDF et Areva ont étudié l’impact des différents scénarios établis dans le cadre du débat national sur la transition énergétique sur la production de déchets radioactifs et sur le projet Cigéo : ../docs/rapport-etude/20130705-courrier-ministere-ecologie.pdf
* Les déchets produits par un éventuel futur parc de réacteurs ne sont pas pris en compte.
QUESTION 842 - Comment légitimer le droit de polluer les génération future pendant plus de cent mille ans?
Posée par Damien DELPIROUX, L'organisme que vous représentez (option) (CREST), le 14/12/2013
Demandons nous le droit aux habitants futur d'enfouir sous leur pieds des produits toxique et hautement dangereux? A qui demanderez vous cette autorisation? Qu'est-ce qui vous rend légitime à prendre ce risque pour plusieurs centaines de milliers d'années???
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Le projet Cigéo suit la procédure décrite à l’article L. 542-10 du Code de l’Environnement.
Plusieurs procédures de consultation sont organisées afin de recueillir l’avis des populations locales et nationales (débat public, avis des collectivités territoriales, enquête publique).
Le Parlement fixe périodiquement les choix relatifs à la mise en œuvre de ce projet :
- loi du 30 décembre 1991, dite loi « Bataille », fixant un programme d’études et recherches de 15 années d’études et recherches sur les déchets radioactifs ;
- loi du 28 juin 2006, définissant le stockage géologique profond comme solution de référence pour les déchets les plus radioactifs et demandant sa mise en service en 2025 ;
- loi à venir sur la réversibilité du projet.
En outre, l’Etat est en contact permanent avec les parties prenantes locales. Un important travail de concertation a été mené, notamment avec les exécutifs locaux, pour élaborer un projet de schéma interdépartemental du territoire.
L’avis des populations locales au travers des procédures de consultation et l’expression de leurs représentants au Parlement est primordial.
La décision d’autoriser ou non la création de Cigéo en Meuse/Haute-Marne n’est pas encore prise. Elle reviendra à l’Etat après l’évaluation du dossier remis par l’Andra en 2015 par l'Autorité de sûreté nucléaire, la Commission nationale d'évaluation et l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, l’avis des collectivités territoriales, le vote d’une nouvelle loi fixant les conditions de réversibilité et une enquête publique.
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
C’est justement pour ne pas laisser aux générations futures la charge de la gestion des déchets radioactifs et les risques associés que le Parlement a fait le choix du stockage réversible profond, après 15 années de recherche et leur évaluation sur le plan scientifique et de la sûreté. A l’inverse de l’entreposage, le stockage permet de mettre en place une protection pour le très long terme. Les générations suivantes auront la possibilité de contrôler sa mise en œuvre grâce à la réversibilité. L’Andra propose ainsi que des points de rendez-vous réguliers soient prévus pendant toute la durée de réalisation du projet avec l’ensemble des acteurs concernés (riverains, collectivités, évaluateurs, Etat…) pour évaluer le fonctionnement du Centre et préparer les étapes suivantes. Cette démarche s’inscrit dans la continuité des échanges engagés depuis 1991 sur le projet. Les acteurs locaux ont été associés à chaque étape du projet. A ce jour, l’Andra a accueilli près de 100 000 visiteurs sur le site du Laboratoire souterrain où sont menées les recherches sur le projet de stockage.
Les recherches menées par l’Andra ont pour objectif d’étudier l’évolution du stockage sur le long terme. La démarche scientifique se fonde sur l’observation, puis sur l’expérimentation et enfin sur la modélisation et la simulation numérique qui permettent d’extrapoler des résultats à des échelles inaccessibles via l’expérimentation. Le propre des sciences de la Terre et de l’Univers est que les observations permettent d’appréhender des phénomènes qui se déroulent sur de très longues durées. Cette démarche scientifique est au cœur des études menées par l’Andra depuis une vingtaine d’années pour étudier la faisabilité du stockage profond. Pour mener ces recherches, l’Andra mobilise la communauté scientifique dans de nombreuses disciplines (sciences de la Terre et de l’environnement, chimie, science des matériaux, mathématiques appliquées…) au travers de partenariats avec des organismes de recherche et des établissements universitaires français, ainsi qu’au moyen de coopérations internationales.
Les recherches menées depuis 1994 sur le site étudié en Meuse/Haute-Marne ont permis aux scientifiques de reconstituer de manière détaillée son histoire géologique, depuis plus de 150 millions d’années. Le site étudié se situe dans la partie Est du bassin de Paris qui constitue un domaine géologiquement simple, avec une succession de couches de calcaires, de marnes et de roches argileuses qui se sont déposées dans d’anciens océans. Les couches de terrain ont une géométrie simple et régulière. Cette zone géologique est stable et caractérisée par une très faible sismicité. La couche argileuse étudiée pour l’implantation éventuelle du stockage, qui s’est déposée il y a environ 155 millions d’années, est homogène sur une grande surface et son épaisseur est importante (plus de 130 mètres).
Aucune faille affectant cette couche n’a été mise en évidence sur la zone étudiée.
Cette analyse s’appuie sur des investigations géologiques approfondies : plus de 40 forages profonds ont été réalisés, complétés par l’analyse de plus de 300 kilomètres de géophysique 2D et de 35 km² de géophysique 3D. Environ 50 000 échantillons de roche ont été prélevés.
La roche argileuse a une perméabilité très faible, ce qui limite fortement les circulations d’eau à travers la couche et s’oppose au transport éventuel des radionucléides par convection (c’est-à-dire par l’entraînement de l’eau en mouvement). Cette très faible perméabilité s’explique par la nature argileuse, la finesse et le très petit rayon des pores de la roche (inférieur à 1/10 de micron). L’observation de la distribution dans la couche d’argile des éléments les plus mobiles comme le chlore ou l’hélium confirme qu’ils se déplacent majoritairement par diffusion et non par convection. Cette « expérimentation », à l’œuvre depuis des millions d’années, confirme que le transport des éléments chimiques se fait très lentement (plusieurs centaines de milliers d’années pour traverser la couche). Ces durées de transport constatées sont cohérentes avec celles estimées par simulation.
Les expérimentations menées au Laboratoire souterrain permettent également d’étudier l’impact de la construction et de l’exploitation d’un stockage sur le milieu géologique : impact lié au creusement des galeries, à l’introduction de matériaux exogènes tels que l’acier ou le béton, à l’effet de la chaleur générée par les déchets les plus radioactifs... La conception de Cigéo vise à limiter les perturbations engendrées et l’étude des processus physiques et chimiques permet de vérifier que ces perturbations induites sur la roche restent limitées. Elle fournit également des orientations pour la conception du stockage. L’Andra met également en place des démonstrateurs dans le Laboratoire souterrain, qui permettent notamment de comparer avec les résultats prévus par les simulations (par exemple la répartition du champ de température autour d’une alvéole simulant le stockage de déchets de haute activité) et de s’assurer que les prévisions des modèles sont cohérentes avec ce que l’on observe. Si Cigéo est autorisé, cette démarche sera poursuivie lors de la réalisation progressive du stockage.
Outre l’expérimentation, la validation des modèles passe également par l’étude d’analogues archéologiques ou naturels. Les laitiers de haut-fourneau du XVIe siècle, les blocs de verre issus d’épaves datant de l’Antiquité ou encore les verres basaltiques constituent par exemple des analogues du système « verre/métal/argile » soumis à une altération par l’eau. Bien que la composition chimique et les conditions d’altération de ces verres ne soient pas strictement identiques à celles des matrices utilisées pour vitrifier certains déchets radioactifs, leur étude permet de tester les modèles proposés et de progresser dans la compréhension des mécanismes d’altération. Concernant le comportement des radionucléides, les deux sites de réacteurs nucléaires naturels découverts à Oklo (Gabon) en 1972, celui de Bangombé en surface à 11 m de profondeur et celui d’Okélobondo à 420 m de profondeur, apportent des informations précieuses. Ces réacteurs naturels ont fonctionné il y a 2 milliards d’années, les conditions géologiques, et notamment la teneur du minerai en uranium 235, ayant provoqué une réaction en chaîne spontanée pendant plusieurs centaines de milliers d’années. Les travaux de caractérisation (analyses minéralogiques, chimiques et isotopiques) ont montré la très faible migration des radionucléides dans les conditions chimiques réductrices et en présence d’argile. Ils ont permis d’établir les mécanismes géochimiques qui ont prévalu à ce comportement et de tester les modèles de représentation associés.
La simulation numérique permet d’obtenir des résultats inaccessibles par l’expérience du fait de la complexité et de l’interaction des phénomènes à étudier ou des grandes échelles de temps et d’espace sur lesquelles ils se déroulent. Pour représenter les phénomènes que l’on veut étudier, on utilise des modèles physiques et mathématiques qui sont alimentés par des données acquises sur le terrain, en laboratoire et dans la littérature scientifique. Ces derniers servent à mener des expériences virtuelles qui, en temps réel, se dérouleraient sur des milliers à centaines de milliers d’années, ou à analyser des processus qui intéressent de très grands volumes de roche. Grâce aux outils qu’elle a développés, l’Andra peut étudier différents phénomènes liés, par exemple, à la chaleur, au déplacement de l’eau ou aux échanges chimiques et analyser comment les composants du stockage se comporteraient et évolueraient dans le temps. Ces modèles permettent également de tester des hypothèses de situations dégradées dans l’évolution du stockage. Les différents modèles ainsi que les codes de simulation numérique font l’objet d’inter-comparaisons. Cela contribue à la confiance dans leur validité et permet d’identifier le cas échéant les points de compréhension à approfondir. Ces travaux de comparaison sont menés à l’Andra et dans le cadre de projets internationaux. Les modèles proposés par l’Andra font également l’objet d’une évaluation indépendante par l’IRSN dans le cadre de l’instruction des dossiers de l’Andra. Cela concerne par exemple les modèles d’écoulements hydrogéologiques et de migration des radionucléides, qui sont au cœur des études de sûreté.
L’ensemble de ces travaux font l’objet de publications dans des revues à comités de lecture (50 à 70 publications scientifiques internationales par an depuis 10 ans) et sont évalués par des instances indépendantes, en particulier la Commission nationale d’évaluation, mise en place par le Parlement, et l’Autorité de sûreté nucléaire qui s’appuie sur l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Les grands dossiers scientifiques et techniques que l’Andra remet dans le cadre de la loi font l’objet, à la demande de l’Etat, de revues internationales sous l’égide de l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’OCDE. L’Andra a également été évaluée en 2012 par l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES). Enfin, des expertises sont régulièrement commandées par le Comité local d’information et de suivi du Laboratoire souterrain sur les grands dossiers de l’Andra ou sur des sujets plus ciblés.
C’est la convergence de l’ensemble de ces études qui permet d’apprécier la robustesse du stockage et de préciser les incertitudes résiduelles. L’analyse de sûreté intègre la connaissance acquise et les incertitudes afin de produire une évaluation pénalisante de l’impact du stockage. Les études menées par l’Andra ont montré que l’impact du stockage serait nettement inférieur à celui de la radioactivité naturelle à l’échelle du million d’années.
QUESTION 841 - Pourquoi investir dans une technologie obsolète à court terme ?
Posée par Adeline CREVEAU, L'organisme que vous représentez (option) (LA FREISSINOUSE), le 14/12/2013
De l'avis même de plusieurs partisans de la poursuite des programmes nucléaires civils au motif du réchauffement climatique, l'énergie nucléaire est néanmoins vouée à disparaître à un horizon d'un maximum de 50 ans (la durée de vie des EPR et autres réacteurs mis en service actuellement, ultime génération de centrales), lorsque les solutions alternatives la supplanteront inéluctablement, et moins encore si un autre accident survient. Pourquoi continuer à investir dans une technologie obsolète à court terme, à l'échelle de l'histoire, et qui n'aura vécu en tout et pour tout qu'un siècle (mais un siècle de trop au vu de la durée des nuisances produites, et si cette industrie devait durer plus longtemps, même ces solutions de stockage géologiques ne seraient pas suffisantes) ? Merci beaucoup de votre réponse !
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Le Président de la République a décidé d’engager la transition énergétique, cette transition reposant d'une part sur la sobriété et l’efficacité énergétique, et d'autre part sur la diversification des sources de production et d'approvisionnement.
Concernant la diversification de nos sources d’énergies, le Président de la République a fixé un cap : réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% d'ici 2025. Parallèlement, le Président de la République a indiqué que la transition énergétique serait fondée sur deux principes : l'efficacité énergétique d'une part, et la priorité donnée aux énergies renouvelables d'autre part. Cette mutation prendra du temps et supposera des étapes d’évaluation en fonction des progrès technologiques et scientifiques et des prix relatifs de chaque source d’énergie.
Pour le quinquennat, le Président de la République a pris quatre engagements en cohérence avec cette perspective : la plus ancienne de nos centrales – Fessenheim – sera arrêtée ; le chantier du réacteur EPR de Flamanville sera conduit à son terme ; le système de traitement – recyclage des combustibles usés et la filière qui l’accompagne seront préservés ; aucune autre centrale ne sera lancée durant ce mandat.
QUESTION 840 - Alternative?
Posée par Didier COSTES, L'organisme que vous représentez (option) (ST-ETIENNE DE TULMONT), le 14/12/2013
Au lieu de dépenser des sommes astronomiques pour l'industrie nucléaire (combien de centaines de milliards d'euros en additionnant tout ce qui s'y rapporte) qui constitue une menace pour le vivant (en cas d'accident, plusieurs centaines de milliers d'années potentiellement inhabitables dans une grande région) pourquoi ne pas investir dans des projets alternatifs combinant plusieurs sources d'énergies renouvelables, sans risque majeur pour des millénaires, sur le milieu vivant? En supprimant tout le gaspillage énergétique on pourrait y arriver sans problème. Il suffit de prendre une décision politique dictée par le bon sens et non par des choix imposés par des grands ingénieurs formés dans le même moule.. Les citoyens ne sont pas les abrutis que vous semblez imaginer!
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
La Cour des Comptes a estimé dans son rapport de 2012 sur les coûts de la filière électronucléaire que le coût de production du MWh nucléaire était d'environ 50€. L'impact du programme de "grand carénage" d'EDF, qui prévoit 55 Md€ de dépenses dans les prochaines années pour la maintenance des centrales, aura, d'après ce même rapport un impact de l'ordre de 10% sur le prix du MWh, soit un coût total de l'ordre de 55 €/MWh.
A titre de comparaison, voici ci-dessous les coûts de production de différentes formes d'énergies :
- énergie hydraulique : 15-20 €/MWh
- éolien terrestre : 80-90 €/MWh
- éolien en mer : plus de 220 €/MWh
- photovoltaïque : entre 230 et 370 €/Mwh selon la taille de l'installation
- charbon et gaz : entre 70 et 100 €/MWh (pour les nouveaux projets de centrales)
Il apparaît donc clairement que l'énergie nucléaire est une source d'énergie compétitive aujourd'hui par rapport aux autres sources d’énergie
Par ailleurs, le Président de la République a décidé d’engager la transition énergétique, cette transition reposant d'une part sur la sobriété et l’efficacité énergétique, et d'autre part sur la diversification des sources de production et d'approvisionnement.
Concernant la diversification de nos sources d’énergies, le Président de la République a fixé un cap : réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% d'ici 2025. Parallèlement, le Président de la République a indiqué que la transition énergétique serait fondée sur deux principes : l'efficacité énergétique d'une part, et la priorité donnée aux énergies renouvelables d'autre part. Cette mutation prendra du temps et supposera des étapes d’évaluation en fonction des progrès technologiques et scientifiques et des prix relatifs de chaque source d’énergie.
QUESTION 839 - Déchets nucléaires
Posée par Sandra DAVEAU, L'organisme que vous représentez (option) (MONTBAZON), le 14/12/2013
Que faire des cuves irradiées au moment d'un démantèlement ? Les détruire sur place génère beaucoup de poussière, condamner le site n'est pas une solution de long terme et déplacer des tonnes de béton radioactif semble une très mauvaise solution. Que faire de ces éléments irradiés dans le cas heureux de fermeture d'une centrale et du remplacement de celle-ci par de nouveaux moyens moins dangereux de fabriquer de l'énergie ?
Réponse du 07/02/2014,
Réponse apportée par EDF :
Lors de la déconstruction d'une centrale nucléaire, plus de 80% des déchets ne sont pas radioactifs. Il s'agit principalement de gravats et de ferrailles dont la plus grande partie peut être recyclée ou valorisée. Les déchets radioactifs issus de ces opérations sont gérés dans les filières adaptées à chaque type de déchet. Les déchets de très faible activité (TFA) - bétons, gravats, terres… - sont triés, compactés et conditionnés, puis transportés vers le centre de stockage de l’Andra de Morvilliers. Les déchets de faible et moyenne activité à vie courte (FMA) - essentiellement des matériels ayant contenu ou véhiculé des fluides radioactifs : tuyauteries, robinets, réservoirs, cuve, générateurs de vapeur - sont soit décontaminés sur place, devenant alors des déchets de très faible activité à stocker à Morvilliers, soit compactés, conditionnés et transportés vers le centre de stockage de l'Andra de Soulaines.
Les cuves des centrales nucléaires de production d'électricité sont des composants métalliques qui peuvent être activés par le flux neutronique issu des assemblages combustibles. Lors des opérations de déconstruction, les parties les plus activées de ces composants constituent des déchets moyennement actifs à vie longue (MAVL) et représentent un volume limité (moins de 1% du total). La stratégie de déconstruction envisagée pour ces éléments consiste à les découper sous eau avec des robots opérés à distance. Cette technique a déjà été mise en œuvre à plusieurs reprises dans le monde, et sur des réacteurs de même type que ceux actuellement en exploitation en France. Dans ce cas, la cuve se retrouve complètement immergée sous une hauteur d'eau suffisamment importante pour assurer une parfaite protection radiologique pour l'environnement et les opérateurs. Les "morceaux de cuve" découpés, de type MA-VL, seront placés dans des conteneurs métalliques ou en béton puis transportés vers le centre de stockage géologique prévu par la loi de 2006, installation qui constituera la solution définitive pour la gestion de ces déchets.
Ainsi, tout au long de leur cycle de vie (de la conception à la déconstruction, en passant par la construction et l'exploitation), EDF assume pleinement la responsabilité de la gestion de ses installations de production d'électricité.
QUESTION 838 - Combien ça coûte ?
Posée par Alain CREVEAU, L'organisme que vous représentez (option) (LA FREISSINOUSE), le 14/12/2013
Au-delà du coût de réalisation du site de stockage, à combien est estimé le coût annuel de stockage, rapporté à la tonne (ou au volume ? selon l'unité de mesure retenue...) de matière active stockée ? En précisant comment est calculé ce coût bien sûr. Et donc, sur la durée de stockage estimée, à combien est évalué le coût total ? Merci d'avance
Réponse du 13/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Conformément à la loi du 28 juin 2006, le ministre chargé de l’énergie arrête et publie l’évaluation du coût, sur la base de l’évaluation proposée par l’Andra et après avoir recueilli l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et les observations des producteurs de déchets (EDF, CEA, Areva) qui financeront ces dépenses. Des mises à jour régulières du chiffrage sont prévues pour prendre en compte les résultats des études menées par l’Andra.
La dernière évaluation du coût du stockage validée par le ministère en charge de l’énergie date de 2005. Au stade des études de faisabilité scientifique et technique, le coût du stockage avait été estimé entre 13,5 et 16,5 milliards d’euros, répartis sur une centaine d’années, soit de l’ordre de 150 millions d’euros par an en moyenne. Cette évaluation couvrait notamment le stockage de tous les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue produits par les réacteurs nucléaires français pendant 40 ans.
Le coût du stockage comporte des coûts spécifiques à chaque type de déchets (les déchets de haute activité HA nécessitent une emprise de stockage plus importante que les déchets de moyenne activité à vie longue MAVL, la chaleur qu’ils dégagent nécessitant de les espacer) et des coûts communs (par exemple les puits et descenderies entre les installations de surface et l’installation souterraine). L’évaluation d’un coût par mètre cube (m3) de déchet stocké dépend des hypothèses retenues pour ventiler ces coûts communs aux différents types de déchets.
A titre indicatif, le coût du stockage des déchets MAVL serait de l’ordre de 70 000 € par mètre cube de déchet MAVL stocké et de l’ordre de 1,4 millions d’euros par mètre cube de déchet HA stocké en faisant l’hypothèse d’une répartition des coûts communs au prorata des coûts spécifiques de chaque famille de déchets et sur la base d’un chiffrage du coût global du stockage de 13,5 Md€ (cf. rapport http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-gt-cout-stockage.pdf - chiffrage Andra SI - Mode de réalisation simple en coût brut non actualisé, correspondant à un inventaire de 59 300 m3 de déchets MAVL et 6 690 m3 de déchets HA).
L’Andra a lancé en 2012 les études de conception industrielle du projet Cigéo. Le travail d’études d’optimisation et de prise en compte des suites du débat du public se poursuivra jusqu’à l’été 2014. Le processus d’arrêt d’une nouvelle évaluation par le ministre chargé de l’énergie comprendra ensuite une phase de consultation, avec le recueil de l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et des observations des producteurs de déchets, à l’issue de laquelle le ministre rendra publique la nouvelle estimation arrêtée par l’Etat.
QUESTION 837 - paris sur l'avenir
Posée par madeleine CHATARD, L'organisme que vous représentez (option) (BELIGNEUX), le 14/12/2013
il faut refroidir en permanence les futs contenant les déchets radioactifs Comment l'andra s'organise pour que dans les siècles prochains voir millénaires les générations futures assument cette charge ?
Réponse du 27/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les colis de déchets de haute activité (HA) ont une puissance thermique significative, du fait de leur haut niveau de radioactivité. A l’instar de la radioactivité, la chaleur dégagée par ces colis décroît dans le temps, principalement durant les premières centaines d’années : par exemple, la puissance thermique d’un colis de déchets HA est de l’ordre de 2 000 W au moment de sa fabrication et diminue à 500 watts au bout d’une soixantaine d’années.
Pour être stockés dans Cigéo, leur puissance thermique devra avoir suffisamment diminué pour qu’il ne soit pas nécessaire de les refroidir dans le stockage. Ainsi, si Cigéo est autorisé, la majorité des déchets HA ne serait stockée qu’au-delà de 2075, après une phase d’entreposage de plusieurs dizaines d’années sur le site Areva de La Hague, le temps que leur puissance thermique diminue.
Après la fermeture du stockage, sa sûreté sera assurée de manière passive, c’est-à-dire sans dépendre d’actions humaines, contrairement à un entreposage. La chaleur résiduelle émise par les déchets HA s’évacuera dans la roche.
QUESTION 836 - Pourquoi surveiller si on enfouit ?
Posée par Yann TRIGANNE, L'organisme que vous représentez (option) (TRÉLAZÉ), le 14/12/2013
A quoi cela sert-il de surveiller le comportement des déchets nucléaires enfouis à plusieurs centaines de mètres de profondeur si aucune intervention n'est possible en cas de problème grave ?
Réponse du 11/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les colis de déchets radioactifs seront transférés en souterrain dans des hottes qui feront écran aux radiations émises par les déchets. Ainsi le personnel pourra circuler dans les galeries souterraines pendant l’exploitation notamment pour assurer la surveillance de l’installation et la maintenance des équipements. Le transfert des colis sera fait préférentiellement de manière automatisée mais il sera possible en cas de besoin de passer en pilotage manuel. Ce mode de fonctionnement est courant dans les installations nucléaires existantes qui manipulent ce type de déchets, à La Hague, Marcoule, Cadarache…
QUESTION 835 - Copier l'autruche vous semble-t-il être la meilleure solution?
Posée par Philippe DERUDDER, L'organisme que vous représentez (option) (CAHORS), le 14/12/2013
Copier l'autruche vous semble-t-il être la meilleure solution?
L'autruche croit échapper au danger en s'enfouissant la tête dans le sable. Enfouir les déchets nucléaires ramène notre propre intelligence à celle de l'autruche. Nous avons développé une technologie en n'y voyant que les bénéfices à court terme sans prendre en compte les conséquences à moyen et long terme. Nous sommes face à une situation que nous ne savons pas gérer. Enfouir n'est pas une solution car sur la durée il y aura toujours un évènement qui ramènera à la surface des radionucléides. Ce procédé est totalement irresponsable
Réponse du 06/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestions sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 834 - Qui paiera finalement ?
Posée par Jean-Pierre COILLOT, L'organisme que vous représentez (option) (VOUILLÉ), le 14/12/2013
Si suite à une conjonction de variations de paramètres d’occurrence très faible mais qui se réalise dans mille ans sur ce site de stockage, une rupture de confinement intervient avec un relargage important de matières encore radioactives dans l'environnement, qui paiera pour les conséquences sanitaires, économiques ? Vous remerciant de prendre en compte cette question.
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 833 - En quoi etes vous superieurs aux finlandais ou aux americains qui n'ont toujours pas trouvé la réponse? La solution?
Posée par Christian REVERT, L'organisme que vous représentez (option) (LANDUNVEZ), le 14/12/2013
Avez vous vu ce film: "Into eternity"? Ce sont des ingénieurs nucléaires sur un site d'enfouissement en construction. Le moindre qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont loins d'être convaincus que c'est une solution sans faille, bien au contraire. En quoi leur êtes vous supérieurs et pourquoi? http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19206525&cfilm=186799.html
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Oui, nous avons vu le film Into eternity. L’Andra a même invité fin 2011 au Centre de Meuse/Haute-Marne le réalisateur du film Michael Madsen pour une réunion d’échanges avec les salariés de l’Andra qui travaillent sur la mémoire du stockage, puis une diffusion publique du film suivie d’un débat.
Into eternity traite du projet de stockage profond finlandais Onkalo (stockage de combustibles usés à environ 500 m de profondeur dans une roche granitique). Il s’agit d’un documentaire sous la forme d’un film de science-fiction dans lequel le réalisateur s’adresse aux générations futures. Le film aborde le stockage profond sous l’angle sociétal et éthique. Dans ce documentaire, au-delà du concept même de ce type stockage et de la garantie de sa sûreté sur de très longues échelles de temps, il est surtout question des problématiques de la mémoire de ces centres et de l’«héritage » laissé aux générations futures. Le film de Michael Madsen interpelle pour que la question de la transmission de la mémoire d’un stockage de déchets radioactifs soit davantage prise en considération en Finlande.
Le principe de base du stockage géologique profond est que sa sûreté après fermeture repose sur le milieu géologique et non pas sur des actions humaines. Il est donc conçu pour être fermé et rester sûr même en cas d’oubli.
Malgré cette robustesse du stockage même en cas d’oubli, l’Andra conçoit Cigéo avec l’objectif d’en conserver la mémoire et de la transmettre aux générations futures le plus longtemps possible. Des solutions d’archivage de long terme existent pour les centres de stockage de surface exploités par l’Andra et font l’objet de revues périodiques. Le retour d’expérience montre que ces solutions paraissent robustes pour au moins les 500 premières années. Ainsi, pour Cigéo, l’Andra prévoit qu’un centre de la mémoire perdurera sur le site. Il pourra accueillir le public et comprendra notamment les archives du Centre.
De manière générale, le maintien de la mémoire doit aussi impliquer les acteurs locaux, qui peuvent prendre le relai en cas de défaillance de l’Andra ou de l’État. L’Andra veille d’ores et déjà à les informer sur les enjeux associés à la mémoire et étudie avec des anthropologues, des philosophes ou encore des artistes les facteurs qui peuvent favoriser la transmission de la mémoire. La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
L’Andra a lancé en 2010 un programme d’études pour proposer des outils qui rendent cette transmission plus robuste sur une échelle de temps millénaire. Des pistes se dessinent tels des marqueurs de surface, mais aussi des rendez-vous réguliers à mettre en place au niveau des populations locales.
En tout état de cause, comme il est impossible de garantir notre capacité à communiquer avec des êtres vivant dans plusieurs milliers d’années, c’est chaque génération qui aura la responsabilité de contribuer à transmettre cette mémoire aux générations suivantes.
QUESTION 832 - Risque 0
Posée par bernard PONTON, L'organisme que vous représentez (option) (NANCY), le 14/12/2013
On sait que le risque 0 n'existe pas. On sait qu'une société ne peut vivre ou grandir sans risque. Mais lorsque les conséquences peuvent atteindre le niveau d'un désastre irrémédiable pour l'Homme et son environnement, jusqu'où peut-on argumenter aux citoyens la notion de "risque 0" ?
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
En effet, le risque zero n’existe pas et l’Andra ne prétend pas que le projet Cigeo ferait exception à la règle.
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement afin de contrôler l’impact de ses activités. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, il permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montre que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France). L’Andra a déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Cigéo sera en permanence soumis au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 831 - ethique
Posée par sylvie VENUAT, L'organisme que vous représentez (option) (SAINT JEAN DE BRAYE), le 14/12/2013
Et l’ETHIQUE dans tout ça ? Quelle est la responsabilité de l’homme ? Que fait l’ANDRA des impératifs de solidarité, de justice et de service du bien commun ? Pourquoi ne pas privilégier l’intérêt général au lieu des intérêts particuliers ? Qui évalue sérieusement les impacts sur les générations à venir ? Que fait-on des impératifs élémentaires : * de précaution ? * de défense de la dignité de l’homme ? * de vérité ? * de la responsabilité vis-à-vis des générations futures.
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’éthique et la responsabilité vis-à-vis des générations futures ont justement contribué à retenir le stockage profond.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage en surface qui impliquerait pour les générations futures de renouveler périodiquement les bâtiments où sont placés ces déchets, de contrôler ces installations et de les maintenir.
Le projet Cigéo propose donc une solution responsable pour les générations futures, alors qu’elles n’auront pas bénéficié de l’électricité procurée par la production de ces déchets.
QUESTION 830 - Comment garantir la sécurité pour des centaines voire milliers d'années???
Posée par Francis BORDOZ, L'organisme que vous représentez (option) (CLERMONT FERRAND ), le 14/12/2013
Les déchets nucléaires sont comme chacun sait recyclés; en tous cas c'est ce qu'on nous martelle depuis des dizaines d'années. Admettons qu'après ce recyclage, il en reste quelques fûts, que l'on surveille de près; LA solution pour ces futs on va forcément la trouver puisqu'on nous l'a promis. Tout va bien, il n'y a pas de problème, il faut juste jeter un oeil de temps en temps sur la camelote. Alors pourquoi diable enfouir?!?! Passer d'une situation stable et maitrisée à une situation inconnue!!! Ou alors on nous aurait menti, sur la quantité, la dangerosité le cout??? Et si on nous a menti hier, les mêmes ne nous mentent ils pas aujourd'hui quand ils nous disent que la sécurité sera assurée pour les centaines (miliers? ) d'années à venir. Un peu présomptueux non?
Réponse du 27/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Votre question pose la question du choix du stockage profond réversible plutôt que de l’entreposage.
L’objectif d’une solution de gestion définitive est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme de cette solution doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Le stockage profond répond à ces objectifs. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage en surface. En effet, laisser les déchets dans des installations en surface impliquerait de renouveler périodiquement les bâtiments où ils seraient placés, de contrôler ces installations et de les maintenir. En cas de perte de contrôle de ces installations, les conséquences radiologiques sur l’homme et l’environnement ne seraient pas acceptables. Compte tenu de la durée pendant laquelle ces déchets resteront dangereux (plusieurs centaines de milliers d’années), l’entreposage - qu’il soit en surface ou à faible profondeur - ne peut être qu’une solution provisoire dans l’attente d’une solution définitive.
D’autres solutions ont été étudiées en France et à l’étranger depuis plus de 50 ans : envoi dans l’espace, au fond des océans, dans le magma, séparation-transmutation… Le stockage est aujourd’hui considéré dans tous les pays comme la meilleure solution pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs sur le très long terme. La directive européenne du 19 juillet 2011 considère ainsi que le stockage géologique constitue actuellement la solution la plus sûre et la plus durable en tant qu’étape finale de la gestion des déchets de haute activité.
Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de déchets radioactifs. Grâce à la réversibilité, les générations suivantes garderont la possibilité de faire évoluer cette solution. Les rendez-vous proposés par l’Andra seront notamment alimentés par les résultats de la surveillance et par les recherches qui continueront à être menées sur la gestion des déchets radioactifs et les avancées technologiques. A chaque étape, il sera possible de décider de poursuivre le processus de stockage tel qu’initialement prévu ou de le modifier, par exemple si des solutions alternatives sont identifiées.
QUESTION 829 - les plaques terrestres ne bougent-elles pas?
Posée par Françoise SCHMIT, L'organisme que vous représentez (option) (ANGERS), le 14/12/2013
Les plaques terrestres ne bougent-elles pas?
Bonjour Je ne suis pas très forte en géologie mais ici en Anjou, on peut voir que les plaques terrestres ont bougé au cours des millénaires, alors comment assurer la sécurité des déchets nucléaires dans ce cas. Ni enterrés, ni en surface, nous ne sommes à ce jour capables d'assurer qu'il n'y aura aucun risque et sans doute encore moins lorsqu'ils sont enterrés. Un documentaire montrait qu'à la Hague, on ne savait plus où étaient enterrés certains déchets et ce n'est pas anciens( certes ce ne sont sans doute pas les + irradiés) mais cela montre que les données se perdent. Je pense que tout géologue averti ne pourra pas dire le contraire. Et cela sans compter tous les autres risques dus à des défaillances des systèmes de sécurité, les erreurs humaines etc. Nous devons prendre soin de notre Terre.C'est notre bien le plus précieux. Très Cordialement
Réponse du 11/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
C’est le jeu des failles présentes dans la croute terrestre qui produit les tremblements de terre. Ces jeux sont la conséquence de la tectonique des plaques et des contraintes mécaniques engendrées au sein de la croûte terrestre. Il n’existe pas de failles sous le site Cigéo, et la création de nouvelles failles (liée à la tectonique des plaques, qui est très bien comprise aujourd’hui) au cours des prochains millions d’années, sur la durée de vie des déchets radioactifs, n’est pas envisageable.
Le site d’implantation de Cigéo (située à l’Est du Bassin de Paris) est à l’écart des zones actives où se produisent les jeux de failles qui absorbent le rapprochement des continents Afrique et Europe. Les mouvements tectoniques de grande amplitude et forts séismes qui en découlent se localisent pour l’essentiel en Méditerranée et dans les chaines de montagnes qui la bordent, et pour le reste (résidu) au niveau des grandes failles qui affectent la plaque européenne, comme les failles du fossé d’Alsace et des Vosges en bordure Est du bloc stable que constitue le Bassin de Paris. Ce dernier compte parmi les régions les plus stables du globe. Il est quasiment asismique avec des taux de déformations extrêmement faibles à l’échelle des temps géologiques, comptés en millions d’années.
L’analyse des directions et vitesses de déplacements relatifs des stations GPS installées en Europe, confirme que le Bassin de Paris constitue un bloc rigide et que les déformations (de faible amplitude) se font à ses frontières, comme le souligne la répartition des séismes. En conséquence, seules les failles majeures qui existent déjà sont susceptibles de glisser, avec des mouvements de très faible amplitude, par à-coups séparés dans le temps par plusieurs dizaines à centaines de milliers d’années.
C’est ainsi que la zone de 30 km² étudiée pour l’implantation de l’installation souterraine est, au plus proche, à 1,5 km du fossé de Gondrecourt, et à 6 km du segment le plus proche du système des failles de la Marne (le fossé de la Marne étant lui-même est à 14 km). Les analyses cartographiques montrent l’absence de mouvements de ces failles au cours des derniers millions d’années. Les derniers mouvements tectoniques du fossé de Gondrecourt datent de 20 à 25 millions d’années (datations de cristaux de calcite) ; les derniers mouvements des failles de la Marne sont du même âge ou plus anciens. La réalisation d’une écoute sismique dont le seuil de détection est très bas, et qui discrimine sans ambiguïté séismes naturels et tirs de carrières, permet d’affirmer l’absence de toute activité sur ces failles. En accord avec la réglementation en vigueur concernant la sûreté des installations nucléaires, les ouvrages de stockage sont toutefois dimensionnés pour résister aux séismes maxima physiquement possibles que pourraient générer ces failles si elles redevenaient actives dans le futur.
QUESTION 828 - Quelle garantie concernant la géologie des terrains concernés
Posée par Françoise HUBERT, CITOYEN (DRAVEIL), le 14/12/2013
Comment pouvez vous assurer qu'il n'y a aucun risque géologique dans les 1000 à 10000 ans à venir . Cacher les déchets en les enfouissant n'est pas la solution .
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Avec Cigéo, l’objectif n’est pas de placer les déchets en profondeur pour les oublier ou les cacher.
L’objectif premier du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
En effet, l’entreposage des déchets des déchets implique de renouveler périodiquement les bâtiments où ils sont placés, avec les opérations associées de transferts de déchets radioactifs, de contrôler ces installations et de les maintenir. En cas de perte de contrôle de ces installations, les conséquences radiologiques sur l’homme et l’environnement ne seraient pas acceptables. Compte tenu de la durée pendant laquelle ces déchets resteront dangereux (plusieurs centaines de milliers d’années), l’entreposage - qu’il soit en surface ou à faible profondeur - ne peut être qu’une solution provisoire dans l’attente d’une solution définitive.
Le choix du site de Meuse/Haute/Marne est le résultat de nombreuses années de recherches scientifiques et de reconnaissances géologiques qui ont permis de démontrer qu’il présentait des caractéristiques favorables à l’implantation d’un tel stockage. En s’appuyant sur l’ensemble des recherches menées sur le site depuis 1994, l’Andra a montré qu’il présente des caractéristiques favorables pour assurer la sûreté à long terme du stockage. La Commission nationale d’évaluation mise en place par le Parlement pour évaluer sur le plan scientifique les travaux de l’Andra souligne ainsi dans son rapport 2012 : « le site géologique de Meuse/Haute-Marne a été retenu pour des études poussées, parce qu’une couche d’argile de plus de 130 m d’épaisseur et à 500 m de profondeur, a révélé d’excellentes qualités de confinement : stabilité depuis 100 millions d’années au moins, circulation de l’eau très lente, capacité de rétention élevée des éléments ».
Après la fermeture du stockage, au-delà de la durée de vie des ouvrages industriels, la couche d’argile dans laquelle sera installé le stockage souterrain, servira de barrière naturelle pour retenir les radionucléides contenus dans les déchets et freiner leur déplacement. Le stockage permet ainsi de garantir leur confinement sur de très longues échelles de temps. Seuls quelques radionucléides mobiles et dont la durée de vie est longue pourront migrer jusqu’aux limites de la couche d’argile qu’ils atteindront après plusieurs dizaines de milliers d’années, puis potentiellement atteindre en quantités extrêmement faibles ensuite la surface et les nappes phréatiques, après plus de 100 000 ans. Leur impact radiologique serait alors plusieurs dizaines de fois inférieur à la radioactivité naturelle (qui est de 2,4 mSv par an en moyenne en France).
QUESTION 827 - durée de vie des déchets
Posée par marc LELIEVRE, L'organisme que vous représentez (option), le 14/12/2013
Comment pouvez vous presumer, compter sur le fait que notre civilisation serait capable de gerer des déchets a tres longues vie alors qu'aucune civilisation jusqu'a ce jour n'a duré plus du dizieme de la durée de vie des déchets que vous voulez enfouir...?
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’impossibilité de garantir la capacité de la société à surveiller les déchets radioactifs pendant des milliers d’années est justement une des raisons qui a conduit au choix de la solution du stockage profond pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs. Contrairement à un entreposage de longue durée, le stockage dans une couche géologique assurant le confinement des éléments radioactifs à l’échelle de plusieurs centaines de milliers d’années permet de protéger l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets sans nécessité d’action humaine. La géologie prend ainsi le relais de l’homme pour garantir la sûreté sur le très long terme. La surveillance du site pourra néanmoins être maintenue aussi longtemps que les générations futures le souhaiteront et contribuera au maintien de la mémoire du stockage.
Si vous souhaitez plus d’informations sur la sûreté de Cigéo, vous pouvez consulter le chapitre 5 du dossier de présentation du projet ../docs/dmo/chapitres/DMO-Andra-chapitre-5.pdf
QUESTION 826 - pourquoi et comment pouvez-vous dire que vous maîtrisez tous les risques pour les millions d'années à venir ?????????
Posée par danielle CHARLEMAGNE, MOI-MÊME... (SAINT DIZIER), le 14/12/2013
Tous les matériels et matériaux subissent l'usure, l'érosion : comment pouvez-vous être si sûrs qu'il ne se produira pas un accident mécanique, électrique, informatique, une erreur humaine, une erreur de conception ou bien un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d'eau... vous vous prenez pour des dieux nucléocrates tout-puissants ? Lorsque le site sera définitivement fermé il ne sera plus possible de remédier à un problème technique ou à celui provoqué par un mouvement de terrain... et encore moins à un séisme ! parmi les solutions vous avez choisi la MEILLEURE pour notre présent et pour, aller disons les 100 prochaines années. Mais vous avez choisi LA PIRE DES SOLUTIONS pour les générations futures ! Je vous considère comme des ASSASSINS en puissance... ASSASSINS de nos descendants ! les catastrophes nucléaires ces 50 dernières années ne suffisent pas à vous ouvrir les yeux ! vous persistez dans la voie du nucléaire et ne savez plus que faire des déchets ! vous êtes vraiment des apprentis sorciers !
Réponse du 17/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
Vos propos sont insultants pour toutes celles et tous ceux qui travaillent à la mise en œuvre de solutions sûres pour protéger les populations actuelles et futures des risques liés aux déchets radioactifs. Toutes les personnes qui travaillent à l’Andra partagent une même valeur : la responsabilité. Nous sommes responsables de la sûreté de nos installations. Nous sommes responsables devant les territoires qui nous accueillent. Nous sommes également responsables devant les générations futures. Les personnes de l’Andra qui travaillent sur les sites de stockage et habitent à proximité sont les premières concernées par la sécurité. Croyez-vous qu’elles accepteraient de travailler sur un site dont la sûreté ne serait pas garantie ?
Quels que soient les choix énergétiques futurs, c’est la responsabilité de notre génération de proposer aux générations suivantes une solution permettant de mettre définitivement en sécurité ces déchets, qui sont produits en France depuis plusieurs dizaines d’années. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
QUESTION 825 - Avenir
Posée par Fabien DESBORDES, L'organisme que vous représentez (option) (SALLES-SUR-MER), le 14/12/2013
Bonjour les hommes politiques nous culpabilisent sur la dette économique que nous laisserions à nos enfants. Comment peuvent-ils engager nos enfants pour des millénaires dans la gestion des déchets radioactifs? Sur des périodes aussi longues qui peut garantir cette gestion et qu'il n'y aura aucun problème géologique? Si ce mode de confinement des déchets est choisi pourquoi ne pas engager les promoteurs de cette solution sur leur bien personnel, et pendant des générations, puisqu'ils sont sûr de la fiabilité? Cordialement
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
La loi du 28 juin 2006 a fait le choix du stockage réversible profond pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations futures. Ce choix a été fait après un programme de quinze années d’études et recherches encadrée par la loi « Bataille » de 1991, un débat public en 2005-2006 et les avis des évaluateurs sur ces recherches. Il est conforté au niveau international par la directive européenne du 19 juillet 2011 qui considère que « il est communément admis que sur le plan technique, le stockage en couche géologique profonde constitue, actuellement, la solution la plus sûre et la plus durable en tant qu’étape finale de la gestion des déchets de haute activité et du combustible usé considéré comme déchet. »
Elle demande à l’Andra d’étudier et d’implanter Cigéo en rappelant que « la demande d'autorisation de création [d’un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs] doit concerner une couche géologique ayant fait l'objet d'études au moyen d'un laboratoire souterrain ». L’Andra poursuit donc ses études en vue d’élaborer pour 2015 le dossier support à l’instruction de la demande d’autorisation de création de Cigéo en Meuse/Haute-Marne, dans la couche d’argile dont les propriétés de confinement sont désormais reconnues.
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Monsieur,
Les personnes de l’Andra qui travaillent sur les sites de stockage et habitent à proximité sont les premières concernées par la sécurité. Croyez-vous qu’elles accepteraient de travailler sur un site dont la sûreté ne serait pas garantie ?
Quels que soient les choix énergétiques futurs, c’est la responsabilité de notre génération de proposer aux générations suivantes une solution permettant de mettre définitivement en sécurité ces déchets, qui sont produits en France depuis plusieurs dizaines d’années. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est justement de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de ces déchets. Grâce à la réversibilité, les générations suivantes garderont la possibilité de faire évoluer cette solution si elles le souhaitent.
QUESTION 824 - Aujourd'hui et demain
Posée par Anne-Marie LIZAMBERT, L'organisme que vous représentez (option) (CHARMES LA GRANDE), le 14/12/2013
L'argent disbribué maintenant protégera-t'il des nuisances de l'enfouissement demain ? Pourra-t'on compter sur la même générosité quand les nuisances se manifesteront ?
Réponse du 11/02/2014,
Réponse apportée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
L’accompagnement économique du projet est décidé par le Parlement. Des taxes sont prélevées sur les exploitants d’installations nucléaires productrices de déchets radioactifs afin d’accompagner le développement du territoire dans le cadre du laboratoire souterrain et dans le futur du projet Cigéo. Ces sommes, issues des taxes d’accompagnement et de diffusion technologique, sont gérées par deux groupements d’intérêt public (GIP) en Meuse et en Haute Marne, afin de réaliser les actions d’insertion territoriale décrites à l’article L. 542-11 du Code de l’environnement :
1° « gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation du laboratoire ou du centre de stockage » ;
2° « mener, dans les limites de son département, des actions d'aménagement du territoire et de développement économique, particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils généraux concernés » ;
3° « soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques, notamment dans les domaines étudiés au sein du laboratoire souterrain et dans ceux des nouvelles technologies de l'énergie. »
Dans le cadre du contrôle de légalité, l’Etat contrôle que l'affectation des ressources fiscales et des dépenses des collectivités respectent la réglementation. De plus, l'Etat, est administrateur ou commissaire du gouvernement des GIP et vérifie dans ce cadre l’utilisation des ressources qui leur sont dévolues.
S’il est autorisé, le projet Cigéo sera soumis à la fiscalité locale, notamment la taxe foncière et la contribution économique territoriale. Ces taxes seront versées par l’exploitant du stockage pendant toute la durée de vie de l’installation.
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
QUESTION 823 - Quelle garantie ?
Posée par Alain FRAPPIN, L'organisme que vous représentez (option) (VERN D'ANJOU), le 14/12/2013
Qui pourra garantir que, dans 10, 100 ou mille années, aucune fuite ne sortira des conteneurs de déchets enfouis jusqu'à la surface par des infiltrations éventuelles d'eau inattendues ? Qui garantira qu'aucun séisme ne se produira à cet endroit déstabilisant la structure du sous-sol ? Je souhaiterais une réponse non lénifiante, et scientifiquement argumentée parce que mes recherches n'en ont fait ressortir aucune.
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Ainsi, après la fermeture du stockage, au-delà de la durée de vie des ouvrages industriels, la couche d’argile dans laquelle sera installé le stockage souterrain, servira de barrière naturelle pour retenir les radionucléides contenus dans les déchets et freiner leur déplacement. Le stockage permet ainsi de garantir leur confinement sur de très longues échelles de temps. Seuls quelques radionucléides mobiles et dont la durée de vie est longue pourront migrer jusqu’aux limites de la couche d’argile qu’ils atteindront après plusieurs dizaines de milliers d’années, puis potentiellement atteindre en quantités extrêmement faibles ensuite la surface et les nappes phréatiques, après plus de 100 000 ans. Leur impact radiologique serait alors plusieurs dizaines de fois inférieur à la radioactivité naturelle (qui est de 2,4 mSv par an en moyenne en France). .
A propos de la présence des séismes. Le site d’implantation de Cigéo (située à l’Est du Bassin de Paris) est à l’écart des zones actives où se produisent les jeux de failles qui absorbent le rapprochement des continents Afrique et Europe. Les mouvements tectoniques de grande amplitude et forts séismes qui en découlent se localisent pour l’essentiel en Méditerranée et dans les chaines de montagnes qui la bordent, et pour le reste (résidu) au niveau des grandes failles qui affectent la plaque européenne, comme les failles du fossé d’Alsace et des Vosges en bordure Est du bloc stable que constitue le Bassin de Paris. Ce dernier compte parmi les régions les plus stables du globe. Il est quasiment asismique avec des taux de déformations extrêmement faibles à l’échelle des temps géologiques, comptés en millions d’années.
L’analyse des directions et vitesses de déplacements relatifs des stations GPS installées en Europe, confirme que le Bassin de Paris constitue un bloc rigide et que les déformations (de faible amplitude) se font à ses frontières, comme le souligne la répartition des séismes. En conséquence, seules les failles majeures qui existent déjà sont susceptibles de glisser, avec des mouvements de très faible amplitude, par à-coups séparés dans le temps par plusieurs dizaines à centaines de milliers d’années.
C’est ainsi que la zone de 30 km² étudiée pour l’implantation de l’installation souterraine est, au plus proche, à 1,5 km du fossé de Gondrecourt, et à 6 km du segment le plus proche du système des failles de la Marne (le fossé de la Marne étant lui-même est à 14 km). Les analyses cartographiques montrent l’absence de mouvements de ces failles au cours des derniers millions d’années. Les derniers mouvements tectoniques du fossé de Gondrecourt datent de 20 à 25 millions d’années (datations de cristaux de calcite) ; les derniers mouvements des failles de la Marne sont du même âge ou plus anciens. La réalisation d’une écoute sismique dont le seuil de détection est très bas, et qui discrimine sans ambiguïté séismes naturels et tirs de carrières, permet d’affirmer l’absence de toute activité sur ces failles. En accord avec la réglementation en vigueur concernant la sûreté des installations nucléaires, les ouvrages de stockage sont toutefois dimensionnés pour résister aux séismes maxima physiquement possibles que pourraient générer ces failles si elles redevenaient actives dans le futur.
QUESTION 822 - responsabilité
Posée par chantal GEHIN, L'organisme que vous représentez (option) (NANTOIN), le 14/12/2013
comment va fonctionner la responsabilité civile dans plusieurs milliers d'années?
Réponse du 10/01/2014,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Il est déjà possible de vous indiquer comment fonctionne la responsabilité civile aujourd'hui. Les risques nucléaires sont couverts par un régime spécifique de responsabilité civile nucléaire régie en France par les conventions de Paris et de Bruxelles. Celles-ci définissent notamment les dommages rattachés à ces risques, l'indemnisation des victimes et les niveaux de garanties requis. Plusieurs tranches de garanties sont prévues : une première à la charge de l'exploitant (qui doit faire l'objet d'une garantie financière, un contrat d'assurance par exemple), une seconde à la charge de l'Etat et enfin une dernière à la charge d'un fonds international.
Le régime a été l'objet d'améliorations successives depuis sa mise en place 1960 et il y a toutes les raisons de croire que celles-ci se poursuivront durant les années à venir.
QUESTION 821 - en quelle langue
Posée par chantal GEHIN, L'organisme que vous représentez (option) (NANTOIN), le 14/12/2013
qui a imaginé une langue capable d'etre comprise dans plusieurs milliers d'années?
Réponse du 08/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif fondamental de Cigéo est de protéger l’homme et l’environnement des déchets radioactifs sur de très longues échelles de temps. La sûreté à long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines et notamment en imaginant une perte complète de la mémoire du stockage. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Malgré cette robustesse du stockage même en cas d’oubli, l’Andra conçoit Cigéo avec l’objectif d’en conserver la mémoire et de la transmettre aux générations futures le plus longtemps possible. Des solutions d’archivage de long terme existent pour les centres de stockage de surface exploités par l’Andra et font l’objet de revues périodiques. Le retour d’expérience montre que ces solutions paraissent robustes pour au moins les 500 premières années. Ainsi, pour Cigéo, l’Andra prévoit qu’un centre de la mémoire perdurera sur le site. Il pourra accueillir le public et comprendra notamment les archives du Centre. De manière générale, le maintien de la mémoire doit aussi impliquer les acteurs locaux, qui peuvent prendre le relai en cas de défaillance de l’Andra ou de l’État. L’Andra veille d’ores et déjà à les informer sur les enjeux associés à la mémoire et étudie avec des anthropologues, des philosophes ou encore des artistes les facteurs qui peuvent favoriser la transmission de la mémoire. La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
Pour des durées bien plus longues, l’Andra pilote depuis plusieurs années un projet baptisé « mémoire pour les générations futures » avec une trentaine d’études variées (linguistique, société, supports, marqueurs, archéologie, anthropologie…). Ce projet comporte également l’animation de plusieurs groupes de réflexion externes (un par région d’implantation) dont la composition très variée n’est pas fermée, ainsi que la participation active à un groupe international sous l’égide de l’OCDE/AEN avec 16 pays représentés.
En tout état de cause, comme il est impossible de garantir notre capacité à communiquer avec des êtres vivant dans plusieurs milliers d’années, c’est chaque génération qui aura la responsabilité de contribuer à transmettre cette mémoire aux générations suivantes.
QUESTION 820 - gigeo c'est trop rigolo
Posée par christian JAN, L'organisme que vous représentez (option) (PLOUEC DU TRIEUX), le 14/12/2013
ce débat public, comme beaucoup d'ailleurs, est une tartuferie monumentale, aussi ma question est simple: les coupables de ce crime contre l'humanité présente et futur, qu'est l'enfouissement des déchets les plus toxiques que l'homme a inventé, se livreront-ils d'eux même à la police ou est ce que le peuple devra allez les chercher pour les juger?
Réponse du 28/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Monsieur,
Les personnes de l’Andra qui travaillent sur les sites de stockage et habitent à proximité sont les premières concernées par la sécurité. Croyez-vous qu’elles accepteraient de travailler sur un site dont la sûreté ne serait pas garantie ?
Quels que soient les choix énergétiques futurs, c’est la responsabilité de notre génération de proposer aux générations suivantes une solution permettant de mettre définitivement en sécurité ces déchets, qui sont produits en France depuis plusieurs dizaines d’années. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est justement de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de ces déchets. Grâce à la réversibilité, les générations suivantes garderont la possibilité de faire évoluer cette solution si elles le souhaitent.
QUESTION 819 - Pourquoi, encore, utiliser l'énergie nucléaire ?
Posée par Daniel PERRET, L'organisme que vous représentez (option) (CHANTONNAY), le 14/12/2013
Le manque de démocratie ayant présidé, à l'origine, à la création du CEA et au programme nucléaire civil, ensuite, se comprenait par le développement envisagé de la "force de frappe nucléaire française". Comment justifier, en 2013, la poursuite de ces programmes ?
Réponse du 17/01/2014,
Réponse apportée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Le CEA est un établissement public industriel et commercial (EPIC). Le CEA est l’outil dont la puissance publique s’est dotée pour conduire des programmes de recherche en vue d’accroître la connaissance scientifique et stimuler l’innovation et les transferts de technologies dans un certain nombre domaines spécifiques représentants des enjeux stratégiques et sociétaux majeurs.
La France s’est dotée d’un cadre législatif favorisant la transparence dans le domaine du nucléaire et de plusieurs structures de concertation, d ‘information et de débat. Ainsi, des Commissions Locales d’information (CLI) ont été créées auprès des installations nucléaires. Elles sont chargées d’une mission générale de suivi, d’information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d’impact des installations nucléaires sur les personnes et l’environnement. Ces CLI sont regroupées en une Association Nationale des Comités et Commissions Locales d’Information (ANCCLI). Le Haut Comité pour la Transparence et l’Information sur la Sécurité Nucléaire (HCTISN) a été créé par la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (dite "loi TSN"). C’est une instance d’information, de concertation et de débat sur les risques liés aux activités nucléaires et l’impact de ces activités sur la santé des personnes, sur l’environnement et sur la sécurité nucléaire. De plus, la loi du 13 juin 2006 instaure un droit d’accès à l’information en matière nucléaire directement auprès des exploitants, qui permet à tout un chacun de s’informer.
QUESTION 818 - Comment garder les traces ?
Posée par Alain PLANCHET, INDIVIDUEL (BRETAGNE), le 14/12/2013
Comment prétendre garder la trace de cet enfouissement pendant des centaines de milliers d'années alors qu'on perd la trace des civilisations qui ont vécu il y a seulement quelques 20 à 30 siècles ? Comment prétendre que les barrières artificielles ou naturelles utilisées garderont leur efficacité pendant des centaines de milliers d'années ? La conscience est élastique en fonction des intérêts...Mais peut-on oser abandonner aux arrières petits enfants de nos arrières petits enfants ce cadeau empoisonné sans mauvaise conscience ?
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Comment prétendre garder la trace de cet enfouissement pendant des centaines de milliers d'années alors qu'on perd la trace des civilisations qui ont vécu il y a seulement quelques 20 à 30 siècles ?
L’objectif fondamental de Cigéo est de protéger l’homme et l’environnement des déchets radioactifs sur de très longues échelles de temps. La sûreté à long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. C’est une des raisons qui a conduit, en 2006, le Parlement à retenir la solution du stockage profond. En effet, cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli, contrairement à l’entreposage. En cas de perte complète de la mémoire du stockage, une intrusion inopinée à 500 mètres sous terre apparaît peu plausible, du moins sans un minimum d’investigations préalables. L’Andra évalue cependant par précaution dans son analyse de sûreté les conséquences d’un forage à travers le stockage pour vérifier que le stockage resterait sûr.
Malgré cette robustesse du stockage même en cas d’oubli, l’Andra conçoit Cigéo avec l’objectif d’en conserver la mémoire et de la transmettre aux générations futures le plus longtemps possible. Des solutions d’archivage de long terme existent pour les centres de stockage de surface exploités par l’Andra et font l’objet de revues périodiques. Le retour d’expérience montre que ces solutions paraissent robustes pour au moins les 500 premières années. Ainsi, pour Cigéo, l’Andra prévoit qu’un centre de la mémoire perdurera sur le site. Il pourra accueillir le public et comprendra notamment les archives du Centre. De manière générale, le maintien de la mémoire doit aussi impliquer les acteurs locaux, qui peuvent prendre le relai en cas de défaillance de l’Andra ou de l’État. L’Andra veille d’ores et déjà à les informer sur les enjeux associés à la mémoire et étudie avec des anthropologues, des philosophes ou encore des artistes les facteurs qui peuvent favoriser la transmission de la mémoire. La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
En tout état de cause, comme il est impossible de garantir notre capacité à communiquer avec des êtres vivant dans plusieurs milliers d’années, c’est chaque génération qui aura la responsabilité de contribuer à transmettre cette mémoire aux générations suivantes.
Comment prétendre que les barrières artificielles ou naturelles utilisées garderont leur efficacité pendant des centaines de milliers d'années ? La conscience est élastique en fonction des intérêts...Mais peut-on oser abandonner aux arrières petits-enfants de nos arrières petits-enfants ce cadeau empoisonné sans mauvaise conscience ?
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
QUESTION 817 - Quelle garantie dans 1000,10000,100000ans.
Posée par arlette JAWORSKI, L'organisme que vous représentez (option) (CONTREXEVILLE), le 14/12/2013
Comment garantir pour des périodes aussi longues une sécurité. Quelles seront les conséquences sur l'eau en particulier?. Comment intervenir dans ce milieu confiné?
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
On trouve plusieurs nappes d’eau souterraines dans le sous-sol du site retenu pour Cigéo, à différentes profondeurs. La plus en surface est la nappe phréatique présente dans les calcaires du Barrois, reposant sur une couche de roche imperméable située seulement à quelques dizaines de mètres sous le sol. D’autres nappes sont présentes dans des formations calcaires plus profondes. Moins accessibles, offrant des caractéristiques moins intéressantes, elles ne sont pas exploitées localement. Mais en termes de sûreté, l’Andra y accorde la même attention que pour la nappe phréatique (car elles sont exploitées ailleurs dans le bassin parisien, à plusieurs kilomètres ou dizaines de kilomètres de là).
Outre le confinement de la radioactivité assuré par la couche d’argilite, l’Andra a prévu des dispositions spécifiquement destinées à protéger ces nappes d’eau souterraines, notamment :
- En surface, les installations nucléaires de Cigéo seront implantées bien au-dessus du niveau de la nappe phréatique en cas d’une éventuelle remontée exceptionnelle du niveau de celle-ci. Les installations seront protégées (rabattement des eaux, étanchéité des bâtiments…) conformément à la réglementation.
- Au niveau des infrastructures reliant l’installation souterraine à la surface (descenderies, puits), il est prévu de mettre en place un dispositif d’étanchéité au niveau des ouvrages qui traverseront les nappes phréatiques souterraines de manière à bien isoler physiquement celles-ci de l’installation.
- Le génie civil intègre aussi dans sa conception la mise en place d’un drainage permettant d’assurer une collecte et un suivi des eaux collectées dans un réseau prévu à cet effet, faisant l’objet d’entretien et de mesures périodiques. La collecte s'effectue par des goulottes intégrées et déployées sur tout l'ouvrage souterrain.
Ce ne sont que quelques-unes des dispositions visant à confiner la radioactivité des déchets.
Après la fermeture du stockage, au-delà de la durée de vie des ouvrages industriels, la couche d’argile très peu perméable, de plus de 130 mètres d’épaisseur, dans laquelle sera installé le stockage souterrain, servira de barrière naturelle pour retenir les radionucléides contenus dans les déchets et freiner leur déplacement. Le stockage permet ainsi de garantir leur confinement sur de très longues échelles de temps. Seuls quelques-uns de ces radionucléides, les plus mobiles et dont la durée de vie est longue, pourront migrer de manière très étalée dans le temps. Ils ne sortiraient pas de cette couche avant 100 000 ans et atteindraient en quantités extrêmement faibles la surface et les nappes phréatiques. Leur impact radiologique serait alors plusieurs dizaines de fois inférieur à la radioactivité naturelle (qui est de 2,4 mSv par an en moyenne en France).
Dans une démarche prudente, l’Andra dans son évaluation d’impact sur l’homme et l’environnement à long terme suppose que les eaux de ces couches pourraient être captées par forage et utilisées pour des usages du type de ceux qui peuvent être pratiqués aujourd’hui (jardin, boisson, abreuvement des animaux). Les études montrent que, même dans ce cas, l’impact du stockage reste inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire et ne présente pas de risque pour la santé.
QUESTION 816 - POURQUOI TANT DE MENSONGES
Posée par C GAL, L'organisme que vous représentez (option), le 14/12/2013
L'argent mène le monde au détriment de la santé de notre pauvre terre et de ces habitants !! Pourquoi la région EST devrait être la poubelle du nucléaire ? Centre TFA Morvilliers Soulaines FA-MA-VC = 1ère cheminée Morvilliers TFA = 2ème cheminée DAHER Epothémont = 3ème cheminée Morvilliers entreposage FA-VL = 4ème cheminée Stockage FAVL à venir (à côté de Morvilliers) Sans compter la centrale nucléaire de Nogent sur Seine qui présente des problèmes de sécurité (usure des pièces ...) On veut rallonger le temps de vie des centrales à 30 ans alors que, notamment à TRICASTIN, des problèmes graves sont minimisés pour permettre de vanter la sécurité de nos sites nucléaires. Pourquoi ne pas utiliser les sommes colossales qui vont être données à ce projet pour développer les énergies propres. Que laisserons nous aux futures générations ? Nous ne savons pas maitriser et nous jouons aux apprentis sorciers !!! TCHERNOBYL, FUKUSHIMA devraient nous donner à réfléchir mais on préfère minimiser les répercussions sanitaires de ces terribles évènements sur les populations !! Il ne peut y avoir un débat car il est tronqué, et les mensonges pleuvent. On ne donne pas suffisamment la parole aux contestataires du nucléaire et les médias ne remplissent pas leur rôle !!
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
En France, on compte plus d’un millier de détenteurs de déchets radioactifs, tous secteurs confondus (industrie électronucléaire, recherche, Défense nationale, médecine et industrie classique), répartis sur autant de sites partout en France. Les cartes présentées dans l’Inventaire national des déchets et des matières radioactives répertorient les principales implantations, vous pourrez constater qu’elles ne concernent pas que l’est de la France. Vous pouvez consulter l’Inventaire national sur le site de l’Andra http://www.andra.fr/index.php?id=edition_1_1_1&recherche_thematique=6
L’Andra étudie le projet Cigéo conformément à la demande du Parlement. Suite au vote de la loi de 1991, des recherches ont été menées en France pour implanter un laboratoire souterrain afin d’étudier la faisabilité d’un stockage profond. Plusieurs territoires se sont porté candidats, dont les départements de Meuse et de Haute-Marne. Après avoir examiné les candidatures, notamment sur le plan scientifique, le Gouvernement a autorisé l’Andra à construire un laboratoire souterrain en Meuse/Haute-Marne. Les recherches menées depuis près de 20 ans sur le site de Meuse/Haute-Marne ont montré qu’il présente des caractéristiques favorables pour y implanter un stockage sûr à très long terme.
Concernant la responsabilité de notre génération vis-à-vis des générations futures, si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. Grâce à la réversibilité, les générations suivantes garderont la possibilité de faire évoluer cette solution. Les rendez-vous proposés par l’Andra seront notamment alimentés par les résultats des recherches qui continueront à être menées sur la gestion des déchets radioactifs et les avancées technologiques. A chaque étape, il sera possible de décider de poursuivre le processus de stockage tel qu’initialement prévu ou de le modifier, par exemple si des solutions alternatives sont identifiées.
Réponse apportée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
En matière de transition énergétique, le Président de la République a fixé le cap suivant pour le mix électrique français : réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% d'ici 2025. Parallèlement, le Président de la République a indiqué que la transition énergétique serait fondée sur deux principes : l'efficacité énergique d'une part, et la priorité donnée aux énergies renouvelables d'autre part. Cette mutation prendra du temps et supposera des étapes d’évaluation en fonction des progrès technologiques et scientifiques et des prix relatifs de chaque source d’énergie.
QUESTION 815 - est ce bien raisonnable ?
Posée par danièle ROURY, L'organisme que vous représentez (option) (SAINT QUINTIN SUR SIOULE), le 14/12/2013
moi citoyenne, je désapprouve la politique énergétique de la France moi citoyenne, je considère que le nucléaire civil et militaire est tellement dangereux qu'il faut arrêter ces programmes demain moi citoyenne, je suis responsable de la terre que je vais laisser aux générations futures moi citoyenne, je refuse pour le confort d'une minorité d'humains dans le temps et l'espace d'hypothéquer l'avenir moi citoyenne, j'arrêterai immédiatement le projet GIGeo moi présidente, je changerai de cap énergétique : arrêt du nucléaire et développement de la sobriété énergétique et des énergies renouvelables Alors, Monsieur le Président qu'attendez vous ?
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Depuis plusieurs dizaines d’années, la France a mis en place une politique de gestion responsable de ses déchets radioactifs. En 2006, après quinze années de recherches encadrées par la loi « Bataille », d’avis des évaluateurs et d’un débat public, le Parlement a fait le choix du stockage réversible profond pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations futures.
En matière de transition énergétique, le Président de la République a fixé le cap suivant pour le mix électrique français : réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% d'ici 2025. Parallèlement, le Président de la République a indiqué que la transition énergétique serait fondée sur deux principes : l'efficacité énergique d'une part, et la priorité donnée aux énergies renouvelables d'autre part. Cette mutation prendra du temps et supposera des étapes d’évaluation en fonction des progrès technologiques et scientifiques et des prix relatifs de chaque source d’énergie.
QUESTION 813 - qui va garantir que l'irradiation ne se propagera pas dans les 1000 ans à venir ?
Posée par Benita DAVID, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 14/12/2013
et comment allez vous expliquer aux prochaines générations que vous n'étiez pas au courant des risques (alors que tout le monde vous informe !)
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
QUESTION 812 - pourquoi dessous?
Posée par eric PAVIOT, L'organisme que vous représentez (option), le 14/12/2013
Bonjour, pour quelles raisons enfouir ces déchets alors que leur surveillance en "extérieur" me semble mieux répondre à l'obligation de sécurité les concernant?.
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
L’entreposage des déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue implique de renouveler périodiquement les bâtiments où sont placés ces déchets, avec les opérations associées de transferts de déchets radioactifs, de contrôler ces installations et de les maintenir. En cas de perte de contrôle de ces installations, les conséquences radiologiques sur l’homme et l’environnement ne seraient pas acceptables. Compte tenu de la durée pendant laquelle ces déchets resteront dangereux (plusieurs centaines de milliers d’années), l’entreposage - qu’il soit en surface ou à faible profondeur - ne peut être qu’une solution provisoire dans l’attente d’une solution définitive.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Le projet Cigéo propose, ainsi, une solution pour gérer les déchets les plus radioactifs produits en France depuis plus d’un demi-siècle. S’il est mis en œuvre, cela permettra de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations futures, alors qu’elles n’auront pas bénéficié de l’électricité procurée par la production de ces déchets. La réversibilité leur laissera la possibilité de contrôler la mise en œuvre de cette solution et de l’adapter si elles le souhaitent.
D’autres solutions ont été étudiées en France et à l’étranger depuis plus de 50 ans : envoi dans l’espace, au fond des océans, dans le magma, séparation-transmutation… Le stockage est aujourd’hui considéré dans tous les pays comme la meilleure solution pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter leur charge sur les générations suivantes. La directive européenne du 19 juillet 2011 considère ainsi que le stockage géologique constitue actuellement la solution la plus sûre et la plus durable en tant qu’étape finale de la gestion des déchets de haute activité.
QUESTION 811 - Et après?
Posée par Robert BLANC, L'organisme que vous représentez (option) (LOIRE), le 14/12/2013
Quand une de nos centrales aura sauté, quels sont les moyens prévus pour survivre à notre calvaire?
Réponse du 21/01/2014,
Réponse apportée par EDF :
Pour EDF, la sûreté des centrales nucléaires est une priorité absolue, afin que la production d'électricité nucléaire n'ait aucune incidence sur l'homme et l'environnement. La sûreté regroupe l'ensemble des dispositions mises en œuvre dès la conception d'une centrale, puis lors de sa construction, de son exploitation et jusqu'à sa déconstruction pour éviter la dispersion de produits radioactifs. Pour EDF, cette exigence de sûreté repose sur le professionnalisme des équipes formées en permanence, la rigueur d’exploitation qui découle de ce professionnalisme, la qualité et la régularité de la maintenance qui garantissent la fiabilité des installations, mais aussi sur les contrôles effectués au quotidien par l’Autorité de Sûreté Nucléaire et le suivi des réglementations. Ces mesures sont en évolution permanente, comme en témoignent les nombreuses modifications apportées aux installations nucléaires d'EDF depuis l'accident de Fukushima au Japon, afin de les rendre encore plus sûres.
L'expérience accumulée par EDF en France et à l'international en matière d'exploitation nucléaire sans qu'aucun accident n'affecte ses centrales contribue à cette amélioration continue de la sûreté nucléaire. Conformément à la règlementation, chaque incident, même le plus minime, est signalé à l'Autorité de Sûreté Nucléaire, et publié de manière transparente par EDF, et si nécessaire, des mesures complémentaires sont prises pour éviter sa reproduction. L'Autorité de Sûreté Nucléaire évalue chaque année la sûreté de chacune des centrales nucléaires d'EDF, impose si nécessaire des mesures d'amélioration, et publie ces bilans, ces prescriptions, et le suivi de leur exécution.
Enfin, comme pour d'autres installations industrielles, l'Etat a mis en place pour chaque centrale nucléaire un plan de protection et d'évacuation de la population en cas d'accident ayant un impact sur l'environnement, et ces plans font régulièrement l'objet d'exercices, avec les collectivités locales et les services de l'état concernés.
RÉPONSE APPORTÉE PAR L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE (ASN) :
Les activités nucléaires sont exercées de façon à prévenir les accidents, mais aussi à en limiter les conséquences. Malgré toutes les précautions prises, l’ASN considère qu’un accident ne peut jamais être exclu, et il convient de prévoir, tester et réviser régulièrement les dispositions nécessaires pour faire face et gérer une situation d’urgence radiologique, même peu probable.
Le principal moyen de prévenir les accidents et de limiter leurs conséquences éventuelles est la « défense en profondeur ».
Elle consiste à mettre en œuvre des dispositions matérielles ou organisationnelles (parfois appelées lignes de défense) organisées en niveaux consécutifs et indépendants et capables de s’opposer au développement d’un accident. En cas de défaillance d’un niveau de protection, le niveau suivant prend le relais.
Un élément important pour l’indépendance des niveaux de défense est la mise en œuvre de technologies de nature différente (systèmes « diversifiés »).
La conception d’une installation nucléaire est fondée sur une démarche de défense en profondeur. Par exemple, pour les réacteurs nucléaires, on définit les cinq niveaux suivants :
PREMIER NIVEAU: prévention des anomalies de fonctionnement et des défaillances des systèmes
Il s’agit en premier lieu de concevoir et de réaliser l’installation d’une manière robuste et prudente, en intégrant des marges de sûreté et prévoyant une résistance à l’égard de ses propres défaillances ou des agressions. Cela implique de mener une étude aussi complète que possible des conditions de fonctionnement normal, pour déterminer les contraintes les plus sévères auxquelles les systèmes seront soumis. Un premier dimensionnement
de l’installation intégrant des marges de sûreté peut alors être établi. L’installation doit ensuite être maintenue dans un état au moins équivalent à celui prévu à sa conception par une maintenance adéquate. L’installation doit être exploitée d’une manière éclairée et prudente.
DEUXIÈME NIVEAU: maintien de l’installation dans le domaine autorisé
Il s’agit de concevoir, d’installer et de faire fonctionner des systèmes de régulation et de limitation qui maintiennent l’installation dans un domaine très éloigné des limites de sûreté. Par exemple, si la température d’un circuit augmente, un système de refroidissement se met en route avant que la température n’atteigne la limite autorisée. La surveillance du bon état des matériels et du bon fonctionnement des systèmes fait partie de ce niveau de défense.
TROISIÈME NIVEAU: maîtrise des accidents sans fusion du cœur
Il s’agit ici de postuler que certains accidents, choisis pour leur caractère « enveloppe », c’est-à-dire les plus pénalisants d’une même famille, peuvent se produire et de dimensionner des systèmes de sauvegarde permettant d’y faire face.
Ces accidents sont, en général, étudiés avec des hypothèses pessimistes, c’est-à-dire qu’on suppose que les différents paramètres gouvernant cet accident sont les plus défavorables possibles. En outre, on applique le critère de défaillance unique, c’est-à-dire que dans la situation accidentelle, on postule en plus la défaillance d’un composant quelconque. Cela conduit à ce que les systèmes intervenant en cas d’accident (systèmes dits de sauvegarde, assurant l’arrêt d’urgence, l’injection d’eau de refroidissement dans le réacteur, etc.) soient constitués d’au moins deux voies redondantes.
QUATRIÈME NIVEAU: maîtrise des accidents avec fusion du cœur
Ces accidents ont été étudiés à la suite de l’accident de Three Mile Island (1979) et sont désormais pris en compte dès la conception des nouveaux réacteurs tels que l’EPR. Il s’agit soit d’exclure ces accidents, soit de concevoir des systèmes permettant d’y faire face. A la lumière du retour d’expérience de l’accident de Fukushima, l’ASN a prescrit un ensemble de mesures visant à renforcer la prévention et la maîtrise des accidents avec fusion du cœur.
CINQUIÈME NIVEAU : limitation des conséquences radiologiques en cas de rejets importants
Il s’agit là de la mise en œuvre de mesures prévues dans les plans d’urgence incluant des actions de protection des populations: mise à l’abri, ingestion de comprimés d’iode stable pour saturer la thyroïde et éviter qu’elle fixe l’iode radioactif véhiculé par le panache radioactif, évacuation, restriction de consommation d’eau ou de produits agricoles, etc.
QUESTION 810 - Sûreté pour les générations suivantes ?
Posée par Gennviève DE ROISSART, L'organisme que vous représentez (option) (LAMAZÈRE), le 14/12/2013
Au vu des terribles accidents récents, (Tchernobyl, Japon,) comment pouvez vous être sûr et certain qu'il n'y a aucun risque à continuer l'industrie nucléaire ? Et d'autant plus ce style d'enfouissement profond qui ne permet peut-etre pas de surveillance aussi précise que d'autres techniques
Réponse du 17/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
Sur le long terme, la couche d’argile dans laquelle est implantée le stockage garantit l’éloignement des déchets radioactifs de la surface. Seuls quelques radionucléides mobiles et dont la durée de vie est longue pourront migrer à travers la couche d’argile après plusieurs dizaines de milliers d’années, puis potentiellement atteindre ensuite la surface et les nappes phréatiques, après plus de 100 000 ans et en quantités extrêmement faibles. Leur impact radiologique serait alors plusieurs dizaines de fois inférieur à la radioactivité naturelle.
Plus généralement, l’approche de l’Andra à propos des risques est présentée ci-dessous.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage. C’est une des raisons qui a conduit, en 2006, le Parlement à retenir la solution du stockage profond.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
QUESTION 809 - Pourquoi tant de difficultés?
Posée par jean luc DUBRAY, MOI, VOUS, NOUS (AUBE), le 14/12/2013
pourquoi tant de difficultés, c'est-à-dire de transparence, de manque de transparence dans le processus de discussion? Tout le monde sait que c'est à celui qui veut la vérité de faire le travail de démonstration, de la preuve, pourquoi ne pas alors changer les choses, en acceptant une discussion sincère? Il nous appartient de préparer un monde ou demain serait meilleur, c'est-à-dire de faire que la décision soit un vrai moment de concertation.
Réponse du 13/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le projet Cigéo suit la procédure décrite à l’article L. 542-10 du Code de l’Environnement.
Au cours de ce processus, plusieurs procédures de consultation sont organisées afin de recueillir l’avis des populations locales et nationales :
- un débat public en 2013, organisé afin de recueillir les avis de l’ensemble de la population au niveau local et national,
- un avis des collectivités locales à proximité du projet (horizon 2016),
- une enquête publique (horizon 2017-2018) préalable au décret d’autorisation de création.
Le Parlement fixe périodiquement les choix relatifs à la mise en œuvre de ce projet :
- loi du 30 décembre 1991, dite loi « Bataille », fixant un programme d’études et recherches de 15 années d’études et recherches sur les déchets radioactifs ;
- loi du 28 juin 2006, définissant le stockage géologique profond comme solution de référence pour les déchets les plus radioactifs en vue, sous réserve de son autorisation, d’une mise en service en 2025 ;
- loi à venir sur la réversibilité du projet à horizon 2016.
L’avis des populations locales au travers des procédures de consultation et l’expression de leurs représentants au Parlement est primordiale.
En outre, des échanges se déroulent en permanence entre l’Andra et les parties prenantes locales (élus, Clis, acteurs associatifs et économiques, riverains…). Un travail de concertation a également été conduit par l’Etat pour élaborer le projet de schéma interdépartemental du territoire.
QUESTION 808 - Périmère du débat
Posée par Jérôme DESQUILBET, L'organisme que vous représentez (option) (CHÂTILLON), le 14/12/2013
Si un "incident" devait survenir dans les prochaines années, qui sera responsable ? Par ailleurs, les conséquences de cet accident entraînerait une contamination d'une très large territoire, comment se fait-il que le débat n'ait pas été mené dans toute la France ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
Réponse apportée par la Commission du débat public :
Sur les 14 réunions publiques initialement prévues, 8 étaient prévues dans les deux départements directement concernés par le projet Cigéo (Meuse et Haute Marne), et 6 dans le reste de la France (carte publiée dans le Journal du débat n°1, disponible sur le site Cpdp).
Les réunions en question n’ayant pu se tenir, 9 débats contradictoires sur internet ont été organisés entre juillet et novembre 2013, visant à permettre à tout citoyen d’approfondir en liaison directe avec des experts indépendants, français et étrangers, les questions qui le préoccupaient concernant le projet Cigéo. Ces débats étaient bien entendu accessibles à toute personne disposant d’internet, quelque soit son lieu de résidence ; de fait nombre de questions posées l’ont été par des personnes étrangères à la région.
Par ailleurs, la presse locale comme les grands médias nationaux ont tout au long rendu compte du débat et du projet en cause.
QUESTION 807 - Et si François 1er avait fait enterrer des déchets nucléaires ?
Posée par Hélène PLANEL-MERLIER, L'organisme que vous représentez (option) (SAVASSE), le 14/12/2013
Et si François 1er avait fait enterrer des déchets nucléaires ? qui saurait à notre époque où ils sont pour en assurer la non dangerosité ? Appliquons le principe de précaution : ne plus fabriquer de déchets nucléaires est la seule alternative pour assurer la sécurité de l'humanité !
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Concernant la transmission de la mémoire du site aux générations futures
L’objectif fondamental de Cigéo est de protéger l’homme et l’environnement des déchets radioactifs sur de très longues échelles de temps. La sûreté à long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. C’est une des raisons qui a conduit, en 2006, le Parlement à retenir la solution du stockage profond. En effet, cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli, contrairement à l’entreposage. En cas de perte complète de la mémoire du stockage, une intrusion inopinée à 500 mètres sous terre apparaît peu plausible, du moins sans un minimum d’investigations préalables. L’Andra évalue cependant par précaution dans son analyse de sûreté les conséquences d’un forage à travers le stockage pour vérifier que le stockage resterait sûr.
Malgré cette robustesse du stockage même en cas d’oubli, l’Andra conçoit Cigéo avec l’objectif d’en conserver la mémoire et de la transmettre aux générations futures le plus longtemps possible. Des solutions d’archivage de long terme existent pour les centres de stockage de surface exploités par l’Andra et font l’objet de revues périodiques. Le retour d’expérience montre que ces solutions paraissent robustes pour au moins les 500 premières années. Ainsi, pour Cigéo, l’Andra prévoit qu’un centre de la mémoire perdurera sur le site. Il pourra accueillir le public et comprendra notamment les archives du Centre.
L’Andra a lancé en 2010 un programme d’études pour proposer des outils qui rendent cette transmission plus robuste sur une échelle de temps millénaire. Des pistes se dessinent tels des marqueurs de surface, mais aussi des rendez-vous réguliers à mettre en place au niveau des populations locales.
En tout état de cause, comme il est impossible de garantir notre capacité à communiquer avec des êtres vivant dans plusieurs milliers d’années, c’est chaque génération qui aura la responsabilité de contribuer à transmettre cette mémoire aux générations suivantes.
Réponse apportée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Concernant l’arrêt de la production de déchets nucléaires
L’énergie nucléaire constitue en effet la première source de production de déchets radioactifs.
En France, le nucléaire occupe une place prépondérante dans le mix électrique, assurant près de 75% de la production française d’électricité. Compte tenu de la durée nécessaire à la construction de moyens de production d’électricité de substitution, un arrêt à court terme de l’ensemble du parc nucléaire n’est pas envisageable sans remettre en cause l’approvisionnement électrique du pays, c’est à dire sans coupures très importantes d’électricité pour les consommateurs. Il apparaît donc extrêmement difficile de ne plus produire de nouveaux déchets radioactifs provenant de l’industrie électronucléaire à très court terme.
En matière de mix électrique, le Président de la République a fixé le cap suivant pour la France : réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% d'ici 2025. Parallèlement, le Président de la République a indiqué que la transition énergétique serait fondée sur deux principes : l'efficacité énergique d'une part, et la priorité donnée aux énergies renouvelables d'autre part. Cette mutation prendra du temps et supposera des étapes d’évaluation en fonction des progrès technologiques et scientifiques et des prix relatifs de chaque source d’énergie.
QUESTION 806 - Comment osez-vous ?
Posée par Véronique COSTEL, LE MONDE VIVANT (BRIEY), le 14/12/2013
Comment pouvez-vous oser dire que vous maîtrisez : la qualité et la quantité exacte de tous les radioéléments que vous aurez enfouis ? la vitesse de migration des radionucléides ? le niveau de leur activité sur un million d’années ? la réalisation des scellements ? Comment osez-vous parier que dans 50 ou 2000 ans, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine ou la chute d'un météorite ne conduiront pas à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des sympathiques radionucléides en surface, dans le lait des vaches et l'eau des rivières, dans le monde vivant, celui des végétaux, des animaux et celui de votre descendance, avec les conséquences que l'on sait ? Comment osez-vous prétendre que le nucléaire et la vie soient compatibles ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 805 - Publicité de ce débat
Posée par Dominique SABROUX, L'organisme que vous représentez (option) (TROYES), le 14/12/2013
Comment les citoyens ordinaires sont-ils au courant de ce débat ?
Réponse du 11/01/2014,
La Commission a utilisé de nombreux médias pour informer du calendrier et des modalités du débat public sur le projet Cigéo :
- distribution de documents d'information dans toutes les boites aux lettres de la Meuse, de la Haute-Marne et du nord des Vosges aux mois de mai et de septembre 2013 (180.000 foyers)
- plusieurs exemplaires de cette documentation, ainsi que des affiches, ont été envoyés aux mairies
- affichage public dans les réseaux urbains et les commerces de proximités
- insertion d’annonces dans la presse écrite, radio, télévisuelle et numérique (locale et nationale) auxquelles se sont ajoutés plusieurs centaines d’articles qui ont couvert l’actualité du débat entre le 15 mai et le 15 décembre 2013
- création d’un site internet dédié et interactif offrant différents formats d’expression et supports d’information : questions, avis, abonnement gratuit, contributions, cahiers d'acteurs, forum, réseaux sociaux, débats contradictoires, documentations diverses
- envoi de lettres électroniques tout au long du débat
- organisation de débats contradictoires retransmis sur internet et sur des plateformes audio et permettant aux auditeurs d'interpeller directement le maître d'ouvrage et les experts indépendants invités
- permanence à Bar-le-Duc ouverte à tous
QUESTION 804 - Que faire de la balayette & de la pelle ?
Posée par frédéric TARCHE, L'organisme que vous représentez (option) (ORLEANS), le 14/12/2013
Une fois que ces déchets seront sous le tapis , que ferons nous de la pelle et de la balayette devenues radioactives ? et ne me répondez qu'on les mettra sous le tapis svp ! Plus sérieusement cette façon de vouloir procéder consiste à laisser à ceux qui nous suivront un problème énorme, et ils ne pourront même pas se retourner contre les promoteurs de cette idée : l'enfouissement . J'aimerais d'autre part que vous me confirmiez on infirmiez l'information selon laquelle il y aurait dans le sous-sol profond de Bure de l'eau , parce que si c'est le cas , par simple souci technique il ne pourrait plus être possible d'y enfouir des déchets radioactifs ; Suis-je correctement informé ?
Réponse du 13/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif du stockage profond n’est pas de mettre les déchets sous le tapis mais de protéger l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. Compte tenu de la durée pendant laquelle ces déchets resteront dangereux (plusieurs centaines de milliers d’années), la sûreté à long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines, pour ne pas reporter la charge des déchets sur les générations futures. Celles-ci pourront continuer à assurer une surveillance du site aussi longtemps qu’elles le souhaiteront. Néanmoins, le stockage restera sûr à long terme même si le site venait à être oublié, contrairement à un entreposage, qu’il soit en surface ou en subsurface.
Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de ces déchets. Grâce à la réversibilité, les générations suivantes garderont la possibilité de faire évoluer cette solution si elles le souhaitent. L’Andra propose que des rendez-vous réguliers soient organisés avec l’ensemble des acteurs (riverains, collectivités, associations, scientifiques, évaluateurs, État…) pour contrôler le déroulement du stockage et préparer les prochaines étapes.
Concernant votre question relative à la présence d’eau
De l’eau est présente dans les formations géologiques. Cette eau est le principal facteur d’altération des colis de déchets et le principal vecteur de transfert des substances radioactives. C’est la raison pour laquelle l’Andra étudie l’implantation du stockage dans une roche argileuse de très faible perméabilité, ce qui limite fortement les circulations d’eau à travers la couche et s’oppose au transport éventuel des radionucléides par convection (c’est-à-dire l’entraînement par l’eau en mouvement). Cette très faible perméabilité s’explique par la nature argileuse, la finesse et le très petit rayon des pores de la roche (inférieur à 1/10 de micron). L’observation de la distribution dans la couche d’argile des éléments les plus mobiles comme le chlore ou l’hélium confirme qu’ils se déplacent majoritairement par diffusion et non par convection. Cette « expérimentation », à l’œuvre depuis des millions d’années, confirme que le transport des éléments chimiques se fait très lentement (plusieurs centaines de milliers d’années pour traverser la couche). Ces durées de transport constatées sont cohérentes avec celles estimées par simulation.
Le stockage permet de garantir le confinement sur de très longues échelles de temps. Seuls quelques radionucléides mobiles et dont la durée de vie est longue pourront migrer jusqu’aux limites de la couche d’argile qu’ils atteindront après plusieurs dizaines de milliers d’années, puis potentiellement atteindre en quantités extrêmement faibles ensuite la surface et les nappes phréatiques. Leur impact radiologique serait alors plusieurs dizaines de fois inférieur à la radioactivité naturelle (qui est de 2,4 milliSievert par an en moyenne en France). Dans une démarche prudente, l’Andra dans son évaluation d’impact sur l’homme et l’environnement à long terme suppose que les eaux de nappes phréatiques au-dessus du stockage pourraient être captées par forage et utilisées pour des usages du type de ceux qui peuvent être pratiqués aujourd’hui (jardin, boisson, abreuvement des animaux). Les études montrent que l’impact du stockage, même en cas de défaillance des scellements, restera inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire et ne présentera pas de risque pour la santé.
QUESTION 803 - Sécurité des sites, risques et conséquences
Posée par Francis CORTEZ, L'organisme que vous représentez (option) (COULOUNIEIX-CHAMIERS), le 14/12/2013
Êtes-vous sûr que les sites de stockage ne seront jamais endommagés par les eaux d'infiltration, les séismes, l'oxydation, les éboulements, les accidents mécaniques, la radioactivité, la malveillance...? Quels moyens de prévention mettriez-vous en place pour lutter contre chaque risque cité ci-dessus ? Si chaque risque se réalise, quelles en seraient les conséquences ?
Réponse du 09/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Selon le principe de défense en profondeur, pour éviter toute dispersion incontrôlée, l’objectif dès le début de la conception de Cigéo est d’identifier l’ensemble des défaillances et des agressions potentielles d’origine interne (chute, collision, incendie, explosion…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourrait remettre en cause le confinement des colis de stockage. Pour chaque défaillance et agression, l’Andra met en place un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles. Ainsi, conformément à la demande formulée par l’Autorité de sûreté nucléaire, l’Andra conçoit Cigéo de sorte que l’on puisse exclure un accident de grande ampleur, comme l’incendie d’un grand nombre de colis dans une alvéole.
Malgré ces dispositions, selon le même principe de défense en profondeur, les situations accidentelles (dont le cumul de plusieurs incidents) sont envisagées, pour vérifier que les conséquences en termes radiologiques restent limitées. Au stade actuel de la conception et de l’analyse des risques, les accidents les plus significatifs qui pourraient conduire à une dispersion de la radioactivité sont la chute d’un colis de déchets, une collision ou un départ de feu sur un engin de transfert transportant un colis. Cela s’explique par la nature des activités nucléaires de Cigéo qui sont principalement de la manipulation de colis de déchets.
Ainsi, la situation la pire en termes de conséquences proviendrait de l’accumulation des nombreuses défaillances successives suivantes :
- un départ de feu malgré la minimisation des matériaux inflammables dans l’installation,
- une détection tardive du fait d’une défaillance du réseau de surveillance,
- un système d’extinction inopérant,
- une intervention des pompiers retardée ou empêchée, malgré la présence d’engins de secours disposés dans l’installation,
- la perte de confinement d’un colis de déchets malgré la protection apportée par le conteneur de stockage.
Ceci engendrerait alors un rejet incontrôlé de particules radioactives à l’extérieur de Cigéo. L’évaluation réalisée, à ce stade de la conception, de l’impact d’un tel scénario hautement improbable montre que ses conséquences resteraient limitées, et nettement en deçà du seuil réglementaire qui impose la mise à l’abri des populations (10 millisieverts).
QUESTION 800 - responsable ?
Posée par boris DENIEL, L'organisme que vous représentez (option) (BLAIN), le 14/12/2013
Vous arrive-t-il de penser à nos, à vos enfants, à leurs enfants ?
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
Absolument. Et c’est justement pour eux que les hommes et les femmes de l’Andra conçoivent Cigéo. Car si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs produits en France depuis plus d’un demi-siècle. Grâce à la réversibilité, les générations suivantes garderont la possibilité de faire évoluer cette solution pendant au moins 100 ans. La fermeture du stockage permettra aux générations suivantes, si elles le souhaitent, de ne plus avoir à intervenir pour assurer la protection de l’homme et de l’environnement contre la dangerosité de ces déchets sur de très longues échelles de temps.
On peut toujours remettre à demain ce que l’on pourrait commencer à faire aujourd’hui. Mais nos enfants pourraient nous reprocher de ne pas avoir préparé de solution pour gérer les déchets radioactifs produits par les activités dont nous bénéficions au quotidien.
QUESTION 799 - Que se passera t-il ...?
Posée par Marie THEVENIN, L'organisme que vous représentez (option) (GARDANNE), le 14/12/2013
si pour une raison quelconque (tremblement de terre, inondations ....) des fuites radioactives contaminent l'eau, l'air, le sol et tuent à petit feu des générations entières ? Evidemment cette contamination est invisible, inodore, elle est déjà à l'oeuvre dans de nombreux lieux en silence et condamne durablement les populations actuelles et à venir .....
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestions sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 798 - qui sera responsable, qui en bénéficiera, qui en pâtira ?
Posée par Dominique AUGER, L'organisme que vous représentez (option) (LILLE), le 14/12/2013
qui sera responsable, qui en bénéficiera, qui en pâtira ?
la vie
Question en cours de traitement
QUESTION 797 - Commennt récupérer ces colis de déchets nucléaires ?
Posée par Francis MEULEY, L'organisme que vous représentez (option) (FRANCE), le 14/12/2013
Bonjour, J'aimerais savoir comment il est prévu de récupérer dans 100 ans tous ces colis de déchets nucléaires HAVL et quel sera le coût de cette récupération puisqu'il est inenvisageable de stocker ces déchets pendant des centaines de milliers d'années dans les couches superficielles du bassin parisien ? Merci par avance pour votre réponse argumentée, chiffrée et détaillée poste par poste. Question subsidiaire : ne serait il pas beaucoup plus simple et beaucoup moins coûteux pour le porte monnaie de tous les contribuables de garder tous ces déchets HAVL dans des centres de stockage spécialisés visibles et aisément supervisables par des ingénieurs qualifiés ? Cordialement, Francis MEULEY Economiste
Réponse du 11/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. Du fait de son implantation à 500 mètres de profondeur, il sera peu vulnérable aux activités humaines comme aux catastrophes naturelles. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique, qui assure le confinement de la radioactivité à très long terme, et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage en surface ou en subsurface que vous proposez.
Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de ces déchets.
Grâce à la réversibilité, les générations suivantes garderont la possibilité de faire évoluer cette solution si elles le souhaitent.
Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement dans une future loi. Les propositions de l’Andra sur la réversibilité sont consultables sur le site du débat public (../informer/les-etudes-preparatoires.html) et abordent les questions que vous posez.
L’Andra propose que le décret d’autorisation de création de Cigéo couvre des opérations de retrait limité et temporaire de colis de déchets stockés. Ces opérations seront décrites dans le rapport de sûreté et dans les règles générales d’exploitation.
L’Andra considère que toute opération notable de retrait de colis de déchets stockés devra faire l’objet d’une autorisation spécifique. Ainsi, dans l’hypothèse d’une évolution de la politique en matière de gestion des déchets radioactifs qui conduirait à envisager une opération de retrait d’un nombre important de colis de déchets, l’Etat demanderait à l’Andra d’étudier l’opération. L’étude devrait comprendre une analyse détriments-bénéfices. L’opération pourrait nécessiter des modifications notables de l’installation, notamment en surface : l’Andra définirait la nature de ces modifications en fonction de la situation de retrait considérée : famille de colis concernée, volumes, dates de retrait, devenir des colis retirés du stockage…
Ce type d’opérations nécessiterait ensuite le dépôt d’une demande de modification du décret d’autorisation de création par l’Andra, évaluée par l’Autorité de sûreté nucléaire et soumise à enquête publique. L’autorisation demandée devrait couvrir les opérations envisagées sur Cigéo (opérations de retrait, de reconditionnement éventuel, d’expédition…) et l’ensemble des modifications d’installations à apporter (construction éventuelle d’entreposages, de nouveaux ateliers…). Le dossier support à la demande devrait présenter une démonstration complète et justifiée de la sûreté des opérations projetées.
Le coût de l’opération de retrait dépend de la situation de retrait considérée. Il serait a priori d’un ordre de grandeur analogue à celui des opérations de mise en stockage des déchets, auquel il conviendrait d’ajouter celui des nouvelles installations à construire pour accueillir les déchets et celui du transfert des déchets dans ces nouvelles installations.
L’Andra propose un partage équitable du financement de la réversibilité entre les générations. Les générations actuelles provisionnent l’ensemble des coûts nécessaires pour permettre la mise en sécurité définitive des déchets radioactifs qu’elles produisent, ainsi que des déchets anciens qui ont été produits depuis le début des années 1960. Ces provisions couvrent également les propositions techniques retenues pour assurer la réversibilité de Cigéo pendant le siècle d’exploitation. Si les générations suivantes décidaient de faire évoluer leur politique de gestion des déchets radioactifs, par exemple si elles décidaient de récupérer des déchets stockés, elles en assureraient le financement. La prise en compte de la réversibilité dès la conception du stockage permet de limiter cette charge potentielle.
QUESTION 796 - capacite et maintenance du site
Posée par jean pierre LEBLOND, L'organisme que vous représentez (option) (TANCARVILLE), le 14/12/2013
quel est la capacite totale de stockage du site.?
Réponse du 31/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Cigéo est conçu pour mettre en sécurité définitive les déchets les plus radioactifs déjà produits ou en cours de production par les installations nucléaires existantes. L’Andra a vérifié que l’architecture de Cigéo serait suffisamment flexible pour s’adapter aux différents scénarios envisagés dans le cadre du débat national sur la transition énergétique. Les conséquences de ces scénarios sur la nature et le volume de déchets sont présentés dans un document réalisé par l’Andra et les producteurs de déchets à la demande du ministère en charge de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (../docs/rapport-etude/20130705-courrier-ministere-ecologie.pdf). Suivant les scénarios, l’emprise de l’installation souterraine de Cigéo varierait entre 15 et 25 km2.
QUESTION 795 - voyants et sorciers?
Posée par PHILIPPE LEVASSEUR, L'organisme que vous représentez (option) (CINDRE), le 14/12/2013
Pensez-vous que la sécurité à 100% existe? Quelle sera votre responsabilité dans quelques centaines années, lorsqu'il y aura un problème que vous n'aurez pas anticipé? Ne jouons pas aux apprentis sorciers, le stockage en surface sur les lieux de production est la seule solution réversible en attendant d’éventuelles solutions au retraitement. Et la transition énergétique pour sortir du nucléaire et résoudre de cette façon le problème des déchets.
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
En effet, le risque zéro n’existe pas et l’Andra ne prétend pas que le projet Cigeo ferait exception à la règle.
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
A propos de la transition énergétique enfin, nous vous rappelons que le stockage est en premier lieu destiné aux déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue déjà produits depuis plus de 50 ans ainsi qu’aux déchets qui seront inévitablement produits quels que soient les choix énergétiques futurs.
QUESTION 794 - qui sera responsable?
Posée par etienne FOURQUET, L'organisme que vous représentez (option) ( APT), le 14/12/2013
les déchets radioactifs doivent rester dans le sous sol des milliers d'années. Ils pourront migrer durant ce temps et apparaître quelque part alors les populations ne seront pas averties. Que penseriez-vous de Louis XIV s'il avait procédé de cette façon?
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
C’est justement parce que nous sommes responsables vis-à-vis des générations futures que la question de la protection à long terme de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose, quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour gérer les déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
Ainsi, pour se placer dans le cas de figure que vous évoquez, nous ne pourrions en vouloir à Louis XIV de s’être mobilisé pour nous protéger d’un danger créé par ses contemporains.
QUESTION 793 - Coût recherche traitement des déchets=coût recherche utilisation énergies renouvelebles?
Posée par odile VALES, L'organisme que vous représentez (option) (BELMONT), le 14/12/2013
les êtres humains ne sont pas des marionnettes ou des pantins avec lesquels on peu jouer dans un décor interchangeable! n'allons pas au devant de nouvelles catastrophes nucléaires, qui feront de nous et des générations futures de vrais pantins dans un vrai décor invivable. Combien d'investissement financier pour la recherche du traitement des déchets des centrales nucléaires sur les 50 dernières années, et combien d'investissement financiers pour la recherche sur l'exploitation des énergies renouvelables? le budget est-il égal?
Réponse du 11/02/2014,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Depuis le début des années 1990, 1,5 milliards d’euros ont été investis pour les études et recherches sur le stockage profond des déchets radioactifs et plus de 1,3 milliards d’euros sur les autres axes de recherche (séparation-transmutation, entreposage de longue durée en surface ou en sub-surface) sur les déchets HA et MAVL.
Les déchets radioactifs existent et il est nécessaire d’y consacrer les sommes nécessaires permettant de s’assurer qu’ils sont gérés de manière sûre et responsable. Les montants correspondants ne sont donc pas comparables directement aux montants investis dans l’exploitation des énergies renouvelables qui visent à développer un mode de production d’énergie.
Le développement des énergies renouvelables bénéficie d’un soutien de l’Etat soit en amont dans le domaine de la recherche et développement, soit en phase d’industrialisation en soutien à la demande et au déploiement commercial (par exemple par le biais de tarifs d'achats, d’appels d’offres ou de dispositifs fiscaux).
Le choix entre les différents outils de soutien dépend de la maturité technologique, de la compétitivité et des retombées en termes de valeur ajoutée en France et en Europe, au regard des caractéristiques de la chaîne de valeur de chaque énergie et de nos avantages comparatifs. Pour plus de détails, vous pouvez consultez le lien suivant http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/32_-_soutien_a_la_production_des_energies_renouvelables.pdf
QUESTION 792 - Information des générations futures
Posée par Serge GRÜNBERG, MOI-MÊME (SAINT AUBIN SUR GAILLON), le 14/12/2013
Puisque l'ANDRA est déterminée à enfouir plutôt qu'à stocker en sub-surface, peut-on savoir comment cet organisme compte s'y prendre pour informer les générations futures (ou même les espèces qui nous succéderaient, fussent-elles les blattes ou les cafards) du danger que représente les amas de radio nucléides fourrées dans les alvéoles de stockages à 500m de profondeur et qui risqueraient de les contaminer de façon irréversible dans le cas d'un forage pour atteindre le potentiel de géothermie disponible, ou même pour parvenir à l'eau qui y abonde comme dans tout ce sous sol jusqu'à la région parisienne ? Ne me parlez pas de message! Le comprendraient-ils ? Et quels pictogrammes pourraient les mettre en garde ? N'est-ce pas faire preuve d'irrespect que de disposer du sous-sol des habitants du futur pour soustraire à la vue de ceux d'aujourd'hui ces déchets qui leur font peur et qu'il ne faut plus montrer ?
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
Le projet de stockage géologique n’est pas du tout une marque d’irrespect envers les générations futures. Au contraire, il est le fruit d’une démarche responsable.
L’objectif fondamental de Cigéo est de protéger l’homme et l’environnement des déchets radioactifs sur de très longues échelles de temps. La sûreté à long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. C’est une des raisons qui a conduit, en 2006, le Parlement à retenir la solution du stockage profond. En effet, cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli, contrairement à l’entreposage. En cas de perte complète de la mémoire du stockage, une intrusion inopinée à 500 mètres sous terre apparaît peu plausible, du moins sans un minimum d’investigations préalables. L’Andra évalue cependant par précaution dans son analyse de sûreté les conséquences d’un forage à travers le stockage pour vérifier que le stockage resterait sûr.
Malgré cette robustesse du stockage même en cas d’oubli, l’Andra conçoit Cigéo avec l’objectif d’en conserver la mémoire et de la transmettre aux générations futures le plus longtemps possible. Des solutions d’archivage de long terme existent pour les centres de stockage de surface exploités par l’Andra et font l’objet de revues périodiques. Le retour d’expérience montre que ces solutions paraissent robustes pour au moins les 500 premières années. Ainsi, pour Cigéo, l’Andra prévoit qu’un centre de la mémoire perdurera sur le site. Il pourra accueillir le public et comprendra notamment les archives du Centre. De manière générale, le maintien de la mémoire doit aussi impliquer les acteurs locaux, qui peuvent prendre le relai en cas de défaillance de l’Andra ou de l’État. L’Andra veille d’ores et déjà à les informer sur les enjeux associés à la mémoire et étudie avec des anthropologues, des philosophes ou encore des artistes les facteurs qui peuvent favoriser la transmission de la mémoire. La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
En tout état de cause, comme il est impossible de garantir notre capacité à communiquer avec des êtres vivant dans plusieurs milliers d’années, c’est chaque génération qui aura la responsabilité de contribuer à transmettre cette mémoire aux générations suivantes.
QUESTION 791 - Quels sont les risques ?
Posée par Helene FLOUR, L'organisme que vous représentez (option) (FAUQUEMBERGUES), le 14/12/2013
Quels sont les risques réels en surface ? en profondeur ? Quels sont les risques de perte de confinement ? (à moyen terme, à long terme, et à très long terme ?) Comment assurer que vous maîtriser les risques sismiques, mouvements de terrain et autres phénomènes naturels ?
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
En ce qui concerne le risque sismique, le site d’implantation de Cigéo (située à l’Est du Bassin de Paris) est à l’écart des zones actives où se produisent les jeux de failles qui absorbent le rapprochement des continents Afrique et Europe. Les mouvements tectoniques de grande amplitude et forts séismes qui en découlent se localisent pour l’essentiel en Méditerranée et dans les chaines de montagnes qui la bordent, et pour le reste (résidu) au niveau des grandes failles qui affectent la plaque européenne, comme les failles du fossé d’Alsace et des Vosges en bordure Est du bloc stable que constitue le Bassin de Paris. Ce dernier compte parmi les régions les plus stables du globe. Il est quasiment asismique avec des taux de déformations extrêmement faibles à l’échelle des temps géologiques, comptés en millions d’années.
L’analyse des directions et vitesses de déplacements relatifs des stations GPS installées en Europe, confirme que le Bassin de Paris constitue un bloc rigide et que les déformations (de faible amplitude) se font à ses frontières, comme le souligne la répartition des séismes. En conséquence, seules les failles majeures qui existent déjà sont susceptibles de glisser, avec des mouvements de très faible amplitude, par à-coups séparés dans le temps par plusieurs dizaines à centaines de milliers d’années.
C’est ainsi que la zone de 30 km² étudiée pour l’implantation de l’installation souterraine est, au plus proche, à 1,5 km du fossé de Gondrecourt, et à 6 km du segment le plus proche du système des failles de la Marne (le fossé de la Marne étant lui-même est à 14 km). Les analyses cartographiques montrent l’absence de mouvements de ces failles au cours des derniers millions d’années. Les derniers mouvements tectoniques du fossé de Gondrecourt datent de 20 à 25 millions d’années (datations de cristaux de calcite) ; les derniers mouvements des failles de la Marne sont du même âge ou plus anciens. La réalisation d’une écoute sismique dont le seuil de détection est très bas, et qui discrimine sans ambiguïté séismes naturels et tirs de carrières, permet d’affirmer l’absence de toute activité sur ces failles. En accord avec la réglementation en vigueur concernant la sûreté des installations nucléaires, les ouvrages de stockage sont toutefois dimensionnés pour résister aux séismes maxima physiquement possibles que pourraient générer ces failles si elles redevenaient actives dans le futur.
QUESTION 790 - Qui sera responsable ?
Posée par Pierre JONATHAN, JE SUIS JUSTE UN CITOYEN CONCERNÉ (FRANCE), le 14/12/2013
Bonjour Quels sont les risques de perte de confinement ? Comment pouvez-vous oser dire que vous maîtrisez les risques de sismicité ou de mouvement de terrain ? En quoi un tel risque est-il acceptable, pour les générations futures ? Merci d'avance pour vos réponses Cordialement, Pierre
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Concernant le risque sismique, la stabilité et la très faible sismicité de la zone d’implantation du laboratoire souterrain est confirmée par les scientifiques qui ont travaillé sur ce site depuis plus de 20 ans. Le site de Meuse/Haute-Marne appartient à un domaine géologique stable (voir carte), particulièrement favorable pour l’installation d’un stockage. L’activité sismique est en effet extrêmement faible, comme le prouvent les enregistrements de sismicité instrumentale (écoute sismique depuis 1961 à l’échelle de la France) qui sont capables de détecter des microséismes, et les chroniques historiques (séismes ayant été ressentis et/ou ayant occasionné des dégâts au cours des derniers 1 000 ans). Au-delà de ces données, la stabilité et la très faible sismicité du site s’expliquent par sa situation géographique dans le bassin parisien qui est protégé des mouvements liés à la tectonique des plaques (collision du continent africain avec l’Europe).
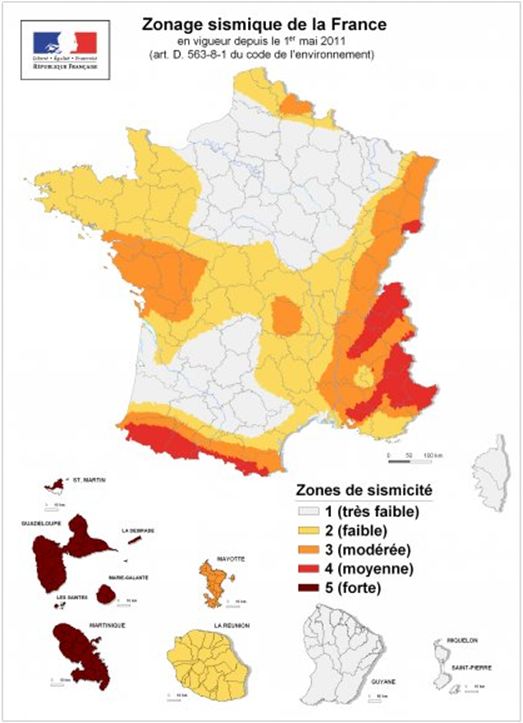
QUESTION 788 - je ne vois pas comment un projet de stockage de déchet radioactif peut être réversible??
Posée par Fabien SELO, L'organisme que vous représentez (option) (PERPIGNAN), le 14/12/2013
Pouvez vous me dire qui serait prêt à aller faire un tour dans un lieu de stockage nucléaire après une catastrophe ou tout simplement après que 15 ans d'exploitation... Il demanderons beaucoup d'argent ou n'iront pas. Ce genre de stockage n'étant pas encore à un stade de développement assez sure, je vous demande d'arrêter ce projet qui pourrait avoir de grande conséquences sur notre environnement et la qualité de l'eau. L'exemple des gaz de schistes n'est pas encore assez révélateur?
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
C’est justement à cause du danger que représentent les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue qui ont vocation à être stockés dans Cigeo que le choix du stockage profond a été fait, parce qu’il offre de meilleures garanties en termes de sûreté sur le très long terme que l’entreposage en surface.
Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Cigéo ne sera d’ailleurs pas autorisé si l’Andra ne démontre pas qu’elle maîtrise tous les risques.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
Pour terminer, votre première affirmation est insultante pour toutes celles et tous ceux qui travaillent à la mise en œuvre de solutions sûres pour protéger les populations actuelles et futures des risques liés aux déchets radioactifs. Toutes les personnes qui travaillent à l’Andra partagent une même valeur : la responsabilité. Nous sommes responsables de la sûreté de nos installations. Nous sommes également responsables devant les générations futures. Les personnes de l’Andra qui travaillent sur les sites de stockage et habitent à proximité sont les premières concernées par la sécurité. Croyez-vous qu’elles accepteraient de travailler sur un site dont la sûreté ne serait pas garantie ?
QUESTION 787 - Argiles
Posée par Philippe FICHAUX, L'organisme que vous représentez (option) (COMPIÈGNE), le 14/12/2013
Comment a été mesurée (ou modélisée) la vitesse de progression de l'eau dans l'argilite de la couche de stockage? Est-ce que c'est une argile gonflante? quelle est la capacité d'adsorption/désorption d'ions métalliques de cette argile?
Réponse du 22/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La vitesse de propagation de l’eau dans l’argilite
L’estimation de la vitesse de déplacement de l’eau au sein de l’argilite du Callovo-Oxfordien résulte pour l’essentiel de mesures de la perméabilité (ou conductivité hydraulique) de l’argilite sur échantillons et in situ dans le Laboratoire souterrain. Les mesures de perméabilité réalisées ont été réalisé in situ et sur des échantillons représentatifs en vertical de toute l’épaisseur de la couche du Callovo-Oxfordien, et en latéral, de la zone de transposition. Deux méthodes de mesure ont été mises en œuvre sur les échantillons, en régime hydraulique transitoire (pulse test) et en régime hydraulique permanent établi. Ces mesures indiquent des valeurs inférieures à 10-12 m/s, globalement comprises entre quelques 10-14 m/s et quelques 10-13 m/s.
Ces valeurs sont cohérentes avec les valeurs de charges hydrauliques mesurées au-dessus et en dessous de la couche du Callovo-Oxfordien (Dogger et Oxfordien Calcaire), en appliquant la loi de Darcy. Le gradient de charge hydraulique à l’échelle de la couche du Callovo-Oxfordien est inférieur à 0,1 m/m sur la Zone d’implantation de Cigéo, et la porosité totale de l’argilite est d’environ 0,18. Avec ces valeurs, on obtient une vitesse de déplacement de l’eau l’ordre au plus de quelques mètres par million d’années (équivalent à une vitesse de l’ordre de 10-13 m/s).
On notera que dans l’argilite, seule environ la moitié de l’eau totale est mobilisable par un gradient de charge hydraulique, l’autre moitié étant fortement liée aux minéraux argileux ; la vitesse de déplacement réelle de l’eau est donc estimée inférieure à celle indiqué ci-dessus. Par ailleurs, l’eau peut se déplacer par d’autres mécanismes que celui sous gradient de charge hydraulique, par exemple l’osmose (déplacement par gradient de potentiel chimique). Ils ont été évalués dans les conditions physico-chimiques de la couche du Callovo-Oxfordien, et les résultats montrent qu’ils sont nuls à très faibles, et n’entrainent pas de déplacement de l’eau supérieur à celui induit par le gradient de charge hydraulique.
Le gonflement de l’argilite
L’argilite du Callovo-Oxfordien, notamment le facies argileux dans lequel seront implantées les installations fond de Cigéo, possède un potentiel de gonflement, lié à la présence de minéraux argileux gonflants, les smectites. Comme l’indiquent les mesures sur échantillons, le potentiel de gonflement de l’argilite est faible (pression de gonflement inférieure à 1 MPa et déformation relative de gonflement inférieure à 1 %, en ordre de grandeur), du fait de la teneur en smectite faible et, ce potentiel ne s’exprime que sur de l’argilite endommagée, par exemple au voisinage immédiat des ouvrages. Ce potentiel est néanmoins suffisant pour permettre le colmatage des fractures et fissures créées dans l’argilite endommagée. Ceci est favorable à la récupération d’une perméabilité de l’argilite endommagée proche de celle de l’argilite initiale, comme le montrent de nombreuses expériences sur échantillons et in situ dans le Laboratoire souterrain.
La capacité d’adsorption/désorption des ions métalliques de l’argilite
Les radionucléides, quelle que soit leur forme en solution (ion métallique ou autre), ont fait l’objet de mesures de sorption sur l’argilite de manière directe ou indirecte (par analogie), dans les conditions physico-chimiques de la couche du Callovo-Oxfordien et du stockage ; il a notamment été tenu compte des effets compétiteurs entre ions, de la concentration en ions et de la température. De manière générale, de par la présence de minéraux argileux, type illite et smectite, qui présentent une forte capacité d’adsorption soit par échange d’ions soit par adsorption spécifique, l’argilite possède des propriétés de rétention élevées des ions métalliques.
La capacité de rétention est représentée de manière macroscopique par le coefficient de partage, Kd, qui est défini comme le rapport à l’équilibre entre la quantité de l’élément dans la phase solide et la concentration de l’élément dans l’eau : le Kd s’exprime donc en m3 par kg de solide.
Pour des conditions fixées (par exemple celles de l’argilite de la formation du Callovo-Oxrfordien), la valeur de Kd dépend de chaque élément chimique. A titre illustratif, on retiendra les ordres de grandeur suivants pour le Kd de certains radionucléides dans l’argilite à 20°C : de l’ordre de 10-3 m3/kg pour des oxo-anions (par exemple le Sélénium) jusqu’à des valeurs de l’ordre du m3/kg pour la plupart des actinides.
QUESTION 786 - Les générations futures
Posée par Jean-Marie GLÄNTZLEN, L'organisme que vous représentez (option) (SAINT-GOBAIN), le 14/12/2013
Est-il plausible que les générations futures trouvent une solution pour "désactiver" ces déchets multimillénaires ? Dans incertitude, n'engageons pas l'avenir de ces générations
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les recherches menées depuis plus de 20 ans sur la transmutation montrent la possibilité de détruire certains atomes radioactifs constitutifs des déchets (des actinides, particulièrement l’américium). Cette destruction fait appel à des réactions de fission nucléaire et nécessite la mise en œuvre de nouveaux types de réacteurs (neutrons rapides). Elle ne supprime pas la radioactivité, mais transforme les atomes concernés en d’autres atomes radioactifs (des produits de fission) dont certains restent à vie longue. Au stade actuel des connaissances seule une partie du contenu radioactif des déchets est potentiellement concernée par une transmutation. En pratique, s’il était décidé de la mettre en œuvre, elle ne porterait que sur les nouveaux déchets produits par de futurs parcs de réacteurs électronucléaires.
D’une manière générale, la destruction d’atomes radioactifs fait nécessairement appel à des réactions nucléaires (c’est-à-dire des réactions sur le noyau atomique). Il apparaît peu vraisemblable que de telles réactions puissent un jour aboutir à « désactiver » les déchets. Au contraire, la réalisation d’opérations nucléaires supplémentaires tend en principe à augmenter le volume des déchets radioactifs produits.
De nombreuses solutions pour gérer les déchets radioactifs ont été imaginées depuis 50 ans : les envoyer dans l’espace, au fond des océans ou dans le magma, les entreposer plusieurs centaines d’années en surface ou à faible profondeur, les transmuter… Seul le stockage profond est aujourd’hui reconnu en France et à l’étranger comme une solution robuste pour mettre en sécurité ces déchets à très long terme. Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de ces déchets. Grâce à la réversibilité, les générations suivantes garderont la possibilité de faire évoluer cette solution. Les rendez-vous proposés par l’Andra seront notamment alimentés par les résultats des recherches qui continueront à être menées sur la gestion des déchets radioactifs et les avancées technologiques. A chaque étape, il sera possible de décider de poursuivre le processus de stockage tel qu’initialement prévu ou de le modifier, par exemple si des solutions alternatives sont identifiées.
QUESTION 785 - Repérage dans le temps des lieux de stockage.
Posée par Jean-Marie MERCY, L'organisme que vous représentez (option) (VERDUN), le 14/12/2013
Au vu des difficiles recherches des vieilles cités disparues depuis plus de 5000 ans, comment pensez vous sérieusement repérer et contrôler la sécurité de matières radioactivement et chimiquement ultradangereuses pendant des dizaines de milliers d'années? Je n'attends pas de réponse utopique, mais quelque chose de fiable et assuré pour de nombreux siècles. A Verdun, malgré toutes les précautions et un siècle après le conflit, chaque année des gens se font tuer par des engins explosifs toujours présents malgré tous les efforts faits pour essayer de tout neutraliser depuis presque 100 ans.
Réponse du 09/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif fondamental de Cigéo est de protéger l’homme et l’environnement des déchets radioactifs sur de très longues échelles de temps. La sûreté à long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. C’est une des raisons qui a conduit, en 2006, le Parlement à retenir la solution du stockage profond. En effet, cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli, contrairement à l’entreposage. En cas de perte complète de la mémoire du stockage, une intrusion inopinée à 500 mètres sous terre apparaît peu plausible, du moins sans un minimum d’investigations préalables. L’Andra évalue cependant par précaution dans son analyse de sûreté les conséquences d’un forage à travers le stockage pour vérifier que le stockage resterait sûr.
Malgré cette robustesse du stockage même en cas d’oubli, l’Andra conçoit Cigéo avec l’objectif d’en conserver la mémoire et de la transmettre aux générations futures le plus longtemps possible. Des solutions d’archivage de long terme existent pour les centres de stockage de surface exploités par l’Andra et font l’objet de revues périodiques. Le retour d’expérience montre que ces solutions paraissent robustes pour au moins les 500 premières années. De manière générale, le maintien de la mémoire doit aussi impliquer les acteurs locaux, qui peuvent prendre le relai en cas de défaillance de l’Andra ou de l’État. L’Andra veille d’ores et déjà à les informer sur les enjeux associés à la mémoire et étudie avec des anthropologues, des philosophes ou encore des artistes les facteurs qui peuvent favoriser la transmission de la mémoire. La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
L’Andra a lancé en 2010 un programme d’études pour proposer des outils qui rendent cette transmission plus robuste sur une échelle de temps millénaire. Des pistes se dessinent tels des marqueurs de surface, mais aussi des rendez-vous réguliers à mettre en place au niveau des populations locales.
En tout état de cause, comme il est impossible de garantir notre capacité à communiquer avec des êtres vivant dans plusieurs milliers d’années, c’est chaque génération qui aura la responsabilité de contribuer à transmettre cette mémoire aux générations suivantes.
QUESTION 784 - comment?
Posée par Romain ALLEMANDET, L'organisme que vous représentez (option) (BESANÇON), le 14/12/2013
Comment être sûr qu'il n'y a aucun risque? Comment savoir si les sociétés en charge des dechets vont survivrent aussi longtemps que les dechets? Comment est envisagée la gestion d'une eventuelle catastrophe? Coment expliquerons nous nos choix aux futures generations en cas de catastrophe? .... comment peut-on être si sûr de nous et se sentir autant intelligent alors que nous ne sommes pas capable de nous gerer nous même?
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 783 - durée de vie?
Posée par Daniel ROMET, L'organisme que vous représentez (option) (LUSSAS), le 14/12/2013
Comment peut on avoir une certitude pareille de vouloir enfouir des déchets à radioactivité longue sans qu'il y ait des conséquences désastreuses sur des centaines? Milliers? d'années?
Réponse du 30/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestions sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 782 - l'ANDRA dans 10000 ans?
Posée par blandin CHRISTOPHE, L'organisme que vous représentez (option) (CHERBOURG), le 14/12/2013
_l' ANDRA existera t-elle toujours dans 10000 ans? _qui assurera la gestion de ces déchets? _ la France sera t-elle toujours une république? cordialement christophe
Réponse du 10/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’impossibilité de garantir la capacité de la société à gérer et à surveiller les déchets radioactifs pendant des milliers d’années est justement une des raisons qui a conduit au choix de la solution du stockage profond pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs. Contrairement à un entreposage de longue durée, le stockage dans une couche géologique assurant le confinement des éléments radioactifs à l’échelle de plusieurs centaines de milliers d’années permet de protéger l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets sans nécessité d’action humaine. La géologie prend ainsi le relais de l’homme pour garantir la sûreté sur le très long terme. La surveillance du site pourra néanmoins être maintenue aussi longtemps que les générations futures le souhaiteront et contribuera au maintien de la mémoire du stockage.
QUESTION 781 - Roulette russe
Posée par Marc DUPONT, NOVISSEN (DRUCAT ), le 14/12/2013
Bonjour l'enfouissement des déchets nucléaires et "jouer à la roulette russe" n'est-ce pas la même chose ? C'est fou de penser qu'il n'y a aucun risque de tremblement même minime qui va engendrer une catastrophe écologique, environnementale et sanitaire MAJEURE
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Concernant le risque sismique, la stabilité et la très faible sismicité de la zone d’implantation du laboratoire souterrain est confirmée par les scientifiques qui ont travaillé sur ce site depuis plus de 20 ans. Le site de Meuse/Haute-Marne appartient à un domaine géologique stable (voir carte), particulièrement favorable pour l’installation d’un stockage. L’activité sismique est en effet extrêmement faible, comme le prouvent les enregistrements de sismicité instrumentale (écoute sismique depuis 1961 à l’échelle de la France) qui sont capables de détecter des microséismes, et les chroniques historiques (séismes ayant été ressentis et/ou ayant occasionné des dégâts au cours des derniers 1 000 ans). Au-delà de ces données, la stabilité et la très faible sismicité du site s’expliquent par sa situation géographique dans le bassin parisien qui est protégé des mouvements liés à la tectonique des plaques (collision du continent africain avec l’Europe).
QUESTION 780 - Comment pouvez vous osez dire dire quevous maitrisez
Posée par alain ORCA, L'organisme que vous représentez (option) (PLOUNEOUR MENEZ), le 14/12/2013
Comment pouvez-vous oser dire que vous maîtrisez : la qualité et la quantité exacte de tous les radioéléments que vous aurez enfouis la vitesse de migration des radionucléides ? le niveau de leur activité sur un million d’années ? la réalisation des scellements ?
Réponse du 11/02/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Sur le long terme, la couche d’argile dans laquelle est implantée le stockage garantit l’éloignement des déchets radioactifs de la surface. Seuls quelques radionucléides mobiles et dont la durée de vie est longue pourront migrer à travers la couche d’argile après plusieurs dizaines de milliers d’années, puis potentiellement atteindre ensuite la surface et les nappes phréatiques, après plus de 100 000 ans et en quantités extrêmement faibles. Leur impact radiologique serait alors plusieurs dizaines de fois inférieur à la radioactivité naturelle (qui est de 2,4 milliSievert par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
Il est bien entendu que Cigéo ne sera pas autorisé si l’Andra ne démontre pas qu’elle maîtrise tous les risques.
Concernant votre question sur les scellements
Pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets radioactifs, Cigéo devra être refermé après son exploitation. C’est aux générations qui nous succèderont qu’il reviendra de décider de procéder aux opérations de fermeture (fermeture et scellement des alvéoles, remblaiement des galeries d’accès...). L’Andra conçoit Cigéo pour qu’il puisse être refermé de manière progressive, depuis l’obturation des alvéoles jusqu’au scellement des puits et des descenderies. Chaque étape de fermeture permettra d’ajouter des dispositifs de sûreté passive.
Conformément à la demande des évaluateurs, l’Andra met en œuvre un programme d’essais pour apporter les éléments nécessaires à la démonstration de la faisabilité industrielle des scellements. En particulier, l’essai FSS (Full Scale Seal) vise à démontrer d’ici 2015 les modalités de construction d’un noyau à base d’argile gonflante et de massifs d’appui en béton en conditions opérationnelles. La qualité de réalisation de l’ouvrage est contrôlée. Le diamètre utile de l’ouvrage considéré est de 7,60 m environ. Compte tenu des contraintes opérationnelles que représente un ouvrage d’une telle taille, l’essai est réalisé en surface dans une « structure d’accueil » construite à cet effet. Des conditions de température et d’hygrométrie représentatives des conditions du stockage sont maintenues autour de l’essai et les conditions qui seraient induites par la réalisation d’un scellement en souterrain sont appliquées (ventilation et délai de transport du béton notamment) pour que cet essai soit représentatif des conditions de Cigéo. Les interfaces avec le revêtement laissé en place et les argilites dans les zones de dépose du revêtement sont représentées par des simulations d’alternances de portions de revêtement maintenues et déposées et de hors-profils (jusqu’à 1 m de profondeur) avec une surface représentative de la texture de l’argilite. Des massifs de confinement en béton bas pH sont également construits de part et d’autre du noyau avec deux méthodes distinctes (béton coulé et béton projeté). Cet essai fait partie du projet européen DOPAS (Demonstration Of Plugs And Seals) qui réunit quatorze organisations issues de huit pays européens et teste quatre concepts de scellement développés en Finlande, en Suède, en République Tchèque et en France.
QUESTION 779 - Déchets
Posée par Michel B., L'organisme que vous représentez (option) (CALUIRE), le 14/12/2013
Que vont devenir ces déchets dans 100 ans ? Et les nappes phréatiques que va t-il se passer ? Il faut stopper le nucléaire et prendre des mesures en ce sens IMMEDIATEMENT
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestions sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
On trouve plusieurs nappes d’eau souterraines dans le sous-sol du site retenu pour Cigéo, à différentes profondeurs. La plus en surface est la nappe phréatique présente dans les calcaires du Barrois, reposant sur une couche de roche imperméable située seulement à quelques dizaines de mètres sous le sol. D’autres nappes sont présentes dans des formations calcaires plus profondes. Moins accessibles, offrant des caractéristiques moins intéressantes, elles ne sont pas exploitées localement. Mais en termes de sûreté, l’Andra y accorde la même attention que pour la nappe phréatique (car elles sont exploitées ailleurs dans le bassin parisien, à plusieurs kilomètres ou dizaines de kilomètres de là).
Outre le confinement de la radioactivité assuré par la couche d’argilite, l’Andra a prévu des dispositions spécifiquement destinées à protéger ces nappes d’eau souterraines, notamment :
- En surface, les installations nucléaires de Cigéo seront implantées bien au-dessus du niveau de la nappe phréatique en cas d’une éventuelle remontée exceptionnelle du niveau de celle-ci. Les installations seront protégées (rabattement des eaux, étanchéité des bâtiments…) conformément à la réglementation.
- Au niveau des infrastructures reliant l’installation souterraine à la surface (descenderies, puits), il est prévu de mettre en place un dispositif d’étanchéité au niveau des ouvrages qui traverseront les nappes phréatiques souterraines de manière à bien isoler physiquement celles-ci de l’installation.
- Le génie civil intègre aussi dans sa conception la mise en place d’un drainage permettant d’assurer une collecte et un suivi des eaux collectées dans un réseau prévu à cet effet, faisant l’objet d’entretien et de mesures périodiques. La collecte s'effectue par des goulottes intégrées et déployées sur tout l'ouvrage souterrain.
Ce ne sont que quelques-unes des dispositions visant à confiner la radioactivité des déchets.
Après la fermeture du stockage, au-delà de la durée de vie des ouvrages industriels, la couche d’argile très peu perméable, de plus de 130 mètres d’épaisseur, dans laquelle sera installé le stockage souterrain, servira de barrière naturelle pour retenir les radionucléides contenus dans les déchets et freiner leur déplacement. Le stockage permet ainsi de garantir leur confinement sur de très longues échelles de temps. Seuls quelques-uns de ces radionucléides, les plus mobiles et dont la durée de vie est longue, pourront migrer de manière très étalée dans le temps. Ils ne sortiraient pas de cette couche avant 100 000 ans et atteindraient en quantités extrêmement faibles la surface et les nappes phréatiques. Leur impact radiologique serait alors plusieurs dizaines de fois inférieur à la radioactivité naturelle (qui est de 2,4 mSv par an en moyenne en France).
Dans une démarche prudente, l’Andra dans son évaluation d’impact sur l’homme et l’environnement à long terme suppose que les eaux de ces couches pourraient être captées par forage et utilisées pour des usages du type de ceux qui peuvent être pratiqués aujourd’hui (jardin, boisson, abreuvement des animaux). Les études montrent que, même dans ce cas, l’impact du stockage reste inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire et ne présente pas de risque pour la santé.
QUESTION 778 - Quel coût pour l'enfouissement ?
Posée par Denis GARNIER, L'organisme que vous représentez (option) (NOTRE DAME DE L'ISLE), le 14/12/2013
N'y a-t-il pas des options moins onéreuses et plus sûr que l'enfouissement? Quelles seront les incidences sur nos abonnements "électricité" ?
Réponse du 27/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
Pour un nouveau réacteur nucléaire sur l’ensemble de sa durée de fonctionnement, le coût du stockage des déchets radioactifs est de l’ordre de 1 à 2 % du coût total de la production d’électricité.
Après 15 années de recherches sur différentes solutions envisagées pour la gestion des déchets les plus radioactifs (transmutation, stockage, entreposage de longue durée) et leur évaluation, le Parlement a fait le choix en 2006 de la solution du stockage profond réversible pour mettre en sécurité définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter leur charge sur les générations futures en misant sur le fait qu’elles trouveront peut-être d’autres solutions. En effet, personne ne peut garantir aujourd’hui que d’autres solutions émergeront dans le futur, ni que ces hypothétiques alternatives présenteraient les mêmes performances de sûreté à long terme que le stockage. Les solutions d’entreposage, qu’elles soient en surface ou à faible profondeur, ne peuvent assurer le confinement à long terme de la radioactivité.
La dernière évaluation du coût du stockage validée par le ministère en charge de l’énergie date de 2005. Le coût du stockage avait été estimé entre 13,5 et 16,5 milliards d’euros, répartis sur une centaine d’années. Cette évaluation couvrait notamment le stockage de tous les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue produits par les réacteurs nucléaires français pendant 40 ans. Une nouvelle évaluation est en cours par l’Andra, pour intégrer les pistes d'optimisation et les nouveautés en termes de solutions techniques, de sécurité et de dimensionnement. Ce chiffrage sera finalisé par l’Andra en 2014. Conformément à la loi du 28 juin 2006, c’est le ministre chargé de l’énergie qui arrêtera l’évaluation des coûts et la rendra publique, après avoir recueilli les observations des producteurs de déchets radioactifs et l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire.
La Cour des comptes a réalisé une analyse des enjeux associés à ces différents points dans son rapport public thématique portant sur « Les coûts de la filière électronucléaire » (janvier 2012) disponible sur le site du débat : ../docs/docs-complementaires/docs-avis-autorites-controle-evaluations/rapport-thematique-filiere-electronucleaire.pdf.
Réponse apportée par Edf :
La loi de juin 2006 sur la gestion des matières et déchets radioactifs reconnaît la solution du stockage géologique comme étant la plus sûre pour assurer la gestion sur le très long terme des déchets de moyenne activité à vie longue et de haute activité. Cette décision du Parlement fait suite aux nombreuses années de recherche menées par l'Andra sur la faisabilité d'un tel stockage, dont les résultats ont été évalués par la Commission Nationale d'Evaluation mise en place par le Parlement et l'Autorité de Sûreté Nucléaire.
Comme le prévoit cette même loi, EDF anticipe le financement du stockage de ses déchets radioactifs, en constituant des provisions et en les sécurisant par des placements dédiés. Ce dispositif financier est placé sous le contrôle du Parlement, et permet de garantir que les futurs coûts de stockage sont bien intégrés dans les coûts de productions actuels, et donc dans les prix actuels de l’électricité. EDF a ainsi d’ores et déjà provisionné dans ses comptes 5,7 milliards d’euros pour faire face à ces charges financières futures.
Aux côtés de l’Andra, EDF s’implique activement dans la recherche, sans aucun compromis sur la sûreté de court et de long terme, de l’optimisation technico-économique du futur centre de stockage Cigéo : cette optimisation contribuera à la compétitivité de la production électronucléaire en France, au bénéfice des entreprises et des ménages français, qui payent aujourd’hui leur kWh deux fois moins cher que leurs voisins allemands.
QUESTION 777 - incendie en sous-sol
Posée par Bénédicte HERBAGE, L'organisme que vous représentez (option) (STRASBOURG), le 14/12/2013
Chez nous en Alsace, dans le sous-sol potassique il y a eu incendies de vieux stock dits inertes. On a eu un mal de chien à circonvenir l'accident, même qu'on a laissé couver, continuer longtemps faute de pouvoir y remédier. Et à Bure ? Tout est prévu ? Remonter en vitesse les fûts fissurés ? Faute de les éviter, limiter les explosions, les incendies ? ... J'espère de tout coeur que vous réussirez là où, avec des déchets inertes, on a échoué. Le sous-sol, c'est pas facile d'accès...
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Pour que le projet puisse être autorisé, l’Andra doit démontrer à l’Autorité de sûreté nucléaire qu’elle maîtrise les risques liés à l’installation, que ce soit pendant son exploitation ou après sa fermeture. Ainsi, conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie les dangers potentiels qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation en amont de la conception. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels montre que leurs conséquences resteraient limitées, et nettement en deçà des normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire.
Le risque incendie est bien sûr pris en compte dès la conception de Cigéo pour garantir la protection du personnel et des riverains. Des dispositions sont prises pour limiter ce risque, le détecter rapidement et faciliter une intervention rapide des secours en cas d’incendie. Une première mesure consiste à limiter la quantité de produits combustibles ou inflammables dans les équipements du stockage. Par exemple, si Cigéo est réalisé, les câbles électriques seront ignifugés et les véhicules à moteur thermique seront interdits dans l’installation nucléaire souterraine de Cigéo. De plus, des dispositifs de détection incendie seront répartis dans les installations pour détecter rapidement et localiser tout départ de feu. Plusieurs systèmes d’extinction automatiques seront installés dans l’installation souterraine. Des systèmes de compartimentage et de ventilation sont prévus pour limiter la propagation du feu. Des équipements d’intervention seront prépositionnés dans l’installation souterraine en permanence. L'architecture souterraine retenue pour le stockage permettra aux secours d'intervenir dans des galeries à l'abri des fumées et facilite l'évacuation du personnel. Outre la mise à l’abri du personnel, la maîtrise du risque incendie vise aussi à protéger les colis contenant les substances radioactives des effets de l’incendie afin de maintenir le confinement de ces substances. Pour cela, les colis seront disposés dans des équipements qualifiés pour résister au feu. Les conteneurs de stockage sont également conçus pour assurer une protection contre l’incendie. Ces dispositions permettent d’exclure tout effet domino entre les colis stockés. La définition de l’ensemble de ces dispositifs associe les services compétents des sapeurs-pompiers et fait l’objet de contrôle par l’Autorité de sûreté nucléaire.
QUESTION 776 - Le tournant énergétique
Posée par Paul TOMBALE, L'organisme que vous représentez (option) (METZ), le 14/12/2013
Bonjour, Pourquoi les pouvoirs prennent des décisions qui peuvent avoir des conséquences incalculables et irréversibles contre les peuples pour un résultat à très court terme et des soucis pour l'éternité à l'échelle de l'Homme, sachant qu'en cas d'imprévu il n'y a pas de solution pour la protection contre les radiations sans parler de la chaîne du traitement des déchets qui est un problème permanent ?
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
La loi du 28 juin 2006 a fait le choix du stockage réversible profond pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations futures. Ce choix a été fait après un programme de quinze années d’études et recherches encadrée par la loi « Bataille » de 1991, un débat public en 2005-2006 et des avis des évaluateurs sur ces recherches. Il est conforté au niveau international par la directive européenne du 19 juillet 2011 qui considère que « il est communément admis que sur le plan technique, le stockage en couche géologique profonde constitue, actuellement, la solution la plus sûre et la plus durable en tant qu’étape finale de la gestion des déchets de haute activité et du combustible usé considéré comme déchet. »
Elle demande à l’Andra d’étudier et d’implanter Cigéo en rappelant que « la demande d'autorisation de création [d’un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs] doit concerner une couche géologique ayant fait l'objet d'études au moyen d'un laboratoire souterrain ». L’Andra poursuit donc ses études en vue d’élaborer pour 2015 le dossier support à l’instruction de la demande d’autorisation de création de Cigéo en Meuse/Haute-Marne, dans la couche d’argile dont les propriétés de confinement sont désormais reconnues.
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Quels que soient les choix énergétiques futurs, c’est la responsabilité de notre génération de proposer aux générations suivantes une solution permettant de mettre définitivement en sécurité ces déchets, qui sont produits en France depuis plusieurs dizaines d’années. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est justement de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de ces déchets. Grâce à la réversibilité, les générations suivantes garderont la possibilité de faire évoluer cette solution si elles le souhaitent.
QUESTION 775 - fuites gazeuses
Posée par sylvain JOLIET, L'organisme que vous représentez (option) (VERSAILLES), le 14/12/2013
en cas de catastrophe interne dans 10, 100, 1000 ans, suivie d'une explosion, quelles seraient les émanations radioactives gazeuses? (merci de ne pas répondre simplement "nulles", ou alors de le justifier)
Réponse du 30/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations.
Les évaluations de sûreté ont montré que l’impact à très long terme du stockage resterait largement inférieur à celui de la radioactivité naturelle : celui-ci sera de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an dans 100 000 ans en évolution normale et resterait inférieur à 0,25 mSv/an en situation dégradée (soit un niveau toujours inférieur à la radioactivité naturelle de 2,4 mSv/an).
QUESTION 774 - dérives du projet depuis le début
Posée par sylvain JOLIET, L'organisme que vous représentez (option) (VERSAILLES), le 14/12/2013
Pouvez-vous lister les modifications du projet, depuis le débat qui avait eu lieu à l'assemblée et au sénat pour le 1er vote (réversibilité, condition d'étanchéité de la roche, sûreté incendie, etc etc )
Réponse du 07/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le fruit du travail mené par l’Andra sur le projet de stockage depuis 1991 est présenté dans le dossier du maître d’ouvrage support au débat public. Les évolutions du projet sont rappelées dans différents documents disponibles sur le site du débat public (../informer/la-synthese-du-projet.html).
Dans son rapport préalable au débat public, le Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire a également retracé le processus entamé dans les années 1980 et ayant abouti au projet Cigéo (../docs/docs-complementaires/docs-avis-autorites-controle-evaluations/rapport-hctisn-gt-cigeo.pdf - voir pages 9 et suivantes)
Pour résumer brièvement l’histoire du projet :
En 1991, le Parlement a défini un programme de recherches pour la gestion à long terme des déchets les plus radioactifs. Le Parlement a chargé l’Andra de mener les recherches sur le stockage en couche géologique profonde et le CEA de mener les recherches sur la séparation-transmuation et sur l’entreposage de longue durée.
Après une mission de concertation lancée en 1992 pour identifier des sites candidats pour l’implantation de laboratoires souterrains, l’Andra a déposé en 1996 trois dossiers de demande de créations de laboratoires souterrains dans l’argile et le granite. Le Gouvernement a décidé en 1998 la construction d’un laboratoire souterrain en Meuse/Haute-Marne dans l’argile.
En 2005, l’Andra a remis au Gouvernement un dossier présentant le résultat des études de faisabilité d’un stockage sur le site étudié en Meuse/Haute-Marne et un dossier présentant les recherches menées sur le stockage dans le granite, en s’appuyant notamment sur les expérimentations menées dans d’autres laboratoires souterrains à l’étranger. Le CEA a également remis le bilan des recherches menées sur la séparation-transmutation et l’entreposage de longue durée, en surface ou en subsurface. Les résultats de ces recherches ont notamment été évalués par la Commission nationale d’évaluation mise en place par le Parlement et par l’Autorité de sûreté nucléaire. Un débat public a été organisé en 2005/2006 sur la politique nationale de gestion des déchets radioactifs.
Sur la base de l’ensemble de ces éléments, le Parlement a retenu en 2006 la solution du stockage profond réversible pour mettre en sécurité définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter leur charge sur les générations futures. Le Parlement a demandé à l’Andra de poursuivre les études et recherches sur le projet de stockage pour élaborer le dossier support à l’instruction de sa demande d’autorisation de création. Le Parlement a également demandé la poursuite des études et recherches sur la séparation-transmutation et sur l’entreposage, en complémentarité avec le stockage.
L’Andra a proposé en 2009 des orientations pour la conception, la sûreté et la réversibilité du stockage. Ces documents ont notamment précisé les orientations pour garantir la sûreté en exploitation du stockage vis-à-vis des risques internes et externes à l’installation. La zone de 30 km² étudiée pour l’implantation souterraine du stockage a été validée par le Gouvernement après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, de la Commission nationale d’évaluation et consultation des élus et du Comité local d’information et de suivi du Laboratoire de Bure.
Depuis 2005, toutes les données acquises, notamment au Laboratoire souterrain, confortent cette appréciation : la couche argileuse étudiée pour l’implantation éventuelle du stockage est homogène sur une grande surface et son épaisseur est importante (plus de 130 mètres). Aucune faille affectant cette couche n’a été mise en évidence sur la zone étudiée. La roche argileuse a une perméabilité très faible, ce qui limite fortement les circulations d’eau à travers la couche. Ainsi, le caractère favorable du site envisagé est aujourd’hui acquis, comme le souligne la Commission nationale d’évaluation dans son rapport de novembre 2013 : « Plus de quinze années d’études du site de Meuse/Haute-Marne ont démontré les excellentes qualités de confinement de la couche d'argilite ».
L’Andra a lancé en 2012 les études de conception industrielle du projet Cigéo. Ceci a notamment conduit à proposer une architecture d’ensemble du stockage et à retenir les principes de fonctionnement de Cigéo dans toutes les phases de sa vie (aspects opérationnels, génie civil, équipements, organisation du chantier et exploitation jusqu’à la fermeture des ouvrages souterrains). L’Autorité de sûreté nucléaire a rendu un avis en novembre 2013 sur les options de sûreté retenues (../docs/docs-complementaires/docs-avis-autorites-controle-evaluations/avis-asn-dossier-intermediaire-18-11-13.pdf). Les propositions de l’Andra relatives à la réversibilité du stockage ont été présentées lors du débat public (../docs/rapport-etude/fiche-reversibilite-cigeo.pdf).
QUESTION 773 - responsabilité
Posée par françois CONTAT, L'organisme que vous représentez (option) (CHAUMONT), le 14/12/2013
en cas de fuites radioactives dans 10, 20 ,100 ou 10000ans comment sera-t-il possible d'intervenir?Qui le fera ? Qui paiera? Si la recherche permet de trouver une possibilité de traitement la radioactivité des déchets comment irez vous rechercher les colis de déchets radioactifs ? Quels enseignements a-t-on pu tirer de Tchernobyl et de Fukushima quand à l'incapicité à maitriser la radioactivité dans les ouvrages ainsi que celle diffusée au moment de l'accident? Quel est le coût du traitement des déchets jusqu'à l'extinction de la radioactivité?
Réponse du 17/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage. Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
De nombreuses solutions pour gérer les déchets radioactifs ont été imaginées depuis 50 ans : les envoyer dans l’espace, au fond des océans ou dans le magma, les entreposer plusieurs centaines d’années en surface ou à faible profondeur, les transmuter… Seul le stockage profond est aujourd’hui reconnu en France et à l’étranger comme une solution robuste pour mettre en sécurité ces déchets à très long terme. Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de ces déchets. Grâce à la réversibilité, ces générations garderont la possibilité de faire évoluer cette solution. L’Andra propose ainsi que des rendez-vous réguliers soient programmés pendant une centaine d’années pour faire le point sur l’exploitation du stockage et préparer les étapes suivantes. Ces rendez-vous seront notamment alimentés par les résultats des recherches qui continueront à être menées sur la gestion des déchets radioactifs et les avancées technologiques. A chaque étape, il sera possible de décider de poursuivre le processus de stockage tel qu’initialement prévu ou de le modifier, par exemple si des solutions alternatives sont identifiées.
Si Cigéo est autorisé, le Centre sera une installation nucléaire de base qui, à ce titre, sera soumise à la réglementation en vigueur concernant ce type d’installation et sera notamment placée sous le contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) comme les autres installations nucléaires de base en France. Conformément à cette réglementation, l’ASN contrôlera très régulièrement le respect des exigences de sûreté mises en œuvre par l’Andra. De nouvelles dispositions pourront être prises à tout moment en cas de retour d’expérience à intégrer ou de changement de normes. Ainsi, les exigences de sûreté ont d’ores et déjà été renforcées notamment suite à la catastrophe de Fukushima. Cigéo n’est cependant pas une centrale nucléaire mais un centre de stockage de déchets radioactifs stabilisés et conditionnés qui du fait de son implantation à 500 mètres de profondeur sera peu vulnérable aux activités humaines comme aux catastrophes naturelles à l’inverse d’une centrale comme celle de Fukushima au Japon.
Pour un nouveau réacteur nucléaire sur l’ensemble de sa durée de fonctionnement, le coût du stockage des déchets radioactifs est de l’ordre de 1 à 2 % du coût total de la production d’électricité. La dernière évaluation du coût du stockage validée par le ministère en charge de l’énergie date de 2005. Au stade des études de faisabilité scientifique et technique et selon les hypothèses techniques retenues à ce stade, le coût du stockage avait été estimé entre 13,5 et 16,5 milliards d’euros, répartis sur une centaine d’années. Cette évaluation couvrait notamment le stockage de tous les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue produits par les réacteurs nucléaires français pendant 40 ans. L’Andra a lancé en 2012 les études de conception industrielle du projet Cigéo. Sur cette base, un nouveau chiffrage du coût du stockage sera finalisé en 2014 pour prendre en compte les pistes d’optimisation identifiées en 2013, les recommandations des évaluateurs et pour intégrer les suites du débat public. La Cour des comptes a réalisé une analyse des enjeux associés dans son rapport public thématique portant sur « Les coûts de la filière électronucléaire » (janvier 2012) disponible sur le site du débat : ../docs/docs-complementaires/docs-avis-autorites-controle-evaluations/rapport-thematique-filiere-electronucleaire.pdf.
QUESTION 772 - Securité
Posée par Jacques CHAUPIN, L'organisme que vous représentez (option) (VITRY-LE-FRANÇOIS), le 14/12/2013
Bonjour, Les bugs informatiques, ça existe, à Bure? Ca peut exister? Salutations 14/12/2013
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Comme c’est le cas pour d’autres installations nucléaires, des dispositions sont prises dès la conception de Cigéo pour maîtriser le risque de pannes informatiques et pouvoir mettre en sécurité le stockage en cas de telles pannes :
- des systèmes informatiques de rechange et de protection contre les effets d’éventuelles pannes seront mis en place,
- en cas de panne informatique, les équipements industriels devront pouvoir être opérés de manière électromécanique (par exemple au moyen d’armoires de commande).
Par ailleurs, les systèmes informatiques sont conçus pour être évolutifs afin de prendre en compte les évolutions technologiques pendant la durée d’exploitation du stockage.
QUESTION 771 - CHOIX DE NOTRE ENERGIE
Posée par c GAL, L'organisme que vous représentez (option), le 14/12/2013
Pourquoi ne pas donner la possibilité aux citoyens de choisir leur énergie ? Actuellement, on nous impose le nucléaire et il est impossible de déroger. Pourquoi ne pas laisser le choix aux régions de disposer, comme pour l'eau, d'un service énergies autonome, avec le choix (hydraulique, éolienne, .. ) en responsabilisant chacun d'entre nous et notamment, en permettant de recycler les déchets pour chauffer les établissements collectifs (piscine, bibliothèque, salle de réunion ...)
Réponse du 11/02/2014,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Depuis le 1er juillet 2007, tous les consommateurs peuvent choisir librement leur fournisseur d'électricité ou de gaz naturel. A côté des opérateurs historiques, une dizaine de fournisseurs proposent désormais aux consommateurs des offres de fourniture d'énergie accompagnées éventuellement d'autres services. Il existe en particulier des offres de fourniture d’électricité 100 % énergies renouvelables.
D’autre part, les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) contribuent à définir les orientations régionales et stratégiques en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de lutte contre la pollution atmosphérique, d’amélioration de la qualité de l’air, de maîtrise de la demande énergétique, de développement des énergies renouvelables et d’adaptation au changement climatique. Les Schémas régionaux climat air énergie (SRCAE), élaborés conjointement par les régions et l’État, permettent d’intégrer dans un seul et même cadre divers documents de planification ayant un lien fort avec l'énergie et le climat, notamment les schémas éoliens et les schémas de services collectifs de l'énergie.
En outre, l'ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. L’ADEME contribue au financement des projets des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public dans cinq domaines (la gestion des déchets, la préservation des sols, les économies d'énergie et les énergies renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le bruit). L’ADEME contribue ainsi à la réalisation de projets tels que des chaufferies biomasse, des systèmes de géothermie, des installations de méthanisation ou le développement de la cogénération ou de réseaux de chaleur reliés à des installations d’incinérations de déchets non dangereux.
Ces questions ont également été traitées dans le cadre du débat national sur la transition énergétique. Elles sont notamment détaillées dans le chapitre consacré à l’enjeu n°12 « Renforcer les compétences des territoires pour favoriser la décentralisation de la mise en œuvre de la transition énergétique » du rapport de synthèse du débat, disponible sur internet au lien suivant : http://www.transition-energetique.gouv.fr/sites/default/files/dnte_synthese_web_bat_28-8.pdf
QUESTION 770 - Avenir hypothéqué?
Posée par Catherine CHOFFAT, CITOYENNE CO-RESPONSABLE (LAUDUN), le 14/12/2013
Comment peut-on garantir l'avenir d'une région qui servira de poubelle nucléaire? Comment peton garantir qu'il n'y aura pas de pollution radioactive? Quel recul? Quelle sureté même à court terme?
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
Comment peut-on garantir l'avenir d'une région qui servira de poubelle nucléaire?
S’il est autorisé, Cigéo participera pleinement à la vie et au développement de son territoire d’accueil.
Le Centre de l’Andra en Meuse/Haute-Marne (Laboratoire souterrain, Espace technologique, Carothèque, Observatoire pérenne de l’environnement, Ecothèque) comprend d’ores et déjà plus de 300 emplois directs. Deux groupements d’intérêt public ont été créés en Meuse et en Haute-Marne pour gérer les équipements de nature à favoriser et faciliter l’installation et l’exploitation du Laboratoire ou de Cigéo, pour mener des actions d’aménagement du territoire et de développement économique et pour soutenir les actions de formation et de diffusion des connaissances scientifiques et technologiques. Ils ont été dotés de 30 millions d’euros par département en 2012. Par ailleurs, EDF, le CEA et Areva mènent une politique active en faveur du développement local.
Si Cigéo est autorisé, il constituera un projet industriel structurant pour le territoire. Entre 1 300 et 2 300 personnes travailleront à la construction des premières installations de Cigéo. Après la mise en service du Centre, entre 600 et 1 000 personnes travailleront de manière pérenne sur le site. Cigéo contribuera au développement de l’activité des entreprises locales et, grâce à la garantie d’une activité sur plus d’un siècle, certaines entreprises feront très vraisemblablement la démarche de s’implanter localement, créant à leur tour une activité nouvelle sur le territoire.
Le Gouvernement a également demandé l’élaboration d’un schéma de développement du territoire à l’échelle des deux départements de Meuse et de Haute-Marne. Ce schéma est élaboré sous l’égide du préfet de la Meuse, préfet coordinateur, en concertation avec les acteurs locaux (collectivités, chambres consulaires…). L’Andra et les entreprises de la filière nucléaire contribuent à son élaboration. Pour accéder à ce schéma : ../docs/docs-complementaires/docs-planification/SIDT-Final.pdf
Comment peut-on garantir qu'il n'y aura pas de pollution radioactive? Quel recul? Quelle sureté même à court terme?
L’objectif fondamental de Cigéo est de confiner la radioactivité des déchets sur de très longues échelles de temps. Tout est mis en œuvre pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. Tous les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation sont identifiés en amont de la conception. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier.
Si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Cet impact restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France). Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, le plan de surveillance de Cigéo permettra notamment de vérifier l’absence de « pollution radioactive »
Le projet Cigéo est le fruit d’un long travail scientifique, mené depuis plus de 20 ans qui est régulièrement évalué de multiples façons (Autorité de sûreté nucléaire et son appui technique l’IRSN, Commission nationale d’évaluation mise en place par le Parlement, publications scientifiques, expertises indépendantes…).
QUESTION 769 - vieillissement des dechets radio-actifs
Posée par remy LALLEMENT, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 14/12/2013
a quand et sur quels dechets nucleaires , des applications du vieillissement artificiels pourrons etre effectifs ? quel en sera le cout ? quels sacrifices humains directs et indirects va t il faloir subir au nom d un modele de societe ubuesque et irresponsable ?
Réponse du 13/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
De nombreuses expériences ont été et sont menées dans les laboratoires du CEA où les matériaux du stockage sont soumis à des rayonnements dont l’intensité et la quantité permettent de simuler le vieillissement de ces matériaux en conditions de stockage. Des modélisations à l’échelle atomique des matériaux sont aussi menées en parallèle, afin notamment d’évaluer l’apparition de défauts liés aux rayonnements, et contribuer ainsi à l’étude du vieillissement des matériaux.
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
Si Cigéo est autorisé, le démarrage de l’exploitation se fera de manière progressive. Des premiers colis de déchets radioactifs pourraient être pris en charge à l’horizon 2025. Le stockage des déchets de moyenne activité à vie longue (MA-VL) débuterait en 2025 et se poursuivrait pendant plusieurs dizaines d’années. Une zone pilote serait également réalisée en 2025 pour stocker une petite quantité de déchets de haute activité (HA). Cette zone serait ainsi observée pendant une cinquantaine d’années et permettrait d’avoir un retour d’expérience important avant de commencer la phase de stockage des déchets HA à l’horizon 2075. Ces déchets sont les plus radioactifs et se caractérisent par un dégagement de chaleur important. Une période d’entreposage de refroidissement sur leur site de production est nécessaire préalablement à leur stockage.
L’évolution du stockage sera surveillée tout au long de l’exploitation de Cigéo. Dans le cadre de la réversibilité de Cigéo, l’Andra propose que des rendez-vous soient programmés régulièrement avec l’ensemble des acteurs (riverains, collectivités, évaluateurs, État…) pour contrôler le déroulement du stockage (../docs/rapport-etude/fiche-reversibilite-cigeo.pdf). Ces rendez-vous seront alimentés par les résultats des de la surveillance du stockage et des réexamens périodiques de sûreté, fixés au moins tous les 10 ans par l’Autorité de sûreté nucléaire, ainsi que par les progrès scientifiques et technologiques. Le premier de ces rendez-vous pourrait avoir lieu cinq ans après le démarrage du centre.
QUESTION 768 - enfouissement
Posée par Thierry GAUDIN, L'organisme que vous représentez (option) (BRUXELLES), le 14/12/2013
Comment se fait-il qu'on s'obstine à vouloir enfouir les déchets nucléaires alors qu'on pourrait les diluer dans les océans (sous forme de composés liquides bien entendu)
Réponse du 27/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La pratique de l’immersion en mer de déchets radioactifs, sous forme solide ou liquide, a été mise en œuvre par de nombreux pays pendant plus de quatre décennies, à partir de 1946. Les signataires de la convention de Londres ont décidé en 1993 d’interdire l’immersion de tout type de déchets radioactifs dans la mer.
Le stockage de déchets radioactifs offre la possibilité d’une mise en œuvre suivant le principe de réversibilité.
L’inventaire national publié par l’Andra comprend un dossier présentant les immersions qui ont été réalisées et les modalités de surveillance des sites d’immersion http://www.andra.fr/download/site-principal/document/editions/467.pdf).
QUESTION 767 - *qu'est ce que l'avenir ?
Posée par pascal ROME, L'organisme que vous représentez (option) (NIORT), le 14/12/2013
est ce que ca ne commence pas déjà? où seront les responsabilités face à l'imprévisible , l'accident? est ce que ce ne serait pas le moment d'inverser les poids de la balance? de faire pencher du coté de la vie plutot que du coté de l'interet marchand?
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’Andra n’a absolument aucun « intérêt marchand » à concevoir le projet Cigeo plutôt qu’une autre solution. L’Andra est un établissement public qui a pour mission de concevoir des centres capables de protéger l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets. Elle est placée sous la tutelle des ministères en charge de l’environnement, de l’industrie et de la recherche.
En France et à l’étranger, le stockage profond est considéré actuellement comme la solution la plus sûre et la plus durable en tant qu’étape finale de la gestion des déchets les plus radioactifs (voir par exemple la directive européenne du 19 juillet 2011 ainsi que le débat du 23 septembre 2013 sur la comparaison des expériences internationales). Le stockage ne fait pas disparaître les déchets radioactifs, mais il permet de ne pas reporter leur charge sur les générations futures en leur donnant la possibilité de les mettre en sécurité de manière définitive.
Notre génération a la responsabilité de mettre en place des solutions de gestion sûres pour les déchets radioactifs produits depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Le but étant de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, tous les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation sont identifiés par l’Andra en amont de la conception. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
QUESTION 766 - Surveillance du site a long terme
Posée par jeremie DESSUS, L'organisme que vous représentez (option) (VITRY), le 14/12/2013
Comment Edf ou l'etat peuvent ils s'engager sur une surveillance et un entretien du site sur une durée de 100.000 ans??
Réponse du 08/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le principe du stockage profond est justement que sa sûreté à long terme ne repose pas sur des actions humaines, notamment sur une surveillance du site, mais sur le milieu géologique. La surveillance du site pourra néanmoins être maintenue aussi longtemps que les générations futures le souhaiteront et contribuera au maintien de la mémoire du stockage. L’Andra présentera dans sa demande d’autorisation de création du stockage les modalités envisagés pour la surveillance du stockage après sa fermeture (surveillance depuis la surface, à partir de forages à faible profondeur, surveillance de l’environnement…).
QUESTION 765 - qui sera responsable en cas de bug informatique?
Posée par Anne ANDRES, L'organisme que vous représentez (option), le 14/12/2013
Un ordi peut-il être jugé responsable s'il y a par exemple un orage informatique qui dérègle le fonctionnement des mesures de sécurité?
Réponse du 09/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Comme c’est le cas pour d’autres installations nucléaires, des dispositions sont prises dès la conception de Cigéo pour maîtriser le risque de pannes informatiques et pouvoir mettre en sécurité le stockage en cas de telles pannes :
- des systèmes informatiques de rechange et de protection contre les effets d’éventuelles pannes seront mis en place,
- en cas de panne informatique, les équipements industriels devront pouvoir être opérés de manière électromécanique (par exemple au moyen d’armoires de commande).
Par ailleurs, les systèmes informatiques sont conçus pour être évolutifs afin de prendre en compte les évolutions technologiques pendant la durée d’exploitation du stockage.
QUESTION 764 - Mais qui êtes vous?
Posée par Francis PHILIPPIN, JE REPRÉSENTE MA PETITE FILLE, SASHA, ELLE A 3 ANS. (COMBLAIN (BE)), le 14/12/2013
Qui êtes-vous pour oser prendre de telles décisions? Faites-vous partie de ces religieux qui parlent au nom de d'Allah, de Dieu, de Jéhovah, de Ron Hubbart? Et qui ne tolèrent aucune contestation sous prétexte qu'il détiennent la vérité? La seule vérité que je peux accepter est celle qui est démontrée par la science, et on sait depuis longtemps maintenant qui si la science avance, c'est parce qu'elle doute, parce que de nombreux chercheurs, ont remis sans cesse en question ce qui était établi. Par votre action irréversible, vous hypothéquer l'avenir de l'humanité, et vous combattez la recherche de la connaissance. Vous ne doutez pas! Tout comme ces gourous qui déclarent "Bienheureux les simples d'esprit, le royaume des cieux est fait pour eux" ou encore "Heureux celui qui croit sans avoir vu.." ou encore, tuez un mécréant, et vous irez au paradis et vivrez en compagnie de 10000 vierges, etc. D'autres avant vous n'ont pas douté, Pol Pot, Hitler pour ne citer que ceux-là. On a vu où cela nous a mené. Hitler avait en plus la haine, celle des juifs, et vous, qui haïssez-vous? Nos petits enfants? Moi, voyez-vous, je suis encore plein de doutes, je m'interroge chaque jour qui passe, mais pas seulement, je suis plein d'espoir aussi, je me dis qu'en tout homme, il doit y avoir du bon, je doute donc que vous soyez 100% malfaisant ou idiot, alors je vous en prie, prouvez-moi que j'ai eu raison de douter. Que l'Esprit vous éclaire ! (ou alors EDF)
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
Vos propos sont insultants pour toutes celles et tous ceux qui travaillent à la mise en œuvre de solutions sûres pour protéger les populations actuelles et futures des risques liés aux déchets radioactifs. Toutes les personnes qui travaillent à l’Andra partagent une même valeur : la responsabilité. Prenez donc le temps de vous documenter sur le projet avant de tenir des propos aussi haineux ! Vous verrez dans les documents mis à votre disposition par la Commission particulière du débat public que :
- le projet est le fruit des très nombreux travaux de recherche ;
- ces travaux scientifiques sont parmi les plus évalués (voir le rapport d’évaluation 2012 fait par l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Aeres)) ;
- le dialogue a fait partie de la construction du projet depuis de nombreuses années (ex : l’élaboration de la ZIRA, zone d’intérêt pour la reconnaissance approfondie)
- le projet est réversible…
QUESTION 763 - Durabilité - Béton ?
Posée par Michèle ACKERMANN, L'organisme que vous représentez (option) (NAYEMONT LES FOSSES ), le 14/12/2013
Il est bien difficile de connaître la limite d'âge du béton même s'il (selon Lafarge ) est 5 fois plus résistant qu'en 1980 et qu'il peut « tenir » 100ans, 300ans, cela ne suffira pas. Wikipédia affirme que son vieillissement dépend de plusieurs facteurs ( évidemment ) « Selon sa composition, ses additifs et selon les conditions de sa préparation ou de son coulage et selon les contraintes qu'il subit ( attaques chimiques, séismes, vibrations, chocs thermiques, infiltration...) il vieillit PLUS ou MOINS bien » ( bel euphémisme! ) Pouvez-vous me rassurer et assurer que les «colis» avec béton (qui est le meilleur du monde ( bien entendu) résisteront au fond des galeries souterraines de BURE alors que ses dégradations sont trop peu connues et que sa durée de vie n'égalera jamais celle du plutonium 239 ( 24000 ans) et de l'uranium 238 (4,5 milliards d'années ) qu'ils sont sensés CONFINER ?
Réponse du 31/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Il est effectivement impossible de construire des ouvrages de génie civil en béton qui resteraient intègres sur la durée de dangerosité des déchets destinés à Cigéo. Le vieillissement du génie civil limite ainsi la durée de vie des installations d’entreposage dans lesquelles se trouvent actuellement les déchets, typiquement autour d’une centaine d’années, au terme de laquelle les déchets doivent en être retirés. Les ouvrages de génie civil sont soumis à des sollicitations physiques et chimiques qui contribuent à leur vieillissement : par exemple, les cycles saisonniers en surface font se succéder des périodes chaudes et des périodes de gel. Lorsque les ouvrages sont implantés en profondeur, certaines sollicitations physiques et chimiques sont atténuées - par exemple la température y est beaucoup plus constante -, ralentissant les processus de dégradation du béton. Malgré ce ralentissement, une dégradation progressive du béton doit être prise en compte dans l’évaluation de la sûreté de Cigéo.
Dans les principes de sûreté du stockage profond, on n’attend pas du béton qu’il confine la radioactivité au-delà de la centaine d’années d’exploitation envisagée. Les ouvrages en béton (conteneurs de stockage et revêtement des galeries) sont conçus pour permettre d’exploiter le stockage en toute sûreté. A long terme, après la fermeture du stockage, c’est la couche d’argile qui, par sa faible perméabilité, ses caractéristiques chimiques et son épaisseur, assurera le confinement de la radioactivité à l’échelle de plusieurs centaines de milliers d’années.
QUESTION 762 - La radioctivité est-elle dangereuse ?
Posée par Michèle ACKERMANN, L'organisme que vous représentez (option) (NAYEMONT LES FOSSES), le 14/12/2013
Pour l'ANDRA la RADIOACTIVITE devient presque une banalité inoffensive: il y a la radioctivité naturelle et toute activité humaine produits des déchets. L'utilisation des propriétés de la radioactivité génèrent des déchets radioactifs. Ces déchets émettent de la radioactivité et présentent des RISQUES POUR L'HOMME ET L'ENVIRONNEMENT. L' ANDRA fait alors une comparaison fallacieuse, puisqu'en France chaque habitant produit 2kg de déchets radioctifs 2500 kg de déchets industriels 360 kg de déchets ménagers Au cours de ses exposés hautement techniques et scientifiques 3 petites phrases «anodines» apparaissent: « Une exposition prolongée ou des doses trop élévées de radioctivité PEUT ALORS provoquer des brûlures, modifier à vie des cellules et provoquer des cancers VOIRE des modifications génétiques.» L'ANDRA est prolixe en explications de toutes sortes qui magnifient notre industrie mais fait l'impasse sur les risques réels de santé que multiplie la radioactivité. Pourquoi ne jamais faire référence aux accidents nucléaires qui ont fait des milliers de déplacés, de morts et de malades en sursis ? à la réalité des maladies du cœur, des muscles, du pancréas, des yeux, de la moelle osseuse..... Pourquoi ne jamais parler des malades qui souffrent dans leur corps, leur tête et leur cœur de cette injustice ? Le nucléaire est dangereux et mortifère depuis l'extraction du minerai jusqu'à la mise à l'écart de ses déchets . La vérité est-elle si difficile à dire?
Réponse du 30/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
L’Andra dit les choses comme elles sont. Elle n’a jamais caché la dangerosité des déchets radioactifs qui sont concernés par Cigéo. Nous vous invitons d’ailleurs à découvrir, sur ce sujet et celui de la radioactivité en général, l’exposition « La radioactivité de Homer à Oppenheimer » réalisée par l’Andra qui est actuellement présentée au Palais de la découverte à Paris et en ligne http://www.andra.fr/laradioactivite/
C’est justement à cause du danger que représentent les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue qui ont vocation à être stockés dans Cigeo que le choix du stockage profond a été fait, parce qu’il offre de meilleures garanties en termes de sûreté sur le très long terme que l’entreposage en surface.
Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestions sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
QUESTION 761 - Pourquoi produire des déchets Ultimes?
Posée par Francis BIA, SANS (MONTMAIN), le 14/12/2013
Ces déchets dont les traces seront oubliées. Sur quels supports seront ils répertoriées et consultables par les générations futures? - A titre d'exemple : pas ou peu d'éléments concernant les nocivités des pollutions industrielles du siècle dernier... Le principe doit être simple: par précaution, toute production générant des déchets non recyclables, est proscrite. Quand la conscience humaine ne s'arrêtera t' elle plus, aux pieds du mercantilisme et du culte de la puissance.
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Concernant la transmission de la mémoire du site aux générations futures
L’objectif fondamental de Cigéo est de protéger l’homme et l’environnement des déchets radioactifs sur de très longues échelles de temps. La sûreté à long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. C’est une des raisons qui a conduit, en 2006, le Parlement à retenir la solution du stockage profond. En effet, cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli, contrairement à l’entreposage. En cas de perte complète de la mémoire du stockage, une intrusion inopinée à 500 mètres sous terre apparaît peu plausible, du moins sans un minimum d’investigations préalables. L’Andra évalue cependant par précaution dans son analyse de sûreté les conséquences d’un forage à travers le stockage pour vérifier que le stockage resterait sûr.
Malgré cette robustesse du stockage même en cas d’oubli, l’Andra conçoit Cigéo avec l’objectif d’en conserver la mémoire et de la transmettre aux générations futures le plus longtemps possible. Des solutions d’archivage de long terme existent pour les centres de stockage de surface exploités par l’Andra et font l’objet de revues périodiques. Le retour d’expérience montre que ces solutions paraissent robustes pour au moins les 500 premières années. Ainsi, pour Cigéo, l’Andra prévoit qu’un centre de la mémoire perdurera sur le site. Il pourra accueillir le public et comprendra notamment les archives du Centre. De manière générale, le maintien de la mémoire doit aussi impliquer les acteurs locaux, qui peuvent prendre le relai en cas de défaillance de l’Andra ou de l’État. L’Andra veille d’ores et déjà à les informer sur les enjeux associés à la mémoire et étudie avec des anthropologues, des philosophes ou encore des artistes les facteurs qui peuvent favoriser la transmission de la mémoire. La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
L’Andra a lancé en 2010 un programme d’études pour proposer des outils qui rendent cette transmission plus robuste sur une échelle de temps millénaire. Des pistes se dessinent tels des marqueurs de surface, mais aussi des rendez-vous réguliers à mettre en place au niveau des populations locales.
En tout état de cause, comme il est impossible de garantir notre capacité à communiquer avec des êtres vivant dans plusieurs milliers d’années, c’est chaque génération qui aura la responsabilité de contribuer à transmettre cette mémoire aux générations suivantes.
A propos de la production de déchets radioactifs non recyclables
Nous tenons à vous préciser que le Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR, www.asn.fr/index.php/content/download/37725/279693/file/PNGMDR-2013-2015-complet.pdf) « organise la mise en œuvre des recherches et études sur la gestion des matières et des déchets avec comme première orientation « la réduction de la quantité et de la nocivité des déchets, notamment par le traitement des combustibles usés et le traitement et le conditionnement des déchets radioactifs » notamment dans le but de « prévenir et de réduire à la source la production et la nocivité des déchets, de mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement en privilégiant : la préparation en vue de la réutilisation ; le recyclage ; la valorisation ; l’élimination ».
QUESTION 760 - Comme à Fukushima...
Posée par Hélène RICHARD, L'organisme que vous représentez (option) (MALAKOFF), le 14/12/2013
En visionnant de multiples reportages après la catastrophe due à l'imprévoyance et l'aveuglement des responsables japonnais, le gouvernement du Japon continue de nier les dangers de la contamination très près de l'explosion et abandonne ses citoyens à leur sort... Messieurs et mesdames les pro-nucléaires francais comment assumerez-vous votre obstination lorsque nous subirons un tel type d'horreur ?
Réponse du 11/02/2014,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
L’utilisation de l’énergie nucléaire a apporté durant plusieurs années un bénéfice important à la France, du point de vue économique tant par une filière industrielle de premier plan mondial que par des prix de l’électricité parmi les plus bas d’Europe et du point de vue environnemental, par des émissions de gaz à effet de serre également parmi les plus basses d’Europe.
L’énergie nucléaire comporte aussi des inconvénients que sont la production de déchets radioactifs à vie longue, qui font l’objet du présent débat public, et le risque d’accident. Le contrôle de la sûreté nucléaire est confié en France à une autorité administrative indépendante, l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), qui a tout pouvoir pour prescrire les mesures techniques nécessaires, afin d’améliorer en permanence la sûreté. Un important travail d’examen de la sûreté a été mené après l’accident de Fukushima et a conduit à prescrire le renforcement des installations.
Malgré toutes les précautions qui sont prises, un accident nucléaire ne peut être totalement exclu par principe. C’est pourquoi des mesures de sauvegarde d’urgence sont prévues par les opérateurs et des plans particuliers d’intervention sont préparés par les pouvoirs publics et régulièrement testés au cours d’exercice. Enfin la France est le premier pays à avoir engagé, dès 2005, une réflexion sur la gestion post-accidentelle des territoires contaminés.
Réponse apportée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) :
Les activités nucléaires sont exercées de façon à prévenir les accidents, mais aussi à en limiter les conséquences. Malgré toutes les précautions prises, l’ASN considère qu’un accident ne peut jamais être exclu, et il convient de prévoir, tester et réviser régulièrement les dispositions nécessaires pour faire face et gérer une situation d’urgence radiologique, même peu probable.
Ces situations d’urgence font l’objet de dispositions matérielles et organisationnelles spécifiques, qui incluent les plans de secours, et impliquent à la fois l’exploitant ou le responsable d’activité et les pouvoirs publics.
L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) participe à la gestion de ces situations, pour les questions relatives au contrôle de sûreté nucléaire et à la radioprotection, et, en s’appuyant sur l’expertise de son appui technique l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), remplit quatre grandes missions qui sont :
- s’assurer du bien-fondé des dispositions prises par l’exploitant et le contrôler ;
- apporter son conseil au Gouvernement et à ses représentants au niveau local, notamment en matière d’actions de protection des populations ;
- participer à la diffusion de l’information ;
- assurer la fonction d’Autorité compétente dans le cadre des conventions internationales.
Par ailleurs, l’ASN a mis en place en 2005 un Comité directeur pour assurer, dans la continuité de la gestion d’urgence radiologique, la gestion de la phase post-accidentelle, dont la doctrine relative aux périodes de sortie de la phase d’urgence, de transition et de long terme, a été publiée en novembre 2012.
En cas d’accident grave susceptible d’occasionner des rejets, plusieurs actions peuvent être prises par le préfet pour protéger la population :
- la mise à l’abri et à l’écoute : les personnes concernées, alertées par une sirène, se mettent à l’abri chez elles ou dans un bâtiment, toutes ouvertures soigneusement closes, et y restent à l’écoute des consignes du préfet transmises par la radio ;
- l’ingestion de comprimés d’iode stable : sur ordre du préfet, les personnes susceptibles d’être exposées à des rejets d’iodes radioactifs sont invitées à ingérer la dose prescrite de comprimés d’iodure de potassium ;
- l’évacuation : en cas de menace imminente de rejets radioactifs importants, le préfet peut ordonner l’évacuation. Les populations sont alors invitées à préparer un bagage, mettre en sécurité leur domicile et quitter celui-ci pour se rendre au point de rassemblement le plus proche.
En cas de rejet effectif de substances radioactives dans l’environnement, des premières actions sont décidées pour préparer la gestion de la phase post-accidentelle : elles reposent sur la définition d’un zonage du territoire qui sera mis en place lors de la sortie de la phase d’urgence et incluent :
- une zone de protection de la population (ZPP) à l’intérieur de laquelle des actions sont nécessaires pour réduire aussi bas que raisonnablement possible, l’exposition des populations due à la radioactivité ambiante et à l’ingestion de denrées contaminées ;
- une zone de surveillance renforcée des territoires (ZST), plus étendue et davantage tournée vers une gestion économique, au sein de laquelle une surveillance spécifique des denrées alimentaires et des produits agricoles sera mise en place ;
- le cas échéant, à l’intérieur de la zone de protection des populations, est introduit un périmètre, dit d’éloignement, défini en fonction de la radioactivité ambiante (exposition externe). Les résidents doivent être éloignés pour une durée plus ou moins longue en fonction du niveau d’exposition dans leur milieu de vie.
Réponse apportée par EDF :
La loi du 13 juillet 2005 (Loi de Programmation et d’Orientation pour l’Energie) a fixé les objectifs du pays en matière énergétique : développement des énergies renouvelables, développement des économies d’énergie, poursuite de la production électronucléaire. Une nouvelle loi de transition énergétique est en préparation, et sera discutée au Parlement en 2014. Les orientations de cette nouvelle loi seront, comme celles de la loi actuelle, mises en œuvre par EDF, qui est actuellement le premier producteur d’électricité nucléaire dans le monde, mais aussi le premier producteur d’énergies renouvelables en France et l’acteur principal du programme d’économies d’énergie dans les bâtiments défini par la loi, via le mécanisme des Certificats d’Economies d’Energie.
Pour EDF, la sûreté des centrales nucléaires est une priorité absolue, afin que la production d'électricité nucléaire n'ait aucune incidence sur l'homme et l'environnement. La sûreté regroupe l'ensemble des dispositions mises en œuvre dès la conception d'une centrale, puis lors de sa construction, de son exploitation et jusqu'à sa déconstruction pour éviter la dispersion de produits radioactifs. Pour EDF, cette exigence de sûreté repose sur le professionnalisme des équipes formées en permanence, la rigueur d’exploitation qui découle de ce professionnalisme, la qualité et la régularité de la maintenance qui garantissent la fiabilité des installations, mais aussi sur les contrôles effectués au quotidien par l’Autorité de Sûreté Nucléaire et le suivi des réglementations. Ces mesures sont en évolution permanente, comme en témoignent les nombreuses modifications apportées aux installations nucléaires d'EDF depuis l'accident de Fukushima au Japon, afin de les rendre encore plus sûres.
L'expérience accumulée par EDF en France et à l'international en matière d'exploitation nucléaire sans qu'aucun accident n'affecte ses centrales contribue à cette amélioration continue de la sûreté nucléaire.
QUESTION 759 - Dans quelques milliers d'années
Posée par Bernard SOCIÉ, L'organisme que vous représentez (option) (CHAUMONT), le 14/12/2013
Quand nous aurons quitté notre enveloppe charnelle, dans 5, 10, 20 000 ans, que vaudront les certitudes actuelles de scientifiques apprentis sorciers qui auront décidé que "rien n'allait jamais bouger" sous ce petit lopin de terre de Bure ? Bénéficieront-ils encore d'un statu de "scientifique" ou même simplement "d'expert" ?
Réponse du 10/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif fondamental de Cigéo est de protéger l’homme et l’environnement des déchets radioactifs sur de très longues échelles de temps. La sûreté à long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. C’est une des raisons qui a conduit, en 2006, le Parlement à retenir la solution du stockage profond. En effet, cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli, contrairement à l’entreposage. En cas de perte complète de la mémoire du stockage, une intrusion inopinée à 500 mètres sous terre apparaît peu plausible, du moins sans un minimum d’investigations préalables. L’Andra évalue cependant par précaution dans son analyse de sûreté les conséquences d’un forage à travers le stockage pour vérifier que le stockage resterait sûr.
Malgré cette robustesse du stockage même en cas d’oubli, l’Andra conçoit Cigéo avec l’objectif d’en conserver la mémoire et de la transmettre aux générations futures le plus longtemps possible. Des solutions d’archivage de long terme existent pour les centres de stockage de surface exploités par l’Andra et font l’objet de revues périodiques. Le retour d’expérience montre que ces solutions paraissent robustes pour au moins les 500 premières années. Ainsi, pour Cigéo, l’Andra prévoit qu’un centre de la mémoire perdurera sur le site. Il pourra accueillir le public et comprendra notamment les archives du Centre. De manière générale, le maintien de la mémoire doit aussi impliquer les acteurs locaux, qui peuvent prendre le relai en cas de défaillance de l’Andra ou de l’État. L’Andra veille d’ores et déjà à les informer sur les enjeux associés à la mémoire et étudie avec des anthropologues, des philosophes ou encore des artistes les facteurs qui peuvent favoriser la transmission de la mémoire. La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
En tout état de cause, comme il est impossible de garantir notre capacité à communiquer avec des êtres vivant dans plusieurs milliers d’années, c’est chaque génération qui aura la responsabilité de contribuer à transmettre cette mémoire aux générations suivantes.
QUESTION 758 - question de la plus haute importance
Posée par Michel FRANÇOIS, HABITANTS VIGILANTS (GONDRECOURT), le 14/12/2013
j'aimerai savoir quel type de déchets nucléaires sont transportés dans les camions stationnant à Void, à 200 m des écoles ?
Réponse du 20/12/2013,
Réponse apportée par Aréva :
Aucun déchet radioactif ne transite par la base de Void-Vacon.
QUESTION 757 - sécurité
Posée par jean-pierre COLLET, L'organisme que vous représentez (option) (AMBRONAY), le 14/12/2013
Comment garantir pour des milliers d'années à venir la sécurité liée à un tel stockage, sachant que nous n'avons : - aucun recul sur cette opération, -aucune certitude quant à la fiabilité et des matériaux et de la nature du terrain, ni même de l'évolution du sous-sol (qui peut assurer par exemple qu'il n'y aura aucun séisme dans les décennies à venir ?) , - et enfin aucune assurance sur la façon dont nos descendants sauront ou non appréhender ce leg (codage ? même langage ? respect des avertissments ? régime politique en place par la suite ?)? Comment avec autant d'inconnues peut-on engager si durablement l'avenir de toute une région (voire d'un pays) , et d'une multitude de générations à venir ?
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif fondamental de Cigéo est de protéger l’homme et l’environnement des déchets radioactifs sur de très longues échelles de temps. La sûreté à long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. C’est une des raisons qui a conduit, en 2006, le Parlement à retenir la solution du stockage profond. En effet, cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli, contrairement à l’entreposage. En cas de perte complète de la mémoire du stockage, une intrusion inopinée à 500 mètres sous terre apparaît peu plausible, du moins sans un minimum d’investigations préalables. L’Andra évalue cependant par précaution dans son analyse de sûreté les conséquences d’un forage à travers le stockage pour vérifier que le stockage resterait sûr.
Malgré cette robustesse du stockage même en cas d’oubli, l’Andra conçoit Cigéo avec l’objectif d’en conserver la mémoire et de la transmettre aux générations futures le plus longtemps possible. Des solutions d’archivage de long terme existent pour les centres de stockage de surface exploités par l’Andra et font l’objet de revues périodiques. Le retour d’expérience montre que ces solutions paraissent robustes pour au moins les 500 premières années. Ainsi, pour Cigéo, l’Andra prévoit qu’un centre de la mémoire perdurera sur le site. Il pourra accueillir le public et comprendra notamment les archives du Centre. De manière générale, le maintien de la mémoire doit aussi impliquer les acteurs locaux, qui peuvent prendre le relai en cas de défaillance de l’Andra ou de l’État. L’Andra veille d’ores et déjà à les informer sur les enjeux associés à la mémoire et étudie avec des anthropologues, des philosophes ou encore des artistes les facteurs qui peuvent favoriser la transmission de la mémoire. La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre. En tout état de cause, comme il est impossible de garantir notre capacité à communiquer avec des êtres vivant dans plusieurs milliers d’années, c’est chaque génération qui aura la responsabilité de contribuer à transmettre cette mémoire aux générations suivantes.
Concernant les séismes, la stabilité et la très faible sismicité de la zone d’implantation du laboratoire souterrain est confirmée par les scientifiques qui ont travaillé sur ce site depuis plus de 20 ans. Le site de Meuse/Haute-Marne appartient à un domaine géologique stable (voir carte), particulièrement favorable pour l’installation d’un stockage. L’activité sismique est en effet extrêmement faible, comme le prouvent les enregistrements de sismicité instrumentale (écoute sismique depuis 1961 à l’échelle de la France) qui sont capables de détecter des microséismes, et les chroniques historiques (séismes ayant été ressentis et/ou ayant occasionné des dégâts au cours des derniers 1 000 ans). Au-delà de ces données, la stabilité et la très faible sismicité du site s’expliquent par sa situation géographique dans le bassin parisien qui est protégé des mouvements liés à la tectonique des plaques (collision du continent africain avec l’Europe).
QUESTION 756 - La seule constante de ce monde est son inconstance
Posée par Michel FOUCHER, L'organisme que vous représentez (option) (TROYES), le 14/12/2013
Le monde technologique tel que nous le connaissons actuellement existe depuis deux cents ans, ce qui est infime par rapport aux quatre milliards d'années d'existence de la terre. Le monde actuel peut donc être considéré comme une exception et aura certainement une fin. En cas de "retour à la vie normale", y aura-t-il un système prévu pour fermer définitivement (en tous cas pour plusieurs siècles) l'accès aux déchets stockés ?
Réponse du 11/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le projet Cigéo est conçu pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter leur charge sur les générations futures. Le Parlement a également demandé que ce stockage, prévu pour être définitif, soit réversible pendant au moins 100 ans. Les conditions de cette réversibilité seront définies dans une future loi.
Pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets radioactifs, Cigéo devra être refermé après son exploitation. L’Andra conçoit Cigéo pour qu’il puisse être refermé de manière progressive et propose que chaque étape de fermeture fasse l’objet le moment venu d’une autorisation spécifique. En effet, ces étapes permettront de progresser vers une sûreté de plus en plus passive mais rendront plus complexe le retrait éventuel de colis stockés. Le Parlement a d’ores et déjà décidé que seule une loi pourrait autoriser la fermeture définitive du stockage.
Après la fermeture du stockage, la sûreté sera assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Une surveillance du site pourra néanmoins être maintenue aussi longtemps que la société le souhaitera et des actions seront menées pour conserver et transmettre la mémoire du stockage.
QUESTION 755 - Prise de conscience de l'échelle de temps concernée
Posée par claude KINTZLER, L'organisme que vous représentez (option) (PÉROLS), le 14/12/2013
Avez-vous conscience que lorsque les déchets les plus toxiques que l'industrie nucléaire se propose d'enfouir à Bure aura perdu la moitié seulement de sa nocivité, TOUTES LES LANGUES PARLÉES ACTUELLEMENT SUR TERRE AURONT DISPARU ? Sachant cela, comment peut-on, sur la foi de quelques hommes du présent que ce soit - Lobbyistes, politiques, industriels, et même scientifiques - imposer un risque quasi éternel à l'échelle humaine aux générations futures ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 753 - maitrise énergie nucléaire
Posée par michele ROMMENS, L'organisme que vous représentez (option), le 14/12/2013
qui peut être assez fou pour continuer à développer une énergie que l'on ne maitrise et qui a autant d'impact sur la planète à l'heure où l'on nous parle sans cesse de "durable" ? avant de vous engager dans de nouvelles folies avec l'enfouissement sous terre extremement dangereux en cas d'accident de toute sorte dont surtout un tremblement de terre ou des mouvements de celle ci même moindres que l'on ne maîtrise pas plus, pourquoi s'entêter et ne mettez vous pas le paquet dans la recherche de la maitrise de cette énergie meurtrière que l'on ne sait pas arrêter en cas de problème et qui ne conduit qu'à de la destruction et non du durable ? pourquoi vous acharnez vous à detruire notre belle planète ? pourquoi voulez vous être responsable de ça après les grands exemples que nous avons connus et qui ne s'arrêteront pas ?
Réponse du 10/02/2014,
Réponse apportée par le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
En France, le nucléaire occupe une place prépondérante dans le mix électrique, assurant près de 75% de la production française d’électricité. Compte tenu de la durée nécessaire à la construction de moyens de production d’électricité de substitution, un arrêt à court terme de l’ensemble du parc nucléaire n’est pas envisageable sans remettre en cause l’approvisionnement électrique du pays, c’est-à-dire sans coupures très importantes d’électricité pour les consommateurs. Il apparaît donc extrêmement difficile de ne plus produire de nouveaux déchets radioactifs provenant de l’industrie électronucléaire à très court terme.
Depuis plusieurs dizaines d’années, la France a mis en place une politique de gestion responsable de ses déchets radioactifs. En 2006, après quinze années de recherches encadrées par la loi « Bataille », d’avis des évaluateurs et d’un débat public, le Parlement a fait le choix du stockage réversible profond pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations futures.
Enfin, en matière de mix électrique, le Président de la République a fixé le cap suivant pour la France : réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% d'ici 2025. Parallèlement, le Président de la République a indiqué que la transition énergétique serait fondée sur deux principes : l'efficacité énergique d'une part, et la priorité donnée aux énergies renouvelables d'autre part. Cette mutation prendra du temps et supposera des étapes d’évaluation en fonction des progrès technologiques et scientifiques et des prix relatifs de chaque source d’énergie.
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit les choix énergétiques futurs. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
QUESTION 752 - Vous rendez-vous compte ?
Posée par Jean-Luc MERCIER, L'organisme que vous représentez (option) (AUBAGNE), le 14/12/2013
De la gravité de cette menace qui va peser sur des générations ?
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
QUESTION 751 - la politique du court terme
Posée par véronique CHAUDIEU, MA CONSCIENCE CITOYENNE (SAINT GERMAIN EN LAYE), le 14/12/2013
L'enfouissement n'offre aucune garantie pour l'avenir pour les dizaines de générations qui suivront la notre inconsciente des conséquences de ses actes. Qu'en sera-t-il des déchets que la france a choisi de continuer de produire?
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Au contraire, le stockage profond est aujourd’hui la seule solution robuste pour mettre en sécurité à très long terme les déchets les plus radioactifs. Cette solution est étudiée depuis plus de 20 ans. Différentes solutions ont été étudiées dans le cadre du programme de recherches institué par la loi de 1991. Les résultats de ces recherches ont été évalués en 2005/2006 et un débat public a été organisé sur la politique nationale de gestion des déchets radioactifs. Sur la base de l’ensemble de ces éléments, le Parlement a fait le choix en 2006 du stockage profond réversible pour mettre en sécurité de manière définitive ces déchets et ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations futures. Le Parlement a demandé à l’Andra de préparer la mise en œuvre de cette solution.
Cigéo est conçu pour prendre en charge l’ensemble des déchets les plus radioactifs produits par les installations nucléaires passées, actuelles et en cours de construction.
QUESTION 749 - Quel est le budget prévu et financé pour assurer la maintenance et la sécurité du site pendant plus de mille ans, sans en imposer la charge aux générations futures ?
Posée par Philippe RAHARD, L'organisme que vous représentez (option) (NORT-S-ERDRE), le 14/12/2013
Comment pouvez-vous être sûr de la tenue des matériaux employés (béton, aciers, électronique, électricité) sur une durée de temps aussi longue alors que personne n'en a le retour d'expérience ? Combien de temps dure un composant électronique de base, et comment se comporte t'il dans des situations extrèmes, par exemple.
Réponse du 07/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
De manière générale, la démarche scientifique se fonde sur l’observation, puis sur l’expérimentation et enfin sur la modélisation et la simulation numérique qui permettent d’extrapoler des résultats à des échelles inaccessibles via l’expérimentation. Le propre des sciences de la Terre et de l’Univers est que les observations permettent d’appréhender des phénomènes qui se déroulent sur de très longues durées. Cette démarche scientifique est au cœur des études menées par l’Andra depuis une vingtaine d’années pour étudier la faisabilité du stockage profond. Pour mener ces recherches, l’Andra mobilise la communauté scientifique dans de nombreuses disciplines (sciences de la Terre et de l’environnement, chimie, science des matériaux, mathématiques appliquées…) au travers de partenariats avec des organismes de recherche et des établissements universitaires français, ainsi qu’au moyen de coopérations internationales.
Les recherches menées depuis 1994 sur le site étudié en Meuse/Haute-Marne ont permis aux scientifiques de reconstituer de manière détaillée son histoire géologique, depuis plus de 150 millions d’années. Le site étudié se situe dans la partie Est du bassin de Paris qui constitue un domaine géologiquement simple, avec une succession de couches de calcaires, de marnes et de roches argileuses qui se sont déposées dans d’anciens océans. Les couches de terrain ont une géométrie simple et régulière. Cette zone géologique est stable et caractérisée par une très faible sismicité. La couche argileuse étudiée pour l’implantation éventuelle du stockage, qui s’est déposée il y a environ 155 millions d’années, est homogène sur une grande surface et son épaisseur est importante (plus de 130 mètres).
Aucune faille affectant cette couche n’a été mise en évidence sur la zone étudiée.
Cette analyse s’appuie sur des investigations géologiques approfondies : plus de 40 forages profonds ont été réalisés, complétés par l’analyse de plus de 300 kilomètres de géophysique 2D et de 35 km² de géophysique 3D. Environ 50 000 échantillons de roche ont été prélevés.
La roche argileuse a une perméabilité très faible, ce qui limite fortement les circulations d’eau à travers la couche et s’oppose au transport éventuel des radionucléides par convection (c’est-à-dire par l’entraînement de l’eau en mouvement). Cette très faible perméabilité s’explique par la nature argileuse, la finesse et le très petit rayon des pores de la roche (inférieur à 1/10 de micron). L’observation de la distribution dans la couche d’argile des éléments les plus mobiles comme le chlore ou l’hélium confirme qu’ils se déplacent majoritairement par diffusion et non par convection. Cette « expérimentation », à l’œuvre depuis des millions d’années, confirme que le transport des éléments chimiques se fait très lentement (plusieurs centaines de milliers d’années pour traverser la couche). Ces durées de transport constatées sont cohérentes avec celles estimées par simulation.
Les expérimentations menées au Laboratoire souterrain permettent également d’étudier l’impact de la construction et de l’exploitation d’un stockage sur le milieu géologique : impact lié au creusement des galeries, à l’introduction de matériaux exogènes tels que l’acier ou le béton, à l’effet de la chaleur générée par les déchets les plus radioactifs... La conception de CIgéo vise à limiter les perturbations engendrées et l’étude des processus physiques et chimiques permet de vérifier que ces perturbations induites sur la roche restent limitées. Elle fournit également des orientations pour la conception du stockage. L’Andra met également en place des démonstrateurs dans le Laboratoire souterrain, qui permettent notamment de comparer avec les résultats prévus par les simulations (par exemple la répartition du champ de température autour d’une alvéole simulant le stockage de déchets de haute activité) et de s’assurer que les prévisions des modèles sont cohérentes avec ce que l’on observe. Si Cigéo est autorisé, cette démarche sera poursuivie lors de la réalisation progressive du stockage.
Outre l’expérimentation, la validation des modèles passe également par l’étude d’analogues archéologiques ou naturels. Les laitiers de haut-fourneau du XVIe siècle, les blocs de verre issus d’épaves datant de l’Antiquité ou encore les verres basaltiques constituent par exemple des analogues du système « verre/métal/argile » soumis à une altération par l’eau. Bien que la composition chimique et les conditions d’altération de ces verres ne soient pas strictement identiques à celles des matrices utilisées pour vitrifier certains déchets radioactifs, leur étude permet de tester les modèles proposés et de progresser dans la compréhension des mécanismes d’altération. Concernant le comportement des radionucléides, les deux sites de réacteurs nucléaires naturels découverts à Oklo (Gabon) en 1972, celui de Bangombé en surface à 11 m de profondeur et celui d’Okélobondo à 420 m de profondeur, apportent des informations précieuses. Ces réacteurs naturels ont fonctionné il y a 2 milliards d’années, les conditions géologiques, et notamment la teneur du minerai en uranium 235, ayant provoqué une réaction en chaîne spontanée pendant plusieurs centaines de milliers d’années. Les travaux de caractérisation (analyses minéralogiques, chimiques et isotopiques) ont montré la très faible migration des radionucléides dans les conditions chimiques réductrices et en présence d’argile. Ils ont permis d’établir les mécanismes géochimiques qui ont prévalu à ce comportement et de tester les modèles de représentation associés.
La simulation numérique permet d’obtenir des résultats inaccessibles par l’expérience du fait de la complexité et de l’interaction des phénomènes à étudier ou des grandes échelles de temps et d’espace sur lesquelles ils se déroulent. Pour représenter les phénomènes que l’on veut étudier, on utilise des modèles physiques et mathématiques qui sont alimentés par des données acquises sur le terrain, en laboratoire et dans la littérature scientifique. Ces derniers servent à mener des expériences virtuelles qui, en temps réel, se dérouleraient sur des milliers à centaines de milliers d’années, ou à analyser des processus qui intéressent de très grands volumes de roche. Grâce aux outils qu’elle a développés, l’Andra peut étudier différents phénomènes liés, par exemple, à la chaleur, au déplacement de l’eau ou aux échanges chimiques et analyser comment les composants du stockage se comporteraient et évolueraient dans le temps. Ces modèles permettent également de tester des hypothèses de situations dégradées dans l’évolution du stockage. Les différents modèles ainsi que les codes de simulation numérique font l’objet d’inter-comparaisons. Cela contribue à la confiance dans leur validité et permet d’identifier le cas échéant les points de compréhension à approfondir. Ces travaux de comparaison sont menés à l’Andra et dans le cadre de projets internationaux. Les modèles proposés par l’Andra font également l’objet d’une évaluation indépendante par l’IRSN dans le cadre de l’instruction des dossiers de l’Andra. Cela concerne par exemple les modèles d’écoulements hydrogéologiques et de migration des radionucléides, qui sont au cœur des études de sûreté.
L’ensemble de ces travaux font l’objet de publications dans des revues à comités de lecture (50 à 70 publications scientifiques internationales par an depuis 10 ans) et sont évalués par des instances indépendantes, en particulier la Commission nationale d’évaluation, mise en place par le Parlement, et l’Autorité de sûreté nucléaire qui s’appuie sur l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Les grands dossiers scientifiques et techniques que l’Andra remet dans le cadre de la loi font l’objet, à la demande de l’Etat, de revues internationales sous l’égide de l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’OCDE. L’Andra a également été évaluée en 2012 par l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES). Enfin, des expertises sont régulièrement commandées par le Comité local d’information et de suivi du Laboratoire souterrain sur les grands dossiers de l’Andra ou sur des sujets plus ciblés.
C’est la convergence de l’ensemble de ces études qui permet d’apprécier la robustesse du stockage et de préciser les incertitudes résiduelles. L’analyse de sûreté intègre la connaissance acquise et les incertitudes afin de produire une évaluation pénalisante de l’impact du stockage. Les études menées par l’Andra ont montré que l’impact du stockage serait nettement inférieur à celui de la radioactivité naturelle à l’échelle du million d’années.
QUESTION 748 - Sûr et certain?
Posée par Julien BORNE, L'organisme que vous représentez (option) (ROCHEFORT), le 14/12/2013
Un enfouissement sûr et certain, absolument garanti, qui jamais, jamais ne saurait être menacé par quoi que ce soit, un phénomène naturel ou une erreur humaine est-il possible? Pas question de laisser une seule minuscule chance à ces déchets de quitter leur enceinte de confinement et venir polluer nos sols, que ce soient les notres ou ceux de nos enfants, petit-enfants, arrière...
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est donc de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
C’est une des raisons qui a conduit, en 2006, le Parlement à retenir la solution du stockage profond.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montre que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 747 - Etes vous sérieux ?
Posée par Stéphanie RAMILLIEN, L'organisme que vous représentez (option) (LUSIGNY), le 14/12/2013
Continuer de produire des déchets hautement radioactifs, alors même qu'aucun scientifique ne peut assurer aujourd'hui la sécurité d'une installation telle que le projet CIGEO. Ne pensez vous pas qu'il est plus qu'urgent de reconnaitre devant le peuple français que l'ANDRA n'a pas de solution convenable à ce jour pour la saine gestion des déchets HAVL ? Nous avons le droit de savoir pour choisir et organiser une politique énergétique adaptée à notre réalité écologique. Pouvez vous dormir sur vos deux oreilles en sachant quel héritage mortifère vous laissez là sous les pieds de nos descendants ?
Réponse du 10/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 746 - et après ?
Posée par françoise THOREL, L'organisme que vous représentez (option) (ROUEN), le 14/12/2013
comment se comporteront ces déchets ultra dangereux dans des centaines d'années ? comment laisser la trace pour les générations à venir, comment feront les populations locales quand les nappes phréatiques seront contaminées?
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Comment laisser la trace pour les générations à venir ?
L’objectif fondamental de Cigéo est de protéger l’homme et l’environnement des déchets radioactifs sur de très longues échelles de temps. La sûreté à long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. C’est une des raisons qui a conduit, en 2006, le Parlement à retenir la solution du stockage profond. En effet, cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli, contrairement à l’entreposage. En cas de perte complète de la mémoire du stockage, une intrusion inopinée à 500 mètres sous terre apparaît peu plausible, du moins sans un minimum d’investigations préalables. L’Andra évalue cependant par précaution dans son analyse de sûreté les conséquences d’un forage à travers le stockage pour vérifier que le stockage resterait sûr.
Malgré cette robustesse du stockage même en cas d’oubli, l’Andra conçoit Cigéo avec l’objectif d’en conserver la mémoire et de la transmettre aux générations futures le plus longtemps possible. Des solutions d’archivage de long terme existent pour les centres de stockage de surface exploités par l’Andra et font l’objet de revues périodiques. Le retour d’expérience montre que ces solutions paraissent robustes pour au moins les 500 premières années. Ainsi, pour Cigéo, l’Andra prévoit qu’un centre de la mémoire perdurera sur le site. Il pourra accueillir le public et comprendra notamment les archives du Centre. De manière générale, le maintien de la mémoire doit aussi impliquer les acteurs locaux, qui peuvent prendre le relai en cas de défaillance de l’Andra ou de l’État. L’Andra veille d’ores et déjà à les informer sur les enjeux associés à la mémoire et étudie avec des anthropologues, des philosophes ou encore des artistes les facteurs qui peuvent favoriser la transmission de la mémoire. La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
En tout état de cause, comme il est impossible de garantir notre capacité à communiquer avec des êtres vivant dans plusieurs milliers d’années, c’est chaque génération qui aura la responsabilité de contribuer à transmettre cette mémoire aux générations suivantes.
Comment se comporteront ces déchets ultra dangereux dans des centaines d'années ? comment feront les populations locales quand les nappes phréatiques seront contaminées?
On trouve plusieurs nappes d’eau souterraines dans le sous-sol du site retenu pour Cigéo, à différentes profondeurs. La plus en surface est la nappe phréatique présente dans les calcaires du Barrois, reposant sur une couche de roche imperméable située seulement à quelques dizaines de mètres sous le sol. D’autres nappes sont présentes dans des formations calcaires plus profondes. Moins accessibles, offrant des caractéristiques moins intéressantes, elles ne sont pas exploitées localement. Mais en termes de sûreté, l’Andra y accorde la même attention que pour la nappe phréatique (car elles sont exploitées ailleurs dans le bassin parisien, à plusieurs kilomètres ou dizaines de kilomètres de là).
Outre le confinement de la radioactivité assuré par la couche d’argilite, l’Andra a prévu des dispositions spécifiquement destinées à protéger ces nappes d’eau souterraines, notamment :
- En surface, les installations nucléaires de Cigéo seront implantées bien au-dessus du niveau de la nappe phréatique en cas d’une éventuelle remontée exceptionnelle du niveau de celle-ci. Les installations seront protégées (rabattement des eaux, étanchéité des bâtiments…) conformément à la réglementation.
- Au niveau des infrastructures reliant l’installation souterraine à la surface (descenderies, puits), il est prévu de mettre en place un dispositif d’étanchéité au niveau des ouvrages qui traverseront les nappes phréatiques souterraines de manière à bien isoler physiquement celles-ci de l’installation.
- Le génie civil intègre aussi dans sa conception la mise en place d’un drainage permettant d’assurer une collecte et un suivi des eaux collectées dans un réseau prévu à cet effet, faisant l’objet d’entretien et de mesures périodiques. La collecte s'effectue par des goulottes intégrées et déployées sur tout l'ouvrage souterrain.
Ce ne sont que quelques-unes des dispositions visant à confiner la radioactivité des déchets.
Après la fermeture du stockage, au-delà de la durée de vie des ouvrages industriels, la couche d’argile très peu perméable, de plus de 130 mètres d’épaisseur, dans laquelle sera installé le stockage souterrain, servira de barrière naturelle pour retenir les radionucléides contenus dans les déchets et freiner leur déplacement. Le stockage permet ainsi de garantir leur confinement sur de très longues échelles de temps. Seuls quelques-uns de ces radionucléides, les plus mobiles et dont la durée de vie est longue, pourront migrer de manière très étalée dans le temps. Ils ne sortiraient pas de cette couche avant 100 000 ans et atteindraient en quantités extrêmement faibles la surface et les nappes phréatiques. Leur impact radiologique serait alors plusieurs dizaines de fois inférieur à la radioactivité naturelle (qui est de 2,4 mSv par an en moyenne en France).
Dans une démarche prudente, l’Andra dans son évaluation d’impact sur l’homme et l’environnement à long terme suppose que les eaux de ces couches pourraient être captées par forage et utilisées pour des usages du type de ceux qui peuvent être pratiqués aujourd’hui (jardin, boisson, abreuvement des animaux). Les études montrent que, même dans ce cas, l’impact du stockage reste inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire et ne présente pas de risque pour la santé.
QUESTION 745 - Provision pour risques et maintenance
Posée par Luc DEGRYSE, L'organisme que vous représentez (option) (BRUXELLES), le 14/12/2013
Pouvez-vous me préciser comment ont été évalués les coûts de stockage, sur quelle période, et quel montant sera provisionné, quand et comment, pour les assumer ? A-t-il bien été tenu compte de la durée de vie des déchets, ainsi que de, la reconstruction périodique indispensable des installations? Je ne doute pas que les gestionnaires de ce projet auront pris en compte tous ces paramètres dans leurs calculs. Aussi est-il essentiel qu'ils les précisent et les soumettent en toute transparence aux premiers intéressés : la population et les générations futures. NE PAS LE FAIRE constituerait de fait, un AVEU DE TROMPERIE. Mais j'ai confiance, car je doute que quiconque puisse se rendre coupable ou complice de tels actes criminels.
Réponse du 28/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’Andra a lancé en 2012 les études de conception industrielle du projet Cigéo. Ces études se fondent sur les grands principes retenus après 20 années de recherche pour assurer la sûreté à long terme du stockage. L’Andra s’appuie sur des ingénieries spécialisées qui apportent leur retour d’expérience sur d’autres grands projets industriels. Sur cette base, un nouveau chiffrage est en cours d’élaboration. Ce chiffrage sera finalisé en 2014 pour prendre en compte les pistes d’optimisation identifiées en 2013, les recommandations des évaluateurs et pour intégrer les suites du débat public. Les études de conception industrielle se poursuivront ensuite. A chaque étape, les études d’ingénierie seront plus détaillées et le chiffrage du projet sera de plus en plus précis.
Le coût du stockage couvre la mise en sécurité définitive de tous les déchets HA et MAVL, existants et futurs, produits par l’ensemble des installations nucléaires françaises existantes ou en construction (EPR Flamanville, ITER). Ces déchets sont produits depuis une cinquantaine d’années et vont continuer à être produits par les installations nucléaires existantes jusqu’à leur démantèlement.
Les investissements liés à Cigéo seront importants pendant toute la durée d’exploitation du stockage, prévue pour durer une centaine d’année :
- Si Cigéo est autorisé, la construction des installations pourrait débuter en 2019, pour aboutir en 2025 à un ensemble industriel comportant deux zones distinctes en surface (installations nécessaires pour la réception, le contrôle et la préparation des colis avant leur stockage / installations support aux travaux), les liaisons entre la surface et le souterrain (descenderies, puits), un premier réseau de galeries souterraines et des premières alvéoles de stockage MAVL et HA0. Le coût de ce premier investissement est de l’ordre de quelques milliards d’euros et un travail est en cours afin d’examiner la possibilité d’optimiser certains investissements.
- De 2025 à 2075, en parallèle des activités d’exploitation, il y aura construction progressive de nouvelles alvéoles de stockage MAVL, au fur et à mesure des besoins. Pour donner un ordre de grandeur, leur coût de construction est de l’ordre de 30 millions d’euros par alvéole de stockage (500 m). Il y en a une cinquantaine à construire en 50 ans.
- A partir de 2070 il faudra construire de nouvelles installations de surface pour réceptionner les colis HA et construire les infrastructures pour la zone de stockage HA. La mise en stockage des colis et la construction des alvéoles se poursuivront en parallèle pendant 50 ans.
C’est l’évaluation du coût de toutes ces phases successives, avec des phases de maintenance à prévoir, la reconstruction périodique de certaines installations (jouvence) ainsi que le démantèlement des installations de surface et la fermeture des installations souterraines, qui fait l’objet des études de chiffrage en cours. L’évaluation du coût du stockage correspond à des dépenses pendant plus de 100 ans : les études, la construction des installations en surface et en souterrain, la fourniture des équipements, le personnel, la maintenance, l’électricité, les assurances, les impôts, les taxes…
L’évaluation de tous ces coûts sur plus de 100 ans est forcément un travail complexe. La première étape consiste à définir les plans de l’installation. Ensuite, on examine les coûts élémentaires, par exemple le coût de creusement de 1 mètre de galerie souterraine, et les quantités. Pour vérifier les coûts élémentaires, on compare à d’autres projets et on doit examiner à chaque fois dans quelle mesure un retour d’expérience sur un autre chantier est transposable ou pas au cas de Cigéo. Ensuite, il faut consolider le coût de chaque sous-ensemble : les installations de surface, l’installation souterraine… Il faut également calculer le coût de construction, de maintenance sur 100 ans, les coûts d’exploitation, de démantèlement et de fermeture… Le coût du projet dépend également de l’inventaire des déchets à stocker et des conditions économiques (par exemple le coût de l’acier et du béton).
Après la fermeture du stockage, la sûreté sera assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Une surveillance du site pourra néanmoins être maintenue aussi longtemps que la société le souhaitera et des actions seront menées pour conserver et transmettre la mémoire du stockage.
Le chiffrage officiel arrêté par l’Etat en 2005 au stade des études de faisabilité scientifique et technique était d’environ 15 milliards d’euros (coût brut non actualisé). En 2009, l’Andra a réalisé une estimation préliminaire d’environ 35 milliards d’euros avant le lancement de la phase de conception industrielle et des optimisations en cours d’étude. Le travail d’études d’optimisation et de prise en compte des suites du débat du public se poursuivra jusqu’à l’été 2014. Le processus d’arrêt d’une nouvelle évaluation par le ministre chargé de l’énergie comprendra ensuite une phase de consultation, avec le recueil de l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et des observations des producteurs de déchets, à l’issue de laquelle le ministre rendra publique la nouvelle estimation arrêtée par l’Etat. Les producteurs de déchets prennent en compte ces dépenses futures sous forme de provisions calculées sur la base d’un coût de référence arrêté par le ministre chargé de l’énergie, comme le prévoit la loi du 28 juin 2006.
QUESTION 744 - Enfouissement
Posée par Henriette CASSABOIS, COMITÉ PARTI DE GAUCHE DE BESANÇON, le 14/12/2013
Qui peut assurer qu'il n'y a ou n'y aura aucune faille et fuite radio active dans les fosses d'enfouissement des déchets nucléaires ?
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
A propos de la présence de faille. Le site d’implantation de Cigéo (située à l’Est du Bassin de Paris) est à l’écart des zones actives où se produisent les jeux de failles qui absorbent le rapprochement des continents Afrique et Europe. Les mouvements tectoniques de grande amplitude et forts séismes qui en découlent se localisent pour l’essentiel en Méditerranée et dans les chaines de montagnes qui la bordent, et pour le reste (résidu) au niveau des grandes failles qui affectent la plaque européenne, comme les failles du fossé d’Alsace et des Vosges en bordure Est du bloc stable que constitue le Bassin de Paris. Ce dernier compte parmi les régions les plus stables du globe. Il est quasiment asismique avec des taux de déformations extrêmement faibles à l’échelle des temps géologiques, comptés en millions d’années.
L’analyse des directions et vitesses de déplacements relatifs des stations GPS installées en Europe, confirme que le Bassin de Paris constitue un bloc rigide et que les déformations (de faible amplitude) se font à ses frontières, comme le souligne la répartition des séismes. En conséquence, seules les failles majeures qui existent déjà sont susceptibles de glisser, avec des mouvements de très faible amplitude, par à-coups séparés dans le temps par plusieurs dizaines à centaines de milliers d’années.
C’est ainsi que la zone de 30 km² étudiée pour l’implantation de l’installation souterraine est, au plus proche, à 1,5 km du fossé de Gondrecourt, et à 6 km du segment le plus proche du système des failles de la Marne (le fossé de la Marne étant lui-même est à 14 km). Les analyses cartographiques montrent l’absence de mouvements de ces failles au cours des derniers millions d’années. Les derniers mouvements tectoniques du fossé de Gondrecourt datent de 20 à 25 millions d’années (datations de cristaux de calcite) ; les derniers mouvements des failles de la Marne sont du même âge ou plus anciens. La réalisation d’une écoute sismique dont le seuil de détection est très bas, et qui discrimine sans ambiguïté séismes naturels et tirs de carrières, permet d’affirmer l’absence de toute activité sur ces failles. En accord avec la réglementation en vigueur concernant la sûreté des installations nucléaires, les ouvrages de stockage sont toutefois dimensionnés pour résister aux séismes maxima physiquement possibles que pourraient générer ces failles si elles redevenaient actives dans le futur.
L’objectif fondamental de Cigéo est de confiner la radioactivité des déchets sur de très longues échelles de temps. Tout est mis en œuvre pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. Tous les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation sont identifiés en amont de la conception. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier.
QUESTION 743
Posée par Maurice MICHEL, le 17/12/2013
QUESTIONS POSÉES LE 14 DÉCEMBRE 2013 PAR MAURICE MICHEL, INSPECTEUR GÉNÉRAL HONORAIRE DES AFFAIRES SOCIALES, PRÉSIDENT DE L’ASODEDRA (Association pour la sensibilisation de l'opinion sur les dangers de l'enfouissement des déchets radioactifs - 88350 GRAND)
« _Pourquoi débat-on ? Débat-on pour débattre, pour satisfaire à de simples obligations formelles d'ordre démocratique ou le débat doit-il aussi éclairer, enrichir la décision »_ [publique] ?
In CNRS / MSH Alpes, cahiers N° 5 - février 2006 « Recherche et déchets nucléaires, Une réflexion interdisciplinaire »
Le débat « public » de 2013 sur le puits de Bure, un débat tronqué
Les « dernières » questions que nous posons n'abordent pas le péché originel du débat public versus 2013. Il faut se rappeler en effet que le débat de 2005/2006 a conduit à l'humiliation des participants, les pouvoirs publics ayant ignoré, dans les décisions qu'ils ont prises, les principales conclusions des discussions telles qu'elles furent synthétisées en févier 2006. Cela a engendré frustration, colère et méfiance dont l'organisateur du débat public (CPDP) a peu tenu compte. Avant d'ouvrir le débat, il fallait le purger de cette faute originelle, c'est-à-dire adopter un moratoire sur le projet de creusement du puits de Bure et affirmer qu'il sera tenu compte des orientations dégagées par le débat dans la synthèse effectuée par la Commission.
Cela n'a pas été fait, cela n'a pas été proposé par la Commission particulière du débat public en dépit de nos demandes, faites au moment où on pouvait encore sauver la démarche d'un désastre annoncé. La Commission, par sa frilosité, porte ainsi une part de responsabilité dans l'échec de l'exercice. Pour tenter de justifier l'échec du débat, et donc aussi le sien, la Commission met en avant le boycott du débat décidé par la majorité des associations de défense de l'environnement opposées au projet alors qu'elle devrait, à notre sens, plutôt se pencher sur ses propres déficiences.
Comme la tonalité de nos questions le montre, nous sommes déçus et insatisfaits de la préparation, de l'organisation et du déroulement du débat. Nous attendons les réponses de la Commission qui, nous a dit le président, doivent être faites avant le 15 janvier 2014. Nous lui avons indiqué que nous nous engageons à formuler nos commentaires en retour avant le 15 février 2014 et que nous serions amenés à considérer que ce serait un nouveau manquement aux règles démocratiques que de ne pas accepter leur publication.
Quelques unes de nos questions peuvent être marquées au coin d'un certaine redondance. Nous en acceptons la remarque.
PRÉPARATION ET ORGANISATION DU DÉBAT
*Les membres de la CPDP et leur expérience ont été correctement présentés au public. Peut-on nous expliquer la correspondance entre, d'une part, la composition de la Commission ainsi définie, d'autre part, les enjeux de société du débat et les attentes du public ?
*On peut comprendre, compte tenu de l'ampleur des craintes provoquées outre Rhin par la proximité du puits de Bure, la nomination d'une personnalité allemande au sein de la Commission. Mais, n'aurait-il pas été utile d'expliquer aux Lorrains et aux Champenois les objectifs poursuivis par le choix d'une « oecotrophologue » ?
*Le choix d'un Inspecteur général de l'agriculture, retraité, expérimenté dans l'animation de débats publics locaux aux enjeux certes importants, mais limités, comme président de la commission a-t-il envoyé un signal positif aux populations locales, même si chacun s'accorde à reconnaître son urbanité consommée ? L'ampleur des enjeux ne justifiait-elle pas la désignation d'une personnalité d'envergure nationale pour présider la commission ?
*A-t-on eu la préoccupation, lors de la nomination de ses membres, d'éviter l'écueil du « parisianisme » ? Si oui, comment cette préoccupation s'est-elle manifestée ? Quelle place respective a-t-on réservé à la représentation des Lorrains et Champenois dans la composition de la commission ? La présence d'un Lorrain en son sein, fût-il de qualité, n'est-elle pas un alibi ?
*Pourquoi ne pas avoir expliqué en quoi la composition de la commission donnait toutes garanties de compétence ? Quelle formation ou quelle sensibilisation (objectifs, durée, contenu et progression pédagogiques) a-t-elle été dispensée aux membres de la commission ?
*Est-il admissible que la Commission ignorât au départ que le site de Bure était appelé à accueillir également des déchets faiblement actifs et à vie longue ?
*La signature d'une charte de déontologie était-elle suffisante pour garantir au public l'indépendance, la neutralité et l'impartialité de ses membres ? En quoi la composition de la commission et le profil de ses membres apportaient toutes assurances en la matière ?
*La commission affirme avoir préparé le débat. Elle a, certes, participé à sa préparation. En fait, la responsabilité de la préparation du débat a été laissée à l'Andra, aidée par les organismes de contrôle. Pourquoi ? Pourquoi ne pas l'avoir confiée à un organisme indépendant, voire à un organisme choisi par la Commission ?
*Le transport des déchets radioactifs a été évoqué et reconnu, en présence du président de la CPDP, au cours des discussions préparatoires au débat public organisées par l'Andra comme un thème majeur. Pourquoi ce thème n'a-t-il pas été d'emblée inscrit par la Commission en mai 2013 au nombre des principaux sujets à traiter au cours du débat ?
*Les questions de risques d'accident, de sûreté et de sécurité ont été abordées par des ingénieurs. Mais n'est-il pas étonnant, eu égard aux enjeux de santé publique du projet, de ne pas avoir organisé un débat sur la santé de la population et les moyens de la préserver ? Avec des représentants du milieu médical étrangement absents du débat?
*N'a-t-on pas confondu neutralité et banalité ? Fallait-il au départ, dans les annonces publiques, minimiser à l'excès le rôle final de la Commission au risque de renforcer le sentiment de l'inutilité du débat ? Au lieu de répéter à l'envi qu'elle n'avait qu'un rôle de « notaire », qu'elle se contenterait de prendre une photographie, la Commission ne pouvait-elle au contraire affirmer qu'elle donnerait du sens à ses conclusions, qu'elle ferait une synthèse intelligente des débats, à l'instar de la Commission du précédent débat de 2005/2006 ?
*Au vu des suites apportées (ou plutôt non apportées) à la principale conclusion du débat de 2005/2006, que pense la Commission de la déclaration en novembre 2013 de la représentante de l'ÖKo Institut sur le débat de 2013 : « _comme pour toutes les mesures permettant la discussion et la participation, il est important d'expliquer clairement en quoi les arguments et les résultats de ces débats influent sur le projet et les décisions à prendre_ » ?
*Le principe de transparence est ainsi énoncé : « _toute l'information disponible sur le sujet en débat est publique. La CPDP veille à sa clarté et à son accessibilité_ ». Dés lors, comment peut-on expliquer que sur le site Internet de la Commission, celle-ci n'y a porté au départ dans la rubrique « S'informer » que des documents émanant d'organismes publics compte tenu de la richesse et de la diversité documentaire du sujet (comptes-rendus de colloques, documents du comité local d'information et de suivi du laboratoire de Bure, etc.) ? Est-il conforme au principe d'équivalence et à celui du contradictoire que dans le dossier de base le public fût renvoyé à une seule source d'informations alimentée par les seuls institutionnels du « bloc » nucléaire?
*Comment expliquer qu'il a fallu batailler plusieurs semaines pour obtenir que le rapport de la commission d'enquête publique de 2010 fût communiqué puis enfin publié à notre demande sur le site ? [Au passage, nous saluons la compétence, précieuse, de la secrétaire de la CPDP, Mme Wu].
*La Commission devait-elle accepter le principe et le déroulement d'une table ronde sur les coûts et le financement du projet sans avoir vérifié auparavant l'existence d'une proposition de chiffrage par l'Etat et/ou le maître d'ouvrage ? Comment discuter en 2013 de chiffres qui ne seront annoncés qu'en 2014 ?
*Il n'a échappé à personne le déséquilibre majeur qui existe entre les acteurs du dossier : d'un côté, la « puissance de feu » de l'industrie nucléaire, et plus largement du « bloc nucléaire » (services de communication étoffés, moyens financiers quasi illimités, frais de publicité dépensés sans compter, une palanquée de scientifiques…), de l'autre, la société civile et ses représentants. Considérer les deux groupes sur un pied d'égalité au nom du principe d'équivalence, n'est-ce pas adopter un comportement de déséquilibre au détriment du plus faible ? Traiter en égaux des inégaux, c'est aggraver l'inégalité. Pourquoi ne pas avoir dissocié, en expliquant cette « discrimination positive », les participations des institutionnels, des professionnels du nucléaire, d'un côté, et celles du « grand public », de l'autre ?
*N'a-ton pas pris le risque du reproche de complaisance quand on siège quasi-systématiquement, sur la tribune, à côté des représentants du maître d'ouvrage dans les séances publiques de préparation du débat ? Quand on interpelle ses représentants ou qu'on les présente par l'expression _« nos amis de l'Andra_ » ? Un débat public n'est pas un combat et nos observations ne sont pas des griefs, mais au regard de l'exaspération des populations locales et de l'incandescence des esprits, n'aurait-on pas dû éviter ces comportements à tout le moins maladroits ?
GESTION ET FONCTIONNEMENT DU DÉBAT
*Comment peut-on expliquer que la commission nationale du débat public (CNDP), garante du processus participatif, informée et saisie à plusieurs reprises par notre association des déficiences et des insuffisances du débat public ainsi que des dérives de la CPDP n'ait jamais pris la peine de répondre, fut-ce simplement pour en accuser réception ? Est-ce conforme à sa mission ? Est-ce conforme à la courtoisie administrative ?
*Pourquoi les tables rondes d'experts sur Internet ont-elles répondu à une organisation dispensatrice d'autant d'ennui ? Faut-il nécessairement qu'un débat soit triste pour être sérieux ?
*Comment peut-on affirmer respecter le principe du contradictoire quand la composition de plusieurs tables rondes sur Internet a été aussi déséquilibrée ? Par exemples, un seul contradicteur a participé aux tables rondes du 11/07/2013, du 23/09/2103 et du 13/11/203 ; la table ronde sur la « comparaison des expériences internationales » est à ce titre une caricature du débat contradictoire : 1 expert indépendant pour 10 experts acquis par nature à la solution de l'enfouissement !
*Pourquoi la Commission s'est-elle exonérée des règles du débat (délais de réponse, identification des participants, etc.) après les avoir publiées et pourquoi n'a-t-elle pas assuré leur respect par le maître d'ouvrage ?
-« _la commission et le maître d'ouvrage s'engagent à apporter leurs réponses dans les meilleurs délais, et sous quatre semaines_ ». Pourquoi fin novembre comptait-on encore des questions du mois de juillet restées sans réponse ? Pourquoi les réponses données à nos questions l'ont été avec un retard systématique et anormalement long ? Parfois, au vu du contenu de la question, on se demande si la longueur du délai apporté à y répondre ne relève pas de la faute professionnelle (voir question/réponse n° 321 par exemple ou encore la question 625) ?
-« _le modérateur s'engage à informer par e-mail l'auteur d'un message de sa publication, de son éventuelle modification ou de son refus_ ». Pourquoi la Commission n'a-telle pas publié, sans un mot d'explication et malgré nos demandes réitérées, notre message critique du 17 août 2013 et nos questions ? Sur quoi s'est-elle fondée pour s'ériger en censeur des positions exprimées avec vivacité mais correction par une association de citoyens ? Son contenu était-il, par exemple, moins acceptable que celui de la question 480 ? Pourquoi ne nous avoir donné aucune explication ?
*« _Tout sera mis sur la table_ » (interview du président de la Commission). Dés lors, comment peut-on expliquer qu'à la question de savoir la liste des localités traversées par les convois ferroviaires de déchets entre leurs lieux d'entreposage actuels et Bure il nous a été répondu que c'était confidentiel défense, sans réaction ni commentaire de la CPDP ?
*Notre association a posé la veille de l'émission à la table ronde Internet consacrée au transport des déchets nucléaires deux questions courtes adaptées au format de l'exercice. Sur proposition de la représentante de la Commission, ce ne sont pas ces questions courtes qui ont été posées, mais une question longue datant de plusieurs mois et rédigée spécialement pour l'écrit. Pourquoi avoir orienté de manière captieuse le choix de l'animatrice du débat, sachant que la responsabilité de cette dernière n'est pas en cause ? Alors que le maître d'ouvrage avait déjà répondu par écrit à notre question qu'il ne pouvait pas y répondre (sic), pourquoi ne pas l'avoir dit à l'antenne ?
*A l'inverse, pourquoi la Commission a-t-elle publié des questions et avis à l'authenticité douteuse ? (voir les pseudonymes farfelus utilisés sur le site : REMIFASOL, le prisonnier, Mme Irma, M. Geotrouvetout, Marie Curie de Bure, émetteur Alpha, etc.). Ne pouvait-elle pas exercer un contrôle _a minima_ pour éliminer, en justifiant à chaque fois son choix, les vraies « fausses-questions », les contributions anonymes non vérifiables, les questions déposées à l'évidence par des relais complaisants du promoteur pour faire du « chiffre » ? La Commission n'aurait-elle pas pu jouer un rôle de certificateur ?
*La Commission a pris l'initiative de transformer en questions publiées sur son site, et décomptées comme telles, des interrogations contenues dans des participations d'autre nature au débat public (tables d'experts sur Internet, avis, cahiers d'acteurs, etc.), pour permettre dit-elle de leur donner une réponse. Quand on sait les délais de réponse, cette explication est peu convaincante. La Commission n'a-elle pas cédé à la tentation du chiffre pour étoffer un bilan quantitatif bien maigre ?
*Nombre de questions, avis, cahiers d'acteurs et autres contributions émanent explicitement d'établissements du nucléaire ou de leurs satellites au sein desquels le promoteur du projet, le décideur, c'est-à dire l'Etat, est majoritaire (outre l'ANDRA, AREVA, EDF, CEA, etc.), ou de salariés ou d'anciens salariés de ceux-ci ou encore d'associations composées de leurs représentants et/ou financées par eux (SFEN, Sauvons le Climat, etc.). En publiant ces contributions, sans explication et sans information du grand public sur leur origine, la Commission a-t-elle respecté le principe de neutralité ? Le souci d'impartialité et d'objectivité ne lui imposait-il pas d'informer le grand public des liens d'endogamie entretenus par ces participants singuliers au débat et de leur positionnement officiel par rapport au débat ?
*La Commission a fait état, fin novembre, d'environ 1000 questions et avis enregistrés. En vérifiant les données que doivent fournir les auteurs des questions et des avis, elle a la possibilité de repérer leur origine. Combien de questions et d'avis en provenance de sources relevant du « milieu nucléaire » a-t-elle identifiés ?
*Pourquoi la Commission a-t-elle « corrigé » (ou modifié) des questions des participants sans les aviser préalablement et surtout sans appliquer le même régime aux réponses de l'Andra, y compris celles qui, par simple construction syntaxique, sont des contre-vérités ? Ou celles qui éludent franchement la question posée (les modalités selon lesquelles l'Andra a traité notre question sur le stockage des verses de Bure sont assez significatives) ? La Commission ne devait-elle pas, dans ces cas, réagir vis-à-vis du maître d'ouvrage et en informer le questionneur ?
* Si on a veillé à ce que le débat ne soit pas tronqué, comment peut-on expliquer certains enchaînements « providentiels », par exemples les avis 131 et 132 posés le même jour ? Comment croire qu'il s'agit du fruit du hasard ?
*Peut-on laisser publier à titre d'exemple l'avis 320 sans donner aucun repère aux lecteurs d'apprécier objectivement l'ambigüité du positionnement de son auteur (M. Boiron) ?
*Est-ce bien conforme au principe de neutralité et à tout le moins n'est-ce pas maladroit que de répondre à notre question de savoir si la CPDP connaissait des associations locales pro-enfouissement que, certes, elle n'en connaît pas, mais qu'en revanche, il existe quelques associations nationales favorables à l'enfouissement et qu'elle communique sans précaution les coordonnées d'entités notoirement liées au « lobby nucléaire » (voir question/ réponse N°203) ? Naïveté ou provocation ?
*Dans le dispositif Questions/ Réponses, pourquoi avoir tant tardé pour donner la parole en réponse à des experts indépendants ?
*De manière plus générale, quelles sont les raisons de la réactivité essoufflée de la Commission qui a souvent laissé le sentiment qu'elle était débordée par le sujet qui lui a été confiée ?
*La Commission a engagé un partenariat avec la presse locale, c'est une bonne initiative, mais, sans chercher à désobliger quiconque :
-comment a-t-elle préalablement évalué l'indépendance des organes de presse qu'elle a retenus ? S'est-elle renseignée sur les liens éventuels entre le maître d'ouvrage et les médias choisis ? A-t-elle réalisé, par exemple, une analyse rapide des 50 derniers articles qu'ils ont publiés sur le sujet pour se faire une idée personnelle de leur positionnement respectif ?
-pourquoi la Commission n'a-t-elle pas réagi quand un organe de presse a modifié la question posée par un participant ? N'est-ce pas ce faisant admettre un biais dans le débat ?
-s'agissant d'un thème sociétal qui déborde la géographie locale, ne pouvait-on organiser un partenariat au niveau national, avec des medias nationaux ?
*La CPDP, relayée par la CNDP, a déclaré à plusieurs reprises que les objectifs du débat ont été atteints ? Cette affirmation, appuyée sur des chiffres de participation ridiculement faibles quand on les compare au nombre de personnes concernées, ne relève-t-elle pas d'une autosatisfaction plutôt déplacée ? Il a fallu attendre le 12 décembre 2013 pour qu'un membre de la Commission parle enfin « d'échec ». Ne devait-on pas faire preuve d'un peu plus d'humilité ?
Réponse du 15/01/2014,
Présentation et organisation du débat
1. Le choix des membres de la CPDP effectués par son président a répondu aux principes et règles de base en la matière de débat public. Les membres d’une CPDP peuvent n’avoir aucune expérience préalable en matière de débat public (ici un seul des 5 membres avait déjà une expérience de débat public), de même qu’ils peuvent n’avoir aucune compétence dans le domaine du projet soumis au débat favorisant ainsi la proximité avec le positionnement du public en général, évitant de trop se focaliser sur les aspects purement techniques du projet et garantissant leur neutralité sur le sujet traité. Les qualités requises sont notamment la disponibilité, la capacité d’adaptation, un tempérament ouvert, une bonne aptitude à l’écoute et le sens de l’équité. Dans ce débat les membres de la CPDP ont eu à montrer à de nombreuses reprises qu’ils possédaient manifestement ces qualités. Le président a veillé à respecter le principe de la parité et à s’entourer de personnes aux profils diversifiés.
2. La diversité des formations et profils professionnels des membres de la CPDP a permis d’avoir une approche diversifiée et riche du projet soumis au débat public. Il va sans dire que la formation académique des membres ne résume pas leur personnalité, leur intelligence du sujet et leur apport au processus de débat public.
3. Les qualités d’écoute et de concertation du président de la CPDP nommé par la CNDP sont reconnues unanimement. Son indépendance d’esprit et la pugnacité dont il a fait preuve dans la conduite de ce débat difficile ont permis de recueillir un nombre important de contributions, positions favorables ou opposées au projet. Comment croire dans le contexte actuel de défiance vis-à-vis de l’Etat, des représentants élus, que la seule désignation d’une personnalité d’envergure nationale aurait modifié le déroulement de ce débat. L’ensemble des contributions disponibles sur le site du débat montre clairement que le public qui a participé au débat a parfaitement saisi l’ampleur des enjeux liés au projet Cigéo.
4. Le projet Cigéo est un projet d’envergure nationale qui s’adresse à tous les français et engage les générations futures. Le débat public vise à recueillir les préoccupations du public, à faire en sorte que le maître d’ouvrage puisse apporter tous les compléments d’information souhaités par les participants au débat. On peut voir au travers des différentes contributions mises en ligne sur le site du débat que ce projet a effectivement conduit à une participation qui va bien au-delà de la Meuse et la Haute Marne. La CPDP s’est cependant largement mise à disposition des territoires où est prévue l’implantation du projet : en rencontrant en préalable au débat les différents acteurs locaux, en implantant son siège à Bar-le-Duc, en diffusant à plus de 180 000 foyers de Meuse, Haute Marne et nord des Vosges et de manière régulière toutes les informations nécessaires au suivi du débat et en leur donnant toute facilité pour pouvoir y participer s’ils le souhaitaient. L’enquête réalisée par la CDNP au cours du débat a montré que les meusiens et les haut-marnais considèrent avoir été bien informés sur le projet.
5. La composition de la commission répond comme indiqué en réponse à la question n°1 aux règles édictées par la Commission Nationale du Débat Public. La diversité des profils de ses membres, la variété de leurs expériences, leur disponibilité, leurs qualités d’écoute, leur neutralité offrent les garanties nécessaires à un débat public d’une telle complexité. Les membres de la CPDP ont reçu les cahiers de méthodologie et le bilan établis pour les 10 ans du débat public. Ils ont participé collectivement à un certain nombre de réunions d’information avec les différents acteurs et notamment les organismes de contrôle, assisté à plusieurs auditions au parlement, participé à plusieurs colloques et visité deux centres de stockage ainsi que la centrale nucléaire de Chooz. Ils ont bénéficié des connaissances acquises par le président de la CPDP au cours de 5 débats auxquels il avait participé auparavant.
6. La CPDP a eu de nombreuses réunions avec le maître d’ouvrage dans la phase d’élaboration du dossier du maître d’ouvrage afin que le dossier puisse répondre aux attentes du public. Le dossier, diffusé lors du lancement du débat, précise en page 15 l’éventualité d’une prise en charge dans Cigéo de déchets FAVL. Dès le début du débat public l’information était donc disponible pour tous.
7. La première des garanties offertes par les membres de la CPDP concernant leur neutralité, indépendance et impartialité est de n’avoir aucun lien présent ou passé avec le maître d’ouvrage et l’opération. Le comportement de la CPDP vis-à-vis des parties prenantes durant la préparation du débat, pendant son déroulement a confirmé ces engagements. Les membres de la CPDP se sont engagés y compris pour la suite du débat à s’abstenir d’exprimer toute opinion sur le fonds du projet soumis à débat.
8. Les missions de la Commission Nationale du Débat Public sont régies par l’article L.121.1 du code de l’environnement. Au-delà d’un seuil la saisine par le maître d’ouvrage est obligatoire. La loi a fixé une procédure qui indique au maître d’ouvrage, quel qu’il soit, les éléments à adresser à la CNDP. C’est à partir du dossier adressé par le maître d’ouvrage que la CNDP va former son jugement et prendre la décision d’organiser un débat public. Après examen du dossier la CNDP peut décider : la tenue d’un débat public animé par une CPDP, un débat public confié au maître d’ouvrage sous contrôle de la CNDP, une concertation recommandée avec ou sans garant ou encore le rejet de la saisine. Pour le projet Cigéo la CNDP a pris la décision d’organiser un débat public animé par une commission particulière. Lors de la préparation du débat, la commission particulière a procédé à de nombreuses relectures du dossier du maître d’ouvrage afin que le dossier présenté à la CNDP soit le plus complet et le plus pédagogique possible.
9. La question des transports a été inscrite comme l’une des questions à débattre dès le journal du débat n°1 d’avril 2013. La lettre n°1 du 17 juin 2013 confirmait l’inscription de ce thème majeur à l’un des débats contradictoires organisés à partir du mois de juillet 2013.
10. Le questionnement sur la santé n’a pas été absent du débat public et est présent dans plusieurs contributions. Les débats contradictoires ont été centrés sur les questionnements majeurs du projet Cigéo, de son opportunité à son insertion dans le territoire, et n’excluait en aucune manière les questions liées à la santé.
11. En application des textes, la CPDP n’a pas à tirer de conclusions du débat public. Sans donner son point de vue ni se prononcer sur le fonds, la CPDP doit livrer dans son compte rendu un argumentaire fidèle aux préoccupations exprimées par le public et présenter impartialement les divers points de vue énoncés et enregistrés pendant le débat. Le compte rendu de la CPDP de 2005/2006 n’a pas dérogé à cette règle et la CPDP du projet Cigéo n’y dérogera pas non plus.
12. A la suite du débat public de 2005/2006 le parlement a discuté et voté la loi du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs. Son article 3 stipule : « pour assurer, dans le respect des principes énoncés à l’article L.542-1 du code de l’environnement, la gestion des déchets radioactifs à vie longue de haute ou de moyenne activité, les recherches et études relatives à ces déchets sont poursuivies selon les 3 axes complémentaires suivants :
1° la séparation et la transmutation…
2°le stockage réversible en couche géologique profonde…
3° l’entreposage…
Le débat public est l’une des nombreuses étapes prévues avant le dépôt de la demande d’autorisation de construction de Cigéo, il permet la participation du public au processus décisionnel en favorisant l’expression de ses préoccupations et ce avant la prise de décision.
13. Deux semaines avant l’ouverture du débat, la CPDP a publié sur le site internet, outre le dossier du maître d’ouvrage, un certain nombre de documents de base sur CIGEO :
- les avis de sécurité, émanant de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), elle même appuyée par l’Institut de radioprotection et de sécurité nucléaire (IRSN)
- les avis scientifiques, notamment ceux de la Commission d’évaluation des recherches et des études relatives à la gestion des déchets radioactifs
- le rapport de la Cour des comptes de janvier 2012 sur les coûts de la filière électronucléaire
- le rapport du Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire en date du 28 mars 2013
Pendant la durée du débat, la CPDP a mis sur le site tous les documents qui lui étaient transmis à cet effet, sans aucune sélection. Comme vous pouvez le voir, notamment dans les rubriques « questions / réponses », « contributions » et « avis », le principe du contradictoire dans l’information du public a été largement respecté.
14. Le rapport de la Commission d’enquête établi lors de l’instruction, en 2010, du dossier de renouvellement de l’autorisation d’exploitation du laboratoire de Bure Saudron puis l’annexe complémentaire vous ont été transmis dès leur réception par la CPDP.
15. Le financement du projet de stockage fait l’objet d’une disposition législative (loi 2006 – 739 du 28 juin 2006), fondée sur le principe pollueur-payeur. Les producteurs de déchets sont tenus de provisionner les dépenses prévisionnelles de démantèlement des installations nucléaires, ainsi que la gestion des déchets radioactifs de tous types qu’elles génèrent. Aussi l’évaluation des coûts prévisionnels est-elle importante, et il était pour le moins normal que la CPDP organise un débat contradictoire sur ce sujet
Le dossier du maitre d’ouvrage, vu par la CNDP dans sa séance du 6 février, précise (p. 90) que « la dernière évaluation du coût du stockage arrêtée par le ministère de l’énergie date de 2005 …un groupe de travail a été mis en place en 2009 par la Direction générale de l ‘énergie et du climat avec l’ANDRA, EDF, le CEA, Areva et l’Autorité de sûreté nucléaire pour préparer cette nouvelle évaluation. Le Ministère chargé de l’énergie souhaite arrêter une nouvelle évaluation fin 2013. Un état d’avancement pourra être fait lors du débat public ».
Sur ces bases, « la Commission nationale a considéré le dossier comme suffisamment complet pour être soumis au débat public, sous réserve que soient explicitées à l’occasion du débat les questions financières » (communiqué du 6 février 2013).
Lors du débat contradictoire sur internet du 13 novembre 2013, le représentant de l’Etat a rappelé que les coûts de construction, d’exploitation et de fermeture du centre de stockage avaient été́ établis en 2005 entre 13,5 et 16,5 milliards d’euros, repartis sur plus de 100 ans, et comprenant aussi bien l’investissement initial que les charges d’exploitation et d’entretien, de recherche et développement, et les coûts du personnel pendant toute la durée de vie du projet. Il ajoutait : « bien qu’un chiffre de 35 milliards d’euros ait pu circuler dans la presse… il était antérieur aux études de conception industrielle et n’a fait l’objet d’aucune validation ».
Il n’a en revanche donné aucune valeur calculée plus récemment, ce qui a conduit l’un des experts invités, M. Benjamin Dessus, a quitté la séance. Le président de la CPDP, malgré le déséquilibre ainsi créé, a poursuivi la séance pour faire le point, avec le représentant de l’Etat notamment, des éléments financiers disponibles et tenter d’apporter des réponses aux questions du public.
16. Dans tout débat public sur un projet d’investissement, le maître d’ouvrage dispose d’une compétence technique qui est pour lui un atout ; par ailleurs il a préparé le débat pendant de longs mois, et il a constitué des équipes dédiées au projet. En ce sens le déséquilibre entre lui et le public est inévitable, et de ce point de vue le débat sur CIGEO ne se différenciait pas des autres débats.
Dans les réunions publiques la CPDP a précisément pour mission de rétablir l’équilibre, et pour cela de « favoriser la richesse des échanges en incitant le maître d’ouvrage à toujours plus de transparence, le soutenir dans cette voie ou l’y conduire avec fermeté et diplomatie » (cahier de méthodologie édité par la CNDP).
En ce qui concerne les autres modes d’expression du public, qu’il s’agisse du simple courrier ou du site internet, le problème existe moins : toutes les contributions (cahiers d’acteur, avis, questions, etc.) reçues par la CPDP sont rendues publiques sur le site internet, sans considération de la qualité de son auteur. Tous les intervenants (organismes publics, collectivités territoriales, entreprises, personnes privées) sont ici placées sur un pied d’égalité.
17. Le cahier de méthodologie édité par la CNDP prévoit que pour les réunions publiques « deux tables sont installées sur l’estrade, celle de la CPDP et celle du maître d’ouvrage, distinctes et séparées l’une de l’autre ». Tel a été le dispositif adopté lors des deux réunions de Bure et de Bar le Duc.
En ce qui concerne le comportement de la CPDP vis de l’ANDRA, le même cahier de méthodologie précise : « il est primordial que la commission entretienne des relations courtoises avec le maître d’ouvrage, tout en gardant à l’esprit l’essence de sa démarche et l’exigence de sa neutralité ». Le fait de présenter ses représentants en les qualifiant par l’expression « nos amis de l’ANDRA » relève de cet état d’esprit ; il s’agit d’une banale marque de courtoisie, qui n’implique aucune complaisance vis à vis de l’organisme qu’ils représentent.
Gestion et fonctionnement du débat
18. Cette question a été transmise à la CNDP
19. Les débats contradictoires sur internet ont été suivis le 11 juillet 2013 par plus de 1000 internautes et ont fait l’objet de près de 300 connexions vidéo et audio pour les autres soirées. A chaque débat de nombreuses questions ont été posées permettant d’animer le débat et montrant tout l’intérêt du public pour les thèmes abordés. Les vidéos et verbatims de l’ensemble des débats, disponibles sur le site internet du débat public, montrent la richesse des échanges plutôt que l’ennui que vous avez ressenti.
20. Quatre des neuf débats contradictoires organisés ont mis en présence un nombre équivalent d’experts indépendants et de représentants du maître d’ouvrage ou des producteurs de déchets. Ce fut le cas pour les débats des 18 septembre, 9 octobre, 16 octobre et 20 novembre. Deux débats ont permis des échanges entre experts indépendant, représentant d’un organisme de recherche et représentants de l’ANDRA les 11 juillet et 23 octobre. Le débat du 30 octobre a permis des échanges entre d’une part un représentant de l’ANDRA et un représentant de la préfecture et d’autre part deux représentants élus et un expert indépendant. On ne peut donc pas parler de déséquilibre quant à la composition des tables rondes ;
Le débat du 23 septembre qui portait sur les comparaisons internationales ne présentait pas la même configuration dans la mesure où il visait à faire le point des recommandations, directives et réglementations par la commission européenne, l’OCDE et l’AIEA et à présenter la situation dans quatre pays : Etats-Unis, Canada, Suède, Finlande. On ne peut dans ce cadre qualifier ce débat de caricature. La configuration a été également adaptée pour le débat du 13 novembre dans la mesure il s’agissait avant tout de faire un état de l’avancement du dossier coût et financement par le représentant de l’Etat et celui des producteurs point qui avait été annoncé dans le dossier du maître d’ouvrage.
21. La commission s’est toujours efforcée de respecter et faire respecter par le maître d’ouvrage les règles du débat. Il n’a effectivement pas toujours été possible de respecter les délais de réponse aux questions dans ce débat riche de plus de 1000 questions. La CPDP le regrette même si elle se félicite de l’intérêt manifesté pour le débat jusqu’au terme de celui-ci puisque que près de 700 questions sont arrivées dans les jours qui ont précédé le 15 décembre. Elle s’engage à ce que ce que chaque question ait une réponse.
22. La CPDP et le maître d’ouvrage se sont engagés à apporter leur réponse dans les meilleurs délais. Malgré les efforts fournis par tous, les délais de réponse à certaines questions ont été effectivement longs. La question n° 321 à laquelle vous faites référence pour parler de « faute professionnelle » a été posée le 19 septembre et a eu une réponse le 28 octobre et ne mérite pas donc pas ce qualificatif. La question 625 quant à elle a été posée le 4 décembre et a reçu une réponse le 20 décembre. Il s’agissait d’une relance sur des questions posées en juillet qui ont eu des réponses le 12 novembre pour l’une et le 5 décembre pour la seconde. Le contenu des questions n’est pas aussi simple que vous le laissez entendre puisque pour l’une d’entre elles il s’agissait d’une demande concernant les quantités de déchets supplémentaires qui seraient générés en cas d’un accident nucléaire en France et plus particulièrement en cas de fusion du cœur d’un réacteur.
23. C’est une question que vous avez déjà posé par mail et à laquelle vous avez eu réponse. Après vérification dans la base de données du site internet, les mails, les courriers et cartes T, la Commission n’a pas trouvé trace de ce premier envoi. En réponse à vos interrogations, la Commission vous a assuré qu’il n’existait aucun obstacle à la publication de votre question, ce qui a été fait.
24. La question du transport des matières et déchets radioactifs a été longuement abordée lors du débat contradictoire consacré au thème des transports. Le thème de l’information sur les parcours et le rôle des différentes parties prenantes ont été traités clairement.
25. Vous avez déjà posé cette question par mail et reçu une réponse écrite et signée du président de la CPDP. La représentante de la CPDP n’est pas intervenue auprès de la journaliste pour orienter ses choix de questions. Les questions retenues l’ont été en toute responsabilité par la journaliste animatrice du débat.
26. Il aurait été contraire à toute déontologie que la CPDP rejette de son propre chef des questions pour cause de « délit de faciès ». S’il est habituellement demandé aux participants de s’identifier, cela n’a jamais empêché d’utiliser une fausse identité voire d’en usurper une. Cela se rencontre dans chaque débat public. Les modes de participation liés aux débats contradictoires, par mail et SMS, ont nécessité une adaptation. Le choix du pseudonyme ne préjugeait en rien de la légitimité de la question ou de l’avis. Enfin, la CPDP n’opère pas une comptabilité des « pour » ou « contre » le projet, elle s’intéresse exclusivement à la qualité de l’argumentation.
27. La CNDP a effectivement tiré un certain nombre de questions des cahiers d’acteurs qu’elle avait reçus. Cela a été fait à la demande expresse de plusieurs associations, et à chaque fois la référence au cahier d’acteurs de référence était clairement présentée. L’accusation d’avoir voulu faire du chiffre est absurde, vu le nombre de questions reçues en tant que telle, la proportion de celles tirées des cahiers d’acteurs est infime.
28. Votre question est contradictoire : d’une part, vous écrivez que ces « questions, avis, cahiers d'acteurs et autres contributions » émanent explicitement « d'établissements du nucléaire ou de leurs satellites au sein desquels le promoteur du projet, le décideur, c'est-à dire l'Etat, est majoritaire (outre l'ANDRA, AREVA, EDF, CEA, etc.), ou de salariés ou d'anciens salariés de ceux-ci ou encore d'associations composées de leurs représentants et/ou financées par eux (SFEN, Sauvons le Climat, etc.) » ; d’autre part, vous reprochez à la CPDP de n’en avoir pas informé le grand public.
Dès lors que - comme vous l’indiquez vous même la présentation a été explicite sur l’origine des documents incriminés dans votre question.
29. Nous vous renvoyons à la question / réponse précédente : puisque vous estimez qu’un certain nombre de questions et d’avis émanaient explicitement du « milieu nucléaire », vous reconnaissez vous même que le principe de transparence a été respecté. La CPDP pour sa part s’est interdit toute enquête sur l’origine des documents qui lui étaient transmis pour publication sur son site ; elle les a tous publiés sur son site, conformément au respect du principe de l’équivalence de traitement des points de vue exprimés.
30. Votre question mélange deux sujets qui n’ont rien à voir ensemble :
a) Vous affirmez que la CPDP aurait « corrigé (ou modifié) des questions des participants sans les aviser préalablement », mais vous ne citez aucun cas concret. Or il s’agit d’une contre vérité : la CPDP n’a rien fait de tel.
Est-il arrivé qu’une erreur technique (typographie ou autre) ait modifié la rédaction d’une question ? La CPDP n’a eu aucun retour des auteurs de questions allant en ce sens.
b) Vous avez posé une question sur le stockage des verses, et la réponse de l’Andra ne vous satisfait pas.
Votre question a été posée le 26 juin, sous le numéro 201 ;
L’Andra vous répondu le 29 juillet, en explicitant la manière dont sa réflexion sur le traitement des verses avait évolué au fil du temps, et vers quoi elle s’orientait.
Si cette réponse ne vous satisfaisait pas, vous aviez tout le loisir de le faire savoir sur le site au cours des quatre mois écoulés.
31. La consultation du site internet pour la période à laquelle vous vous référez donne les indications suivantes :
18 juin - 1 avis ajouté - no. 128 - Favorable au projet
19 juin - 1 avis ajouté - no. 129 - Défavorable au projet
20 juin - 3 avis ajoutés - no. 130 - Défavorable au projet - no. 131 - Favorable au projet
- no. 132 - Défavorable au projet
21 juin - 2 avis publiés - no. 133 - Défavorable au projet
- no. 134 - Défavorable au projet
22 juin - 0 avis publié
Et ainsi de suite, tout au long de la période du débat.
Comment pouvez vous en déduire que le « débat a été tronqué » et qu’il y a des « enchaînements providentiels » ?
32. M. Boiron se présente lui-même dans son avis n° 20 comme « ingénieur retraité de l’industrie nucléaire, ancien commissaire enquêteur ». Qu’auriez vous souhaité que la CPDP ajoute de plus ? Et de quel droit l’aurait elle fait ?
33. Dans sa réponse à votre question n° 203 la CPDP s’est bornée à vous indiquer les noms de quatre associations nationales qui lui avaient adressé des cahiers d’acteur dans lesquels elles s’exprimaient en faveur du projet Cigeo, en vous précisant les numéros des dits cahiers d’acteurs.
Il s’agissait d’une information purement factuelle, basée sur des documents rendus publics par la CPDP à la demande des intéressées. Il n’appartenait évidemment pas à la CPDP de porter des jugements de valeur sur ces associations.
34. Dans la présentation du dispositif Questions / Réponses du site internet de la CPDP, il est expressément indiqué que les réponses seront apportées soit par le maître d’ouvrage, soit par la CPDP elle même, selon la nature de la question. Cette procédure, d’ailleurs conforme aux prescriptions du cahier de méthodologie édité par la CNDP, a été suivie tout au long du débat.
La collaboration des experts aux réponses écrites est une innovation mise en place suite aux débats contradictoires. Des experts invités pour éclairer une thématique au cours d’un débat contradictoire répondaient ensuite aux questions des auditeurs qui n’avaient pu être traitées en direct.
35. Est-ce une question ? Auquel cas il faudrait que vous fournissiez quelques cas concrets pour que la CPDP puisse les examiner.
Ou bien est-ce une appréciation personnelle ? Auquel cas la CPDP ne peut que regretter que vous ayez eu ce sentiment … qui ne correspond en rien au vécu de ses membres.
36. Cette question a été transmise à la CNDP
37. L’impossibilité de tenir les 8 réunions publiques prévues localement a certes créé un vide, toutefois la CPDP a veillé tout au long de la période du débat à ce que l’information des populations concernées ne soit pas entravée, et que les personnes ou organismes souhaitant s’exprimer puissent le faire en toute liberté, sans aucune restriction ni censure.
Ce dispositif, basé essentiellement sur le site internet de la CPDP, a permis de recueillir près de 1 500 questions, 444 avis, 150 cahiers d’acteur, 23 contributions.
La grande diversité des opinions ainsi recueillies sur Cigeo peut se constater sur le site de la CPDP, puisque toutes ont été (ou vont l’être prochainement pour les dernières reçues) publiées.
Parler d’échec est donc pour le moins excessif.
QUESTION 742 - Les fourberies du CEA
Posée par Christine DARDALHON, L'organisme que vous représentez (option) (PORTES), le 14/12/2013
Sous ce titre, dans le journal “A Contre Courant” de novembre j’ai lu ceci : “ Les études du CEA sont dénuées de toute rigueur scientifique et ne servent qu’à légitimer a posteriori les décisions prises par le lobby nucléaire, quelles qu’elles soient. Il s’agit des études concernant la tenue des verres dans le temps.” Peut-on réellement mettre en doute les travaux des scientifiques qui travaillent sur le projet CIGEO ?
Réponse du 23/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
En effet, peut-on mettre en doute les centaines de scientifiques et d’ingénieurs qui travaillent en France et à l’étranger sur le stockage profond depuis plusieurs dizaines d’années ? Ainsi que les évaluateurs indépendants qui évaluent régulièrement leurs résultats ?
La transparence de l’information et l’évaluation des recherches sont des conditions essentielles pour assurer la confiance vis-à-vis du travail mené par les scientifiques. Les dossiers de sûreté, réalisés par l’Andra pour préparer le projet Cigéo, ainsi que les avis des autorités de contrôle et d’évaluation sont accessibles au public (voir notamment la rubrique « Les avis des autorités de contrôle et d’évaluation » du site ainsi que le site internet de l’Andra).
Les recherches menées par l’Andra font appel à une large communauté scientifique (10 organismes et établissements universitaires partenaires, 70 laboratoires académiques, participation à 12 programmes de recherche européens depuis 2006…). Chaque année, les résultats des recherches font l’objet de 50 à 70 publications.
Dans son rapport d’évaluation en 2012, l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Aeres) considère que « l’Andra est probablement l’un des établissements les plus évalués de France y compris et surtout dans son activité de recherche ».
L’Autorité de sûreté nucléaire a souligné dans son avis du 16 mai 2013 la qualité des études et des recherches menées par l’Andra, notamment dans le Laboratoire souterrain ainsi que les points à approfondir.
La Commission nationale d’évaluation, mise en place par le Parlement pour évaluer les recherches menées sur la gestion des déchets radioactifs, rend public chaque année son rapport d’évaluation et le présente à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques ainsi qu’au Comité local d’information et de suivi (Clis) du Laboratoire souterrain. Le Clis commande également régulièrement des expertises sur les dossiers de l’Andra ou des sujets plus ciblés.
Tous ces éléments sont des gages de la robustesse de la démarche qui est mise en œuvre pour garantir la sûreté du projet.
QUESTION 741 - Securité
Posée par Patrick BERNARD, L'organisme que vous représentez (option) (CLUNY), le 13/12/2013
Bonjour Quelle sécurité pour ce site? qui surveille? l'armée ou des sociétés privées ?... Ne vaudrait-il pas mieux choisir un site mondial totalement désertique au lieu de disséminer nos cochonneries partout et ainsi augmenter le risque statistique d'accidents potentiels dans l'avenir ?
Réponse du 16/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Concernant la sécurité et la surveillance du site
La sûreté est au cœur du projet Cigéo. Pour que le projet puisse être autorisé, l’Andra doit démontrer à l’Autorité de sûreté nucléaire que l’installation permet de maîtriser les risques liés aux déchets radioactifs, pendant son exploitation et après sa fermeture. Si vous souhaitez plus d’informations sur la démarche de sûreté, vous pouvez consulter le chapitre 5 du dossier du maître d’ouvrage ../docs/dmo/chapitres/DMO-Andra-chapitre-5.pdf
Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de stockage de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement afin de contrôler l’impact de ses activités. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, il permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement et l’absence de contamination dans l’environnement. L’Andra a déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. De plus, Cigéo sera en permanence soumis au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
En complément, des contre-expertises indépendantes pourront être réalisées autour de Cigéo à la demande de la Commission Locale d’Information comme cela a été plusieurs fois le cas sur les centres de stockage de surface et récemment sur le centre de stockage de l’Aube par l’ACRO (Association pour la radioactivité dans l’ouest).
Concernant le stockage dans un lieu désertique
Sur le plan réglementaire, la directive européenne du 19 juillet 2011, établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre des combustibles usés et des déchets radioactifs, stipule que les déchets radioactifs doivent être stockés dans l’Etat membre où ils ont été produits. L’utilisation d’une installation de stockage dans un autre pays est soumise à un accord intergouvernemental et implique de s’assurer que :
- le pays de destination a conclu un accord avec la Communauté Euratom ou fait partie de la convention commune sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs,
- le pays dispose de programmes de gestion et de stockage des déchets radioactifs dont les objectifs, d’un haut niveau de sûreté, sont équivalents à ceux fixés par la directive,
- l’installation de stockage du pays de destination est autorisée à recevoir les déchets radioactifs à transférer, en activité avant le transfert et gérée conformément aux exigences établies dans le cadre du programmes de gestion et de stockage des déchets radioactifs de ce pays de destination.
Sur le plan technique, la conception d’un stockage, quel que soit son emplacement, nécessiterait l’étude détaillée des propriétés géologiques du site pour concevoir un stockage adapté et s’assurer de sa capacité à protéger l’homme et l’environnement à très long terme. L’étude devrait également prendre en compte les évolutions climatiques possibles sur le long terme.
QUESTION 740 - question
Posée par léa BUCQ, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 13/12/2013
Que fera-t-on des déblais issus du creusement de l’enfouissement ?
Réponse du 20/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les déblais d’argile excavés lors du creusement de l’installation souterraine représenteront un volume de l’ordre de 10 millions de mètres cubes, répartis sur une centaine d’années*. Environ 40 % des déblais seront réutilisés pour remblayer les ouvrages souterrains à la fermeture de Cigéo.
Les déblais seront stockés en surface dans des « verses ». Ces verses seront réalisées progressivement, sur une emprise estimée à terme de l’ordre de 130 hectares. Elles feront l’objet d’un traitement spécifique afin d’être intégrées au paysage (utilisation de la topographie du site, couverture végétale, reboisement…) en cherchant à limiter leur extension, en hauteur et en surface.
L’implantation des verses est étudiée à proximité immédiate des installations de Cigéo pour limiter les besoins en transports.
* A titre de comparaison, le volume de déblais générés par le creusement de grands tunnels est du même ordre de grandeur (environ 7 millions de mètres cubes pour le tunnel sous la Manche, environ 15 millions de mètres cubes pour le futur tunnel de base de la liaison ferroviaire Lyon-Turin) mais répartis sur une dizaine d’années.
QUESTION 739 - question sur cigéo
Posée par Véronique LEMANCHE, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 13/12/2013
Madame, monsieur, On entend dire que tout est décidé. Qui prendra la décision de construire Cigéo et quand ? Merci d'avance pour votre réponse, Cordialement,
Réponse du 19/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra à l’État après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création du centre en 2015 conformément au calendrier fixé par la loi du 28 juin 2006. Ce processus comprendra notamment l’évaluation de la sûreté par l’Autorité de sûreté nucléaire, l’évaluation des recherches scientifiques par la Commission nationale d’évaluation, l’avis des collectivités territoriales, le vote d’une nouvelle loi fixant les conditions de réversibilité, la mise à jour de la demande de création de Cigéo par l’Andra suite à cette loi, et une enquête publique. Si Cigéo est autorisé, les travaux de construction pourraient débuter en 2019 pour une mise en service en 2025, sous réserve de l’autorisation de l’Autorité de sûreté nucléaire.
QUESTION 738
Posée par Gérard ARNOUX (LE KREMLIN-BICÊTRE), le 13/12/2013
Ne serait-il pas possible de se débarrasser définitivement des déchets en utilisant la tectonique des plaques pour les faire disparaître définitivement sous l'écorce terrestre?
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
Les zones de subduction ont été imaginées comme solution à la fin des années 1970. Cette proposition a très tôt été éliminée pour plusieurs raisons. Les vitesses de subduction sont de l’ordre de quelques centimètres par an (8 à 10 cm/an au maximum). Comment être certain d’envoyer des colis de déchets suffisamment près de la zone de subduction à très grande profondeur (souvent 10 000 mètres ou plus) pour qu’ils soient « absorbés » assez rapidement ? Si les colis de déchets sont pris dans la gigantesque zone broyée, que constitue la zone de subduction, ils seront eux-mêmes écrasés et détruits, et relâcheront leur radioactivité avant de passer sous la plaque continentale. S’ils restent au fond des océans, ils seront progressivement corrodés et libéreront progressivement leur radioactivité. Nous n’aurions donc aucun moyen de surveillance et de contrôle de leur devenir.
Enfin, d’un point de vue juridique, en 1993, les signataires de la convention de Londres ont décidé d’interdire l’immersion de tout type de déchets radioactifs dans la mer ; cette décision se fondait sur des critères moraux, sociaux et politiques.
QUESTION 737
Posée par ACRO, le 13/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de l'ACRO : La réversibilité présentée par l’Andra ne sera crédible que quand elle aura été testée au Centre de la Manche. Certes, le rapport Turpin de 1996, ne recommandait pas la reprise du site. Mais la doctrine en matière de démantèlement des installations nucléaires a changé entre-temps : il faut démanteler immédiatement une installation en fin de vie en bénéficiant des progrès technologiques. Pourquoi cela ne serait pas applicable au Centre Manche ?
Réponse du 10/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les dispositions relatives au démantèlement des installations nucléaires de base ne sont pas applicables aux installations de stockage des déchets radioactifs (cf. article 29 de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire). En effet, les stockages sont justement conçus pour assurer la mise en sécurité des déchets radioactifs sur le long terme.
Le Centre de stockage de la Manche est le premier centre de stockage de déchets radioactifs en France. Il a été créé en 1969 par le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) et a été exploité jusqu’en 1994. Achevée en 1997, une couverture "multi-couches" imperméable protège les déchets stockés. Le Centre a été autorisé à passer en phase de surveillance par décret du 10 janvier 2003. Le plan de surveillance est validé par l'Autorité de sûreté nucléaire. Chaque année, 2 000 prélèvements et 10 000 analyses sont effectués sur le Centre et aux alentours (dans l'air, l'eau, les végétaux, les boues et les sédiments de rivières). L'impact mesuré du Centre de stockage de la Manche sur son environnement est plus de 1 000 fois inférieur à la radioactivité naturelle de la région (2,7 mSv/an pour la Manche selon une étude du Comité Nord-Cotentin réalisée en 1998). Les résultats de mesure de la surveillance de l'environnement du Centre sont accessibles sur le site du Réseau national de mesure de la radioactivité de l'environnement et dans les rapports annuels du Centre qui sont présentés à la Commission locale d’information et consultables sur le site internet de l’Andra. En 2010, sur la base du rapport de sûreté 2009 remis par l’Andra, l’Autorité de sûreté nucléaire a confirmé que le stockage évoluait conformément aux prévisions, avec un impact très inférieur à celui de la radioactivité naturelle.
L’Andra estime que la reprise des colis, bien que techniquement possible, ne présente pas d’intérêt. Toutes les mesures réalisées dans le cadre du plan de surveillance montrent que l’impact du Centre sur l’Homme et l’environnement reste très faible. Par ailleurs, l’Andra a pris toutes les dispositions (surveillance, mise en place de la couverture, maintien de la mémoire…) pour limiter l’impact du Centre sur le long terme. La commission Turpin mise en place en 1996 avait également conclu dans le même sens au regard des inconvénients qu’elle engendrerait (impact environnemental, dosimétrie pour les travailleurs, génération de déchets).
QUESTION 736
Posée par ACRO, le 13/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de l'ACRO :
Cet entreposage pérennisé sera nécessaire pour toutes les matières dites valorisables, mais qui ne sont pas valorisées car il n’existe aucune filière pour les utiliser, avec des volumes bien plus grands que pour ce qui est prévu pour Cigéo. Pourquoi ce qui est possible pour ces matières devient impossible pour ce que l’Andra veut enfouir ? Comment justifier qu’il y a un impératif moral vis-à-vis des générations futures pour enfouir les déchets et ne rien proposer pour la plus grande partie de ce qui sort des réacteurs ?
Réponse du 17/01/2014,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Certains combustibles usés (MOX et URE) sont actuellement entreposés de façon sûre dans l’attente de leur utilisation ultérieure dans les réacteurs de 4ème génération. Les recherches sur la quatrième génération, génération qui permettrait de tirer parti complètement de tout le potentiel énergétique contenu dans l’uranium naturel, sont actuellement encadrées par les lois n°2005-781 du 13 juillet 2005 et la loi n°2006-739 du 28 juin 2006.
Au cas où cette filière venait à ne pas être déployée, les combustibles MOX et URE seraient alors considérés comme des déchets. Le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie a demandé à l’Andra d’étudier à titre de précaution la faisabilité du stockage de ces combustibles usés dans Cigéo.
QUESTION 735
Posée par ACRO, le 13/12/2013
Questions posées dans le cahier d'acteurs de l'ACRO : Qui décidera d’aller rechercher des déchets problématiques dans Cigéo ? Combien cela coûtera ? Qui payera ? Quelle solution alternative pour les déchets problématiques ? Ces questions ne sont même pas abordées dans le dossier rédigé par l’Andra. Qu’en sera-t-il s’il faut reprendre une fraction importante des déchets stockés ? Quel en sera le coût ? Quelle solution alternative ?
Réponse du 06/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement dans une future loi. Les propositions de l’Andra sur la réversibilité sont consultables sur le site du débat public (../informer/les-etudes-preparatoires.html) et abordent les questions que vous posez.
L’Andra propose que le décret d’autorisation de création de Cigéo couvre des opérations de retrait limité et temporaire de colis de déchets stockés. Ces opérations seront décrites dans le rapport de sûreté et dans les règles générales d’exploitation.
L’Andra considère que toute opération notable de retrait de colis de déchets stockés devra faire l’objet d’une autorisation spécifique. Ainsi, dans l’hypothèse d’une évolution de la politique en matière de gestion des déchets radioactifs qui conduirait à envisager une opération de retrait d’un nombre important de colis de déchets, l’Etat demanderait à l’Andra d’étudier l’opération. L’étude devrait comprendre une analyse détriments-bénéfices. L’opération pourrait nécessiter des modifications notables de l’installation, notamment en surface : l’Andra définirait la nature de ces modifications en fonction de la situation de retrait considérée : famille de colis concernée, volumes, dates de retrait, devenir des colis retirés du stockage…
Ce type d’opérations nécessiterait ensuite le dépôt d’une demande de modification du décret d’autorisation de création par l’Andra, évaluée par l’Autorité de sûreté nucléaire et soumise à enquête publique. L’autorisation demandée devrait couvrir les opérations envisagées sur Cigéo (opérations de retrait, de reconditionnement éventuel, d’expédition…) et l’ensemble des modifications d’installations à apporter (construction éventuelle d’entreposages, de nouveaux ateliers…). Le dossier support à la demande devrait présenter une démonstration complète et justifiée de la sûreté des opérations projetées.
Le coût de l’opération de retrait dépend de la situation de retrait considérée. Il serait a priori d’un ordre de grandeur analogue à celui des opérations de mise en stockage des déchets, auquel il conviendrait d’ajouter celui des nouvelles installations à construire pour accueillir les déchets et celui du transfert des déchets dans ces nouvelles installations.
L’Andra propose un partage équitable du financement de la réversibilité entre les générations. Les générations actuelles provisionnent l’ensemble des coûts nécessaires pour permettre la mise en sécurité définitive des déchets radioactifs qu’elles produisent, ainsi que des déchets anciens qui ont été produits depuis le début des années 1960. Ces provisions couvrent également les propositions techniques retenues pour assurer la réversibilité de Cigéo pendant le siècle d’exploitation. Si les générations suivantes décidaient de faire évoluer leur politique de gestion des déchets radioactifs, par exemple si elles décidaient de récupérer des déchets stockés, elles en assureraient le financement. La prise en compte de la réversibilité dès la conception du stockage permet de limiter cette charge potentielle.
QUESTION 734
Posée par ACRO, le 13/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de l'ACRO : Comment garantir un stockage profond sur des centaines de milliers d’années quand on ne peut pas garantir un stockage en subsurface pour quelques décennies ?
Réponse du 27/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Cette question est extraite du cahier d’acteurs n°81 de l’ACRO qui évoque le Centre de stockage de la Manche.
Le Centre de stockage de la Manche a été créé en 1969 et exploité jusqu’en 1994 avant la mise en place de sa couverture. L’Andra est chargée d’assurer la surveillance de ce site. Tous les contrôles effectués année après année confirment que son impact est très faible, plus de 1 000 fois inférieur à l’impact de la radioactivité naturelle. Les résultats de la surveillance du Centre sont présentés chaque année à la Commission locale d’information et sont consultable sur le site internet de l’Andra (voir le rapport annuel sur http://www.andra.fr/index.php?id=edition_1_3_1&recherche_thematique=1).
QUESTION 733
Posée par ACRO, le 13/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de l'ACRO :
Le Centre de stockage : Combien de temps va-t-il pouvoir retenir les éléments toxiques avant qu’ils ne se dispersent dans l’environnement ?
Réponse du 20/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Après la fermeture du stockage, au-delà de la durée de vie des ouvrages industriels, la couche d’argile très peu perméable, de plus de 130 mètres d’épaisseur dans laquelle serait implanté le stockage souterrain s’il est autorisé, servira de barrière naturelle pour retenir les radionucléides contenus dans les déchets et freiner leur déplacement. Le stockage permet ainsi de garantir leur confinement sur de très longues échelles de temps. Seuls quelques-uns de ces radionucléides, les plus mobiles et dont la durée de vie est longue, pourront migrer de manière très étalée dans le temps. Ils ne sortiraient pas de cette couche avant 100 000 ans et atteindraient en quantités extrêmement faibles la surface et les nappes phréatiques. Leur impact radiologique serait alors de l’ordre du millième de la radioactivité naturelle (qui est de 2,4 mSv par an en moyenne en France).
QUESTION 732
Posée par Nathalie CHRETIEN, le 13/12/2013
Questions posées dans le cahier d'acteurs de Mme Nathalie Chrétien : La CNE aurait-elle le pouvoir de dire NON au projet Cigéo ? Jean-Claude Duplessy « On a toute une série de questions, il y a des choses sur lesquelles on n’était pas très satifsait, sur lesquelles on pensait qu’il fallait des compléments d’études. L’Andra nous dit qu’on aura la réponse dans la Demande d’Autorisation de Création ». Cette phrase extraite de la page 3 du rapport de la CNE serait-elle une menace ou un leurre ?
Réponse du 10/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra à l’État après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo en 2015 conformément au calendrier fixé par la loi du 28 juin 2006. Ce processus comprendra notamment l’évaluation de la sûreté par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), l’évaluation des recherches scientifiques par la Commission nationale d’évaluation (CNE), l’avis des collectivités territoriales, le vote d’une nouvelle loi fixant les conditions de réversibilité et une enquête publique. Ainsi, si l’Andra n’a pas satisfait les demandes des évaluateurs, dont la CNE, l’Etat ne donnera pas l’autorisation à l’Andra de construire le stockage.
QUESTION 731
Posée par Nathalie CHRETIEN, le 13/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de Mme Nathalie Chrétien :
L’Andra étudie la possibilité de se doter, dès 2050, d’un module d’entreposage de 100 à 500 m3. Ce volume sera-t-il suffisant pour effectuer les manipulations nécessaires ?
Réponse du 10/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Dans le cadre de ses études et recherches sur l’entreposage menées depuis la loi du 28 juin 2006, l’Andra avait proposé en 2009 d’étudier l’éventualité de doter à terme Cigéo de capacités d’entreposage supérieures au strict besoin de tampons d’exploitation : « A partir de 2040, une alternative peut s’ouvrir entre une localisation de toutes les capacités nouvelles [d’entreposage] sur les sites de conditionnement [ex: les sites des producteurs] et une localisation d’une partie d’entre elles sur le centre de stockage. (…) Des capacités implantées sur le centre de stockage seraient particulièrement adaptées à la gestion de colis récupérés dans le cadre de la réversibilité ».
Suite aux échanges avec les parties prenantes, cette proposition n’a pas été retenue pour la suite des études, comme indiqué dans le bilan des études et recherches sur l’entreposage publié par l’Andra en 2013 et consultable sur le site du débat public (../docs/decisions/Rapport-2012-Andra-entreposage.pdf – cf. § 10). Dans l’hypothèse où Cigéo serait autorisé, les bâtiments de surface du Centre auront pour unique fonction l’accueil, la réception, le contrôle et la préparation des colis avant leur transfert vers l’installation souterraine. Les capacités de ces bâtiments seront limitées pour répondre à ces besoins et n’auront pas vocation à se substituer aux entreposages présents sur les sites des producteurs de déchets.
La réversibilité du stockage pose la question de capacités d’entreposage qui accueilleraient, le cas échéant, des colis de déchets retirés du stockage. Toute opération notable de retrait de colis de déchets stockés devrait faire l’objet d’une autorisation spécifique. L’opération pourrait nécessiter des modifications notables de l’installation, notamment en surface : l’Andra définirait la nature de ces modifications en fonction de la situation de retrait considérée : famille de colis concernée, volumes, dates de retrait, devenir des colis retirés du stockage… Ce type d’opérations nécessiterait ensuite le dépôt d’une demande de modification du décret d’autorisation de création par l’Andra, évaluée par l’Autorité de sûreté nucléaire et soumise à enquête publique. L’autorisation demandée devrait couvrir les opérations envisagées sur Cigéo (opérations de retrait, de reconditionnement éventuel, d’expédition…) et l’ensemble des modifications d’installations à apporter (construction éventuelle d’entreposages, de nouveaux ateliers…).
QUESTION 730
Posée par ACRO, le 13/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de l'ACRO :
Le rôle de la CPDP aurait dû être de compléter l’information manquante pour favoriser le débat. Mais, on ne trouve sur son site Internet que des documents officiels émanant de l’Andra ou des autorités. Pas de résumé, ni les conclusions du débat précédent. Ni les expertises du CLIS de Bure ou les livres blancs de l’ANCCLI. On ne parle même pas de textes émanant d’associations. Pourquoi ignorer les expressions citoyennes pluralistes ? Elles ne valent rien ?
Réponse du 06/01/2014,
Le site de la CPDP met à disposition du public, au-delà des documents officiels émanant de l’ANDRA ou des autorités de contrôle, l’ensemble des contributions des citoyens, associations, organismes consulaires, syndicats, partis politiques, conseils généraux, communautés de communes ... qui ont souhaité apporter leur contribution au débat public. Vous trouverez ainsi sur le site de la CPDP plus de 480 avis, 1430 questions, 104 cahiers d’acteurs (dont celui du CLIS de Bure) à la date du 27 décembre 2013. Vous trouverez également, des rapports de recherche de l’association Global Chance ou Wise paris, les contributions de MM. Laponche et Thuiller, Dessus, Blavette. Les débats qui ont eu lieu sur les ondes, les débats contradictoires sont également en ligne. Enfin, vous pouvez également trouver le compte rendu et le résumé du débat public de 2005.
QUESTION 729
Posée par ACRO, le 13/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de l'ACRO : Sachant que les autorités affirment qu’un accident nucléaire est possible en France, l’Andra a-t-elle sérieusement envisagé cette hypothèse en terme de gestion de déchets ? En cas de fusion du cœur d’un réacteur, quelle quantité de déchets supplémentaires cela engendrerait-il pour Cigéo et les autres sites ?
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
En cas d’accident d’une centrale nucléaire, les déchets les plus radioactifs proviendraient de l’enceinte du site accidenté : déchets de haute activité provenant de la récupération des éléments combustibles, certains ayant fondus, déchets de moyenne activité à vie longue, de faible et moyenne activité à vie courte et déchets de très faible activité. L’Andra n’a pas connaissance à ce stade des volumes de déchets issus du site de la centrale accidentée de Fukushima. A Tchernobyl le volume de déchets issus de l’enceinte du site accidenté est d’environ 350 000 m3.
A l’extérieur du site on trouverait essentiellement des déchets de très faible activité. A Fukushima le volume de déchets à gérer à l’extérieur du site est estimé à 30 millions de mètres-cubes (sols, débris végétaux, déchets d’assainissement) ; à Tchernobyl le volume de sols contaminés a été estimé à 15 millions de mètres cubes.
En France, l’Autorité de sûreté nucléaire a mis en place un « Comité directeur pour la gestion de la phase post-accidentelle d'un accident nucléaire » (CODIRPA) en 2005 à la demande du Gouvernement. Il s’intéresse plus particulièrement à la gestion des territoires contaminés en dehors du site d’une installation qui serait accidentée. En 2012, le CODIRPA a publié un guide présentant les principes retenus pour soutenir la gestion post-accidentelle nucléaire. Il s’attache à présenter les principales actions à mettre en œuvre ou à engager dès la sortie de la phase d’urgence ainsi que les lignes directrices pour la gestion des périodes de transition et de long terme y compris la question de la gestion des déchets. L’Andra a participé à ces travaux. Pour plus d’information, vous pouvez accéder à ce guide sur le site de l’ASN à l’adresse suivante : http://www.asn.fr/index.php/Bas-de-page/Sujet-Connexes/Gestion-post-accidentelle/Comite-directeur-gestion-de-phase-post-accidentelle/Elements-de-doctrine-pour-la-gestion-post-accidentelle-d-un-accident-nucleaire-5-octobre-2012.
Ce document ne traite que des déchets de très faible et faible activité, qui représenterait le principal flux de déchets à gérer dans une telle situation et qui peuvent être stockés en surface. Les déchets de moyenne activité à vie longue et de haute activité qui seraient produits sur le site accidenté lui-même feraient en priorité l’objet d’une mise en sécurité sur ce site. Leur transfert en stockage profond n’interviendrait que plusieurs années après. Les Japonais estiment ainsi à une quarantaine d’années le temps nécessaire au démantèlement des centrales nucléaires accidentées.
De tels déchets n’ont pas été pris en compte dans le dimensionnement du projet de stockage Cigéo car leur volume et leurs caractéristiques dépendraient du type d’accident. Il est clair qu’un tel accident bouleverserait la stratégie de gestion des déchets radioactifs et les conditions d’exploitation des stockages. Une fois les déchets de la zone accidentée mis en sécurité, il conviendrait de réexaminer le dimensionnement des centres de stockage en fonction des volumes à gérer.
QUESTION 728
Posée par Huguette MARECHAL, le 13/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de Mme Huguette Maréchal : Pourquoi démanteler les centrales en fin de vie ? Les centrales nucléaires emploient un personnel hautement qualifié, qui serait parfaitement capable de surveiller les déchets en attendant que l’avenir apporte une vraie solution. Pour quelle raison ne serait-ce pas envisageable ?
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’entreposage des déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue implique de renouveler périodiquement les bâtiments où sont placés ces déchets, avec les opérations associées de transferts de déchets radioactifs, de contrôler ces installations et de les maintenir. En cas de perte de contrôle de ces installations, les conséquences radiologiques sur l’homme et l’environnement ne seraient pas acceptables. Compte tenu de la durée pendant laquelle ces déchets resteront dangereux (plusieurs centaines de milliers d’années), l’entreposage - qu’il soit en surface ou à faible profondeur - ne peut être qu’une solution provisoire dans l’attente d’une solution définitive.
Le projet Cigéo propose une solution pour protéger sur le très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs produits en France depuis plus d’un demi-siècle. S’il est mis en œuvre, cela permettra de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations futures, alors qu’elles n’auront pas bénéficié de l’électricité procurée par la production de ces déchets. La réversibilité leur laissera la possibilité de contrôler la mise en œuvre de cette solution et de l’adapter si elles le souhaitent.
QUESTION 727
Posée par Huguette MARECHAL, le 13/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de Mme Huguette Maréchal :
S’il devait être abandonné en cours de réalisation, avec des colis déjà entreposés en surface, a-t-on mesuré l’ampleur de la catastrophe qui s’ensuivrait ?
Réponse du 15/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion des déchets radioactifs sur le long terme à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat, et non à une société privée. La loi du 28 juin 2006 a également institué un dispositif de sécurisation du financement des charges nucléaires de long terme. Il prévoit la constitution d'un portefeuille d'actifs dédiés par les exploitants nucléaires, sous le contrôle de l’Etat.
S’il était décidé d’arrêter l’exploitation du stockage, les installations ne seraient pas abandonnées. Les opérations de stockage engagées seraient achevées. Les installations de surface pourraient ensuite être démantelées. Les déchets non stockés resteraient entreposés sur les sites des producteurs de déchets.
QUESTION 726
Posée par Huguette MARECHAL, le 13/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de Mme Huguette Maréchal :
Qui paiera la remise en état d’une ancienne ligne de chemin de fer ? Depuis 1969, elle n’assure plus le transport des voyageurs. Seuls les wagons remplis de céréales parviennent jusqu’à Gondrecourt. Ensuite il faudra tout refaire. Qui devra payer ? A qui incombera ensuite l’entretien de la voie ferrée ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le réseau ferré existant est géré par Réseau Ferré de France (RFF). Les aménagement éventuels à réaliser sur ce réseau (renforcement des voies existantes…) pour les besoins du projet Cigéo ou d’autres activités relèvent de la maîtrise d’ouvrage de RFF.
S’il est décidé de créer un raccordement ferroviaire pour la desserte de Cigéo (d’environ 15 kilomètres), celui-ci serait réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de l’Andra et sa gestion serait ensuite assurée par l’Andra.
Les modalités de financement de ces aménagements sont à traiter dans le cadre du schéma interdépartemental de développement du territoire.
QUESTION 725
Posée par Cécile PONTAUD, le 13/12/2013
Que font les autres pays pour leur déchets hautement radioactifs ?
D'autres pays ont-il fait d'autres choix ? merci de votre retour
Réponse du 19/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Depuis plus de 50 ans, les chercheurs en France et à l’étranger ont étudié différents moyens de gestion des déchets radioactifs : envoi dans l’espace, au fond des océans, dans le magma, entreposage, séparation-transmutation… Le stockage est aujourd’hui considéré dans tous les pays comme la meilleure solution pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter leur charge sur les générations suivantes.
La directive européenne du 19 juillet 2011 considère effectivement que le stockage géologique constitue actuellement la solution la plus sûre et la plus durable en tant qu’étape finale de la gestion des déchets de haute activité. Tous les pays qui ont à gérer ce type de déchets s’orientent vers cette solution. Outre la France, c’est le cas par exemple des Etats-Unis, de la Finlande, de la Suède, du Canada, de la Chine, de la Belgique, de la Suisse, de l’Allemagne ou encore du Japon.
QUESTION 724
Posée par Huguette MARECHAL, le 13/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de Mme Huguette Maréchal :
Que se passera-t-il à Bure si une surchauffe des colis bitumeux provoque un incendie ? Quels produits utilisera-t-on pour l’éteindre ? Ajouteront-ils une pollution chimique à la pollution radioactive ?
Réponse du 09/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le risque incendie est pris en compte dès la conception de Cigéo : pour réduire le risque d’incendie, une première mesure consiste à limiter la quantité de produits combustibles ou inflammables dans les équipements du stockage. Par exemple, si Cigéo est réalisé, les câbles électriques seront ignifugés et les véhicules à moteur thermique seront interdits dans l’installation nucléaire souterraine de Cigéo. De plus, des dispositifs de détection incendie seront répartis dans les installations pour détecter rapidement et localiser tout départ de feu. Plusieurs systèmes d’extinction automatiques seront installés dans l’installation souterraine. Des systèmes embarqués d’extinction automatique (gaz, poudre...) seront placés sur les engins de transfert des colis de déchets et sur les engins de manutention en alvéole, afin d’éteindre tout départ de feu. Des systèmes d’extinction automatique seront également disposés dans certaines zones de l’installation souterraine telles que les locaux électriques et les zones de soutien logistique. Ces dispositifs seront mis en place en complément de moyens de lutte contre l’incendie plus traditionnels de types extincteurs, points de raccordement à un réseau d’alimentation en agent extincteur (eau, mousse…) etc.
Malgré toutes ces dispositions, une situation d'incendie est quand même considérée par prudence. Dans les installations de surface, les même principes seront appliqués que dans les installations nucléaires de base : en cas d’incendie, les locaux concernés seraient isolés du reste de l’installation, les moyens d’extinction et d’intervention seraient déclenchés et le personnel serait évacué. Dans l’installation souterraine, compte tenu de sa géométrie spécifique, ces dispositions sont adaptées dès la conception. Des systèmes de compartimentage et de ventilation sont prévus pour limiter la propagation du feu. Des équipements d’intervention seront prépositionnés dans l’installation souterraine en permanence. L'architecture souterraine retenue pour le stockage permettra aux secours d'intervenir dans des galeries à l'abri des fumées et facilite l'évacuation du personnel.
Outre la mise à l’abri du personnel, la maîtrise du risque incendie vise aussi à protéger les colis contenant les substances radioactives des effets de l’incendie afin de maintenir le confinement de ces substances. Pour cela, les colis seront disposés dans des équipements qualifiés pour résister au feu (cellules résistantes au feu munies de portes coupe-feu, hotte de protection pour le transfert dans l’installation souterraine, conteneurs en béton de plusieurs tonnes pour les colis de déchets bitumés…). Les conteneurs de stockage sont également conçus pour assurer une protection contre l’incendie. Ces dispositions permettent d’exclure tout effet domino entre les colis stockés.
La définition de l’ensemble de ces dispositifs associe les services compétents des sapeurs-pompiers et fait l’objet de contrôle par l’Autorité de sûreté nucléaire. Cigéo ne sera jamais autorisé si l’Andra ne démontre pas qu’elle maîtrise tous les risques, dont le risque d’incendie.
Concernant les effluents générés par les eaux d’extinction en cas d’incendie, un réseau de canalisations permettra d’évacuer ces effluents vers des cuves de stockage. Ceux-ci seront analysés avant de faire l’objet d’un traitement adapté à leur nature, ce qui permettra d’exclure toute pollution chimique.
QUESTION 723
Posée par Huguette MARECHAL, le 13/12/2013
Question posée dans le cahiers d'acteurs de Mme Huguette Maréchal :
Quel sera le devenir de notre économie reposant sur les richesses produites par la terre : agriculture, élevage, viticulture, fruits locaux, forêts ? Quel sort sera-t-il réservé aux appellations prestigieuses comme le champagne, le brie de Meaux, les eaux de Vittel et de Contrexeville ? Et qui du tourisme vert ?
Réponse du 08/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Cigéo est conçu pour protéger l’Homme et l’environnement. L’impact du centre en termes de radioactivité sera très inférieur à celui de la radioactivité naturelle et n’aura donc aucun impact sur la qualité des productions agricoles. L’Andra a créé l’Observatoire pérenne de l’environnement, qui a pour mission d’assurer un suivi détaillé de l’évolution de l’environnement du stockage. Cela permettra de lever ainsi toute inquiétude en démontrant que le stockage n’a pas d’impact sur les activités agricoles de proximité. Cet observatoire labellisé s’inscrit dans un grand nombre de réseaux scientifiques nationaux ou internationaux. Par ailleurs, le retour d’expérience de l’implantation de l’Andra dans l’Aube depuis 20 ans montre que l’implantation d’un centre de stockage de déchets radioactifs n’est en aucun cas incompatible, même en termes d’image, avec les activités agricoles. De nombreuses installations nucléaires coexistent en France avec des activités agricoles, sans qu’elles en souffrent. L’industrie et l’agriculture ont toujours coexisté en France, il n’y a pas de raison que cela ne dure pas.
QUESTION 722
Posée par Huguette MARECHAL, le 13/12/2013
Questions posées dans le cahier d'acteurs de Mme Huguette Maréchal : En cas de contamination accidentelle, a-t-on prévu l’évacuation des riverains ? Dans quel délai ? Quelles sommes sont-elles provisionnées pour indemniser les victimes ? A quel niveau ? Par qui ? Le personnel de nettoyage des wagons est-il employé par la SNCF elle-même ? Bénéficiera-t-il d’un suivi médical ? D’une indemnisation en cas de contamination ? Etre affecté à ce poste de travail suffira-t-il à prouver l’origine de cette contamination ? Quel serait le coût d’un accident dispersant la radioactivité dans l’environnement ? Quels organismes peuvent-ils être visés par ce texte dans le cas précis du projet Cigéo ? A BURE, avant d’être descendus dans les alvéoles, les colis seront entreposés (stock tampon) pendant un siècle et pourront contaminer l’environnement, malgré les filtrages sur les ventilations ? Peut-on exclure un risque accru de cancers ? N’est-il pas prévu une étude épidémiologique sur zone et sur zone témoin ? Sommes-nous des cobayes ?
Réponse du 10/02/2014,
Réponse apportée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
En France, les risques nucléaires sont couverts par un régime spécifique de responsabilité civile nucléaire régie par les conventions de Paris et de Bruxelles. Celles-ci définissent notamment les dommages rattachés à ces risques, l'indemnisation des victimes et les niveaux de garanties requis. Plusieurs tranches de garanties sont prévues : une première à la charge de l'exploitant (qui doit faire l'objet d'une garantie financière, un contrat d'assurance par exemple), une seconde à la charge de l'Etat et enfin une dernière à la charge d'un fonds international.
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Pour que Cigéo puisse être autorisé, l’Andra doit démontrer à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) qu’elle maîtrise les risques liés à l’installation, que ce soit pendant son exploitation ou après sa fermeture. Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels de Cigéo montre que leurs conséquences resteraient limitées, et nettement en deçà du seuil réglementaire qui imposeraient des mesures de protection des populations (mise à l’abri, évacuation).
Cigéo sera à l’origine de très faibles quantités de rejets radioactifs pendant son exploitation. Ces rejets et leurs limites devront faire l’objet d’une autorisation par l’ASN et seront strictement contrôlés. Une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que leur impact serait de l’ordre de 0,01 milliSievert par an (mSv/an) à proximité du Centre, soit très largement inférieur à la norme réglementaire (1 mSv/an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv en moyenne par an). Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses Centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’Observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les résultats de la surveillance feront l’objet d’un rapport annuel rendu public et présenté à la Commission locale d’information. Par ailleurs, Cigéo sera en permanence soumis au contrôle de l’ASN qui mandate des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant.
Malgré ce très faible impact, et pour répondre à la demande exprimée à plusieurs reprises par les acteurs locaux et notamment le Clis (Comité local d’information et de suivi du Laboratoire souterrain), l’Andra s’est rapprochée des organismes de santé publique (Institut national de veille sanitaire, Observatoires régionaux de la santé de Lorraine et de Champagne-Ardenne) pour étudier les modalités possibles d’une surveillance de la santé autour du stockage. L’Andra a saisi ses ministères de tutelle pour que la gouvernance et l’organisation d’un tel dispositif soient précisées.
Réponse apportée par AREVA :
Les déchets radioactifs sont actuellement transportés et seront transportés vers Cigéo dans des « emballages » de haute technologie et agréés par l’Autorité de Sûreté Nationale (ASN). Le retour d’expérience de plusieurs dizaines d’années confirme le haut niveau de sûreté mis en œuvre : aucun accident ayant eu des conséquences radiologiques n’est à déplorer. La résistance des emballages est testée en conditions extrêmes. En effet, la sûreté nucléaire repose d’abord sur l’emballage. Les emballages utilisés sont conçus pour assurer la protection des personnes et de l’environnement en toutes circonstances, tant dans des conditions normales que dans des situations accidentelles.
Les emballages destinés aux transports des déchets les plus radioactifs sont conçus pour être étanches et le rester même en cas d’accident (collision, incendie, immersion…). Leur étanchéité maintenue même en situation extrême permet de prévenir le risque de contamination. Par ailleurs, ces emballages sont composés de plusieurs types de matériaux permettant de réduire les niveaux d’exposition aux rayonnements pour les rendre inferieurs aux limites fixées par la réglementation.
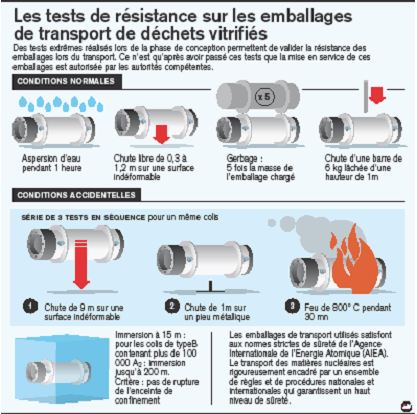
Les transports sont réalisés aujourd’hui et seront réalisés pour Cigéo dans le cadre des réglementations internationales (AIEA, ADR, RID…) et nationales en vigueur. Ces réglementations sont établies en fonction de la nature de la matière transportée et du mode de transport utilisé. En France, l’ASN est responsable du contrôle de la sûreté des transports de substances radioactives pour les usages civils.
Le transport de substances radioactives est assuré par des sociétés spécialisées et autorisées par les autorités compétentes.
Le niveau de rayonnement et la non-contamination des emballages sont vérifiés par les exploitants et des organismes indépendants à chaque étape du transport, y compris lors de changements de modes de transport. Ces mesures peuvent être vérifiées à tout moment et sur le terrain par l’ASN.
Le transport en toute sûreté de plus 6000 colis de déchets de Haute Activité et Moyenne activité à vie Longue, principalement par le rail illustrent la maîtrise des risques de contamination et d’exposition aux rayonnements.
Des mesures attestent, à chaque étape du transport (cf. figure ci-après), que les équipements sont conformes aux réglementations en vigueur et assurent la protection des personnes et de l’environnement. Pour les personnels de la SNCF, la limite applicable au public de 1 mSv/an est appliquée. A titre de comparaison, l’exposition moyenne annuelle de la population française à la radioactivité naturelle est de 2,4 mSv.
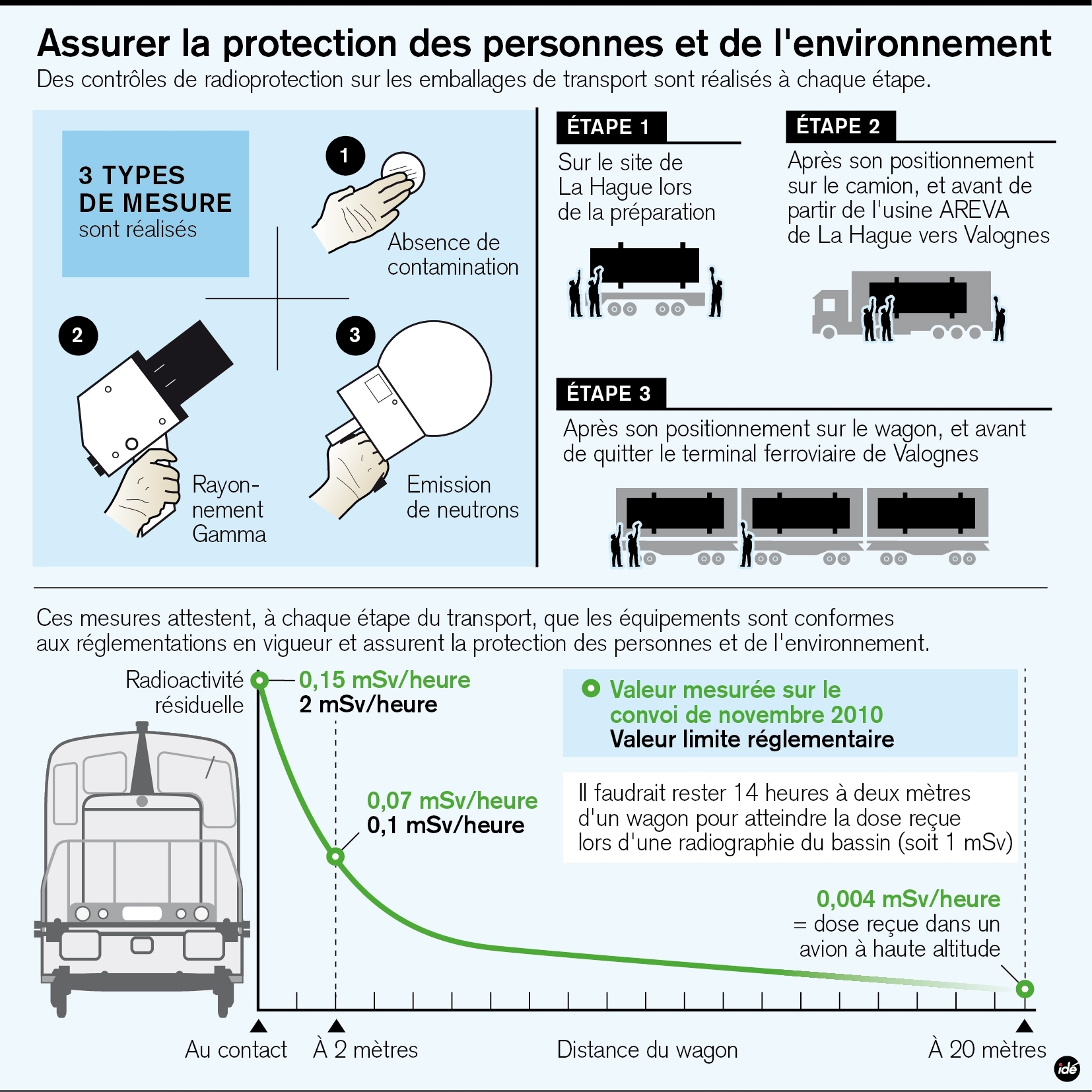
En complément de ce dispositif de prévention éprouvé, la France a mis en place un dispositif national pour gérer de potentiels accidents. Les autorités s’appuient sur les dispositifs mis en place dans le cadre des plans ORSEC et à leur déclinaison départementale. Les Préfectures sont averties par le Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle de Crises (COGIC) des transports transitant par leur département ; ce dernier assure, entre autres missions, sous l’autorité du Ministère de l’Intérieur, des responsabilités opérationnelles dans le domaine de la gestion et du suivi des transports. AREVA au travers de sa filiale AREVA TN dispose, par ailleurs, d’un plan d’urgence interne spécifique appelé PUI-T. Celui-ci couvre les phases d’alerte, d’analyse de la situation et d’intervention sur le terrain suite à un incident ou un accident de transport de matières radioactives. Il permet à AREVA TN de mettre à la disposition des autorités compétentes des moyens humains spécialisés et des matériels spécifiques. L’ensemble de ce dispositif est testé, en moyenne, chaque année à l’échelon national avec les principaux acteurs et notamment les autorités compétentes.
Il existe un cadre juridique établi par les conventions internationales qui définissent les règles d'un régime spécifique de responsabilité civile nucléaire (RCN) en cas d'accident nucléaire, notamment lors d'un transport de substances nucléaires. En effet, le régime RCN applique un certain nombre de principes directeurs qui ont vocation à permettre une indemnisation efficace et rapide des victimes éventuelles en cas d'accident nucléaire. Parmi ces principes, l'exploitant nucléaire a notamment l'obligation de maintenir une assurance ou autre garantie financière à concurrence, par accident, du montant de sa responsabilité.
Ce régime RCN, initialement appliqué en droit français par la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 modifiée relative à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, est désormais codifié dans le code de l'environnement aux articles L. 597-1 et suivants."
QUESTION 721
Posée par Huguette MARECHAL, le 13/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de Mme Huguette Maréchal :
Quelles mesures de sécurité anti-terroristes seront-elles mises en œuvre ? Quelles en seront les conséquences sur la liberté des populations locales ?
Réponse du 20/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Du fait de son implantation à 500 mètres de profondeur, le stockage est une installation peu vulnérable. En particulier, après sa fermeture, le stockage sera complètement inaccessible à toute agression depuis la surface.
Les installations de surface, nécessaires pendant la phase d'exploitation pour le contrôle et la préparation des colis de stockage, sont conçues pour protéger les opérateurs et les riverains des différents risques qui peuvent survenir. En particulier, le risque de malveillance est pris en compte par l'Andra. Des dispositions appropriées (contrôle des accès, gardiennage, résistance des bâtiments…) sont prévues pour assurer la protection des installations. Comme pour toute installation nucléaire, ces dispositions sont contrôlées par le Haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère en charge de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Pour être autorisées, les installations de Cigéo - en surface et en souterrain - devront répondre aux exigences des autorités de contrôle, qui ont été renforcées suite aux attentats de 2001.
Ces différentes mesures seront mises en œuvre dans le périmètre des installations de Cigéo et n’entraineront aucune restriction sur les libertés des populations locales.
QUESTION 720
Posée par Huguette MARECHAL, le 13/12/2013
Questions posées dans le cahier d'acteurs de Mme Huguette Maréchal : Quelle dangerosité le projet Cigéo représente-t-il dans sa phase première, le transport et l’entreposage sur surface ? Comment protégera-t-on les conducteurs des transports ? Les autres usagers de la route ? Les transports eux-mêmes contre les risques d’accident, d’attaques terroristes ? Etablira-t-on des déviations pour ne pas traverser les villages ? Comment protégera-t-on les cheminots, les voyageurs, les riverains des lignes de chemin de fer, les agriculteurs travaillent dans leurs champs et les cultures elles-mêmes ? Qil y a des gares de transfert, le problème ne sera-t-il pas encore accru puisque « un employé de la SNCF se trouvant à 3,5 mètres de la paroi du château reçoit à un mètre du sot 6,81JSv/h » ? A-t-on prévu d’équiper le personnel de dosimètres, de limiter leur temps de travail ? Déplacera-t-on les gares à bonne distance des habitations ?
Réponse du 13/02/2014,
Réponse apportée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) :
Chaque entreprise intervenant dans le transport de substances radioactives doit établir un programme de protection radiologique, tel que défini au chapitre 1.7.2 de l’ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route) pour la route et du RID (Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail) pour le rail. Ce programme permet l’évaluation de la dose que subit chaque personne de l’entreprise au cours d’une année.
Ainsi, si un conducteur est susceptible de recevoir entre 1 mSv et 6 mSv par an, il faut appliquer un programme d'évaluation des doses par le biais d'une surveillance des lieux de travail (cabine) ou d’une surveillance individuelle. Si un conducteur est susceptible de recevoir plus de 6 mSv en un an, il faut procéder à une surveillance individuelle. Le chauffeur devra alors obligatoirement porter un dosimètre.
La sûreté des transports de substances radioactives à usage civil est contrôlée en France par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), sur la base d’inspections et de l’instruction de demandes d’agrément d’emballages. Ce contrôle vise à assurer la protection des personnes et de l’environnement. Il porte sur la conception des emballages et les opérations de transports qui sont soumises à des contraintes réglementaires rigoureuses.
Les emballages doivent notamment assurer un confinement des substances radioactives transportées et fortement réduire le rayonnement à l’extérieur du colis.
Le RID (réglementation ferroviaire) impose, à l’alinéa b du paragraphe 7.5.11 CW 33 (3.3), un débit de dose maximal à 2 mètres du wagon de 0,1 mSv/h. La dose annuelle du public étant de 1 mSv /an , elle serait atteinte en 10 heures continues à 2 mètres du wagon.
Ce scénario est peu réaliste puisque d'une part les personnes du public se trouvent en général à bien plus de 2 mètres, d'autre part, sauf cas particulier, le wagon est roulant et l'exposition est de l'ordre de quelques dizaines de secondes.
Vous mentionnez qu’« un employé de la SNCF se trouvant à 3,5 mètres de la paroi du château reçoit à un mètre du sot 6,81JSv/h ». D'après les éléments en notre possession, les cheminots ne sont pas exposés en moyenne à plus d'1mSv/an. Conformément à la réglementation (article 1.7.2. du RID), une évaluation des doses susceptibles d'être reçues est rendue obligatoire pour estimer les risques d'exposition des travailleurs.
Concernant le risque terroriste, les substances les plus sensibles du point de vue de la prévention des actes de malveillance relevant du code de la défense font l’objet de dispositions spécifiques. À ce titre, les itinéraires sont validés par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère chargé de l’environnement.
Concernant les risques d’accident, les modèles de colis sont soumis à des épreuves réglementaires destinées à démontrer leur résistance lors du transport. Le niveau d’exigence de ces épreuves est proportionné à la dangerosité des substances transportées. À titre d’exemple, les modèles de colis correspondant aux substances les plus dangereuses doivent conserver leurs fonctions de sûreté, y compris en cas d’accident (simulé par une chute de 9 m sur une surface indéformable, une chute de 1 m sur un poinçon, un incendie d’hydrocarbure totalement enveloppant de 800° C minimum pendant 30 mn, une immersion dans l’eau à une profondeur de 200 m).
En cas d’accident, le préfet du département concerné dirige les opérations de secours et prend les mesures nécessaires pour assurer la protection de la population et des biens menacés par l’accident. Il s’appuie sur des plans d’urgence spécifiques aux transports de substances radioactives. L’ASN apporte son concours au préfet sur la base du diagnostic et du pronostic de l’accident et des conséquences effectives et potentielles.
De leur côté, le transporteur et l’expéditeur doivent mettre en œuvre une organisation et des moyens permettant de faire face à une situation incidentelle ou accidentelle, d’en évaluer et d’en limiter les conséquences, d’alerter et d’informer régulièrement les autorités publiques.
Des exercices sont menés régulièrement par les responsables de transport et les pouvoirs publics
QUESTION 719
Posée par Guillaume BLAVETTE, le 13/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de M. Guillaume Blavette : Transports des déchets :
Les départements de la Meuse et de la Haute-Marne pourront-ils supporter la charge de ce trafic ?
Réponse du 30/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Si Cigéo est autorisé, le transport des colis de déchets se ferait majoritairement par voie ferrée.
Le réseau ferré national permet d’acheminer les convois jusqu’à proximité de Cigéo. La desserte locale de Cigéo est étudiée dans le cadre du schéma interdépartemental de développement du territoire (voir carte). L’arrivée et le déchargement des trains se feraient dans un terminal ferroviaire spécifique. Deux options sont possibles :
- Soit le terminal ferroviaire est implanté sur une voie ferroviaire existante en Meuse ou en Haute-Marne. Le transport final jusqu’à Cigéo serait alors réalisé par voie routière.
- Soit le terminal ferroviaire est implanté sur le site même de Cigéo, ce qui nécessiterait de créer un raccordement ferroviaire d’environ 15 km.
Plus d’information sur le transport des colis de déchets (chapitre 4.3)
../docs/dmo/chapitres/DMO-Andra-chapitre-4.pdf
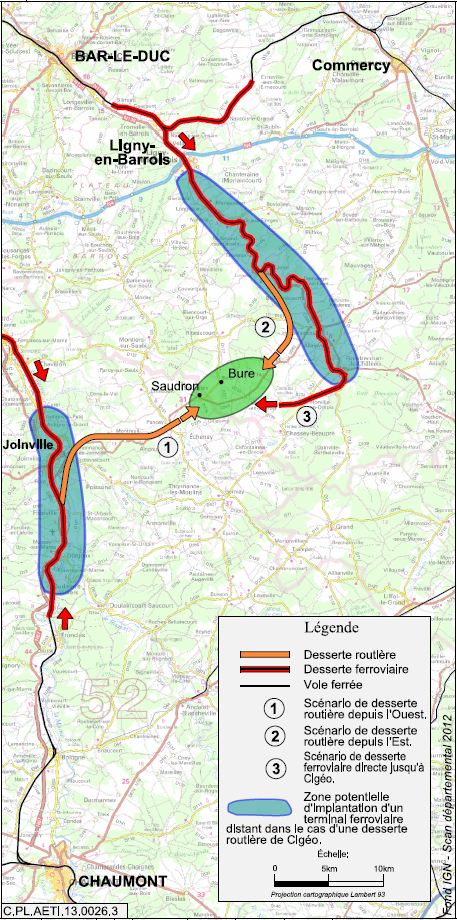
QUESTION 718
Posée par Bernard GONDOUIN, le 13/12/2013
Questions posées dans le cahier d'acteurs de M. Bernard Gondouin : Combien de chercheurs de tous les horizons ont travaillé et travaillent sur le projet Cigéo ? Combien ont des doutes sur leurs découvertes, sur l’interprétation et l’exploitation de leurs propres calculs, de leurs modélisations ? N’y aurait-il pas un problème d’indépendance des chercheurs rémunérés directement ou indirectement par l’Andra ? Combien sont suffisamment libres et indépendants pour s’exprimer en leur âme et conscience ? Quel est l’apport de nombreux programmes européens, ou mondiaux ? Quel est le rôle des fréquents colloques nationaux et internationaux ? Notez également les appels à projets également rémunérée… jusqu’à 70.000€. Peut-on imaginer une thèse ainsi rémunérée qui conclurait qu’il ne faut pas enfouir ? Pourquoi faire davantage confiance ne la géologie qu’en la société ? Peut-on faire confiance aux scientifiques ? On en vient même à se demander si la question des déchets nucléaires n’est pas trop sérieuse pour être laissée aux seuls scientifiques. Le Déaut entend instaurer un « Conseil stratégique de la recherche » chargé de définir les grandes orientations de la stratégie nationale de recherche, qui sera placé près du Premier ministre et piloté par le ministre de la Recherche, Conseil qui s’appuiera sur les compétences des 5 alliances thématiques, une mission transversale confiée au CNRS, avec l’expertise de l’OPECST. Quelle peut-être l’indépendance de ce conseil stratégique de la Recherche, piloté par l’OPECST ?
Réponse du 28/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Concernant vos questions relatives au projet Cigéo
L’intégrité est une valeur partagée par l’ensemble des hommes et des femmes qui travaillent à l’Andra et il n’est pas acceptable de douter de leur conscience professionnelle. Certains d’entre eux ont d’ailleurs pris l’initiative de témoigner de leur expérience personnelle lors du débat public. Nous vous invitons à lire leur cahier d’acteurs, qui répond à vos interrogations (« Cigéo : c’est aussi des hommes et des femmes responsables qui travaillent avec passion et rigueur sur un projet d’intérêt général », cahier d’acteurs de salariés de l’Andra, n°142).
Pour mener les recherches sur la gestion des déchets radioactifs, l’Andra mobilise la communauté scientifique dans de nombreuses disciplines (sciences de la Terre et de l’environnement, chimie, science des matériaux, mathématiques appliquées…) au travers de partenariats avec des organismes de recherche et des établissements universitaires français (10 organismes et établissements universitaires partenaires, 70 laboratoires académiques). Le travail des doctorants au cours de la préparation de leur thèse est de faire de la recherche sur une question scientifique précise. Leurs résultats sont évalués par des chercheurs compétents dans le domaine de recherche concerné. L’Andra s’appuie également sur des coopérations internationales. L’Andra a ainsi participé à 12 programmes européens de recherche depuis 2006. Ces participations lui permettent de confronter les points de vue et de partager son savoir-faire et son expérience.
L’ensemble de ces travaux font l’objet de publications dans des revues à comités de lecture (50 à 70 publications scientifiques internationales par an depuis 10 ans) et sont évalués par des instances indépendantes, en particulier la Commission nationale d’évaluation, mise en place par le Parlement, et l’Autorité de sûreté nucléaire qui s’appuie sur l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Les grands dossiers scientifiques et techniques que l’Andra remet dans le cadre de la loi font l’objet, à la demande de l’Etat, de revues internationales sous l’égide de l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’OCDE. L’Andra a également été évaluée en 2012 par l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES). Enfin, des expertises sont régulièrement commandées par le Comité local d’information et de suivi du Laboratoire souterrain sur les grands dossiers de l’Andra ou sur des sujets plus ciblés.
Dans son rapport d’évaluation en 2012, l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Aeres) considère que « l’Andra est probablement l’un des établissements les plus évalués de France y compris et surtout dans son activité de recherche. »
Tous ces éléments sont des gages de la robustesse de la démarche qui est mise en œuvre pour garantir la sûreté du projet.
Contrairement à ce que vous indiquez, la question des déchets radioactifs ne relève pas des seuls scientifiques. C’est le Parlement qui fixe le cadre des recherches menées sur la gestion des déchets radioactifs et qui fixera les conditions de réversibilité du stockage. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra à l’État après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création du stockage. Ce processus comprendra notamment l’évaluation de la sûreté par l’Autorité de sûreté nucléaire, l’évaluation des recherches scientifiques par la Commission nationale d’évaluation, l’avis des collectivités territoriales et une enquête publique.
Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de ces déchets. Grâce à la réversibilité, ces générations garderont la possibilité de faire évoluer cette solution. L’Andra propose ainsi que des rendez-vous réguliers soient programmés avec l’ensemble des acteurs (riverains, collectivités, scientifiques, évaluateurs, État…) pour contrôler le déroulement du stockage et pour préparer chaque décision importante concernant les étapes suivantes.
Le débat public de 2005/2006 s’était conclu sur la question : faut-il faire confiance à la géologie ou à la société ? La conviction de l’Andra est qu’il faut faire confiance à la géologie ET à la société. C’est notre définition du stockage réversible.
Concernant votre question relative à la mise en place d’un conseil stratégique de la recherche
Le Conseil Stratégique de la Recherche a été installé le 19 décembre2013. Son rôle, sa gouvernance et sa composition sont donnés sur le site ci-après: http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid75992/installation-du-conseil-strategique-de-la-recherche.html
QUESTION 717
Posée par CEDRA, le 13/12/2013
Questions posées dans le cahier d'acteurs du CEDRA : Comment faire confiance à un projet qui n’est qu’un pari sur l’avenir ? Comment faire confiance à un processus où la démocratie est bafouée ? Comment faire confiance à un projet et à un processus dans l’erreur ?
Réponse du 28/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le projet Cigéo n’est pas un pari sur l’avenir, contrairement à l’entreposage. Le rôle du stockage profond est de mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs, pour ne pas reporter leur charge indéfiniment sur les générations futures. Après plus de 20 années de recherches et leur évaluation, seul le stockage profond est aujourd’hui reconnu en France et à l’étranger comme une solution robuste pour mettre en sécurité définitive les déchets les plus radioactifs produits depuis plusieurs dizaines d’années en France.
Contrairement à ce que vous indiquez, la démocratie n’est pas bafouée. Le Parlement s’est saisi de la question des déchets radioactifs dès 1991. C’est lui qui définit les orientations de la politique nationale de gestion des déchets radioactifs et c’est lui qui fixera les conditions de réversibilité du stockage. Même si les réunions publiques ont été empêchées, les très nombreuses contributions pendant le débat public (questions, cahiers d’acteurs, interventions dans les médias…) montrent l’implication de nos concitoyens sur les enjeux liés à la gestion des déchets radioactifs et donnent à l’Andra des orientations pour la suite du projet.
La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra à l’État après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création du stockage. Ce processus comprendra notamment l’évaluation de la sûreté par l’Autorité de sûreté nucléaire, l’évaluation des recherches scientifiques par la Commission nationale d’évaluation, l’avis des collectivités territoriales, le vote d’une loi fixant les conditions de réversibilité et une enquête publique. La création du stockage ne pourra être autorisée que si l’Andra démontre qu’elle maîtrise les risques.
Comment faire confiance au projet et au processus ? Le débat public de 2005/2006 s’était conclu sur la question : faut-il faire confiance à la géologie ou à la société ? La conviction de l’Andra est qu’il faut faire confiance à la géologie ET à la société. C’est notre définition du stockage réversible.
Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de ces déchets. Grâce à la réversibilité, ces générations garderont la possibilité de faire évoluer cette solution si elles le souhaitent. L’Andra propose ainsi que des rendez-vous réguliers soient programmés avec l’ensemble des acteurs (riverains, collectivités, associations, scientifiques, évaluateurs, État…) pour contrôler le déroulement du stockage et pour préparer chaque décision importante concernant les étapes suivantes.
QUESTION 716
Posée par Irène GUNEPIN, le 13/12/2013
Questions posées dans le cahier d'acteurs de Mme Irène GUNEPIN : L’Andra peut-elle démontrer qu’elle maîtrise le risque de pollution du Bassin parisien et du Bassin mosan ? En cas de contamination, qui indemniserait les riverains ? Qui assurerait la dépollution et avec quel financement ?
Réponse du 30/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Concernant votre question relative à la maîtrise du risque de pollution
La protection à très long terme de l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Les générations futures pourront continuer à assurer une surveillance du site aussi longtemps qu’elles le souhaiteront. Néanmoins, le stockage restera sûr même si le site venait à être oublié, contrairement à un entreposage, qu’il soit en surface ou en subsurface.
Les recherches menées depuis 1994 sur le site étudié en Meuse/Haute-Marne ont permis aux scientifiques de reconstituer de manière détaillée son histoire géologique, depuis plus de 150 millions d’années. Le site étudié se situe dans la partie Est du bassin de Paris qui constitue un domaine géologiquement simple, avec une succession de couches de calcaires, de marnes et de roches argileuses qui se sont déposées dans d’anciens océans. Les couches de terrain ont une géométrie simple et régulière. Cette zone géologique est stable et caractérisée par une très faible sismicité. La couche argileuse étudiée pour l’implantation éventuelle du stockage, qui s’est déposée il y a environ 155 millions d’années, est homogène sur une grande surface et son épaisseur est importante (plus de 130 mètres). Aucune faille affectant cette couche n’a été mise en évidence sur la zone étudiée.
Cette analyse s’appuie sur des investigations géologiques approfondies : plus de 40 forages profonds ont été réalisés, complétés par l’analyse de plus de 300 kilomètres de géophysique 2D et de 35 km² de géophysique 3D. Environ 50 000 échantillons de roche ont été prélevés.
La roche argileuse a une perméabilité très faible, ce qui limite fortement les circulations d’eau à travers la couche et s’oppose au transport éventuel des radionucléides par convection (c’est-à-dire par l’entraînement de l’eau en mouvement). Cette très faible perméabilité s’explique par la nature argileuse, la finesse et le très petit rayon des pores de la roche (inférieur à 1/10 de micron). L’observation de la distribution dans la couche d’argile des éléments les plus mobiles comme le chlore ou l’hélium confirme qu’ils se déplacent majoritairement par diffusion et non par convection. Cette « expérimentation », à l’œuvre depuis des millions d’années, confirme que le transport des éléments chimiques se fait très lentement (plusieurs centaines de milliers d’années pour traverser la couche). Les études menées par l’Andra ont montré que l’impact du stockage serait nettement inférieur à celui de la radioactivité naturelle à l’échelle du million d’années.
Concernant vos questions suivantes
Il est possible de vous indiquer comment fonctionne la responsabilité civile nucléaire aujourd'hui. Les risques nucléaires sont couverts par un régime spécifique de responsabilité civile nucléaire régie en France par les conventions de Paris et de Bruxelles. Celles-ci définissent notamment les dommages rattachés à ces risques, l'indemnisation des victimes et les niveaux de garanties requis. Plusieurs tranches de garanties sont prévues : une première à la charge de l'exploitant (qui doit faire l'objet d'une garantie financière, un contrat d'assurance par exemple), une seconde à la charge de l'Etat et enfin une dernière à la charge d'un fonds international.
QUESTION 715
Posée par Dominique LORRAIN, le 13/12/2013
Questions posées dans le cahier d'acteurs de Dominique Lorrain :
Dans les relations internationales et les négociations autour du climat les pays émergents font valoir que le taux actuel de CO2 s’impute plus à l’industrie des pays riches qu’à leur propre développement. Dans ces conditions ils demandent à ces pays de faire l’effort principal. Pourquoi ce qui vaut comme principe de négociation entre Etats, ne s’appliquerait pas à l’intérieur d’un pays. Est-ce à dire qu’en dehors des traités s’applique la loi de la majorité au détriment des petits territoires ? Est-ce à dire aussi que l’intérieur du même espace politique il existe des territoires qui ont vocation aux emplois de qualité, aux équipements publics et à toutes les aménités du monde moderne et d’autres qui feraient office de réceptacle des scories du développement ? En un mot Paris-lumière versus Meuse-profonde. Si déchets nucléaires il y a, la Meuse y a contribué pour une part infime.
Réponse du 07/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le site de Meuse/Haute-Marne a été choisi pour ses propriétés géologiques.
En effet, pour des raisons de sûreté, ces déchets nécessiteront d’être stockés en profondeur pour garantir leur mise en sécurité définitive. Ce type de stockage doit être implanté dans un milieu géologique favorable (stabilité géologique, très faible sismicité…) et une couche de roche dont les propriétés permettent le confinement des déchets sur de très longues échelles de temps (profondeur et épaisseur suffisante, stabilité, faible perméabilité, propriétés de rétention…).
La loi de recherche du 30 décembre 1991 prévoyait la réalisation de laboratoires souterrains pour l’étude des possibilités de stockage dans les formations géologiques profondes. Suite à une mission de concertation lancée fin 1992 et à des premières analyses géologiques, quatre sites candidats avaient été identifiés dans les départements du Gard, de la Meuse, de la Haute-Marne (couches argileuses) et de la Vienne (couche granitique). L’Andra a été autorisée par le Gouvernement à mener des investigations géologiques sur ces sites dans le but de savoir s’il était intéressant d’y construire un laboratoire souterrain pour continuer les études. En 1996, l’Andra a déposé trois dossiers de demandes d’installation de laboratoires souterrains. Les résultats des investigations géologiques ont montré que la géologie du site en Meuse/Haute-Marne (les deux sites ont été fusionnés en une seule zone en raison de la continuité de la couche argileuse étudiée) était particulièrement favorable. Concernant le Gard, le site présentait une plus grande complexité scientifique liée à son évolution géodynamique à long terme et faisait l’objet d’oppositions locales. L’instruction du dossier relatif au site étudié dans la Vienne n’a pas abouti à un consensus scientifique sur la qualité hydrogéologique du massif granitique.
En 1998, le Gouvernement a décidé la construction d’un laboratoire de recherche souterrain en Meuse/Haute-Marne et la poursuite des études pour trouver un autre site dans une roche granitique. La recherche d’un site dans une roche granitique a finalement été abandonnée, la mission de concertation n’ayant pas abouti. L’Andra a toutefois poursuivi ses recherches sur le milieu granitique jusqu’en 2005, en s’appuyant notamment sur les connaissances déjà disponibles sur les massifs granitiques français et sur les travaux menés dans les laboratoires souterrains d’autres pays (Suède, Canada, Suisse). Ces recherches ont conduit l’Andra à conclure en 2005 qu’un stockage dans les massifs granitiques ne présenterait pas de caractère rédhibitoire mais que la principale incertitude porte sur l’existence de sites en France avec un granite ne présentant pas une trop forte densité de fractures.
En s’appuyant sur l’ensemble des recherches menées sur le site de Meuse/Haute-Marne depuis 1994, l’Andra a montré que ce site présente des caractéristiques favorables pour assurer la sûreté à long terme d’un éventuel stockage. La Commission nationale d’évaluation mise en place par le Parlement pour évaluer sur le plan scientifique les travaux de l’Andra souligne ainsi dans son rapport 2012 : « le site géologique de Meuse/Haute-Marne a été retenu pour des études poussées, parce qu’une couche d’argile de plus de 130 m d’épaisseur et à 500 m de profondeur, a révélé d’excellentes qualités de confinement : stabilité depuis 100 millions d’années au moins, circulation de l’eau très lente, capacité de rétention élevée des éléments ».
QUESTION 714
Posée par Daniel RUHLAND, le 13/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de M. Daniel RUHLAND : Enfin, parmi les questions qui nécessitent également une réponse, l’environnement : Stocker des roches extraites du sous-sol relève de l’évidence puisque des kilomètres de tunnel sont envisagés pour le stockage pérenne… Si, comme les opposants l’ont signalé, ces roches argileuses se dégradent en présence d’eau, que va devenir le paysage (recouvert d’environ 10 mètres de remblais sur des centaines d’hectares), va-t-il y avoir des pollutions locales induites par ces remblais « dégradables » ? Quel va être l’effet sur la faune giboyeuse et la végétation ?
Réponse du 30/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’Andra dispose d’un retour d’expérience d’une dizaine d’années sur la verse du Laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne. Leur impact sur l’environnement est maîtrisé et elles n’ont pas d’effet sur la faune giboyeuse et la végétation.
Les études d’avant-projet permettront de définir les dispositions à mettre en œuvre pour leur insertion paysagère et pour protéger l’environnement des effets liés au lessivage des verses par les eaux de pluie. Plusieurs dispositions techniques peuvent être utilisées (modelage, végétalisation, mise en place de bassins de collecte des eaux de ruissellement, dispositifs de traitement de ces eaux avant rejet vers le milieu naturel si nécessaire). Elles pourront faire l’objet d’échanges avec les acteurs locaux.
Ces dispositions seront décrites dans l’étude d’impact jointe à la demande d’autorisation de création du projet Cigéo, qui sera soumise à enquête publique.
QUESTION 713
Posée par Daniel RUHLAND, le 13/12/2013
Questions posées dans le cahier d'acteurs de M. Daniel RUHLAND : Compte tenu de la taille du chantier associé à Cigéo se pose la question des transports, de la qualité des routes et peut-être du prolongement d’une voie de chemin de fer (entre Gondrecourt et Bure/Saudron ?). Comment la population peut-elle être associée à ces évolutions envisagées ? Ou subira-t-elle les nuisances induites par les transports ? En effet, en dehors du transport possible des salariés, les remblais liés à l’extraction de dizaines de milliers de tonnes de roche (situés à moins de 500m) et le transport des matériaux de construction (ciment – sable – granulats – etc) vont entrainer des passages qui pourraient être de l’ordre de quelques centaines de camions par jour (1 par minute environ). La résolution des nombreuses nuisances acoustiques, vibratoires, poussières, etc passe par une étude qui n’est pas réellement évoquée dans le document du Maître d’Ouvrage (DMO). Comment protéger nos concitoyens de ces nuisances ?
Réponse du 06/02/2014,
Réponse apportée par le Directeur du Schéma interdépartemental de développement du territoire :
Lors du dernier Comité de Haut Niveau, la Ministre de l'Ecologie du Développement Durable et de l'Energie a demandé à Madame la préfète de la Meuse, préfète coordinatrice, de faire des propositions à l'issue du débat public sur la gouvernance du développement territorial qui serait impacté par Cigéo. La mise en œuvre du Schéma Interdépartemental de Développement du territoire passe en effet par une évolution de la gouvernance du projet de territoire, qui tient compte des investissements à réaliser, ainsi que du point de vue des communes et intercommunalités les plus impactées par les développements envisagés. Il est clair que la mise à niveau des infrastructures bénéficiera également aux déplacements des populations et des activités économiques du territoire. Ces opérations d’aménagement seront soumises à leurs propres concertations publiques.
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Si Cigéo est autorisé, l’Andra privilégiera une gestion des roches extraites lors du creusement des galeries souterraines à proximité immédiate des installations de surface de Cigéo pour limiter les transports associés. Pendant la phase de construction initiale des installations, des flux de matériaux seront nécessaires entre la zone descenderies et la zone puits, qui sont distantes d’environ 5 km. La desserte entre les deux zones devra être définie en concertation avec les acteurs locaux dans le cadre du schéma interdépartemental de développement du territoire. Après la phase de construction initiale, l’ensemble des matériaux excavés seront extraits par les puits et stockés directement dans les verses attenantes à cette zone, ce qui limitera les flux de transports de matériaux entre les deux sites.
L’approvisionnement des matériaux nécessaires à la construction de Cigéo relèvera de la responsabilité des entreprises qui seront chargées de la construction de Cigéo. Les modes de transport qu’elles utiliseront dépendront des infrastructures à proximité des sites de production de ces matériaux et des infrastructures disponibles à proximité de Cigéo. A ce titre, l’Andra souhaite examiner avec les acteurs locaux les infrastructures qui pourraient être réalisées pour encourager l’utilisation du transport ferroviaire et du transport fluvial.
Ce schéma local de transports doit être défini dans le cadre du schéma interdépartemental de développement du territoire, avec le double objectif d’assurer une desserte de Cigéo permettant de limiter autant que possible les nuisances liées aux transports et de contribuer au développement du territoire. Ces dispositions seront présentées dans l’étude d’impact du projet jointe à la demande d’autorisation de création de Cigéo, qui fera l’objet d’une enquête publique.
QUESTION 712
Posée par Daniel RUHLAND, le 13/12/2013
Questions posées dans le cahier d'acteurs de M. Daniel RUHLAND :
Il existe de nombreuses productions agricoles de haute qualité et de leurs transformations industrielles (en nombre plus restreint). L’image « déchets », radioactifs de surcroît, est-elle porteuse d’une image positive pour permettre un redéploiement industriel et agricole, nécessaires pour le devenir du canton ? L’achat de terrains agricoles par l’Andra sera-t-il un facteur d’augmentation des prix des terres agricoles et/ou un moyen de limiter encore la population des agriculteurs, réelle force vive du canton ?
Réponse du 08/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Cigéo est conçu pour protéger l’Homme et l’environnement. L’impact du centre en termes de radioactivité sera très inférieur à celui de la radioactivité naturelle et n’aura donc aucun impact sur la qualité des productions agricoles. L’Andra a créé l’Observatoire pérenne de l’environnement, qui a pour mission d’assurer un suivi détaillé de l’évolution de l’environnement du stockage. Cela permettra de lever ainsi toute inquiétude en démontrant que le stockage n’a pas d’impact sur les activités agricoles de proximité. Cet observatoire labellisé s’inscrit dans un grand nombre de réseaux scientifiques nationaux ou internationaux. Par ailleurs, le retour d’expérience de l’implantation de l’Andra dans l’Aube depuis 20 ans montre que l’implantation d’un centre de stockage de déchets radioactifs n’est en aucun cas incompatible, même en termes d’image, avec les activités agricoles.
En tant qu’exploitant de Cigéo, si celui-ci est autorisé, l’Andra devra être propriétaire des terrains où seraient implantées les installations de surface du Centre et où seraient aménagées les voies d’accès nécessaires. L’Andra est consciente que cette obligation pourrait engendrer la disparition ou la déstructuration d’exploitations agricoles. Afin d’éviter toute expropriation, l’Andra a engagé des acquisitions foncières en Meuse et en Haute-Marne (exploitations, terres agricoles et terrains boisés) lui permettant de constituer une réserve pour procéder à des échanges (par des actes notariés ou par des actes administratifs amiables) ou pour restructurer les exploitations concernées si besoin. Cette démarche a déjà été conduite pour la construction du Centre industriel de regroupement, d’entreposage et de stockage (Cires) ouvert dans l'Aube en août 2003. Ce système avait correctement fonctionné et permis d'obtenir les terrains nécessaires par de simples actes de ventes ou d'échanges.
Afin de ne pas remettre en cause la viabilité des exploitations et proposer des modalités appropriées, l’Andra sera d’autant plus vigilante concernant les élevages dont les contraintes sont les plus fortes (notamment en ce qui concerne l’alimentation ou l’abreuvement des animaux). Rappelons également que l’emprise des installations de surface de Cigéo, occuperait environ 300 hectares, soit un peu plus que la superficie d’une exploitation agricole moyenne en Meuse, ce qui ne déstabilisera pas la production agricole locale.
Concernant les prix, l’Andra achète systématiquement au prix du marché, ce qui est régulé et contrôlé par les Safer et France Domaine.
QUESTION 711
Posée par Daniel RUHLAND, le 13/12/2013
Questions posées dans le cahier d'acteurs de M. Daniel RUHLAND :
Si les travaux doivent durer moins de 20 ans, peut-on envisagé la création de logements « en dur » dans le canton pour une durée aussi limité ? Si oui, cela pourrait autoriser, pour autant que ces travailleurs viennent avec leurs familles, la présence de médecins, de commerces, d’écoles, fortement désirée par les habitants. Si non, parce qu’ils viennent seuls, où vont-ils habiter ? Cette question d’un possible « guetto » doit être abordée. En effet, s’ils occupent des logements provisoires de type « ALGECO » au voisinage du chantier, comment vont-ils pouvoir être associés/assimilés à la population actuelle ? S’ils viennent des villes avoisinantes, qu’apporteront-ils à l’économie locale du canton, en dehors des passages de bus les transportant à leur travail ? Si cela se passe comme pour la construction de l’EPR de Flamanville (centrale nucléaire en construction en Normandie), plusieurs dizaines de nationalités différentes se côtoieraient sur le chantier gigantesque pour le canton. Comment alors, au nom du bien-être maintenu (plutôt amélioré ?) des habitants, aborder cette réelle question ? Si seuls de très grands groupes de BTP sont concernés, comment pourra-t-on envisager sereinement la reprise d’activité des demandeurs d’emploi de la sous-région (les trois cantons) et la création de PME dans le domaine ? D’ailleurs, remarquons que la construction du laboratoire de l’Andra n’a pas permis l’implantation de telles PME dans le canton de Montiers. Qu’en sera-t-il en termes de retombées économiques dans le futur ? A ce sujet, pour soutenir une reprise d’activités économiques, le canton ne pourrait-il pas envisager le recours à des formations spécialisées, effectuées sur place, pour permettre le redéploiement souhaité (et limiter en partie l’afflux de main-d’œuvre extérieure, venant travailler sur des périodes courtes, en sachant que cette population est difficilement intégrable) ? Pour aller dans cette direction possible, il serait souhaitable que les pouvoirs publics prennent en considération cette volonté d’une activité du canton, ouverte sur le futur, en arrêtant déjà de fermer des classes dans les écoles, voire des écoles.
Réponse du 06/02/2014,
Réponse apportée par le Directeur du Schéma interdépartemental de développement du territoire :
Cette question relève en effet des enjeux auxquels le territoire doit faire face pour l'accueil de nouvelles populations. La phase de chantier s'étend entre 2017 et 2025 mais également sur une durée de 20 ans compte tenu de la concomitance des activités industrielles de stockage avec la poursuite des travaux des phases ultérieures. Cette période peut être considérée comme suffisamment large pour un accueil durable des travailleurs (et de leurs familles) en déplacement. Si on regarde ce qui a été fait sur d'autres opérations "grands chantier", on s'aperçoit que cette durée est plus vaste qu'un chantier d'infrastructure (ligne TGV, par exemple) et que dans le cas de Cigéo, l'intégration dans le territoire des travailleurs et de leur famille est une réalité. Les expériences menées dans le cadre de ces "grands chantiers" sont nombreuses pour permettre le logement des employés en s'intégrant aux tissus ruraux de leurs implantations.
La question du logement est centrale, en effet, pour la revitalisation du cadre bâti et pour les impacts de l'implantation de ménages sur l'économie locale. A l'instar des "grands chantier" français, sur une période aussi longue, les conditions d'accueil des ménages ont été proposées suivant différentes formes:
- logements temporaires proposés par les entreprises à leurs employés ;
- accueil dans les gîtes ruraux (ce qui est la cas actuellement pour les déplacements liés au laboratoire, avec un taux de remplissage élevé), avec information interactive des disponibilités ;
- logements meublés (pour les familles en déplacements), logements locatifs proposés par l'entreprise ou dans un conventionnement avec les bailleurs sociaux ou acquisitions de logements neufs ou anciens.
Le projet de Schéma interdépartemental de développement du territoire Meuse-Haute-Marne a identifié ces enjeux et propose de les anticiper dès à présent, dans une programmation de l'offre de logements et un accompagnement des communes (qu'elles soient à proximité ou plus éloignées) afin qu'elles élaborent leurs propres stratégies de développement en fonction des objectifs qu'elles se seront fixés et en tenant compte des hypothèses de localisations temporaires (sur une vingtaine d'années) ou durables des ménages. Des solutions peuvent également être mises en œuvre avec les entreprises qui interviendront sur le chantier et qui ont en partie la responsabilité de loger leurs employés. Des solutions peuvent également être mises en œuvre pour proposer une offre de logements modulables qui pourraient se voir adaptés à la demande en fonction des phases du projet. L'élaboration des documents de planification procède de cette démarche, en particulier les Schémas de cohérence territoriale.
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Des incitations à recruter localement seront demandées aux entreprises impliquées pendant la phase de construction de Cigéo tout en respectant les dispositions règlementaires de passation des marchés. Ainsi, au niveau de ses commandes et de ses contrats, l’Andra prévoit des règles d’équité sous forme de clauses destinées à juger de la valeur sociale des offres qui lui permettront notamment de prendre en compte le recours à l’emploi local et la formation des acteurs locaux.
Ces mesures ont déjà fait leurs preuves pour le Laboratoire souterrain et les Centres de l’Andra dans l’Aube. Leurs activités ont généré annuellement plusieurs millions d’euros de commandes à des entreprises locales (Meuse, Haute-Marne, Aube). En 2012, dans les Centres de l’Aube, plus de 35% des commandes ont été passées à des entreprises locales. Il en résulte que le nombre d’entreprises locales capables de travailler avec l’Andra à l’avenir augmente. La pratique montre également que les grands groupes qui répondent à nos appels d’offres ont souvent recours à des co-traitants, antennes ou filiales locaux.
L’accueil des travailleurs en déplacement est discuté dans le cadre du schéma interdépartemental de développement du territoire élaboré sous l’égide de la préfecture de la Meuse. L’hébergement en structures provisoires à proximité du chantier, en gîtes ou en logements meublés est proposé parmi les services pouvant être mis à leur disposition. Le schéma permettra de coordonner les acteurs du logement pour mettre à disposition une offre locative adaptée aux besoins. Le retour d’expérience d’autres grands chantiers, tels que celui de Flamanville, pourra être approfondi pour veiller à mettre en œuvre des modalités d’accueil qui permettent des relations harmonieuses avec les riverains.
QUESTION 710
Posée par Daniel RUHLAND, le 13/12/2013
Questions posées dans le cahier d'acteurs de M. Daniel RUHLAND :
Selon les dires, le coût de Cigéo, très important, pourrait être compris entre 15 milliards d’€ et plus de 100 milliards d’€ (est-ce en fonction de la qualité du processus envisagé de réversibilité ?) ; l’absence de certitude sur un coût (certes estimé) n’est-elle pas liée à une imprécision sur les moyens à mettre en œuvre pour éviter tous risques ? Quelle confiance pour les populations proches du site envisagé ?
Réponse du 06/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le but du stockage est de ne pas reporter indéfiniment la charge des déchets radioactifs sur les générations futures. Le coût global du stockage permet la mise en sécurité définitive de tous les déchets français de haute activité et de moyenne activité à vie longue, produits par les installations nucléaires françaises depuis les années 1960 et qui seront produits par les installations nucléaires actuelles jusqu’à leur démantèlement.
Pour un nouveau réacteur nucléaire, sur l’ensemble de sa durée de fonctionnement, le coût du stockage des déchets radioactifs est de l’ordre de 1 à 2 % du coût total de la production d’électricité. Au stade des études de faisabilité scientifique et technique, le chiffrage arrêté par l’Etat en 2005 était d’environ 15 milliards d’euros, répartis sur une centaine d’années (coût brut non actualisé). En 2009, l’Andra a réalisé une estimation préliminaire d’environ 35 milliards d’euros, répartis également sur une centaine d’années (coût brut incluant une mise à jour de l’inventaire des déchets et des conditions économiques), avant le lancement des études de conception industrielle. A titre de comparaison, le coût de la gestion des autres déchets en France (déchets ménagers, entreprises, nettoyage des rues) est de l’ordre de 15 milliards d’euros par an.
L’Andra a lancé en 2012 les études de conception industrielle de Cigéo avec l’appui de maîtres d’œuvre spécialisés qui apportent leur retour d’expérience sur d’autres projets industriels (construction de tunnels, d’ateliers nucléaires, d’usines…). L’Etat a demandé à l’Andra de finaliser son nouveau chiffrage d’ici l’été 2014, après prise en compte des suites du débat public et des études d’optimisation en cours. Sur cette base, le ministre chargé de l’énergie pourra arrêter une nouvelle estimation et la rendre publique après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et observations des producteurs de déchets, conformément au processus défini par la loi du 28 juin 2006.
Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de ces déchets. Grâce à la réversibilité, ces générations garderont la possibilité de faire évoluer cette solution. L’Andra propose un partage équitable entre les générations du financement de la réversibilité :
- Les générations actuelles provisionnent l’ensemble des coûts nécessaires pour permettre la mise en sécurité définitive des déchets radioactifs produits depuis les années 1960 ainsi que ceux qu’elles produisent. Ces provisions couvrent également les propositions techniques retenues par l’Andra pour assurer la réversibilité de Cigéo pendant le siècle d’exploitation.
- Si les générations suivantes décidaient de faire évoluer leur politique de gestion des déchets radioactifs, par exemple si elles décidaient de récupérer des déchets stockés, elles en assureraient le financement. La prise en compte de la réversibilité dès la conception du stockage permet de limiter cette charge.
Le cadre législatif et réglementaire qui s’applique à l’Andra, futur exploitant du stockage s’il est autorisé, est très clair et donne la priorité à la sûreté. Outre les limites strictes imposées par les textes, ceux-ci imposent également aux exploitants d’abaisser autant que possible le niveau d’exposition des populations au-delà des limites fixées par la réglementation. L’Andra, comme tous les exploitants, est soumise à ces exigences réglementaires, qui sont de plus complètement cohérentes avec sa mission, qui est de mettre en sécurité les déchets radioactifs, afin de protéger l’homme et l’environnement sur le long terme.
QUESTION 709
Posée par Daniel RUHLAND, le 13/12/2013
Questions posées dans le cahier d'acteurs de M. Daniel RUHLAND : La possibilité d’avoir, pour différentes raisons, des travaux de BTP pour creuser des galeries, préparer des alvéoles de stockage des déchets radioactifs, etc. et simultanément des travaux d’enfouissement, associant des cultures, des travailleurs et des compétences très différentes ne constitue-t-elle pas un facteur important de risque pour l’installation et donc pour tout l’environnement ? C’est un constat que j’ai fait plusieurs fois en tant que chef d’entreprise…
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les activités de chantier et les activités nucléaires seront séparées sur les installations de Cigéo, et seront donc exploitées comme deux entités indépendantes. Pour cela :
- dans l’installation souterraine, la zone d’exploitation et la zone chantier seront physiquement séparées,
- l’accès aux différentes zones se fera par des accès distincts : par la descenderie pour la zone en exploitation, par les puits verticaux pour la zone chantier,
- chaque zone aura un circuit de ventilation dédié.

QUESTION 708
Posée par Daniel RUHLAND, le 13/12/2013
Questions posées dans le cahier d'acteurs de M. Daniel RUHLAND :
Peut-on être sûr que des petits pays de l’Union Européenne (voire d’autres) ne tenteront pas de nous proposer leurs propres déchets radioactifs (ce qui semble ne pas être interdit par l’Union) ? La faiblesse financière de la France ne peut-elle alors pas s’ouvrir au stockage, sur le site de Bure, pour des déchets étrangers ?
Réponse du 10/01/2014,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Depuis la loi de 1991, le Parlement a interdit le stockage en France de déchets radioactifs en provenance de l’étranger. Cette interdiction figure aujourd’hui à l’article L. 542-2 du Code de l’environnement. Cette législation est cohérente avec la directive européenne du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre des combustibles usés et des déchets radioactifs, qui réaffirme la responsabilité de chaque État dans la gestion de ses déchets radioactifs.
QUESTION 707
Posée par Daniel RUHLAND, le 13/12/2013
Questions posées dans le cahier d'acteurs de M. Daniel RUHLAND : Quel est la taille de Cigéo (pour tenir compte de cet excédent de produits à stocker) ? Quelle sécurité, liée à la présence de plutonium, présent dans les déchets, dont la dangerosité est bien connue ?
Réponse du 28/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La nécessité de stocker des combustibles usés dépendra de la politique énergétique qui sera mise en œuvre par la France dans le futur.
Dans le cadre de la politique énergétique actuelle en France, les combustibles usés issus de la production électronucléaire ne sont pas considérés comme des déchets mais comme des matières pouvant être valorisées, notamment dans les réacteurs de quatrième génération. A ce titre, ils ne sont pas destinés à être stockés dans Cigéo. Seuls les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue, issus du traitement de combustibles usés, sont destinés à Cigéo.
Cigéo est conçu pour mettre en sécurité définitive les déchets les plus radioactifs déjà produits ou en cours de production par les installations nucléaires existantes. L’Andra a vérifié que l’architecture de Cigéo serait suffisamment flexible pour s’adapter aux différents scénarios envisagés dans le cadre du débat national sur la transition énergétique, y compris si le stockage direct de combustibles usés était décidé. Les conséquences de ces scénarios sur la nature et le volume de déchets sont présentées dans un document réalisé par l’Andra et les producteurs de déchets à la demande du ministère en charge de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (../docs/rapport-etude/20130705-courrier-ministere-ecologie.pdf). Suivant les scénarios, l’emprise de l’installation souterraine de Cigéo varierait entre 15 et 25 km². En revanche, Cigéo n’est pas conçu pour gérer les déchets qui seraient produits par un éventuel futur parc de réacteurs.
Les combustibles usés contiennent du plutonium (de l’ordre de 1% pour les combustibles d’oxyde d’uranium usés et de 6 % pour les combustibles MOX usés). Si leur stockage était décidé, il n’interviendrait pas avant l’horizon 2070/2080. Les combustibles usés seraient conditionnés dans des conteneurs en acier épais pour assurer leur confinement et dont la géométrie doit exclure le risque de criticité lié à la présence de plutonium. Ce conteneur assure aussi la protection des combustibles usés pendant toute la phase d’exploitation. Ces colis seraient ensuite placés dans les alvéoles de stockage qui forment une seconde protection. A long terme, lorsque des radionucléides seront relâchés, la roche argileuse prendra le relais comme barrière naturelle. Le plutonium est un élément très peu mobile qui restera confiné dans l’argile.
La faisabilité de principe et la sûreté du stockage profond des combustibles usés ont été démontrées par l’Andra en 2005. Dans le cadre du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, l’État a demandé à l’Andra de vérifier par précaution que les concepts de stockage de Cigéo restent compatibles avec l’hypothèse d’un stockage direct de combustibles usés si ceux-ci étaient un jour considérés comme des déchets. L’Andra a remis fin 2012 un rapport d’étape qui est consultable sur le site du débat public (../docs/rapport-etude/rapport-stockage-direct-combustibles-uses.pdf).
La nature et les quantités de déchets autorisés pour un stockage dans Cigéo seront fixées par le décret d’autorisation de création du centre. Toute évolution notable de cet inventaire devra faire l’objet d’un nouveau processus d’autorisation, comprenant notamment une enquête publique et un nouveau décret d’autorisation.
QUESTION 706
Posée par Daniel RUHLAND, le 13/12/2013
Questions posées dans le cahier d'acteurs de M. Daniel RUHLAND :
Le projet Cigéo est-il, dans le cadre d’une vie meilleure, une opportunité ou une menace (ou les deux ?) pour le canton de Montiers : pour son environnement et sa population ?
Réponse du 10/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
S’il est autorisé, Cigéo participera pleinement à la vie de son territoire d’accueil meusien et haut-marnais et à son développement.
Le Centre de l’Andra en Meuse/Haute-Marne (Laboratoire souterrain, Espace technologique, Carothèque, Observatoire pérenne de l’environnement, Ecothèque) comprend d’ores et déjà plus de 300 emplois directs. Deux groupements d’intérêt public ont été créés en Meuse et en Haute-Marne pour gérer les équipements de nature à favoriser et faciliter l’installation et l’exploitation du Laboratoire ou de Cigéo, pour mener des actions d’aménagement du territoire et de développement économique et pour soutenir les actions de formation et de diffusion des connaissances scientifiques et technologiques. Ils ont été dotés de 30 millions d’euros par département en 2012. Par ailleurs, EDF, le CEA et Areva mènent une politique active en faveur du développement local.
Si Cigéo est autorisé, il constituera un projet industriel structurant pour le territoire. Entre 1 300 et 2 300 personnes travailleront à la construction des premières installations de Cigéo. Après la mise en service du Centre, entre 600 et 1 000 personnes travailleront de manière pérenne sur le site. Cigéo contribuera au développement de l’activité des entreprises locales et, grâce à la garantie d’une activité sur plus d’un siècle, certaines entreprises feront très vraisemblablement la démarche de s’implanter localement, créant à leur tour une activité nouvelle sur le territoire.
Le Gouvernement a également demandé l’élaboration d’un schéma de développement du territoire à l’échelle des deux départements de Meuse et de Haute-Marne. Ce schéma est élaboré sous l’égide du préfet de la Meuse, préfet coordinateur, en concertation avec les acteurs locaux (collectivités, chambres consulaires…). L’Andra et les entreprises de la filière nucléaire contribuent également à son élaboration. Pour accéder à ce schéma : ../docs/docs-complementaires/docs-planification/SIDT-Final.pdf
QUESTION 705
Posée par Wladimir GRÜNBERG, le 13/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de M. Wladimir GRÜNBERG : Pourquoi avoir choisi Bure pour le stockage profond et écarté la possibilité d’exploiter la géothermie de ce site ?
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Comme partout ailleurs en France, la géothermie dite de surface (qui permet d’alimenter des maisons individuelles et des immeubles collectifs ou tertiaires via des pompes à chaleur) est réalisable localement. L’exploitation de ces ressources en surface ne serait d’ailleurs pas incompatible avec Cigéo, même au droit des installations souterraines de Cigéo, qui seraient situées à 500 mètres de profondeur.
La géothermie profonde nécessite des investissements importants et est aujourd’hui mise en œuvre dans les zones avec à la fois des conditions géologiques favorables et des perspectives d’utilisation importante de la chaleur extraite. Concernant les conditions géologiques, un forage à 2000 mètres de profondeur dans les grès du Trias (Forage EST 433, Montiers-sur-Saulx) a été réalisé lors d’une campagne de reconnaissance menée en 2007-2008 afin de mesurer le potentiel du site. Les caractéristiques habituellement recherchées pour déterminer s’il existe un potentiel géothermique (salinité, température et productivité) ont été mesurées. Il en ressort que le sous-sol dans la zone étudiée pour l’implantation de Cigéo ne présente pas un caractère exceptionnel en tant que ressource potentielle pour une exploitation géothermique profonde. Dans son rapport n°4 de juin 2010, la CNE aboutit aux mêmes conclusions : « Le trias de la région de Bure ne représente pas une ressource géothermique potentielle attractive dans les conditions technologiques et économiques actuelles. »
Par ailleurs, même si le sous-sol de Bure ne présente aucun caractère exceptionnel, il est tout à fait possible de réaliser des projets de géothermie profonde dans la région en dehors de l’installation souterraine de Cigéo (qui serait implantée à l’intérieur d’une zone de 30 km²). Par précaution, l’Andra a tout de même envisagé que l’on puisse exploiter le sous-sol au niveau du stockage et qu’une intrusion puisse avoir lieu. Les analyses ont montré que même dans ce cas, le stockage conserverait de bonnes capacités de confinement. Comme dans le dossier 2005, l’Andra présentera dans le dossier de demande d’autorisation de création de tels scénarios d’intrusion, incluant des doublets de forage comme ceux pratiqués pour l’exploitation de la géothermie.
QUESTION 704
Posée par Wladimir GRÜNBERG, le 13/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de M. Wladimir GRÜNBERG :
Pourquoi n’a-t-on pas intégré les conclusions du débat public 2005-2006 dans la loi de 2006 ?
Réponse du 06/01/2014,
Un débat public ne fournit pas de conclusions mais retranscrit les principales opinions exprimées sur le projet ainsi que les arguments échangés. Les opinions sont souvent opposées et le compte rendu de la CPDP doit les prendre en compte dans leur diversité. L’article 3 de la loi de 2006 qui entérine la poursuite des études et recherches selon les trois axes complémentaires séparation/transmutation, stockage réversible en couche géologique profonde et entreposage a repris une des préoccupations majeures exprimées lors du débat public.
QUESTION 703
Posée par Danielle GRÜNBERG, le 13/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de Mme Danielle GRÜNBERG :
La directive européenne du 19 juin 2011 peut conduire à entreposer à Cigéo des déchets provenant d’autres pays européens. Mais quelle place pour ces déchets additionnels possibles ?
Réponse du 21/01/2014,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Depuis la loi de 1991, le Parlement a interdit le stockage en France de déchets radioactifs en provenance de l’étranger. Cette interdiction figure aujourd’hui à l’article L. 542-2 du Code de l’environnement. Cette législation est cohérente avec la directive européenne du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre des combustibles usés et des déchets radioactifs, qui réaffirme la responsabilité de chaque État dans la gestion de ses déchets radioactifs.
QUESTION 702
Posée par Danielle GRÜNBERG, le 13/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de Mme Danielle GRÜNBERG :
Un débat public a eu lieu en 2006 mais ses conclusions n’ont pas été intégrées dans la loi du 28 juin 2006. Et pourquoi, par conséquent, en ira-t-il différemment pour le débat de 2013 ?
Réponse du 06/01/2014,
Un débat public ne fournit pas de conclusions mais retranscrit les principales opinions exprimées sur le projet ainsi que les arguments échangés. Les opinions sont souvent opposées et le compte rendu de la CPDP doit les prendre en compte dans leur diversité. L’article 3 de la loi de 2006 qui entérine la poursuite des études et recherches selon les trois axes complémentaires séparation/transmutation, stockage réversible en couche géologique profonde et entreposage a repris une des préoccupations majeures exprimées lors du débat public.
QUESTION 701
Posée par PARTI LORRAIN, le 13/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs du Parti Lorrain : François HOLLANDE se disait « opposé au projet ici et ailleurs », comme le rapporte en mai 2000 un bulletin anti-nucléaire. La Mission granit s’est finalement enlisée et il ne reste aujourd’hui plus que Bure. La loi Bataille de 1991, votée par M. HOLLANDE, prévoyait pourtant d’expérimenter plusieurs types de sites en France. Dès lors, pourquoi le Président de la République HOLLANDE autoriserait-il à Bure le projet d’enfouissement que le député HOLLANDE a refusé en Corrèze ? Ce qui est valable pour la Corrèze l’est aussi pour la Meuse.
Réponse du 17/01/2014,
Réponse apportée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
La loi du 28 juin 2006 a fait le choix du stockage réversible profond pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations futures. Ce choix a été fait après un programme de quinze années d’études et recherches encadrée par la loi « Bataille » de 1991, un débat public en 2005-2006 et les avis des évaluateurs sur ces recherches. Il est conforté au niveau international par la directive européenne du 19 juillet 2011 qui considère que « il est communément admis que sur le plan technique, le stockage en couche géologique profonde constitue, actuellement, la solution la plus sûre et la plus durable en tant qu’étape finale de la gestion des déchets de haute activité et du combustible usé considéré comme déchet. »
Elle demande à l’Andra d’étudier et d’implanter Cigéo en rappelant que « la demande d'autorisation de création [d’un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs] doit concerner une couche géologique ayant fait l'objet d'études au moyen d'un laboratoire souterrain ». L’Andra poursuit donc ses études en vue d’élaborer pour 2015 le dossier support à l’instruction de la demande d’autorisation de création de Cigéo en Meuse/Haute-Marne, dans la couche d’argile dont les propriétés de confinement sont désormais reconnues.
QUESTION 700
Posée par PARTI LORRAIN, le 13/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs du Parti Lorrain : Une fois enterrés, comment les colis radioactifs pourraient-ils être sortis, techniquement et financièrement, dans un gruyère de 300 km de galeries ?
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les conditions de réversibilité seront fixées par une future loi.
L’Andra prévoit la mise en œuvre de nombreuses dispositions techniques pour faciliter une opération éventuelle de retrait de colis de déchets après leur stockage (colis indéformables en béton ou en acier utilisés pour le stockage des déchets, espaces ménagés entre les colis pour permettre leur retrait, tunnels de stockage avec un revêtement en béton ou en acier pour éviter les déformations, connaissance précise de l’emplacement de chaque colis et de ses conditions de stockage, surveillance des ouvrages…). Ces dispositions prennent en compte le retour d’expérience d’autres installations, en France et à l’étranger. Des essais de retrait de colis ont d’ores et déjà été réalisés à l’échelle 1. Des nouveaux tests de retrait seront réalisés dans le stockage avant que la mise en service de Cigéo ne puisse être autorisée, puis pendant toute l’exploitation de Cigéo.
L’Andra propose un partage équitable du financement de la réversibilité entre les générations. Les générations actuelles provisionnent l’ensemble des coûts nécessaires pour permettre la mise en sécurité définitive des déchets radioactifs qu’elles produisent, ainsi que des déchets anciens qui ont été produits depuis le début des années 1960. Ces provisions couvrent également les propositions techniques retenues pour assurer la réversibilité de Cigéo pendant le siècle d’exploitation. Si les générations suivantes décidaient de faire évoluer leur politique de gestion des déchets radioactifs, par exemple si elles décidaient de récupérer des déchets stockés, elles en assureraient le financement. La prise en compte de la réversibilité dès la conception du stockage permet de limiter cette charge potentielle.
Pour en savoir plus sur les propositions faites par l’Andra en matière de réversibilité du stockage, voir ../docs/rapport-etude/fiche-reversibilite-cigeo.pdf
QUESTION 699 - Tremblement de terre
Posée par Tonny MONARI, L'organisme que vous représentez (option) (NOMPATELIZE), le 12/12/2013
Etant donné les derniers tremblements de terre connus dans la région " élargie" de Bure: - 1356 Bâle- Suisse intensité 9 -10 échelle MSK - 1682 Remiremont " 8 " - 1784 Neufchâteau " 5 " - 1952 Wissembourg " 7 " - 2003 Rambervillers intensité 5,4 - 5,9 éch. Richter - 2004 Fribourg- Colmar " 5,3 " Etant donné que nous ne savons pas ce qu'il s'est passé avant qu'il n'y ait des traces écrites sur les tremblements de terre en France ( 1° trace an 502 ) que nous ne pouvons prévoir ce que la terre nous réserve pour demain , ou dans 300 ans.... Mais nous savons que la terre tremble encore tous les jours et qu' à quelques kilomètres de Bure il y a des failles importantes que les séismes Vosgiens pourraient rouvrir. Un séisme de 6 à 7 n'est pas à exclure dans la zone Vosges-Fossé Rhénan (Grégoire Fleurot, journaliste à Slate.fr) J'aimerais donc savoir comment vos" scientifiques " peuvent prétendre que la terre à Bure ne bougera pas d'ici 100 ou même 50 000 ans, qu'il n'y aura pas de fissuration des roches, ni d'infiltration, que les radionucléides vont rester dans le "coffre-fort géologique" et que les eaux souterraines radioactives ne se déverseront pas dans la vallée de la Marne et ensuite dans le Bassin Parisien.
Réponse du 15/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
C’est le jeu des failles présentes dans la croute terrestre qui produit les tremblements de terre. Ces jeux sont la conséquence de la tectonique des plaques et des contraintes mécaniques engendrées au sein de la croûte terrestre. Il n’existe pas de failles sous le site Cigéo, et la création de nouvelles failles (liée à la tectonique des plaques, qui est très bien comprise aujourd’hui) au cours des prochains millions d’années, sur la durée de vie des déchets radioactifs, n’est pas envisageable.
Le site d’implantation de Cigéo (située à l’Est du Bassin de Paris) est à l’écart des zones actives où se produisent les jeux de failles qui absorbent le rapprochement des continents Afrique et Europe. Les mouvements tectoniques de grande amplitude et forts séismes qui en découlent se localisent pour l’essentiel en Méditerranée et dans les chaines de montagnes qui la bordent, et pour le reste (résidu) au niveau des grandes failles qui affectent la plaque européenne, comme les failles du fossé d’Alsace et des Vosges en bordure Est du bloc stable que constitue le Bassin de Paris. Ce dernier compte parmi les régions les plus stables du globe. Il est quasiment asismique avec des taux de déformations extrêmement faibles à l’échelle des temps géologiques, comptés en millions d’années.
L’analyse des directions et vitesses de déplacements relatifs des stations GPS installées en Europe, confirme que le Bassin de Paris constitue un bloc rigide et que les déformations (de faible amplitude) se font à ses frontières, comme le souligne la répartition des séismes. En conséquence, seules les failles majeures qui existent déjà sont susceptibles de glisser, avec des mouvements de très faible amplitude, par à-coups séparés dans le temps par plusieurs dizaines à centaines de milliers d’années.
C’est ainsi que la zone de 30 km² étudiée pour l’implantation de l’installation souterraine est, au plus proche, à 1,5 km du fossé de Gondrecourt, et à 6 km du segment le plus proche du système des failles de la Marne (le fossé de la Marne étant lui-même est à 14 km). Les analyses cartographiques montrent l’absence de mouvements de ces failles au cours des derniers millions d’années. Les derniers mouvements tectoniques du fossé de Gondrecourt datent de 20 à 25 millions d’années (datations de cristaux de calcite) ; les derniers mouvements des failles de la Marne sont du même âge ou plus anciens. La réalisation d’une écoute sismique dont le seuil de détection est très bas, et qui discrimine sans ambiguïté séismes naturels et tirs de carrières, permet d’affirmer l’absence de toute activité sur ces failles. En accord avec la réglementation en vigueur concernant la sûreté des installations nucléaires, les ouvrages de stockage sont toutefois dimensionnés pour résister aux séismes maxima physiquement possibles que pourraient générer ces failles si elles redevenaient actives dans le futur.
QUESTION 698 - Comment faire confiance?;
Posée par Tonny MONARI, L'organisme que vous représentez (option) (NOMPATELIZE), le 12/12/2013
L'ANDRA a tendance à toujours répéter et à clamer dans ses communications que tous ses travaux sont validés et applaudis par l'IRSN, l'ASN, la CNE, etc... Ce n'est pas tout à fait vrai. La CNE, notamment dans ses rapports, est très critique et semble exiger quantité de vérifications techniques. Et j'ai l'impression que ces organismes sont fort courtois, voire complaisants. Je me permettrai de dire aussi que j'ai bien des doutes au niveau de leur indépendance. D'autant plus qu'ils sont tous financés par l'Etat. Comment l'Etat pourrait il contredire, contrarier, compromettre un projet d'Etat? D'autant plus que CIGEO est présenté maintenant comme une Opération d' Intérêt National! Et en lisant toutes les questions, les avis, les cahiers d'acteurs pour ce "débat public" sur internet, je me pose une autre question importante : Qui fera le dépouillement et la synthèse de ce "débat public"? Est ce que je peux avoir confiance dans ce "jury" ? Car sera -t'il vraiment objectif? Comment faire confiance à toute cette organisation?
Réponse du 06/01/2014,
Vous vous interrogez sur la courtoisie et la complaisance dont feraient preuve vis à vis de l’ANDRA les organismes que vous citez (IRSN, ASN, CNE, etc), et vous éprouvez des doutes sur leur indépendance puisqu’ils sont financés par l’Etat.
Il n’appartient pas à la Cpdp de porter des jugements qualitatifs sur ces organismes ; il lui appartient par contre de mettre sur son site internet, à la disposition du public, l’ensemble des documents publiés par eux, ainsi que les questions ou interrogations du public les concernant (comme votre question, par exemple).
S’agissant du dépouillement et de la synthèse du débat public en cours, cela sera fait par la Cpdp, qui s’efforcera autant que faire se peut d’être objective. Chacun pourra juger du résultat, puisque son compte rendu sera rendu public le 15 février 2014.
QUESTION 697 - Le rôle du CLIS de BURE
Posée par Jean-Claude MONTAGNE, CDVE (CHAUMONT), le 12/12/2013
J'ai assisté à plusieurs réunion du CLIS de BURE. J'ai lu pas mal d'articles. J'ai des doutes sur le rôle du CLIS de BURE. N'a t-il pas été créé en fait pour faciliter l'implantation de l'ANDRA ? Que font-ils exactement toute la journée les permanents ? Et je pense qu'il y a trop d'élus parmi ses membres. Des élus qui sont tellement arrosés qu'ils sont incapables de réfléchir. Avec les nouvelles lois (Aarhus notamment) il faudrait redonner du pouvoir aux citoyens et aux riverains. Que va t-il se passer après le débat public ? Comment pourront nous nous exprimer ? En descendant dans la rue
Réponse du 15/01/2014,
Réponse apportée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
La création des commissions locales d’information s’inscrit dans le cadre des initiatives successives lancées pour impliquer le public dans le suivi environnemental et sanitaire à proximité des installations industrielles et répond à un contexte de demande de participation croissante de la société et d’exigences juridiques renforcées en matière de transparence. Des textes comme la Charte de l’environnement en France, ou la Convention d’Aarhus sur le plan international, soutiennent cette évolution.
Prévu par la loi du 30 décembre 1991, le Comité local d’information et de suivi du Laboratoire de Bure a été mis en place en 1999 après l’autorisation de création du Laboratoire souterrain. Le CLIS est un organisme indépendant chargé de suivre les recherches sur le stockage géologique des déchets radioactifs. Il est chargé d'une mission générale de suivi, d'information et de concertation en matière de recherche sur la gestion des déchets radioactifs et, en particulier, sur le stockage de ces déchets en couche géologique profonde (article L. 542-13 du code de l’environnement).
Ce comité comprend notamment des élus, des représentants d'associations de protection de l'environnement, de syndicats agricoles, d'organisations professionnelles, d'organisations syndicales de salariés représentatives et de professions médicales.
Vous pouvez trouver le détail des actions menées par le CLIS sur son site internet : http://www.clis-bure.com/index.html. Son cahier d’acteurs est disponible sur le site du débat public.
QUESTION 696 - Risque hydrogène
Posée par Yves LENOIR, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 12/12/2013
Les déchets radioactifs seront tôt ou tard touchés par l'eau. Il est très difficile de prévoir le moment où cela commencera comme le prouve l'évolution assez imprévue (se reporter aux discours et rapports du début des années 70) du stockage de Asse en Allemagne. La chimie jouera son rôle dans la corrosion des conteneurs. L'idée que les blocs de verre sont homogènes est fausse. Après avoir été coulés et leur conteneur scellé, il sont décontaminés ce qui provoque un choc thermique. Des fissures se développent alors qui vont accroître la surface de contact avec l'eau quand elle aura ruiné les conteneurs. Entretemps les émissions de particules alpha auront produit des inclusions gazeuses (hélium) à haute pression à l'intérieur de la masse vitreuse. On sait aussi que soumis à des rayonnements le verre se dévitrifie progressivement, jusqu'à être réduit à un état voisin de cristallin, c'est à dire à l'état de sable. Ces phénomènes sont lents mais les durées de toxicité des déchets dépassent toute perspective historique. On peut donc conclure qu'un jour dans un avenir indéterminé les déchets de haute activité seront en contact avec de l'eau selon une surface d'échange de plusieurs ordre de grandeur supérieurs à celui de la surface extérieure des conteneurs qui les confinaient. Un phénomène de radiolyse de l'eau d'infiltration pourra alors se développer massivement et rapidement. La radiolyse produira de l'hydrogène. On a visé l'étanchéité. Les gaz s'accumuleront jusqu'au moment où les conditions de l'explosion seront réunies (l'énergie des désintégrations est des millions de fois supérieure à celle requise pour l'ignition !). Cela peut se calculer bien que cela soit très compliqué car l'hydrogène diffuse différemment de l'oxygène. On peut raisonnablement penser que l'accident de Kyshtym est lié à un dégagement d'hydrogène. Les dégâts écologiques et humains sont considérables et la radioactivité s'étend maintenant sur un territoire plus de dix fois plus vaste que la zone interdite initiale, toute en longueur (100 km x 10 km). Avec les déchets de faible activité ce risque est quasi nul. Il n'en sera pas de même avec les produits de Haute Activité avec des transuraniens en prime. Le promoteur a-t-il réalisé une étude concernant ce risque ? Si oui, quelle grille de paramètres a-t-elle été explorée ? Le rapport de l'étude doit être versé au dossier. Si non, pourquoi l'étude de ce risque fait-elle défaut ? Quelle justification scientifique à cette lacune ?
Réponse du 10/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les contraintes mécaniques lors du refroidissement du verre après sa coulée engendrent effectivement une fracturation. Ce phénomène est connu et a fait l’objet de nombreuses études sur son étendue et son effet sur les propriétés de confinement du verre. Il ne remet pas en cause les propriétés très favorables du verre dont la dissolution s’étale sur des durées de plusieurs dizaines à centaines de milliers d’années. La fracturation est intégrée dans les analyses de sûreté qui prennent en compte notamment les vitesses auxquels les colis de déchets vont se dégrader dans le temps et relâcher les radionucléides.
Concernant la production d’hélium liée aux désintégrations alpha, les études ont montré qu’elle n’a aucune conséquence sur le comportement mécanique du verre jusqu’à des teneurs de 8. 1019 He/g (soit après plusieurs millions d’années) ; aucune étude n’a mis en évidence une fissuration liée à la présence d’hélium même dans les expériences où des quantités importantes d’hélium ont été incorporées dans le verre. De plus, aucune étude sur le verre n’a mis en évidence des bulles d’hélium de taille supérieure à 10 nm (résolution de l’appareil de mesure). Enfin, concernant l’effet de l’irradiation sur la fissuration du verre, les modifications observées des propriétés mécaniques des verres sous auto-irradiation montrent une augmentation de la ténacité et donc une meilleure résistance à la fissuration.
La dévitrification du verre (ou cristallisation) n’est pas liée à l’irradiation mais à la nucléation et la croissance d’hétérogénéités par diffusion. Ce processus est thermiquement activé et il se produit essentiellement dans les premiers jours après l’élaboration du verre. Après cela, dès que la température du verre est inférieure à la température de transition vitreuse, 520 °C pour les verres produits par Areva à La Hague, le processus est rapidement inhibé si bien que la cristallisation du bloc de verre est très inférieure à 1 %.
La radiolyse de l’eau est un phénomène étudié depuis longtemps, notamment pour ses effets dans les réacteurs et sur la matière vivante. Soumise à un rayonnement, l’eau (H2O) (liquide ou de vapeur d'eau) se décompose en espèces moléculaires (H2, H2O2…) et en espèces radicalaires (OH., H. …). Ces espèces peuvent se recombiner, notamment H2 et H2O2 en présence des radicaux pour reformer de l’eau. Il faut un rayonnement énergétique intense, bien au-delà de quelques dizaines de Gray/h, pour décomposer l’eau et aboutir à un bilan net de production d’hydrogène positif important. De tels rayonnements ne concernent que les premières dizaines à centaines d’années après la formation du déchets vitrifiés, du fait notamment des radionucléides à vie courte comme le Césium 137. La présence d’un surconteneur empêchant l’arrivée d’eau sur le verre pendant plusieurs centaines d’années évite la production d’hydrogène par radiolyse de l’eau sur le verre. En tout état de cause, l’absence d’oxygène une fois le stockage fermé exclut tout risque d’explosion.
QUESTION 695 - Documents du maître d'ouvrage mensongés ?
Posée par Luc BARANGER, L'organisme que vous représentez (option) (RABLAY SUR LAYON), le 12/12/2013
J'ai lu les documents du maître d'ouvrage, ils me semblent bien légers. Ils sont si incomplets, qu'ils sont certainement mensongers...sans doute par omission? Ils sont par ailleurs très positifs et très optimistes. Cela les rend non crédibles. De plus, à la lecture des rapports de la CNE et les analyses de Bertrand THUILLIER (expert reconnu et indépendant), on a une autre vision de la réalité. Comment faire confiance aux déclarations du directeur de la "maîtrise des risques" ? L'idée même de la maîtrise des risques, n'est-ce pas un premier mensonge? Pourquoi l'ANDRA vend-t-elle CIGEO comme on vend une lessive ? Et à FUKUSHIMA, les japonnais n'avaient pas de "directeur de la maîtrise des risques" ?
Réponse du 10/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Vous faites sans doute référence au dossier du maître d’ouvrage (DMO) qui est un document effectivement synthétique. Ce dossier vient en support au débat public, et doit présenter en une centaine de pages l’ensemble des enjeux du projet, pour permettre au public non initié d’appréhender le projet mis en débat. Mais vous trouverez aisément sur le site du débat (../) des documents plus techniques, fournis par l’Andra et des travaux tels que les avis des autorités de contrôle et d’évaluation ou encore des avis d’experts.
La démarche de sûreté de l’Andra s’appuie en effet sur des études menées depuis plus de vingt ans, qui ont fait l’objet de volumineux dossiers. Ces dossiers ont été expertisés par d’évaluateurs scientifiques et de sûreté indépendants, notamment la Commission nationale d’évaluation et l’Autorité de sûreté nucléaire.
QUESTION 694 - Méfiance!
Posée par Antoine CERIANI, L'organisme que vous représentez (option) (KAYSERSBERG), le 12/12/2013
Comment faire confiance à des lobbies industriels et à l'Etat qui prétextent l'implantation d'un laboratoire de recherche en jurant qu'il était hors de question qu'il devienne un centre d'enfouissement..et qui continue de nier tout lien entre les cancers et les retombées de Tchernobyl!? En ce qui me concerne je n'ai AUCUNE CONFIANCE en cette industrie et encore moins à sa gestion des déchets nucléaires!
Réponse du 20/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La loi de recherche du 30 décembre 1991 prévoyait la réalisation de laboratoires souterrains pour l’étude des possibilités de stockage dans les formations géologiques profondes. Suite à une mission de concertation lancée fin 1992 et à des premières analyses géologiques, quatre sites candidats avaient été identifiés dans les départements du Gard, de la Meuse, de la Haute-Marne (couches argileuses) et de la Vienne (couche granitique). L’Andra a été autorisée par le Gouvernement à mener des investigations géologiques dans le but de savoir s’il était intéressant d’y construire un laboratoire souterrain pour continuer les études. En 1996, l’Andra a déposé trois dossiers de demandes d’installation de laboratoires souterrains. Les résultats des investigations géologiques ont montré que la géologie du site en Meuse/Haute-Marne (les deux sites ont été fusionnés en une seule zone en raison de la continuité de la couche argileuse étudiée) était particulièrement favorable. Concernant le Gard, le site présentait une plus grande complexité scientifique liée à son évolution géodynamique à long terme et faisait l’objet d’oppositions locales. L’instruction du dossier relatif au site étudié dans la Vienne n’a pas abouti à un consensus scientifique sur la qualité hydrogéologique du massif granitique.
En 1998, le Gouvernement a décidé la construction d’un laboratoire de recherche souterrain en Meuse/Haute-Marne et la poursuite des études pour trouver un autre site dans une roche granitique. La recherche d’un site dans une roche granitique a finalement été abandonnée, la mission de concertation n’ayant pas abouti. L’Andra a toutefois poursuivi ses recherches sur le milieu granitique jusqu’en 2005, en s’appuyant notamment sur les travaux menés dans les laboratoires souterrains d’autres pays (Suède, Canada, Suisse). Ces recherches ont conduit l’Andra à conclure en 2005 qu’un stockage dans les massifs granitiques ne présenterait pas de caractère rédhibitoire mais que la principale incertitude porte sur l’existence de sites en France avec un granite ne présentant pas une trop forte densité de fractures.
La loi du 28 juin 2006 a fait le choix du stockage réversible profond pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations futures. Elle demande à l’Andra d’étudier et d’implanter Cigéo en stipulant que « la demande d'autorisation de création [d’un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs] doit concerner une couche géologique ayant fait l'objet d'études au moyen d'un laboratoire souterrain ». L’Andra poursuit donc ses études en vue d’élaborer pour 2015 le dossier support à l’instruction de la demande d’autorisation de création de Cigéo en Meuse/Haute-Marne, dans la couche d’argile dont les propriétés de confinement sont désormais reconnues.
L’Andra est en charge de la gestion des déchets radioactifs, l’étude de l’impact sanitaire de l’accident de Tchernobyl ne relève pas de ses compétences.
QUESTION 693
Posée par Elisabeth BRENIERE (CHAMBERY), le 20/01/2014
Questions posées dans le cahier d'acteurs n°108 de Mme Elisabeth Breniere : Quel niveau de risque notre société considère-t-elle comme acceptable? Combien de morts et de malades prévisibles parmi les travailleurs, les populations locales? Quel risque est-on en droit de faire courir à l'ensemble de l'humanité sur plusieurs milliers de générations? Quelle comparaison avec les autres solutions pour produire de l'électricité? Quels risques imaginables et leurs compétences possibles, d'une part sur la période d'exploitation prévue sur 100 ou 150 ans, d'autre part après la fermeture pendant toute la durée de la radioactivité? Que se passerait-il en cas de guerre, terrorisme, sabotage, séismes, catastrophes naturelles, crise économique, impossibilité de trouver des volontaires pour intervenir sur place, désertification de la région, erreurs humaines à différents niveaux, cycles climatiques extrèmes, coupure d'alimentation électrique, séries de pannes techniques, épidémies ou pollutions rendant les lieux inaccessibles, etc..? A titre de comparaison, quelles conséquences peut-on observer sur les conditions de vie de la population proche des centres de stockage existants de déchets radioactifs? Près des mines du Limousion, près de La Hague, près de Marcoule, près de Cadarache, près de Soulaines et de Morvilliers, près de Tricastin, près de Pontfaverger-Moronvilliers? Quels sont les risques sanitaires susceptibles d'être découverts plus tard pour les faibles doses de radioactivités qui seront rejetées? (Souvenons-nous de l'amiante qui était considérée coàmme sans danger pendant presqu'un siècle avant de devenir un matériau extrêmement cancérigène.)
Réponse du 06/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs est au cœur des préoccupations du projet Cigéo. Les déchets dont il est question ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestions sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
Ainsi, l’objectif du stockage profond est donc de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
La surveillance des stockages existants dans la Manche et dans l’Aube confirme qu’ils n’ont pas d’impact sur la santé et l’environnement. Ils ont en revanche un effet positif sur l’activité locale, stimulant la construction ou la rénovation, permettant le maintien et le développement de services, la création d'emplois. Pour être convaincu de ce dernier point, il suffit de se rendre sur l'une ou l'autre des zones d'activité créées il y a moins de 20 ans sur les communes autour des centres de l’Andra dans l’Aube qui accueillent aujourd'hui plusieurs entreprises de secteurs d'activité variés et qui génèrent plusieurs dizaines d'emplois. Des entreprises se sont implantées et certaines ont pu et continuent à se développer en travaillant pour l'Andra dans les domaines du BTP, du génie civil, de la mécanique, de l'électricité, etc. Certaines entreprises nationales ont même fait le choix d'implanter des antennes ou bureaux localement.
Par ailleurs, l’évolution positive du nombre d’habitants sur le canton de Soulaines, à la différence des cantons voisins, illustre également l’impact positif de la présence des installations de l’Andra.
Enfin, le retour d’expérience de l’Andra sur l’implantation de ses installations depuis 20 ans, montre que la présence d’un centre de stockage de déchets radioactifs n’est en aucun cas incompatible, même en termes d’image, avec des activités agricoles de premier choix (lait, viande, légumes, viticulture...). L'industrie et l’agriculture ont toujours coexisté et de nombreuses installations industrielles y compris nucléaires sont installées en France à proximité de zones de production agricoles dont des zones géographiques protégées ou encore des zones d'appellation contrôlée.
QUESTION 692 - Censure ?
Posée par Alain LASSERTEUX, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 11/12/2013
Je viens d'apprendre qu'il est interdit de qualifier l'enfouissement de déchets radioactifs comme étant criminel. Cette censure absurde prétextée par d'éventuelles poursuites judiciaires augure mal du résultat de ce "débat", parce qu'il préjuge de l'honnêteté moral des organisateurs dont j'espère ne pas à avoir dire un jour que ce sont des criminels !!!
Réponse du 10/01/2014,
La qualification du projet Cigéo de "crime" voire de "crime contre l'humanité" n'est pas interdite. Vous trouverez d'ailleurs ces qualificatifs dans de nombreuses questions, avis et même cahier d'acteurs.
QUESTION 691 - Achat des consciences
Posée par Céline SUREL, L'organisme que vous représentez (option) (CHAUMONT), le 11/12/2013
Pourquoi tout cet accompagnement économique démesuré ? Pourquoi ces parrainages ? Pourquoi ces dons ? Pourquoi ce faux mécénat ? Pourquoi ces promesses d’emplois ? Pourquoi cet argent qui dégouline ? Pourquoi cet achat des consciences ? Et tout récemment dans les cahiers d¹acteurs deux entreprises viennent de remercier publiquement le GIP, l¹EDF et AREVA pour leur soutien financier. La première : Orthoboots (cahier n°26) avoue : " les financeurs, les banques et les organismes qui viennent consolider les fonds propres traditionnels ont du mal à accompagner les SCOP. Ce sont des schémas qu¹ils ne connaissent pas. Le soutien financier d¹EDF, puis d¹Areva nous est donc d¹autant plus précieux". La seconde : (Forgex : n° 28): "Je sais pouvoir compter sur le Conseil Général d¹une part, via le GIP, et d¹autre part sur EDF et AREVA qui vont avoir un rôle prépondérant dans le bouclage de ce tour de table". Comment voudriez-vous que nous ayons confiance dans un tel projet ? Une région échange sa géologie profonde contre de l'argent. C'est une forme de prostitution. Elle est d’ailleurs aujourd'hui répréhensible. Et c'est le celui qui paye qui est punissable.
Réponse du 31/01/2014,
Réponse apportée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Des taxes prélevées sur les exploitants sont reversées à la Meuse et Haute-Marne afin d’accompagner le développement du territoire dans le cadre du laboratoire souterrain et dans le futur du projet Cigéo. Ainsi, les sommes issues des taxes d’accompagnement et de diffusion technologique sont gérées par deux groupements d’intérêt public (GIP) en Meuse et en Haute Marne, afin de réaliser les actions suivantes décrites à l’article L. 542-11 du Code de l’environnement :
1° « gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation du laboratoire ou du centre de stockage » ;
2° « mener, dans les limites de son département, des actions d'aménagement du territoire et de développement économique, particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils généraux concernés » ;
3° « soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques, notamment dans les domaines étudiés au sein du laboratoire souterrain et dans ceux des nouvelles technologies de l'énergie. »
Il s’agit donc de sommes destinées au développement du territoire autour du projet, afin de faciliter son insertion dans le territoire Meusien et Haut-Marnais.
Dans le cadre du contrôle de légalité, l’Etat contrôle que l'affectation des ressources fiscales et des dépenses des collectivités respectent la réglementation. De plus, l'Etat, est administrateur ou commissaire du gouvernement des GIP et vérifie dans ce cadre l’utilisation des ressources qui leur sont dévolues.
QUESTION 690 - réversibilité
Posée par sabine ALARD, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 11/12/2013
Combien de temps durera la réversibilité ? Comment pourra-t-on récupérer les colis de déchets ? Merci, Sabine
Réponse du 09/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le Parlement a demandé que le stockage soit réversible pendant au moins 100 ans afin de laisser aux générations suivantes la possibilité de faire évoluer le stockage si elles le souhaitent. En réponse à cette demande, l’Andra propose des conditions de réversibilité, durant le siècle d’exploitation, qui ne compromettent pas la sûreté du stockage et qui sont réalisables sur le plan technique. Ces propositions concernent à la fois la technique et le pilotage du stockage.
Pouvoir récupérer les colis de déchets après leur stockage
De nombreuses dispositions techniques sont mises en œuvre pour faciliter une opération éventuelle de retrait de colis du stockage. Ces dispositions prennent en compte le retour d’expérience d’autres installations, en France et à l’étranger. Les colis utilisés pour le stockage des déchets, en béton ou en acier, sont indéformables. Des espaces suffisants sont ménagés entre les colis pour permettre leur retrait. Les tunnels de stockage (alvéoles de stockage) ont un revêtement en béton ou en acier pour éviter les déformations. L’exploitant disposera d’une connaissance précise de l’emplacement de chaque colis et de ses conditions de stockage. Des essais de retrait de colis ont d’ores et déjà été réalisés à l’échelle 1. Des nouveaux tests de retrait seront réalisés dans le stockage avant que la mise en service de Cigéo ne puisse être autorisée, puis pendant toute l’exploitation de Cigéo.
Un calendrier de fermeture progressif et révisable dans le temps
Pour assurer la mise en sécurité définitive des déchets radioactifs, le stockage devra être fermé. La conception de Cigéo offre la possibilité d’une fermeture progressive des alvéoles de stockage, des galeries souterraines puis des puits et des descenderies. Chaque étape de fermeture rendra plus complexe le retrait de colis (nécessité de rouvrir l’alvéole et de réinstaller les équipements de manutention) mais permettra d’ajouter des dispositifs de sûreté passive. Compte tenu de leur importance, l’Andra propose que le franchissement de ces étapes fasse l’objet d’une autorisation spécifique. Le Parlement a d’ores et déjà décidé que seule une loi pourrait autoriser la fermeture définitive du stockage.
Des rendez-vous réguliers avec l’ensemble des acteurs pour décider ensemble
L’Andra propose que des rendez-vous soient programmés régulièrement avec l’ensemble des acteurs (riverains, collectivités, évaluateurs, État…) pour contrôler le déroulement du stockage et préparer les étapes suivantes. Ces rendez-vous seront alimentés par les résultats des réexamens périodiques de sûreté, fixés au moins tous les 10 ans par l’Autorité de sûreté nucléaire, de la surveillance du stockage et par les progrès scientifiques et technologiques. Le premier de ces rendez-vous pourrait avoir lieu cinq ans après le démarrage du centre.
Les conditions de réversibilité constituent l’un des sujets majeurs discutés dans le cadre du débat public. Les échanges alimenteront la préparation de la future loi qui fixera les conditions de réversibilité du stockage. Cette loi sera votée avant que la création de Cigéo ne puisse être décidée.
Pour en savoir plus sur les propositions faites par l’Andra en matière de réversibilité du stockage, voir ../docs/rapport-etude/fiche-reversibilite-cigeo.pdf
QUESTION 689 - laboratoire
Posée par Alexandre UNGE, L'organisme que vous représentez (option) (MARLY LE ROI), le 11/12/2013
Bonjour, j’ai visité le laboratoire de bure et je suis rassuré sur le travail de l’Andra. Jusqu’à quand le laboratoire sera-t-il exploité ? Merci
Réponse du 19/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’autorisation d’exploiter le Laboratoire souterrain a été prolongée jusqu’en 2030 pour accompagner la phase de démarrage du stockage et poursuivre les observations sur la durée. A l’horizon 2030, il conviendra d’examiner l’intérêt de poursuivre ces observations de longue durée en prolongeant l’exploitation du Laboratoire, en parallèle de Cigéo.
QUESTION 688 - déchets prévus
Posée par Michel JABELOT , L'organisme que vous représentez (option) (HAUTE MARNE), le 11/12/2013
Il faut s'occuper de ces déchets sans attendre ! Connaissez-vous l’ensemble des déchets qui pourraient être stockés ? En quelle quantité ? Merci . michel
Réponse du 30/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le projet de stockage profond Cigéo est conçu pour mettre en sécurité définitive les déchets dont le niveau de radioactivité et la durée de vie ne permettent pas de les stocker, de manière sûre à long terme, en surface ou à faible profondeur.
Les déchets concernés proviennent principalement du secteur de l’industrie électronucléaire et des activités de recherche associées ainsi que, dans une moindre part, des activités liées à la Défense nationale. Les déchets dits de « haute activité » (HA) correspondent principalement aux résidus hautement radioactifs issus du traitement des combustibles nucléaires usés utilisés pour la production d’électricité. Les déchets dits de « moyenne activité à vie longue » (MA-VL) ont des origines variées : résidus issus du traitement des combustibles nucléaires usés et de la fabrication de certains combustibles, composants (hors combustible) ayant séjournés dans les réacteurs nucléaires, déchets technologiques issus de la maintenance des installations nucléaires, de laboratoires, d’installations liées à la Défense nationale, du démantèlement...
Cigéo est conçu pour prendre en charge l’ensemble des déchets les plus radioactifs produits par les installations nucléaires passées, actuelles et en cours de construction. Par précaution, des volumes supplémentaires sont prévus en réserve dans Cigéo pour certains déchets de faible activité à vie longue qui, le cas échéant, ne pourraient pas être stockés dans le stockage à faible profondeur à l’étude par l’Andra.
L’inventaire détaillé des déchets radioactifs susceptibles d’être stockés dans Cigéo est connu et a été établi en lien avec les producteurs de déchets. Le document est disponible sur le site du débat public : ../docs/rapport-etude/dechets-pris-en-compte-dans-etudes-conception-cigeo.pdf.
QUESTION 687 - Proctection
Posée par Michel JABELOT, L'organisme que vous représentez (option) (HAUTE MARNE), le 11/12/2013
Ces déchets existent depuis de nombreuses années. J'imagine que l'expérience des entreprises qui s'occupent de ces déhcets actuellement va servir pour Cigéo. Les travailleurs pourront -il intervenir dans les galeries à 500 mètres sous terre ? Seront-ils protégés ?
Réponse du 28/01/2014,
Réponse apportée à l’Andra, maître d’ouvrage :
Si Cigéo est autorisé, les activités de chantier et les activités nucléaires seront séparées sur les installations de Cigéo, et seront donc exploitées comme deux entités indépendantes. Pour cela :
- dans l’installation souterraine, la zone d’exploitation et la zone chantier seront physiquement séparées,
- l’accès aux différentes zones se fera par des accès distincts : par la descenderie pour la zone en exploitation, par les puits verticaux pour la zone chantier,
- chaque zone aura un circuit de ventilation dédié.
Dans la zone d’exploitation, les colis de déchets radioactifs seront transférés en souterrain dans des hottes qui feront écran aux radiations émises par les déchets. Ainsi le personnel pourra circuler dans les galeries souterraines pendant l’exploitation notamment pour assurer la surveillance de l’installation et la maintenance des équipements.
Les mesures de protection des travailleurs qui seraient appliquées pour Cigéo, seraient identiques à celles prises actuellement dans les installations nucléaires existantes et notamment celles accueillant les déchets radioactifs destinés au stockage. Comme pour toute installation nucléaire, le choix et le dimensionnement de ces protections suivront le principe « ALARA* » qui vise à limiter autant que possible l’exposition des personnes aux rayonnements et la réglementation en vigueur édictée par le code de la santé publique et le code du travail.
Pour plus d’information voir la circulaire relative aux mesures de prévention des risques d’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants a été élaborée conjointement par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et la direction générale du travail http://www.asn.fr/index.php/S-informer/Actualites/2010/Prevention-des-risques-d-exposition-des-travailleurs-aux-rayonnements-ionisants
*As Low As Reasonably Achievable

QUESTION 686 - Faire confiance dans les estimations de pollution ?
Posée par Marie Franceline PORNON, L'organisme que vous représentez (option) (SAINT PRIEST), le 11/12/2013
Cela a été écrit dans un des cahiers d'acteurs : l'ANDRA n'annonce pas à la population qu'il n'y aura pas de remontée de radionucléides vers le lieu de vie des générations futures, non, elle annonce clairement qu'il y aura une pollution, une contamination acceptable. Et avec les modèles mathématiques elle prévoit des valeurs précises en millisieverts. Des valeurs qui dans des siècles auront peut-être changé et n'auront plus aucun sens, vu que régulièrement cette norme est sans cesse abaissée. Comment peut-on faire confiance en de telles valeurs, dans de telles échéances ? Et comment oser comparer l'impact des radionucléides artificiels remontés au niveau du sol, à l'impact de la radioactivité naturelle ?
Réponse du 06/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le milliSievert (mSv) est une unité de mesure utilisée dans tous les pays et qui permet d’évaluer les effets des rayonnements ionisants sur l’homme. Elle prend en compte l’ensemble des dommages induits par une irradiation et permet ainsi de comparer tous les types d'exposition à un rayonnement ionisant, qu’il soit d’origine naturelle (rayonnement cosmique, radioactivité naturelle) ou artificielle (installations nucléaires, applications médicales).
La réglementation impose aux installations nucléaires de ne pas dépasser la norme de 1 mSv par an pour l’impact que pourraient engendrer leurs rejets sur la population. L’Autorité de sûreté nucléaire impose au stockage profond un seuil de 0,25 mSV par an, soit un quart de cette norme réglementaire. Si les normes réglementaires sont susceptibles d’évoluer, la comparaison à l’irradiation d’origine naturelle (2,5 mSv en moyenne en France, soit dix fois plus que la valeur applicable à Cigéo) restera quant à elle toujours pertinente.
La couche d’argile très peu perméable, de plus de 130 mètres d’épaisseur, dans laquelle serait installé le stockage souterrain à 500 mètres de profondeur s’il est autorisé, servira de barrière naturelle pour retenir les radionucléides contenus dans les déchets et freiner leur déplacement. Le stockage permettra ainsi de garantir leur confinement sur de très longues échelles de temps. Seuls quelques-uns de ces radionucléides, les plus mobiles et dont la durée de vie est longue, pourront migrer jusqu’aux limites de la couche argileuse - de manière très étalée dans le temps (plus d’une centaine de milliers d’années) - et atteindre en quantités extrêmement faibles les couches géologiques situées au-dessus et en-dessous de l’argile et dans lesquelles l’eau peut circuler. Dans son évaluation d’impact sur l’homme et l’environnement à long terme, l’Andra suppose que les eaux de ces couches pourraient être captées par forage et utilisées pour des usages du type de ceux qui peuvent être pratiqués aujourd’hui (jardin, boisson, abreuvement des animaux). Les études montrent que même dans ce cas, l’impact du stockage reste inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire et ne présente pas de risque pour la santé.
QUESTION 685 - Le débat public
Posée par Isabelle GEORGES, L'organisme que vous représentez (option) (MOËLAN SUR MER), le 11/12/2013
Le débat public se termine le 15 décembre. Si c'est un échec au niveau des réunions publiques, je trouve qu'il y a pas mal de choses intéressantes sur internet. Il me semble que toutes les failles du projet ont été signifiées. En dehors de la synthèse attendue qui sera rédigée par la CPDP, quel rôle, de par sa mission légale, pourrait jouer la CNDP au niveau de l'information à l’OPECST, aux deux chambres et au gouvernement ? Est-ce qu'il y a un après-débat encadré par la CNDP ?
Réponse du 19/12/2013,
Le président de la CNDP rédigera pour le 15 février un bilan du débat portant sur le déroulement et les conditions du débat. Ce bilan accompagnera le compte rendu de la CPDP, ces documents sont publics. Le parlement (commissions, OPECST) peut décider d’auditionner le président de la CNDP. Ces auditions peuvent être publiques.
La concertation postérieure à un débat public ne porte plus sur l’opportunité du projet ; ce point a été l’un des enjeux principaux de débat public. C’est une obligation pour le maître d’ouvrage codifiée dans le code de l’environnement à l’article L.121-131 :
« Le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable du projet informe la commission nationale du débat public, pendant la phase postérieure au débat public jusqu’à l’enquête publique, des modalités d’information et de participation du public mises en œuvre ainsi que de sa contribution à l’amélioration du projet.
La commission peut émettre des avis et recommandations sur ces modalités et leur mise en œuvre.
Le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable du projet peut demander à la commission de désigner un garant chargé de veiller à la mise en œuvre des modalités d’information et de participation du public. »
QUESTION 684 - Un projet truqué?
Posée par Jean-Pierre LAFFORT, L'organisme que vous représentez (option) (TOULON), le 10/12/2013
Description * Quand on s'intéresse à l'historique du projet CIGéo on voit tout de suite que tout est truqué. Il y a une volonté délibérée d'aboutir à l'enfouissement. On a mis beaucoup d'argent dans la solution de l'enfouissement. On n'a pas fait grand chose pour étudier la transformation des déchets, ni le stockage pérenne en surface. On n'a pas fait grand chose pour concevoir des casemates de surface ou sub-surface qui dureraient des siècles. Pourquoi privilégier l'enfouissement ? Comment faire confiance en la Terre dont on connaît un peu le passé, mais dont on est incapable de prévoir le comportement ni dans le court terme ni dans le très long terme?
Réponse du 30/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Concernant vos questions relatives aux autres axes de recherche
Dans le cadre du programme de recherches mis en place par le Parlement en 1991, plus de 1,3 milliards d’euros ont été consacrés aux recherches sur la séparation/transmutation des déchets et l’entreposage de longue durée, en surface et en sub-surface selon les données fournies par le CEA.
La séparation/transmutation ne supprime pas la nécessité d’un stockage profond car elle ne serait applicable qu’à certains radionucléides contenus dans les déchets (ceux de la famille de l’uranium, appelés les actinides mineurs). Par ailleurs, les installations nucléaires nécessaires à la mise en œuvre d’une telle technique produiraient des déchets qui nécessiteraient aussi d’être stockés en profondeur pour des raisons de sûreté.
Le compte rendu du débat public de 2005 avait fait émerger deux options. L’une de ces options retenait le stockage géologique comme solution en tenant compte de l’exigence de réversibilité. L’autre option consistait à mettre en place un double programme d’essais in situ, l’un à Bure pour le stockage géologique, l’autre sur un site à déterminer pour l’entreposage de longue durée, et à renvoyer la décision autour de 2020.
Dans son avis du 1er février 2006, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a toutefois estimé qu’il ne serait pas raisonnable de retenir comme solution de référence la solution consistant à renouveler plusieurs fois un entreposage de longue durée, car elle suppose le maintien d’un contrôle de la part de la société et la reprise des déchets par les générations futures, ce qui semble difficile à garantir sur des périodes de plusieurs centaines d’années. Dans ces conditions, l’ASN a considéré que l’entreposage de longue durée ne peut pas constituer une solution définitive pour la gestion des déchets radioactifs de haute activité à vie longue. L’ASN a estimé au contraire que des résultats majeurs relatifs à la faisabilité et à la sûreté d’un stockage ont été acquis sur le site étudié par l’Andra en Meuse/Haute-Marne.
Dans le cadre de la loi de programme du 28 juin 2006, le Parlement a fait le choix de la solution du stockage profond pour mettre en sécurité définitive les déchets les plus radioactifs. Il est en effet de la responsabilité des générations actuelles de proposer une solution pour mettre en sécurité de manière définitive ces déchets et ne pas reporter leur charge sur les générations futures en misant sur le fait qu’elles trouveront peut-être d’autres solutions. En effet, personne ne peut garantir aujourd’hui que d’autres solutions émergeront dans le futur, ni que ces hypothétiques alternatives présenteraient les mêmes performances de sûreté à long terme que le stockage. Les solutions d’entreposage, qu’elles soient en surface ou à faible profondeur, ne peuvent assurer le confinement à long terme de la radioactivité. Le Parlement a demandé que le stockage soit réversible pendant au moins 100 ans pour laisser des choix aux générations suivantes. Cela leur permettra notamment de faire évoluer cette solution si elles le souhaitent.
Le Parlement a également décidé la poursuite des études et recherches sur l’entreposage et la séparation-transmutation, en complémentarité avec le stockage. Un travail important a ainsi été réalisé par l’Andra et Areva pour intégrer les avancées des recherches dans la conception d’une nouvelle installation d’entreposage de déchets vitrifiés mise en service en 2013 à La Hague pour envisager une durée de vie accrue de l’installation au-delà d’une cinquantaine d’années. Fin 2012, l’Andra a réalisé un bilan des études et des recherches sur l’entreposage (../docs/decisions/Rapport-2012-Andra-entreposage.pdf).
Concernant votre question relative à la géologie
De manière générale, la démarche scientifique se fonde sur l’observation, puis sur l’expérimentation et enfin sur la modélisation et la simulation numérique qui permettent d’extrapoler des résultats à des échelles inaccessibles via l’expérimentation. Le propre des sciences de la Terre et de l’Univers est que les observations permettent d’appréhender des phénomènes qui se déroulent sur de très longues durées. Cette démarche scientifique est au cœur des études menées par l’Andra depuis une vingtaine d’années pour étudier la faisabilité du stockage profond. Pour mener ces recherches, l’Andra mobilise la communauté scientifique dans de nombreuses disciplines (sciences de la Terre et de l’environnement, chimie, science des matériaux, mathématiques appliquées…) au travers de partenariats avec des organismes de recherche et des établissements universitaires français, ainsi qu’au moyen de coopérations internationales.
Les recherches menées depuis 1994 sur le site étudié en Meuse/Haute-Marne ont permis aux scientifiques de reconstituer de manière détaillée son histoire géologique, depuis plus de 150 millions d’années. Le site étudié se situe dans la partie Est du bassin de Paris qui constitue un domaine géologiquement simple, avec une succession de couches de calcaires, de marnes et de roches argileuses qui se sont déposées dans d’anciens océans. Les couches de terrain ont une géométrie simple et régulière. Cette zone géologique est stable et caractérisée par une très faible sismicité. La couche argileuse étudiée pour l’implantation éventuelle du stockage, qui s’est déposée il y a environ 155 millions d’années, est homogène sur une grande surface et son épaisseur est importante (plus de 130 mètres).
Aucune faille affectant cette couche n’a été mise en évidence sur la zone étudiée.
Cette analyse s’appuie sur des investigations géologiques approfondies : plus de 40 forages profonds ont été réalisés, complétés par l’analyse de plus de 300 kilomètres de géophysique 2D et de 35 km² de géophysique 3D. Environ 50 000 échantillons de roche ont été prélevés.
La roche argileuse a une perméabilité très faible, ce qui limite fortement les circulations d’eau à travers la couche et s’oppose au transport éventuel des radionucléides par convection (c’est-à-dire par l’entraînement de l’eau en mouvement). Cette très faible perméabilité s’explique par la nature argileuse, la finesse et le très petit rayon des pores de la roche (inférieur à 1/10 de micron). L’observation de la distribution dans la couche d’argile des éléments les plus mobiles comme le chlore ou l’hélium confirme qu’ils se déplacent majoritairement par diffusion et non par convection. Cette « expérimentation », à l’œuvre depuis des millions d’années, confirme que le transport des éléments chimiques se fait très lentement (plusieurs centaines de milliers d’années pour traverser la couche). Ces durées de transport constatées sont cohérentes avec celles estimées par simulation.
Les expérimentations menées au Laboratoire souterrain permettent également d’étudier l’impact de la construction et de l’exploitation d’un stockage sur le milieu géologique : impact lié au creusement des galeries, à l’introduction de matériaux exogènes tels que l’acier ou le béton, à l’effet de la chaleur générée par les déchets les plus radioactifs... La conception de Cigéo vise à limiter les perturbations engendrées et l’étude des processus physiques et chimiques permet de vérifier que ces perturbations induites sur la roche restent limitées. Elle fournit également des orientations pour la conception du stockage. L’Andra met également en place des démonstrateurs dans le Laboratoire souterrain, qui permettent notamment de comparer avec les résultats prévus par les simulations (par exemple la répartition du champ de température autour d’une alvéole simulant le stockage de déchets de haute activité) et de s’assurer que les prévisions des modèles sont cohérentes avec ce que l’on observe. Si Cigéo est autorisé, cette démarche sera poursuivie lors de la réalisation progressive du stockage.
Outre l’expérimentation, la validation des modèles passe également par l’étude d’analogues archéologiques ou naturels. Les laitiers de haut-fourneau du XVIe siècle, les blocs de verre issus d’épaves datant de l’Antiquité ou encore les verres basaltiques constituent par exemple des analogues du système « verre/métal/argile » soumis à une altération par l’eau. Bien que la composition chimique et les conditions d’altération de ces verres ne soient pas strictement identiques à celles des matrices utilisées pour vitrifier certains déchets radioactifs, leur étude permet de tester les modèles proposés et de progresser dans la compréhension des mécanismes d’altération. Concernant le comportement des radionucléides, les deux sites de réacteurs nucléaires naturels découverts à Oklo (Gabon) en 1972, celui de Bangombé en surface à 11 m de profondeur et celui d’Okélobondo à 420 m de profondeur, apportent des informations précieuses. Ces réacteurs naturels ont fonctionné il y a 2 milliards d’années, les conditions géologiques, et notamment la teneur du minerai en uranium 235, ayant provoqué une réaction en chaîne spontanée pendant plusieurs centaines de milliers d’années. Les travaux de caractérisation (analyses minéralogiques, chimiques et isotopiques) ont montré la très faible migration des radionucléides dans les conditions chimiques réductrices et en présence d’argile. Ils ont permis d’établir les mécanismes géochimiques qui ont prévalu à ce comportement et de tester les modèles de représentation associés.
La simulation numérique permet d’obtenir des résultats inaccessibles par l’expérience du fait de la complexité et de l’interaction des phénomènes à étudier ou des grandes échelles de temps et d’espace sur lesquelles ils se déroulent. Pour représenter les phénomènes que l’on veut étudier, on utilise des modèles physiques et mathématiques qui sont alimentés par des données acquises sur le terrain, en laboratoire et dans la littérature scientifique. Ces derniers servent à mener des expériences virtuelles qui, en temps réel, se dérouleraient sur des milliers à centaines de milliers d’années, ou à analyser des processus qui intéressent de très grands volumes de roche. Grâce aux outils qu’elle a développés, l’Andra peut étudier différents phénomènes liés, par exemple, à la chaleur, au déplacement de l’eau ou aux échanges chimiques et analyser comment les composants du stockage se comporteraient et évolueraient dans le temps. Ces modèles permettent également de tester des hypothèses de situations dégradées dans l’évolution du stockage. Les différents modèles ainsi que les codes de simulation numérique font l’objet d’inter-comparaisons. Cela contribue à la confiance dans leur validité et permet d’identifier le cas échéant les points de compréhension à approfondir. Ces travaux de comparaison sont menés à l’Andra et dans le cadre de projets internationaux. Les modèles proposés par l’Andra font également l’objet d’une évaluation indépendante par l’IRSN dans le cadre de l’instruction des dossiers de l’Andra. Cela concerne par exemple les modèles d’écoulements hydrogéologiques et de migration des radionucléides, qui sont au cœur des études de sûreté.
L’ensemble de ces travaux font l’objet de publications dans des revues à comités de lecture (50 à 70 publications scientifiques internationales par an depuis 10 ans) et sont évalués par des instances indépendantes, en particulier la Commission nationale d’évaluation, mise en place par le Parlement, et l’Autorité de sûreté nucléaire qui s’appuie sur l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Les grands dossiers scientifiques et techniques que l’Andra remet dans le cadre de la loi font l’objet, à la demande de l’Etat, de revues internationales sous l’égide de l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’OCDE. L’Andra a également été évaluée en 2012 par l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES). Enfin, des expertises sont régulièrement commandées par le Comité local d’information et de suivi du Laboratoire souterrain sur les grands dossiers de l’Andra ou sur des sujets plus ciblés.
C’est la convergence de l’ensemble de ces études qui permet d’apprécier la robustesse du stockage et de préciser les incertitudes résiduelles. L’analyse de sûreté intègre la connaissance acquise et les incertitudes afin de produire une évaluation pénalisante de l’impact du stockage. Les études menées par l’Andra ont montré que l’impact du stockage serait nettement inférieur à celui de la radioactivité naturelle à l’échelle du million d’années.
QUESTION 683 - Soulèvement de terrain
Posée par Mario MULÉ, L'organisme que vous représentez (option) ( LA TRINITÉ), le 10/12/2013
J'ai lu dans un compte rendu de la CNE que l'ANDRA prévoyait que, du fait de l'augmentation de la température de l'argilite autour du stockage, le sol de BURE, autrement dit le plancher des vaches, remonterait de 20 cm en 600 ans. Je trouve cela extraordinaire. Comment se fier à des modèles mathématiques pour affirmer de telles transformations. Ce qui m'étonne encore davantage, c'est que cette remontée se fasse de façon homogène, d'un seul bloc, sans créer de failles dans lesquelles l'eau pourrait s'engouffrer. Comment cela est-ce possible ?
Réponse du 28/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L'évaluation de l'effet de la chaleur dégagée par les déchets de haute activité sur la déformation du sous-sol repose sur la physique bien connue de la dilatation des matériaux sous l'effet d'une élévation de température. Les paramètres régissant les transferts thermiques, la dilatation et la déformation mécanique des roches ont été mesurés sur échantillons prélevés dans des forages sur le site étudié en Meuse/Haute-Marne. Les simulations thermo-mécaniques ont montré l’absence de risque de fracturation des couches géologiques induites par l’échauffement et que les déformations en surface resteront limitées et très peu perceptibles, sauf avec des moyens de mesures précis (GPS, satellites).
QUESTION 682 - Enfouir c'est oublier
Posée par Patrick RIPART, L'organisme que vous représentez (option) (ANGERS), le 14/12/2013
Enfouir c'est favoriser l'oubli : l'oubli de ce qui est enfoui mais aussi de qui a décidé l'enfouissement. N'est-il pas plus sûr de ne pas jouer à l'apprenti-sorcier sur un avenir qui semble une éternité ?
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le stockage profond, est aujourd’hui la seule solution robuste pour mettre en sécurité à très long terme les déchets les plus radioactifs. Cette solution est étudiée depuis plus de 20 ans. Différentes solutions ont été étudiées dans le cadre du programme de recherches institué par la loi de 1991. Les résultats de ces recherches ont été évalués en 2005/2006 et un débat public a été organisé sur la politique nationale de gestion des déchets radioactifs. Sur la base de l’ensemble de ces éléments, le Parlement a fait le choix en 2006 du stockage profond réversible pour mettre en sécurité de manière définitive ces déchets et ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations futures. Le Parlement a demandé à l’Andra de préparer la mise en œuvre de cette solution.
La fermeture du stockage n’interviendra qu’à la fin d’un long processus, placé sous le contrôle de la société. Si Cigéo est autorisé, les générations suivantes pourront contrôler le déroulement du stockage et récupérer les déchets si elles souhaitent mettre en œuvre d’autres modes de gestion. En fonction de l’expérience acquise lors de l’exploitation de Cigéo, elles pourront décider progressivement de commencer à franchir des étapes de fermeture de certaines parties du stockage, par étapes. Après une centaine d’années d’exploitation, si elles décident de fermer définitivement le stockage, la sûreté sera alors assurée de manière passive, sans nécessité d’action humaine.
Le stockage n’est en aucune façon la voie vers l’oubli : l’une des missions importantes de l’Andra est justement d’organiser le maintien de la mémoire du stockage le plus longtemps possible. Le stockage profond est cependant la seule solution qui permet de se prémunir contre les conséquences d’un oubli, qui ne peut être exclu sur plusieurs milliers d’années, que les déchets soient laissés en surface ou stockés en profondeur. En effet, même en cas de perte complète de la mémoire du stockage, une intrusion inopinée à 500 mètres sous terre apparaît peu plausible, du moins sans un minimum d’investigations préalables. L’Andra évalue cependant par précaution dans son analyse de sûreté les conséquences d’un forage à travers le stockage pour vérifier que le stockage resterait sûr.
QUESTION 681 - CU
Posée par Damien NOUVEL, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 10/12/2013
J'ai une question : Pourra-t-on stocker les combustibles usés si un jour ils devaient venir à Bure ? A-t-on fait des études là-dessus ? Merci, Damien
Réponse du 19/12/2013,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La nécessité de stocker des combustibles usés dépendra de la politique énergétique qui sera mise en œuvre par la France dans le futur.
Dans le cadre de la politique énergétique actuelle en France, les combustibles usés issus de la production électronucléaire ne sont pas considérés comme des déchets mais comme des matières pouvant être valorisées, notamment dans les réacteurs de quatrième génération. A ce titre, ils ne sont pas destinés à être stockés dans Cigéo. Seuls les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue, issus du traitement de combustibles usés, sont destinés à Cigéo.
Dans l’hypothèse où les combustibles usés devraient être stockés directement, après refroidissement, ils pourraient être stockés dans Cigéo, qui a été conçu pour être flexible afin de pouvoir s’adapter à d’éventuels changements de la politique énergétique et à ses conséquences sur la nature et les volumes de déchets qui devront alors être stockés. A la demande du Ministère en charge de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, l’Andra, EDF et Areva ont étudié l’impact des différents scénarios établis dans le cadre du débat national sur la transition énergétique sur la production de déchets radioactifs et sur le projet Cigéo : ../docs/rapport-etude/20130705-courrier-ministere-ecologie.pdf.
La faisabilité de principe et la sûreté du stockage profond des combustibles usés ont par ailleurs été démontrées par l’Andra en 2005. Dans le cadre du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, l’État a demandé à l’Andra de vérifier par précaution que les concepts de stockage de Cigéo restent compatibles avec l’hypothèse d’un stockage direct de combustibles usés si ceux-ci étaient un jour considérés comme des déchets. L’Andra a remis fin 2012 un rapport d’étape. Dans l’hypothèse d’un stockage direct des combustibles usés, compte tenu du temps nécessaire de refroidissement, comme pour l’essentiel des déchets HA, leur stockage n’interviendrait pas avant l’horizon 2070/2080.
La nature et les quantités de déchets autorisés pour un stockage dans Cigéo seront fixées par le décret d’autorisation de création du centre. Toute évolution notable de cet inventaire devra faire l’objet d’un nouveau processus d’autorisation, comprenant notamment une enquête publique et un nouveau décret d’autorisation.
QUESTION 680 - transports des matières
Posée par Marie-Christine BASTIEN, L'organisme que vous représentez (option) (EULMONT), le 09/12/2013
Pour moi qui ne connaît rien au nucléaire, rien à la géologie, ce qui me fait le plus peur, c'est les transports ! J'ai entendu beaucoup à ce sujet. Quels sont les risques d'irradiation pour les voyageurs qui se trouveraient à côté d'un convoi ? Quelles sont les distances et les durées à respecter ? Qui a établi les règlements ? j'ai entendu parler de rayonnement gamma et en plus de rayonnement neutronique, que faut-il en penser ?
Réponse du 07/02/2014,
Réponse apportée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) :
La sûreté des transports de substances radioactives à usage civil est contrôlée en France par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), sur la base d’inspections et de l’agrément des emballages. Ce contrôle vise à assurer la protection des personnes et de l’environnement. Il porte sur la conception des emballages et les opérations de transports qui sont soumises à des contraintes réglementaires rigoureuses.
Les emballages doivent notamment assurer le confinement des substances radioactives transportées (éviter tout risque de contamination) et fortement réduire le rayonnement à l’extérieur du colis (limiter l’irradiation).
Concrètement, le débit de dose à proximité du véhicule ne doit pas dépasser certains seuils pour tous les rayonnements (dont les rayonnements gamma et neutrons). En pratique, les niveaux relevés sont en général beaucoup plus faibles que ces seuils. Même si ces seuils étaient atteints, une personne devrait rester 10 heures à deux mètres du véhicule pour que le rayonnement reçu atteigne la limite annuelle réglementaire d’exposition du public, soit 1 millisievert.
Avant chaque transport, le respect des limites de débits de dose tant pour le rayonnement gamma que pour le rayonnement neutron sont contrôlés.
À la différence de la réglementation technique de la sûreté des installations, propre à chaque État, pour la sûreté du transport de substances radioactives, des prescriptions à caractère international ont été élaborées au niveau de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Nommées TS-R-1, elles servent de base à la réglementation française sur le sujet.
Cette réglementation est par essence internationale compte tenu du nombre de transports franchissant les frontières.
L'Autorité de sûreté nucléaire s'attache donc à intervenir le plus en amont possible de l'élaboration de cette réglementation, en liaison avec l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), notamment au niveau du comité TRANSSC (Transport Safety Standards Committee) de l'AIEA.
Le rayonnement gamma est émis par les atomes possédant un trop plein d'énergie. Il s’agit d’une onde électromagnétique de même nature que la lumière ou les rayons X, mais beaucoup plus énergétique.
Le rayonnement neutronique est l'émission de neutrons résultant d'une fusion, d'une fission nucléaire, ou à la suite de divers réactions de noyaux telles que la désintégration nucléaire. Il existe surtout dans les réacteurs nucléaires où des réactions de fissions sont provoquées en masse. Dans les déchets radioactifs qui seront transportés à Cigéo, ce rayonnement neutronique, dû aux fissions spontanées des actinides présents dans les déchets, est très faible.
QUESTION 679 - L'expérience de la maîtrise des risques
Posée par Nathalie CHRÉTIEN, L'organisme que vous représentez (option) (CHAMPIGNY), le 09/12/2013
Je connais assez bien ce qui se passe dans le stockage de Soulaines et de Morvilliers. J'ai vécu comment l'ANDRA a imposé les centres de stockage de Soulaines et à Morvilliers. J'ai le droit de comparer avec Bure. Le même argent qui dégouline. Soulaines, une commune de 300 habitants avec un budget de 1,8 millions d'euros. Des rejets de radionucléides cachés. Des autorisations de rejets qui arrivent 14 années plus tard. Du tritium dans la nappe phréatique. Un accident de rejet de tritium sérieux (1,78 fois l'autorisation annuelle). Une pollution au terminal ferroviaire de Brienne-le-Château : entre les rails : 400 kg de terre qui ont alors été considérés comme des déchets radioactifs. Des grenades de la Grande guerre dans des big-bag livrés à Morvilliers. De l'américium en provenance de Valduc livré à Soulaines. La triche autorisée par l'ASN avec l'acceptation à Soulaines de déchets à vie longue, comme le chlore 36, le plutonium, l'uranium, etc...Et récemment le camion de déchets qui glisse sur une plaque de verglas à Arsonval. Maîtrise des risques ? Ais-je le droit de transposer pour BURE ?
Réponse du 11/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le Centre de stockage de l’Aube (CSA) est exploité par l’Andra dans le respect des règles de sûreté. Il en sera de même pour Cigéo. Dans son dernier rapport sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France (2012), l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) « porte une appréciation positive sur la façon dont l’ANDRA exploite ses centres de stockage de déchets radioactifs ».
Depuis la mise en service du CSA il y a plus de 20 ans (1992), aucun incident supérieur au niveau 1 de l’échelle INES (anomalie sortant du régime de fonctionnement autorisé, sans conséquence sur le site ou hors du site) n’a eu lieu. Chaque année, plusieurs milliers de mesures sont effectuées sur le site et dans son environnement afin de vérifier que le Centre ne présente pas de risque pour la santé.
L’impact du Centre est soumis au contrôle de l’ASN, qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’Andra. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra font l’objet d’un rapport annuel rendu public. En complément, des contre-expertises indépendantes ont déjà été réalisées autour du CSA, à la demande de la Commission locale d’information, comme récemment par l’ACRO (Association pour la radioactivité dans l’ouest). Ces contre-expertises confirment les résultats de l’Andra.
QUESTION 678 - Localisation ?
Posée par matthieu ELIOTT, L'organisme que vous représentez (option) (FRANCE), le 09/12/2013
Où serait construit le centre exactement ? En Meuse ? En Haute-Marne ? Ailleurs ?
Réponse du 30/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Si Cigéo est autorisé, son implantation est prévue à cheval sur les départements de la Meuse et de la Haute-Marne.
L’installation de surface dédiée à la réception, au contrôle et à la préparation des colis de déchets serait implantée dans une zone contiguë à la Meuse et à la Haute-Marne (cercle bleu sur la carte), située autour du Laboratoire souterrain, sur l’axe de la route départementale. Cette zone peut être desservie par une voie ferrée si cette option est retenue. Pour l’installation de surface, dédiée aux travaux de creusement des ouvrages souterrains et située à la verticale de l’installation souterraine, plusieurs scénarios d’implantation ont été étudiés en Meuse. Deux scénarios sont proposés (les scénarios 2 et 3) car ils sont plus favorables du fait de leur implantation en partie centrale de la zone dans laquelle sera implantée l’installation souterraine.
L’installation souterraine serait implantée au sud de la Meuse, à quelques kilomètres du Laboratoire souterrain de l’Andra, dans une zone de 30 km² au sein de la couche d’argile située à 500 mètres de profondeur et ayant fait l’objet de nombreuses reconnaissances géologiques.
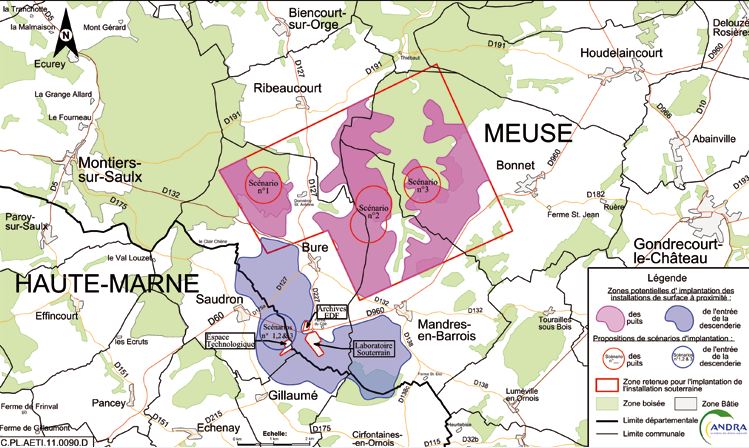
QUESTION 677 - Question
Posée par EVE NUM, L'organisme que vous représentez (option) (FRANCE), le 09/12/2013
Bonjour Pouvez vous nous dire ce que deviendront les déchets si le stockage n’était pas construit ? Merci
Réponse du 12/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les déchets les plus radioactifs produits par les générations passées et actuelles sont aujourd’hui entreposés, de manière sûre mais provisoire, sur leurs sites de production à La Hague (Manche), Marcoule (Gard), Cadarache (Bouches-du-Rhône) et, pour un volume limité, à Valduc (Côte-d’Or). Plus de 40 000 mètres cubes de déchets de haute activité (HA) et de moyenne activité à vie longue (MA-VL) y sont actuellement entreposés.
Si le stockage profond n’est pas autorisé, de nouvelles capacités d’entreposage seront nécessaires pour accueillir les déchets HA et MA-VL futurs et remplacer les entrepôts existants lorsque leur durée de vie sera atteinte. Ce mode de gestion laisse de la latitude pour décider ou non de réaliser le projet Cigéo. En revanche, il ne constitue pas une solution de gestion définitive et conduit à reporter la charge de la gestion de ces déchets radioactifs sur les générations suivantes.
Si le stockage profond est autorisé, les colis de déchets pourront être transférés progressivement de leurs entrepôts vers le stockage. La réversibilité donnera aux générations suivantes la possibilité de réexaminer périodiquement la stratégie de gestion retenue et de la faire évoluer si elles le souhaitent. La mise en œuvre de cette solution limite les charges reportées sur les générations futures et ouvre la voie à une mise en sécurité définitive des déchets.
On peut toujours remettre à demain ce que l’on pourrait commencer à faire aujourd’hui. Mais nos enfants pourraient nous reprocher de ne pas avoir préparé de solution pour gérer les déchets radioactifs produits par les activités dont nous bénéficions au quotidien.
QUESTION 676 - TRANSPORTS
Posée par emma BOX, L'organisme que vous représentez (option) (FRANCE), le 09/12/2013
Pouvez vous nous préciser comme seront transportés les déchets jusqu’à Cigéo ? Merci
Réponse du 12/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maitre d’ouvrage :
Les modalités d’acheminement des colis de déchets radioactifs depuis les sites où ils sont entreposés jusqu’à Cigéo sont étudiées par les producteurs de déchets (Areva, CEA et EDF). Le transport par voie ferroviaire est privilégié. Le réseau ferré national permet d’acheminer les convois jusqu’à proximité de Cigéo.
La desserte locale de Cigéo est étudiée dans le cadre du schéma interdépartemental de développement du territoire. L’arrivée et le déchargement des trains se feraient dans un terminal ferroviaire spécifique. Deux options sont possibles :
- soit le terminal ferroviaire est implanté sur une voie ferroviaire existante en Meuse ou en Haute-Marne. Le transport final jusqu’à Cigéo serait alors réalisé par voie routière.
- soit le terminal ferroviaire est implanté sur le site même de Cigéo, ce qui nécessiterait de créer un raccordement ferroviaire d’environ 15 km.
Pour plus d’informations sur les itinéraires étudiés pour le transport des colis de déchets, vous pouvez consulter le chapitre correspondant du dossier du maître d’ouvrage (4.3 – Le transport des colis de déchets): ../docs/dmo/chapitres/DMO-Andra-chapitre-4.pdf
QUESTION 675 - question
Posée par SERGE LAMA, L'organisme que vous représentez (option) (STRASBOURG ), le 09/12/2013
Madame, Monsieur, Je ne comprends pas pourquoi enfouir à 500 m est ce moins sur que de laisser ces déchets là ou ils sont ? Merci de penser à nos enfants !! bien à vous Serge
Réponse du 12/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
En France, toute installation nucléaire répond à des exigences de sûreté contrôlées par l’Autorité de sûreté nucléaire. Ainsi, quelle que soit sa situation, en surface ou en profondeur, une installation gérant des déchets radioactifs doit garantir le confinement de la radioactivité contenue dans les déchets. Cette garantie doit être apportée y compris en situation accidentelle. Par exemple, des mesures renforcées sont prises vis-à-vis du risque incendie pour une installation souterraine. En France comme à l’étranger, le stockage profond est privilégié car une installation située à 500 mètres de profondeur offre la possibilité de mettre en sécurité les déchets radioactifs sur le très long terme contrairement à un entreposage en surface. De plus une installation souterraine est par nature moins vulnérable aux agressions externes (conditions météorologiques extrêmes, chute d’avion, actes de malveillance…) qu’une installation située en surface.
QUESTION 674 - Titre de votre question *Evaluations falsifiées ?
Posée par Jacques MASCA, L'organisme que vous représentez (option) (BOURGES), le 09/12/2013
Description : Je viens d'apprendre par un rapport de la société Suisse GEOWATT que l'ANDRA avait plus ou moins falsifié les résultats de ses recherches sur le potentiel géothermique de BURE. Comment est-il possible que les évaluateurs comme l'IRSN et la CNE n'aient pas vu la triche ? Pourquoi n'ont-ils pas réagi ? Pourquoi n'ont-ils rien communiqué sur le sujet ? Pourquoi n'ont-ils pas rappelé l'ANDRA à l'ordre ? Peut-on faire confiance dans les évaluateurs ? Peut-on alors faire confiance à l'ANDRA qui ment pour arriver à ses fins ? Jacques Masca
Réponse du 27/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’Andra réfute énergiquement l’accusation de falsification des résultats du forage destiné à étudier les potentialités en matière de géothermie proférée par les opposants au projet. Nous vous invitons à consulter le communiqué de presse suivant qui répond aux accusations sur le potentiel géothermique autour de Cigéo : http://www.andra.fr/download/andra-meuse-fr/document/l_andra-repond-aux-accusations-sur-la-geothermie-cp-du-06-11-2013.pdf.
La CNE a pris position dans son rapport n°4 de juin 2010 (https://www.cne2.fr/telechargements/Rapport-CNE2-2010.pdf), estimant que « La Commission adhère, comme l’Andra, à la conclusion que le Trias dans la région de Bure ne représente pas une ressource géothermique potentielle attractive dans les conditions technologiques et économiques actuelles. Cependant cette considération repose plus sur la modestie de la température et l’incertitude qui demeure sur les possibilités de réinjecter l’eau que sur la productivité de l’aquifère du Trias inférieur dont il n’est pas pour l’instant démontré qu’elle soit inférieure à celle constatée dans les installations géothermiques au Dogger existantes dans le centre du Bassin parisien. »
L’IRSN a également rappelé sa position sur le potentiel géothermique du site de Meuse/Haute-Marne. http://www.irsn.fr/dechets/cigeo/Documents/Fiches-thematiques/IRSN_Debat-Public-Cigeo_Fiche-Geothermie.pdf
QUESTION 673 - question
Posée par mayar DAVID, L'organisme que vous représentez (option) (BAGNEUX), le 09/12/2013
Bonjour, Comment pourrons nous conserver la mémoire d’un tel site ? Laisser les déchets en surface serait dangereux si personne n’est là pour les surveiller dans 5 000 ans, l’enfouissement restera-t-il sûr lui, même en cas d’oubli ?
Réponse du 12/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif fondamental de Cigéo est de protéger l’homme et l’environnement des déchets radioactifs sur de très longues échelles de temps. La sûreté à long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. C’est une des raisons qui a conduit, en 2006, le Parlement à retenir la solution du stockage profond. En effet, cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli, contrairement à l’entreposage. En cas de perte complète de la mémoire du stockage, une intrusion inopinée à 500 mètres sous terre apparaît peu plausible, du moins sans un minimum d’investigations préalables. L’Andra évalue cependant par précaution dans son analyse de sûreté les conséquences d’un forage à travers le stockage pour vérifier que le stockage resterait sûr.
Malgré cette robustesse du stockage même en cas d’oubli, l’Andra conçoit Cigéo avec l’objectif d’en conserver la mémoire et de la transmettre aux générations futures le plus longtemps possible. Des solutions d’archivage de long terme existent pour les centres de stockage de surface exploités par l’Andra et font l’objet de revues périodiques. Le retour d’expérience montre que ces solutions paraissent robustes pour au moins les 500 premières années. Ainsi, pour Cigéo, l’Andra prévoit qu’un centre de la mémoire perdurera sur le site. Il pourra accueillir le public et comprendra notamment les archives du Centre.
De manière générale, le maintien de la mémoire doit aussi impliquer les acteurs locaux, qui peuvent prendre le relai en cas de défaillance de l’Andra ou de l’État. L’Andra veille d’ores et déjà à les informer sur les enjeux associés à la mémoire et étudie avec des anthropologues, des philosophes ou encore des artistes les facteurs qui peuvent favoriser la transmission de la mémoire. La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
L’Andra a lancé en 2010 un programme d’études pour proposer des outils qui rendent cette transmission plus robuste sur une échelle de temps millénaire. Des pistes se dessinent tels des marqueurs de surface, mais aussi des rendez-vous réguliers à mettre en place au niveau des populations locales.
En tout état de cause, comme il est impossible de garantir notre capacité à communiquer avec des êtres vivant dans plusieurs milliers d’années, c’est chaque génération qui aura la responsabilité de contribuer à transmettre cette mémoire aux générations suivantes.
QUESTION 672 - Sécurité du site - guerres
Posée par Guillaume ETIEVENT, L'organisme que vous représentez (option) (SAINT MARTIN D'HERES), le 09/12/2013
La région envisagée pour le site de stockage n'est pas si éloignée des lieux de combat des dernières guerres qui ont eu lieu en Europe occidentale : de 1870 à 1945 en passant par 1914. Par ailleurs, l'évolution de l'équipement militaire et les projets de recherche en cours laissent présager des moyens de destruction autrement plus importants que ceux utilisés à l'époque ! Enfin, quoiqu'en disent ses promoteurs et malgré toute notre bonne volonté pacifiste, la construction européenne ne pourra jamais garantir l'absence de conflits armés en Europe pour les siècles à venir : la crise actuelle, la montée des égoïsmes nationaux, des extrémismes et autres nationalismes peuvent faire craindre, pour cette crise ou la suivante, le retour de tels conflits, même au sein de l'Europe ! Qu'est-il prévu en cas de déclenchement de conflit armé en Europe ? A quel type d'attaque le site est-il conçu pour résister ? (bombardement classique, attaque nucléaire ?) A-t-on étudié les comportements possibles du stockage en cas d'attaque frontale, en particulier nucléaire ? Et en cas d'attaque par intrusion plus discrète (terrorisme, sabotage) ? Combien de temps le site sera-t-il capable de vivre "en autarcie" en cas de siège lors d'un conflit armé ? Cordialement,
Réponse du 09/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Du fait de son implantation à 500 mètres de profondeur, le stockage est une installation peu vulnérable. En particulier, après sa fermeture, le stockage sera complètement inaccessible à toute agression depuis la surface. Les installations de surface, nécessaires pendant la phase d'exploitation pour le contrôle et la préparation des colis de stockage, sont conçues pour protéger les opérateurs et les riverains des différents risques qui peuvent survenir. En particulier, le risque de malveillance est pris en compte par l'Andra. Des dispositions appropriées (contrôle des accès, gardiennage, résistance des bâtiments…) sont prévues pour assurer la protection des installations. Comme pour toute installation nucléaire, ces dispositions sont contrôlées par le Haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère en charge de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Pour être autorisées, les installations de Cigéo - en surface et en souterrain - devront répondre aux exigences des autorités de contrôle, qui ont été renforcées suite aux attentats de 2001.
QUESTION 671 - Les modèles mathémathiques
Posée par fabrice DESRIVOT, L'organisme que vous représentez (option), le 09/12/2013
Comment faire confiance à des modèles mathématiques pour imaginer le temps que mettront les radionucléides à traverser 65 mètres d'argilite ? Surtout quand il s'agit de durée supérieure à 100 000 ans ? De plus vous n'avez aucun moyen de vérifier vos prévisions ! Une catastrophe est prévisible. Quelle excuse les générations futures pourraient-elles vous donner ?
Réponse du 10/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
De manière générale, la démarche scientifique se fonde sur l’observation, puis sur l’expérimentation et enfin sur la modélisation et la simulation numérique qui permettent d’extrapoler des résultats à des échelles inaccessibles via l’expérimentation. Le propre des sciences de la Terre et de l’Univers est que les observations permettent d’appréhender des phénomènes qui se déroulent sur de très longues durées. Cette démarche scientifique est au cœur des études menées par l’Andra depuis une vingtaine d’années pour étudier la faisabilité du stockage profond. Pour mener ces recherches, l’Andra mobilise la communauté scientifique dans de nombreuses disciplines (sciences de la Terre et de l’environnement, chimie, science des matériaux, mathématiques appliquées…) au travers de partenariats avec des organismes de recherche et des établissements universitaires français, ainsi qu’au moyen de coopérations internationales.
Les recherches menées depuis 1994 sur le site étudié en Meuse/Haute-Marne ont permis aux scientifiques de reconstituer de manière détaillée son histoire géologique, depuis plus de 150 millions d’années. Le site étudié se situe dans la partie Est du bassin de Paris qui constitue un domaine géologiquement simple, avec une succession de couches de calcaires, de marnes et de roches argileuses qui se sont déposées dans d’anciens océans. Les couches de terrain ont une géométrie simple et régulière. Cette zone géologique est stable et caractérisée par une très faible sismicité. La couche argileuse étudiée pour l’implantation éventuelle du stockage, qui s’est déposée il y a environ 155 millions d’années, est homogène sur une grande surface et son épaisseur est importante (plus de 130 mètres).
Aucune faille affectant cette couche n’a été mise en évidence sur la zone étudiée.
Cette analyse s’appuie sur des investigations géologiques approfondies : plus de 40 forages profonds ont été réalisés, complétés par l’analyse de plus de 300 kilomètres de géophysique 2D et de 35 km² de géophysique 3D. Environ 50 000 échantillons de roche ont été prélevés.
La roche argileuse a une perméabilité très faible, ce qui limite fortement les circulations d’eau à travers la couche et s’oppose au transport éventuel des radionucléides par convection (c’est-à-dire par l’entraînement de l’eau en mouvement). Cette très faible perméabilité s’explique par la nature argileuse, la finesse et le très petit rayon des pores de la roche (inférieur à 1/10 de micron). L’observation de la distribution dans la couche d’argile des éléments les plus mobiles comme le chlore ou l’hélium confirme qu’ils se déplacent majoritairement par diffusion et non par convection. Cette « expérimentation », à l’œuvre depuis des millions d’années, confirme que le transport des éléments chimiques se fait très lentement (plusieurs centaines de milliers d’années pour traverser la couche). Ces durées de transport constatées sont cohérentes avec celles estimées par simulation.
Les expérimentations menées au Laboratoire souterrain permettent également d’étudier l’impact de la construction et de l’exploitation d’un stockage sur le milieu géologique : impact lié au creusement des galeries, à l’introduction de matériaux exogènes tels que l’acier ou le béton, à l’effet de la chaleur générée par les déchets les plus radioactifs... La conception de Cigéo vise à limiter les perturbations engendrées et l’étude des processus physiques et chimiques permet de vérifier que ces perturbations induites sur la roche restent limitées. Elle fournit également des orientations pour la conception du stockage. L’Andra met également en place des démonstrateurs dans le Laboratoire souterrain, qui permettent notamment de comparer avec les résultats prévus par les simulations (par exemple la répartition du champ de température autour d’une alvéole simulant le stockage de déchets de haute activité) et de s’assurer que les prévisions des modèles sont cohérentes avec ce que l’on observe. Si Cigéo est autorisé, cette démarche sera poursuivie lors de la réalisation progressive du stockage.
Outre l’expérimentation, la validation des modèles passe également par l’étude d’analogues archéologiques ou naturels. Les laitiers de haut-fourneau du XVIe siècle, les blocs de verre issus d’épaves datant de l’Antiquité ou encore les verres basaltiques constituent par exemple des analogues du système « verre/métal/argile » soumis à une altération par l’eau. Bien que la composition chimique et les conditions d’altération de ces verres ne soient pas strictement identiques à celles des matrices utilisées pour vitrifier certains déchets radioactifs, leur étude permet de tester les modèles proposés et de progresser dans la compréhension des mécanismes d’altération. Concernant le comportement des radionucléides, les deux sites de réacteurs nucléaires naturels découverts à Oklo (Gabon) en 1972, celui de Bangombé en surface à 11 m de profondeur et celui d’Okélobondo à 420 m de profondeur, apportent des informations précieuses. Ces réacteurs naturels ont fonctionné il y a 2 milliards d’années, les conditions géologiques, et notamment la teneur du minerai en uranium 235, ayant provoqué une réaction en chaîne spontanée pendant plusieurs centaines de milliers d’années. Les travaux de caractérisation (analyses minéralogiques, chimiques et isotopiques) ont montré la très faible migration des radionucléides dans les conditions chimiques réductrices et en présence d’argile. Ils ont permis d’établir les mécanismes géochimiques qui ont prévalu à ce comportement et de tester les modèles de représentation associés.
La simulation numérique permet d’obtenir des résultats inaccessibles par l’expérience du fait de la complexité et de l’interaction des phénomènes à étudier ou des grandes échelles de temps et d’espace sur lesquelles ils se déroulent. Pour représenter les phénomènes que l’on veut étudier, on utilise des modèles physiques et mathématiques qui sont alimentés par des données acquises sur le terrain, en laboratoire et dans la littérature scientifique. Ces derniers servent à mener des expériences virtuelles qui, en temps réel, se dérouleraient sur des milliers à centaines de milliers d’années, ou à analyser des processus qui intéressent de très grands volumes de roche. Grâce aux outils qu’elle a développés, l’Andra peut étudier différents phénomènes liés, par exemple, à la chaleur, au déplacement de l’eau ou aux échanges chimiques et analyser comment les composants du stockage se comporteraient et évolueraient dans le temps. Ces modèles permettent également de tester des hypothèses de situations dégradées dans l’évolution du stockage. Les différents modèles ainsi que les codes de simulation numérique font l’objet d’inter-comparaisons. Cela contribue à la confiance dans leur validité et permet d’identifier le cas échéant les points de compréhension à approfondir. Ces travaux de comparaison sont menés à l’Andra et dans le cadre de projets internationaux. Les modèles proposés par l’Andra font également l’objet d’une évaluation indépendante par l’IRSN dans le cadre de l’instruction des dossiers de l’Andra. Cela concerne par exemple les modèles d’écoulements hydrogéologiques et de migration des radionucléides, qui sont au cœur des études de sûreté.
L’ensemble de ces travaux font l’objet de publications dans des revues à comités de lecture (50 à 70 publications scientifiques internationales par an depuis 10 ans) et sont évalués par des instances indépendantes, en particulier la Commission nationale d’évaluation, mise en place par le Parlement, et l’Autorité de sûreté nucléaire qui s’appuie sur l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Les grands dossiers scientifiques et techniques que l’Andra remet dans le cadre de la loi font l’objet, à la demande de l’Etat, de revues internationales sous l’égide de l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’OCDE. L’Andra a également été évaluée en 2012 par l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES). Enfin, des expertises sont régulièrement commandées par le Comité local d’information et de suivi du Laboratoire souterrain sur les grands dossiers de l’Andra ou sur des sujets plus ciblés.
C’est la convergence de l’ensemble de ces études qui permet d’apprécier la robustesse du stockage et de préciser les incertitudes résiduelles. L’analyse de sûreté intègre la connaissance acquise et les incertitudes afin de produire une évaluation pénalisante de l’impact du stockage. Les études menées par l’Andra ont montré que l’impact du stockage serait nettement inférieur à celui de la radioactivité naturelle à l’échelle du million d’années.
QUESTION 670 - Circulation ed l'eau en sous-sols
Posée par Guillaume ETIEVENT, L'organisme que vous représentez (option) (SAINT MARTIN D'HERES), le 09/12/2013
Je ne suis pas expert en géologie, mais chacun sait que l'eau circule comme elle l'entend dans les différentes couches. Voire que les trajets peuvent changer avec le temps. Les spéléologues le savent très bien : j'ai lu des histoires de traçage avec de la fluorescéine. Les géologues attendaient la sortie de l'eau colorée en un point précis, et l'eau ressortait exactement à l'opposé. Et en reproduisant l'expérience à une autre période de l'année, l'eau ressortait ailleurs. Si l'eau pénétrait dans le stockage, que pourriez-vous faire ? Comment pourriez-vous empêcher la remontée de l'eau ? Comment être sur de ne pas reproduire le centre d'Asse en France et, le cas échéant, de pouvoir re-vider celui de Bure ? Cordialement,
Réponse du 11/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Concernant l’eau dans le stockage
Pendant l’exploitation du stockage, de nombreuses mesures seront prises pour prévenir d’éventuelles arrivées d’eau accidentelles dans Cigéo :
- Protection des puits et de la descenderie contre les intempéries,
- Etanchéification des puits et des descenderies au niveau des couches de roche aquifères traversées au-dessus de la couche d’argilite,S
- Systèmes de drainage des eaux issues des couches de roche supérieures peu productives et pompage de ces eaux jusqu’à la surface,
- Protection des canalisations d’eau interne et mécanismes de fermeture automatique en cas de rupture.
Ces dispositions sont largement éprouvées dans l’industrie minière.
Par précaution, des scénarios accidentels d’arrivées d’eau (par exemple suite à la défaillance d’une canalisation ou suite à une panne dans le système de drainage des eaux provenant des couches de roche supérieures) sont pris en compte dans les études de sûreté menées pour Cigéo, au même titre que pour n’importe quelle installation nucléaire. Compte tenu des origines possibles, ce débit sera nécessairement limité (pour mémoire le débit drainé par chacun des puits du Laboratoire souterrain est de l’ordre de 10 m3/jour en moyenne, ou moins, ce qui est très faible par comparaison à certains sites miniers). Un tel évènement resterait très localisé dans le stockage et n’aurait qu’un effet très limité sur l’argile qui sera protégée par les revêtements. En tout état de cause, ce type d’incident ne remettra pas en cause la sûreté du stockage.
Après la fermeture du stockage, au-delà de la durée de vie des ouvrages industriels, la couche d’argile très peu perméable, de plus de 130 mètres d’épaisseur, dans laquelle sera installé le stockage souterrain, servira de barrière naturelle pour retenir les radionucléides contenus dans les déchets et freiner leur déplacement. Le stockage permet ainsi de garantir leur confinement sur de très longues échelles de temps. Seuls quelques radionucléides mobiles et dont la durée de vie est longue pourront migrer jusqu’aux limites de la couche d’argile qu’ils atteindront après plusieurs dizaines de milliers d’années, puis potentiellement atteindre en quantités extrêmement faibles ensuite la surface et les nappes phréatiques, après plus de 100 000 ans. Leur impact radiologique serait alors plusieurs dizaines de fois inférieur à la radioactivité naturelle (qui est de 2,4 mSv par an en moyenne en France).
Concernant la possibilité de récupérer les colis de déchets
De nombreuses mesures sont prises pour garantir la réversibilité de Cigéo pendant toute sa durée d’exploitation afin de laisser des choix aux générations suivantes et notamment la possibilité de récupérer des déchets stockés.
L’Andra prévoit dès la conception de Cigéo des dispositifs techniques destinés à faciliter le retrait éventuel de colis de déchets stockés. En particulier, les alvéoles pour stocker les colis de déchets seront revêtues d’une paroi en béton ou en acier pour éviter les déformations et garantir l’accès aux colis de déchets pendant au moins 100 ans, avec des espaces ménagés entre les colis et les parois pour permettre leur retrait. Des capteurs permettront de surveiller le comportement des ouvrages.
Pour en savoir plus sur les propositions faites par l’Andra en matière de réversibilité du stockage, voir ../docs/rapport-etude/fiche-reversibilite-cigeo.pdf
QUESTION 669 - Faire confiance au génie de l'homme
Posée par Pascal HOUADART, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 09/12/2013
Enfouir c'est refuser de faire confiance au génie de l'Homme, à sa capacité d’inventer. Il y a à l'évidence une autre solution que l'enfouissement. Par exemple chauffer les radionucléides à 1 milliard de degrés pour les transformer en hélium. Ceux qui disent que c'est impossible mentent. Je l'ai lu encore récemment dans le journal 20 minutes : http://www.20minutes.fr/article/1080037/jean-pierre-petit-les-z-machines-permettent-envisager-fusion-nucleaire-pratiquement-dechets On aurait atteint 3,7 milliards de degrés en 2007 ! Or, il ne suffit que de 1 milliard de degrés. Les Américains et les russes travaillent sur ce sujet. On dépense bien des milliards pour le projet ITER ! Pourquoi ne pas ouvrir cette voie ? Et il y en a sûrement d'autres.
Réponse du 06/02/2014,
Réponse apportée pour l’Andra, maître d’ouvrage :
Le procédé que vous mentionnez fait sans doute référence à des recherches menées sur les réactions de fusion nucléaire associées à l’obtention de hautes températures. Le principe de la fusion consiste à produire de l’énergie en fusionnant deux atomes légers pour former un noyau plus lourd. Les radionucléides à période longue contenus dans les déchets radioactifs, qui ne sont pas des atomes légers, ne se prêtent pas à une réaction de fusion. Aussi les recherches menées sur la transmutation de radionucléides lourds (en l’occurrence les actinides) se fondent sur l’utilisation de neutrons rapides (plusieurs sources sont envisageables pour générer ces neutrons rapides ; celles qui ont été étudiées à ce stade sont (i) des réacteurs de fission nucléaire à neutrons rapides, (ii) des systèmes hybrides associant un accélérateur de protons et un réacteur au sein duquel lequel les protons sont transformés en neutrons (par « spallation »).
L’un des arguments mis en avant par les partisans des réacteurs de fusion de type Z-machine pour la production future d’énergie nucléaire est l’absence de formation de déchets radioactifs. Nous ne disposons pas d’éléments pour confirmer ou infirmer cette information. En tout état de cause Cigéo est conçu pour gérer les déchets existants et ceux restant à produire par le parc électronucléaire actuel, et non ceux que produiront, le cas échéant, de futurs parcs.
QUESTION 668 - Entreposage
Posée par Andrée LERAY, L'organisme que vous représentez (option) (PLOERMEL), le 08/12/2013
A la Hague, Areva vient d'inaugurer un nouveau bâtiment pour entreposer des colis HA. Ses murs feraient 2 m d'épaisseur et seraient conçu pour tenir un siècle. Des experts pensent qu'on saurait en faire qui pourraient tenir 3 siècles. Pourquoi ne travaille t-on pas sur cette voie ? Il y a bien des cathédrales qui ont plus de 1 000 ans ? Et il n'est pas certains qu'elles aient été conçues pour cette durée !
Réponse du 10/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’entreposage de longue durée (jusqu’à 300 ans) a été étudié par le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) dans le cadre des axes de recherche définis par le Parlement en 1991. Les études menées par le CEA ont notamment porté sur la durabilité des installations et sur leur fonctionnement. La durabilité des structures a été recherchée en recourant à des matériaux éprouvés dont les mécanismes d’altération sont maîtrisés et prévisibles et en instaurant naturellement autour des colis de déchets, dans les alvéoles ou les fosses d’entreposage, des conditions hygrométriques et thermiques favorables. Les études ont également cherché à simplifier la surveillance et la maintenance des installations, afin d’en réduire la charge sur le long terme et d’en accroître ainsi la pérennité.
Les concepts d’entreposage de longue durée présentent néanmoins des limites techniques. Les déchets les plus radioactifs destinés à Cigéo sont des déchets dangereux, qui le resteront plusieurs dizaines à centaines de milliers d’années. Les installations d’entreposage, qu’elles soient en surface ou en subsurface, ne sont pas conçues pour confiner la radioactivité à très long terme. En cas de perte de contrôle de telles installations, les conséquences radiologiques sur l’homme et l’environnement ne seraient pas acceptables. Dans son avis sur les recherches rendu au Gouvernement le 1er février 2006, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a considéré « que l’entreposage de longue durée ne peut pas constituer une solution définitive pour la gestion des déchets radioactifs de haute activité à vie longue » car il « suppose le maintien d'un contrôle de la part de la société et leur reprise par les générations futures, ce qui semble difficile à garantir sur des périodes de plusieurs centaines d'années. »
Le Parlement a fait le choix en 2006 du stockage profond réversible pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs. L’entreposage sur les sites des producteurs de déchets est nécessaire en complémentarité du stockage pour gérer les déchets dans l’attente de leur mise en stockage.
La loi du 28 juin 2006 a demandé à l’Andra de coordonner les études et recherches sur l’entreposage. Areva et l’Andra ont ainsi collaboré sur la conception du nouveau bâtiment d’entreposage inauguré récemment par Areva à La Hague, dans une optique de lui conférer une plus grande durabilité. Cette collaboration a abouti à l’intégration de plusieurs innovations : adoption d’un béton plus résistant à la carbonatation et à la chloruration, modification de la conception de l’installation pour une meilleure protection des pièces métalliques sensibles vis-à-vis de la corrosion, réservation d’un puits d’entreposage pour l’exposition des matériaux témoins de colisage et de structure soumis aux conditions de température et d’irradiation.
Le bilan des études et recherches menées par l’Andra sur l’entreposage est consultable sur le site du débat public : ../docs/decisions/Rapport-2012-Andra-entreposage.pdf
QUESTION 667 - Les scellements
Posée par Laurie Anne LERAY, L'organisme que vous représentez (option) (BEURVILLE), le 08/12/2013
Les scellements : L'ANDRA ne sait pas encore réaliser un scellement. Comment peut-on imaginer réaliser CIGéo sachant qu'on ne sait pas encore fermer la porte ? Puisque l'Andra aime bien parler de coffre-fort géologique, vous lanceriez-vous dans la fabrication d'un coffre-fort de banque sachant que vous ne savez pas fabriquer la porte, donc que vous ne pouvez pas tester sa solidité, sa résistance à l’effraction, son étanchéité, sa longévité ?
Réponse du 10/01/2014,
Réponse apporté par l’Andra, maître d’ouvrage :
Conformément à la demande des évaluateurs, l’Andra met en œuvre un programme d’essais pour apporter les éléments nécessaires à la démonstration de la faisabilité industrielle des scellements. En particulier, l’essai FSS (Full Scale Seal) vise à démontrer d’ici 2015 les modalités de construction d’un noyau à base d’argile gonflante et de massifs d’appui en béton en conditions opérationnelles. La qualité de réalisation de l’ouvrage est contrôlée. Le diamètre utile de l’ouvrage considéré est de 7,60 m environ. Compte tenu des contraintes opérationnelles que représente un ouvrage d’une telle taille, l’essai est réalisé en surface dans une « structure d’accueil » construite à cet effet. Des conditions de température et d’hygrométrie représentatives des conditions du stockage sont maintenues autour de l’essai et les conditions qui seraient induites par la réalisation d’un scellement en souterrain sont appliquées (ventilation et délai de transport du béton notamment) pour que cet essai soit représentatif des conditions de Cigéo. Les interfaces avec le revêtement laissé en place et les argilites dans les zones de dépose du revêtement sont représentées par des simulations d’alternances de portions de revêtement maintenues et déposées et de hors-profils (jusqu’à 1 m de profondeur) avec une surface représentative de la texture de l’argilite. Des massifs de confinement en béton bas pH sont également construits de part et d’autre du noyau avec deux méthodes distinctes (béton coulé et béton projeté). Cet essai fait partie du projet européen DOPAS (Demonstration Of Plugs And Seals) qui réunit quatorze organisations issues de huit pays européens et teste quatre concepts de scellement développés en Finlande, en Suède, en République Tchèque et en France.

QUESTION 666 - La récupérabilité
Posée par Violette DUFLOS, L'organisme que vous représentez (option) (BEURVILLE), le 08/12/2013
Comment peut t-on être sûr de la récupérabilité des colis HA dans des tuyaux de 100 m de longueur réalisés en éléments non soudés ? Aucune modélisation ne peut imaginer la déformation d’un tel ensemble durant un siècle. Si oui, merci de nous communiquer les documents.
Réponse du 11/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le chemisage des alvéoles de stockage des déchets de haute activité (HA) est prévu d’être réalisé par un tube d’acier épais (25 mm). Il permettra notamment les opérations de manutention des colis de déchets (mise en place dans le stockage et retrait éventuel dans le cadre de la réversibilité). Il sera mis en place au moment du creusement des alvéoles. Différentes techniques sont étudiées pour assembler les tronçons constitutifs du chemisage : emboîtement, soudage, voire vissage. Cet assemblage solidarise mécaniquement les tronçons entre eux. Les essais technologiques réalisés par l’Andra au Laboratoire souterrain et sur des bancs d’essai en surface ont permis de vérifier la précision d’alignement des tronçons et la possibilité de retirer les colis placés dans une alvéole de 100 m.
Afin de s’assurer d’une tenue mécanique durable du chemisage, l’acier retenu par l’Andra est capable de résister à des environnements sévères, sur le plan mécanique et sur le plan de la corrosion. En effet, il est issu de l’industrie pétrolière, où il doit assurer notamment une résistance à la corrosion en présence de sulfure d’hydrogène. Il s’agit d’un acier ductile, à forte limité d’élasticité. L’Andra procède à des essais spécifiques pour s’assurer notamment de l’insensibilité de cet acier à la corrosion sous contrainte.
L’Andra étudie le comportement mécanique du chemisage sous la sollicitation mécanique exercée par les argilites. Les instrumentations mises en place au Laboratoire souterrain sur des alvéoles d’essai ont permis de mesurer les efforts appliqués sur le chemisage. Ces données permettent de préciser les modèles mécaniques pour évaluer le comportement du chemisage à long terme et les choix de conception à privilégier pour assurer la robustesse du chemisage.
Si Cigéo est autorisé, l’Andra propose de réaliser à l’horizon 2025 une zone pilote pour le stockage de premiers colis de déchets HA moyennement exothermiques. Cette zone pilote comprendra des alvéoles témoins spécifiquement instrumentées. Cela permettra de disposer d’un retour d’expérience d’une cinquantaine d’années avant de mettre en œuvre le stockage des déchets HA fortement exothermiques, qui sont entreposés d’ici là sur le site Areva de La Hague pendant leur décroissance thermique.
QUESTION 665 - La légèreté des tests incendie
Posée par Muriel LERAY, L'organisme que vous représentez (option) (BEURVILLE), le 08/12/2013
D'après les communications de Bertrand THUILLIER il semblerait que les tests de tenue au feu aient été réalisés sur de simples éprouvettes en "ciment-bitume" à 800°C et pendant seulement 30 mn, alors que dans ce genre de tunnel, à cause de l'effet four, on a déjà mesuré des températures de 800 à 1200°C. Comment faire confiance en ces tests, alors que partout l'ANDRA a écrit clairement que, dans la zone de stockage MAVL, la situation d'incendie est plus difficile à écarter ?
Réponse du 30/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les tests auxquels vous faites référence ont été menés par le CEA pour ses propres besoins de caractérisation d’une matrice ciment-bitume retenue pour conditionner certains déchets. Ils ne doivent pas être confondus avec le programme d’essais spécifiques mis en place par l’Andra pour s’assurer de la robustesse des options techniques retenues pour le stockage de déchets bitumés. Ce programme prend en compte les spécificités liées à l’environnement souterrain. Un programme d’essais spécifique est ainsi en cours sur des conteneurs de stockage avec des essais de feu à l’échelle 1, dans des conditions réalistes d’incendie en souterrain, pour qualifier leurs performances.
De nombreux dispositifs sont retenus dans la conception de Cigéo pour maîtriser le risque d’incendie (réduction des charges calorifiques dans les équipements du stockage, dispositifs de détection et d’extinction, compartimentage des installations pour éviter toute propagation d’un incendie, possibilités d’intervention rapide des pompiers dans l’installation souterraine de Cigéo). Les conteneurs de stockage apportent une protection supplémentaire en cas d’incendie en complément de ces dispositifs.
QUESTION 664 - L'effet dominos
Posée par Jacques LERAY, L'organisme que vous représentez (option) (BEURVILLE), le 08/12/2013
Tout le monde est bien conscient de chacun des problèmes de l'hydrogène, de l'étincelle, de l'explosion, de l'incendie, de son extinction, de la tenue au feu du béton et du système de convoyage, chacun étant pris individuellement. Mais que se passera t-il en cas d'enchaînement des séquences, ce qu'on appelle l'effet dominos ? Imaginons : La chute d'un colis. La ventilation qui tombe en panne. L'hydrogène qui explose parce qu'on est à plus de 4%, à cause d'une étincelle qui se produit dans le détecteur d'incendie lui même. Le bitume pur qui s'auto-enflamme parce qu'on est à 350°C. La ventilation qui ne veut pas s'arrêter. Les portes coupe-feu qui ne ferment plus... Là, est-ce que Monsieur Fabrice BOISSIER maîtrise ?
Réponse du 09/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Selon le principe de défense en profondeur, pour éviter toute dispersion incontrôlée, l’objectif dès le début de la conception de Cigéo est d’identifier l’ensemble des défaillances et des agressions potentielles d’origine interne (chute, collision, incendie, explosion…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourrait remettre en cause le confinement des colis de stockage. Pour chaque défaillance et agression, l’Andra met en place un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles. Ainsi, conformément à la demande formulée par l’Autorité de sûreté nucléaire, l’Andra conçoit Cigéo de sorte que l’on puisse exclure un accident de grande ampleur, comme l’incendie d’un grand nombre de colis dans une alvéole.
Malgré ces dispositions, selon le même principe de défense en profondeur, les situations accidentelles (dont le cumul de plusieurs incidents) sont envisagées, pour vérifier que les conséquences en termes radiologiques restent limitées. Au stade actuel de la conception et de l’analyse des risques, les accidents les plus significatifs qui pourraient conduire à une dispersion de la radioactivité sont la chute d’un colis de déchets, une collision ou un départ de feu sur un engin de transfert transportant un colis. Cela s’explique par la nature des activités nucléaires de Cigéo qui sont principalement de la manipulation de colis de déchets.
Ainsi, la situation la pire en termes de conséquences proviendrait de l’accumulation des nombreuses défaillances successives suivantes :
- un départ de feu malgré la minimisation des matériaux inflammables dans l’installation,
- une détection tardive du fait d’une défaillance du réseau de surveillance,
- un système d’extinction inopérant,
- une intervention des pompiers retardée ou empêchée, malgré la présence d’engins de secours disposés dans l’installation,
- la perte de confinement d’un colis de déchets malgré la protection apportée par le conteneur de stockage.
Ceci engendrerait alors un rejet incontrôlé de particules radioactives à l’extérieur de Cigéo. L’évaluation réalisée, à ce stade de la conception, de l’impact d’un tel scénario hautement improbable montre que ses conséquences resteraient limitées, et nettement en deçà du seuil réglementaire qui impose la mise à l’abri des populations (10 millisieverts).
QUESTION 663 - Transformer les déchets demain
Posée par Yvette LOUCHART, L'organisme que vous représentez (option) (PROVIN ( NORD)), le 08/12/2013
Pourquoi avoir laissé tomber l'entreposage pérenne plébiscité durant le débat public de 2005 ? C'est la solution qui ouvre l'avenir. Elle fait confiance au génie de l'Homme capable de trouver la solution à la gestion des déchets nucléaires. Pourquoi ne pas imaginer que les ingénieurs de demain soient capables de trouver une vraie solution ? N'y a t'il pas des projets du côté des très hautes températures ?
Réponse du 10/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le compte rendu du débat public de 2005 avait fait émerger deux options. L’une de ces options retenait le stockage géologique comme solution en tenant compte de l’exigence de réversibilité. L’autre option consistait à mettre en place un double programme d’essais in situ, l’un à Bure pour le stockage géologique, l’autre sur un site à déterminer pour l’entreposage de longue durée, et à renvoyer la décision autour de 2020.
Dans son avis du 1er février 2006, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a toutefois estimé qu’il ne serait pas raisonnable de retenir comme solution de référence la solution consistant à renouveler plusieurs fois un entreposage de longue durée, car elle suppose le maintien d’un contrôle de la part de la société et la reprise des déchets par les générations futures, ce qui semble difficile à garantir sur des périodes de plusieurs centaines d’années. Dans ces conditions, l’ASN a considéré que l’entreposage de longue durée ne peut pas constituer une solution définitive pour la gestion des déchets radioactifs de haute activité à vie longue. L’ASN a estimé au contraire que des résultats majeurs relatifs à la faisabilité et à la sûreté d’un stockage ont été acquis sur le site de Bure.
Dans le cadre de la loi de programme du 28 juin 2006, le Parlement a fait le choix de la solution du stockage profond pour mettre en sécurité définitive les déchets les plus radioactifs. Il est en effet de la responsabilité des générations actuelles de proposer une solution pour mettre en sécurité de manière définitive ces déchets et ne pas reporter leur charge sur les générations futures en misant sur le fait qu’elles trouveront peut-être d’autres solutions. En effet, personne ne peut garantir aujourd’hui que d’autres solutions émergeront dans le futur, ni que ces hypothétiques alternatives présenteraient les mêmes performances de sûreté à long terme que le stockage. Les solutions d’entreposage, qu’elles soient en surface ou à faible profondeur, ne peuvent assurer le confinement à long terme de la radioactivité.
Le Parlement a demandé que le stockage soit réversible pendant au moins 100 ans pour laisser des choix aux générations suivantes. Cela leur permettra notamment de faire évoluer cette solution si elles le souhaitent (par exemple si des progrès scientifiques et technologiques futurs dans le domaine des très hautes températures venaient à offrir de nouvelles possibilités).
Le Parlement a également décidé la poursuite des études et recherches sur l’entreposage et la séparation-transmutation, en complémentarité avec le stockage. Un travail important a ainsi été réalisé par l’Andra et Areva pour intégrer les avancées des recherches dans la conception d’une nouvelle installation d’entreposage de déchets vitrifiés mise en service en 2013 à La Hague pour envisager une durée de vie accrue de l’installation au-delà d’une cinquantaine d’années.
QUESTION 662 - colis bitumineux
Posée par Elisabeth GUILLERY, L'organisme que vous représentez (option) (MEXIMIEUX), le 08/12/2013
Comment être sûr que les colis bitumineux non étanches, qui ne peuvent donc être qu'en position verticale, ne présentent aucun danger dans un espace confiné à 500 m sous terre, et en atmosphère explosive, à cause des rejets d'hydrogène ? En cas de problème sera t-il possible de redresser, de déplacer, de reprendre un colis défectueux, et qui de plus serait en train de voir migrer les radionucléides à l'extérieur des colis, de par le gonflement naturel des colis bitumineux ? Par ailleurs, hors du colis le bitume participe activement au risque d'incendie : comment affirmer, comment démontrer que bitume plus hydrogène n'entraîne pas l'infaisabilité du stockage ?
Réponse du 28/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le conditionnement par bitumage avait été retenu dans les années 1960 car il permet d’immobiliser les substances radioactives et d’empêcher leur dispersion (par exemple en cas de chute de colis de déchets lors d’une opération de manutention), en enrobant ces substances dans une matrice de bitume qui est ensuite coulée dans des fûts en acier. Les déchets bitumés sont actuellement entreposés sur les sites de Marcoule (CEA) et de La Hague (Areva NC). Leur stockage dans Cigéo ne pourra être autorisé par l’Autorité de sûreté nucléaire que si l’Andra démontre qu’elle maîtrise les risques associés à leur stockage.
Pour garantir la sûreté lors de leur stockage, l’Andra prévoit de placer les déchets bitumés dans des conteneurs de stockage robustes, de forte épaisseur, en béton armé (10 tonnes environ). Ces conteneurs devront résister aux agressions potentielles dans l’installation (incendie, explosion, chute). Ainsi, même en cas de problème pendant l’exploitation, il serait possible d’intervenir sur un colis de déchets bitumés, le colis de stockage garantissant le confinement des déchets. En particulier, en cas de gonflement, les déchets bitumés resteraient confinés à l’intérieur du conteneur en béton.
Les conteneurs de stockage apportent une protection supplémentaire en cas d’incendie en complément des autres dispositifs retenus dans la conception de Cigéo (réduction des charges calorifiques dans les équipements du stockage, dispositifs de détection et d’extinction, compartimentage des installations pour éviter toute propagation d’un incendie, possibilités d’intervention rapide des pompiers dans l’installation souterraine de Cigéo). Un programme d’essais est en cours sur des conteneurs de stockage avec des essais de feu à l’échelle 1 pour qualifier leurs performances.
Les déchets bitumés dégagent de faibles quantités d’hydrogène gazeux (quelques litres par an et par fût) , non radioactif. Au-delà d’une certaine quantité, l’hydrogène présente un risque d’explosion en présence d’oxygène. Pour maîtriser ce risque, l’Andra fixe une limite stricte aux quantités d’hydrogène émise par chaque colis de déchets, qui fera l’objet de contrôles. Pour éviter l’accumulation d’hydrogène, les installations souterraines et de surface seront ventilées pendant leur exploitation, comme le sont les installations d’entreposage dans lesquelles se trouvent actuellement ces déchets. Compte tenu de sa contribution à la sûreté de l’installation, la ventilation fait l’objet de mesures de fiabilisation pour réduire le risque de panne. De plus, des dispositifs de surveillance seront mis en place pour détecter toute anomalie sur le fonctionnement de la ventilation. Des situations de perte de la ventilation ont été envisagées. Les analyses de l’Andra montrent que, dans ce cas, on disposera alors de plus d’une dizaine de jours pour la rétablir, ce qui permettra de mettre en place les dispositions nécessaires. Les conséquences d’une explosion au sein d’une alvéole de stockage ont néanmoins été évaluées. Les résultats montrent que les colis de stockage ne seraient que faiblement endommagés, ce qui ne compromettrait pas le confinement des substances qu’ils contiennent.
QUESTION 661 - Comment s'assurer qu'il sera possible de sortir ces déchets dans 2000 ans
Posée par Franck R, L'organisme que vous représentez (option) (S), le 08/12/2013
Bonjour, - Je me demandais comment il était possible de s'assurer qu'il sera possible de sortir ces déchets stocké à 2000 m sous terre dans 2000 ans. Je me demande bien si ce processus est vraiment réversible. - Je me demandais combien coûtait le gardiennage d'un tel site de stockage pendant 2000 ans. Bien cordialement, Franck
Réponse du 09/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
Si Cigéo est autorisé, l’installation souterraine dans laquelle seront stockés les déchets radioactifs sera implantée à environ 500 mètres de profondeur dans la couche d’argile étudiée au moyen du Laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne. Cette profondeur permet de mettre les déchets à l’abri des activités humaines et des événements naturels de surface (comme l’érosion) et de les isoler sur de très longues échelles de temps.
Le but du stockage profond est de mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs pour ne pas reporter indéfiniment la charge de leur gestion sur les générations futures. Dans son avis sur les recherches menées dans le cadre de la loi de 1991, publié en 2006, l’Autorité de sûreté nucléaire considère que, sur le plan des principes, la réversibilité ne peut avoir qu’une durée limitée. Par ailleurs, elle ne considère pas que la possibilité de reprendre aisément les colis de déchets soit acquise sur une durée de plusieurs siècles.
Conformément à la demande du Parlement, l’Andra étudie un stockage qui soit réversible pendant au moins 100 ans, ce qui permet de laisser des portes ouvertes aux générations suivantes. L’Andra retient les meilleures techniques d’ingénierie disponibles pour offrir aux générations suivantes le maximum de flexibilité pour la gestion dans le temps de l’installation : épaisseur des ouvrages, colis résistants, surveillance… En fonction de l’expérience acquise lors de l’exploitation de Cigéo, les générations suivantes seront libres de décider du devenir de Cigéo, en particulier de son calendrier de fermeture et elles pourront périodiquement réévaluer la période de réversibilité. L’Andra propose que les décisions à prendre tout au long du processus de stockage réversible puissent être préparées par des rendez-vous réguliers avec l’ensemble des acteurs. Les conditions de réversibilité seront définies dans une future loi. Pour en savoir plus sur les propositions de l’Andra, vous pouvez consulter le document de synthèse sur le site du débat public : ../docs/rapport-etude/fiche-reversibilite-cigeo.pdf.
Après une centaine d’années d’exploitation, si les générations suivantes décident de fermer définitivement le stockage, la sûreté sera assurée de manière passive, sans nécessité d’action humaine, notamment une surveillance du site pendant 2 000 ans ou plus. Une surveillance du site pourra néanmoins être maintenue aussi longtemps que les générations futures le souhaiteront et contribuera au maintien de la mémoire du stockage.
QUESTION 660 - Développement économique
Posée par DAVID MICHAUT, L'organisme que vous représentez (option) (TRANNES), le 08/12/2013
Pourquoi faire croire en un développement économique autour de BURE ? Chacun sait que cette mono-industrie qu'est le nucléaire appelle le nucléaire et chasse toutes les autres. L'exemple de Soulaines est flagrant. Cela fait 20 années que les élus du canton de Soulaines réclament des projets structurants. On lit ça régulièrement dans l’Est-Eclair. Ils attendent encore. Ils ne peut pas y en avoir pour des raisons de sécurité. Je crois même que l'ASN fait des recommandations sur des périmètres interdits à des équipements qui regrouperaient trop de gens.
Réponse du 07/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Concernant le canton de Soulaines, l’Andra y exerce une activité industrielle depuis une vingtaine d’années. Les Centres industriels de l’Andra dans l’Aube participent activement à la vie économique du territoire (plus de 200 emplois, 7,4 millions d’euros de commandes aux entreprises locales et 8,9 millions d’euros de fiscalité locale en 2013). Les zones d'activités créées sur les communes de Chaumesnil et d'Epothemont accueillent aujourd'hui plusieurs entreprises de secteurs d'activité variés et qui génèrent plusieurs dizaines d'emplois. Le dynamisme du canton de Soulaines s’est traduit par l'évolution positive de la démographie contrairement à de nombreux autres cantons du département. Les activités existantes et les projets à venir (le diagnostic du territoire et la feuille de route à 10 ans de la Communauté de communes de Soulaines sont consultables sur son site internet) montrent que les activités de l'Andra ne sont pas opposées au développement d'autres activités sur le territoire, bien au contraire.
Concernant le périmètre que vous mentionnez, la réglementation en matière de maîtrise des activités autour des installations nucléaires ne concerne que celles nécessitant un plan particulier d’intervention (PPI), définies par le décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005. Ce plan est décidé par le préfet, autour des installations pouvant nécessiter des actions de protection des populations à mettre en œuvre pour limiter les conséquences d’un accident éventuel. Elle vise essentiellement à ne pas remettre en cause la faisabilité des actions de mise à l’abri et d’évacuation. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels de Cigéo montre que leurs conséquences resteraient limitées, et nettement en deçà du seuil réglementaire qui imposeraient des mesures de protection des populations (mise à l’abri, évacuation). Cigéo ne serait donc pas concerné par ces règles de maîtrise des activités.
Réponse apportée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) :
La maîtrise de l’urbanisation autour des INB, vise à limiter les conséquences d’un accident grave sur la population et les biens. De telles démarches sont ainsi mises en œuvre, depuis 1987, autour des installations industrielles non nucléaires et ont été renforcées depuis l’accident d’AZF (Toulouse) survenu en 2001. La loi relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (dite loi TSN désormais codifiée aux livres Ier et V du code de l’environnement) permet aux pouvoirs publics de maîtriser l’urbanisation autour des INB, par l’instauration de servitudes d’utilité publique limitant ou interdisant les nouvelles constructions à proximité de ces installations.
La démarche de maîtrise de l’urbanisation relève de responsabilités partagées entre l’exploitant, les maires et l’État :
– l’exploitant est responsable de ses activités et des risques associés ;
– le maire est responsable de l’élaboration des documents d’urbanisme et de la délivrance des permis de construire ;
– le préfet informe les maires des risques existants et exerce le contrôle de légalité sur les actes des communes ;
– l’ASN fournit les éléments techniques pour caractériser le risque et propose son appui au préfet pour l’accompagner dans la démarche de maîtrise de l’urbanisation.
La doctrine actuelle de l’ASN en matière de maîtrise des activités autour des installations nucléaires ne concerne que celles nécessitant un PPI et vise essentiellement à ne pas remettre en cause la faisabilité des actions de mise à l’abri et d’évacuation. Elle se concentre sur les zones dites « réflexes » des PPI, ou zones d’aléa à cinétique rapide, établies dans le cadre de la circulaire du 10 mars 2000 et dans lesquelles des actions automatiques de protection des populations sont mises en œuvre en cas d’accident à cinétique rapide.
Une circulaire du ministère en charge de l’environnement du 17 février 2010 a demandé aux préfets d’exercer une vigilance accrue sur le développement de l’urbanisation à proximité des installations nucléaires. Cette circulaire précise qu’il est nécessaire d’avoir la plus grande attention vis-à-vis des projets sensibles de par leur taille, leur destination ou des difficultés qu’ils occasionneraient en matière de protection des populations dans la zone dite réflexe. Cette circulaire confie à l’ASN et à la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) la mission d’animer un groupe de travail pluraliste pour définir les modalités de maîtrise des activités autour des installations nucléaires.
Ce groupe de travail, qui a associé les administrations, les élus, l’Association nationale des commissions et comités locaux d’information (ANCCLI) et les exploitants concernés, a proposé en 2011 un projet de guide relatif à la maîtrise des activités autour des INB, sur la base des principes suivants :
– préserver l’opérabilité des plans de secours ;
– privilégier un développement territorial au-delà de la zone d’aléa à cinétique rapide ;
– permettre un développement maîtrisé et répondant aux besoins de la population résidente.
Ce guide a fait l’objet d’une large consultation publique sur les sites Internet du ministère en charge de l’environnement et de l’ASN à la fin de l’année 2011. Depuis 2012, les travaux sont poursuivis avec le ministère en charge de l’environnement pour compléter le guide par les modalités d’institution de servitudes d’utilité publique visant à permettre une prise en compte des principes de maîtrise des activités dans les documents de planification de l’usage des sols.
QUESTION 659 - secret défense
Posée par Sylvie SAUVAGE, L'organisme que vous représentez (option) (TULLY), le 08/12/2013
Le journal Ouest-France, dans son article du 6 décembre 2013 , « Nucléaire : comment éviter un Fukushima français » souligne que l’entreposage dans le périmètre d’AREVA NC à la Hague est classé « secret défense ». En sera-t-il de même à Bure ?
Réponse du 27/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
S’il est autorisé, le Centre de stockage Cigéo sera une installation nucléaire de base (INB) au sens de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, comme le Centre de stockage de l’Aube et le Centre de stockage de la Manche. Cette installation nucléaire n’est pas classée secret défense. Les dispositions prises pour assurer la sécurité du site contre les actes de malveillance sont néanmoins classifiées afin que des personnes mal intentionnées n’y aient pas accès.
QUESTION 658 - Créer le vide autour de BURE
Posée par Benedicte ALINQUANT, L'organisme que vous représentez (option), le 07/12/2013
L'ASN est en train de préparer des règles très strictes quant à l'implantation d'activités économiques et de concentration de population autour des INB. Dans un rayon non encore précisé aucun regroupement de population ne sera possible. Normal, au cas il faudrait évacuer. Autour de BURE-SAUDRON il n'y aura donc place uniquement pour un désert vert, et des bâtiments d'archives bien pauvres en employés. Pourquoi ne dites vous pas la vérité aux élus et à la population ? Pourquoi ne dites vous pas que vous allez sacrifier une région au nom de l'intérêt national ?
Réponse du 06/02/2014,
Réponse apportée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) :
La maîtrise de l’urbanisation autour des INB, vise à limiter les conséquences d’un accident grave sur la population et les biens. De telles démarches sont ainsi mises en œuvre, depuis 1987, autour des installations industrielles non nucléaires et ont été renforcées depuis l’accident d’AZF (Toulouse) survenu en 2001. La loi relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (dite loi TSN désormais codifiée aux livres Ier et V du code de l’environnement) permet aux pouvoirs publics de maîtriser l’urbanisation autour des INB, par l’instauration de servitudes d’utilité publique limitant ou interdisant les nouvelles constructions à proximité de ces installations.
La démarche de maîtrise de l’urbanisation relève de responsabilités partagées entre l’exploitant, les maires et l’État :
- l’exploitant est responsable de ses activités et des risques associés ;
- le maire est responsable de l’élaboration des documents d’urbanisme et de la délivrance des permis de construire ;
- le préfet informe les maires des risques existants et exerce le contrôle de légalité sur les actes des communes ;
- l’ASN fournit les éléments techniques pour caractériser le risque et propose son appui au préfet pour l’accompagner dans la démarche de maîtrise de l’urbanisation.
La doctrine actuelle de l’ASN en matière de maîtrise des activités autour des installations nucléaires ne concerne que celles nécessitant un PPI et vise essentiellement à ne pas remettre en cause la faisabilité des actions de mise à l’abri et d’évacuation. Elle se concentre sur les zones dites « réflexes » des PPI, ou zones d’aléa à cinétique rapide, établies dans le cadre de la circulaire du 10 mars 2000 et dans lesquelles des actions automatiques de protection des populations sont mises en œuvre en cas d’accident à cinétique rapide.
Une circulaire du ministère en charge de l’environnement du 17 février 2010 a demandé aux préfets d’exercer une vigilance accrue sur le développement de l’urbanisation à proximité des installations nucléaires. Cette circulaire précise qu’il est nécessaire d’avoir la plus grande attention vis-à-vis des projets sensibles de par leur taille, leur destination ou des difficultés qu’ils occasionneraient en matière de protection des populations dans la zone dite réflexe. Cette circulaire confie à l’ASN et à la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) la mission d’animer un groupe de travail pluraliste pour définir les modalités de maîtrise des activités autour des installations nucléaires.
Ce groupe de travail, qui a associé les administrations, les élus, l’Association nationale des commissions et comités locaux d’information (ANCCLI) et les exploitants concernés, a proposé en 2011 un projet de guide relatif à la maîtrise des activités autour des INB, sur la base des principes suivants :
- préserver l’opérabilité des plans de secours ;
- privilégier un développement territorial au-delà de la zone d’aléa à cinétique rapide ;
- permettre un développement maîtrisé et répondant aux besoins de la population résidente.
Ce guide a fait l’objet d’une large consultation publique sur les sites Internet du ministère en charge de l’environnement et de l’ASN à la fin de l’année 2011. Depuis 2012, les travaux sont poursuivis avec le ministère en charge de l’environnement pour compléter le guide par les modalités d’institution de servitudes d’utilité publique visant à permettre une prise en compte des principes de maîtrise des activités dans les documents de planification de l’usage des sols.
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La réglementation en matière de maîtrise des activités autour des installations nucléaires ne concerne que celles nécessitant un plan particulier d’intervention (PPI), définies par le décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005. Ce plan est décidé par le préfet, autour des installations pouvant nécessiter des actions de protection des populations à mettre en œuvre pour limiter les conséquences d’un accident éventuel. Elle vise essentiellement à ne pas remettre en cause la faisabilité des actions de mise à l’abri et d’évacuation.
L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels montre que leurs conséquences resteraient limitées, et nettement en deçà du seuil réglementaire qui imposeraient des mesures de protection des populations (mise à l’abri, évacuation). Cigéo ne serait donc pas concerné par ces règles de maîtrise des activités.
QUESTION 657 - Comme les déchets ménagers
Posée par Yannig DERRIEN, CITOYEN (TRÉGUIER), le 07/12/2013
Comme les déchets ménagers Je suis breton. Je suis sensibilisé à la gestion des déchets. Qu'ils soient ménagers, agricoles, industriels, radioactifs... il y a d'autres solutions que l'enfouissement dans une décharge. Mais on ne travaille pas assez sérieusement sur les autres pistes. Prenons nos déchets ménagers. La première idée a été de les enfouir dans des décharges. Il en a fallu du temps pour arriver au tri et à la valorisation. Pourquoi n'applique t-on pas le même raisonnement pour les déchets nucléaires ? Il y a à l'évidence d'autres solutions que l'enfouissement à 500 m, avec tous les risques que cela représente. Si la transmutation telle que définie aujourd'hui n'est pas intéressante, cherchons autre chose. On parle de chauffer les radionucléides à très haute température ? Qu'en est-il ? Qui travaille sérieusement dans cette voie ?
Réponse du 11/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le procédé que vous mentionnez fait sans doute référence à des recherches menées sur les réactions de fusion nucléaire associées à l’obtention de hautes températures. Le principe de la fusion consiste à produire de l’énergie en fusionnant deux atomes légers pour former un noyau plus lourd. Les radionucléides à période longue contenus dans les déchets radioactifs, qui ne sont pas des atomes légers, ne se prêtent pas à une réaction de fusion. Aussi les recherches menées sur la transmutation de ces radionucléides (en l’occurrence les actinides) se fondent sur l’utilisation de neutrons rapides. Plusieurs sources sont envisageables pour générer des neutrons rapides : celles qui ont été étudiées à ce stade sont :
- des réacteurs de fission nucléaire à neutrons rapides,
- des systèmes hybrides associant un accélérateur de protons et un réacteur au sein duquel lequel les protons sont transformés en neutrons (par « spallation »).
QUESTION 656 - Les colis vitrifiés
Posée par Huguette MARÉCHAL, L'organisme que vous représentez (option) (DAINVILLE-BERTHELÉVILLE), le 07/12/2013
Le cahier d'acteur n°69, qui traite de la qualité du verre des colis vitrifiés est inquiétant. Qu'en est-il exactement? Quelle est la durée de vie réelle du verre et de ses qualités pour assurer la confinement? Le CEA annonce 10.000 ans et Gilbert TALLENT déclare, lui, moins d'un an. Qui a raison? Et pourquoi n'ouvre-t-on pas un des colis fabriqués, pour voir dans quel état est le verre aujourd'hui? Cela pourrait donner une idée de l'état dans lequel il sera plus tard.
Réponse du 10/02/2014,
Réponse apportée par le maître d’ouvrage :
Les colis de déchets vitrifiés sont prévus d’être placés dans des conteneurs de stockage en acier avant leur mise en stockage. Au fil du temps, ces conteneurs seront soumis d’une part à la corrosion au contact de l’eau contenue dans la roche et d’autre part à la pression exercée par le terrain. Leur dimensionnement leur permettra de rester étanches dans ce contexte pendant au moins plusieurs centaines d’années, empêchant tout relâchement de radionucléides pendant cette période. Au-delà de cette période, le verre prendra le relais pour retarder le relâchement des radionucléides. En effet ce verre a été conçu spécifiquement pour piéger l’ensemble des radionucléides dans sa structure. Le relâchement de radionucléides hors du verre ne peut se produire qu’au fur et à mesure de la dissolution progressive du verre dans l’eau. Il s’agit d’un mécanisme très lent, le verre étant par nature un matériau très peu soluble. La dissolution du verre et celle des radionucléides qu’il contient sera lente et étalée sur des durées de plusieurs dizaines à centaines de milliers d’années. Les études et recherches réalisées notamment par le CEA sur le relâchement des radionucléides par le verre prennent en compte son état initial (notamment sa fracturation provoquée par les contraintes mécaniques apparaissant lors du refroidissement du verre après sa coulée) et les mécanismes d’altération susceptibles d’intervenir au cours du temps. Elles s’appuient sur des expertises et des expérimentations réalisées sur des échantillons représentatifs du verre nucléaire. Les radionucléides relâchés progressivement par le verre seront ensuite retenus par la roche argileuse du Callovo-Oxfordien ; seuls des radionucléides mobiles et à vie longue, plus particulièrement l’iode 129 et le chlore 36, pourront traverser la couche d’argile du Callovo-Oxfordien sur une durée d’un million d’années. Cette migration s’effectuant majoritairement par diffusion dans une forte épaisseur d’argile, ces radionucléides parviendront aux limites de la couche argileuse de façon très étalée dans le temps et très atténuée. Les études ont montré que le stockage n’aura pas d’impact avant 100 000 ans et que celui-ci sera très inférieur à l’impact de la radioactivité naturelle.
Réponse apportée par le Commissariat l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) :
Le verre a été choisi comme matrice de confinement pour les déchets ultimes pour ses propriétés de confinement, c’est-à-dire son aptitude à les incorporer et à les immobiliser durablement. En effet, le verre a, de par sa structure chimique, la capacité d’intégrer une grande gamme de radioéléments au sein même de sa structure, et ce avec une très bonne homogénéité.
Par ailleurs, les études menées par le CEA ont montré une très bonne résistance de la matrice vitreuse à l’altération sur des temps très longs. Notamment, les études menées sur des verres radioactifs de laboratoires ont montré une très bonne résistance de la matrice vitreuse à l’auto-irradiation. Que ce soit sur des verres radioactifs réels ou sur des verres « dopés » en éléments radioactifs, intégrant en quelques années une auto irradiation équivalente à celle que subira un verre nucléaire réel pendant quelques milliers d’années, les études entreprises ne montrent pas d’évolution significative des propriétés macroscopiques des verres. Par ailleurs, les études menées en laboratoire à la fois sur des verres inactifs et radioactifs permettent d’identifier les mécanismes physico chimiques responsable de l’altération des verres dans des conditions représentatives de celles d’un stockage géologique profond. Ces expériences accélérées, couplées avec des études d’analogues naturels ou archéologiques (roches volcaniques, verres antiques,…) permettent d’établir et de qualifier les modèles d’évolution des colis sur le long terme.
L’ouverture d’un colis récemment conditionné, qui constituerait une opération complexe sur le plan industriel, n’apporterait pas d’élément supplémentaire quant à son comportement sur le long terme en conditions de stockage.
QUESTION 655 - les colis rebus
Posée par raymond CHAUSSIN, L'organisme que vous représentez (option) (CAEN), le 07/12/2013
Selon les dires de Bertrand THUILLIER il y aurait un certain nombre de colis non ou mal identifiés. Certains présentent des points de corrosion perforante et des soudures défectueuses sur leurs couvercles ! D'autres qui dégagent trop d'hydrogène. Qu'allez vous en faire ? Les entreposer de façon pérenne en surface ? Dans ce cas cela signifierait qu'un entreposage en surface est possible !
Réponse du 09/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’ensemble des déchets qui pourraient être stockés dans Cigéo est identifié et décrit de manière détaillé – voir ../docs/rapport-etude/dechets-pris-en-compte-dans-etudes-conception-cigeo.pdf
Les colis reçus sur Cigéo devront respecter les critères d’acceptation définis par l’Andra. Avant expédition des colis, l’Andra s’assurera du respect de ces critères, au moyen de contrôles réalisés par les producteurs aux différentes étapes de production, d’entreposage, et de désentreposage des colis, et au moyen d’une surveillance exercée par l’Andra chez les producteurs. Ces mesures doivent permettre d’apporter le maximum de garanties sur la conformité des colis avant leur expédition vers Cigéo. L’Andra effectuera par précaution de nouveaux contrôles à la réception des colis, à titre de vérification et de traçabilité. Si ces contrôles venaient à montrer que le colis ne respecte pas les exigences de sûreté de Cigéo, le colis serait réexpédié à son producteur.
QUESTION 654 - le dimensionnement de l'entreposage
Posée par raymond CHAUSSIN, L'organisme que vous représentez (option) (CAEN), le 07/12/2013
Il y a un problème avec le dimensionnement de l’entreposage. A lire les dossiers de la CNE, il n’y aurait en surface à BURE, qu’un micro-entreposage tampon (ordre de grandeur correspondant à un flux de 5 à 6 colis/jour). Or dans les dossiers Argile il a été dit qu’ « au lieu de certaines extensions futures sur les sites de production et de conditionnement, une réalisation de capacités d’entreposage sur le centre de stockage pourra constituer une opportunité qui mérite d’être examinée ». Et celle-ci a bien été examinée, car on peut lire par ailleurs : que « l’implantation des nouvelles installations d’entreposage devra privilégier entre autres le site du futur centre de stockage » - que « certains besoins au-delà de 2025 pourraient être assurés par des capacités d’entreposage intégrées au centre de stockage, au lieu de la création ou de l’extension d’installation sur les sites de production ou de conditionnement » - que ces installations « permettraient d’accroître la flexibilité de gestion d’ensemble des colis », ayant pour corollaire évidemment « d’anticiper les transports entre le site de la Hague et le centre de stockage », - que « la mise en surconteneur ne sera plus effectuée à la Hague, mais sur le site de stockage », - qu’il a déjà été décidé de considérer l’entreposage des 36 040 colis HA vitrifiés (C1, C2, C0.2, et C0.3) en modules de 3 600 à 10 800 colis !!! Inquiétant pour les riverains, non ? Bien évidemment cela n'est pas écrit dans le Dossier du maître d'ouvrage, mais ces projets ne pourraient-ils pas réapparaître très vite dans les objectifs dés que le CIGéo sera lancé ?
Réponse du 10/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Si l’étude prospective de capacités d’entreposage plus importantes sur le site de Cigéo avait effectivement été proposée en 2009, cette option n’a plus été considérée ensuite après les échanges qui se sont tenus avec les parties prenantes du projet Cigéo. Les études et recherches sur l’entreposage menées dans le cadre de la loi du 28 juin 2006 sont ainsi orientées vers des installations futures qui seront implantées sur des sites d’Areva, du CEA et d’EDF, comme indiqué dans la conclusion du bilan des études et recherches sur l’entreposage réalisé par l’Andra en 2012 (../docs/decisions/Rapport-2012-Andra-entreposage.pdf).
Dans l’hypothèse où Cigéo serait autorisé, les bâtiments de surface du Centre auront pour unique fonction l’accueil, la réception, le contrôle et la préparation des colis avant leur transfert vers l’installation souterraine. Les capacités de ces bâtiments seront limitées pour répondre à ces besoins et n’auront pas vocation à se substituer aux entreposages présents sur les sites des producteurs de déchets.
QUESTION 653 - scellement
Posée par raymond CHAUSSIN, L'organisme que vous représentez (option) (CAEN), le 07/12/2013
Scellement : La notion de scellement est évolutive. La CNE faisait même un distingo entre un scellement provisoire et le scellement définitif juste avant la fermeture du stockage. Décision de fermeture qui ferait même l'objet d'une loi. Dans un siècle, y aura t-il encore la notion de lois dans ce qui sera peut-être devenu l'Europe ? Ce distingo a disparu du Dossier du maître d’ouvrage. Il n’est peut-être plus à l’ordre du jour. Mais méfions-nous, l’ANDRA sait très bien mentir par omission. Bref, que sait-on de la durée de fermeture d’une alvéole en vue du scellement provisoire ou définitif ? Si cette durée est supérieure à la durée d’accumulation d’hydrogène, soit 4%, on risque l’explosion ! La CNE a bien expliqué que nous avons un siècle devant nous pour trouver une solution fiable au scellement. Mais si on ne trouvait pas de solution fiable et budgétairement acceptable, est-il raisonnable d’enfouir, puisqu'on ne pourrait pas, par conséquent, fermer le stockage ?
Réponse du 28/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La loi du 28 juin 2006 stipule que seule une loi peut autoriser la fermeture définitive du centre de stockage. Cette fermeture définitive, qui devrait intervenir au bout d’une durée de l’ordre d’une centaine d’années d’exploitation, consiste principalement à sceller les puits et descenderies d’accès à l’installation souterraine. Auparavant, l’exploitation de Cigéo comprendra plusieurs étapes intermédiaires de fermeture partielle : fermeture des alvéoles de stockage, puis fermeture de leurs galeries d’accès. Chaque étape de fermeture devra faire l’objet d’une autorisation spécifique. Ces éléments sont présentés dans le dossier du maître d’ouvrage (p78-79).
Conformément à la demande des évaluateurs, l’Andra met en œuvre un programme d’études et d’essais pour apporter les éléments nécessaires à la démonstration de la faisabilité industrielle des scellements dès la demande d’autorisation de création du stockage. Dans ce cadre, des dispositions spécifiques sont étudiées (mise en place d’un sas de protection, inertage…) pour exclure tout risque d’explosion lors des opérations de fermeture des alvéoles de stockage pour les déchets de moyenne activité à vie longue, dont certains dégagent de l’hydrogène gazeux en faibles quantités.
QUESTION 652 - Confiance durant le remplissage
Posée par Malfay-Regnier CHRISTINE , L'organisme que vous représentez (option) (VALENCE), le 07/12/2013
J'ai des doutes sur la ventilation et la filtration. Les galeries envisagées me font penser à des stations de métro. Les dimensions et les quantités d'air ventilées sont colossales. Imaginer la présence d'hydrogène dans le métro ! Imaginez que la ventilation tombe en panne. Panne d'électricité. Groupes électrogènes noyés. cela ne vous rappelle rien ? Déclarer qu'on maîtrise tous les paramètres est un mensonge. Comment pouvez-vous être sûrs de vos calculs, de vos techniques, du matériel, de vos hommes ?
Réponse du 20/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la présence d’hydrogène a bien été étudiée et des mesures adaptées ont été élaborées.
Certains déchets MA-VL, notamment ceux contenant des composés organiques, dégagent de l'hydrogène non radioactif produit par radiolyse : les ¾ des colis de déchets MA-VL destinés à Cigéo dégagent peu d’hydrogène (moins de 3 litres par an et par colis), voire pas du tout. Au-delà d’une certaine quantité et en présence d’oxygène, cet hydrogène peut présenter un risque d’explosion.
Pour maîtriser ce risque pendant l’exploitation de Cigéo, l’Andra fixe une limite stricte aux quantités d’hydrogène émises par chaque colis. Des contrôles seront mis en place et aucun colis ne sera accepté s’il ne respecte pas cette limite. Pour éviter l’accumulation de ce gaz, les installations souterraines et de surface seront ventilées en permanence pendant leur exploitation, comme le sont les installations d’entreposage dans lesquelles se trouvent actuellement ces déchets. Les modélisations d’aéraulique montrent que la ventilation prévue par la conception de Cigéo permet d’éviter toute zone de concentration d’hydrogène au sein des alvéoles de stockage.
Le système de ventilation du stockage fait par ailleurs l’objet de dispositions pour réduire le risque de panne (redondance des équipements, maintenance..) et des dispositifs de surveillance seront mis en place pour détecter toute anomalie sur son fonctionnement, notamment la présence d’hydrogène dans l’air à de très faibles concentrations... Des situations de perte de la ventilation sont étudiées malgré tout. Les études montrent que, dans le pire des cas, on disposera de plus d’une dizaine de jours pour rétablir la ventilation, ce qui permettra de mettre en place une ventilation de secours. Les conséquences d’une explosion sont tout de même évaluées afin d’envisager tous les scénarios possibles : les résultats montrent que les colis concernés ne seraient que faiblement endommagés, sans aucune perte de confinement des substances qu’ils contiennent.
QUESTION 651 - Comment faire confiance ?
Posée par François SIMON, L'organisme que vous représentez (option) (MONT SAINT AIGNAN), le 07/12/2013
Pour moi le HCTISN était un organisme chargé de communication, d'information par rapport à la transparence des activités de l'industrie nucléaire, donc aussi biens les arguments POUR que les arguments CONTRE. Pourquoi se permet-il de jouer un rôle essentiellement dans la promotion du nucléaire et pour le choix de l'enfouissement des déchets ? Aussi bien à SOULAINES qu'à BURE ! La CRIIRAD en qui j'ai toute confiance a même dénoncé que le HCTISN était carrément pro-nucléaire. Comment faire confiance ?
Réponse du 15/01/2014,
Réponse apportée par le Haut comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire (HCTISN) :
Le HCTISN est une instance d'information, de concertation et de débat sur les activités nucléaires, leur sûreté, leur contrôle, leur impact sur la santé et l’environnement, et leur transparence. Il peut être saisi notamment par le Gouvernement ou le Parlement pour établir des rapports objectifs faisant la lumière sur tout sujet relatif à la sécurité nucléaire. Il est composé de 40 membres, répartis en sept collèges, dont un collège des commissions locales d'information, un collège des organisations syndicales de salariés, et un collège des associations de protection de l'environnement, dans lequel de grandes associations nationales telles que France Nature Environnement ou Greenpeace sont représentées. Cette composition pluraliste assure une expression et une prise en compte de l'ensemble des points de vue, ainsi que la neutralité et le caractère factuel des rapports établis par le HCTISN, tel que le rapport préalable au débat public sur le projet Cigéo (http://www.hctisn.fr/IMG/pdf/Rapport_GT_Cigeo_vf_cle8a687d.pdf). Le HCTISN ne joue aucun rôle dans la promotion du nucléaire.
QUESTION 650 - OPECST
Posée par Hélène PARIZET, L'organisme que vous représentez (option) (LA POSSESSION), le 07/12/2013
Avec internet et Google j'ai recherché quelques informations sur l'OPECST. Il y aurait de quoi rédiger un cahier d'acteurs. Comment faire confiance à une telle entité ? Cela ne représente que l'avis de 18 députés et 18 sénateurs, mais leurs évaluations, leurs choix sont toujours orientés et très influencés par les lobbyes. Et il n'y a pas que dans le nucléaire, c'est la même chose avec le gaz de schiste ! Pour décider CIGéo, pourquoi c'est l'OPECST qui va rédiger le dossier final pour le Premier ministre ? Pourquoi ce n'est pas une loi débattue et votée au parlement qui décidera deconstruire ou pas CIGéo ?
Réponse du 15/01/2014,
Réponse apportée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Le Parlement fixe périodiquement les choix relatifs à la mise en œuvre de ce projet :
- loi du 30 décembre 1991, dite loi « Bataille », fixant un programme d’études et recherches de 15 années d’études et recherches sur les déchets radioactifs ;
- loi du 28 juin 2006, définissant le stockage géologique profond réversible comme solution de référence pour les déchets les plus radioactifs et demandant sa mise en service en 2025 ;
- loi à venir sur la réversibilité du projet.
Conformément à l’article L.542-10 du code de l’environnement, l’OPESCT est chargé d’évaluer la demande d’autorisation de création de CIGEO déposée par l’ANDRA et de rendre compte de ses travaux aux commissions compétentes de l’Assemblée Nationale et du Sénat.
La décision d’autoriser ou non la création de Cigéo en Meuse/Haute-Marne n’est pas encore prise. Elle reviendra à l’Etat après l’évaluation du dossier remis par l’Andra en 2015 par l'Autorité de sûreté nucléaire, la Commission nationale d'évaluation et l’OPESCT, l’avis des collectivités territoriales, le vote d’une nouvelle loi fixant les conditions de réversibilité et une enquête publique.
QUESTION 649 - et la démocratie?
Posée par philippe PORTÉ, L'organisme que vous représentez (option) (CHÂLONS EN CHAMPAGNE), le 07/12/2013
Pourquoi c'est pas le Parlement ? Incroyable ! Je viens de comprendre que le projet CIGéo ne sera même pas débattu et voté au Parlement ! Les députés passent des heures à discuter du mariage pour tous, du prix des amendes pour les client des prostituées, et rien sur un projet comme CIGéo ? Comment expliquer ça ? C'est un déni de démocratie pour un projet national, ce n'est pas un projet local!
Réponse du 15/01/2014,
Réponse apportée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
La loi du 28 juin 2006 a fait le choix du stockage réversible profond pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations futures. Elle demande à l’Andra d’étudier et d’implanter un Centre de stockage réversible profond de déchets radioactifs (Cigéo) en indiquant que « la demande d'autorisation de création [d’un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs] doit concerner une couche géologique ayant fait l'objet d'études au moyen d'un laboratoire souterrain ». L’Andra poursuit donc ses études en vue d’élaborer pour 2015 le dossier support à l’instruction de la demande d’autorisation de création de Cigéo en Meuse/Haute-Marne.
La décision d’autoriser ou non la création de Cigéo en Meuse/Haute-Marne n’est donc pas encore prise. Elle reviendra à l’Etat après l’évaluation du dossier remis par l’Andra en 2015 par l'Autorité de sûreté nucléaire et la Commission nationale d'évaluation, l’avis des collectivités territoriales, le vote d’une nouvelle loi fixant les conditions de réversibilité et une enquête publique.
Le Parlement fixe périodiquement les choix relatifs à la mise en œuvre de ce projet :
- loi du 30 décembre 1991, dite loi « Bataille », fixant un programme d’études et recherches de 15 années d’études et recherches sur les déchets radioactifs ;
- loi du 28 juin 2006, définissant le stockage géologique profond réversible comme solution de référence pour les déchets les plus radioactifs et demandant sa mise en service en 2025 ;
- loi à venir sur la réversibilité du projet.
En outre, l’Etat est en contact permanent avec les parties prenantes locales. Un important travail de concertation a été mené, notamment avec les exécutifs locaux, pour élaborer un projet de schéma interdépartemental du territoire.
QUESTION 648 - Il faut transformer ces déchets
Posée par Jean-Pierre YVERT, L'organisme que vous représentez (option) (GÄRDE 27 78530 GAGNEF SUÈDE), le 07/12/2013
Je réside actuellement en Suède. Je m'intéresse à ce problème des déchets. Je suis sûr qu'il ne faut pas les enfouir mais les transformer. Il y a des solutions qu'on nous cache peut-être, parce qu'elles seraient longues à finaliser et onéreuses. Par exemple, on n'entend presque pas parler des Z machines : http://fr.wikipedia.org/wiki/Z_machine Elles permettent d'obtenir des très hautes températures, et donc de transformer les atomes des matières radioactives en atomes élémentaires. On parle de l'hélium. Pourquoi pas ? Il faut faire confiance en la science et non en la géologie qu'on ne maîtrise pas. Pourquoi aucune recherche sur ce type de transformation n'est faite et même pas envisagée ?
Réponse du 10/02/2014,
Réponse apportée pour l’Andra, maître d’ouvrage :
Le procédé que vous mentionnez fait sans doute référence à des recherches menées sur les réactions de fusion nucléaire associées à l’obtention de hautes températures. Le principe de la fusion consiste à produire de l’énergie en fusionnant deux atomes légers pour former un noyau plus lourd. Les radionucléides à période longue contenus dans les déchets radioactifs, qui ne sont pas des atomes légers, ne se prêtent pas à une réaction de fusion. Aussi les recherches menées sur la transmutation de radionucléides lourds (en l’occurrence les actinides) se fondent sur l’utilisation de neutrons rapides (plusieurs sources sont envisageables pour générer ces neutrons rapides) celles qui ont été étudiées à ce stade sont :
- des réacteurs de fission nucléaire à neutrons rapides,
- des systèmes hybrides associant un accélérateur de protons et un réacteur au sein duquel lequel les protons sont transformés en neutrons (par « spallation »).
L’un des arguments mis en avant par les partisans des réacteurs de fusion de type Z-machine pour la production future d’énergie nucléaire est l’absence de formation de déchets radioactifs. Nous ne disposons pas d’éléments pour confirmer ou infirmer cette information. En tout état de cause Cigéo est conçu pour gérer les déchets existants et ceux restant à produire par le parc électronucléaire actuel, et non ceux que produiront, le cas échéant, de futurs parcs.
QUESTION 647 - impact local
Posée par daniel DROUOT, PARTI DE GAUCHE (LANGRES), le 07/12/2013
Quelles sont les menaces réelles pour l'économie régionale? Quel impact sur l'image des productions agricoles intensives? Quel impact sur l'image des productions bio? Quel impact sur l'image du champagne tout proche, et dont la région porte le nom? Quel impact sur les fromages langres, brie etc fabriqués avec le lait des vaches qui vont brouter l'herbe au dessus et autour du stockage? Quel impact sur les eaux de vittel et contrexéville? Quel impact sur le tourisme vert et le grand parc? Quel impact sur l'immobilier? merci à vous
Réponse du 08/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage:
Cigéo est conçu pour protéger l’Homme et l’environnement. L’impact du centre en termes de radioactivité sera très inférieur à celui de la radioactivité naturelle et n’aura donc aucun impact sur la qualité des productions agricoles. L’Andra a créé l’Observatoire pérenne de l’environnement, qui a pour mission d’assurer un suivi détaillé de l’évolution de l’environnement du stockage. Cela permettra de lever ainsi toute inquiétude en démontrant que le stockage n’a pas d’impact sur les activités agricoles de proximité. Cet observatoire labellisé s’inscrit dans un grand nombre de réseaux scientifiques nationaux ou internationaux. Par ailleurs, le retour d’expérience de la présence de l’Andra dans l’Aube depuis 20 ans montre que l’implantation d’un centre de stockage de déchets radioactifs n’est en aucun cas incompatible, même en termes d’image, avec des activités agricoles de premier choix (lait, viande, légumes, viticulture...). L'industrie et l’agriculture ont toujours coexisté et de nombreuses installations industrielles y compris nucléaires sont installées en France à proximité de zones de production agricoles dont des zones géographiques protégées ou encore des zones d'appellation contrôlée.
QUESTION 646 - Le rôle de l'IRSN
Posée par bern BONDIS, L'organisme que vous représentez (option) (MIREPOIX), le 07/12/2013
L'IRSN fait de la recherche fondamentale et étudie tous les sujets techniques qui concernent l'enfouissement. Cela lui permet de savoir et de comprendre. Elle échange probablement beaucoup avec l'ANDRA et cela me paraît normal. Mais alors, comment peut-elle moralement et légalement évaluer les travaux de l'ANDRA, en toute indépendance ? Comment peut-elle émettre un Avis officiel crédible dans le processus décisionnel ?
Réponse du 15/01/2014,
Réponse apportée par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) :
L’IRSN a pour missions de développer la recherche sur les risques nucléaires et radiologiques, d’évaluer la manière dont ces risques sont pris en compte, de fournir un appui scientifique et technique aux pouvoirs publics et autorités, d’informer et de faciliter la vigilance de la société par la diffusion publique d’information.
Pour mener à bien ses missions, l’IRSN échange avec l’ensemble des acteurs de la gouvernance du risque nucléaire : les industriels du nucléaire, les autres utilisateurs de substances radioactives ou rayonnement ionisants, les autorités et ministères, les autres parties prenantes (société civile, commissions locales d’information…).
Dans ce contexte, l’Institut veille à préserver son indépendance de jugement et d’action pour la réalisation de ses évaluations et les choix des recherches prioritaires à mener dans l’objectif de faire avancer la sûreté nucléaire et la radioprotection. A cet égard, afin d’établir un cadre pour la résolution d’éventuels conflits d’intérêt dans ses activités, l’IRSN s’est doté d’une « Charte d’éthique et de déontologie » qui fixe les principes d’éthique et énonce les règles de déontologie que l’Institut s’impose dans l’exercice de ses missions. Cette charte a été mise en place par un Comité d’éthique et de déontologie, qui veille également à son application. Ces principes et règles satisfont en outre aux exigences de la Charte de l’environnement en matière de droit à l’information et à la participation. Sur ce point, il faut noter que l’IRSN développe une politique d’ouverture qui vise à faciliter l’accès à l’expertise et la montée en compétence des acteurs non institutionnels. L’IRSN coopère ainsi avec les Commissions locales d’information et l’Association nationale des comités et commissions locales d’information afin de construire et faciliter un tel accès à l’expertise. Au travers de cette démarche d’ouverture, l’Institut s’engage ainsi concrètement dans le partage des connaissances, qui est l’un des principes de sa charte.
Dans le domaine des déchets radioactifs, le rôle principal de l’IRSN est d’évaluer la sûreté des filières de gestion en s’appuyant sur des travaux de recherche qu’il effectue lui-même ou dans le cadre de partenariats nationaux et internationaux.
Pour l’IRSN, ces travaux de recherche constituent un élément essentiel pour maintenir sa compétence et la pertinence de ses expertises. Ils constituent également un levier pour renforcer l’indépendance de l’Institut : grâce à ses moyens propres de recherche, l’IRSN a en effet la capacité d’initier et de développer par lui-même des travaux de recherche sur les questions qui lui apparaissent importantes. Pour l’étude des stockages géologiques, il dispose en particulier de la station expérimentale souterraine de Tournemire, qui lui permet de mettre en œuvre des travaux dans un milieu géologique proche de celui étudié pour le projet Cigéo, indépendamment des moyens expérimentaux qui sont développés par l’Andra. Dans ce contexte, les relations partenariales nouées par l’IRSN sont un moyen de stimuler la vitalité des recherches et d’étendre le périmètre des questions scientifiques abordées par ses équipes. Pour éviter que les coopérations ne puissent constituer un obstacle à son indépendance de jugement, l’Institut s’assure, par des clauses appropriées dans les accords qu’il établit, que la nature des collaborations engagées ne compromet pas sa liberté de communiquer et d’utiliser, notamment à des fins d’expertise, les résultats des travaux partenariaux. Il est ainsi à noter que dans le domaine du stockage géologique, l’Institut a émis ou été associé à plus de 260 publications depuis l’initiation par la loi de 1991 des recherches sur la gestion des déchets de haute activité à vie longue. Cette politique de publication constitue un gage supplémentaire de crédibilité des connaissances acquises puisqu’elle permet aux scientifiques de toute appartenance d’apprécier la qualité des recherches effectuées ainsi que l’absence de biais dans leur réalisation
Enfin, s’agissant de l’expertise de sûreté associée au projet Cigéo, les échanges techniques entre l’Andra et l’IRSN découlent du processus réglementaire défini et mis en œuvre par les pouvoirs publics. Tout projet d’installation nucléaire fait l’objet d’une démonstration, établie par et sous la responsabilité de l’exploitant (pour Cigeo, l’Andra) de la maîtrise des risques. L’évaluation de cette démonstration est effectuée par l’IRSN, pour le compte de l’Autorité de sûreté. Cette évaluation est l’occasion d’un dialogue technique qui est destiné à compléter la compréhension du dossier par l’évaluateur, sur la base de questions écrites et de réunions techniques. Cet échange est réalisé selon un processus certifié, auditable et conforme aux exigences de la norme NF-X50-110 « qualité en expertise » qui vise notamment à écarter tout conflit d’intérêt entre l’évaluateur et l’organisme. Depuis 2006, l’IRSN a en outre publié l’ensemble des expertises qu’il a réalisées sur le projet Cigéo.
Pour aller plus loin :
QUESTION 645 - Surtout ne pas enfouir
Posée par Catherine FOUTOYET, L'organisme que vous représentez (option) (SOISSY SUR SEINE), le 07/12/2013
Il faut attendre et ne pas enfouir. Il y a d'autres solutions. Je ne suis pas scientifique, mais je m'intéresse un peu à l'histoire de la Terre. D'où on vient et où on va. L'avis n° 132 donne à réfléchir. Cette idée de casser les atomes pour les ramener à de l'hélium basique me paraît géniale. Au risque de faire hurler les scientifiques, c'est un peu la nucléosynthèse à l'envers. - http://www.astronomes.com/le-big-bang/nucleosynthese-primordiale/ - Pourquoi les scientifiques du monde entier ne travaillent-ils pas sur ce dossier ? Pourquoi l'AIEA, grand promoteur de l'énergie nucléaire n'organise t-elle pas ces travaux ?
Réponse du 10/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le procédé que vous mentionnez fait sans doute référence à des recherches menées sur les réactions de fusion nucléaire associées à l’obtention de hautes températures. Le principe de la fusion consiste à produire de l’énergie en fusionnant deux atomes légers pour former un noyau plus lourd. Les radionucléides à période longue contenus dans les déchets radioactifs, qui ne sont pas des atomes légers, ne se prêtent pas à une réaction de fusion. Aussi les recherches menées sur la transmutation de ces radionucléides (en l’occurrence les actinides) se fondent sur l’utilisation de neutrons rapides. Plusieurs sources sont envisageables pour générer des neutrons rapides : celles qui ont été étudiées à ce stade sont :
- des réacteurs de fission nucléaire à neutrons rapides,
- des systèmes hybrides associant un accélérateur de protons et un réacteur au sein duquel lequel les protons sont transformés en neutrons (par « spallation »).
QUESTION 644 - Effet fracturation gaz de schiste
Posée par Pascal PAQUIN, L'organisme que vous représentez (option) (FLEURY- LA- VALLÉE), le 07/12/2013
Après scellement des alvéoles, la pression augmentant à l’intérieur de l’alvéole, ne doit-on pas craindre un effet “gaz de schiste radioactifs” ? Les gaz ne vont-ils pas s’infiltrer dans les moindres failles, fractures, micro fractures, fissures, micro fissures de l’argilite environnante ? Notamment celles de l’EDZ ? La fracturation hydraulique est interdite en France. Pourquoi l’ANDRA serait-elle autorisée, surtout avec une telle technologie !
Réponse du 28/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Après la fermeture du stockage, de l’hydrogène sera produit au sein du stockage principalement par la corrosion des éléments métalliques. En l’absence d’oxygène, ce processus de corrosion est très lent. L’hydrogène sera évacué très progressivement, d’une part par dissolution dans l’eau présente dans l’argilite, d’autre part par les galeries remblayées dont la perméabilité est plus élevée que le massif argileux.
Les essais menés au Laboratoire souterrain indiquent qu’il faut des pressions élevées, à minima de 12 MPa (120 bars ou l’équivalent de la pression d’une colonne d’eau de 1200 m), pour entraîner une fracturation des argilites. L’Andra étudie la conception du stockage pour que les pressions d'eau et de gaz maximales à long terme restent inférieures à cette valeur.
QUESTION 643 - Une autre solution
Posée par Christian PICQUE, AUCUN (SAINT SERNIN DU PLAIN), le 07/12/2013
L'avis 132 publié sur votre site m'a interpellé. J'ai lu qu'en chauffant les déchets nucléaires à très haute température de 150 millions ou un milliard de degrés, je ne sais pas, c'est très compliqué, on pourrait transformer tous les radionucléides en helium stable. C'est complètement génial, non ? Pourquoi ne travaille t-on pas sur cette idée ?
Réponse du 06/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le procédé que vous mentionnez fait sans doute référence à des recherches menées sur les réactions de fusion nucléaire associées à l’obtention de hautes températures. Le principe de la fusion consiste à produire de l’énergie en fusionnant deux atomes légers pour former un noyau plus lourd. Les radionucléides à période longue contenus dans les déchets radioactifs, qui ne sont pas des atomes légers, ne se prêtent pas à une réaction de fusion. Aussi les recherches menées sur la transmutation de ces radionucléides (en l’occurrence les actinides) se fondent sur l’utilisation de neutrons rapides. Plusieurs sources sont envisageables pour générer des neutrons rapides : celles qui ont été étudiées à ce stade sont (i) des réacteurs de fission nucléaire à neutrons rapides, (ii) des systèmes hybrides associant un accélérateur de protons et un réacteur au sein duquel lequel les protons sont transformés en neutrons (par « spallation »).
QUESTION 642 - Le rapport de l'IERR
Posée par Hubert LERAY, L'organisme que vous représentez (option) (LIMOGES), le 07/12/2013
Le rapport de l'IERR n'a pas été vraiment pris en compte. Il dénonçait quantités de problèmes. Il jugeait notamment les conclusions des travaux et expériences de l'ANDRA beaucoup trop optimistes. Pourquoi ne pas prendre le temps d'étudier correctement tout cela ? Pourquoi cette précipitation ?
QUESTION 641 - Un siècle !
Posée par Amélie CECCON, L'organisme que vous représentez (option) (MEYLAN), le 07/12/2013
Existe t-il un exemple de construction industrielle qui se soit étalée durant plus d'un siècle ? En dehors de nos cathédrales ! Que pensera le chef de chantier de Bouygues en descendant dans le stockage ? Dans quel état seront les toutes premières galeries construites, un siècle plus tard, avant scellement et fermeture ?
Réponse du 08/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le réseau du métro de Paris est un exemple de construction industrielle dont la réalisation s’étale sur plus d’un siècle. Les entreprises de génie civil savent garantir des structures en béton pendant plus de 100 ans (par exemple 120 ans pour le tunnel sous la Manche). Pour les tunnels de Cigéo, les types de béton et leur épaisseur sont définis pour résister aux contraintes mécaniques exercées par la couche d’argile pendant toute l’exploitation du Centre. Des marges sont intégrées dans leur dimensionnement. Ils seront équipés de capteurs qui permettront de suivre leur comportement dans le temps et de s’assurer de la durabilité des toutes premières galeries construites. Dans le cadre de ses propositions sur la réversibilité, l’Andra propose d’organiser des rendez-vous réguliers avec l’ensemble des acteurs (riverains, collectivités, évaluateurs, Etat…) pour contrôler le déroulement du stockage. Ces rendez-vous seront notamment alimentés par les résultats des réexamens périodiques de sûreté, conduits au moins tous les 10 ans par l’Autorité de sûreté nucléaire, par le retour d’expérience de l’exploitation du stockage et de sa surveillance, ainsi que par les progrès scientifiques et technologiques.
QUESTION 640 - co-activité
Posée par Henri PIDOUX, L'organisme que vous représentez (option) (TOULON), le 07/12/2013
Je n'arrive pas à comprendre comment la co-activité est possible ? Comment creuser des galeries et en même temps en remplir avec des colis extrêmement lourds et dangereux ? C'est comme si on pratiquait des opérations chirurgicales dans un hôpital en construction. Est-ce que Monsieur Boissier, le directeur de la maîtrise des risques de l’Andra enfilerait la blouse du chirurgien ?
Réponse du 10/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les activités de chantier et les activités nucléaires seront séparées sur les installations de Cigéo, et seront donc exploitées comme deux entités indépendantes. Pour cela :
- dans l’installation souterraine, la zone d’exploitation et la zone chantier seront physiquement séparées,
- l’accès aux différentes zones se fera par des accès distincts : par la descenderie pour la zone en exploitation, par les puits verticaux pour la zone chantier,
- chaque zone aura un circuit de ventilation dédié.

QUESTION 639 - Faire confiance aux géologues ?
Posée par Catherine GAUER, L'organisme que vous représentez (option) (NANTES), le 07/12/2013
Pourquoi faire confiance à la géologie, plutôt qu'aux "hommes" ? la géologie n'est que la science des géologues. Et seul un petit groupe de géologues est pour l'enfouissement. Qui sont donc ces géologues enfouisseurs ? Qui connait leurs noms ? On parle de consensus international ! C'est quoi ? ça prend quelle forme? C'est publié où? On n'en trouve pas trace sur internet... Je suis certaine qu'il y a plus de scientifiques opposés à CIGéo que de scientifiques favorables à Cigéo. Ce serait logique. Il faut organiser un véritable débat sous forme de colloque avec tous les scientifiques (pas seulement les géologues) qui ont un avis sur le sujet et confronter les idées. Qui l'organisera?
Réponse du 10/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le stockage est aujourd’hui considéré dans tous les pays comme la seule solution pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter leur charge sur les générations suivantes. Aux Etats-Unis, le WIPP (Waste Isolation Pilot Plant) stocke depuis une dizaine d’années, à environ 700 m de profondeur dans une formation géologique de sel, des déchets de moyenne activité à vie longue issus des activités de défense américaines. En Finlande et en Suède, les demandes d’autorisation de création de centres de stockage dans le granite pour les combustibles usés sont en cours d’instruction. De nombreux autres pays mènent également des recherches en vue de la mise en œuvre d’un stockage profond (Allemagne, Belgique, Canada, Chine, Japon, Royaume-Uni, Suisse…).
En France, le débat public de 2005/2006 s’était conclu sur la question : faut-il faire confiance à la géologie ou à la société ? La conviction de l’Andra est qu’il faut faire confiance à la géologie ET à la société : c’est notre définition du stockage réversible. La géologie permet de protéger l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs à l’échelle du million d’années. La réversibilité permet à la société de contrôler le déroulement du stockage.
L’ensemble des travaux de recherche liés au stockage font l’objet de publications dans des revues à comités de lecture (50 à 70 publications scientifiques internationales par an depuis 10 ans). Les études et recherches sont évaluées par des instances indépendantes, en particulier la Commission nationale d’évaluation, mise en place par le Parlement, et l’Autorité de sûreté nucléaire dont les avis sont consultables sur le site du débat public.
Dans son cahier d’acteur (n°150), l’association SGF (Société Géologique de France), qui réunit 1 400 membres issus des milieux académiques et professionnels, a souhaité apporter son éclairage au débat public, suite à une consultation de ses membres. Elle considère ainsi que, dans l’état des connaissances scientifiques actuelles, l’option du stockage géologique profond réversible de déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue est, sur le plan technique, le moyen le plus sûr et le mieux adapté pour gérer ces éléments. Elle souligne la nécessité de mettre en place une surveillance géologique du site à une large échelle, de poursuivre des programmes de recherche, enrichis par les observations du suivi, pour réduire sans cesse les incertitudes et minimiser les risques et de pérenniser des filières de formation permettant d’accéder aux compétences nécessaires à la sûreté du site de stockage et à ses impacts sur l’environnement. Elle considère également que, ne pouvant présager des résultats des avancées scientifiques et des innovations technologiques futures, la réversibilité du stockage apparaît comme un critère important pour permettre la mise en œuvre d’éventuelles solutions nouvelles.
La mise en œuvre du stockage n’interdit pas la poursuite des recherches pour continuer à améliorer la politique de gestion des déchets radioactifs, bien au contraire. Le Parlement a ainsi maintenu en 2006 les recherches sur la séparation-transmutation et l’entreposage. L’Andra propose également de poursuivre le travail sur la réduction des volumes et de la nocivité des déchets radioactifs. Dans ses propositions sur la réversibilité (../docs/rapport-etude/fiche-reversibilite-cigeo.pdf), l’Andra propose de faire régulièrement le point sur les résultats des recherches qui continueront à être menées sur la gestion des déchets radioactifs. Si les générations suivantes le souhaitent, elles pourront ainsi faire évoluer leur stratégie de gestion des déchets radioactifs, en fonction des avancées des recherches.
QUESTION 638 - Comportement des colis sur des siècles
Posée par françoise POUZET, LES GÉNÉRATIONS FUTURES! (RÉGION CENTRE), le 06/12/2013
Comment ne pas être inquiet quand l'ANDRA affirme qu'elle maîtrise tous les risques, alors qu'on voit, en Belgique, dans un entreposage de surface, un problème apparemment de grande ampleur, après si peu d'années : des fûts radioactifs qui débordent ! Cela concerne la moitié d'une catégorie de fûts ! Voir : http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20131204_00399118 Comment l'ANDRA peut-elle être aussi sûre du comportement de ses colis sur le très long terme ?
Réponse du 30/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
Lors d’une opération de contrôle, Belgoprocess (filiale de l’Ondraf, Organisme national de gestion déchets radioactifs et des matières fissiles) a identifié la formation d’un gel à la surface d’une matrice en béton utilisée par certaines centrales nucléaires en Belgique pour confiner des déchets de faible activité. Un vaste programme d’inspection et de contrôle a été mis en place par l’Ondraf (cf. http://www.ondraf.be/sites/default/files/20140107_Communique%20de%20presse-ONDRAF_FR.pdf). Une alcali-réaction dans le béton pourrait être à l’origine de ce phénomène.
Pour se prémunir du risque d’alcali-réaction, l'Andra impose un cahier des charges précis pour les matériaux utilisés pour la fabrication des colis de stockage. Les granulats et le ciment sont choisis pour garantir leur stabilité chimique. Par ailleurs, le béton pouvant également réagir au contact de certains déchets, l’Andra interdit le mélange de certaines familles de déchets avec ce type de matériau. Pour s'assurer du respect de ces spécifications, l’Andra procède à des contrôles en complément de ceux réalisés par les producteurs de déchets, qui sont responsables de la qualité des colis livrés sur les centres de stockage. A travers ces différents contrôles, l'Andra vérifie la maîtrise globale de la qualité des colis qu'elle reçoit. Si une erreur est observée, l’agrément d’une famille de déchets pour le stockage peut être suspendu.
QUESTION 637 - Ethique
Posée par Francis BORDOZ, L'organisme que vous représentez (option) (CLERMONT FERRAND ), le 06/12/2013
On a beaucoup entendu parler d'ETHIQUE. Pour l'ANDRA, l'ETHIQUE c'est d'enfouir pour que les générations futures ne s'occupent de rien. Pour d'autres l'ETHIQUE c'est de ne pas faire courrir le risque d'une perte de confinement. Ce serait un crime. Comment décontaminer des volumes à 500 m sous terre ? Comment contenir la contamination des nappes phréatiques ? On ne sait pas le faire ni à Tchernobyl, ni à Fukushima !
Réponse du 06/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La protection de l’homme et de l’environnement et la prise en compte des générations futures fondent la politique française de gestion des déchets radioactifs définie par le Parlement. L’article L. 542-1 du code de l’environnement stipule ainsi :
« La gestion durable des matières et des déchets radioactifs de toute nature, résultant notamment de l’exploitation ou du démantèlement d’installations utilisant des sources ou des matières radioactives, est assurée dans le respect de la protection de la santé des personnes, de la sécurité et de l’environnement.
La recherche et la mise en œuvre des moyens nécessaires à la mise en sécurité définitive des déchets radioactifs sont entreprises afin de prévenir ou de limiter les charges qui seront supportées par les générations futures. »
L’objectif du projet Cigéo est bien de protéger l’homme et l’environnement sur le très long terme de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. Si Cigéo est autorisé, il sera implanté dans une couche géologique spécialement choisie en raison de ses propriétés de confinement. Du fait de son implantation à 500 mètres de profondeur, il sera peu vulnérable aux activités humaines comme aux catastrophes naturelles à l’inverse d’une centrale comme celle de Tchernobyl en URSS ou de Fukushima au Japon.
La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra à l’État après un processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande d’autorisation de création du stockage. Ce processus comprendra notamment l’évaluation de la sûreté par l’Autorité de sûreté nucléaire, l’évaluation des recherches scientifiques par la Commission nationale d’évaluation, l’avis des collectivités territoriales, le vote d’une loi fixant les conditions de réversibilité et une enquête publique. La création du stockage ne pourra être autorisée que si l’Andra démontre qu’elle maîtrise les risques pendant son exploitation et après sa fermeture.
Si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’Observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public. Après sa fermeture, les générations futures pourront continuer à assurer une surveillance du site aussi longtemps qu’elles le souhaiteront. Néanmoins, le stockage restera sûr même si le site venait à être oublié, contrairement à un entreposage, qu’il soit en surface ou en subsurface.
QUESTION 636 - Signalisation du centre d'enfouissement
Posée par Bruno LABELLE, L'organisme que vous représentez (option) (FRANCE), le 06/12/2013
Bonjour, étant un site d'enfouissement à très long terme, comment pensez-vous indiquer la présence de ce site aux générations futures, et ce pendant des milliers d'années ?
Réponse du 19/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif fondamental de Cigéo est de protéger l’homme et l’environnement des déchets radioactifs sur de très longues échelles de temps. La sûreté à long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. C’est une des raisons qui a conduit, en 2006, le Parlement à retenir la solution du stockage profond. En effet, cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli, contrairement à l’entreposage. En cas de perte complète de la mémoire du stockage, une intrusion inopinée à 500 mètres sous terre apparaît peu plausible, du moins sans un minimum d’investigations préalables. L’Andra évalue cependant par précaution dans son analyse de sûreté les conséquences d’un forage à travers le stockage pour vérifier que le stockage resterait sûr.
Malgré cette robustesse du stockage même en cas d’oubli, l’Andra conçoit Cigéo avec l’objectif d’en conserver la mémoire et de la transmettre aux générations futures le plus longtemps possible. Des solutions d’archivage de long terme existent pour les centres de stockage de surface exploités par l’Andra et font l’objet de revues périodiques. Le retour d’expérience montre que ces solutions paraissent robustes pour au moins les 500 premières années. Ainsi, pour Cigéo, l’Andra prévoit qu’un centre de la mémoire perdurera sur le site. Il pourra accueillir le public et comprendra notamment les archives du Centre.
De manière générale, le maintien de la mémoire doit aussi impliquer les acteurs locaux, qui peuvent prendre le relai en cas de défaillance de l’Andra ou de l’État. L’Andra veille d’ores et déjà à les informer sur les enjeux associés à la mémoire et étudie avec des anthropologues, des philosophes ou encore des artistes les facteurs qui peuvent favoriser la transmission de la mémoire. La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
L’Andra a lancé en 2010 un programme d’études pour proposer des outils qui rendent cette transmission plus robuste sur une échelle de temps millénaire. Des pistes se dessinent tels des marqueurs de surface, mais aussi des rendez-vous réguliers à mettre en place au niveau des populations locales.
En tout état de cause, comme il est impossible de garantir notre capacité à communiquer avec des êtres vivant dans plusieurs milliers d’années, c’est chaque génération qui aura la responsabilité de contribuer à transmettre cette mémoire aux générations suivantes.
QUESTION 635 - la sureté
Posée par Jean TRIVAUD, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 06/12/2013
Je suis pour le stockage à Bure. Mais qui contrôlera la sureté du site pendant son exploitation ? Merci
Réponse du 10/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le cadre réglementaire établit clairement la responsabilité première de l’exploitant d’une installation nucléaire pour assurer la sûreté de son installation. Ainsi, c’est l’Andra qui assure la sûreté de Cigéo, depuis sa conception, son exploitation jusqu’à sa fermeture. De plus, L’Andra sera en permanence soumis au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), autorité administrative indépendante créée par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (dite "loi loi TSN : loi du 13 juin 2006 relative à la Transparence et à la sécurité en matière NucléaireTSN") et chargée de contrôler les activités nucléaires civiles en France. L’ASN examine en particulier tous les dossiers de sûreté produits par l’Andra, avec son appui technique l’IRSN. Elle rend aussi un avis avant l’autorisation du stockage, autorise sa mise en service après avoir vérifié que les dispositions pour garantir la sûreté ont bien été prises. Pendant toute la construction et l’exploitation de l’installation, elle réalise des inspections pour contrôler la bonne mise en œuvre de ces dispositions. Pour en savoir plus sur l’ASN, vous pouvez vous rendre sur le site www.asn.fr
En complément, des contre-expertises indépendantes pourront être réalisées autour de Cigéo à la demande de la Commission Locale d’Information comme cela a été plusieurs fois le cas sur les centres de stockage de surface et récemment sur le centre de stockage de l’Aube par l’ACRO (Association pour la radioactivité dans l’ouest).
QUESTION 634 - Entreposage
Posée par Maude WATHIER, L'organisme que vous représentez (option) (MELUN), le 05/12/2013
Bonjour, que dit l’autorité de sûreté sur la possibilité d’un entreposage de longue durée comme celui étudié dans les années 90 ? Bien à vous
Réponse du 13/02/2014,
Réponse apportée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) :
Lorsque l'on mentionne le cas de l'entreposage de longue durée il convient de bien différencier deux aspects liés à ce concept :
- soit il s’agit d’installations dont la durée de vie est sensiblement supérieure aux installations actuellement autorisées, l’ordre de grandeur étant de la centaine d’année (jusqu'à 300 ans) contre quelques dizaines d’années actuellement,
- soit, comme cela peut être évoqué, il s’agit du fait d’utiliser de telles installations pour proposer une solution de gestion des déchets radioactifs d’attente qui pourrait potentiellement devenir définitive. Dans cette hypothèse, cela nécessiterait un entreposage renouvelé sur une longue durée et donc, périodiquement, un reconditionnement des déchets et une reconstruction d’installations d’entreposage.
L’entreposage de longue durée en surface est l’un des trois axes de recherche sur la gestion des déchets de haute activité à vie longue, fixé par la loi du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs.
Les questions de sûreté soulevées par la durée de vie envisagée pour ces installations d'entreposage sont multiples : difficulté d’anticiper et modéliser le vieillissement de l'installation et des colis de déchets sur de si longues périodes dans la démonstration de sûreté, difficultés relatives à la définition de marges suffisantes dans le dimensionnement de l'installation, ... Ces questions sont cumulées aux enjeux de sûreté des installations d’entreposage « classiques » et notamment concernant la maîtrise des risques (manutention, criticité, explosion, incendie, …)
Par ailleurs, la maîtrise d'une installation d'entreposage nécessite des actions de surveillance et de maintenance continues donc d'un contrôle institutionnel dont la pérennité est difficile à garantir sur de longues périodes de temps. La perte de maîtrise technique de l'installation, voire le risque d'abandon, pourrait alors conduire à des situations potentiellement inacceptables.
L’ASN a rendu un avis le 1er février 2006 sur les quinze années de recherches menées par le CEA dans le cadre de la loi susmentionnée (qui portaient sur l’entreposage en surface et en subsurface). Cet avis est consultable sur le site internet de l’ASN.
QUESTION 633 - Surveillance du site de stockage
Posée par jc BENOIT, L'organisme que vous représentez (option) (RENNES), le 05/12/2013
Envisagez-vous l'utilisation de drones tout terrain ex : chenillés et durcis, aux radiations munsi de capteurs :video; température, humidité, etc pour la surveillance souterraine du site de stockage ? avantage : minimise les risques pour les humains
Réponse du 28/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
S’il est autorisé, Cigéo fera l’objet d’une surveillance systématique, comme toute installation nucléaire. Cette surveillance s’appuie sur un ensemble de dispositifs permettant de contrôler les différents paramètres (radiologique, thermique, mécanique, hydrique…). Cette surveillance sera effectuée par l’Andra et sera contrôlée par l’Autorité de sûreté nucléaire.
Les tunnels de l’installation souterraine seront accessibles au personnel, à l’exception des alvéoles où seront stockés les déchets radioactifs. Des dispositifs spécifiques de surveillance sont étudiés par l’Andra pour ces alvéoles, en s’appuyant notamment sur le retour d’expérience acquis dans l’industrie nucléaire pour inspecter des zones à fort niveau de radiation, par exemple dans les centrales nucléaires. En particulier, les équipements utilisés sont « durcis », c’est-à-dire conçus pour pouvoir opérer dans ces zones irradiantes.
QUESTION 632 - question pour la commission
Posée par Nicole R, L'organisme que vous représentez (option) (HAUTE-MARNE), le 05/12/2013
Je préfère écouter les vrais experts que des pseudos-experts qui font croire aux gens qu’ils connaissent le sujet. Comment la CPDP a-t-elle sélectionné les intervenants lors des débats ? Pourquoi n’avoir pris que des « experts » contre le stockage et laisser penser que tous ceux qui ne travaillent ni à l’Andra, ni à l’IRSN, ni à EDF sont forcément contre le stockage ? Pourquoi n’y a-t-il pas eu un seul vrai expert indépendant en stockage de déchets radioactifs lors des débats ? Aucun des experts présents n’ont jamais travaillé sur le déchets radioactifs ou le stockage, vous confirmez ? C'est bien d'avoir différents avis sur le sujet et de débattre mais ce n'est pas normal de laisser donner de fausses informations sous prétexte d'un débat. Merci de bien vouloir répondre à ces questions.
Réponse du 20/12/2013,
La CPDP a cherché à réunir lors des débats contradictoires des experts aux points de vues différents, certains opposés au projet Cigéo d’autres favorables. La contradiction recherchée a conduit effectivement à privilégier les experts opposés au stockage géologique tous présentant une connaissance approfondie du sujet. Les questions des internautes ont permis aux différentes positions de s’exprimer dont celles favorables au stockage.
QUESTION 631 - question
Posée par Nicole R, L'organisme que vous représentez (option) (HAUTE-MARNE), le 05/12/2013
Dans l’Aube des expertises faites par des associations indépendantes confirment les contrôles fait par l’Andra sur l’environnement ? Pourra-t-il y avoir le même type de contre-expertises autour de Cigéo ? Que fera l’Andra pour surveiller l’environnement ?
Réponse du 18/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de stockage de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement afin de contrôler l’impact de ses activités. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, il permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement et l’absence de contamination dans l’environnement. L’Andra a déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. De plus, Cigéo sera en permanence soumis au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
En complément, des contre-expertises indépendantes pourront effectivement être réalisées autour de Cigéo à la demande de la Commission Locale d’Information comme cela a été plusieurs fois le cas sur les centres de stockage de surface et récemment sur le centre de stockage de l’Aube par l’ACRO (Association pour la radioactivité dans l’ouest).
QUESTION 630 - les scentifiques
Posée par mark HOFFMAN, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 05/12/2013
Je fais confiance aux scientifiques pour mener à bien ce projet. Quelles sont les mesures particulières prises pour garantir que les nappes phréatiques ne seront pas contaminés ? Cordialement. Mark
Réponse du 18/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Pendant l’exploitation du Centre, afin d’éviter tout risque de contamination des nappes phréatiques, les effluents liquides susceptibles d’être contaminés seront systématiquement collectés et contrôlés.
Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement afin de contrôler l’impact de ses activités. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, il permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement et l’absence de contamination des nappes phréatiques. L’Andra a déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
De plus, Cigéo sera en permanence soumis au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
Après la fermeture du stockage, au-delà de la durée de vie des ouvrages industriels, la couche d’argile très peu perméable, de plus de 130 mètres d’épaisseur, dans laquelle sera installé le stockage souterrain, servira de barrière naturelle pour retenir les radionucléides contenus dans les déchets et freiner leur déplacement. Le stockage permet ainsi de garantir leur confinement sur de très longues échelles de temps. Seuls quelques-uns de ces radionucléides, les plus mobiles et dont la durée de vie est longue, pourront migrer de manière très étalée dans le temps. Ils ne sortiraient pas de cette couche avant 100 000 ans et atteindraient en quantités extrêmement faibles la surface et les nappes phréatiques. Leur impact radiologique serait alors plusieurs dizaines de fois inférieur à la radioactivité naturelle (qui est de 2,4 mSv par an en moyenne en France).
QUESTION 629 - surveillance
Posée par Camille ONETTE, L'organisme que vous représentez (option) (BONNELLES), le 05/12/2013
Bonjour, y aura-t-il une surveillance de la santé des populations voisines de l’enfouissement ? Fait stocker ces déchets une bonne fois pour toute pour éviter de laisser nos enfants s’en occuper à notre place! C’est ça être responsable ! Camille
Réponse du 18/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif fondamental de Cigéo est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement des risques liés aux déchets radioactifs. Une première évaluation, faite sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact des rejets pendant l’exploitation du site serait de l’ordre de 0,01 mSv par an à proximité du Centre, soit très largement inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France). A titre de comparaison, lors d’un scanner de l’abdomen, les doses reçues sont de l’ordre de 10 mSv.
Malgré ce très faible impact, et pour répondre à la demande exprimée à plusieurs reprises par les acteurs locaux et notamment le Clis (Comité local d’information et de suivi du Laboratoire souterrain), l’Andra s’est rapprochée des organismes de santé publique (Institut national de veille sanitaire, Observatoires régionaux de la santé de Lorraine et de Champagne-Ardenne) pour étudier les modalités possibles d’une surveillance de la santé autour du stockage. L’Andra a saisi ses ministères de tutelle pour que la gouvernance et l’organisation d’un tel dispositif soient précisées.
QUESTION 628 - sécurité incendie
Posée par antoine OMONT, L'organisme que vous représentez (option) (MONTROUGE), le 05/12/2013
Bonjour j'aurais voulu savoir quel dispositif de sécurité incendie est prévu que se passerait il en cas d'incendie ? est il prévu de baser des pompiers sur place ?
Réponse du 09/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Effectivement, une équipe de pompiers sera présente en permanence sur place, mais de nombreuses autres mesures sont prises pour maîtriser le risque incendie :
Le risque incendie est pris en compte dès la conception de Cigéo : pour réduire le risque d’incendie, une première mesure consiste à limiter la quantité de produits combustibles ou inflammables dans les équipements du stockage. Par exemple, si Cigéo est réalisé, les câbles électriques seront ignifugés et les véhicules à moteur thermique seront interdits dans l’installation nucléaire souterraine de Cigéo. De plus, des dispositifs de détection incendie seront répartis dans les installations pour détecter rapidement et localiser tout départ de feu. Plusieurs systèmes d’extinction automatiques seront installés dans l’installation souterraine. Des systèmes embarqués d’extinction automatique (gaz, poudre...) seront placés sur les engins de transfert des colis de déchets et sur les engins de manutention en alvéole, afin d’éteindre tout départ de feu. Des systèmes d’extinction automatique seront également disposés dans certaines zones de l’installation souterraine telles que les locaux électriques et les zones de soutien logistique. Ces dispositifs seront mis en place en complément de moyens de lutte contre l’incendie plus traditionnels de types extincteurs, points de raccordement à un réseau d’alimentation en agent extincteur (eau, mousse…) etc.
Malgré toutes ces dispositions, une situation d'incendie est quand même considérée par prudence. Dans les installations de surface, les mêmes principes seront appliqués que dans les installations nucléaires de base : en cas d’incendie, les locaux concernés seraient isolés du reste de l’installation, les moyens d’extinction et d’intervention seraient déclenchés et le personnel serait évacué. Dans l’installation souterraine, compte tenu de sa géométrie spécifique, ces dispositions sont adaptées dès la conception. Des systèmes de compartimentage et de ventilation sont prévus pour limiter la propagation du feu. Des équipements d’intervention seront prépositionnés dans l’installation souterraine en permanence. L'architecture souterraine retenue pour le stockage permettra aux secours d'intervenir dans des galeries à l'abri des fumées et facilite l'évacuation du personnel.
Outre la mise à l’abri du personnel, la maîtrise du risque incendie vise aussi à protéger les colis contenant les substances radioactives des effets de l’incendie afin de maintenir le confinement de ces substances. Pour cela, les colis seront disposés dans des équipements qualifiés pour résister au feu (cellules résistantes au feu munies de portes coupe-feu, hotte de protection pour le transfert dans l’installation souterraine). Les conteneurs de stockage sont également conçus pour assurer une protection contre l’incendie. Ces dispositions permettent d’exclure tout effet domino entre les colis stockés.
La définition de l’ensemble de ces dispositifs associe les services compétents des sapeurs-pompiers et fait l’objet de contrôle par l’Autorité de sûreté nucléaire. Cigéo ne sera jamais autorisé si l’Andra ne démontre pas qu’elle maîtrise tous les risques, dont le risque d’incendie.
QUESTION 627 - Visite
Posée par Réné MARTINE, L'organisme que vous représentez (option) (55), le 05/12/2013
Comment faire pour visiter le laboratoire de Bure ? Le stockage sera réversible 100 ans, comment ?
Réponse du 10/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Concernant votre demande de visite
Pour effectuer une visite du Laboratoire souterrain nous vous invitons à contacter le service communication du site de Meuse/Haute-Marne :
Concernant la réversibilité de Cigéo
Le Parlement a demandé que le stockage soit réversible pendant au moins 100 ans afin de laisser aux générations suivantes la possibilité de faire évoluer le stockage si elles le souhaitent. En réponse à cette demande, l’Andra propose des conditions de réversibilité, durant le siècle d’exploitation, qui ne compromettent pas la sûreté du stockage et qui sont réalisables sur le plan technique. Ces propositions concernent à la fois la technique et le pilotage du stockage.
- Pouvoir récupérer les colis de déchets après leur stockage : De nombreuses dispositions techniques sont mises en œuvre pour faciliter une opération éventuelle de retrait de colis du stockage. Ces dispositions prennent en compte le retour d’expérience d’autres installations, en France et à l’étranger. Les colis utilisés pour le stockage des déchets, en béton ou en acier, sont indéformables. Des espaces suffisants sont ménagés entre les colis pour permettre leur retrait. Les tunnels de stockage (alvéoles de stockage) ont un revêtement en béton ou en acier pour éviter les déformations. L’exploitant disposera d’une connaissance précise de l’emplacement de chaque colis et de ses conditions de stockage. Des essais de retrait de colis ont d’ores et déjà été réalisés à l’échelle 1. Des nouveaux tests de retrait seront réalisés dans le stockage avant que la mise en service de Cigéo ne puisse être autorisée, puis pendant toute l’exploitation de Cigéo.
- Un calendrier de fermeture progressif et révisable dans le temps :
Pour assurer la mise en sécurité définitive des déchets radioactifs, le stockage devra être fermé. La conception de Cigéo offre la possibilité d’une fermeture progressive des alvéoles de stockage, des galeries souterraines puis des puits et des descenderies. Chaque étape de fermeture rendra plus complexe le retrait de colis (nécessité de rouvrir l’alvéole et de réinstaller les équipements de manutention) mais permettra d’ajouter des dispositifs de sûreté passive. Compte tenu de leur importance, l’Andra propose que le franchissement de ces étapes fasse l’objet d’une autorisation spécifique. Le Parlement a d’ores et déjà décidé que seule une loi pourrait autoriser la fermeture définitive du stockage.
- Des rendez-vous réguliers avec l’ensemble des acteurs pour décider ensemble :
L’Andra propose que des rendez-vous soient programmés régulièrement avec l’ensemble des acteurs (riverains, collectivités, évaluateurs, État…) pour contrôler le déroulement du stockage et préparer les étapes suivantes. Ces rendez-vous seront alimentés par les résultats des réexamens périodiques de sûreté, fixés au moins tous les 10 ans par l’Autorité de sûreté nucléaire, de la surveillance du stockage et par les progrès scientifiques et technologiques. Le premier de ces rendez-vous pourrait avoir lieu cinq ans après le démarrage du centre.
Les conditions de réversibilité constituent l’un des sujets majeurs discutés dans le cadre du débat public. Les échanges alimenteront la préparation de la future loi qui fixera les conditions de réversibilité du stockage. Cette loi sera votée avant que la création de Cigéo ne puisse être décidée.
Pour en savoir plus sur les propositions faites par l’Andra en matière de réversibilité du stockage, voir ../docs/rapport-etude/fiche-reversibilite-cigeo.pdf
QUESTION 626 - Ouverture du centre de stockage
Posée par Franck MORALES, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 04/12/2013
Bonsoir
Pouvez vous svp me dire la date prévue pour l'ouverture de ce centre ? Le report perpétuel de la décision ne fait que porter sur les générations futures un problème qui est d'ores et déjà bien actuel. Notre "génération responsable" doit traiter ce sujet. Merci Franck
Réponse du 10/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra à l’État après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo en 2015 conformément au calendrier fixé par la loi du 28 juin 2006. Ce processus comprendra notamment l’évaluation de la sûreté par l’Autorité de sûreté nucléaire, l’évaluation des recherches scientifiques par la Commission nationale d’évaluation, l’avis des collectivités territoriales, le vote d’une nouvelle loi fixant les conditions de réversibilité, la mise à jour de la demande de création de Cigéo par l’Andra suite à cette loi, et une enquête publique.
Si Cigéo est autorisé, les travaux de construction pourraient débuter en 2019 pour une mise en service en 2025, sous réserve de l’autorisation de l’Autorité de sûreté nucléaire.
QUESTION 625 - quand répondrez-vous?
Posée par L MATHIEU, L'organisme que vous représentez (option) (BESANÇON), le 04/12/2013
Bonjour, On approche de la fin du débat et je n'ai toujours pas reçu de réponse aux questions que j'ai posées en juillet. Trouvez-vous cela normal ? Est-ce que l'ANDRA va me répondre ou les questions sont-elles trop complexes ? Et si je ne suis pas satisfaite par la réponse, je ne pourrai pas réagir. Comment peut-on parler de "dialogue" ou "débat" dans de telles conditions ? C'est la deuxième fois que je pose des questions sur les délais. La dernière fois, elles n'avaient pas été mises en ligne. J'espère que cette fois-ci sera la bonne, que ces nouvelles questions seront publiées et que j'aurai une réponse.
Réponse du 20/12/2013,
Les questions n° 236 et 245 que vous avez posées en juillet ont obtenu une réponse. Votre question n° 246 sur les déchets étrangers en date du 16 juillet 2013 est encore en attente de réponse, la CPDP regrette vivement ce délai et a relancé le maître d’ouvrage afin qu’une réponse vous soit apportée maintenant dans les plus brefs délais.
QUESTION 624
Posée par Serge GRÜNBERG, le 03/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de M. Serge GRÜNBERG :
Imaginons maintenant un accident nucléaire en France. Que ce soit un petit, un grave ou un majeur, les coûts allant de 75 à 5800 M€, que ferait-on des déchets ?
Au Japon, les autorités font face (si l'on peut dire) à 30 millions de m3 de résidus ...
Réponse du 20/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
En cas d’accident d’une centrale nucléaire, les déchets les plus radioactifs proviendraient de l’enceinte du site accidenté : déchets de haute activité provenant de la récupération des éléments combustibles, certains ayant fondus, déchets de moyenne activité à vie longue, de faible et moyenne activité à vie courte et déchets de très faible activité. L’Andra n’a pas connaissance à ce stade des volumes de déchets issus du site de la centrale accidentée de Fukushima. A Tchernobyl le volume de déchets issus de l’enceinte du site accidenté est d’environ 350 000 m3.
A l’extérieur du site, on trouverait essentiellement des déchets de très faible activité. A Fukushima le volume de déchets à gérer à l’extérieur du site est estimé à 30 millions de mètres-cubes (sols, débris végétaux, déchets d’assainissement) ; à Tchernobyl le volume de sols contaminés a été estimé à 15 millions de mètres cubes.
En France, l’Autorité de sûreté nucléaire a mis en place un « Comité directeur pour la gestion de la phase post-accidentelle d'un accident nucléaire » (CODIRPA) en 2005 à la demande du Gouvernement. Il s’intéresse plus particulièrement à la gestion des territoires contaminés en dehors du site d’une installation qui serait accidentée. En 2012, le CODIRPA a publié un guide présentant les principes retenus pour soutenir la gestion post-accidentelle nucléaire. Il s’attache à présenter les principales actions à mettre en œuvre ou à engager dès la sortie de la phase d’urgence ainsi que les lignes directrices pour la gestion des périodes de transition et de long terme y compris la question de la gestion des déchets. L’Andra a participé à ces travaux. Pour plus d’information, vous pouvez accéder à ce guide sur le site de l’ASN à l’adresse suivante : http://www.asn.fr/index.php/Bas-de-page/Sujet-Connexes/Gestion-post-accidentelle/Comite-directeur-gestion-de-phase-post-accidentelle/Elements-de-doctrine-pour-la-gestion-post-accidentelle-d-un-accident-nucleaire-5-octobre-2012.
Ce document ne traite que des déchets de très faible et faible activité, qui représenterait le principal flux de déchets à gérer dans une telle situation et qui peuvent être stockés en surface. Les déchets de moyenne activité à vie longue et de haute activité qui seraient produits sur le site accidenté lui-même feraient en priorité l’objet d’une mise en sécurité sur ce site. Leur transfert en stockage profond n’interviendrait que plusieurs années après. Les Japonais estiment ainsi à une quarantaine d’années le temps nécessaire au démantèlement des centrales nucléaires accidentées.
De tels déchets n’ont pas été pris en compte dans le dimensionnement du projet de stockage Cigéo car leur volume et leurs caractéristiques dépendraient du type d’accident. Il est clair qu’un tel accident bouleverserait la stratégie de gestion des déchets radioactifs et les conditions d’exploitation des stockages. Une fois les déchets de la zone accidentée mis en sécurité, il conviendrait de réexaminer le dimensionnement des centres de stockage en fonction des volumes à gérer.
QUESTION 623
Posée par Serge GRÜNBERG, le 03/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteur de M. Serge GRÜNBERG :
Trois lieux retenus pour l’enfouissement, Bure, Bure ou… Bure. Pourquoi ?
Réponse du 20/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La loi de recherche du 30 décembre 1991 prévoyait la réalisation de laboratoires souterrains pour l’étude des possibilités de stockage dans les formations géologiques profondes. Suite à une mission de concertation lancée fin 1992 et à des premières analyses géologiques, quatre sites candidats avaient été identifiés dans les départements du Gard, de la Meuse, de la Haute-Marne (couches argileuses) et de la Vienne (couche granitique). L’Andra a été autorisée par le Gouvernement à mener des investigations géologiques dans le but de savoir s’il était intéressant d’y construire un laboratoire souterrain pour continuer les études. En 1996, l’Andra a déposé trois dossiers de demandes d’installation de laboratoires souterrains. Les résultats des investigations géologiques ont montré que la géologie du site en Meuse/Haute-Marne (les deux sites ont été fusionnés en une seule zone en raison de la continuité de la couche argileuse étudiée) était particulièrement favorable. Concernant le Gard, le site présentait une plus grande complexité scientifique liée à son évolution géodynamique à long terme et faisait l’objet d’oppositions locales. L’instruction du dossier relatif au site étudié dans la Vienne n’a pas abouti à un consensus scientifique sur la qualité hydrogéologique du massif granitique.
En 1998, le Gouvernement a décidé la construction d’un laboratoire de recherche souterrain en Meuse/Haute-Marne et la poursuite des études pour trouver un autre site dans une roche granitique. La recherche d’un site dans une roche granitique a finalement été abandonnée, la mission de concertation n’ayant pas abouti. L’Andra a toutefois poursuivi ses recherches sur le milieu granitique jusqu’en 2005, en s’appuyant notamment sur les travaux menés dans les laboratoires souterrains d’autres pays (Suède, Canada, Suisse). Ces recherches ont conduit l’Andra à conclure en 2005 qu’un stockage dans les massifs granitiques ne présenterait pas de caractère rédhibitoire mais que la principale incertitude porte sur l’existence de sites en France avec un granite ne présentant pas une trop forte densité de fractures.
La loi du 28 juin 2006 a fait le choix du stockage réversible profond pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations futures. Elle demande à l’Andra d’étudier et d’implanter Cigéo en stipulant que « la demande d'autorisation de création [d’un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs] doit concerner une couche géologique ayant fait l'objet d'études au moyen d'un laboratoire souterrain ». L’Andra poursuit donc ses études en vue d’élaborer pour 2015 le dossier support à l’instruction de la demande d’autorisation de création de Cigéo en Meuse/Haute-Marne, dans la couche d’argile dont les propriétés de confinement sont désormais reconnues.
QUESTION 622
Posée par UNION DEPARTEMENTALE CLCV MARNE, le 03/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de l'UNION DEPARTEMENTALE CLCV MARNE :
L’industrie nucléaire est-elle la solution alternative aux énergies fossiles ?
Réponse du 09/01/2014,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
En France, le nucléaire occupe une place prépondérante dans le mix électrique, assurant près de 75% de la production française d’électricité. Compte tenu de la durée nécessaire à la construction de moyens de production d’électricité de substitution, un arrêt à court terme de l’ensemble du parc nucléaire n’est pas envisageable sans remettre en cause l’approvisionnement électrique du pays, c’est à dire sans coupures très importantes d’électricité pour les consommateurs. Il apparaît donc extrêmement difficile de ne plus produire de nouveaux déchets radioactifs provenant de l’industrie électronucléaire à très court terme.
Depuis plusieurs dizaines d’années, la France a mis en place une politique de gestion responsable de ses déchets radioactifs. En 2006, après quinze années de recherches encadrées par la loi « Bataille », d’avis des évaluateurs et d’un débat public, le Parlement a fait le choix du stockage réversible profond pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations futures.
Enfin, en matière de mix électrique, le Président de la République a fixé le cap suivant pour la France : réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% d'ici 2025. Parallèlement, le Président de la République a indiqué que la transition énergétique serait fondée sur deux principes : l'efficacité énergique d'une part, et la priorité donnée aux énergies renouvelables d'autre part. Cette mutation prendra du temps et supposera des étapes d’évaluation en fonction des progrès technologiques et scientifiques et des prix relatifs de chaque source d’énergie.
QUESTION 621
Posée par PAX CHRISTI FRANCE, le 03/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de PAX CHRISTI France :
Même si le stockage géologique a également les faveurs dans d’autres pays, l’entreposage actuel ne permet-il pas d’éviter toute précipitation, d’affiner le projet, et de chercher d’autres solutions ?
Réponse du 09/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
On peut toujours remettre à demain ce que l’on pourrait commencer à faire aujourd’hui. Mais nos enfants pourraient nous reprocher de ne pas avoir préparé de solution pour gérer les déchets les plus radioactifs produits par les activités dont nous avons bénéficié au quotidien. De nombreuses solutions pour gérer les déchets radioactifs ont été imaginées depuis 50 ans : les envoyer dans l’espace, au fond des océans ou dans le magma, les entreposer plusieurs centaines d’années en surface ou à faible profondeur, les transmuter… seul le stockage profond est aujourd’hui reconnu comme une solution robuste pour mettre en sécurité ces déchets à très long terme.
C’est justement pour ne pas laisser aux générations suivantes la charge de la gestion des déchets radioactifs et les risques associés que le Parlement a fait le choix du stockage réversible profond, après 15 années de recherches et leur évaluation sur le plan scientifique et de la sûreté. Plus de 40 000 m3 de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue ont déjà été produits en France depuis une cinquantaine d’années. Ces déchets sont actuellement entreposés de manière provisoire dans l’attente d’une solution de gestion à long terme, notamment sur les sites de La Hague, Marcoule et Cadarache. A l’inverse de l’entreposage, le stockage permet de mettre en sécurité ces déchets de manière définitive.
Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de ces déchets. Grâce à la réversibilité, ces générations garderont la possibilité de faire évoluer cette solution. L’Andra propose ainsi que des rendez-vous réguliers soient programmés pendant une centaine d’années pour faire le point sur l’exploitation du stockage et préparer les étapes suivantes. Ces rendez-vous seront notamment alimentés par les résultats des recherches menées en France et à l’étranger sur la gestion des déchets radioactifs et les avancées technologiques. A chaque étape, il sera possible de décider de poursuivre le processus de stockage tel qu’initialement prévu ou de le modifier, par exemple si des solutions alternatives sont identifiées.
La décision éventuelle de créer Cigéo sera fondée sur les résultats de près de 25 années de recherches. Elle ne sera donc pas prise dans la précipitation ou sans que le projet ait été suffisamment affiné. Cette décision reviendra à l’État après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo. Ce processus comprendra notamment l’évaluation de la sûreté par l’Autorité de sûreté nucléaire, l’évaluation des recherches scientifiques par la Commission nationale d’évaluation, l’avis des collectivités territoriales, le vote d’une nouvelle loi fixant les conditions de réversibilité et une enquête publique.
QUESTION 620
Posée par PAX CHRISTI FRANCE, le 03/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de PAX CHRISTI France :
Le financement est en principe assuré par des provisions. Cependant, celles-ci sont-elles suffisantes et les estimations sont-elles fiables ?
Réponse du 10/01/2014,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
L'article 20 de la loi du 28 juin 2006 pose le principe de la responsabilité première de l'exploitant d’une installation nucléaire pour le provisionnement des charges de gestion à long terme des déchets radioactifs qu’il produit et la couverture de ces charges par des actifs dédiés à leur financement. La responsabilité de constituer et de gérer ces actifs est à la charge de l'exploitant. Il doit s'assurer à tout moment que leur valeur de marché est supérieure au niveau requis. Il dispose pour cela d'outils de gestion actif-passif tenant compte de l'historique des rendements de ses actifs, y compris pendant la
précédente crise financière. Tout cela est étroitement contrôlé par l’Etat. A cet égard, en vertu des articles L. 594-1 et suivants du code de l'environnement (articles codifiés correspondants à l'article 20 de la loi du 28 juin 2006), l'exploitant fournit chaque année au gouvernement des documents qui doivent notamment montrer que les actifs dédiés sont suffisamment sûrs, liquides et rentables. »
QUESTION 619
Posée par MEDEF MEUSE, le 03/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteur du MEDEF Meuse :
De 1300 à 2300 emplois directs vont être créés avec Cigéo d’ici 2025, puis entre 600 et 1000 pendant les 100 ans d’exploitation du site. Il faudrait donc gérer aussi à cette date cette diminution d’emplois. La réponse est-elle à la hauteur des attentes et des besoins ?
Réponse du 10/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Si la création du projet Cigéo est autorisée, une des caractéristiques du projet est qu’il sera construit et exploité sur plus de 100 ans. L’estimation donnée par les études d’esquisse indique que de 1 300 à 2 300 personnes travailleraient à la construction des premières installations de Cigéo. Après 2025, de l’ordre de 600 à 1 000 personnes travailleraient de manière pérenne sur le site pour assurer à la fois l’exploitation des installations et la construction progressive de l’installation souterraine qui se poursuivra en parallèle.
Comme sur d’autres grands chantiers (LGV Sud Europe Atlantique Tours-Bordeaux, EPR Flamanville...) un travail d’anticipation doit être conduit entre le maître d’ouvrage et les acteurs locaux afin de préparer les phases de mobilisation et de démobilisation des salariés du site. Cette anticipation implique une coordination forte entre les acteurs lors de la mobilisation, afin de répondre aux besoins en main-d’œuvre des entreprises, par des mesures favorisant la formation et la constitution d’un vivier de candidatures locales. Avec la fin de la période construction initiale de Cigéo, des démobilisations devront être planifiées (même si des chantiers de construction se poursuivront pendant toute la durée de Cigéo). L’Andra, les entreprises intervenant sur le chantier et les acteurs locaux devront développer des actions d’accompagnement, de formation et de reconversion pour favoriser la sécurisation des parcours professionnels des salariés du chantier à une échelle locale, régionale ou nationale.
QUESTION 618
Posée par Danielle BILLY, le 03/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de Mme Danielle BILLY :
Pourquoi un calendrier si tendu ? La faisabilité et la qualité d’une fermeture étanche avec la bentonite, seront donc connus après la demande d’autorisation de construction, est-ce acceptable ? En cas de catastrophe, qui sera responsable ?
Réponse du 08/01/2014,
Réponse apporté par l’Andra, maître d’ouvrage :
Conformément à la demande des évaluateurs, l’Andra met en œuvre un programme d’essais pour apporter les éléments nécessaires à la démonstration de la faisabilité industrielle des scellements. En particulier, l’essai FSS (Full Scale Seal) vise à démontrer d’ici 2015 les modalités de construction d’un noyau à base d’argile gonflante et de massifs d’appui en béton en conditions opérationnelles. La qualité de réalisation de l’ouvrage est contrôlée. Le diamètre utile de l’ouvrage considéré est de 7,60 m environ. Compte tenu des contraintes opérationnelles que représente un ouvrage d’une telle taille, l’essai est réalisé en surface dans une « structure d’accueil » construite à cet effet. Des conditions de température et d’hygrométrie représentatives des conditions du stockage sont maintenues autour de l’essai et les conditions qui seraient induites par la réalisation d’un scellement en souterrain sont appliquées (ventilation et délai de transport du béton notamment) pour que cet essai soit représentatif des conditions de Cigéo. Les interfaces avec le revêtement laissé en place et les argilites dans les zones de dépose du revêtement sont représentées par des simulations d’alternances de portions de revêtement maintenues et déposées et de hors-profils (jusqu’à 1 m de profondeur) avec une surface représentative de la texture de l’argilite. Des massifs de confinement en béton bas pH sont également construits de part et d’autre du noyau avec deux méthodes distinctes (béton coulé et béton projeté). Cet essai fait partie du projet européen DOPAS (Demonstration Of Plugs And Seals) qui réunit quatorze organisations issues de huit pays européens et teste quatre concepts de scellement développés en Finlande, en Suède, en République Tchèque et en France.

QUESTION 617
Posée par Danielle BILLY, le 03/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de Mme Danielle BILLY : Combien de m3 pourront pénétrer dans le stockage quand il y aura 4 puits d’accès, les cheminées de ventilation et les deux descenderies ? Qu’est-ce qui garantira alors la sûreté du stockage ? Pouvez-vous garantir que ce milieu géologique aura la capacité à lui tout seul de maintenir la quantité phénoménale de radioactivité qui sera stockée ? En quoi l’argilite peut-elle être considérée comme un matériau idéal pour constituer un « coffre-fort géologique » ? Quelle est la capacité de l’argilite à confiner cette radioactivité ? Que devient l’argilite poreuse si de l’eau pénètre dans les galeries et les alvéoles ? Comment ne pas avoir peur des séismes ? Comment zapper ces séismes, si proches dans le temps ? Comment faire davantage confiance en la géologie qu’en l’Homme ? Qui sont les géologues qui pensent qu’on peut enfouir ? Il existe bien un principe de précaution qui est écrit dans la constitution, pourquoi ne pas l’appliquer ? Comment est-on assuré qu’aucun séisme, aucune fracturation géologique ne pourrait survenir, quoiqu’en dise l’Andra, qui briserait la barrière de protection ? Qui peut prédire que l’eau souterraine ne s’infiltrera pas, disséminant les radionucléides migrant dans la roche, le long des failles terrestres ?
Réponse du 28/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Concernant l’arrivée d’eau dans Cigéo
Si le stockage est autorisé, des puits et des descenderies seront nécessaires pour relier les installations de surface et l’installation souterraine (flux de personnel, transfert des hottes de protection contenant les colis de déchets, ventilation, flux liés aux travaux…). De nombreuses mesures seront prises pour limiter les arrivées d’eau dans l’installation souterraine par ces liaisons. Les têtes de puits et de descenderies seront protégées contre les intempéries. Les puits et les descenderies seront étanchés au niveau des couches de roche aquifères traversées au-dessus de la couche d’argilite. Les eaux issues des couches de roche supérieures seront drainées et pompées jusqu’à la surface. Compte tenu de la faible productivité de ces roches, les débits collectés seront très faibles par comparaison à certains sites miniers. A titre indicatif, le débit drainé par chacun des puits du Laboratoire souterrain est de l’ordre de 10 mètres cubes par jour en moyenne.
Concernant la possibilité de construire un stockage sûr dans l’argilite de Meuse Haute-Marne
Les recherches menées depuis 1994 sur le site étudié en Meuse/Haute-Marne ont permis aux scientifiques de reconstituer de manière détaillée son histoire géologique, depuis plus de 150 millions d’années. Le site étudié se situe dans la partie Est du bassin de Paris qui constitue un domaine géologiquement simple, avec une succession de couches de calcaires, de marnes et de roches argileuses qui se sont déposées dans d’anciens océans. Les couches de terrain ont une géométrie simple et régulière. Cette zone géologique est stable et caractérisée par une très faible sismicité. La couche argileuse étudiée pour l’implantation éventuelle du stockage, qui s’est déposée il y a environ 155 millions d’années, est homogène sur une grande surface et son épaisseur est importante (plus de 130 mètres).
Aucune faille affectant cette couche n’a été mise en évidence sur la zone étudiée.
Cette analyse s’appuie sur des investigations géologiques approfondies : plus de 40 forages profonds ont été réalisés, complétés par l’analyse de plus de 300 kilomètres de géophysique 2D et de 35 km² de géophysique 3D. Environ 50 000 échantillons de roche ont été prélevés.
La roche argileuse a une perméabilité très faible, ce qui limite fortement les circulations d’eau à travers la couche et s’oppose au transport éventuel des radionucléides par convection (c’est-à-dire par l’entraînement de l’eau en mouvement). Cette très faible perméabilité s’explique par la nature argileuse, la finesse et le très petit rayon des pores de la roche (inférieur à 1/10 de micron). L’observation de la distribution dans la couche d’argile des éléments les plus mobiles comme le chlore ou l’hélium confirme qu’ils se déplacent majoritairement par diffusion et non par convection. Cette « expérimentation », à l’œuvre depuis des millions d’années, confirme que le transport des éléments chimiques se fait très lentement (plusieurs centaines de milliers d’années pour traverser la couche). Les études menées par l’Andra ont montré que l’impact du stockage serait nettement inférieur à celui de la radioactivité naturelle à l’échelle du million d’années.
L’ensemble de ces travaux font l’objet de publications dans des revues à comités de lecture (50 à 70 publications scientifiques internationales par an depuis 10 ans) et sont évalués par des instances indépendantes, en particulier la Commission nationale d’évaluation, mise en place par le Parlement, et l’Autorité de sûreté nucléaire qui s’appuie sur l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Les grands dossiers scientifiques et techniques que l’Andra remet dans le cadre de la loi font l’objet, à la demande de l’Etat, de revues internationales sous l’égide de l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’OCDE. L’Andra a également été évaluée en 2012 par l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES). Enfin, des expertises sont régulièrement commandées par le Comité local d’information et de suivi du Laboratoire souterrain sur les grands dossiers de l’Andra ou sur des sujets plus ciblés.
Concernant les séismes
Même si les tremblements de terre ne sont pas prévisibles, les zones sismiques ou les zones à risque sont parfaitement connues. Les séismes ne se produisent pas n’importe où. Ils se produisent soit à la surface entre deux plaques de la croûte terrestre (exemple du séisme survenu au Japon) soit au niveau d’une faille existante (cas des séismes enregistrés en France).
En ce qui concerne le site étudié en Meuse/Haute-Marne, sa très faible sismicité est confirmée par les scientifiques qui ont travaillé sur ce site depuis plus de 20 ans. Le site de Meuse/Haute-Marne appartient à un domaine géologique stable, le bassin de Paris (voir carte), particulièrement favorable pour l’installation d’un stockage. L’activité sismique est en effet extrêmement faible à l’échelle du millénaire, comme le prouvent les enregistrements de sismicité instrumentale (écoute sismique depuis 1961 à l’échelle de la France) qui sont capables de détecter des microséismes, et les chroniques historiques (séismes ayant été ressentis et/ou ayant occasionné des dégâts au cours des derniers 1 000 ans).
Toutefois, des séismes sans précédent historique peuvent se produire sur une très longue durée, un million d’année dans le cas de Cigéo, compte tenu des faibles vitesses de déplacement de la croûte terrestre dans cette région. Ils se produiraient sur les failles les plus profondes existantes, c’est-à-dire le long de la vallée de la Marne, même si elles n’ont pas eu d’activité apparente dans le dernier million d’années.
Dans la conception de Cigéo, l’Andra prend donc en compte la possibilité qu’un ou plusieurs séismes puissent éventuellement survenir, après la fermeture du stockage, au niveau de ces failles. Par précaution, on évalue l’énergie maximale physiquement possible qui serait libérée par un séisme (c’est-à-dire la magnitude) compte tenu de la géométrie de ces failles. La magnitude maximale serait d’environ 6. Cigéo est conçu pour que plusieurs séismes de ce type n’altèrent pas sa capacité à confiner la radioactivité contenue dans les déchets stockés.
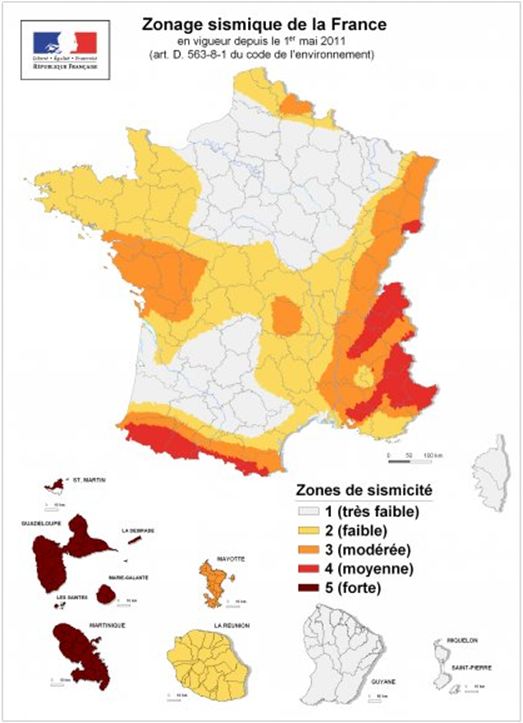
Concernant le choix du stockage géologique et l’application du principe de précaution
Plus de 40 000 mètres cubes de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue sont déjà produits et entreposés sur différents sites en France. Ces déchets génèrent un risque potentiel pour la santé des générations futures et pour l’environnement. En effet, les installations d’entreposage dans lesquelles ils se trouvent actuellement ont une durée de vie limitée (typiquement 50 à 100 ans), au terme de laquelle les déchets doivent en être ressortis puis replacés dans une nouvelle installation, faute de quoi la sûreté ne serait plus assurée. Tant que l’on utilise des installations d’entreposage, la sûreté de la gestion de ces déchets repose sur la capacité technique et financière des générations futures à renouveler les installations. En application du principe de précaution, le Parlement a mis en place en 1991 un programme de recherches pour étudier différentes solutions pour la gestion à long terme de ces déchets, un dispositif d’évaluation et de concertation et un processus de décision.
Après plus de 20 années de recherches, seul le stockage profond est aujourd’hui reconnu en France et à l’étranger comme une solution robuste pour mettre en sécurité définitive les déchets les plus radioactifs. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra à l’État après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création du stockage. Ce processus comprendra notamment l’évaluation de la sûreté par l’Autorité de sûreté nucléaire, l’évaluation des recherches scientifiques par la Commission nationale d’évaluation, l’avis des collectivités territoriales, le vote d’une loi fixant les conditions de réversibilité et une enquête publique.
Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de ces déchets. Grâce à la réversibilité, ces générations garderont la possibilité de faire évoluer cette solution. L’Andra propose ainsi que des rendez-vous réguliers soient programmés pendant une centaine d’années pour faire le point sur l’exploitation du stockage et préparer les étapes suivantes. Ces rendez-vous seront notamment alimentés par les résultats des recherches qui continueront à être menées sur la gestion des déchets radioactifs et les avancées technologiques.
Le débat public de 2005/2006 s’était conclu sur la question : faut-il faire confiance à la géologie ou à la société ? La conviction de l’Andra est qu’il faut faire confiance à la géologie ET à la société. C’est notre définition du stockage réversible.
QUESTION 616
Posée par Danielle BILLY, le 03/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de Mme Danielle BILLY :
Confirmez-vous qu’au-delà d’une centaine d’années le stockage sera irréversible et que le site d’enfouissement sera alors inaccessible et ce, quoi qu’il arrive ?
Réponse du 09/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le but du stockage est de mettre en sécurité de manière définitive les déchets radioactifs, pour ne pas reporter leur charge sur les générations futures. A long terme, la protection de l’homme et de l’environnement doit être assurée sans nécessité d’intervention humaine (sûreté « passive »). La décision de fermer le stockage pour assurer la sûreté de manière passive reviendra aux générations suivantes et la loi du 28 juin 2006 prévoit que seule une loi pourra l’autoriser. La surveillance du site pourra être maintenue aussi longtemps que les générations suivantes le souhaiteront. Il pourrait toujours être envisagé de revenir dans le stockage au moyen de techniques minières adaptées, mais le confinement apporté par la roche et les ouvrages de fermeture ne serait alors plus assuré.
QUESTION 615
Posée par Raymond CHAUSSIN, le 03/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de M. Raymond CHAUSSIN : Quel est l’avenir des 60 tonnes de plutonium stockées à la Hague, va-t-on les incorporer aux déchets vitrifiés ?
Réponse du 07/02/2014,
Réponse apportée par AREVA :
Le plutonium présente un potentiel énergétique très important. En effet, en terme énergétique, 1 g de plutonium équivaut à une tonne de pétrole environ. C’est pourquoi le plutonium présent dans le combustible nucléaire usé (à hauteur d’environ 1% de la masse du combustible) est extrait en vue de son recyclage sous forme de nouveau combustible nucléaire (A l’heure actuelle, ces combustibles dit « MOX » utilisés par les réacteurs d’EDF recyclent environ 10 tonnes de Plutonium par an). Le stock de plutonium séparé à la Hague évolue en fonction de sa réutilisation optimale dans les réacteurs des clients d’AREVA et afin de répondre à des besoins de flexibilité opérationnelle des installations de recyclage. Le plutonium qui fait l’objet d’un inventaire rendu public annuellement sera in fine recyclé sous forme de combustible. Il n’est donc pas prévu de stocker cette matière valorisable dans Cigéo.
QUESTION 614
Posée par Raymond CHAUSSIN, le 03/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de M. Raymond CHAUSSIN :
En cas de refus du permis de construire Cigéo et de l’abandon du projet, qu’adviendra-t-il des salariés embauchés et quels seront leurs recours en droit du travail ? Comment pouvez-vous en l’état actuel du dossier, affirmer dans la rédaction d’une offre d’emploi que vous construirez et exploiterez le centre de stockage géologique profond (Cigéo) ?
Réponse du 06/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez aux offres d’emplois publiées par l’Andra. Les offres liées au projet Cigéo font mention du « projet » de stockage. Les salariés embauchés par l’Andra dans le cadre du projet Cigéo ont des compétences très variées (sûreté, gestion de projet, connaissances des déchets radioactifs, études d’ingénierie...). Si le projet Cigéo n’est pas mis en œuvre, leurs compétences seront mobilisées sur les autres projets confiés à l’Agence. Leurs compétences sont également recherchées par d’autres industriels ou maîtres d’ouvrage et une expérience à l’Andra est appréciée très favorablement par les recruteurs.
QUESTION 613
Posée par Raymond CHAUSSIN, le 03/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de M. Raymond CHAUSSIN :
La communication est le premier métier de l’Andra. Elle la confie aux plus grandes agences parisiennes. Un des objectifs : faire croire au grand public que le projet Cigéo est déjà décidé ; sa manière de communication est donc celle de la propagande. Pour preuve la lecture détaillé de son rapport moral 2012, riche en sous-entendus laissant croire au lecteur que de toute manière le centre de stockage Cigéo sera réalisé quoi qu’il advienne. A sa lecture, nous apprenons que : - « Sur le plan industriel, le projet Cigéo a franchi un nouveau pas vers son industrialisation en raison des études d’esquisses, et de la poursuite des essais et expérimentations dans le laboratoire sous-terrain » - « Le mot déploiement est sans conteste celui qui caractérise le mieux les activités de l’Andra en 2012 ». L’andra a-t-elle conscience que ces 2 phrases, parlant d’industrialisation et de déploiement, annihilent le doute de tout citoyen sur les probabilités de construction de Cigéo ? « Le projet Cigéo est un projet offrant à la France une gestion sûre et responsable de ses déchets les plus radioactifs, jusqu’alors sans solution de stockage ». Pourquoi cette phrase n’a-t-elle pas été mise au conditionnel ?
Réponse du 30/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Nous vous invitons à relire la phrase que vous citez, qui fait bien mention d’un projet.
Aujourd’hui, la décision de créer Cigéo n’est pas encore prise. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra à l’État après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé le dossier support à la demande de création de Cigéo. Ce processus comprendra notamment une évaluation de sûreté par l’Autorité de sûreté nucléaire et une évaluation scientifique par la Commission nationale d’évaluation, l’avis des collectivités territoriales, le vote d’une nouvelle loi fixant les conditions de réversibilité et une enquête publique.
QUESTION 612
Posée par Joëlle DEBELLEIX, le 03/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de Mme Joëlle DEBELLEIX :
A ce jour où j’écris (18 septembre 2013), le débat public est en cours et il me semble que l’Andra tire bien rapidement les conclusions d’un débat qui ne se termine qu’en décembre 2013. N’y a-t-il pas ici une volonté d’orienter l’opinion publique ? Peut-on parler d’un véritable débat démocratique alors que les décisions semblent déjà prises ? J’en ai pour preuve le livre scolaire d’histoire/géographie/éducation civique Terminale BAC PRO programme 2011, édition Belin 2011. J’y lis page 183 « … En ce qui concerne le projet stratégique du stockage géologique profond des déchets de haute activité à vie longue, dont l’ouverture (à Bure) est prévue en 2025,…) N’est-il pas prématuré de parler, en le nommant, dans un livre scolaire, de la programmation de l’ouverture d’un site dont le débat public est en cours et les conclusions à venir ? D’ailleurs, qui assure le dépouillement de débat public et quel est le degré d’objectivité et d’intégrité de ce jury ?
Réponse du 20/12/2013,
Les décisions concernant le projet Cigéo ne sont pas prises. Le débat public s’inscrit dans un processus décisionnel qui prévoit après la publication du compte rendu du débat : une réponse sous 3 mois du maître d’ouvrage, un dépôt par l’ANDRA de la demande d’autorisation de création de Cigéo en 2015 puis entre 2015 et 2018 l’évaluation de cette demande par la Commission Nationale d’Evaluation, l’avis de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, le recueil de l’avis des collectivités territoriales, une loi fixant les conditions de réversibilité du stockage qui devrait être débattue et votée par le parlement en 2016. L’ANDRA devra alors mettre à jour sa demande d’autorisation qui sera instruite à nouveau par l’Autorité de Sûreté Nucléaire après enquête publique. La délivrance de l’autorisation de création si elle devait être donnée le serait ensuite par décret en Conseil d’Etat. L’ouverture de Cigéo est bien prévue dans le calendrier prévisionnel actuel en 2025 comme l’indique le manuel scolaire auquel vous faites référence mais reste conditionnée comme vous pouvez le voir à toute une série d’évaluations et d’instructions dont rien ne permet aujourd’hui de garantir qu’elles aboutissent à une décision favorable.
Le compte rendu du débat public est réalisé par le président de la commission particulière du débat public appuyé par les membres de la commission et ce en toute indépendance du maître d’ouvrage, des financeurs et de l’Etat.
Les membres de la CPDP ont signé un document les engageant à respecter un certains nombre de règles éthiques et déontologiques.
QUESTION 611
Posée par Joëlle DEBELLEIX, le 03/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de Mme Joëlle DEBELLEIX : Comment envisagez-vous le maintien du savoir-faire des salariés du nucléaire dans la gestion de ces déchets sur des périodes de plusieurs siècles, ou milliers de siècles ? Avez-vous imaginé tous les évènements extérieurs pouvant intervenir dans la perte de ce savoir-faire (dissémination du personnel compétent et perte du savoir pour cause de maladies épidémiques, guerres, catastrophes naturelles…) ? J’en prends pour exemple l’agriculture paysanne qui, dans sa grande sagesse, a su pendant des siècles construire avec patience une agriculture respectueuse de la Vie, c’est-à-dire de l’être humain et de son environnement, le premier étant totalement dépendant du second. Paysannerie agressée par les lobbies des agro-industriels, de la chimie et des biotechnologies qui lui ont voté son savoir et son savoir-faire et menacent par leurs pratiques destructrices l’intégralité de notre biodiversité et la survie de l’humanité. Combien de paysans suicidés à ce jour ?
Réponse du 31/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Cigéo est conçu pour qu’après sa fermeture, la sûreté du stockage soit assurée de manière passive, c’est-à-dire sans dépendre d’actions humaines. Ainsi, la problématique que vous soulevez ne se pose que pour la période d’exploitation, sur une centaine d’année. L’histoire industrielle récente fournit de tels exemples : sous leur forme moderne, l’exploitation des mines de fer lorraines et l’industrie sidérurgique qui l’a accompagnée se sont déroulées depuis approximativement le milieu du XIXème siècle, pour se terminer vers la fin du XXème, à la fin des années 80.
QUESTION 610
Posée par Joëlle DEBELLEIX, le 03/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de Mme Joëlle DEBELLEIX :
Du point de vue de la communication, comment envisagez-vous la signalétique de la dangerosité du site pour les générations futures ?
Réponse du 06/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif fondamental de Cigéo est de protéger l’homme et l’environnement des déchets radioactifs sur de très longues échelles de temps. La sûreté à long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. C’est une des raisons qui a conduit, en 2006, le Parlement à retenir la solution du stockage profond. En effet, cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli, contrairement à l’entreposage. En cas de perte complète de la mémoire du stockage, une intrusion inopinée à 500 mètres sous terre apparaît peu plausible, du moins sans un minimum d’investigations préalables. L’Andra évalue cependant par précaution dans son analyse de sûreté les conséquences d’un forage à travers le stockage pour vérifier que le stockage resterait sûr.
Malgré cette robustesse du stockage même en cas d’oubli, l’Andra conçoit Cigéo avec l’objectif d’en conserver la mémoire et de la transmettre aux générations futures le plus longtemps possible. Des solutions d’archivage de long terme existent pour les centres de stockage de surface exploités par l’Andra et font l’objet de revues périodiques. Le retour d’expérience montre que ces solutions paraissent robustes pour au moins les 500 premières années. Ainsi, pour Cigéo, l’Andra prévoit qu’un centre de la mémoire perdurera sur le site. Il pourra accueillir le public et comprendra notamment les archives du Centre.
De manière générale, le maintien de la mémoire doit aussi impliquer les acteurs locaux, qui peuvent prendre le relai en cas de défaillance de l’Andra ou de l’État. L’Andra veille d’ores et déjà à les informer sur les enjeux associés à la mémoire et étudie avec des anthropologues, des philosophes ou encore des artistes les facteurs qui peuvent favoriser la transmission de la mémoire. La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
L’Andra a lancé en 2010 un programme d’études pour proposer des outils qui rendent cette transmission plus robuste sur une échelle de temps millénaire. Des pistes se dessinent tels des marqueurs de surface, mais aussi des rendez-vous réguliers à mettre en place au niveau des populations locales.
En tout état de cause, comme il est impossible de garantir notre capacité à communiquer avec des êtres vivant dans plusieurs milliers d’années, c’est chaque génération qui aura la responsabilité de contribuer à transmettre cette mémoire aux générations suivantes.
QUESTION 609
Posée par Joëlle DEBELLEIX, le 03/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de Mme Joëlle DEBELLEIX :
L’accessibilité au site sera-t-elle toujours maintenue (ce qui me paraît indispensable si un tel projet voit le jour) afin d’en assurer la maintenance ?
Réponse du 09/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maitre d’ouvrage :
Oui, l’accessibilité au site sera maintenue pendant toute la période d’exploitation. Les colis de déchets radioactifs seront transférés en souterrain dans des hottes qui feront écran aux radiations émises par les déchets. Ainsi le personnel pourra circuler dans les galeries souterraines pendant l’exploitation notamment pour assurer la surveillance de l’installation et la maintenance des équipements. Ce mode de fonctionnement est courant dans les installations nucléaires existantes qui manipulent ce type de déchets, à La Hague, Marcoule, Cadarache…
QUESTION 608
Posée par Joëlle DEBELLEIX, le 03/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de Mme Joëlle DEBELLEIX : Avez-vous pris en compte, alors que l’écorce terrestre est toujours en mouvement et en transformation, les risques d’effondrements des souterrains et d’écrasements des déchets ? Quel est le degré d’écrouissage et de ductilité des matériaux utilisés pour ce stockage ? N’y a-t-il pas de risques que ces colis subissent des déformations et des détériorations dans le temps d’autant plus si l’on considère le nombre d’années pris en compte, c’est-à-dire des milliers voir des millions d’années selon les radionucléides avant que ces derniers ne perdent leur dangerosité ? Dans le Journal du dimanche du 12 mai 2013 (par Matthieu Pechberty), Thibaud Labelette directeur du projet à l’Andra ose dire : « Les conteneurs en acier se désintégreront dans quelques centaines d’années, mais l’enveloppe imperméable de l’argile permet de contenir la radioactivité pendant 100.000 ans. » Comment M. T.Labelette peut-il apporter avec tant de certitude et de désinvolture une telle affirmation ? N’est-ce pas au mépris des générations futures ? Un peu plus haut dans l’article, je lis : Un ingénieur projette sur la paroi des dizaines de litres d’eau : « Nous tentons de ramollir l’argile pour creuser plus facilement. » Où est la soi-disant imperméabilité protectrice de l’argile ? Cela ne me paraît pas très sérieux. Plus loin dans l’article, M. Labelette parle du coût de Cigéo. Il dit : « Les discussions ne sont pas simples avec EDF, qui veut limiter les dépenses… Mais nous ne transigerons pas sur la sûreté ». Sommes-nous donc dans un jeu télévisé où le prix est donné au hasard du petit bonheur la chance ?
Réponse du 10/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Concernant vos questions relatives aux ouvrages de stockage
Les matériaux utilisés pour le stockage (béton, acier) sont de même nature que ceux classiquement utilisés pour le soutènement d’ouvrages souterrains (tunnels, canalisations…). L’épaisseur des ouvrages de stockage sera dimensionnée pour garantir la sûreté des opérations pendant toute la phase d’exploitation de Cigéo. Après la fermeture du stockage, les colis contenant les déchets radioactifs et les ouvrages souterrains se dégraderont petit à petit au contact de l’eau contenue dans la roche. C’est là que l’argile prend le relais pour retenir les radionucléides et freiner leur déplacement. Le stockage permet ainsi de garantir leur confinement sur de très longues échelles de temps. Seuls des radionucléides mobiles et à vie longue, plus particulièrement l’iode 129 et le chlore 36, pourront traverser la couche d’argile du Callovo-Oxfordien sur une durée d’un million d’années. Cette migration s’effectuant majoritairement par diffusion dans une forte épaisseur d’argile, ces radionucléides parviendront aux limites de la couche argileuse de façon très étalée dans le temps et très atténuée. Les études ont montré que le stockage n’aura pas d’impact avant 100 000 ans et que celui-ci sera très inférieur à l’impact de la radioactivité naturelle.
Concernant votre question relative aux coûts
Le coût global du stockage couvre la mise en sécurité définitive de tous les déchets français de haute activité et de moyenne activité à vie longue, produits par les installations nucléaires françaises depuis les années 1960 et qui seront produits par les installations nucléaires actuelles jusqu’à leur démantèlement. L’Andra doit évaluer toutes les dépenses sur plus de 100 ans : les études, la construction des installations en surface et en souterrain, les équipements, le personnel, la maintenance, l’électricité, les assurances, les impôts, les taxes… L’évaluation de tous ces coûts est un travail complexe qui demande du temps. Aucun autre projet industriel n’est évalué aussi loin dans le temps.
L’Andra a lancé en 2012 les études industrielles avec des maîtres d’œuvre spécialisés qui apportent leur retour d’expérience sur d’autres projets industriels (construction de tunnels, d’ateliers nucléaires, d’usines…). Un travail important est réalisé sur les outils et les méthodes de chiffrage pour apporter le maximum de robustesse à l’estimation du coût du stockage et prendre en compte l’ensemble du retour d’expérience disponible sur les installations nucléaires existantes et sur d’autres installations industrielles ou ouvrages souterrains de grande envergure.
L’Etat a demandé à l’Andra de finaliser son nouveau chiffrage en 2014 après prise en compte des suites du débat public et des études d’optimisation en cours. Sur cette base, le ministre chargé de l’énergie pourra arrêter une nouvelle estimation après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et observations des producteurs de déchets. La loi du 28 juin 2006 stipule que c’est le ministre qui rend publique cette nouvelle évaluation.
Le cadre législatif et réglementaire qui s’applique à l’Andra, futur exploitant du stockage s’il est autorisé, est très clair et donne la priorité à la sûreté. Outre les limites strictes imposées par les textes, ceux-ci imposent également aux exploitants d’abaisser autant que possible le niveau d’exposition des populations au-delà des limites fixées par la réglementation. L’Andra, comme tous les exploitants, est soumise à ces exigences réglementaires, qui sont de plus complètement cohérentes avec sa mission, qui est de mettre en sécurité les déchets radioactifs, afin de protéger l’homme et l’environnement sur le long terme.
QUESTION 607
Posée par Joëlle DEBELLEIX, le 03/12/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de Mme Joëlle DEBELLEIX : Quel sera l’état de conservation de ces colis dans 1 siècle et au-delà, après la fermeture définitive du site qui semble envisagée ? Comment pourra être assurée la maintenance du site d’entreposage et des colis de déchets après que l’accès au site Cigéo aura été scellé si tel est le cas ? Comment est prévue la surveillance du site Cigéo après la période de réversibilité si celle-ci est retenue ?
Réponse du 28/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les conteneurs de stockage, en acier ou en béton, dans lesquels seront placés les fûts de déchets radioactifs sont conçus pour pouvoir rester manipulables pendant toute la durée d’exploitation du stockage, prévue pour durer une centaine d’année. A long terme, après la fermeture du stockage, c’est la couche d’argile qui, par sa faible perméabilité, ses caractéristiques chimiques et son épaisseur, assurera le confinement de la radioactivité à l’échelle de plusieurs centaines de milliers d’années.
L’impossibilité de garantir la capacité de la société à maintenir les installations d’entreposage des déchets radioactifs sur de longues durées est justement une des raisons qui a conduit au choix de la solution du stockage profond pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs. Contrairement à un entreposage de longue durée, le stockage permet de protéger l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets sans nécessité d’action humaine. La géologie prend ainsi le relais de l’homme pour garantir la sûreté sur le très long terme. La surveillance du site pourra néanmoins être maintenue aussi longtemps que les générations futures le souhaiteront et contribuera au maintien de la mémoire du stockage.
Plusieurs moyens pourront être mis en œuvre pour continuer de surveiller l’installation souterraine et l’environnement après fermeture. Les pistes à l’étude sont des forages depuis la surface jusqu’à la couche de l’Oxfordien calcaire située au-dessus de la couche argileuse du Callovo-Oxfordien, des moyens géophysiques et des instruments laissés en place dans l’installation souterraine lors de sa fermeture.
QUESTION 606 - Cout
Posée par O DERACKER, L'organisme que vous représentez (option) (BAR LE DUC), le 02/12/2013
Le représentant de l'Andra se permet de dire: " en Meuse/Haute-Marne, on ne me demande pas si le coût du stockage va être 15 milliards ou 35 milliards dans 100 ans, on me demande: si le projet se fait, comment mon entreprise va-t-elle pouvoir intervenir sur ce chantier, etc.? C’était la question qu’il y a eu sur le débat de l’insertion territoriale." Monsieur de l'Andra, arrêtez de prendre les habitants de la région pour des imbéciles. De quel droit vous permettez vous de nous juger? Je suis sur que vous pourrez me confirmer que vous habitez en région parisienne. Non, les habitants de Meuse/Haute Marne, comme vous dites, vous demande si le coüt du stockage est de 15 milliards d'euros ou de 35 milliards d'euros?
Réponse du 08/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le chiffrage officiel arrêté par l’Etat en 2005 au stade des études de faisabilité scientifique et technique était d’environ 15 milliards d’euros. En 2009, l’Andra a réalisé une estimation préliminaire d’environ 35 milliards d’euros avant le lancement de la phase de conception industrielle et des optimisations en cours d’étude. Avant de finaliser un nouveau chiffrage, l’État a demandé à l’Andra de poursuivre les études permettant de prendre en compte les suites du débat public, les recommandations des évaluateurs et les pistes d’optimisation identifiées en 2013. Ce chiffrage sera finalisé par l’Andra en 2014. Conformément à la loi du 28 juin 2006, c’est le ministre chargé de l’énergie qui arrêtera l’évaluation des coûts et la rendra publique, après avoir recueilli les observations des producteurs de déchets radioactifs et l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire.
QUESTION 605 - Cout du premier investissement
Posée par Nolwenn G, L'organisme que vous représentez (option) (BREST), le 02/12/2013
Le 13 novembre, l'Andra a dit: "Les premiers travaux nécessaires afin de pouvoir mettre en service CIGEO, si CIGEO est autorisé, seraient de l’ordre de quelques milliards d’euros." C'est quoi les premiers travaux? Ils commencent quand, ils finissent quand? Est ce que l'Andra peut préciser ce que signifie "quelques milliards d'euros" En coût actualisé, cela fait combien?
Réponse du 08/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Si Cigéo est autorisé, la première tranche de travaux couvrira la réalisation des installations nécessaires à la mise en service du Centre et au démarrage de son exploitation. Elle comprendra en particulier la réalisation des installations de surface, des liaisons surface-fond (puits, descenderies) et les ouvrages en souterrain nécessaires au stockage des premiers colis de déchets à l’horizon 2025. L’estimation du coût de cette première tranche sera progressivement affiné et servira à définir le coût objectif pour la réalisation de cette première phase d’investissement. L’optimisation des coûts d’acquisition de la première tranche d’investissement est l’un des objectifs des études d’avant-projet.
Avant de finaliser un nouveau chiffrage, l’État a demandé à l’Andra de poursuivre les études permettant de prendre en compte les suites du débat public, les recommandations des évaluateurs et les pistes d’optimisation identifiées en 2013. Ce chiffrage sera finalisé par l’Andra en 2014. Conformément à la loi du 28 juin 2006, c’est le ministre chargé de l’énergie qui arrêtera l’évaluation des coûts et la rendra publique, après avoir recueilli les observations des producteurs de déchets radioactifs et l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire.
QUESTION 604 - Garantie décennale
Posée par joel LOUIS, L'organisme que vous représentez (option) (CULEY), le 01/12/2013
les installations à Bure que l'Andra fait construire en tant que maitre d'ouvrage bénéficient-elles de la garantie décennale? si oui même les installations souterraines?
Réponse du 11/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les ouvrages de surface que l’Andra a fait construire sur le site de Bure sont couverts par des assurances de responsabilité civile décennale en application des dispositions des articles L 241-1 et L 242-1 du code des assurances, afin de garantir les dommages définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil. Les ouvrages souterrains ne peuvent pas bénéficier de ce type d’assurance. Néanmoins, l’Andra a pris les dispositions nécessaires auprès de son contractant afin qu’il assume la responsabilité des dommages éventuels correspondants.
QUESTION 603 - Provisions des exploitants
Posée par Germaine KRIEGEL, L'organisme que vous représentez (option) (NANCY), le 30/11/2013
Dans son rapport de juillet 2012, la CNEF écrit: "On peut se demander si en attendant cette nouvelle étude destinée à clarifier la question des coûts, la prudence ne devrait pas conduire les producteurs à réviser en hausse leurs évaluations des provisions pour évoluer vers une moyenne entre les évaluations basses et hautes" Que voulait dire cette recommandation? Est ce que cette recommandation a été mise en oeuvre? Si non, pourquoi?
Réponse du 06/02/2014,
Réponse apportée par EDF :
EDF a provisionné, sous forme d’actifs dédiés, sa quote-part des coûts futurs de Cigéo, sur la base du chiffrage publié par le Ministère de l’Energie en 2005. 5,7 milliards d’euros ont été provisionnés à cet effet. Un nouveau chiffrage sera publié par le ministre en 2014, et EDF adaptera, si nécessaire, ses provisions en conséquence. Ce mécanisme permet de garantir que les coûts complets de Cigéo sont bien pris en charge dès maintenant par les consommateurs de l'électricité produite par les centrales nucléaires à l’origine des déchets qui y seront stockés. Aux côtés de l’Andra, EDF s’implique activement dans la recherche, sans aucun compromis sur la sûreté de court et de long terme, de l’optimisation technico-économique du futur ouvrage Cigéo : cette optimisation contribuera à la compétitivité de la production électronucléaire en France, au bénéfice des entreprises et des ménages français, qui payent aujourd’hui leur kWh deux fois moins cher que leurs voisins allemands.
Réponse apportée par AREVA :
Pour Cigéo, la procédure d’évaluation du coût du projet est définie dans la loi. Les exploitants évaluent les provisions afférentes en fonction du seul coût arrêté par le Ministère en charge de l’énergie. Ce coût a été arrêté en 2005 à l’issue des travaux mené par l’Etat, L’Andra et les exploitants ; les coûts de construction, d’exploitation et de fermeture du stockage avaient été estimés entre 13,5 et 16,5 milliards d’euros répartis sur plus de 100 ans. A l’intérieur de cette fourchette, les exploitants ont retenu un coût de référence de 14,1 milliards d’euros (conditions économiques janvier 2003) correspondant à une prise en compte prudente des aléas de réalisation des risques et opportunités. En tenant compte de l’inflation, cette estimation s’établit à environ 16,5 milliards d’euros aux conditions économiques de 2012. Ce montant demeure la seule référence pour calculer les charges futures et les provisions pour le stockage des déchets HA et MA-VL. Un processus d’échanges piloté par la DGEC est actuellement en place entre l’Andra et les exploitants destiné à affiner le chiffrage afin de prendre en compte les recommandations des évaluateurs ainsi que les modifications éventuelles qui seront apportées au projet suite au débat public. Sur cette base, il reviendra à l’Andra, qui est le maître d’ouvrage du projet, de proposer au Ministre une estimation affinée du coût du stockage. Lorsque le nouveau chiffrage, en cours de construction par l’ANDRA, et qui intègrera toutes les évolutions techniques et les optimisations par rapport au chiffrage de 2005, sera publié par le Ministre de l’Energie, AREVA ajustera si nécessaire les montants des provisions correspondants. Tout cela garantit qu’AREVA disposera bien des fonds voulus au moment voulu.
QUESTION 602 - Cout inermédiaire de Cigéo
Posée par F DD, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 30/11/2013
Dans le journal de l'Andra du printemps 2012 (n° 10, page 10), l'Andra indique: "le coût du Centre industriel de stockage géologique Cigéo a donné lieu à un chiffrage intermédiaire d’environ 35 milliards par l’Andra en 2009, incluant la construction, l’exploitation sur plus de 100 ans et la fermeture du stockage." Est ce que ce "chiffrage intermédiaire" a été provisionné par EDF et AREVA? Si non, pourquoi?
Réponse du 15/01/2014,
Réponse apportée par Edf, AREVA, et le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) :
Ce chiffrage réalisé par l’Andra avant le lancement de la phase de conception industrielle reposait sur des options techniques non figées et qui évoluent dans le cadre de la phase de conception industrielle en cours.
Pour Cigéo, la procédure d’évaluation du coût du projet est définie dans la loi. Les exploitants évaluent les provisions afférentes en fonction du seul coût arrêté par le Ministère en charge de l’énergie. Ce coût a été arrêté en 2005 à l’issue des travaux mené par l’Etat, L’Andra et les exploitants ; les coûts de construction, d’exploitation et de fermeture du stockage avaient été estimés entre 13,5 et 16,5 milliards d’euros repartis sur plus de 100 ans. A l’intérieur de cette fourchette, les exploitants ont retenu un coût de référence de 14,1 milliards d’euros (conditions économiques janvier 2003) correspondant a une prise en compte prudente des aléas de réalisation des risques et opportunités. En tenant compte de l’inflation, cette estimation s’établit a environ 16,5 milliards d’euros aux conditions économiques de 2012. Ce montant demeure la seule référence pour calculer les charges futures et les provisions pour le stockage des déchets HA et MA-VL. Un processus d’échanges piloté par la DGEC est actuellement en place entre l’Andra et les exploitants destiné à affiner le chiffrage afin de prendre en compte les recommandations des évaluateurs ainsi que les modifications éventuelles qui seront apportées au projet suite au débat public. Sur cette base, il reviendra à l’Andra, qui est le maître d’ouvrage du projet, de proposer au Ministre une estimation affinée du coût du stockage. Lorsque le nouveau chiffrage, en cours de construction par l’ANDRA, et qui intègrera toutes les évolutions techniques et les optimisations par rapport au chiffrage de 2005, sera publié par le Ministre de l’Energie, les exploitants EDF, le CEA et AREVA ajusteront si nécessaire les montants des provisions correspondants. Tout cela garantit que les exploitants disposeront bien des fonds voulus au moment voulu.
QUESTION 601 - Action de la CPDP
Posée par U MADEC, L'organisme que vous représentez (option) (CHAUMONT), le 30/11/2013
Monsieur le Président de la CPDP, Quand est ce que vous allez arrêter de vous faire cracher dessus par l'Andra? Quand est ce que vous allez reprendre la main sur ce débat majeur pour la France? Allez vous exiger de l'Andra qu'elle donne des éléments sérieux sur le cout du projet comme vous l'aviez promis au début du débat? Il se dit que vous avez accepté que l'Andra lance les études d'avant projet alors que le débat public n'est même pas fini. Est ce vrai? Si oui, lorsque vous racontiez que ce débat allait servir à quelque chose, qu'on discuterait de l'opportunité du projet: vous étiez sincère ou vous mentiez?
Réponse du 16/12/2013,
Le débat public doit permettre la participation du public au processus d’élaboration du projet et éclairer la décision du maître d’ouvrage. La CPDP veille à ce que les informations, opinions, argumentations soient étayées, claires et sincères. La CPDP ne prend pas position dans le débat mais s’engage à rendre compte de arguments échangés. Elle n’a pas à intervenir auprès du maître d’ouvrage pour autoriser des études, elle est neutre et respectueuse de toutes les opinions émises dans le respect des personnes.
QUESTION 600 - Evaluation du cout du stockage
Posée par Morgane LOUISIER, L'organisme que vous représentez (option) (LILLE), le 30/11/2013
Dans le dossier du maître d'ouvrage (page 90), l'Andra indique à propos de l'évaluation du coût: "Le ministère chargé de l'énergie souhaite arrêter une nouvelle évaluation fin 2013." Pourquoi l'Andra ne respecte pas les demandes du ministre de l'énergie? Pourquoi la CPDP accepte que l'Andra ne respecte pas ses engagements?
Réponse du 08/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le contrat d’objectifs Etat-Andra 2013-2016 demandait à l’Andra de proposer une nouvelle évaluation des coûts de stockage en 2013 qui « [prenne] en compte les modifications éventuelles apportées au projet par l’Andra suite au débat public ». Le débat public a été prolongé jusqu’au 15 décembre 2013. Les modifications apportées au projet seront décidées par l’Andra en 2014, après la publication du bilan et du compte-rendu du débat.
Avant de finaliser un nouveau chiffrage, l’État a demandé à l’Andra de poursuivre les études permettant de prendre en compte les suites du débat public, les recommandations des évaluateurs et les pistes d’optimisation identifiées en 2013. Ce chiffrage sera finalisé par l’Andra en 2014. Conformément à la loi du 28 juin 2006, c’est le ministre chargé de l’énergie qui arrêtera l’évaluation des coûts et la rendra publique, après avoir recueilli les observations des producteurs de déchets radioactifs et l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire.
QUESTION 599 - Etudes de conception
Posée par Armelle GUIVERC'H, L'organisme que vous représentez (option) (JOINVILLE), le 30/11/2013
Le 25 novembre, l'Andra publie un communiqué de presse sur son site internet intitulé "Poursuite des études de conception de Cigéo" C'est une blague? Non seulement il n'y a pas eu de véritables réunions publiques mais en plus l'Andra se fout de nous et ridiculise la CPDP. Comment l'Andra peut elle ensuite faire semblant et nous faire croire que rien n'est décidé? Comment la CPDP peut elle accepter une telle injure, un tel mépris sans le dénoncer publiquement? Comment la CPDP peut maintenant nous faire croire que ce débat aura servi à quelque chose? Comment la CPDP peut affirmer qu'elle est indépendante si elle accepte un tel affront? En fait, ce communiqué de l'Andra qui se félicite d'avoir lancé les études d'avant projet montre que non seulement ce débat est une mascarade mais aussi que l'Andra méprise la CPDP et que l'Andra n'éprouve même pas le besoin de la cacher.
Réponse du 16/12/2013,
Le débat public conformément aux articles L 121-1 et suivants organise la participation du public au processus d’élaboration des projets d’aménagement ou d’équipement d’intérêt national présentant de forts enjeux socio-économiques et des impacts significatifs sur l’environnement et l’aménagement du territoire. Le débat ne porte pas seulement sur les modalités de l’ouvrage mais sur son principe même, quelque soit l’état d’avancement des études préparatoires. La CPDP a constamment rappelé ces éléments et l’opportunité du projet fait d’ailleurs l’objet de nombreux questionnements sur le site du débat et est largement abordé dans les cahiers d’acteurs. La poursuite des études de conception de Cigéo s’inscrivent dans un processus interne à l’ANDRA qui a été chargée par la loi de présenter un projet industriel de stockage géologique en profondeur. Ces études n’engagent en rien les décisions qui seront prises par le gouvernement à l’horizon 2018.
QUESTION 598 - Cout de la R&D
Posée par Marie GRAROUBE, L'organisme que vous représentez (option) (COURBEVOIE), le 29/11/2013
A défaut d'avoir le coût du projet, l'Andra doit connaître le coût des études R&D et de conception du stockage d'ici la mise en service du stockage. Comment est ce? Combien coûte le labo de Bure jusqu'en 2030 date de sa fermeture? Est ce que vous pouvez nous certifier que ces coûts sont bien provisionnés par EDF, AREVA et le CEA? A quel niveau?
Réponse du 08/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Depuis le début des années 1990, 1,5 milliards d’euros ont été investis pour la recherche sur le stockage profond. Ces études et recherches sont financées par une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base. Elle est collectée par l'Autorité de sûreté nucléaire auprès des exploitants nucléaires concernés (Areva, CEA, EDF) et versée sur un fonds géré par l’Andra. Sur la période 2010-2012, cette taxe s’élevait à environ 118 millions d’euros par an. Ce budget couvre notamment les recherches menées au Laboratoire souterrain de Meuse Haute-Marne mais également toutes les études techniques et scientifiques menées dans le cadre du projet. Le dispositif de financement des études et recherches a été adapté dans le cadre du projet de loi de finances rectificative 2013, avec la création d’un fonds « conception » séparant les études nécessaires à la conception du fonds « recherche ». Ce fonds est également financé par les exploitants d’installations nucléaires. Le coût de la R&D et des études de conception d’ici la mise en service du stockage sera intégré dans la nouvelle évaluation des coûts du stockage que l’Andra remettra à l’Etat en 2014.
Réponse apportée par Edf :
Comme le prévoient les lois de 1991 et de 2006, EDF a provisionné, sous forme d'actifs dédiés, sa quote-part (80%) de toutes les charges de recherche, d'études, de construction, d'exploitation et de fermeture du futur stockage Cigéo. Les sommes ainsi mises de côté, sur la base du coût prévisionnel publié par l'Etat en 2005, s'élèvent actuellement à 5,7 milliards d'euros. Si nécessaire, ces provisions et les actifs dédiés correspondants seront ajustés, sur la base de la nouvelle évaluation du coût du stockage qui sera publiée par le Ministre en charge de l'énergie en 2014. Les coûts correspondants seront, comme c'est le cas pour les sommes déjà provisionnées, répercutés sur les factures des clients d'EDF.
Réponse apportée par AREVA :
AREVA provisionne sous forme d’actifs dédiés les dépenses relatives aux déchets radioactifs dont elle assume la responsabilité. Les provisions pour la gestion à long terme des colis de déchets radioactifs s’élèvent à 820 millions d’euros (au 31 décembre 2012). Ces provisions incluent notamment la quote-part AREVA (soit 5%) de toutes les charges de recherche, d'études, de construction, d'exploitation et de fermeture du futur stockage Cigéo.
QUESTION 597 - Cout et avancement du projet
Posée par Michel GROTOURE, L'organisme que vous représentez (option) (ORSAY), le 29/11/2013
Comment l'Andra peut elle clôturer les études d'esquisse et lancer l'APS sans connaître le coût du projet? Est ce que l'Andra peut nous donner le coût du projet, le chiffrage des optimisations, des risques et des aléas?
Réponse du 08/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Avant le lancement proprement dit des études d’avant-projet, une phase initiale de plusieurs mois est prévue pour optimiser le projet industriel et pour prendre en compte les modifications du projet qui découleraient du débat public.
Le travail d’études d’optimisation et de prise en compte des suites du débat public se poursuivra jusqu’à l’été 2014. Le processus d’arrêt d’une nouvelle évaluation par le ministre chargé de l’énergie comprendra ensuite une phase de consultation, avec le recueil de l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et des observations des producteurs de déchets, à l’issue de laquelle le ministre rendra publique la nouvelle estimation arrêtée par l’Etat.
L’évaluation des coûts qui sera proposée par l’Andra en 2014 au ministre chargé de l’énergie comprendra le chiffrage des optimisations, des risques et des aléas.
QUESTION 596 - Cout et contrat quadriennal
Posée par Roger GARENDIE, L'organisme que vous représentez (option) (CHATENAY-MALABRY), le 29/11/2013
Le contrat quadriennal de l'Andra prévoit comme objectif de proposer une nouvelle estimation du stockage en 2013 (objectif 1.3). Pourquoi l'Andra ne respecte pas une demande de 3 ministres (écologie, recherche et économie) ?
Réponse du 08/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le contrat d’objectifs Etat-Andra 2013-2016 demandait à l’Andra de proposer une nouvelle évaluation des coûts de stockage en 2013 qui « [prenne] en compte les modifications éventuelles apportées au projet par l’Andra suite au débat public ». Le débat public a été prolongé jusqu’au 15 décembre 2013. Les modifications apportées au projet seront décidées par l’Andra en 2014, après la publication du bilan et du compte-rendu du débat.
Avant de finaliser un nouveau chiffrage, l’État a demandé à l’Andra de poursuivre les études permettant de prendre en compte les suites du débat public, les recommandations des évaluateurs et les pistes d’optimisation identifiées en 2013. Ce chiffrage sera finalisé par l’Andra en 2014. Conformément à la loi du 28 juin 2006, c’est le ministre chargé de l’énergie qui arrêtera l’évaluation des coûts et la rendra publique, après avoir recueilli les observations des producteurs de déchets radioactifs et l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire.
QUESTION 595
Posée par BENOIT PIERRE, le 02/12/2013
L'ANDRA apporte sa réponse à la question de la géothermie, dans le bulletin n°6, tome 184, année 2013 de la société géologique de France (SGF): Lithologie, hydrodynamisme et thermicité dans le systême sédimentaire multicouche recoupé par les forages ANDRA de Montiers sur Saulx (Meuse), pp 519 à 543. A noter que sur cinq coauteurs, quatre appartiennent à l'ANDRA. Dans l'expertise judiciaire, l'expert est récusé s'il présente un lien quelconque avec une des parties. Ce ne semble pas le cas ici. Autre lieu, autre moeurs?
J'aimerais savoir par ailleurs quelles sont les analyses effectuées sur les prélèvements d'eau (balance ionique, éléments traces isotopes tels le C14 ou le deutérium, potassium-argon...) et, j'aimerais savoir si les profils sismiques présentés sont traités rapidement par méthode d'inversion ou par une technique autre, employée par exemple à l'Ecole centrale de Lille ou un bureau d'étude indépendant faisant retraiter des profils sismiques réflexion en Hongrie.
En dernier lieu, pourquoi l'ANDRA n'a pas poursuivi ses forages dans le permien sous-jacent indiqué aquifère, par le portail d'accès aux données pétrolières nationales , guichet hydrocarbures BEPH?
Pierre Benoit
Réponse du 12/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’article auquel vous faites référence est une publication scientifique. Comme toutes les publications scientifiques, celle-ci a été soumise au comité de lecture de la revue. Ce comité est indépendant de l’Andra.
Par cet article l’Andra ne fait que donner des informations factuelles sur ce forage de reconnaissance de 2 000 m de profondeur qui, rappelons-le, était le premier forage de cette profondeur permettant une étude très détaillée depuis le programme scientifique Géologie Profonde de la France il y a plus de 25 ans.
Concernant votre question sur les analyses
Les analyses effectuées sur les prélèvements d'eau dans les niveaux aquifères de l’Oxfordien, du Dogger et du Trias ont été les suivantes :
Espèces chimiques majeures : Na, Mg, Ca, K, CID, SO4 , Cl, Si, NO3 , Br, NH4
Espèces en traces : Al, F, Ba, Cs, U, As, Mn, Sr, PO4, Zn, Pb, Cr, Ag, Sn, Co, Cu, Ni, Li, I, Se, COD, Fe(II/III), Th, Gd, Nb, B, Mo, Zr, Rb, Eu
Gaz dissous et leurs isotopes : N2, O2, CO2, CH4 et autres gaz organiques, δ13C (gaz carbonés), δ2H (alcanes), δ15N (N2), CFC
Isotopes et abondance des gaz rares : He, Ne, Ar, Kr, Xe, 3He, 4He, 20Ne, 21Ne, 22Ne, 36Ar, 38Ar, 40Ar, 78Kr, 80Kr, 82Kr, 83Kr, 84Kr, 86Kr, 124Xe, 126Xe, 128Xe, 129Xe, 130Xe, 131Xe, 132Xe, 134Xe, 136Xe
Isotopes de l’eau et des espèces aqueuses : δ2H (H2O), δ18O (H2O), δ34S (SO4), δ18O (SO4), δ13C (CID), δ15N (NH4)
Isotopes Li et B, isotopes U/Th
Concernant votre question sur les profils sismiques
La campagne de sismique 2D réalisée par l’Andra en 2007, de 174 km au total, a couvert l’ensemble de la zone de transposition avec des prolongations de lignes à l’Est et à l’Ouest de la zone afin de reconnaître les structures tectoniques bordières.
Le maillage des lignes sismiques a été de 2 x 2 à 3 x 3 km. Des améliorations ont été apportées aux paramètres d’acquisition du signal sismique par rapport aux campagnes antérieures. Une trentaine de forages courts (dits « forages VT ») ont été réalisés afin de bâtir un modèle de corrections statiques qui prenne en compte la géologie de surface. Le retraitement des signaux sismiques a été réalisé par la société allemande DMR, entreprise spécialisée dans ce domaine. L’interprétation des profils sismiques a été confiée au BEICIP, filiale de l’IFPEN, organisme de recherche spécialisé notamment dans les méthodes de reconnaissance du sous-sol pour la prospection pétrolière. Le BEICIP a entre autres réalisé une inversion stratigraphique, c’est à dire à partir des paramètres sismiques mesurés en chaque point calculé la porosité de la roche, en utilisant les méthodes développées par l’IFPEN.
En 2010, 37 km2 de sismique réflexion en trois dimensions (3D) et à haute résolution (HR) associés à 11km de sismique 2D ont été réalisés par l’entreprise DMT sur la Zone d’Intérêt pour une Reconnaissance Approfondie (ZIRA).
Des carottages sismiques (21 forages courts) et des profils de sismique réfraction ont également été acquis pour permettre le développement d’un modèle géologique de sub-surface nécessaire au traitement des corrections statiques des données sismiques 2D/3D (neutralisation des effets de topographie et d’altération des couches superficielles sur la propagation des ondes sismiques). Ce modèle a été réalisé conjointement par Andra et Paradigm. Les autres phases de traitement (atténuation de bruit et augmentation du gain des signaux acoustiques, prise en compte des effets du pendage et sommation) ont été effectuées par Fugro Robertson Ltd, de même que l’interprétation structurale et l’inversion en paramètre élastique (impédance). Parallèlement, un travail d’interprétation ciblé sur des structures linéaires détectées en sismique 3D a été entrepris en 2011 par Beicip-Franlab et associé à un contrôle géologique sur le terrain par Cambridge Carbonates. Des travaux complémentaires d’inversion stratigraphique ont été confiés au Beicip Franlab afin d’optimiser la conversion en paramètres pétro-physiques. La conversion temps/profondeur a été renouvelée par Seisquare en mars 2012, en construisant un modèle de vitesses « géologiques » robustes à partir des données de forage et en utilisant un procédé géostatistique de krigeage bayésien multi-variable.
Concernant votre questions sur la profondeur du forage
Le forage EST433 a fait partie d’une campagne de reconnaissance, comprenant 12 forages et des profils de sismique réflexion 2D, réalisée en 2007 et 2008 avec pour objectifs :
- Apporter les données permettant d’appréhender les variations éventuelles de la couche du Callovo-Oxfordien en support à la proposition d’une ZIRA,
- Compléter la connaissance sur les écoulements et des transferts dans les formations sus- et sous-jacentes à la couche,
- Caractériser les formations profondes (Lias et Trias), tant du point de vue de leur impact sur les transferts globaux que de leur potentiel géothermique.
Ce forage a été approfondi jusqu’à 2000 m pour répondre à ce dernier objectif. Il a accueilli aussi un programme de recherche multidisciplinaire et multi-organismes (Universités, CNRS, IFPEN, BRGM, IRSN) dont la thématique était « Transferts actuels et passés dans un système sédimentaire aquifère – aquitard : un forage de 2000 mètres dans le Mésozoïque du Bassin de Paris (TAPSS) » (voir annexe 2) : 22 laboratoires y ont participé.
L’ensemble des éléments relatifs à l’étude du potentiel géothermique a été transmis au CLIS, et que l’expert mandaté par celui-ci a eu connaissance du programme de tests en amont de la réalisation du forage.
QUESTION 594
Posée par Maurice MICHEL, le 02/12/2013
Maurice MICHEL – ASODEDRA – Le 29 novembre 2013
Questions posées [notamment] à l’Andra, et, (s’ils ne sont pas lassés de jouer leur rôle de contradicteurs indépendants) à Messieurs Benjamin DESSUS et Bernard LAPONCHE experts de Global Chance ainsi qu’à Monsieur Jean-Marie BROWN, universitaire.
----------------------
« /…/ Ne nous voilons pas la face ! Nous le disons et nous le répétons : un stockage profond de déchets radioactifs ne sera vraiment sûr à long terme que dans la mesure où il sera fermé définitivement /…/»
[Interview de Mme Marie-Claude DUPUIS, directrice générale de l’Andra, paru dans l’Est Républicain Meuse du 16 décembre 2010]
« Pour ne pas laisser aux générations futures la responsabilité de la gestion des déchets radioactifs, les centre de stockage sont conçus pour être fermés et rester sûrs sans qu’aucune intervention humaine ne soit nécessaire »
-------------------------
Nous avons compris que les experts de l’Andra considèrent – comme nombre de ceux issus de l’industrie nucléaire et de ses satellites institutionnels- que la sûreté du site de Bure implique qu’il soit définitivement fermé à l’issue d’une période temporaire de réversibilité de l’ordre de 100/120 ans. Pour conforter sa position, l’agence invoque la loi de 2006, elle estime qu’il n’est pas convenable de reporter la charge de la gestion des déchets nucléaires sur les générations suivantes et qu’il est préférable de faire plus confiance à la géologie qu’à la société.
Cette position a pour effet de priver à jamais les générations postérieures à la période réversibilité de leur capacité de décision. Il leur sera en effet interdit de revenir sur le stockage profond, si elles le souhaitent, notamment dans l’hypothèse où des progrès scientifiques et technologiques venaient à offrir de nouvelles possibilités. Mais aussi, en cas de changement de paradigme éthique, lorsqu’il sera communément admis que laisser aux générations futures le soin de faire elles-mêmes les choix qui les engagent est un principe général de même nature sociétale que celui du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Dés 2005, en marge du débat public ouvert à cette époque, des chercheurs relevant de différentes sciences et disciplines du monde académique ont confronté leurs points de vue dont la synthèse a été publiée en février 2006 [C E N T R E NATIONAL DE L A R E C H E R C H E SCIENTIFIQUE - C A H I E R S - Risques Collectifs et Situations de Crise - N°5 - FÉVRIER 2006 - Recherche et déchets nucléaires, Une réflexion interdisciplinaire, Axe Risques et Crises Collectifs, Avec le soutien du Programme sur l'Aval du Cycle Électronucléaire (PACE) du CNRS, PUBLICATIONS DE LA MSH-ALPES. Les thèmes traités au cours du séminaire figurent dans le sommaire ci-après :
SOMMAIRE
Avant-propos 7
Note introductive
L a gestion des déchets nucléaires : le contexte français 11
1 - Faut-il retraiter les combustibles usés ? 17
2 - Le stockage géologique est-il incontournable ? 25
3 - L a réversibilité : un trompe-l'œil ? 33
4 - L a transmutation :
une palette de solutions sérieusement explorées ? 41
5 - Une "recherche ouverte" sur les déchets :
une nécessité, un alibi ou une gêne ? 49
6 - Faut-il un débat public sur les déchets nucléaires ?
Quel est le lien avec la décision ? 59
7 - L a "peur du public" ou la peur du public ? 71
8 - Peut-on débattre des déchets nucléaires indépendamment
des choix de filières nucléaires ? 81]
Huit ans après, les réflexions de ces scientifiques n’ont pas pris une ride. Nous en avons extrait ci-après quelques lignes des pages 29, 36 et 31 tirées du thème « le stockage géologique est-il incontournable ?». Nous avons souligné les questions que nous souhaitons poser à nos interlocuteurs :
« Le stockage géologique profond : une solution qui ferme l'avenir
En dépit de l'affirmation du concept de "stockage géologique
réversible", le dépôt des déchets radioactifs dans des couches géolo-
giques profondes est fondamentalement une solution irréversible (cf.
infra question 3). Ce type de stockage, qui doit permettre d'organiser
"l'oubli" des déchets, est fondé sur un certain nombre d'hypothèses,
assez largement partagées dans le cercle des acteurs et des scienti-
fiques concernés par ces questions. Elles peuvent surprendre et n'ont
pas manqué de susciter des réactions parmi les chercheurs en sciences
humaines et sociales participant au séminaire.
D'une part, le stockage géologique profond repose sur l'idée
que les générations futures n'auront aucun intérêt à "reprendre" ces
déchets ni ne seront pas mises en contact sous une forme ou sous une
autre avec ces déchets. Or cette hypothèse est discutable.
D'autre part, de façon liée, le stockage géologique profond re-
pose sur l'idée que les générations futures n'auront pas de solution
plus intéressante à faire valoir dans le cadre du traitement des déchets.
Il est curieux que cette hypothèse soit avancée par des scientifiques
dans la mesure où elle traduit un pessimisme radical à l'égard du pro-
grès des connaissances, et plus généralement à l'égard de l'évolution
des sociétés humaines. D'autant que c'est l'argument exactement in-
verse qui est avancé pour ne pas mettre dès à présent un frein aux
atteintes à l'environnement qui menacent l'avenir de la planète. C'est
une vision pessimiste, voire catastrophiste du futur, qui transparaît en
tout cas dans les justifications du stockage géologique profond dont
l'intérêt serait précisément, de ce point de vue, de "fermer l'avenir".
Mais, là encore, l'hypothèse de l'incapacité des générations futures à
trouver d'autres solutions techniques ou. à défaut, à surveiller un en-
treposage en surface ou en subsurface de déchets, est une hypothèse
discutable et qui, en tout cas, ne peut guère être validée.
Finalement, la justification ultime du stockage géologique pro-
fond repose sur l'idée que, sur les échelles de temps considérées, la
nature, en l'occurrence les couches géologiques profondes, est plus
fiable que la société et que les capacités technologiques humaines. Et,
de fait, le débat à propos des déchets nucléaires, au-delà de la techni-
cité des argumentations, peut souvent être ramené à cette question
simple : faut-il croire au progrès et aux capacités de l'homme d'assu-
rer ce progrès, ou faut-il y renoncer et s'appuyer sur le déjà-là, à savoir
la nature et ses capacités de protection ?
En conclusion
L'option du stockage géologique profond, en raison de son ap-
parente évidence et simplicité, du consensus dont elle fait l'objet dans
le cercle des décideurs et des experts (y compris internationaux), est
présentée comme la solution aux problèmes des déchets nucléaires
(ceux-ci étant habituellement appréhendés de manière globale).
Cette option, par ses caractéristiques propres, tend à emporter
la décision. Elle crée même une situation d'urgence dès lors qu'elle
apparaît comme le moyen (et même l'unique moyen) techniquement
sûr de régler la question des déchets. De façon liée, cette option ferme
de nombreuses interrogations, et penser une alternative devient diffi-
cile, d'autant plus que toute alternative tend à apparaître, face à l'affir-
mation de la robustesse de cette solution, comme une spéculation.
Pourtant, la question de l'urgence à décider est toute relative.
Cette urgence se comprend surtout à travers la volonté de "régler le
problème", d'introduire une solution proche qui ferme (ou tout au moins
limite) les débats techniques, scientifiques et, ainsi faisant, les débats
sociaux et politiques. Soustraire les déchets nucléaires à l'attention
publique via la solution du stockage profond ne serait-il pas l'une des
principales raisons de l'urgence habituellement évoquée ? Or, il est
probable qu'une fois la décision prise, une longue période d'attente
(au moins 50 ans) s'instaure, tant pour des raisons techniques, scienti-
fiques que strictement économiques. C'est d'ailleurs ce qui est envi-
sagé à propos du démantèlement des centrales nucléaires arrivées en
fin de vie. Une telle période d'attente, inscrite dans les modalités même
de gestion, rend a priori possible de maintenir "ouverts" les débats.
D'autre part, il est évident qu'en rendant urgente la décision de stoc-
ker, on se prépare à stocker ainsi tout ce qui est actuellement vitrifié,
c'est-à-dire les actinides mineurs (les plus radiotoxiques) comme les
produits de fission.
L'examen de la solution actuellement privilégiée conduit donc à
s'interroger dans les termes suivants : souhaite-t-on, à travers une vision
simplifiée du stockage géologique profond, régler une fois pour toute
le problème des déchets nucléaires ou plutôt affirmer qu'il est réglé ? »
Réponse du 09/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de ces déchets. Grâce à la réversibilité, ces générations garderont la possibilité de faire évoluer cette solution. L’Andra propose ainsi que des rendez-vous réguliers soient programmés pendant une centaine d’années pour faire le point sur l’exploitation du stockage et préparer les étapes suivantes. Ces rendez-vous seront notamment alimentés par les résultats des recherches qui continueront à être menées sur la gestion des déchets radioactifs et les avancées technologiques. A chaque étape, il sera possible de décider de poursuivre le processus de stockage tel qu’initialement prévu ou de le modifier, par exemple si des solutions alternatives sont identifiées.
Réponse de MM Benjamin Dessus, Bernard Laponche et Jean-Marie Brom :
Une partie des gens qui travaillent sur le projet CIGEO ou dans des équipes de recherche ou de contrôle sur ces questions de gestion des déchets pensent sincèrement que l’enfouissement en profondeur de ces déchets (au moins une partie d’entre eux) est la meilleure solution. Certains connaissent le doute, surtout lorsqu’ils ont étudié de près le projet mais s’en expriment rarement. D’autres, les plus nombreux sans doute, s’alignent sur cette position en faveur de la solution et du projet parce que c’est celle de leur entreprise et ils ne cherchent pas plus loin.
Par contre, il est clair que dans l’esprit des dirigeants des entreprise nucléaires productrices de ces déchets, comme des responsables politiques qui leur sont liés, l’enfouissement à grande profondeur dans la croûte terrestre a pour première vertu de « faire disparaître les déchets », ce qui leur permettrait de dire que « le problème des déchets nucléaires est réglé ». Ils y voient même d’intéressantes perspectives à l’exportation.
D’où la pression pour précipiter les décisions, alors que bien des problèmes restent en suspens, demandent des études et des démonstrations supplémentaires (qui prendront un certain temps), notamment sur les risques d’accident. La solution raisonnable serait, sur un tel sujet, de « prendre son temps ».
Bien évidemment, en plus de cette pression des producteurs de déchets, essentiellement pour des motifs de « communication », s’exerce celle des entreprises de travaux publics et autres aménagements et matériels (très onéreux) qui considèrent comme une manne inespérée l’immense chantier que représente CIGEO. Tous se pressent à la queue des appels d’offre.
Afin de mieux connaître nos positions sur l’ensemble de la problématique des déchets et matières nucléaires et du projet CIGEO, vous pouvez consulter les deux cahiers d’acteur de l’association Global Chance sur le site de la CPDP, ainsi que le numéro 34 des Cahiers de Global Chance (« Le casse-tête des matières et déchets nucléaire ») sur le site www.global-chance.org.
QUESTION 593 - sécurité geologique du site
Posée par robert CLAR, L'organisme que vous représentez (option) (SAINT MANDÉ), le 28/11/2013
Existe t il dans le monde une mine en exploitation depuis plus de 50 ans et creusée dans de l'argile plus ou moins identique a celle du site? Quelle est l'évaluation de la quantité de chaleur dégagée par les colis enfouis quand le site sera plein au 3/4? Cette chaleur pourra t elle craqueler la couche d'argile et ainsi permettre aux nucléides gazeux de s'echapper?
Réponse du 20/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les considérations d’exploitation propres à une mine sont différentes de celles d’un stockage, de sorte que les analogies avec le stockage sont difficiles à mener et souvent non pertinentes. En effet, une exploitation minière a pour objectif d’extraire un maximum les substances minières intéressantes. A l’inverse, le but du stockage est de préserver au maximum le milieu géologique qui servira de barrière naturelle pour confiner les substances radioactives. En outre, les milieux argileux exploités sont généralement en surface ou proches de la surface ; en profondeur, les milieux argileux sont plutôt des milieux traversés pour atteindre les milieux exploités.
Dans le stockage, la chaleur dégagée par les déchets de haute activité s’évacuera majoritairement dans la roche. Des expérimentations thermiques ont été réalisées au Laboratoire souterrain pour valider les paramètres thermiques de la roche. Cigéo est conçu pour que la température dans la roche reste inférieure à 100 °C. De manière enveloppe, l’Andra retient même une température de 90°C. Cela repose notamment sur l’espacement entre les alvéoles de stockage et sur la limitation de la puissance thermique des déchets stockés (la puissance thermique d’un colis de déchets vitrifiés de haute activité, de l’ordre de 2 000 watts moment de sa fabrication, ne sera stocké que lorsque sa puissance thermique sera descendue en dessous 500 watts, au bout de plusieurs dizaines d’années.
Associées à la forte capacité de rétention de l’eau par les argilites et aux pressions d’eau dans la couche du callovo-Oxfordien, les élévations de température générées par le stockage ne sont pas susceptibles de craqueler la couche d’argile. Ceci est montré dans les essais simulant le dégagement de chaleur d’alvéole menés au laboratoire souterrain, au cours desquels les déformations de la roche et les pressions hydrauliques ont été mesurées tant pendant la montée en température qu’au cours du refroidissement.
QUESTION 592
Posée par STOP-EPR, le 28/11/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de STOP-EPR :
Comment se fait-il qu’au bout de vingt années, la France ait renoncé à la plupart des possibilités définies par la Loi Bataille pour se concentrer principalement sur le stockage en couche géologique profonde des déchets de haute activité ?
Réponse du 09/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
Les résultats des 15 années de recherches menées sur la gestion des déchets les plus radioactifs dans le cadre de la loi « Bataille » de 1991 ont montré que :
- La séparation-transmutation ne supprime pas la nécessité d’un stockage profond car elle ne serait applicable qu’à certains radionucléides contenus dans les déchets (ceux de la famille de l’uranium, appelés les actinides mineurs). Par ailleurs, les installations nucléaires nécessaires à la mise en œuvre d’une telle technique produiraient des déchets qui nécessiteraient aussi d’être stockés en profondeur pour des raisons de sûreté.
- L’entreposage de longue durée, qu’il soit en surface ou en subsurface, ne peut assurer le confinement à long terme de la radioactivité. Il ne constitue donc pas une solution de gestion définitive et reporte la charge de la gestion des déchets radioactifs sur les générations futures. Dans son avis du 1er février 2006, l’Autorité de sûreté nucléaire a notamment appelé l’attention sur le fait que l’entreposage de longue durée supposerait le maintien d’un contrôle de la part de la société et la reprise des déchets par les générations futures, ce qui semble difficile à garantir sur des périodes de plusieurs centaines d’années.
- Le stockage profond permet de mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs. A l’inverse de l’entreposage, cette solution permet de mettre en place une protection pour le très long terme. Les générations suivantes auront la possibilité de contrôler sa mise en œuvre grâce à la réversibilité. Dans son avis du 1er février 2006, l’Autorité de sûreté nucléaire a estimé que des résultats majeurs relatifs à la faisabilité et à la sûreté d’un stockage avaient été acquis sur le site de Bure et a identifié les points à approfondir pour établir le dossier de sûreté qui serait à associer à une éventuelle demande de création d’une installation de stockage.
Dans le cadre de la loi de programme du 28 juin 2006, le Parlement a fait le choix de la solution du stockage profond pour mettre en sécurité définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter leur charge sur les générations futures. Le Parlement a demandé que le stockage soit réversible pendant au moins 100 ans pour laisser des choix aux générations suivantes. Cela leur permettra notamment de faire évoluer cette solution si elles le souhaitent (par exemple si des progrès scientifiques et technologiques futurs venaient à offrir de nouvelles possibilités). Le Parlement a demandé à l’Andra de poursuivre les études et recherches en vue de remettre en 2015 le dossier support à l’instruction de la demande d’autorisation de création du stockage.
Le Parlement a également décidé la poursuite des études et recherches sur l’entreposage et la séparation-transmutation, en complémentarité avec le stockage. Le bilan des études menées par l’Andra sur l’entreposage et par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives sur la séparation-transmutation sont disponibles sur le site du débat public :
../docs/decisions/Rapport-2012-Andra-entreposage.pdf
../docs/decisions/dossier-CESA-separ-transmut/Tome-2.pdf
QUESTION 591
Posée par STOP-EPR, le 28/11/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de STOP-EPR :
Pouvons-nous raisonnablement courir un tel risque d’accident nucléaire dans l’Est de la France ?
Réponse du 09/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Cigéo n’est pas une centrale nucléaire mais un centre de stockage de déchets radioactifs (stabilisés et conditionnés dans des fûts en béton ou en acier) qui du fait de son implantation à 500 mètres de profondeur sera peu vulnérable aux activités humaines comme aux catastrophes naturelles. L’unique objectif du stockage profond est justement de protéger l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets radioactifs.
Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels montre que leurs conséquences resteraient limitées, et nettement en deçà du seuil réglementaire qui imposeraient des mesures de protection des populations (mise à l’abri, évacuation).
Cigéo doit répondre aux règles de sûreté définies par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). La création du stockage ne pourra être autorisée que si l’Andra démontre sa sûreté et la maîtrise de tous les risques. La mise en service de Cigeo sera également soumise à l’autorisation de l’ASN. Des réexamens de sûreté seront ensuite réalisés périodiquement (tous les dix ans au moins), pendant toute la durée son exploitation. Si l’ASN considère qu’un risque n’est pas maîtrisé correctement, elle peut imposer des prescriptions supplémentaires voire mettre à l’arrêt l’installation.
QUESTION 590
Posée par STOP-EPR, le 28/11/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de STOP-EPR :
La récupérabilité que prétend garantir l’Andra, sans toutefois le démontrer, permettra-t-elle de remonter des déchets en cas d’accidents souterrains
Réponse du 09/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La sûreté de l’installation doit être acquise indépendamment de la réversibilité. Si un accident devait survenir, l’installation sera mise en sécurité par la pose rapide d’équipements provisoires (ventilation, barrière de confinement…) et non par une opération de retrait de colis. Une fois la mise en sécurité réalisée, l’exploitant examinera les dispositions à mettre en œuvre pour reprendre l’exploitation normale en tout sûreté. Le maintien en stockage de colis, même endommagés, ou leur retrait éventuel pourra être décidé sans caractère d’urgence. S’il était décidé de retirer un grand nombre de colis du stockage, des installations spécifiques seraient alors à construire en surface pour les gérer (pour leur entreposage, leur réexpédition, leur traitement…). Toute opération notable de retrait de colis de déchets devra faire l’objet d’une autorisation spécifique.
Pour plus d’informations sur les propositions de l’Andra en matière de réversibilité : http://www.cigéo.com/images/cigeo/site/pdf/499.pdf
QUESTION 589 - risques
Posée par charline PARBEAU, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 04/12/2013
Quel pourrait être le pire accident dans Cigéo ?
Réponse du 06/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le pire événement redouté serait la dispersion incontrôlée de radioactivité, quelle qu’en soit la cause. L’objectif même de Cigéo est de protéger l’homme et l’environnement contre ce risque.
Selon le principe de défense en profondeur, pour éviter toute dispersion incontrôlée, l’objectif dès le début de la conception de Cigéo est d’identifier l’ensemble des défaillances et des agressions potentielles d’origine interne (chute, collision, incendie, explosion…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourrait remettre en cause le confinement des colis de stockage. Pour chaque défaillance et agression, l’Andra met en place un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles. Ainsi, conformément à la demande formulée par l’Autorité de sûreté nucléaire, l’Andra conçoit Cigéo de sorte que l’on puisse exclure un accident de grande ampleur, comme l’incendie d’un grand nombre de colis dans une alvéole.
Malgré ces dispositions, selon le même principe de défense en profondeur, les situations accidentelles sont envisagées, pour vérifier que les conséquences en termes radiologiques restent limitées. Au stade actuel de la conception et de l’analyse des risques, les accidents les plus significatifs qui pourraient conduire à une dispersion de la radioactivité sont la chute d’un colis de déchets, une collision ou un départ de feu sur un engin de transfert transportant un colis. Cela s’explique par la nature des activités nucléaires de Cigéo qui sont principalement de la manipulation de colis de déchets.
Ainsi, la situation la pire en termes de conséquences proviendrait de l’accumulation des nombreuses défaillances successives suivantes :
- un départ de feu malgré la minimisation des matériaux inflammables dans l’installation,
- une détection tardive du fait d’une défaillance du réseau de surveillance,
- un système d’extinction inopérant,
- une intervention des pompiers retardée ou empêchée, malgré la présence d’engins de secours disposés dans l’installation,
- la perte de confinement d’un colis de déchets malgré la protection apportée par le conteneur de stockage.
Ceci engendrerait alors un rejet incontrôlé de particules radioactives à l’extérieur de Cigéo. L’évaluation réalisée, à ce stade de la conception, de l’impact d’un tel scénario hautement improbable montre que ses conséquences resteraient limitées, et nettement en deçà du seuil réglementaire qui impose la mise à l’abri des populations (10 millisieverts).
QUESTION 588
Posée par STOP-EPR, le 28/11/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de STOP-EPR : Pourquoi vouloir en France persévérer dans une voix périlleuse et hors de prix ? Qu’en sera-t-il à Cigéo avec des déchets hautement radioactifs et très chauds ?
Réponse du 27/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
En France et à l’étranger, le stockage profond est considéré actuellement comme la solution la plus sûre et la plus durable en tant qu’étape finale de la gestion des déchets les plus radioactifs (voir par exemple la directive européenne du 19 juillet 2011 ainsi que le débat du 23 septembre 2013 sur la comparaison des expériences internationales). Le stockage ne fait pas disparaître les déchets radioactifs, mais il permet de ne pas reporter leur charge sur les générations futures en leur donnant la possibilité de les mettre en sécurité de manière définitive.
Notre génération a la responsabilité de mettre en place des solutions de gestion sûres pour les déchets radioactifs produits depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Le but étant de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Si Cigéo est autorisé, il donnera ainsi la possibilité aux générations suivantes de mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs. La réversibilité leur permettra également de faire évoluer cette solution si elles le souhaitent.
Pour que le projet puisse être autorisé, l’Andra doit démontrer à l’Autorité de sûreté nucléaire qu’elle maîtrise les risques liés à l’installation, que ce soit pendant son exploitation ou après sa fermeture. Ainsi, conformément au principe de défense en profondeur, tous les dangers potentiels qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation sont identifiés en amont de la conception. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels montre que leurs conséquences resteraient limitées, et nettement en deçà des normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire.
QUESTION 587
Posée par FEDERATION DU PCF DE LA MEUSE, le 28/11/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de la Fédération du PCF de la Meuse :
Comment pouvons-nous affirmer dans le même temps, la complémentarité entre les solutions d’entreposage et de transmutations et celle du stockage et empêcher à la fois toute récupérabilité des déchets ?
Réponse du 20/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le stockage est conçu pour être réversible. Pendant tout sa durée d’exploitation il sera donc possible de récupérer des colis de déchets stockés si nécessaires.
Le Parlement a en effet demandé à l’Andra que le stockage soit réversible pendant au moins 100 ans pour laisser des portes ouvertes aux générations qui nous succéderons et la possibilité de faire évoluer cette solution si elles souhaitent. L’Andra place cette demande de la société au cœur du projet. Elle a ainsi fait des propositions concrètes pour pouvoir récupérer les colis de déchets si besoin et laisser des choix possibles aux générations suivantes. Dans le cadre de la réversibilité, l’Andra propose d’organiser des points de rendez-vous réguliers qui permettront notamment de suivre les avancées des recherches sur la gestion des déchets radioactifs. Si d’autres solutions étaient découvertes dans le futur, les générations concernées pourront décider de faire évoluer leur politique de gestion des déchets.
Les conditions de réversibilité seront définies par une future loi avant que la création de Cigéo ne puisse être autorisée. Pendant au moins 100 ans, les générations suivantes pourront contrôler le déroulement du stockage et récupérer les déchets si elles le souhaitent. En fonction de l’expérience acquise lors de l’exploitation de Cigéo, elles pourront décider de commencer la fermeture par étapes du stockage. Après une centaine d’années d’exploitation, si elles décident de fermer définitivement le stockage, la sûreté sera assurée de manière passive, sans nécessité d’action humaine.
Pour en savoir plus sur les propositions faites par l’Andra en matière de réversibilité du stockage, voir : ../docs/rapport-etude/fiche-reversibilite-cigeo.pdf
QUESTION 586
Posée par AUXON-DIT-NON, le 28/11/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de AUXON-dit-NON :
Un plan de communication de crise est-il déjà prévu pour contrer la dégradation de l’image de la région ou du Champagne, suite à une campagne médiatique d’envergure ?
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
Cigéo est conçu pour protéger l’Homme et l’environnement. L’impact du centre en termes de radioactivité sera très inférieur à celui de la radioactivité naturelle et n’aura donc aucun impact sur la qualité des productions agricoles. L’Andra a créé l’Observatoire pérenne de l’environnement, qui a pour mission d’assurer un suivi détaillé de l’évolution de l’environnement du stockage. Cela permettra de lever ainsi toute inquiétude en démontrant que le stockage n’a pas d’impact sur les activités agricoles de proximité. Cet observatoire labellisé s’inscrit dans un grand nombre de réseaux scientifiques nationaux ou internationaux.
La mise à disposition régulière, auprès du public et des acteurs locaux, des résultats des mesures effectuées dans l'environnement permettra aussi de prévenir ou de répondre à une campagne médiatique éventuelle. En effet ces mesures permettront de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité et donc de démontrer l'absence d'impact du stockage sur les activités agricoles. Par ailleurs, le cas échéant, des mesures indépendantes pourront être diligentées par l’Autorité de sûreté nucléaire ou la Commission locale d’information pour confirmer les résultats.
Par ailleurs, le retour d’expérience de la présence de l’Andra dans l’Aube depuis 20 ans montre que l’implantation d’un centre de stockage de déchets radioactifs n’est en aucun cas incompatible, même en termes d’image, avec des activités agricoles de premier choix (lait, viande, légumes, viticulture...). L'industrie et l’agriculture ont toujours coexisté et de nombreuses installations industrielles y compris nucléaires sont installées en France à proximité de zones de production agricoles dont des zones géographiques protégées ou encore des zones d'appellation contrôlée.
QUESTION 585
Posée par AUXON-DIT-NON, le 28/11/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de AUXON-dit-NON :
A-t-on estimé à sa juste valeur les impacts d’un tel projet dans l’économie non pas départementale, mais régionale ? Est-il possible de s’assurer et de prouver la neutralité de ce projet sur l’activité économique de la région ? Quel est le montant du fond prévisionnel de compensation de l’ANDRA ou de l’Etat en faveur des acteurs économiques de la région qui seront probablement touchés en suivant cette analyse ? Est-ce qu’un fond de procédure et d’expertise est provisionné si des sociétés comme LVMH ou Bongrain devaient déposer des recours pour atteinte et dégradation à l’encontre de l’image de leurs marques ?
Réponse du 07/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Si Cigéo est autorisé, il constituera un projet industriel structurant pour le territoire. Entre 1 300 et 2 300 personnes travailleront à la construction des premières installations de Cigéo. Après la mise en service du Centre, entre 600 et 1 000 personnes travailleront de manière pérenne sur le site. Cigéo contribuera au développement de l’activité des entreprises locales et, grâce à la garantie d’une activité sur plus d’un siècle, certaines entreprises feront très vraisemblablement la démarche de s’implanter localement, créant à leur tour une activité nouvelle sur le territoire. L’Andra mène depuis plusieurs années une politique volontariste visant le développement des relations avec le tissu économique local. En 2011, les deux régions ont émis 10 % du montant total des facturations (HT) liées au projet Cigéo. Cela représente une collaboration avec plus de 250 établissements locaux (publics ou privés), implantés pour 60 % d’entre eux en Lorraine et 40 % en Champagne-Ardenne. Les départements de Meuse et de Haute-Marne regroupent chacun 30 % du total des établissements concernés.
Cigéo est conçu pour protéger l’Homme et l’environnement. L’impact du centre en termes de radioactivité sera très inférieur à celui de la radioactivité naturelle et n’aura donc aucun impact sur la qualité des productions agricoles. L’Andra a créé l’Observatoire pérenne de l’environnement, qui a pour mission d’assurer un suivi détaillé de l’évolution de l’environnement du stockage. Cela permettra de lever ainsi toute inquiétude en démontrant que le stockage n’a pas d’impact sur les activités agricoles de proximité. Cet observatoire labellisé s’inscrit dans un grand nombre de réseaux scientifiques nationaux ou internationaux. Par ailleurs, le retour d’expérience de l’implantation de l’Andra dans l’Aube depuis 20 ans montre que l’implantation d’un centre de stockage de déchets radioactifs n’est en aucun cas incompatible, même en termes d’image, avec des activités agricoles de premier choix (lait, viande, légumes, viticulture...). L'industrie et l’agriculture ont toujours coexisté et de nombreuses installations industrielles y compris nucléaires sont installées en France à proximité de zones de production agricoles dont des zones géographiques protégées ou encore des zones d'appellation contrôlée.
QUESTION 584
Posée par AUXON-DIT-NON, le 28/11/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de AUXON-dit-NON :
Comment pourrons-nous contrer, dans l’actuel contexte de globalisation, cette association d’image quand, en 2006, dans l’Ain, un élevage de dindes touché par la grippe aviaire provoquait un embargo international de 43 pays hors Europe sur le foie gras français ?
Réponse du 08/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
Cigéo est conçu pour protéger l’Homme et l’environnement. L’impact du centre en termes de radioactivité sera très inférieur à celui de la radioactivité naturelle et n’aura donc aucun impact sur la qualité des productions agricoles. L’Andra a créé l’Observatoire pérenne de l’environnement, qui a pour mission d’assurer un suivi détaillé de l’évolution de l’environnement du stockage. Cela permettra de lever ainsi toute inquiétude en démontrant que le stockage n’a pas d’impact sur les activités agricoles de proximité. Cet observatoire labellisé s’inscrit dans un grand nombre de réseaux scientifiques nationaux ou internationaux. Par ailleurs, le retour d’expérience de la présence de l’Andra dans l’Aube depuis 20 ans montre que l’implantation d’un centre de stockage de déchets radioactifs n’est en aucun cas incompatible, même en termes d’image, avec des activités agricoles de premier choix (lait, viande, légumes, viticulture...). L'industrie et l’agriculture ont toujours coexisté et de nombreuses installations industrielles y compris nucléaires sont installées en France à proximité de zones de production agricoles dont des zones géographiques protégées ou encore des zones d'appellation contrôlée.
QUESTION 583
Posée par CHAMBRE D'AGRICULTURE DE HAUTE-MARNE, le 28/11/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de la Chambre d'Agriculture de Haute-Marne : Enfin la profession agricole se questionne sur l’obligation de la réversibilité du site, s’agit-il d’obéir à une obligation réglementaire en s’outillant pour assurer le retrait des colis pendant 100 ans ou s’agit-il d’une réelle préoccupation de l’ANDRA de pouvoir récupérer les colis à quelque échéance qu’il soit et, si tel était le cas, pour quel devenir ?
Réponse du 27/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de ces déchets. Grâce à la réversibilité, les générations suivantes garderont la possibilité de faire évoluer cette solution si elles le souhaitent. L’Andra place cette demande de la société au cœur du projet. Elle a ainsi fait des propositions concrètes pour pouvoir récupérer les colis de déchets si besoin et laisser des choix possibles aux générations suivantes (../docs/rapport-etude/fiche-reversibilite-cigeo.pdf) :
1) Contrôler le déroulement du processus de stockage
Pendant au moins 100 ans, les générations suivantes pourront contrôler le déroulement du stockage et récupérer des déchets stockés si elles le souhaitent. L’Andra propose que des rendez-vous réguliers soient organisés avec l’ensemble des acteurs (riverains, collectivités, évaluateurs, État…) pour faire le point sur l’exploitation du stockage et les prochaines étapes. Ces discussions seront alimentées par la surveillance du stockage et les résultats des réexamens de sûreté (l’Autorité de sûreté nucléaire impose un réexamen périodique de sûreté, au moins tous les 10 ans, pour toutes les installations nucléaires). Ces rendez-vous offriront aussi aux générations suivantes la possibilité de réexaminer périodiquement les conditions de réversibilité.
2) Préserver la possibilité de mettre en œuvre d’autres modes de gestion
De nombreuses solutions pour gérer les déchets radioactifs ont été imaginées depuis 50 ans : les envoyer dans l’espace, au fond des océans ou dans le magma, les entreposer plusieurs centaines d’années en surface ou à faible profondeur, les transmuter… Seul le stockage profond est aujourd’hui reconnu en France et à l’étranger comme une solution robuste pour mettre en sécurité ces déchets à très long terme. Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de ces déchets.
Grâce à la réversibilité, les générations suivantes garderont la possibilité de faire évoluer cette solution. Les rendez-vous proposés par l’Andra seront notamment alimentés par les résultats des recherches qui continueront à être menées sur la gestion des déchets radioactifs et les avancées technologiques. A chaque étape, il sera possible de décider de poursuivre le processus de stockage tel qu’initialement prévu ou de le modifier, par exemple si des solutions alternatives sont identifiées.
3) Conserver une possibilité d’intervention en cas d’évolution anormale
Les expérimentations menées au Laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne ont permis de qualifier in situ les propriétés de la roche argileuse, d’étudier les perturbations qui seraient induites par la réalisation d’un stockage (effets du creusement, de la ventilation, de la chaleur apportée par certains déchets…), de mettre au point des méthodes d’observation et de surveillance et de tester les procédés de réalisation qui pourraient être utilisés si Cigéo est mis en œuvre.
L’étape suivante sera d’acquérir une expérience complémentaire lors de la réalisation des premiers ouvrages de stockage. Si Cigéo est autorisé, le démarrage de l’exploitation se fera de manière progressive. Des premiers colis de déchets radioactifs pourraient être pris en charge à l’horizon 2025. Dans son avis du 16 mai 2013, l’Autorité de sûreté nucléaire a recommandé une phase de « montée en puissance » progressive de l’exploitation du stockage. L’évolution du stockage sera surveillée tout au long de l’exploitation de Cigéo. Les rendez-vous proposés par l’Andra seront alimentés par les résultats de la surveillance du stockage.
4) Pouvoir récupérer des colis de déchets
L’Andra prévoit dès la conception de Cigéo des dispositifs techniques destinés à faciliter le retrait éventuel de colis de déchets stockés. Les tunnels pour stocker les colis de déchets seront ainsi revêtus d’une paroi en béton ou en acier pour éviter les déformations, avec des espaces ménagés entre les colis et les parois pour permettre leur retrait. Des capteurs permettront de surveiller le comportement des ouvrages. Des essais de retrait de colis pourront être réalisés périodiquement dans le stockage pendant son exploitation. Dans l’hypothèse d’une évolution de la politique en matière de gestion des déchets radioactifs qui conduirait à envisager une opération de retrait d’un nombre important de colis de déchets, de nouvelles installations devraient être créées pour prendre en charge ces déchets (reconditionnement éventuel, expédition, entreposage, traitement…).
5) Ne pas abandonner le site
Après fermeture, la sûreté du stockage sera assurée de manière passive, c’est-à-dire sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique, qui sert de barrière naturelle à très long terme, et sur la conception du stockage. Une surveillance sera néanmoins maintenue après la fermeture du stockage aussi longtemps que la société le souhaitera et des actions seront menées pour conserver et transmettre sa mémoire. Le Parlement a d’ores et déjà décidé que seule une loi pourrait autoriser la fermeture définitive du stockage. Cette future loi pourra fixer les conditions dans lesquelles le site restera contrôlé, sa surveillance maintenue et la mémoire conservée.
QUESTION 582
Posée par Olivier DEBELLEIX, le 28/11/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de M. Olivier DEBELLEIX :
Quelles sont les mesures chiffrées envisagées et les solutions prévues afin de compenser ces pertes de production (élevage bovin, chèvres, brebis, porcins et truies reproductrices, poulets de chair et coqs) ? Quelles sont les mesures chiffrées envisagées et les solutions prévues afin de compenser ces pertes de production en culture dues à une surface agricole inutilisable, soit 634.299 hectares pour la Meuse et la Haute-Marne ?
Réponse du 08/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Cigéo est conçu pour protéger l’Homme et l’environnement. L’impact du centre en termes de radioactivité sera très inférieur à celui de la radioactivité naturelle et n’aura donc aucun impact sur la qualité des productions agricoles. L’Andra a créé l’Observatoire pérenne de l’environnement, qui a pour mission d’assurer un suivi détaillé de l’évolution de l’environnement du stockage. Cela permettra de lever ainsi toute inquiétude en démontrant que le stockage n’a pas d’impact sur les activités agricoles de proximité. Cet observatoire labellisé s’inscrit dans un grand nombre de réseaux scientifiques nationaux ou internationaux. Par ailleurs, le retour d’expérience de l’implantation de l’Andra dans l’Aube depuis 20 ans montre que l’implantation d’un centre de stockage de déchets radioactifs n’est en aucun cas incompatible, même en termes d’image, avec les activités agricoles.
QUESTION 581 - Déroulement des études
Posée par Gustave BONNET, L'organisme que vous représentez (option) (METZ), le 28/11/2013
Lors du débat du 13 novembre, il a été dit: "Ce débat public se déroule à une certaine phase de la conception du projet CIGEO qui est à cheval entre l’esquisse et l’APS (avant-projet sommaire)." Quand est ce que l'Andra compte lancer les études d'APS? J'imagine que c'est aprés avoir reçu le CR du débat et y avoir répondu, c'est à dire vers avril 2014. Est ce que vous pouvez me le confirmer?
Réponse du 07/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les études de conception industrielle de Cigéo ont débuté en 2012 avec une première phase d'esquisse, qui a permis de définir une architecture d'ensemble du projet industriel, présentée au débat public. L’Andra a signé en novembre 2013 les contrats de maîtrise d'œuvre qui lui permettent de poursuivre les études de conception du projet Cigéo en vue d'élaborer le dossier support à l’instruction de la demande d'autorisation de création du centre de stockage, conformément à la loi du 28 juin 2006. Les contrats prévoient une phase initiale de plusieurs mois pour optimiser le projet industriel et pour prendre en compte les modifications qui seront apportées au projet par l’Andra suite au débat public. La signature de ces contrats par L’Andra ne préjuge en rien des suites qui seront données par l'État au débat public.
QUESTION 580 - Actualisation
Posée par Jeanne LOCHET, L'organisme que vous représentez (option) (SAINT DENIS), le 28/11/2013
Dans le débat du 13 novembre, le représentant d'EDF indique "L’an dernier, cela a bien marché puisque nos actifs ont rapporté plus de 10 %, donc on est bien au-delà des 4,8% qui sont le taux, inflation comprise, d’actualisation que nous utilisons. " Est ce que 4,8% est bien le taux d'actualisation utilisé par EDF? Quel est le taux d'actualisation utilisé par AREVA et le CEA? Le décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires indique "Ce taux d'actualisation ne peut en outre excéder un plafond fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie". Quel est le niveau actuel du plafond fixé par l'arrêté?
Réponse du 31/01/2014,
Réponse apportée EDF :
Comme indiqué dans le rapport financier 2012 d'EDF, consultable sur finance.edf.com, le taux d’actualisation retenu par EDF au 31 décembre 2012 pour le calcul des provisions était de 4,8 % (5,0 % avant cette date). Ce taux a été calculé avec la méthode de détermination mise en œuvre par EDF depuis 2005, conformément aux normes comptables et sous le contrôle de ses Commissaires Aux Comptes. Le décret du 23 février 2007 prévoit d'une part que la méthode retenue doit être pérenne, et d'autre part que le taux doit être inférieur à un plafond réglementaire, qui s'est lui-même établi à 4,8% au 31 décembre 2012. Au 30 juin 2013, comme indiqué dans les comptes consolidés à cette date, EDF a maintenu un taux d'actualisation de 4,8%, en application de la méthode de détermination et conformément au principe de pérennité de cette méthode, malgré un niveau du plafond réglementaire de 4,7%, compte tenu de discussions en cours autour d'une éventuelle modification du dispositif du plafond réglementaire.
Réponse apportée par AREVA :
A fin 2012, les provisions d'AREVA sont actualisées au taux de 4.75%, en baisse par rapport au taux de 5.00% de la clôture précédente.
Réponse apportée par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) :
Le taux d’actualisation pour le CEA a évolué comme suit :5% en 2011, 4,75% en 2012. 4,75% en 2013.
QUESTION 579 - Cout de Cigéo
Posée par Fabrice DUPUIS, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 28/11/2013
Seul le coût de Cigéo estimé par l'Andra en 2005 est provisionné par les producteurs de déchets. D'après le dossier du maitre d'ouvrage, l'estimation de 2005 est aux conditions économiques de 2012 de 16,5 milliards d'euros. Est ce que l'Andra peut nous indiquer quel est le cout du stockage non optimisé et quel est le chiffrage maximale des optimisations en cours d'étude? Si ce n'est pas possible, est ce que l'Andra peut nous certifier que le coût du stockage non optimisé moins le montant des optimisations espérées est bien inférieur à 16,5 milliards d'euros?
Réponse du 08/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Avant de finaliser un nouveau chiffrage, l’État a demandé à l’Andra de poursuivre les études permettant de prendre en compte les suites du débat public, les recommandations des évaluateurs et les pistes d’optimisation identifiées en 2013. Ce chiffrage sera finalisé par l’Andra en 2014. Conformément à la loi du 28 juin 2006, c’est le ministre chargé de l’énergie qui arrêtera l’évaluation des coûts et la rendra publique, après avoir recueilli les observations des producteurs de déchets radioactifs et l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire.
QUESTION 578 - Cout de Cigéo
Posée par Fabrice DUPUIS, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 28/11/2013
Lors du débat du 13 novembre, le représentant de l'Andra a indiqué: "À ce stade, les ordres de grandeur du coût global du stockage sont connus et publics, Charles -Antoine Louët y a fait référence, et je peux confirmer ce soir que l’on restera dans les mêmes ordres de grandeur" Est il possible d'expliciter? On est dans l'ordre de grandeur de 15 milliards d'euros ou de 36 milliards d'euros?
Réponse du 08/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le chiffrage officiel arrêté par l’Etat en 2005 au stade des études de faisabilité scientifique et technique était d’environ 15 milliards d’euros. En 2009, l’Andra a réalisé une estimation préliminaire d’environ 35 milliards d’euros avant le lancement de la phase de conception industrielle et des optimisations en cours d’étude. Le travail d’études d’optimisation et de prise en compte des suites du débat du public se poursuivra jusqu’à l’été 2014. Le processus d’arrêt d’une nouvelle évaluation par le ministre chargé de l’énergie comprendra ensuite une phase de consultation, avec le recueil de l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et des observations des producteurs de déchets, à l’issue de laquelle le ministre rendra publique la nouvelle estimation arrêtée par l’Etat.
QUESTION 577 - Validité du débat
Posée par Monique REDIBUT, L'organisme que vous représentez (option) (BAR LE DUC), le 28/11/2013
Ma question s'adresse à la CPDP. Vu le déroulement du débat, estimez vous que l'article 1 de la décision de la CPDP du 6 février 2013 est respecté? Est ce que le fait que l'explicitation des questions financières (vous savez que cela voulait dire donner des éléments sur le cout du stockage) n'est pas eu lieu pourrait remettre en question le débat? Merci de nous donner une réponse sans langue de bois du type "l"Andra a donné quelques éléments", vous savez que ce n'est pas ce qui était attendu et que l'Andra n'a fait que citer des documents qui étaient déjà publiés en février (rapport de la Cour des comptes, rapport de la CNEF...)
Réponse du 16/12/2013,
Le dossier du maître d’ouvrage indique dans la partie consacrée au financement que « le ministère chargé de l’énergie souhaite arrêter une nouvelle évaluation fin 2013. Un état d’avancement pourra être fait lors du débat public. » Dans son communiqué du 6 février 2013, la commission nationale du débat public a considéré le dossier comme suffisamment complet pour être soumis au débat public, sous réserve que soient explicités à l’occasion du débat les questions financières. Lors du débat contradictoire du 13 novembre 2013 le représentant de l’Etat a rappelé les coûts établis en 2005 entre 13,5 et 16,5 milliards d’euros répartis sur plus de 100 ans et a informé de la disponibilité d’un prochain chiffrage en 2014 compte tenu de la complexité des données à quantifier. Le débat contradictoire a cependant permis d’approfondir un certain nombre de sujets d’importance. Le financement sera donc explicité après la fin du débat public. Il apparaît que l’ANDRA et le ministère n’ont effectivement pas répondu à la demande de la CNDP. Le compte rendu du débat prendra en compte les différentes opinions et argumentations exprimées sur la question du financement.
QUESTION 576
Posée par Olivier DEBELLEIX, le 25/11/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de M. Olivier DEBELLEIX :
Pourquoi a-t-il été décidé d’exclure les eaux de Vittel et de Contrex du périmètre des risques induits par la construction de Cigéo, alors qu’il s’agit de ressources en eau potable ? Quelles sont les solutions prévues pour pallier le déficit en eau minérale et donc les ressources en eau potable d’une partie de la population française résultant d’une pollution des eaux de sources de Contrex et Vittel ?
Réponse du 20/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La présence d’un stockage comme Cigéo, ne va pas perturber les eaux souterraines de la zone de stockage, ni celles de surface d’ailleurs, et encore moins les eaux de Vittel et de Contrexéville, qui sont puisées dans des nappes qui ne sont pas en relation avec celles de la zone de stockage.
Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement afin de contrôler l’impact de ses activités. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, il permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement et l’absence de contamination des nappes phréatiques. L’Andra a déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Mais également, Cigéo sera en permanence soumis au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
QUESTION 575
Posée par Olivier DEBELLEIX, le 25/11/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de M. Olivier DEBELLEIX :
Quels moyens humains, financiers et économiques seront provisionnés afin de prévoir la reconversion professionnelle et donc le reclassement de 13772 personnes visées par ce cahier d’acteur ? Pour 1 emploi apporté par Cigéo, combien de perdus dans les AOP (Appellation d’origine protégée), les eaux minérales, parmi les activités agricoles, le tourisme vert ?
Réponse du 23/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Cigéo est conçu pour protéger l’Homme et l’environnement. L’impact du centre en termes de radioactivité sera très inférieur à celui de la radioactivité naturelle et n’aura donc aucun impact sur la qualité des productions agricoles ou sur les différentes activités présentes dans la région. En ce sens aucun reclassement ou centre de reconversion n’est prévu et nécessaire. L’Andra a créé l’Observatoire pérenne de l’environnement, qui a pour mission d’assurer un suivi détaillé de l’évolution de l’environnement du stockage pendant plus de cent ans ; cela permettra de lever ainsi toute inquiétude en démontrant que le stockage n’a pas d’impact sur les activités agricole de proximité. Cet observatoire labellisé, s’inscrit dans un grand nombre de réseaux scientifiques nationaux ou internationaux.
La sûreté du stockage étant garantie, est-ce que l’image des produits locaux pourrait être ternie par la présence de Cigéo ? L’expérience prouve que non : de nombreuses installations nucléaires coexistent en France avec des activités agricoles, sans qu’elles en souffrent. L’industrie et l’agriculture ont toujours coexisté en France, il n’y a pas de raison que cela ne dure pas.
QUESTION 574
Posée par MEDEF HAUTE-MARNE, le 25/11/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs du MEDEF Haute-Marne :
Pourquoi ne pas envisager un projet plus large tourné sur un conservatoire de la nature dont l’écothèque serait un département ? Ce conservatoire pourrait agréger des écoles d’agronomie, de l’horticulture, des chercheurs, des jardiniers et bien d’autres activités. Un tel équipement ne manquerait pas d’attirer le public, et une vacation touristique pourrait être développée (comme Vulcania).
Réponse du 09/01/2014,
Réponse apportée par le Directeur du Schéma Interdépartemental de Développement du Territoire :
Le projet de Schéma Interdépartemental de Développement du Territoire a identifié les enjeux auxquels le territoire sera confronté, ainsi que les opportunités à saisir pour permettre le développement économique du territoire et la capacité d'entraînement de Cigéo dans ce cadre.
Il est clair que les investissements dans les équipements de recherche réalisés par l'ANDRA en Meuse et Haute-Marne pour étudier le projet de centre de stockage présentent une opportunité et une forme d'attractivité au territoire. La fréquentation du site du Laboratoire, au titre du tourisme industriel, s’élève d’ores et déjà à près de 15 000 visiteurs par an. L’ouverture de l’écothèque, pour laquelle un nouvel espace d’exposition consacré aux études sur l’environnement a été créé, devrait également contribuer à l’attractivité touristique du site. De plus, le renouvellement des expositions temporaires proposées sur le site permet de maintenir l’intérêt des visiteurs et de participer au développement d’un véritable pôle de diffusion de la culture scientifique.
L’ensemble des équipements de recherche de l’Andra, constitué du Laboratoire souterrain, de l’Observatoire Pérenne de l’Environnement et de l’Ecothèque, a été labellisé par le ministère de la recherche « Infrastructure de recherche », sous le nom de SOMET (Structure pour l’Observation et la Mémoire de l’Environnement et de la Terre) . L’Andra a déposé, avec le soutien de l’Université de Lorraine et de la Préfète coordinatrice, un projet de création de station pédagogique dans le cadre du contrat plan Etat-région destinée à accueillir en résidence les étudiants des cycles supérieurs en stages pratiques (géosciences, génie civil, environnement, biodiversité, sciences humaines et sociales ...), ainsi que les personnels d'entreprises de recherches géologiques, minières et souterraines. Ce projet est mené en étroite collaboration et co-construction avec les structures académiques régionales qui seraient porteuses des aspects pédagogiques. Le campus d’enseignement ainsi créé serait également ouvert à l’ensemble des établissements d’enseignement français, avec une potentielle ouverture européenne que favorise l’implantation géographique de SOMET au cœur de l’Europe.
L'Observatoire Pérenne de l'Environnement (OPE) a vocation à produire une évaluation permanente de l'état et de l'évolution de l'environnement local. Ce dispositif d'observation est unique par l'étendue de ses prestations et l'association des scientifiques et des acteurs locaux. Sa valorisation dans le secteur agronomique mérite effectivement d’être approfondie dans le cadre du projet de Schéma Interdépartemental de Développement du Territoire.
QUESTION 573
Posée par MEDEF HAUTE-MARNE, le 25/11/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs du MEDEF Haute-Marne :
Le coût global de fonctionnement et d’investissement de Cigéo serait de 30 milliards, mais sur une période de 100 ans. Comment seront affectées ces sommes et quelle est la part qui sera localisée sur le territoire ?
Réponse du 08/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le chiffrage officiel arrêté par l’Etat en 2005 au stade des études de faisabilité scientifique et technique était d’environ 15 milliards d’euros. En 2009, l’Andra a réalisé une estimation préliminaire d’environ 35 milliards d’euros avant le lancement de la phase de conception industrielle et des optimisations en cours d’étude. Avant de finaliser un nouveau chiffrage, l’État a demandé à l’Andra de poursuivre les études permettant de prendre en compte les suites du débat public, les recommandations des évaluateurs et les pistes d’optimisation identifiées en 2013. Ce chiffrage sera finalisé par l’Andra en 2014. Conformément à la loi du 28 juin 2006, c’est le ministre chargé de l’énergie qui arrêtera l’évaluation des coûts et la rendra publique, après avoir recueilli les observations des producteurs de déchets radioactifs et l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire.
L’Andra mène depuis plusieurs années une politique volontariste visant le développement des relations avec le tissu économique local. En 2011, les deux régions ont émis 10 % du montant total des facturations (HT) liées au projet Cigéo. Cela représente une collaboration avec plus de 250 établissements locaux (publics ou privés), implantés pour 60 % d’entre eux en Lorraine et 40 % en Champagne-Ardenne. Les départements de Meuse et de Haute-Marne regroupent chacun 30 % du total des établissements concernés. Les achats locaux s’inscrivent pleinement dans la politique Achats de l’Andra qui précise que l’Agence « s’efforce de développer ses achats auprès des territoires qui l’accueillent, notamment en consultant dès que possible les acteurs économiques locaux ». L’Andra organise régulièrement des événements pour présenter ses besoins futurs et ses procédures en matière d’achat. 110 entreprises locales ont ainsi participé à la 4ème manifestation « Devenez un prestataire de l’Andra » en 2012 organisée en Meuse/Haute-Marne. Des échanges sont également organisés, notamment dans le cadre du Schéma interdépartemental de développement du territoire, pour donner aux acteurs locaux une visibilité sur les différents besoins industriels liés à Cigéo (mécaniques, bâtiments, réseaux, terrassements…). A ce stade, il est néanmoins trop tôt pour estimer la part des dépenses qui pourraient être réalisées auprès des entreprises locales.
QUESTION 572
Posée par MEDEF HAUTE-MARNE, le 25/11/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs du MEDEF Haute-Marne :
Ce centre de stockage aura un impact limité en termes d’emplois : environ 2200 personnes sur le site dans la phase de 2018 à 2025 puis de 600 à 1000 personnes ultérieurement. Quel sera l’effet d’entrainement pour le territoire ? Quelles seront les obligations de localisation des intervenants ?
Réponse du 09/01/2014,
Réponse apportée par le Directeur du schéma de développement du territoire :
Le Schéma Interdépartemental de Développement du Territoire a identifié les retombées en termes d'emplois, de la réalisation du centre de stockage, soit environ 2 200 personnes en phase chantier suivant les tranches de réalisation. Il faut aussi mesurer ces retombées sur le long terme en phase d'exploitation, soit environ 1 200 personnes, sur le site. Il faut remarquer d'une part que le chiffre de 2 200 emplois sur le site en phase de chantier n'est pas neutre pour le territoire de Meuse et de Haute-Marne. Ces emplois ne manqueront pas de générer une activité de sous-traitance et des retombées dans l'économie locale.
D'autres parts, les emplois créés sur le long terme et tout au long de la durée d'exploitation centenaire du centre de stockage sont également caractéristiques, puisqu'ils concernent trois générations d'emplois et qu'ils ne présentent pas le risque de se trouver délocalisables.
L'ambition sur laquelle se sont accordée l'Etat, maître d'ouvrage du Schéma, les collectivités locales, les chambres de Commerce et d'industrie l'Andra et les entreprises de la filière nucléaire dans la rédaction du projet de Schéma Interdépartemental de Développement du Territoire est de "Tirer parti du développement économique en captant localement la plus grand part d'activités et d'emplois".
Le Schéma a identifié les actions nécessaires pour permettre aux entreprises locales de se positionner sur les marchés qui seront ouverts, ainsi que les conditions d'accueil et d'attractivité pour attirer les entreprises qui pourraient s'implanter en Meuse et en Haute-Marne pour réaliser les travaux de construction du centre et son exploitation. Les objectifs visés sont les suivants:
- augmentation des compétences (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) et des qualifications,
- accompagnement des PME dans les synergies à trouver avec les donneurs d'ordre,
- transferts de technologies dans les PME,
- capacités d'accueil et d'attractivité pour l'implantation d'entreprises.
Certaines de ces actions ont d'ores et déjà été engagées par l'ANDRA ou par les entreprises de la filière nucléaire dans leurs programmes d'actions économiques. Les financements dévolus par les GIP de Meuse et de Haute-Marne procèdent également des actions de développement économique par anticipation de la mise en œuvre du centre de stockage.
Enfin, il faut noter que certaines prestations de sous-traitance nécessiteront la proximité du chantier et du centre d'exploitation. Elles sont justifiées par le bilan économique des transports, ou par l'astreinte que leurs prestations obligeront auprès du maître d'ouvrage.
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’Andra mène depuis plusieurs années une politique volontariste visant le développement des relations avec le tissu économique local. En 2011, les deux régions ont émis 10 % du montant total des facturations (HT) liées au projet Cigéo. Cela représente une collaboration avec plus de 250 établissements locaux (publics ou privés), implantés pour 60 % d’entre eux en Lorraine et 40 % en Champagne-Ardenne. Les départements de Meuse et de Haute-Marne regroupent chacun 30 % du total des établissements concernés. Des incitations à recruter localement seront demandées aux entreprises impliquées pendant la phase de construction de Cigéo tout en respectant les dispositions règlementaires de passation des marchés. Ainsi, au niveau de ses commandes et de ses contrats, l’Andra prévoit des règles d’équité sous forme de clauses destinées à juger de la valeur sociale des offres qui lui permettront notamment de prendre en compte le recours à l’emploi local et la formation des acteurs locaux.
QUESTION 571
Posée par Olivier DEBELLEIX, le 25/11/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de M. Olivier DEBELLEIX : Qu’elles seraient les conséquences sur l’approvisionnement en eau potable des populations ? Qu’elles seraient les solutions apportées afin de palier à ce manque d’eau potable ? Existerait-il seulement une solution ? Qu’elles seraient les conséquences sur l’élevage, l’agriculture (maraichage, céréales, arboriculture) ? Qu’en serait-il des sources de Vittel, Contrexéville etc… ? Ne risquons-nous pas de remettre en cause et de manière irrémédiable notre souveraineté alimentaire alors que se profile déjà de part le monde une guerre pour les terres cultivables ? Peut-on nier aujourd’hui que des pays comme la Jordanie ou certains de l’Afrique du Nord remettent en cause leur agriculture par manque d’eau, hypothéquant ainsi leur survie ? Que devient la dignité de l’Homme dans tout cela ? Pouvons-nous nous permettre de faire courir un tel risque à nos descendants, ici en France ? Les scientifiques de l’Andra et de l’INRA dans leur laboratoire de simulation numérique peuvent-ils affirmer que ce scénario catastrophe est irréaliste? Comment pourrons-nous répondre à cette détresse si notre propre pays est en difficulté suite à une défaillance irréversible de notre site d’enfouissement et de stockage des déchets radioactifs ayant entrainé une pollution de nos eaux et d’une partie de notre territoire national ? La pollution des nappes phréatiques et du sous-sol liée à l’extraction de l’uranium au Niger n’a-t-elle pas servie de leçon pour que nous soyons prêts à répéter les même erreurs sur le sol français, au mépris là aussi des populations locales ?
Réponse du 27/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le stockage géologique a pour principe de confiner la radioactivité des déchets sur de très longues échelles de temps. Pour cela, le stockage serait implanté, à environ 500 mètres de profondeur, dans une couche d’argile très peu perméable de plus de 130 mètres d’épaisseur qui servira de barrière naturelle pour retenir les radionucléides contenus dans les déchets et freiner leur déplacement. Seuls quelques-uns de ces radionucléides, les plus mobiles et dont la durée de vie est longue, pourront migrer de manière très étalée dans le temps (plus d’une centaine de milliers d’années) et atteindre en quantités extrêmement faibles les couches géologiques situées au-dessus et au-dessous de l’argile et dans lesquelles l’eau peut circuler (couches géologiques appelées aquifères). Dans une démarche prudente, l’Andra dans son évaluation d’impact sur l’homme et l’environnement à long terme suppose que les eaux de ces couches pourraient être captées par forage et utilisées pour des usages du type de ceux qui peuvent être pratiqués aujourd’hui (jardin, boisson, abreuvement des animaux). Les études montrent que même dans ce cas, l’impact du stockage reste inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire et ne présente pas de risque pour la santé.
QUESTION 570 - opposant
Posée par Stephane KING, L'organisme que vous représentez (option) (MARNE), le 04/12/2013
Bonsoir, ma question est la suivante = Que se passera-t-il si à cause des opposants l’enfouissement était reporté ? Merci pour votre réponse Stéphane
Réponse du 06/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les déchets les plus radioactifs produits par les générations passées et actuelles sont aujourd’hui entreposés, de manière sûre mais provisoire, sur leurs sites de production à La Hague (Manche), Marcoule (Gard), Cadarache (Bouches-du-Rhône) et, pour un volume limité, à Valduc (Côte-d’Or). Plus de 40 000 mètres cubes de déchets de haute activité (HA) et de moyenne activité à vie longue (MA-VL) y sont actuellement entreposés.
Si le stockage profond n’est pas autorisé, de nouvelles capacités d’entreposage seront nécessaires pour accueillir les déchets HA et MA-VL futurs et remplacer les entrepôts existants lorsque leur durée de vie sera atteinte. Ce mode de gestion laisse de la latitude pour décider ou non de réaliser le projet Cigéo. En revanche, il ne constitue pas une solution de gestion définitive et conduit à reporter la charge de la gestion de ces déchets radioactifs sur les générations suivantes.
Si le stockage profond est autorisé, les colis de déchets pourront être transférés progressivement de leurs entrepôts vers le stockage. La réversibilité donnera aux générations suivantes la possibilité de réexaminer périodiquement la stratégie de gestion retenue et de la faire évoluer si elles le souhaitent. La mise en œuvre de cette solution limite les charges reportées sur les générations futures et ouvre la voie à une mise en sécurité définitive des déchets.
On peut toujours remettre à demain ce que l’on pourrait commencer à faire aujourd’hui. Mais nos enfants pourraient nous reprocher de ne pas avoir préparé de solution pour gérer les déchets radioactifs produits par les activités dont nous bénéficions au quotidien.
QUESTION 569
Posée par Olivier DEBELLEIX, le 25/11/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de M. Olivier DEBELLEIX :
Dès lors, il y a lieu de s’interroger sur la perméabilité de l’argile suite à l’impact des multiples fissures. Stabilisé depuis plus de 160 millions d’années, il va devenir bloc géologique perturbé par les actions liées à l’activité humaine. L’homme peut-il prendre la responsabilité d’une telle intrusion ?
Qu’elles seront alors les conséquences sur les colis de déchets et leur hotte de transfert ?
1ère question : Pourquoi l'Andra édulcore-t-elle le fait que le site de stockage sera installé entre 2 aquifères?
2ème question : Pourquoi l'Andra affirme-t-elle que le site de stockage ne sera pas installé ni au-dessus ni en dessous de zones utilisées pour l'approvisionnement en eau alors que de toute évidence, l'aquifères oxfordien est déjà utilisé au niveau locale ?
3ème question : Comment peut-on affirmer que l'aquifère dogger n'est pas déjà en contact avec les nappes phréatiques et que demain il ne sera pas une ressource non négligeable en eau potable ?
Réponse du 20/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’Andra a toujours été claire sur ces questions : le projet de stockage Cigéo est prévu d’être implanté dans la couche argileuse du Callovo-Oxfordien, située à une profondeur d’environ 500 m et dont l’épaisseur varie de 140 à 160 m environ sur le site étudié. Au sens de la définition générale d’un aquifère (ou nappe phréatique), il existe trois formations aquifères situées de part et d’autre de la couche du Callovo-Oxfordien :
- En surface, les calcaires du Barrois : d’une épaisseur de quelques dizaines de mètres, il s’agit d’un aquifère généralement de type karts. Cet aquifère est exploité localement pour l’alimentation en eau potable,
- De part et d’autre de la couche du Callovo-Oxfordien, l’Oxfordien carbonaté au-dessus et le Dogger en dessous :
- L’Oxfordien carbonaté d’environ 300 mètres d’épaisseur est à une profondeur de 200 m. L’aquifère est en fait constitué de deux aquifères séparés par des marnes. L’aquifère le plus proche de la couche du Callovo-Oxfordien est située environ de 40 m et 100 m de cette dernière,
- Le Dogger a une épaisseur d’environ 300 m. On y distingue aussi deux aquifères séparés par des marnes (marnes de Longwy) d’environ 30 m d’épaisseur : l’un, le Bathonien, est situé en partie supérieure du Dogger, avec une épaisseur moyenne de 100 m environ ; l’autre, le bajocien, est en partie basse. Sur le site, la distance entre la base du Callovo-Oxfordien et le bathonien aquifère varie de 20 m à 40 m environ.
Sur la zone de transposition, les aquifères de l’Oxfordien et du Dogger présentent des caractéristiques hydrogéologiques faibles, parfois désignés sous le nom d’aquitards. Ils ne sont de ce fait exploités qu’en dehors de la zone où pourrait être implanté Cigéo, là où leurs caractéristiques hydrogéologiques sont plus favorables.
QUESTION 568
Posée par Maurice MICHEL, le 25/11/2013
Maurice MICHEL – ASODEDRA – 88350 GRAND, le 21 novembre 2013
Deux questions à Monsieur le président du conseil d’administration de l’ANDRA
Les principales conclusions, convergentes, des participants au précédent débat public de 2005 sur Bure ont été balayées par les pouvoirs publics en 2006. Il ne faut donc pas s’étonner que des collectifs de citoyens en colère boycottent celui de 2013 en ne souhaitant pas être humiliés une seconde fois. Les décisions sont déjà prises, disent-ils, et l’Etat se soucie comme d’une guigne de l’avis de la population et des aimables causettes de la CPDP.
Comment ne pas ressentir le même malaise ? Il y a 22 ans, dès 1991, bien avant la loi de juin 2006, les dés étaient apparemment jetés. Pour éliminer les déchets radioactifs [le projet de la loi « Bataille » était relatif aux recherches sur l’élimination des déchets radioactifs (sic)], il faut les enfouir à jamais en profondeur. En 1991, au cours des débats parlementaires qui ont porté sur ce projet, quelques députés, et pas des moindres, avaient déjà pressenti que le choix était fait de sacrifier les générations futures en feignant de les protéger : élus visionnaires ou parlementaires lucides ? Qu’on en juge.
Le 25 juin 1991, M. Jean-Louis MASSON, député de la Moselle, ingénieur des mines et ancien inspecteur des installations nucléaires, ne prend pas de gants pour affirmer devant ses collègues : « le projet de loi qui nous est présenté /…/ traite uniquement de l’enfouissement souterrain des déchets radioactifs. Son but est donc ni plus ni moins d’entériner le choix définitif de l’enfouissement, du stockage souterrain comme seule technique d’élimination des déchets » (page 3640 du journal officiel « JO »– Assemblée Nationale – 3ème séance du 25 juin 1991).
M. MASSON est rejoint par M. Jean De GAULLE, député des Deux-Sèvres, petit-fils du Général, qui apostrophe le ministre en charge de l’énergie en ces termes : « En réalité, nous l’avons bien compris, vous avez déjà opté pour l’enfouissement irréversible des déchets radioactifs. Tout le reste n’est qu’habillage » (page 3748 du JO – Assemblée Nationale – 1ère séance du 27 juin 1991). L’actualité du propos vieux de 22 ans laisse pantois.
Pour sa part, M. François-Michel GONNOT, député de l’Oise, [futur et actuel Président de l’ANDRA] n’est pas en reste. Il insiste en s’adressant au ministre chargé de l’énergie : « Je le dis sans esprit polémique, votre ministère donne le sentiment d’avoir fait un choix, ainsi que l’a rappelé tout à l’heure notre collègue MASSON, celui de l’enfouissement ». (Page 3649 du JO - Assemblée Nationale – 3ème séance du 25 juin 1991).
- Ainsi, le député qui allait devenir le président de l’ANDRA, comptait en 1991 au nombre des représentants du peuple qui avaient compris que l’enfouissement des déchets nucléaires était déjà décidé. Monsieur GONNOT pense-t-il toujours que le choix de l’enfouissement [–on y a ajouté en 2006 une période temporaire de réversibilité- ] est arrêté depuis 22 ans ?
Un peu plus loin, M. GONNOT lance une adresse au ministre : « Nous aimerions aussi que vous rassuriez davantage peut-être les populations concernées par les fameux laboratoires [à l’époque, il devait y en avoir plusieurs] qui pourraient demain devenir les sites de stockage, que vous puissiez leur garantir qu’elles seront consultées de façon précise sur le choix des sites et sur les procédures qui seront nécessaires avant l’adoption de solutions définitives » (page 3649 du JO - Assemblée Nationale – 3ème séance du 25 juin 1991).
A l’époque, M. GONNOT subodorait que les sites d’implantation des laboratoires deviendraient sans doute les sites de stockage des déchets. L’avenir allait lui donner raison. Aussi, estimait-il que la saisine de la représentation nationale n’était pas suffisante et réclamait-il que les populations concernées « par les laboratoires » soient « consultées de façon précise sur le choix des sites ».
- Maintenant que l’agence qu’il préside est en charge de l’enfouissement des déchets à côté du laboratoire de Bure, M. GONNOT peut-il nous éclairer sur ce qu’il entendait en 1991 par la « consultation de façon précise » de la population sur le choix des sites, sachant que la démarche du débat public n’est apparue qu’en 1995 ?
Réponse du 09/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La loi du 31 décembre 1991 a ouvert plusieurs voies de recherche : la séparation/transmutation, le stockage profond et l’entreposage de longue durée. Sur la base des résultats des recherches menées sur ces trois voies, de leur évaluation par l’Autorité de sûreté nucléaire et par la Commission nationale d’évaluation et des recommandations du débat public organisé en 2005, le Parlement a fait le choix en 2006 du stockage profond réversible pour mettre en sécurité définitive les déchets les plus radioactifs produits en France. Les recherches sur la séparation/transmutation et l’entreposage sont poursuivies dans une logique de complémentarité avec le stockage.
Le processus de consultation préalable à la mise en œuvre éventuelle de Cigéo est défini par la loi du 28 juin 2006. Ce processus comprend plusieurs étapes de consultation, notamment le présent débat public, le recueil de l’avis des collectivités territoriales, le vote d’une loi fixant les conditions de réversibilité et une enquête publique.
QUESTION 567 - Transport
Posée par J-Louis AGRAPART, L'organisme que vous représentez (option) (BAR LE DUC), le 23/11/2013
Pour éviter les risques majeurs inhérents au transport, pourquoi ne pas stocker et surveiller les colis en surfaces ou subsurface sur les lieux de production là ou ils sont actuellement? Question 2: Combien de temps les colis seront-ils maintenus en surface à BURE-SAUDRON pour leur refroidissement?
Réponse du 07/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
En réponse à votre première question
Les déchets les plus radioactifs destinés à Cigéo sont des déchets dangereux, qui le resteront plusieurs dizaines à centaines de milliers d’années. Ces déchets, produits en France depuis les années 1960, sont actuellement entreposés de manière sûre mais provisoire dans des bâtiments sur leurs sites de production, dans l’attente d’une solution de gestion à long terme. Les installations d’entreposage, qu’elles soient en surface ou en subsurface, ne sont pas conçues pour confiner la radioactivité à très long terme. En cas de perte de contrôle de telles installations, les conséquences radiologiques sur l’homme et l’environnement ne seraient pas acceptables.
Le stockage à 500 mètres de profondeur dans une couche géologique assurant le confinement à très long terme permet de protéger l’homme et l’environnement de la dangerosité de ces déchets et de ne pas reporter indéfiniment la charge de leur gestion sur les générations futures. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
En réponse à votre seconde question
Dans l’hypothèse où Cigéo serait autorisé, les bâtiments de surface du Centre auront pour unique fonction l’accueil, la réception, le contrôle et la préparation des colis avant leur transfert vers l’installation souterraine. A ce stade des études, la durée moyenne de ces opérations pour un colis de déchet est estimée de l’ordre de 2 semaines.
Les installations réalisées sur Cigéo n’auront pas vocation à se substituer aux entreposages sur les sites des producteurs de déchets. Le refroidissement des déchets les plus chauds continuera ainsi à être réalisé à La Hague, où une extension de l’entrepôt accueillant les déchets vitrifiés vient d’être mise en service par Areva.
QUESTION 566 - Indémnisations pour baisse des ventes de produits agricoles
Posée par Christophe BRUVIER, L'organisme que vous représentez (option) (EUVILLE), le 22/11/2013
En cas d'émanations radioactives du stockage que les médias sauront diffuser, la vente des produits agricole de la région (exemple : brie de meaux) seront sûrement sévèrement pénalisées, laissant tout un pan de l'économie locale sinistrée. Quelles solutions et quelle indemnisation est prévue ?
Réponse du 30/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
Cigéo est conçu pour protéger l’Homme et l’environnement. L’impact du centre en termes de radioactivité sera très inférieur à celui de la radioactivité naturelle et n’aura donc aucun impact sur la qualité des productions agricoles. L’Andra a créé l’Observatoire pérenne de l’environnement, qui a pour mission d’assurer un suivi détaillé de l’évolution de l’environnement du stockage. Cela permettra de lever ainsi toute inquiétude en démontrant que le stockage n’a pas d’impact sur les activités agricoles de proximité. Cet observatoire labellisé s’inscrit dans un grand nombre de réseaux scientifiques nationaux ou internationaux. Par ailleurs, le retour d’expérience de la présence de l’Andra dans l’Aube depuis 20 ans montre que l’implantation d’un centre de stockage de déchets radioactifs n’est en aucun cas incompatible, même en termes d’image, avec des activités agricoles de premier choix (lait, viande, légumes, viticulture...). L'industrie et l’agriculture ont toujours coexisté et de nombreuses installations industrielles y compris nucléaires sont installées en France à proximité de zones de production agricoles dont des zones géographiques protégées ou encore des zones d'appellation contrôlée.
QUESTION 565 - ethique
Posée par dominique ROBERT, L'organisme que vous représentez (option) (LA BRUNELLERIE), le 22/11/2013
Dans ce contexte qui bafoue toute loi démocratique, les questions logistiques qui restent sans vraie réponse possible du fait d'un avenir inconnu sont si nombreuses que je ne peux en poser qu'une: Que tirez-vous d'un tel acharnement à détruire la vie?
Réponse du 08/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
De quel « acharnement à détruire la vie » parlez-vous ? L’objectif fondamental de Cigéo est justement de protéger l’homme et l’environnement sur le très long terme de la dangerosité des déchets radioactifs. La sûreté est au cœur du projet Cigéo. L’Andra doit démontrer qu’elle maîtrise les risques en exploitation et après la fermeture du stockage pour que la création de Cigéo puisse être autorisée. Par ailleurs, si Cigéo est autorisé, sa construction se fera de manière très progressive pour contrôler toutes les étapes de son développement.
Vous invoquez un déni de démocratie. Or le Parlement s’est saisi de la question des déchets radioactifs en 1991 puis en 2006. Il se saisira à nouveau du sujet pour définir les conditions de réversibilité. Depuis plus de 20 ans, l’ensemble des recherches menées sur la gestion des déchets radioactifs sont évaluées de manière indépendante sur le plan scientifique et de la sûreté. Ces évaluations sont publiques et consultables sur le site du débat public. Les acteurs locaux, en particulier le Comité local d’information et de suivi, sont associés à chaque étape du projet. A ce jour, près de 100 000 personnes ont fait la démarche de venir visiter le site du Laboratoire souterrain où sont menées les recherches sur le projet de stockage.
La création de Cigéo n’est pas décidée. Le débat public est l’occasion de permettre à chacun de s’exprimer sur le projet présenté par l’Andra. Les conclusions du débat public seront prises en compte par l’Andra dans la poursuite des études.
QUESTION 564 - et la géothermie ?
Posée par anne JORDAN, L'organisme que vous représentez (option) (PLOERDUT), le 22/11/2013
depuis que nous savons la richesse potentielle pour la région , en termes de Géothermie , votre entreprise doit répondre à la question : qu'en sera t il de cette énergie non carbonée , inépuisable et bon marché , si vous persistez ?
Réponse du 08/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Comme partout ailleurs en France, la géothermie dite de surface (qui permet d’alimenter des maisons individuelles et des immeubles collectifs ou tertiaires via des pompes à chaleur) est réalisable localement. L’exploitation de ces ressources en surface ne serait d’ailleurs pas incompatible avec Cigéo, même au droit des installations souterraines de Cigéo, qui seraient situées à 500 mètres de profondeur.
Les études et les conclusions de l’Andra portent sur le potentiel géothermique profond du site mesuré grâce à un forage à 2000 mètres de profondeur dans les grès du Trias (Forage EST 433, Montiers-sur-Saulx) réalisé lors d’une campagne de reconnaissance menée en 2007-2008. Les caractéristiques habituellement recherchées pour déterminer s’il existe un potentiel géothermique (salinité, température et productivité) ont été mesurées. Il en ressort que le sous-sol dans la zone étudiée pour l’implantation de Cigéo ne présente pas un caractère exceptionnel en tant que ressource potentielle pour une exploitation géothermique profonde. Dans son rapport n°4 de juin 2010, la CNE aboutit aux mêmes conclusions : « Le trias de la région de Bure ne représente pas une ressource géothermique potentielle attractive dans les conditions technologiques et économiques actuelles. »
Par ailleurs, même si le sous-sol de Bure ne présente aucun caractère exceptionnel, il est tout à fait possible de réaliser des projets de géothermie profonde dans la région en dehors de l’installation souterraine de Cigéo (qui serait implantée à l’intérieur d’une zone de 30 km²). Par précaution, l’Andra a tout de même envisagé que l’on puisse exploiter le sous-sol au niveau du stockage et qu’une intrusion puisse avoir lieu. Les analyses ont montré que même dans ce cas, le stockage conserverait de bonnes capacités de confinement. Comme dans le dossier 2005, l’Andra présentera dans le dossier de demande d’autorisation de création de tels scénarios d’intrusion, incluant des doublets de forage comme ceux pratiqués pour l’exploitation de la géothermie.
QUESTION 563 - géothermie
Posée par philippe PORTÉ, L'organisme que vous représentez (option) (CHÂLONS EN CHAMPAGNE), le 22/11/2013
Je ne peux accepter un projet qui empêcherait de se servir d'une ressource abondante et gratuite, l'eau chaude comme énergie. L'eau est abondante dans notre région en sous sol et je pense que l'eau s'infiltrera très rapidement dans les souterrains car il y a de nombreuses ouvertures pour mettre éventuellement des déchets radioactifs sous terre. Comment pensez vous arrêter l'eau qui ne doit pas migrer dans les galeries et comment irons nous chercher l'eau chaude quand il n'y aura plus de pétrole? Cordialement
Réponse du 09/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Concernant l’arrivée accidentelle d’eau dans Cigéo
De nombreuses mesures seront prises pour prévenir d’éventuelles arrivées d’eau accidentelles dans Cigéo :
- Protection des puits et de la descenderie contre les intempéries,
- Etanchéification des puits et des descenderies au niveau des couches de roche aquifères traversées au-dessus de la couche d’argilite,
- Systèmes de drainage des eaux issues des couches de roche supérieures peu productives et pompage de ces eaux jusqu’à la surface,
- Protection des canalisations d’eau interne et mécanismes de fermeture automatique en cas de rupture.
Ces dispositions sont largement éprouvées dans l’industrie minière.
Par précaution, des scénarios accidentels d’arrivées d’eau (par exemple suite à la défaillance d’une canalisation ou suite à une panne dans le système de drainage des eaux provenant des couches de roche supérieures) sont pris en compte dans les études de sûreté menées pour Cigéo, au même titre que pour n’importe quelle installation nucléaire. Compte tenu des origines possibles, ce débit sera nécessairement limité (pour mémoire le débit drainé par chacun des puits du Laboratoire souterrain est de l’ordre de 10 m3/jour en moyenne, ou moins, ce qui est très faible par comparaison à certains sites miniers). Un tel évènement resterait très localisé dans le stockage et n’aurait qu’un effet très limité sur l’argile qui sera protégée par les revêtements. En tout état de cause, ce type d’incident ne remettra pas en cause la sûreté du stockage.
Concernant l’exploitation du potentiel géothermique
La géothermie dite de surface, qui permet d’alimenter des maisons individuelles et des immeubles collectifs ou tertiaires via des pompes à chaleur, est réalisable partout, avec des techniques adaptées en fonction des terrains. L’exploitation de ces ressources en surface ne serait pas incompatible avec Cigéo, même au droit des installations souterraines de Cigéo, qui seraient situées à 500 mètres de profondeur.
La géothermie profonde nécessite des investissements importants et est aujourd’hui mise en œuvre dans les zones avec à la fois des conditions géologiques favorables et des perspectives d’utilisation importante de la chaleur extraite. Concernant les conditions géologiques, un forage à 2000 mètres de profondeur dans les grès du Trias (Forage EST 433, Montiers-sur-Saulx) a été réalisé lors d’une campagne de reconnaissance menée en 2007-2008 afin de mesurer le potentiel du site. Les caractéristiques habituellement recherchées pour déterminer s’il existe un potentiel géothermique (salinité, température et productivité) ont été mesurées. Il en ressort que le sous-sol dans la zone étudiée pour l’implantation de Cigéo ne présente pas un caractère exceptionnel en tant que ressource potentielle pour une exploitation géothermique profonde. Dans son rapport n°4 de juin 2010, la CNE aboutit aux mêmes conclusions : « Le trias de la région de Bure ne représente pas une ressource géothermique potentielle attractive dans les conditions technologiques et économiques actuelles. »
Par ailleurs, même si le sous-sol de Bure ne présente aucun caractère exceptionnel, il est tout à fait possible de réaliser des projets de géothermie profonde dans la région en dehors de l’installation souterraine de Cigéo (qui serait implantée à l’intérieur d’une zone de 30 km²). Par précaution, l’Andra a tout de même envisagé que l’on puisse exploiter le sous-sol au niveau du stockage et qu’une intrusion puisse avoir lieu. Les analyses ont montré que même dans ce cas, le stockage conserverait de bonnes capacités de confinement. Comme dans le dossier 2005, l’Andra présentera dans le dossier de demande d’autorisation de création de tels scénarios d’intrusion, incluant des doublets de forage comme ceux pratiqués pour l’exploitation de la géothermie.
QUESTION 561
Posée par NC, le 22/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 20 novembre 2013 - La gouvernance du projet :
L'Allemagne serait le lieu idéal : où est Asse déjà ?
Réponse du 05/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La mine de Asse est en Basse-Saxe, à 10 km au sud-est de Wolfenbüttel.
Réponse apportée par Bernard Laponche, polytechnicien, docteur ès sciences en physique des réacteurs nucléaires, docteur en économie de l'énergie, membre de l'association Global Chance (www.global-chance.org) :
Rappelons les faits :
Le site de Asse, en Basse-Saxe, est une ancienne mine de sel dans laquelle 126 000 barils de déchets nucléaires ont été entreposés entre 1967 et 1978. Depuis des décennies, la mine souffre d’infiltrations d’eau. Des galeries s’effondrent, des barils seraient endommagés. Il y a risque de contamination de l’eau. Le Parlement allemand a voté une loi pour accélérer l’évacuation du site...
Rassurez-vous, la France n’a pas l’apanage de solutions dites sûres qui s’avèrent catastrophiques. Bien évidemment, lorsque le choix a été fait de stocker les déchets dans une ancienne mine de sel, cette solution a été présentée par les « spécialistes » allemands comme parfaitement sûre (ici aussi pour de très longues périodes). C’est raté !
Mais ce qu’a expliqué Madame Beate Kallenbach-Herbert, responsable « Ingénierie nucléaire et sûreté des installations » à l’Öko Institut, en Allemagne, pendant le débat du 20 novembre, ce n’est pas que les Allemands ne font pas eux aussi des erreurs grossières, mais qu’ils sont apparemment capables de le reconnaître. Et aussi, qu’ils savent organiser des débats publics dont ils tiennent compte dans leurs décisions politiques et surtout qu’il existe plusieurs instituts indépendants qui peuvent être consultés aussi bien par les autorités publiques que par des groupes d’opposants. C’est cela qui manque en France et qui a été souligné dans le débat. Tant que l’on ne reconnaîtra pas l’importance de la critique et de l’expertise indépendante, que l’on ne saura pas organiser de véritables débats publics sur le nucléaire et que les responsables politiques ignoreront ces débats, on aura vraiment du mal à traiter correctement la question des déchets comme, plus largement, celle de la politique nucléaire de la France.
QUESTION 560
Posée par NC, le 22/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 20 novembre 2013 - La gouvernance du projet :
Mais M. Laponche est aussi de ce système qu'il dénonce, non ?
Réponse du 05/12/2013,
Réponse apportée par Bernard Laponche, polytechnicien, docteur ès sciences en physique des réacteurs nucléaires, docteur en économie de l'énergie, membre de l'association Global Chance (www.global-chance.org) :
Question très délicate qui mériterait une définition du « système » et une discussion sur ce que cela implique. S’il s’agit du « système nucléaire », j’en ai effectivement fait partie puisque j’ai travaillé au CEA en physique des réacteurs nucléaires pendant les douze premières années de ma carrière professionnelle. La réponse est moins évidente pour les années passées comme responsable à la CFDT du CEA, puis au niveau national. On peut dire que je suis revenu dans le « système d’Etat » en étant directeur général de l’Agence française pour la maîtrise de l’énergie, ancêtre de l’ADEME actuelle, mais c’était sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelable, donc bien loin du nucléaire. Ensuite et depuis la fin des années 1980, j’ai travaillé comme consultant au plan international, en structure privée (bureau d’étude puis consultant indépendant) sur les politiques de maîtrise de l’énergie : je suis sorti professionnellement du « système ». C’est en fonction de mes capacités d’expert que j’ai eu l’honneur d’être le conseiller technique de Dominique Voynet en 1998 et 1999, sur les questions d’énergie et de sûreté nucléaire. Quant à mon affiliation à l’association Global Chance depuis sa création en 1992, elle est totalement indépendante et même critique vis-à-vis du « système ». Mais chacun peut en juger différemment selon son appréciation du dit système.
QUESTION 557
Posée par Joseph PRODHOMME, le 22/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 20 novembre 2013 - La gourvernance du projet :
Depuis 40 mn personne n'a parlé de la loi du 28 juillet 2006. Pour les "experts indépendants", le parlement de la république n'existe pas?
Réponse du 05/12/2013,
Réponse apportée par Bernard Laponche, polytechnicien, docteur ès sciences en physique des réacteurs nucléaires, docteur en économie de l'énergie, membre de l'association Global Chance (www.global-chance.org) :
La loi de 2006 a été très souvent citée au cours des premiers débats « video ». Elle constitue en effet la base du projet CIGEO et les « experts indépendants » la connaissent très bien. Elle constitue la « toile de fond » des différents débats. Je pense que dans l’esprit des intervenants du 20 novembre (y compris les « experts non indépendants »), elle est suffisamment connue pour qu’il ne soit pas nécessaire de la rappeler dans chaque séance. Ce fut probablement une erreur de ne pas l’avoir au moins mentionnée, je vous l’accorde.
Cela étant dit, il faut toutefois remarquer que cette loi n’a que timidement mentionné l’entreposage, et encore moins l’entreposage à sec en sub-surface des déchets radioactifs (combustibles irradiés notamment), comme l’exprimait en 2006 dans son « bilan du débat » le président de la CNDP, Yves Mansillon, dont je reproduis ci-dessous les propos :
« En ce qui concerne les déchets à vie longue, l’apport le plus notable du débat public est l’apparition d’une nouvelle stratégie possible.
Pendant une grande partie du débat, se sont confrontés les arguments des partisans du stockage en couche géologique profonde et des partisans de l’entreposage en surface ou sub-surface, ceux qui font confiance à la géologie et ceux qui font confiance à la société, comme le dit le compte-rendu. Puis s’est dégagée l’idée de l’entreposage pérennisé, non plus solution provisoire, fût-elle de longue durée, en attendant le stockage, mais autre solution à long terme ; on a relevé que certains, qui étaient vivement opposés à l’enfouissement, ne s’y déclaraient pas opposés.
Et de là apparaît la possibilité d’une nouvelle stratégie qui n’est apparemment critiquée par personne : celle consistant à prévoir dans la loi de 2006 à la fois la poursuite des expérimentations sur le stockage géologique, qui pour certains devrait constituer à l’avenir la « solution de référence » et sur un prototype à réaliser d’entreposage pérennisé ; cela permettrait, en l’absence de deuxième laboratoire, de recréer la possibilité d’un choix ; on utilise ainsi les délais, qui sont de toute façon indispensables pour être sûr de la faisabilité du stockage, pour se donner encore plus d’éléments d’éclairage de la décision à l’échéance suivante (2020) et pour se donner le temps de mieux prendre en compte les considérations éthiques ».
S’il est parfaitement normal de respecter la loi, il est regrettable que les élus de la République, de leur côté, ne tiennent pas compte des conclusions d’un débat public.
Et il est également regrettable que, quand cela « arrange », la loi ne soit pas respectée par le pouvoir exécutif, ce qui a été le cas pour la première loi sur les déchets radioactifs, celle de 1991, qui demandait que plusieurs laboratoires de recherche soient installés, alors que ce fut seulement le cas pour celui de Bure. La perte de confiance des citoyens sur ce sujet ne date donc pas d’hier... Elle n’a pu que se renforcer avec le passage subreptice d’un laboratoire à un centre de stockage sur le site de Bure, en dépit des déclarations officielles.
Enfin, comme le président de la CPDP l’a plusieurs fois souligné lors des débats video, une nouvelle loi peut modifier et même annuler la précédente si l’on s’aperçoit que l’on a fait fausse route. Je suis convaincu que c’est le cas, qu’il s’agisse du principe même d’enfouissement en profondeur des déchets radioactifs ou du projet CIGEO lui-même.
C’est le mieux que l’on puisse souhaiter au vu de l’inadaptation de la loi de 2006 à la réalité de la situation des déchets et des matières nucléaires dites « valorisables » (combustibles irradiés, notamment les MOX, plutonium, uranium appauvri d’enrichissement et surtout de retraitement, etc.).
QUESTION 556
Posée par Philippe , le 22/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 20 novembre 2013 - La gouvernance du projet :
Bonsoir, L'argent versé aux territoires d'accueil de Cigéo pourrait-il être géré de manière participative, dans l'esprit des budgets participatifs ?
Réponse du 10/01/2014,
Réponse apportée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Les sommes issues des taxes d’accompagnement et de diffusion technologique sont gérées par deux groupements d’intérêt public (GIP) en Meuse et en Haute Marne, afin de réaliser les actions suivantes décrites à l’article L. 542-11 du Code de l’environnement :
1° « gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation du laboratoire ou du centre de stockage » ;
2° « mener, dans les limites de son département, des actions d'aménagement du territoire et de développement économique, particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils généraux concernés » ;
3° « soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques, notamment dans les domaines étudiés au sein du laboratoire souterrain et dans ceux des nouvelles technologies de l'énergie. »
Les instances de gouvernance des GIP (conseil d’administration, assemblée générale) statuent sur les demandes de subventions, le programme annuel d’activités du GIP et le budget correspondant, et vérifient la cohérence des actions du GIP avec les missions définies par la loi du 28 juin 2006. Dans le cadre du contrôle de légalité, l’Etat contrôle que l'affectation des ressources fiscales et des dépenses des collectivités respectent la réglementation. De plus, l'Etat, est administrateur ou commissaire du gouvernement des GIP et vérifie dans ce cadre l’utilisation des ressources qui leur sont dévolues. Les décisions des GIP font l’objet d’une publicité permettant d’assurer la visibilité de son action et la traçabilité de l’utilisation des fonds. Il n'est pas envisagé à ce jour de gestion des fonds en dehors des modes de représentation prévus par les institutions en place.
Réponse apportée par Patricia Andriot, vice-présidente du Conseil Régional Champagne-Ardenne :
Cela serait effectivement une demande justifiée compte tenu de la justification des ces fonds. Cela dit pour avoir déjà esquissé cette question au sein du GIP 52 et pour en voir la gestion actuelle, force est de reconnaître que nous sommes à des années lumières de cette approche. La logique de gestion participative de budget ne semble pas dans le "logiciel "actuel des membres du GIP qui voient cela comme une utopie d'écolo !! Et même sans aller jusqu'à une gestion participative, des progrès pourraient être faits en matière de transparence. La diffusion de toutes les aides attribuées sur un site internet dédié, que j'ai demandé à plusieurs reprises n'est pas acquise, même si le site existe maintenant et qu'il y a quelques progrès et seules les aides au delà de 20 000 euros sont soumises au conseil d'administration. Tout le reste est décidé par un comité exécutif restreint.
QUESTION 555
Posée par ISEF, le 22/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 13 novembre 2013 - Coûts et financement du projet :
Bonjour, Nous parlons ce soir du coût du projet. On a pu lire dans la presse qu'edf trouvait cigéo trop cher. Début novembre, edf a publié son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de 2013. Il s'élève « à 55,2 milliards d'euros, en croissance de 6,9% par rapport à la même période en 2012 en raison principalement d'un effet périmètre lié à la prise de contrôle d'Edison en mai 2012. » Si on considère que Cigéo coûte un peu plus de 35 milliards… edf a donc largement de quoi payer pour les déchets une bonne fois pour toute et nous protéger, ce qui me semble le plus important, non ? Qu’en pense le monsieur d'edf ?
Réponse du 20/12/2013,
Réponse apportée par Edf :
Comme l’a indiqué le représentant d’EDF lors du débat contradictoire du 13 novembre, EDF a provisionné, sous forme d’actifs dédiés, sa quote-part des coûts futurs de Cigéo, sur la base du chiffrage publié par le Ministère de l’Energie en 2005. 5,7 milliards d’euros ont été provisionnés à cet effet. Un nouveau chiffrage sera publié par le ministre en 2014, et EDF adaptera, si nécessaire, ses provisions en conséquence. Ce mécanisme permet de garantir que les coûts complets de Cigéo sont bien pris en charge dès maintenant par les consommateurs de l'électricité produite par les centrales nucléaires à l’origine des déchets qui y seront stockés. Aux côtés de l’Andra, EDF s’implique activement dans la recherche, sans aucun compromis sur la sûreté de court et de long terme, de l’optimisation technico-économique du futur ouvrage Cigéo : cette optimisation contribuera à la compétitivité de la production électronucléaire en France, au bénéfice des entreprises et des ménages français, qui payent aujourd’hui leur kWh deux fois moins cher que leurs voisins allemands.
Réponse apportée par Benjamin Dessus, ingénieur, économiste et président de l’association Global Chance :
Cette question s’adresse à EDF. Je voudrais seulement dire que les 55 milliards ne sont pas les bénéfices d’EDF mais son chiffre d’affaires ce qui n’est évidemment pas pareil. Ne pas oublier qu’EDF fabrique 500 TWh d’électricité et que cela a un coût (des salaires, des équipements, des combustibles, etc.). Par conséquent EDF ne dispose pas de 55 milliards tous les ans pour une dépense du genre CIGEO mais de quelques pour cent de cette somme seulement.
QUESTION 554
Posée par Daniel RUHLAND, le 22/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 13 novembre 2013 - Coûts et financement du projet :
En ce qui concerne l’enfouissement, quelles vont-être les aides précises pour le canton de Montiers/Saulx ? En clair, qui touchera, combien, quand et de quelle manière ? La loi du 28 juin 2006 a instauré des inégalités flagrantes au sein même du canton en ce qui concerne les dotations ; les communes de plus de 10 kms étant exclues (seules 6 communes sur 14 sont indemnisées) ce qui provoque des tensions inévitables (idem pour les cantons de Gondrecourt et Poissons). La prochaine loi sera-t’elle aussi injuste ? Le Canton sera–t’il enfin reconnu dans sa globalité ?
Réponse du 09/01/2014,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
La question posée fait référence aux modalités de répartition actuelles sur le territoire des taxes d’accompagnement et de diffusion technologique, qui sont aujourd’hui liées à la présence du laboratoire souterrain de l’Andra. La loi prévoit actuellement qu’une partie de ces taxes soit reversée dans les communes situées à moins de 10 km du laboratoire. Les groupements d’intérêt publics (GIP) qui reçoivent ces taxes financent également des projets sur l’ensemble des départements de Meuse et de Haute Marne.
S’il est autorisé, le projet Cigéo sera soumis à la fiscalité locale, notamment la taxe foncière et la contribution économique territoriale. Ces taxes seront versées par l’Andra pendant toute la durée de vie de l’installation. Les montants de fiscalité précis sont en cours d’évaluation dans le cadre du chiffrage du projet. Ils seront de l’ordre de plusieurs milliards d’euros répartis sur plus de cent ans.
Le Comité de Haut Niveau, regroupant les élus locaux meusiens et haut-marnais, les producteurs de déchets, l’Andra et les services de l’Etat, a retenu le principe de la création d'une Zone Interdépartementale (ZID) regroupant les communes les plus proches de Cigéo. L’objectif de la ZID est de permettre de redistribuer de manière adéquate au sein des communes, des communautés de communes et des deux départements les revenus fiscaux générés par CIGEO. Cette ZID sera dotée d’une gouvernance afin d’accompagner le développement du territoire suite à l’implantation du stockage. Justice et efficacité seront recherchées, pour assurer l'implantation et le développement du projet dans des conditions respectueuses des équilibres locaux.
QUESTION 553
Posée par Francis DUPUY, le 22/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 13 novembre 2013 - Coûts et financement du projet :
Pourquoi nous avoir menti sur Bure ? L'eau chaude à 66° est certainement plus intéressante que les déchets atomiques ; les intérêts pécuniers meilleurs alors que les déchets vont se répandre dans les nappes. Merci les faux ingénieurs payés par l'Andra
Réponse du 06/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Avant de porter des jugements de valeur sur les hommes et les femmes qui travaillent à l’Andra, nous vous invitons à venir les rencontrer pour qu’ils puissent vous présenter leur travail et répondre personnellement à vos allégations.
L’Andra n’a pas menti ni nié le potentiel géothermique du site étudié pour l’implantation du stockage.
Comme partout ailleurs en France, la géothermie dite de surface (qui permet d’alimenter des maisons individuelles et des immeubles collectifs ou tertiaires via des pompes à chaleur) est réalisable localement. L’exploitation de ces ressources en surface ne serait d’ailleurs pas incompatible avec Cigéo, même au droit des installations souterraines de Cigéo, qui seraient situées à 500 mètres de profondeur.
Les études et les conclusions de l’Andra portent sur le potentiel géothermique profond du site mesuré grâce à un forage à 2000 mètres de profondeur dans les grès du Trias (Forage EST 433, Montiers-sur-Saulx) réalisé lors d’une campagne de reconnaissance menée en 2007-2008. Les caractéristiques habituellement recherchées pour déterminer s’il existe un potentiel géothermique (salinité, température et productivité) ont été mesurées. Il en ressort que le sous-sol dans la zone étudiée pour l’implantation de Cigéo ne présente pas un caractère exceptionnel en tant que ressource potentielle pour une exploitation géothermique profonde. Dans son rapport n°4 de juin 2010, la CNE aboutit aux mêmes conclusions : « Le trias de la région de Bure ne représente pas une ressource géothermique potentielle attractive dans les conditions technologiques et économiques actuelles. »
Par ailleurs, même si le sous-sol de Bure ne présente aucun caractère exceptionnel, il est tout à fait possible de réaliser des projets de géothermie profonde dans la région en dehors de l’installation souterraine de Cigéo (qui serait implantée à l’intérieur d’une zone de 30 km²). Par précaution, l’Andra a tout de même envisagé que l’on puisse exploiter le sous-sol au niveau du stockage et qu’une intrusion puisse avoir lieu. Les analyses ont montré que même dans ce cas, le stockage conserverait de bonnes capacités de confinement. Comme dans le dossier 2005, l’Andra présentera dans le dossier de demande d’autorisation de création de tels scénarios d’intrusion, incluant des doublets de forage comme ceux pratiqués pour l’exploitation de la géothermie.
Réponse apportée par Benjamin Dessus, ingénieur, économiste et président de l’association Global Chance :
Je ne sais pas si les ingénieurs de l’Andra ont menti, ou si, obnubilés par leur projet, ils ont minimisé ce risque réel à moyen et long terme, mais nous savons depuis le début des années 80 grâce au BRGM qu’il existe une ressource géothermique dans les sous sl de Bure. Il est vrai que cette ressource ne trouverait probablement pas de clients en ce moment car il n’y a pax de concentration de population importante au niveau local pour utiliser cette source de chaleur basse température comme dans la région parisienne. Mais dans 100, 500 ans ou 1000 ans quand on aura oublié Cigeo depuis belle lurette il n’est pas impossible qu’on se réintéresse à cette ressource alors que les énergies fossiles seront épuisées… Plus généralement, j’aimerais faire remarquer que l’ensemble du sous sol terrestre deviendra une magnifique source d’énergie thermique si la géothermie des roches sèches se développe ce qi paraît possible au moins sur le plan technique (voir le pilote de Soultz en Alsace)…
QUESTION 552
Posée par Jacques MERY, le 22/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 13 novembre 2013 - Coûts et financement du projet :
S'il faut provisionner des fonds comme c'est maintenant imposé par la loi, y a t-il des leçons à tirer de la crise financière de 2008 concernant la stabilité financière des actifs concernés ? On peut certes toujours se dire qu'un Etat pourra lever l'impôt nécessaire si la sphère financière faisait défaut, mais tout le monde peut déjà constater l'apparent égoisme (pour ne pas dire nimbysme) fiscal règnant actuellement dans notre pays...
Réponse du 09/01/2014,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
L'article 20 de la loi du 28 juin 2006 pose le principe de la responsabilité première de l'exploitant d’une installation nucléaire pour le provisionnement des charges de gestion à long terme des déchets radioactifs qu’il produit et la couverture de ces charges par des actifs dédiés à leur financement. La responsabilité de constituer et de gérer ces actifs est à la charge de l'exploitant. Il doit s'assurer à tout moment que leur valeur de marché est supérieure au niveau requis. Il dispose pour cela d'outils de gestion actif-passif tenant compte de l'historique des rendements de ses actifs, y compris pendant la
précédente crise financière. Tout cela est étroitement contrôlé par l’Etat. A cet égard, en vertu des articles L. 594-1 et suivants du code de l'environnement (articles codifiés correspondants à l'article 20 de la loi du 28 juin 2006), l'exploitant fournit chaque année au gouvernement des documents qui doivent notamment montrer que les actifs dédiés sont suffisamment sûrs, liquides et rentables. »
QUESTION 551
Posée par Jacques MERY, le 22/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 13 novembre 2013 - Coûts et financement du projet :
On a entendu parler d'un coût de CIGEO de 15G€, puis de 30G€ : où en est-on actuellement, en particulier en fonction des diverses hypothèses de réversibilité ?
Réponse du 08/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le chiffrage officiel arrêté par l’Etat en 2005 au stade des études de faisabilité scientifique et technique était d’environ 15 milliards d’euros. En 2009, l’Andra a réalisé une estimation préliminaire d’environ 35 milliards d’euros avant le lancement de la phase de conception industrielle et des optimisations en cours d’étude. Avant de finaliser un nouveau chiffrage, l’État a demandé à l’Andra de poursuivre les études permettant de prendre en compte les suites du débat public, les recommandations des évaluateurs et les pistes d’optimisation identifiées en 2013. Ce chiffrage sera finalisé par l’Andra en 2014. Conformément à la loi du 28 juin 2006, c’est le ministre chargé de l’énergie qui arrêtera l’évaluation des coûts et la rendra publique, après avoir recueilli les observations des producteurs de déchets radioactifs et l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire. Concernant la réversibilité, c’est le Parlement qui en fixera les conditions dans une future loi.
Réponse apportée par Benjamin Dessus, ingénieur, économiste et président de l’association Global Chance :
On en est nulle part. Andra dit maintenant qu’elle ne sera capable de chiffrer son projet qu’en juin 2014. De deux choses l’une : ou l’Andra ne connaît pas le coût car il faut faire encore beaucoup d’études de faisabilité pour s’en faire une idée, ou bien elle sait déjà que cela va coûter beaucoup plus de 36 milliards et préfère n’en pas parler. Dans les deux cas c’est inquiétant, d’autant qu’on sait bien que pour ce genre de chantier il y a encore souvent un facteur 2 ou 3 entre le devis initial et le coût réel.
QUESTION 550
Posée par Jacques MERY, le 22/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 13 novembre 2013 - Coûts et financement du projet :
Comment l'ANDRA compte t-elle équilibrer ses recettes et dépenses : en espérance mathématique des flux et prix futurs actualisés (à quel taux ?), en fonction de scenarios contrastés (avec quel scenario alors retenu ?), et sur quel horizon temporel (en particulier si on veut comparer avec une option d'entreposage de longue durée) ?
Réponse du 08/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Conformément à la loi du 28 juin 2006, le financement de la construction, de l’exploitation et de la fermeture de Cigéo sera assuré intégralement par les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC), au travers de conventions à mettre en place avec l’Andra.
QUESTION 549
Posée par Jacques MERY, le 22/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 13 novembre 2013 - Coûts et financement du projet :
Bonjour, Tant que CIGEO aura des clients solvables (les producteurs de déchets qui auront l'obligation de se défaire de leurs déchets dans des conditions imposées par la loi), la construction et l'exploitation du centre pourra être financée. Il se peut même que CIGEO ne soit jamais définitivement fermé dans la mesure où il n'y a pas de raison que la clientèle disparaisse rapidement (sauf abandon brutal et définitif de la filière électro-nucléaire ?). Mais comment se passera le financement le jour où la fermeture du centre est décidée et que le centre n'a donc plus de "clients" ?
Réponse du 09/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 548
Posée par Sylvie SAUVAGE, le 22/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 13 novembre 2013 : Coûts et financement du projet :
Allons, Mr Bernet, les dossiers financiers s'ils ne peuvent être présentés dans les 15 jours, c'est qu'ils n'existent pas ! Moi aussi, j'aimerais bien les lire
Réponse du 04/02/2014,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Le document du maître d'ouvrage contient une section dédiée au coût et au financement du projet. Comme indiqué lors de la séance du débat contradictoire consacrée à cette question, de nombreux documents existent sur la question du coût et du financement du projet, qui sont consultables sur internet et qui vont au-delà du niveau d’évaluation habituel mis en œuvre sur les projets soumis à débat public.
La dernière évaluation du coût arrêtée par le ministère de l’énergie, présentée dans le dossier du maître d'ouvrage, est fondée sur un rapport de juillet 2005 téléchargeable au lien suivant http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-gt-cout-stockage.pdf. Ce rapport très complet détaille les hypothèses prises, les différents scénarios de chiffrage, la répartition des coûts entre les différents postes et les méthodes de comptabilisation des risques et opportunités.
Cette évaluation est appelée à être mise à jour en fonction de l'avancée de la conception du projet. La nouvelle évaluation du coût n'est en effet pas finalisée. Dans le contrat d'objectif de l'Andra, le Gouvernement lui a demandé de mettre à jour le chiffrage en prenant en compte les modifications éventuelles apportées au projet par l’Andra suite au débat public. Le nouveau chiffrage sera bien entendu rendu public.
La question des coûts de long terme du nucléaire et du mécanisme de leur financement a été traitée dans le rapport de la Cour des Comptes de janvier 2012 (../docs/docs-complementaires/docs-avis-autorites-controle-evaluations/rapport-thematique-filiere-electronucleaire.pdf), le rapport de la Commission nationale d'évaluation du financement des charges de long terme (CNEF) de juillet 2012 (http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/1207_10_Rapport_de_la_CNEF.pdf) et le rapport de la commission d'enquête du Sénat sur les coûts réels de l'électricité de juillet 2012 (http://www.senat.fr/commission/enquete/cout_electricite/).
Des informations détaillées sur la gestion des actifs sécurisant la couverture des charges de long termes sont disponibles dans les documents de référence des exploitants nucléaires, consultables eux aussi sur internet.
Réponse apportée par EDF :
Les rapports financiers annuels et semestriels d'EDF, disponibles sur le site internet http://finance.edf.com>, comportent en annexe le détail des provisions constituées pour la gestion à long terme des déchets radioactifs, ainsi que le détail des actifs financiers dédiés à la sécurisation de ces engagements de long terme.
QUESTION 547
Posée par Jean COUDRY (SAINT DIZIER), le 22/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 13 novembre 2013 - Coûts et financement du projet :
Retarder le calendrier ne ferait-il pas augmenter le côut du traitement des déchets?
Réponse du 09/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La mise en œuvre du stockage limite les charges reportées sur les générations suivantes et ouvre la voie à une mise en sécurité définitive des déchets les plus radioactifs. Un décalage du calendrier réduirait le coût actualisé du projet en reportant dans le temps les dépenses liées à la mise en œuvre du stockage. Néanmoins, dans l’attente de la mise en œuvre de cette solution, de nouvelles capacités d’entreposage seraient nécessaires pour accueillir les déchets produits et remplacer les entrepôts existants lorsque leur durée de vie sera atteinte.
QUESTION 546
Posée par Michel GUERITTE, le 22/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 13 novembre 2013 - Coûts et financement :
Il n'y a rien dans les rapports de la CNEF. La CNE exige même un chiffrage sérieux avant la fin 2013.
Réponse du 09/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le chiffrage officiel arrêté par l’Etat en 2005 au stade des études de faisabilité scientifique et technique était d’environ 15 milliards d’euros. Avant de finaliser un nouveau chiffrage, l’État a demandé à l’Andra de poursuivre les études permettant de prendre en compte les suites du débat public, les recommandations des évaluateurs et les pistes d’optimisation identifiées en 2013. Ce chiffrage sera finalisé par l’Andra en 2014. Conformément à la loi du 28 juin 2006, c’est le ministre chargé de l’énergie qui arrêtera l’évaluation des coûts et la rendra publique, après avoir recueilli les observations des producteurs de déchets radioactifs et l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire.
QUESTION 545
Posée par Françoise , le 22/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 13 novembre 2013 - Coûts et financement :
Un son mais pas d'images ça nous concernent un peu beaucoup puisque j'habite à coté de BURE mais internet c'est pas le top, à nous les déchets et surtout ne pas se renseigner
Réponse du 19/12/2013,
Il est très regrettable que vous n’ayez eu que le son et pas d’image lors de la retransmission du débat contradictoire du 13 novembre 2013 sur les coûts et le financement de Cigéo. Des problèmes techniques ont été rencontrés parfois localement ils ont été heureusement de faible ampleur. Vous pouvez retrouver l’ensemble des débats publics contradictoires en ligne sur le site internet du débat public (debatpublic-cigeo.org) et visionner si vous le souhaitez le débat du 13 novembre.
QUESTION 543
Posée par Michel MARIE, le 22/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 13 novembre 2013 - Coûts et financement du projet :
Comment expliquer qu'il n'y ait qu'un seul expert indépendant sur 4 intervenants ? quant à la DGEC, que nous connaissons ô combien, elle a largement prouvé sa non indépendance
Réponse du 19/12/2013,
Le financement du projet Cigéo est un dossier sur lequel il était nécessaire d’avoir le maximum de représentants officiels capables de répondre aux questions des internautes. Plus que de contradiction il s’agissait ici de rassembler les données financières les plus récentes auprès des responsables présents : ministère chargé de l’énergie, EDF et maître d’ouvrage.
QUESTION 542
Posée par Michel MARIE, le 22/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 13 novembre 2013 - Coûts et financement :
Est-il vrai qu'un intervenant est invité à débattre sans avoir auparavant les informations voulues ?
Réponse du 19/12/2013,
Benjamin Dessus de l’association Global Chance a été invité à participer au débat contradictoire du 13 novembre 2013 en ayant eu connaissance comme l’ensemble du public des documents disponibles à cette date sur ce sujet et mis en ligne notamment sur le site internet de la CPDP. Le dossier du maître d’ouvrage indique dans la partie consacrée au financement que « le ministère chargé de l’énergie souhaite arrêter une nouvelle évaluation fin 2013. Un état d’avancement pourra être fait lors du débat public ». La CNDP dans son communiqué du 6 février 2013 a considéré le dossier comme suffisamment complet pour être soumis au débat public, sous réserve que soient explicités à l’occasion du débat les questions financières. La CPDP a fixé l’organisation du débat contradictoire sur le financement à la fin du débat public afin de laisser le maximum de temps à la mise au point de cette nouvelle évaluation. Lors du débat du 13 novembre le représentant de l’Etat n’a pas communiqué de nouveaux éléments et les a annoncés pour 2014 compte tenu de la complexité des données à quantifier. La CPDP le regrette et fera bien évidemment mention de cet élément dans son compte rendu.
QUESTION 541
Posée par Sylvie SAUVAGE, le 22/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 13 novembre 2013 - Coûts et financement du projet :
Pourquoi ne laissez-vous pas Mr Dessus s'expliquer jusqu'au bout ? je n'apprécie pas les interruptions de la journaliste
Réponse du 16/12/2013,
L’animation d’un débat en direct sur un sujet complexe nécessite un professionnalisme certain. La CPDP a donc fait appel à une société spécialisée et la journaliste a animé l’ensemble des débats contradictoires avec sérieux et en toute impartialité. M. Dessus a eu le temps nécessaire pour exprimer sa position avant de quitter le débat du 13 novembre 2013.
QUESTION 540
Posée par Laurine DEROY, le 22/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 13 novembre 2013 - Coûts et financement du projet :
Beaucoup de personnes sont opposées à ce projet Cigéo. Le contribuable va-t-il trinquer pour le payer ?
Réponse du 30/01/2014,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Le financement de la gestion des matières et déchets radioactifs est assuré, sous le contrôle de l’État, par les exploitants nucléaires, selon le principe « pollueur-payeur ».
Le projet Cigéo est donc entièrement financé par les exploitants nucléaires producteurs de déchets : EDF, Areva, CEA. Cela comprend donc les coûts des recherches, des études, de la construction, de l’exploitation, de la surveillance et de la fermeture.
Un dispositif de sécurisation du financement des charges nucléaires de long terme, est institué dans la loi du 28 juin 2006 codifiée au code de l'environnement. Il prévoit la constitution d'un portefeuille d'actifs dédiés par les exploitants nucléaires au cours de l'exploitation. Pour cela, les exploitants sont tenus d'évaluer l’ensemble de leurs charges de long terme parmi lesquelles figurent les charges liées au projet Cigéo. Ils doivent assurer dès à présent, la couverture de ces charges à venir par la constitution d'actifs dédiés qui doivent présenter un haut niveau de sécurité.
Réponse apportée par Benjamin Dessus, ingénieur, économiste et président de l’association Global Chance :
A priori selon le principe pollueur payeur, ce sont les producteurs de déchets, en particulier EDF, qui vont payer l’enfouissement, donc les consommateurs que nous sommes. Mais il y a deux limites importantes :
- le débat tronqué du 13 novembre sur internet montre qu’on ne connaît pas le coût du projet : 16,5 milliards, 35,5 ou 100 nous n’en savons rien. Et si le coût se révèle beaucoup plus élevé que « prévu » si j’ose dire, EDF s’adressera probablement à l’ETAT pour éviter la faillite
- les provisions constituées par EDF consistent à placer chaque année pendant 120 ans une somme donnée à 5%. Cela suppose à la fois qu’EDF existe encore dans 120 ans , ce qui est très improbable et qu’on puisse placer de l’argent à 5% pendant 100 ans, ce qui sourire tout financier honnête..
Il me semble donc très probable qu’on s’adresse dans quelque temps à la poche des contribuables en plus de celle des consommateurs.
QUESTION 539
Posée par Yves BERTHELEMY, le 22/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 13 novembre 2013 - Coûts et finanacement du projet :
La science d'aujourd'hui peut elle prévoir et endiguer les catastrophes de demain, peut elle en déterminer les coûts industriels et humains...?
Réponse du 05/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestions sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. Du fait de son implantation à 500 mètres de profondeur, il sera peu vulnérable aux activités humaines comme aux catastrophes naturelles. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique, qui assure le confinement de la radioactivité à très long terme, et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de ces déchets. Grâce à la réversibilité, les générations suivantes garderont la possibilité de faire évoluer cette solution si elles le souhaitent.
Réponse apportée par Benjamin Dessus, ingénieur, économiste et président de l’association Global Chance :
Il est bien évident que la science même avec un grand « S » n’est pas capable de répondre à ces questions mais en même temps elle n’est pas sans ressources :
- d’abord parce qu’elle peut progresser à un rythme inattendu : souvenez vous qu’il y a cent ans on ne savait rien de la radioactivité, alors dans 100 ans on peut fort bien avoir trouvé un moyen de réduire celle des déchets,
- ensuite parce qu’elle nous permet déjà de mesurer les incertitudes qu’il reste à lever dans le domaine du stockage des déchets et
- enfin parce qu’elle sait déjà très bien qu’elle ne pourra jamais affirmer avec sérénité que les déchets ne ressortiront pas à la surface de la terre avant 100 000 ans.
La proposition de l’enfouissement relève donc en grande partie de l’idée de pari et pas de la science. On a bien le droit de prendre ce pari mais c’est une question d’éthique et de société dans laquelle la science et ses certitudes ne peut jouer un rôle que mineur.
QUESTION 538 - irréversibilité impossible
Posée par bern BONDIS, L'organisme que vous représentez (option) (MIREPOIX), le 21/11/2013
En Allemagne à Asse le stockage en profondeur s'est très mal passé alors que tout devait bien se dérouler ,pourquoi en serait il autrement à Bure, comment pouvez vous garantir l'imprévisible ? En cas d'incendie il sera impossible d'intervenir (regardons ce qu'il s'est passé dans les incendies en Autriche dans le funiculaire, en France au Mont Blanc ). Ne serait il pas plus sage de stocker les déchets sur les sites de production ?
Réponse du 09/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
En aucun cas la mine de Asse en Allemagne ne peut être comparée au projet Cigéo. Le stockage à Asse a été réalisé au titre du droit minier et non des réglementations de la sûreté nucléaire telles qu’elles existent aujourd’hui. Il s’agit d’une ancienne mine de sel qui a été reconvertie en un stockage de déchets radioactifs en 1967. Lors du creusement de la mine, aucune précaution n’avait été prise pour préserver le confinement assuré par le milieu géologique. Le stockage n’avait pas non plus été conçu au départ pour être réversible. Les difficultés rencontrées aujourd’hui à Asse illustrent pleinement l’importance d’une démarche d’étude scientifique et d’évaluation préalablement à la décision de mettre en œuvre un projet de stockage.
Pour que le projet puisse être autorisé, l’Andra doit démontrer à l’Autorité de sûreté nucléaire qu’elle maîtrise les risques liés à l’installation, que ce soit pendant son exploitation ou après sa fermeture. Ainsi, conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie les dangers potentiels qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation en amont de la conception. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels montre que leurs conséquences resteraient limitées, et nettement en deçà des normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire.
Le risque incendie est bien sûr pris en compte dès la conception de Cigéo pour garantir la protection du personnel et des riverains. Des dispositions sont prises pour limiter ce risque, le détecter rapidement et faciliter une intervention rapide des secours en cas d’incendie. Une première mesure consiste à limiter la quantité de produits combustibles ou inflammables dans les équipements du stockage. Par exemple, si Cigéo est réalisé, les câbles électriques seront ignifugés et les véhicules à moteur thermique seront interdits dans l’installation nucléaire souterraine de Cigéo. De plus, des dispositifs de détection incendie seront répartis dans les installations pour détecter rapidement et localiser tout départ de feu. Plusieurs systèmes d’extinction automatiques seront installés dans l’installation souterraine. Des systèmes de compartimentage et de ventilation sont prévus pour limiter la propagation du feu. Des équipements d’intervention seront prépositionnés dans l’installation souterraine en permanence. L'architecture souterraine retenue pour le stockage permettra aux secours d'intervenir dans des galeries à l'abri des fumées et facilite l'évacuation du personnel. Outre la mise à l’abri du personnel, la maîtrise du risque incendie vise aussi à protéger les colis contenant les substances radioactives des effets de l’incendie afin de maintenir le confinement de ces substances. Pour cela, les colis seront disposés dans des équipements qualifiés pour résister au feu. Les conteneurs de stockage sont également conçus pour assurer une protection contre l’incendie. Ces dispositions permettent d’exclure tout effet domino entre les colis stockés. La définition de l’ensemble de ces dispositifs associe les services compétents des sapeurs-pompiers et fait l’objet de contrôle par l’Autorité de sûreté nucléaire.
Les déchets les plus radioactifs destinés à Cigéo sont des déchets dangereux, qui le resteront plusieurs dizaines à centaines de milliers d’années. Ces déchets, produits en France depuis les années 1960, sont actuellement entreposés de manière sûre mais provisoire dans des bâtiments sur leurs sites de production, dans l’attente d’une solution de gestion à long terme. Ces installations d’entreposage ne sont pas conçues pour confiner la radioactivité à très long terme. En cas de perte de contrôle de telles installations, les conséquences radiologiques sur l’homme et l’environnement ne seraient pas acceptables. Le but du stockage profond est de protéger l’homme et l’environnement de la dangerosité de ces déchets sur de très longues durées. Si Cigéo est autorisé, il donnera ainsi la possibilité aux générations suivantes de mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs. La réversibilité leur permettra également de faire évoluer cette solution si elles le souhaitent.
QUESTION 537 - Déchets MA-VL
Posée par Charles FRIBOURG, L'organisme que vous représentez (option) (ANTONY), le 21/11/2013
Quelles sont les bases de l'évaluation prévisionnelle des volumes et masses de déchets MA-VL pris en compte pour définir les capacités du stockage correspondant?
Réponse du 05/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le projet de stockage profond Cigéo est conçu pour mettre en sécurité définitive les déchets dont le niveau de radioactivité et la durée de vie ne permettent pas de les stocker, de manière sûre à long terme, en surface ou à faible profondeur.
Les déchets concernés proviennent principalement du secteur de l’industrie électronucléaire et des activités de recherche associées ainsi que, dans une moindre part, des activités liées à la Défense nationale. Les déchets dits de « haute activité » (HA) correspondent principalement aux résidus hautement radioactifs issus du traitement des combustibles nucléaires usés utilisés pour la production d’électricité. Les déchets dits de « moyenne activité à vie longue » (MA-VL) ont des origines variées : résidus issus du traitement des combustibles nucléaires usés et de la fabrication de certains combustibles, composants (hors combustible) ayant séjournés dans les réacteurs nucléaires, déchets technologiques issus de la maintenance des installations nucléaires, de laboratoires, d’installations liées à la Défense nationale, du démantèlement...
Cigéo est conçu pour prendre en charge les déchets produits par les installations nucléaires existantes. Les volumes de déchets HA et MA-VL sont estimés à environ 10 000 m3 pour les déchets HA (soit environ 60 000 colis de déchets) et environ 70 000 m3 pour les déchets MA-VL (soit environ 180 000 colis de déchets) dans l’hypothèse d’une poursuite de la production électronucléaire* et d’une durée de fonctionnement des installations nucléaires existantes de 50 ans. Dans cette hypothèse, 30 % des déchets HA et 60 % des déchets MA-VL sont déjà produits. Par précaution, des volumes supplémentaires (environ 20 % du volume de déchets MA-VL à stocker) sont prévus en réserve dans Cigéo pour certains déchets de faible activité à vie longue qui, le cas échéant, ne pourraient pas être stockés dans le stockage à faible profondeur à l’étude par l’Andra.
Cigéo est conçu pour être flexible afin de pouvoir s’adapter à d’éventuels changements de la politique énergétique. En cas d’arrêt de la production électronucléaire et d’arrêt du traitement des combustibles nucléaires usés, environ 3 500 m3 de déchets HA, 59 000 m3 de déchets MA-VL et 90 000 m3 de combustibles usés non traités seraient destinés au stockage. A la demande du Ministère en charge de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, l’Andra, EDF et Areva ont étudié l’impact des différents scénarios établis dans le cadre du débat national sur la transition énergétique sur la production de déchets radioactifs et sur le projet Cigéo : ../docs/rapport-etude/20130705-courrier-ministere-ecologie.pdf
* Les déchets produits par un éventuel futur parc de réacteurs ne sont pas pris en compte.
QUESTION 536 - En admettant que 1000 milliards de becquerels sont stockés, dans combien de temps est ce que les déchets seront devenus inoffensifs?
Posée par Simon BOULANGER, L'organisme que vous représentez (option) (BELGIQUE), le 21/11/2013
En prenant pour hypothèse qu'il y a 1000 milliards de becquerels, quelle est le temps nécessaire pour que les déchets ne soient plus dangereux?
Réponse du 05/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La radioactivité des déchets diminue au fil du temps du fait de la décroissance de la radioactivité qu’ils contiennent. Cette décroissance est plus ou moins lente en fonction de la nature des déchets. Les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue destinés à Cigéo resteront dangereux plusieurs centaines de milliers d’années, c’est pourquoi la France comme de nombreux autres pays étudient le stockage profond pour mettre en sécurité ces déchets radioactifs sur le très long terme.
Si vous souhaitez plus d’informations sur la radioactivité et sur les temps de décroissance de différents radionucléides (Tritium, Carbone 14, Iode 129…), vous pouvez consulter l’annexe 1 du dossier du maître d’ouvrage qui porte sur la radioactivité : ../docs/dmo/chapitres/DMO-Andra-annexes.pdf
QUESTION 535 - Durée du risque présenté par le stockage
Posée par Pascal PEYROT, L'organisme que vous représentez (option) (SAINT ROMAIN EN JAREZ), le 21/11/2013
Au bout de combien de temps le stockage (tel que décrit actuellement et avec le contenu envisagé) ne présentera plus aucun danger de radiotoxicité, quelle que soit l’activité mise en œuvre aux environs de cigéo (forage, fracturation hydraulique, exploitation minière, ...) ?
Réponse du 05/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La radioactivité des déchets diminue au fil du temps du fait de la décroissance de la radioactivité qu’ils contiennent. Cette décroissance est plus ou moins lente en fonction de la nature des déchets. Les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue destinés à Cigéo resteront dangereux plusieurs centaines de milliers d’années, c’est pourquoi la France comme de nombreux autres pays étudient le stockage profond pour mettre en sécurité ces déchets radioactifs sur le très long terme.
QUESTION 534
Posée par CONFRONTATIONS EUROPE, le 21/11/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de Confrontations Europe :
La « récuperabilité » doit être acquise, mais si elle est longue, cela ne pourrait-il pas limiter une réaction rapide à un accident majeur ?
Réponse du 09/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La sûreté de l’installation doit être acquise indépendamment de la réversibilité. Si un accident devait survenir, l’installation sera mise en sécurité par la pose rapide d’équipements provisoires (ventilation, barrière de confinement…) et non par une opération de retrait de colis. Une fois la mise en sécurité réalisée, l’exploitant examinera les dispositions à mettre en œuvre pour reprendre l’exploitation normale en tout sûreté. Le maintien en stockage de colis, même endommagés, ou leur retrait éventuel pourra être décidé sans caractère d’urgence. S’il était décidé de retirer un grand nombre de colis
du stockage, des installations spécifiques seraient alors à construire en surface pour les gérer (pour leur entreposage, leur réexpédition, leur traitement…). Toute opération notable de retrait de colis de déchets devra faire l’objet d’une autorisation spécifique.
Pour plus d’informations sur les propositions de l’Andra en matière de réversibilité : http://www.cigéo.com/images/cigeo/site/pdf/499.pdf
QUESTION 533
Posée par CONFRONTATIONS EUROPE, le 21/11/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de Confrontations Europe :
La migration de l’eau dans une couche argileuse compacte peut être faible, contrairement à celle dans une roche fissurée, peut-elle l’être avec des mouvements de terrain possibles sous l’effet des travaux de construction, ou naturellement ?
Réponse du 09/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Concernant l’impact des travaux
Si la construction de Cigéo est autorisée, les travaux réalisés en surface seront de faible amplitude et trop éloignés de la roche et du stockage pour entrainer des vibrations au fond. Pour les travaux souterrains, le retour d’expérience du laboratoire souterrain montre qu’il n’y aurait pas d’effet mécanique du creusement au-delà d’une zone de quelques mètres autour des galeries (zone dite endommagée). Cet effet n’induit pas de mouvements d’eau dans la roche : des mises en pression de l’eau ont été observées très localement, elles n’étaient pas suffisantes pour entraîner un déplacement significatif de l’eau compte tenu de la très faible perméabilité des argiles. L’analyse de la sûreté de Cigéo prend en compte la présence de cette zone endommagée.
Concernant l’impact de séismes
Le site étudié pour l’implantation de Cigéo présente une sismicité très faible. La stabilité et la très faible sismicité de la zone d’implantation du laboratoire souterrain est confirmée par les scientifiques qui ont travaillé sur ce site depuis plus de 20 ans. Le site de Meuse/Haute-Marne appartient à un domaine géologique stable (voir carte), particulièrement favorable pour l’installation d’un stockage. L’activité sismique est en effet extrêmement faible, comme le prouvent les enregistrements de sismicité instrumentale (écoute sismique depuis 1961 à l’échelle de la France) qui sont capables de détecter des microséismes, et les chroniques historiques (séismes ayant été ressentis et/ou ayant occasionné des dégâts au cours des derniers 1 000 ans). Au-delà de ces données, la stabilité et la très faible sismicité du site s’expliquent par sa situation géographique dans le bassin parisien qui est protégé des mouvements liés à la tectonique des plaques (collision du continent africain avec l’Europe).
En accord avec la réglementation en vigueur concernant la sûreté des installations nucléaires, les ouvrages de stockage sont toutefois dimensionnés pour résister aux séismes maxima physiquement possibles que pourraient générer ces failles si elles redevenaient actives dans le futur.
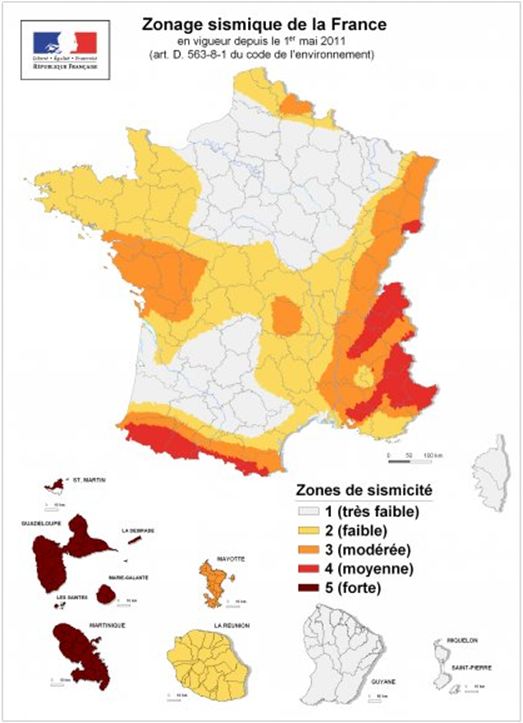
QUESTION 532
Posée par GROUPE DES ELUS DE GAUCHE AU CONSEIL GENERAL DE LA MEUSE, le 21/11/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs du Groupe des Elus de Gauche au Conseil Général de la Meuse :
Comment avons-nous l’intention de protéger nos descendants ?
Réponse du 09/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les déchets les plus radioactifs destinés à Cigéo sont des déchets dangereux, qui le resteront plusieurs dizaines à centaines de milliers d’années. Ces déchets, produits en France depuis les années 1960, sont actuellement entreposés de manière sûre mais provisoire dans des bâtiments sur leurs sites de production, dans l’attente d’une solution de gestion à long terme. Ces installations d’entreposage ne sont pas conçues pour confiner la radioactivité à très long terme. En cas de perte de contrôle de telles installations, les conséquences radiologiques sur l’homme et l’environnement ne seraient pas acceptables.
Le but du stockage profond est de protéger l’homme et l’environnement de la dangerosité de ces déchets sur de très longues durées. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage. Pour que le projet puisse être autorisé, l’Andra doit démontrer à l’Autorité de sûreté nucléaire qu’elle maîtrise les risques liés à l’installation, que ce soit pendant son exploitation ou après sa fermeture.
Si Cigéo est autorisé, il donnera ainsi la possibilité aux générations suivantes de mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs. La réversibilité leur permettra également de faire évoluer cette solution si elles le souhaitent.
QUESTION 531
Posée par GROUPE DES ELUS DE GAUCHE AU CONSEIL GENERAL DE LA MEUSE, le 21/11/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs du Groupe des Elus de Gauche au Conseil Général de la Meuse :
En matière de réversibilité, qui aura l’autorité pour décider de leur remontée ou non ?
Réponse du 09/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les conditions de réversibilité du stockage seront définies par le Parlement dans une future loi. Les modalités de gouvernance du stockage relèvent de cette future loi.
Dans ses propositions relatives à la réversibilité du projet Cigéo, l’Andra aborde la question des modalités d’autorisation d’une opération de retrait de colis de déchets stockés (voir le chapitre 7.5 du document Propositions de l’Andra relatives à la réversibilité du projet Cigéo, qui est consultable sur le site du débat public http://www.cigéo.com/images/cigeo/site/pdf/499.pdf). L’Andra propose que le décret d’autorisation de création de Cigéo couvre des opérations de retrait limité et temporaire de colis de déchets stockés. Ces opérations seront décrites dans le rapport de sûreté et dans les règles générales d’exploitation. L’Andra considère que toute opération notable de retrait de colis de déchets stockés devra faire l’objet d’une autorisation spécifique.
Ainsi, dans l’hypothèse d’une évolution de la politique en matière de gestion des déchets radioactifs qui conduirait à envisager une opération de retrait d’un nombre important de colis de déchets, l’Etat demanderait ainsi à l’Andra d’étudier l’opération. L’étude devrait comprendre une analyse détriments-bénéfices. L’opération pourrait nécessiter des modifications notables de l’installation, notamment en surface : l’Andra définirait la nature de ces modifications en fonction de la situation de retrait considérée : famille de colis concernée, volumes, dates de retrait, devenir des colis retirés du stockage… Ce type d’opérations nécessiterait ensuite le dépôt d’une demande de modification du décret d’autorisation de création par l’Andra, évaluée par l’Autorité de sûreté nucléaire et soumise à enquête publique. L’autorisation demandée devrait couvrir les opérations envisagées sur Cigéo (opérations de retrait, de reconditionnement éventuel, d’expédition…) et l’ensemble des modifications d’installations à apporter (construction éventuelle d’entreposages, de nouveaux ateliers…). Le dossier support à la demande devrait présenter une démonstration complète et justifiée de la sûreté des opérations projetées.
QUESTION 530
Posée par GROUPE DES ELUS DE GAUCHE AU CONSEIL GENERAL DE LA MEUSE, le 21/11/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs du Groupe des Elus de Gauche au Conseil Général de la Meuse :
Pour quel motif et selon quelles modalités ces colis seraient-ils récupérés ?
Réponse du 09/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La réversibilité est une demande sociale et politique. Elle a émergé progressivement dans le cadre du processus d’études et de recherches mis en place par la loi du 30 décembre 1991, qui envisageait « l’étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formations géologiques profondes ». Lorsqu’il a autorisé la création et l’exploitation du Laboratoire souterrain (décret du 3 août 1999), le gouvernement a demandé à l’Andra d’inscrire dorénavant ses études dans la « logique de réversibilité ». La réversibilité a ensuite été imposée au projet par la loi du 28 juin 2006. Les conditions de réversibilité seront fixées par une future loi.
Les échanges avec les parties prenantes montrent que la demande de réversibilité peut être motivée par différents types de préoccupations, en particulier : contrôler le déroulement du processus de stockage, préserver la possibilité de mettre en œuvre d’autres modes de gestion, conserver une possibilité d’intervention en cas d’évolution anormale, pouvoir récupérer des colis si les déchets qu’ils contiennent devenaient valorisables, ne pas abandonner le site. Ces attentes sont illustrées au travers de différentes questions posées sur le site du débat public.
Ces attentes ont conduit l’Andra à proposer une approche de la réversibilité reposant sur des dispositions techniques destinées à faciliter le retrait éventuel de colis et sur un processus décisionnel permettant de piloter le processus de stockage :
1) Contrôler le déroulement du processus de stockage
Si Cigéo est autorisé, l’Andra propose que des rendez-vous soient programmés régulièrement pendant une centaine d’années avec l’ensemble des acteurs (riverains, collectivités, évaluateurs, État…) pour contrôler le déroulement du stockage et préparer les étapes suivantes. Le premier de ces rendez-vous pourrait avoir lieu cinq ans après le démarrage du centre. Compte tenu de leur importance, l’Andra propose également que le franchissement des étapes de fermeture du stockage fasse l’objet d’une autorisation spécifique.
2) Préserver la possibilité de mettre en œuvre d’autres modes de gestion
De nombreuses solutions pour gérer les déchets radioactifs ont été imaginées depuis 50 ans : les envoyer dans l’espace, au fond des océans ou dans le magma, les entreposer plusieurs centaines d’années en surface ou à faible profondeur, les transmuter… Seul le stockage profond est aujourd’hui reconnu en France et à l’étranger comme une solution robuste pour mettre en sécurité ces déchets à très long terme. Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de ces déchets.
Grâce à la réversibilité, les générations suivantes garderont la possibilité de faire évoluer cette solution. Les rendez-vous proposés par l’Andra seront notamment alimentés par les résultats des recherches qui continueront à être menées sur la gestion des déchets radioactifs et les avancées technologiques. A chaque étape, il sera possible de décider de poursuivre le processus de stockage tel qu’initialement prévu ou de le modifier, par exemple si des solutions alternatives sont identifiées.
3) Conserver une possibilité d’intervention en cas d’évolution anormale
Les expérimentations menées au Laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne ont permis de qualifier in situ les propriétés de la roche argileuse, d’étudier les perturbations qui seraient induites par la réalisation d’un stockage (effets du creusement, de la ventilation, de la chaleur apportée par certains déchets…), de mettre au point des méthodes d’observation et de surveillance et de tester les procédés de réalisation qui pourraient être utilisés si Cigéo est mis en œuvre.
L’étape suivante sera d’acquérir une expérience complémentaire lors de la réalisation des premiers ouvrages de stockage. Si Cigéo est autorisé, le démarrage de l’exploitation se fera de manière progressive. Des premiers colis de déchets radioactifs pourraient être pris en charge à l’horizon 2025. Dans son avis du 16 mai 2013, l’Autorité de sûreté nucléaire a recommandé une phase de « montée en puissance » progressive de l’exploitation du stockage. L’évolution du stockage sera surveillée tout au long de l’exploitation de Cigéo. Les rendez-vous proposés par l’Andra seront alimentés par les résultats de la surveillance du stockage.
La sûreté de l’installation doit être acquise quelle que soit sa réversibilité. Dans la logique de la réversibilité, l’Andra conçoit néanmoins le stockage afin de faciliter la récupération éventuelle de colis de déchets stockés. Les dispositions mises en œuvre par l’Andra prennent en compte le retour d’expérience d’autres installations, en France et à l’étranger. Les colis utilisés pour le stockage des déchets, en béton ou en acier, sont indéformables. Des espaces suffisants sont ménagés entre les colis pour permettre leur retrait. Les tunnels de stockage (alvéoles de stockage) ont un revêtement en béton ou en acier pour éviter les déformations. L’exploitant disposera d’une connaissance précise de l’emplacement de chaque colis et de ses conditions de stockage. Des essais de retrait de colis ont d’ores et déjà été réalisés à l’échelle 1. Des nouveaux tests de retrait seront réalisés dans le stockage avant que la mise en service de Cigéo ne puisse être autorisée, puis pendant toute l’exploitation de Cigéo.
4) Pouvoir récupérer des colis si les déchets qu’ils contiennent devenaient valorisables
Conformément à la loi du 28 juin 2006, les déchets radioactifs destinés à Cigéo sont des déchets ultimes, c’est-à-dire qui « ne peuvent plus être traités dans les conditions économiques du moment, notamment par extraction de leur part valorisable ou par réduction de leur caractère polluant ou dangereux ». A l’inverse, une matière radioactive est une « substance radioactive pour laquelle une utilisation ultérieure est prévue ou envisagée, le cas échéant après traitement ». Les combustibles usés, qui sont aujourd’hui considérés comme des matières valorisables, ne sont ainsi pas inclus dans l’inventaire du projet Cigéo, même si la faisabilité de leur stockage est étudiée par précaution.
Par ailleurs, les déchets radioactifs sont conditionnés par leurs producteurs pour les solidifier ou les immobiliser sous une forme non dispersable. Plusieurs modes de conditionnement sont mis en œuvre suivant la nature des déchets (vitrification, cimentation, bitumage). Ces conditionnements, dont le but est d’améliorer le confinement des déchets, rendent corollairement plus complexes la récupération des éléments radioactifs. Il n’apparaît pas aujourd’hui pertinent de chercher à récupérer les radionucléides contenus dans les déchets une fois conditionnés. Néanmoins, un suivi des éventuels progrès scientifiques et technologiques pourra être réalisé dans le cadre des rendez-vous réguliers proposés par l’Andra.
5) Ne pas abandonner le site
Après fermeture, la sûreté du stockage sera assurée de manière passive, c’est-à-dire sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique, qui sert de barrière naturelle à très long terme, et sur la conception du stockage. Une surveillance sera néanmoins maintenue après la fermeture du stockage aussi longtemps que la société le souhaitera et des actions seront menées pour conserver et transmettre sa mémoire. Le Parlement a d’ores et déjà décidé que seule une loi pourrait autoriser la fermeture définitive du stockage. Cette future loi pourra fixer les conditions dans lesquelles le site restera contrôlé, sa surveillance maintenue et la mémoire conservée.
Plusieurs moyens pourront être mis en œuvre pour continuer de surveiller l’installation souterraine et l’environnement après fermeture. Les pistes à l’étude sont par exemple des forages depuis la surface jusqu’à l’Oxfordien calcaire situé au-dessus de la couche argileuse du Callovo-Oxfordien, des moyens géophysiques et des instruments laissés en place dans l’installation souterraine lors de sa fermeture.
La mémoire du stockage sera transmise aux générations futures pour les informer de l’existence et du contenu de l’installation. Des solutions d’archivage de long terme existent pour les centres de stockage de surface exploités par l’Andra et font l’objet de revues périodiques. Le retour d’expérience montre que ces solutions paraissent robustes pour au moins les 500 premières années. Ainsi, pour Cigéo, l’Andra prévoit qu’un centre de la mémoire perdurera sur le site. Il pourra accueillir le public et comprendra notamment les archives du Centre. De manière générale, le maintien de la mémoire doit aussi impliquer les acteurs locaux, qui peuvent prendre le relai en cas de défaillance de l’Andra ou de l’État. L’Andra veille d’ores et déjà à les informer sur les enjeux associés à la mémoire et étudie avec des anthropologues, des philosophes ou encore des artistes les facteurs qui peuvent favoriser la transmission de la mémoire. L’Andra a lancé en 2010 un programme d’études pour proposer des outils qui rendent cette transmission plus robuste sur une échelle de temps millénaire. Des pistes se dessinent tels des marqueurs de surface, mais aussi des rendez-vous réguliers à mettre en place au niveau des populations locales. En tout état de cause, comme il est impossible de garantir notre capacité à communiquer avec des êtres vivant dans plusieurs milliers d’années, c’est chaque génération qui aura la responsabilité de contribuer à transmettre cette mémoire aux générations suivantes.
Les propositions de l’Andra relatives à la réversibilité sont présentées sur le site du débat public ../informer/les-etudes-preparatoires.html.
QUESTION 529
Posée par ANCCLI, le 21/11/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de l'ANCCLI :
En matière de réversibilité, que dit la loi ? Qui va décider ? Avec quelle concertation ?
Réponse du 09/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les conditions de réversibilité seront décidées par le Parlement dans le cadre d’une future loi. La loi du 28 juin 2006 indique que la réversibilité doit être assurée, à titre de précaution, pendant une durée qui ne peut être inférieure à cent ans.
Suite à une démarche de dialogue menée depuis 2006 à l’échelle locale (commission réversibilité du Comité local d’information et de suivi du Laboratoire souterrain, rencontres avec le public et des acteurs locaux), nationale (colloque scientifique de Nancy en 2009, échanges avec les évaluateurs, rencontres avec des associations) et internationale (projet international sous l’égide de l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’OCDE, conférence internationale de Reims en 2010), l’Andra a présenté lors du débat public des propositions pour la réversibilité de Cigéo (voir ../docs/rapport-etude/fiche-reversibilite-cigeo.pdf).
Si Cigéo est mis en œuvre, l’Andra propose en particulier que des rendez-vous réguliers soient organisés avec l’ensemble des acteurs (riverains, collectivités, évaluateurs, Etat…) pour contrôler le déroulement du stockage et pour préparer chaque décision importante concernant les étapes suivantes. Ces rendez-vous permettraient de faire le bilan de l’exploitation du stockage, de discuter des perspectives à venir, de faire un point sur l’avancement des recherches en France et à l’étranger sur la gestion des déchets radioactifs, et de réexaminer les conditions de réversibilité.
QUESTION 528
Posée par ANCCLI, le 21/11/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de l'ANCCLI :
En quoi la réversibilité consiste-t-elle concrètement ? Est-ce risqué ? Financièrement et techniquement, est-ce possible ?
Réponse du 02/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le Parlement a demandé que le stockage soit réversible pendant au moins 100 ans. En réponse à cette demande, l’Andra propose des conditions de réversibilité, durant le siècle d’exploitation, qui ne compromettent pas la sûreté du stockage et qui sont réalisables sur le plan technique. Ces propositions concernent à la fois la technique et le pilotage du stockage.
Pouvoir récupérer les colis de déchets après leur stockage :
De nombreuses dispositions techniques sont mises en œuvre pour faciliter une opération éventuelle de retrait de colis du stockage. Ces dispositions prennent en compte le retour d’expérience d’autres installations, en France et à l’étranger. Les colis utilisés pour le stockage des déchets, en béton ou en acier, sont indéformables. Des espaces suffisants sont ménagés entre les colis pour permettre leur retrait. Les tunnels de stockage (alvéoles de stockage) ont un revêtement en béton ou en acier pour éviter les déformations. L’exploitant disposera d’une connaissance précise de l’emplacement de chaque colis et de ses conditions de stockage. Des essais de retrait de colis ont d’ores et déjà été réalisés à l’échelle 1. Des nouveaux tests de retrait seront réalisés dans le stockage avant que la mise en service de Cigéo ne puisse être autorisée, puis pendant toute l’exploitation de Cigéo.
Un calendrier de fermeture progressif et révisable dans le temps :
Pour assurer la mise en sécurité définitive des déchets radioactifs, le stockage devra être fermé. La conception de Cigéo offre la possibilité d’une fermeture progressive des alvéoles de stockage, des galeries souterraines puis des puits et des descenderies. Chaque étape de fermeture rendra plus complexe le retrait de colis (nécessité de rouvrir l’alvéole et de réinstaller les équipements de manutention) mais permettra d’ajouter des dispositifs de sûreté passive. Compte tenu de leur importance, l’Andra propose que le franchissement de ces étapes fasse l’objet d’une autorisation spécifique. Le Parlement a d’ores et déjà décidé que seule une loi pourrait autoriser la fermeture définitive du stockage.
Des rendez-vous réguliers avec l’ensemble des acteurs pour décider ensemble :
L’Andra propose que des rendez-vous soient programmés régulièrement avec l’ensemble des acteurs (riverains, collectivités, évaluateurs, État…) pour contrôler le déroulement du stockage et préparer les étapes suivantes. Ces rendez-vous seront alimentés par les résultats des réexamens périodiques de sûreté, fixés au moins tous les 10 ans par l’Autorité de sûreté nucléaire, de la surveillance du stockage et par les progrès scientifiques et technologiques. Le premier de ces rendez-vous pourrait avoir lieu cinq ans après le démarrage du centre.
Concernant le financement de la réversibilité, l’Andra propose un partage équitable entre les générations. Les générations actuelles provisionnent l’ensemble des coûts nécessaires pour permettre la mise en sécurité définitive des déchets radioactifs qu’elles produisent, ainsi que des déchets anciens qui ont été produits depuis le début des années 1960. Ces provisions couvrent également les propositions techniques retenues pour assurer la réversibilité de Cigéo pendant le siècle d’exploitation. Si les générations suivantes décidaient de faire évoluer leur politique de gestion des déchets radioactifs, par exemple si elles décidaient de récupérer des déchets stockés, elles en assureraient le financement. La prise en compte de la réversibilité dès la conception du stockage permet de limiter cette charge potentielle.
Les conditions de réversibilité constituent l’un des sujets majeurs discutés dans le cadre du débat public. Les échanges alimenteront la préparation de la future loi qui fixera les conditions de réversibilité du stockage. Cette loi sera votée avant que la création de Cigéo ne puisse être décidée.
Pour en savoir plus sur les propositions faites par l’Andra en matière de réversibilité du stockage, voir ../docs/rapport-etude/fiche-reversibilite-cigeo.pdf
QUESTION 527
Posée par ANCCLI, le 21/11/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de l'ANCCLI :
Quelle durée de vie (et de production de déchets) pour le parc nucléaire actuel ? Les déchets FAVL (bitumes, graphites) se destinent-ils à Cigéo ou à une future installation spécifique ? Les combustibles nucléaires usés seront-ils finalement recyclés de façon complète ?
Réponse du 09/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le projet de stockage profond Cigéo est conçu pour mettre en sécurité définitive les déchets dont le niveau de radioactivité et la durée de vie ne permettent pas de les stocker, de manière sûre à long terme, en surface ou à faible profondeur. Cigéo est conçu pour prendre en charge les déchets produits par les installations nucléaires passées et actuelles. Le stockage est en premier lieu destiné aux déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue déjà produits depuis plus de 50 ans ainsi qu’aux déchets qui seront inévitablement produits quels que soient les choix énergétiques futurs.
Concernant les déchets qui seront produits dans les années à venir par les installations actuelles, différents scénarios ont été étudiés afin d’anticiper les conséquences sur la nature et les volumes de déchets qui seraient à stocker (d’une part poursuite de la production électronucléaire avec recyclage complet des combustibles usés*, avec une durée de fonctionnement des réacteurs de 40, 50, 60 ans, d’autre part arrêt de la production de l’industrie électronucléaire et stockage direct des combustibles usés). Ces scénario sont présentés dans le chapitre 1 du Dossier du maître d’ouvrage : ../docs/dmo/chapitres/DMO-Andra-chapitre-1.pdf. A la demande du Ministère en charge de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, l’Andra, EDF et Areva ont étudié l’impact des différents scénarios établis dans le cadre du débat national sur la transition énergétique sur la production de déchets radioactifs et sur le projet Cigéo : ../docs/rapport-etude/20130705-courrier-ministere-ecologie.pdf
Par ailleurs, des volumes supplémentaires de déchets sont prévus par précaution en réserve dans Cigéo, correspondant en particulier aux déchets qui, le cas échéant, ne pourraient pas être stockés dans le stockage à faible profondeur aujourd’hui à l’étude par l’Andra pour le stockage de déchets de faible activité à vie longue (réserve d’environ 20 % du volume de déchets de moyenne activité à vie longue à stocker).
Cigéo est ainsi conçu pour être flexible afin de pouvoir s’adapter à d’éventuels changements de la politique énergétique. L’inventaire détaillé des déchets radioactifs pris en compte dans les études de conception de Cigéo est disponible sur le site du débat public (../docs/rapport-etude/dechets-pris-en-compte-dans-etudes-conception-cigeo.pdf). La nature et les quantités de déchets autorisés pour un stockage dans Cigéo seront fixées par le décret d’autorisation de création du Centre. Toute évolution notable de cet inventaire devra faire l’objet d’un nouveau processus d’autorisation, comprenant notamment une enquête publique et un nouveau décret d’autorisation.
* Les déchets produits par un éventuel futur parc de réacteurs ne sont pas pris en compte.
QUESTION 526
Posée par CCI HAUTE-MARNE, le 21/11/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de la CCI Haute-Marne :
Ce manque d’ambition n’est pas acceptable au regard du service qui sera rendu à la Communauté Nationale. En effet, Cigéo ne pourra se développer dans un territoire qui reste à long terme en difficultés et un tel territoire ne saurait contribuer efficacement à sa réussite. Or, il apparait que le SIDT se limite à proposer l’adaptation de nos territoires à l’accueil du projet Cigéo et à cet égard il ne saurait requérir en l’état l’assentiment des Elus, responsables et populations de Meuse et de Haute-Marne. Pourquoi ? Dans quel contexte de déprise démographique et de diminution des postes de travail, quelle sera la capacité du territoire à capitaliser sur les retombées économiques du projet alors même qu’il en subira les contraintes ? Quel impact aura Cigéo en termes d’activités, d’emplois, d’accueil de population, d’infrastructures de transports et de mobilités, et quel impact également sur l’image du département ? Que représente la création d’environ 1200 emplois sur le site quand le seul arrondissement de Saint-Dizier a perdu 3400 emplois industriels en 10 ans ?
Réponse du 09/01/2014,
Réponse apportée par le Directeur du schéma interdépartemental de développement du territoire :
Le Projet de Schéma Interdépartemental de Développement du territoire a identifié le nombre d'emplois directs et indirects sur le site que générera le chantier de construction du centre industriel ainsi que son exploitation. Ont été également identifiés les estimations d'emplois indirects dans la sous-traitance et les emplois induits dans l'économie résidentielle. Le Projet de Schéma a estimé le nombre total de ces emplois dans une fourchette comprise entre 2 000 et 4 000 emplois à horizon 2025. Il est clair qu'un tel chantier et qu'un tel équipement généreront des retombées économiques pour le territoire. Rares sont les chantiers de cette ampleur et les projets d'équipements industriels à hauteur de cet investissement. Il faut également souligner que le centre de stockage est une activité économique pérenne. Ce qui signifie que les investissements (en équipements et en compétences) qui seraient à réaliser dans le Sud-Meusien et le Nord Haut-Marnais ne présentent pas le risque de se voir délocaliser.
Le Projet de Schéma est élaboré par l'Etat avec un comité de pilotage associant les conseils généraux, les Chambres de commerce et d'Industrie, les entreprises de la filière nucléaire, ainsi que l'Andra et les communes et communautés de communes concernées. Dans ce cadre l'objectif retenu est bien de "Tirer parti du développement économique en captant la plus grande part d'activités et d'emplois".
Il est vrai que le territoire dans lequel s'inscrit ce projet industriel est en prise avec une forme de déclin démographique que le seul projet Cigéo ne permettra pas d'inverser. Dans le contexte économique général, Cigéo reste néanmoins une opportunité de développement économique dont chacun pourra se saisir, de sorte à en tirer les bénéfices localement, dans les compétences et la formation, dans la synergie entre les PME et les donneurs d'ordre, dans l'accès aux marchés de sous-traitance qui seront ouverts.
L'économie locale bénéficiera de l'apport de revenus sur le territoire, via les entreprises et leurs activités ou via les ménages qui seront concernés par l'emploi dans le site industriel et en phase chantier. L'économie résidentielle qui relève des services aux entreprises, des services à la personne, et des services publics, bénéficiera de ces retombées locales. Inversement, la structuration des activités de services représentera un facteur d'attractivité pour offrir un attrait à l'accueil des entreprises et des ménages.
QUESTION 525
Posée par EDA, le 21/11/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de l'association Environnement Développement Alternatif (EDA) :
Comment concevoir qu’une fois le site fermé, la mémoire en soit conservée, à travers les bouleversements de civilisation qui adviendront au cours des siècles?
Comment nos descendants dans cent générations pourront-ils se représenter cette gigantesque construction invisible à leurs yeux, conçue pour répondre à des besoins et des objectifs qui leur seront étrangers, avec des techniques devenues obsolètes ?
Réponse du 05/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif fondamental de Cigéo est de protéger l’homme et l’environnement des déchets radioactifs sur de très longues échelles de temps. La sûreté à long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. C’est une des raisons qui a conduit, en 2006, le Parlement à retenir la solution du stockage profond. En effet, cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli, contrairement à l’entreposage. En cas de perte complète de la mémoire du stockage, une intrusion inopinée à 500 mètres sous terre apparaît peu plausible, du moins sans un minimum d’investigations préalables. L’Andra évalue cependant par précaution dans son analyse de sûreté les conséquences d’un forage à travers le stockage pour vérifier que le stockage resterait sûr.
Malgré cette robustesse du stockage même en cas d’oubli, l’Andra conçoit Cigéo avec l’objectif d’en conserver la mémoire et de la transmettre aux générations futures le plus longtemps possible. Des solutions d’archivage de long terme existent pour les centres de stockage de surface exploités par l’Andra et font l’objet de revues périodiques. Le retour d’expérience montre que ces solutions paraissent robustes pour au moins les 500 premières années. Ainsi, pour Cigéo, l’Andra prévoit qu’un centre de la mémoire perdurera sur le site. Il pourra accueillir le public et comprendra notamment les archives du Centre.
De manière générale, le maintien de la mémoire doit aussi impliquer les acteurs locaux, qui peuvent prendre le relai en cas de défaillance de l’Andra ou de l’État. L’Andra veille d’ores et déjà à les informer sur les enjeux associés à la mémoire et étudie avec des anthropologues, des philosophes ou encore des artistes les facteurs qui peuvent favoriser la transmission de la mémoire. La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
L’Andra a lancé en 2010 un programme d’études pour proposer des outils qui rendent cette transmission plus robuste sur une échelle de temps millénaire. Des pistes se dessinent tels des marqueurs de surface, mais aussi des rendez-vous réguliers à mettre en place au niveau des populations locales.
En tout état de cause, comme il est impossible de garantir notre capacité à communiquer avec des êtres vivant dans plusieurs milliers d’années, c’est chaque génération qui aura la responsabilité de contribuer à transmettre cette mémoire aux générations suivantes.
QUESTION 524
Posée par EDA, le 21/11/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de l'EDA :
Quels sont les déchets qu’il est réellement prévu d’enfouir ? En quelles quantités? Quelles problématiques autour du sort des FAVL, du MOX, des bitumes…?
Réponse du 20/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le projet de stockage profond Cigéo est conçu pour mettre en sécurité définitive les déchets dont le niveau de radioactivité et la durée de vie ne permettent pas de les stocker, de manière sûre à long terme, en surface ou à faible profondeur. L’inventaire détaillé des déchets radioactifs susceptibles d’être stockés dans Cigéo a été établi en lien avec les producteurs de déchets. Le document est disponible sur le site du débat public : ../docs/rapport-etude/dechets-pris-en-compte-dans-etudes-conception-cigeo.pdf
Les déchets concernés proviennent principalement du secteur de l’industrie électronucléaire et des activités de recherche associées ainsi que, dans une moindre part, des activités liées à la Défense nationale. Les déchets dits de « haute activité » (HA) correspondent principalement aux résidus hautement radioactifs issus du traitement des combustibles nucléaires usés utilisés pour la production d’électricité. Les déchets dits de « moyenne activité à vie longue » (MA-VL) ont des origines variées : résidus issus du traitement des combustibles nucléaires usés et de la fabrication de certains combustibles, composants (hors combustible) ayant séjournés dans les réacteurs nucléaires, déchets technologiques issus de la maintenance des installations nucléaires, de laboratoires, d’installations liées à la Défense nationale, du démantèlement...
Cigéo est conçu pour prendre en charge les déchets produits par les installations nucléaires existantes. Les volumes de déchets HA et MA-VL sont estimés à environ 10 000 m3 pour les déchets HA (soit environ 60 000 colis de déchets) et environ 70 000 m3 pour les déchets MA-VL (soit environ 180 000 colis de déchets) dans l’hypothèse d’une poursuite de la production électronucléaire* et d’une durée de fonctionnement des installations nucléaires existantes de 50 ans. Dans cette hypothèse, 30 % des déchets HA et 60 % des déchets MA-VL sont déjà produits. Par précaution, des volumes supplémentaires (environ 20 % du volume de déchets MA-VL à stocker) sont prévus en réserve dans Cigéo pour certains déchets de faible activité à vie longue qui, le cas échéant, ne pourraient pas être stockés dans le stockage à faible profondeur à l’étude par l’Andra.
Cigéo est conçu pour être flexible afin de pouvoir s’adapter à d’éventuels changements de la politique énergétique. En cas d’arrêt de la production électronucléaire et d’arrêt du traitement des combustibles nucléaires usés, environ 3 500 m3 de déchets HA, 59 000 m3 de déchets MA-VL et 90 000 m3 de combustibles usés non traités (y compris les combustibles usés MOX) seraient destinés au stockage. A la demande du Ministère en charge de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, l’Andra, EDF et Areva ont étudié l’impact des différents scénarios établis dans le cadre du débat national sur la transition énergétique sur la production de déchets radioactifs et sur le projet Cigéo : ../docs/rapport-etude/20130705-courrier-ministere-ecologie.pdf
Le cas des déchets présentant des problématiques spécifiques, comme celui des déchets bitumés, fait l’objet d’une attention particulière. Pour concevoir Cigéo, l’Andra prend bien sûr en compte les risques spécifiques induits par ces déchets qui contiennent des substances inflammables. Le stockage de ces déchets dans Cigéo ne pourra être autorisé par l’Autorité de sûreté nucléaire que si l’Andra démontre qu’elle maîtrise les risques associés à leur stockage.
* Les déchets produits par un éventuel futur parc de réacteurs ne sont pas pris en compte.
QUESTION 523
Posée par EDA, le 21/11/2013
Question posée dans le cahier d'acteurs de l'EDA :
Quelle confiance peut-on avoir dans le caractère représentatif des observations faites depuis 15 ans dans le laboratoire de Bure, au regard des millénaires pendant lesquels le danger sera présent ? Quelle confiance dans les modèles de calcul utilisés pour les prévisions ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
De manière générale, la démarche scientifique se fonde sur l’observation, puis sur l’expérimentation et enfin sur la modélisation et la simulation numérique qui permettent d’extrapoler des résultats à des échelles inaccessibles via l’expérimentation. Le propre des sciences de la Terre et de l’Univers est que les observations permettent d’appréhender des phénomènes qui se déroulent sur de très longues durées. Cette démarche scientifique est au cœur des études menées par l’Andra depuis une vingtaine d’années pour étudier la faisabilité du stockage profond. Pour mener ces recherches, l’Andra mobilise la communauté scientifique dans de nombreuses disciplines (sciences de la Terre et de l’environnement, chimie, science des matériaux, mathématiques appliquées…) au travers de partenariats avec des organismes de recherche et des établissements universitaires français, ainsi qu’au moyen de coopérations internationales.
Les recherches menées depuis 1994 sur le site étudié en Meuse/Haute-Marne ont permis aux scientifiques de reconstituer de manière détaillée son histoire géologique, depuis plus de 150 millions d’années. Le site étudié se situe dans la partie Est du bassin de Paris qui constitue un domaine géologiquement simple, avec une succession de couches de calcaires, de marnes et de roches argileuses qui se sont déposées dans d’anciens océans. Les couches de terrain ont une géométrie simple et régulière. Cette zone géologique est stable et caractérisée par une très faible sismicité. La couche argileuse étudiée pour l’implantation éventuelle du stockage, qui s’est déposée il y a environ 155 millions d’années, est homogène sur une grande surface et son épaisseur est importante (plus de 130 mètres).
Aucune faille affectant cette couche n’a été mise en évidence sur la zone étudiée.
Cette analyse s’appuie sur des investigations géologiques approfondies : plus de 40 forages profonds ont été réalisés, complétés par l’analyse de plus de 300 kilomètres de géophysique 2D et de 35 km² de géophysique 3D. Environ 50 000 échantillons de roche ont été prélevés.
La roche argileuse a une perméabilité très faible, ce qui limite fortement les circulations d’eau à travers la couche et s’oppose au transport éventuel des radionucléides par convection (c’est-à-dire par l’entraînement de l’eau en mouvement). Cette très faible perméabilité s’explique par la nature argileuse, la finesse et le très petit rayon des pores de la roche (inférieur à 1/10 de micron). L’observation de la distribution dans la couche d’argile des éléments les plus mobiles comme le chlore ou l’hélium confirme qu’ils se déplacent majoritairement par diffusion et non par convection. Cette « expérimentation », à l’œuvre depuis des millions d’années, confirme que le transport des éléments chimiques se fait très lentement (plusieurs centaines de milliers d’années pour traverser la couche). Ces durées de transport constatées sont cohérentes avec celles estimées par simulation.
Les expérimentations menées au Laboratoire souterrain permettent également d’étudier l’impact de la construction et de l’exploitation d’un stockage sur le milieu géologique : impact lié au creusement des galeries, à l’introduction de matériaux exogènes tels que l’acier ou le béton, à l’effet de la chaleur générée par les déchets les plus radioactifs... La conception de CIgéo vise à limiter les perturbations engendrées et l’étude des processus physiques et chimiques permet de vérifier que ces perturbations induites sur la roche restent limitées. Elle fournit également des orientations pour la conception du stockage. L’Andra met également en place des démonstrateurs dans le Laboratoire souterrain, qui permettent notamment de comparer avec les résultats prévus par les simulations (par exemple la répartition du champ de température autour d’une alvéole simulant le stockage de déchets de haute activité) et de s’assurer que les prévisions des modèles sont cohérentes avec ce que l’on observe. Si Cigéo est autorisé, cette démarche sera poursuivie lors de la réalisation progressive du stockage.
Outre l’expérimentation, la validation des modèles passe également par l’étude d’analogues archéologiques ou naturels. Les laitiers de haut-fourneau du XVIe siècle, les blocs de verre issus d’épaves datant de l’Antiquité ou encore les verres basaltiques constituent par exemple des analogues du système « verre/métal/argile » soumis à une altération par l’eau. Bien que la composition chimique et les conditions d’altération de ces verres ne soient pas strictement identiques à celles des matrices utilisées pour vitrifier certains déchets radioactifs, leur étude permet de tester les modèles proposés et de progresser dans la compréhension des mécanismes d’altération. Concernant le comportement des radionucléides, les deux sites de réacteurs nucléaires naturels découverts à Oklo (Gabon) en 1972, celui de Bangombé en surface à 11 m de profondeur et celui d’Okélobondo à 420 m de profondeur, apportent des informations précieuses. Ces réacteurs naturels ont fonctionné il y a 2 milliards d’années, les conditions géologiques, et notamment la teneur du minerai en uranium 235, ayant provoqué une réaction en chaîne spontanée pendant plusieurs centaines de milliers d’années. Les travaux de caractérisation (analyses minéralogiques, chimiques et isotopiques) ont montré la très faible migration des radionucléides dans les conditions chimiques réductrices et en présence d’argile. Ils ont permis d’établir les mécanismes géochimiques qui ont prévalu à ce comportement et de tester les modèles de représentation associés.
La simulation numérique permet d’obtenir des résultats inaccessibles par l’expérience du fait de la complexité et de l’interaction des phénomènes à étudier ou des grandes échelles de temps et d’espace sur lesquelles ils se déroulent. Pour représenter les phénomènes que l’on veut étudier, on utilise des modèles physiques et mathématiques qui sont alimentés par des données acquises sur le terrain, en laboratoire et dans la littérature scientifique. Ces derniers servent à mener des expériences virtuelles qui, en temps réel, se dérouleraient sur des milliers à centaines de milliers d’années, ou à analyser des processus qui intéressent de très grands volumes de roche. Grâce aux outils qu’elle a développés, l’Andra peut étudier différents phénomènes liés, par exemple, à la chaleur, au déplacement de l’eau ou aux échanges chimiques et analyser comment les composants du stockage se comporteraient et évolueraient dans le temps. Ces modèles permettent également de tester des hypothèses de situations dégradées dans l’évolution du stockage. Les différents modèles ainsi que les codes de simulation numérique font l’objet d’inter-comparaisons. Cela contribue à la confiance dans leur validité et permet d’identifier le cas échéant les points de compréhension à approfondir. Ces travaux de comparaison sont menés à l’Andra et dans le cadre de projets internationaux. Les modèles proposés par l’Andra font également l’objet d’une évaluation indépendante par l’IRSN dans le cadre de l’instruction des dossiers de l’Andra. Cela concerne par exemple les modèles d’écoulements hydrogéologiques et de migration des radionucléides, qui sont au cœur des études de sûreté.
L’ensemble de ces travaux font l’objet de publications dans des revues à comités de lecture (50 à 70 publications scientifiques internationales par an depuis 10 ans) et sont évalués par des instances indépendantes, en particulier la Commission nationale d’évaluation, mise en place par le Parlement, et l’Autorité de sûreté nucléaire qui s’appuie sur l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Les grands dossiers scientifiques et techniques que l’Andra remet dans le cadre de la loi font l’objet, à la demande de l’Etat, de revues internationales sous l’égide de l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’OCDE. L’Andra a également été évaluée en 2012 par l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES). Enfin, des expertises sont régulièrement commandées par le Comité local d’information et de suivi du Laboratoire souterrain sur les grands dossiers de l’Andra ou sur des sujets plus ciblés.
C’est la convergence de l’ensemble de ces études qui permet d’apprécier la robustesse du stockage et de préciser les incertitudes résiduelles. L’analyse de sûreté intègre la connaissance acquise et les incertitudes afin de produire une évaluation pénalisante de l’impact du stockage. Les études menées par l’Andra ont montré que l’impact du stockage serait nettement inférieur à celui de la radioactivité naturelle à l’échelle du million d’années.
QUESTION 522
Posée par EDA, le 21/11/2013
Question posée dans le cachier d'acteurs de l'association Environnement Développement Alternatif (EDA) :
Faut-il comprendre que « la seule solution sûre » serait de les enfouir, de fermer le site et de les oublier ?
Réponse du 05/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le stockage profond, est aujourd’hui la seule solution robuste pour mettre en sécurité à très long terme les déchets les plus radioactifs. Cette solution est étudiée depuis plus de 20 ans. Différentes solutions ont été étudiées dans le cadre du programme de recherches institué par la loi de 1991. Les résultats de ces recherches ont été évalués en 2005/2006 et un débat public a été organisé sur la politique nationale de gestion des déchets radioactifs. Sur la base de l’ensemble de ces éléments, le Parlement a fait le choix en 2006 du stockage profond réversible pour mettre en sécurité de manière définitive ces déchets et ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations futures. Le Parlement a demandé à l’Andra de préparer la mise en œuvre de cette solution.
La fermeture du stockage n’interviendra qu’à la fin d’un long processus, placé sous le contrôle de la société. Si Cigéo est autorisé, les générations suivantes pourront contrôler le déroulement du stockage et récupérer les déchets si elles souhaitent mettre en œuvre d’autres modes de gestion. En fonction de l’expérience acquise lors de l’exploitation de Cigéo, elles pourront décider progressivement de commencer à franchir des étapes de fermeture de certaines parties du stockage, par étapes. Après une centaine d’années d’exploitation, si elles décident de fermer définitivement le stockage, la sûreté sera alors assurée de manière passive, sans nécessité d’action humaine.
Le stockage n’est en aucune façon la voie vers l’oubli : l’une des missions importantes de l’Andra est justement d’organiser le maintien de la mémoire du stockage le plus longtemps possible. Le stockage profond est cependant la seule solution qui permet de se prémunir contre les conséquences d’un oubli, qui ne peut être exclu sur plusieurs milliers d’années, que les déchets soient laissés en surface ou stockés en profondeur. En effet, même en cas de perte complète de la mémoire du stockage, une intrusion inopinée à 500 mètres sous terre apparaît peu plausible, du moins sans un minimum d’investigations préalables. L’Andra évalue cependant par précaution dans son analyse de sûreté les conséquences d’un forage à travers le stockage pour vérifier que le stockage resterait sûr.
QUESTION 521 - comment peut on oser parler de democratie a ce projet qui est truqué depuis le debut
Posée par christian CHAUFFAILLE (METZ), le 20/11/2013
Comment oser parler démocratie avec cigeo où tout n'est basé que sur le mensonge et la non-transparence et tout est deja programmé?
Réponse du 05/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le Parlement s’est saisi de la question des déchets radioactifs en 1991. Depuis plus de 20 ans, l’ensemble des recherches menées sur la gestion des déchets radioactifs sont évaluées sur le plan scientifique et de la sûreté par des autorités indépendantes, en particulier l’Autorité de sûreté nucléaire et la Commission nationale d’évaluation mise en place par le Parlement. Ces évaluations sont disponibles sur le site du débat public. Les élus locaux sont associés de manière continue à l’ensemble de ces travaux et près de 100 000 visiteurs ont fait la démarche de venir visiter le site du Laboratoire souterrain. Deux débats publics ont été organisés. Un Comité local d’information et de suivi a été mis en place auprès du Laboratoire souterrain, avec la participation d’associations opposées au projet de stockage. Nous vous remercions de bien vouloir préciser vos accusations de mensonge et de non-transparence pour nous permettre de vous répondre sur ce point.
Aujourd’hui, la décision de créer Cigéo n’est pas encore prise. L’Andra a justement souhaité que le débat public intervienne en 2013, quand le projet n’est pas encore finalisé, pour prendre en compte le débat public dans la suite de ses études en vue d’établir le dossier de demande d’autorisation de création du centre de stockage. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra à l’État après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo en 2015. Ce processus comprendra notamment une évaluation de sûreté par l’Autorité de sûreté nucléaire et une évaluation scientifique par la Commission nationale d’évaluation, l’avis des collectivités territoriales, le vote d’une nouvelle loi fixant les conditions de réversibilité et une enquête publique.
QUESTION 520
Posée par Gérard LATOURTE (GIVRAUVAL), le 19/11/2013
Je me souviens ....Vous avez publié un petit journal dans lequel un article disait à peu près ceci : “Quelque part,en Chine,on a exhumé d’un argile identique à celui de Bure,la momie d’une vieille femme , en parfait état de conservation,après une très longue période....” Votre conclusion : “donc l’argile de Bure est le milieu idéal pour conserver sans risque des déchets nucléaires hautement radioactifs et de longue durée...” Le parallèle entre le cadavre d’une vieille dame et les déchets nucléaires dont il est question ici me laisse supposer que tous discours sur le sujet qui nous occupe auront pour justification, la COMMUNICATION et non L’INFORMATION. (Après cela, comment ferez-vous pour être crédibles???)
Réponse du 06/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’exemple que vous citez illustre la lenteur des processus de dégradation dans les milieux argileux. Les recherches relatives à la sûreté d’un stockage dans la couche d’argile du Callovo-Oxfordien étudiée au Laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne se fondent sur un ensemble de travaux scientifiques, qui incluent également l’étude d’analogues géologiques.
Pour l’Andra, informer (par exemple au travers de la publication d’un journal ou de documentations) et communiquer (par exemple en organisant des visites de nos Centres ou des journées portes ouvertes qui permettent au public de poser leurs questions directement aux scientifiques et aux ingénieurs qui travaillent à l’Andra) sont deux missions complémentaires. Nous menons ces missions avec un souci constant de transparence afin de permettre à chacun de se construire sa propre opinion sur les solutions mises en œuvre pour gérer les déchets radioactifs.
QUESTION 519
Posée par Thierry COURILLON, le 18/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 30 octobre 2013 - transformations locales et aménagement du territoire :
Pour tout ce qui concerne les "offres locales" pourquoi ne pas mettre en place un fond d'aide qui favoriserait l'investissement et la création de nouvelles entreprises 100% locales ? J'espère que mes questions seront présentes au débat, mais n'ayant pas eu de retour de mes envois précédents, je doute que cela le soit sur ce sujet.
Réponse du 09/01/2014,
Réponse apportée par le Directeur du schéma de développement du territoire :
Oui c'est une très bonne idée. Mettre en place un fonds d'investissement pour la création d'entreprises locales relève de l'accompagnement économique du territoire pour anticiper la mise en œuvre du centre industriel de stockage des déchets radioactifs. Les financements dévolus par les GIP de Meuse et de Haute-Marne sont dédiés, à ce titre, à l'accompagnement économique.
Au-delà de l'aide à l'investissement des entrepreneurs locaux, le chantier et l'exploitation de Cigéo représentent un marché et un gisement de prestations importants. Il s'agit pour les entreprises locales, qu'elles existent aujourd'hui ou qu'elles soient à créer, de capter les marchés qui seront ouverts à la concurrence et de positionner leurs offres. Ce positionnement des entreprises locales dans les prochaines années et dans l'attente de la consultation, nécessitera également que soient augmentées leurs qualifications et leurs compétences.
Dès à présent, les entreprises de la filière nucléaire mettent en œuvre les actions d'accompagnement économique :
- dans les investissements locaux (à hauteur de 67 millions d'€ depuis 2009)
- en soutien à l'économie locale (achats, bonification de prêts, programme de maîtrise de l'Energie).
Ces donneurs d'ordre interviennent également sur le plan des qualifications, en accompagnement les entreprises locales dans les marchés qu'elles passent. Toutes ces entreprises sont organisées sous l'égide de la grappe Energic ST 55 52. En ce qui concerne les compétences, la CCI de Haute-Marne, la Maison de l'Emploi de Meuse et les branches professionnelles conduisent avec l'ANDRA une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales en perspective des marchés qui seront ouverts et en perspective des formations qui seront proposées localement.
Réponse apportée par Bertrand Thuillier, docteur ès sciences :
Votre question me semble pertinente et montre bien votre crainte que cette phase chantier, seule réelle pourvoyeuse d'emplois pendant 7 ans, ne profite pas aux entreprises locales. Cependant, je doute, étant par ailleurs chef d'entreprise, que de nouvelles entreprises, par définition, réduites, puissent répondre à des appels d'offres nécessitant des couvertures financières, des exigences de certification, et des garanties qui sont à mille lieux d'une entreprise nouvellement créée. Ces emplois ne sont prévus qu'en sous-traitance ; peut-être des co-contrats de sous-sous-traitance pourront être envisagés, mais avec des niveaux de rémunération et d'intérêt qui risquent encore, d'être au détriment de ces nouvelles entreprises, les entreprises de travaux publics des pays de l'est étant, pour l'essentiel, les plus aptes à répondre à ces derniers types de co-contrats.
QUESTION 518
Posée par Thierry COURILLON, le 18/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 30 octobre 2013 - transformations locales et aménagement du territoire :
Mise en place d'un rammassage par bus pour ceux qui travailleront sur site (éviterait la construction d'un immense parking, limiterait ainsi l'impact environnemental, et permettrait à des personnes n'ayant pas de véhicule de venir) ? Possibilité de restauration sur le chantier avec offre diversifiée : Self, + Fast food + KEbab ou autre ? Possibilité d'une offre de services locale (aide à la recherche de logement pour les extérieurs qui viendront) ? Possibilité de fédérer les offres d'hébergement locales en favorisant des maison d'hôtes locales, l'habitat chez l'habitant, ce qui génêrerait des flux financiers indirects qui seraient ré-investis par la suite ? Mettre en place localement, sur le chantier, des offres de pressing, éventuellement garde d'enfant (peut aider un père ou une mère célibataire) avec des prix préférentiels pour les personnes travaillant sur le chantier, quelque soit l'entreprise d'origine ? Mes questions ne concernent pas seulement l'emploi local pour les travaux, mais également tous les emplois indirects qui seront générés.
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par le Directeur du schéma interdépartemental de développement du territoire :
Les propositions que vous énoncez vont dans le sens de l'attractivité du territoire pour accueillir les activités, et les ménages qui ne manqueront pas de s'installer dans le territoire.
Comme repris dans le projet de Schéma Interdépartemental de Développement du territoire, le nombre d'emplois directs et indirects sur le site est estimé, à ce stade de la conception industrielle du projet à hauteur de 2 200 emplois en phases de chantier et 1 200 emplois en exploitation. A ces emplois s'ajouteront les emplois indirects qui seront localisés, éventuellement à proximité du site ou dans les zones d'activités qui leur seront proposées, ainsi que, comme soulignés les emplois induits (ceux qui relèvent de l'économie locale générée par les revenus).
Ces implantations devraient se localiser dans un territoire suffisamment diversifié pour proposer le maximum de choix à ses ménages, étant entendus que certains d'entre eux seront localisés à proximité du site pour des raisons astreintes professionnelles ou de choix personnels.
En ce qui concerne les déplacements domicile-travail, la mise en place des modes de transports des salariés des entreprises relève de la responsabilité de ces entreprises, la recommandation qui est faite, à ce stade, est d'organiser des Plans de Déplacements Entreprises permettant l'utilisation de transports collectifs ou éventuellement de solutions de co-voiturage, pour éviter les nuisances liées à ces déplacements.
Les services à la personne sont un facteur d'attractivité pour les emplois. Il s'agit également d'intégrer au mieux, les installations industrielles et les activités dans le contexte rural de Meuse et de Haute-Marne.
Comme on peut le voir sur d'autres chantiers ou exploitations industrielles de cette ampleur, la manière dont les collaborateurs se logent est large, depuis le logement en gîte rural de proximité, jusqu'à l'investissement familial dans une résidence. Elle dépend aussi de plusieurs facteurs:
- les parcours résidentiels des collaborateurs appelés à travailler sur le site: une situation de célibataire géographique évolue vers une résidence locale lorsque l'ensemble du ménage trouve une réponse à ses besoins en termes d'implantation (emplois et produits d'habitat
- l'offre des produits d'habitat: foncier disponible, logements locatifs, patrimoine à restaurer, ...
- l'attractivité de tel ou tel secteur en fonction des services et aménités proposés aux ménages (écoles, commerce, loisirs, ..)
En termes de prospective, les apports de nouveaux ménages se substitueront partiellement aux déficits de populations dont les tendances sont constatées aujourd'hui. Il convient par conséquent d'anticiper ces mutations en étudiant les conditions d'attractivité et en préparant l'offre diversifiée qui sera proposée au regard des attentes. La planification permet de poser les réflexions préalables et les choix pour engager, en temps opportun (en fonction de l'agenda du chantier et de la mise en service du centre industriel) les actions et les opérations.
En ce qui concerne les services de proximité, l'aménagement industriel du site s'attache tout d'abord aux problématiques industrielles tout en tenant compte de leurs intégrations paysagères et environnementales. Des réflexions existent pour les services à la personne, en termes de restauration, de loisirs, de garde d'enfants, de conciergerie (pressing, dépannage automobile, formalités, ...). Ces services esquissent ce qui sera indispensable dans une zone d'activités du 3è millénaire et il est clair que ces activités généreront également des revenus pour l'économie locale. La construction d'un hôtel à Bure procède d'ores et déjà de ce type de services. De tels équipements doivent également être pensés dans un agenda qui permette leurs réalisations en fonction de leurs pertinences économiques et leurs réalisations dans un cadre de l'aménagement qui respecte le contexte environnemental, économique et social local.
QUESTION 517
Posée par Véronique et Olivier NAUDIN (CHARDOGNE), le 18/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 30 octobre 2013 : transformations locales et aménagement du territoire :
Phase exploitation : ne serait-il pas plus pertinent et efficace que les deux GIP 52/55 se rassemblent dans une même structure collégiale et transparente, plutôt que que de se faire en quelque sorte concurrence pour obtenir des subventions ou les faveurs des donneurs d'ordres ? Au bout du compte, c'est l'emploi et l'image de nos collectivités qui en sortiraient grandis.
Réponse du 09/01/2014,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
La coopération interdépartementale est en effet un enjeu majeur pour la réussite de l'intégration du projet dans son environnement. Certains projets font l'objet de cofinancements de la part des deux GIP, notamment le lancement d'une étude conjointe sur les modalités de d'approvisionnement en eau et d'assainissement pour Cigéo.
L'État veille par ailleurs à la bonne coordination interdépartementale qui est assurée par la préfète coordonnatrice du projet, qui sera prochainement accompagnée d'un sous-préfet employé à plein temps sur ces questions.
Réponse apportée par Bertrand Thuillier, docteur ès sciences :
Pourquoi pas, mais maintenant est-il normal de compenser par des fonds aussi importants la présence d'un laboratoire, ce qui à ma connaissance ne ce serait jamais fait, si ce n'est que de considérer que c'est bien la présence d'un futur stockage de déchets qui est à l'origine de cette compensation. Mais, alors comment légalement et démocratiquement gérer des fonds pour un projet non encore décidé (?), et vers quelle orientation. Par exemple, il faut savoir que le GIP Meuse n'a consacré en 2011 que 2,83% de ces fonds pour les questions de "Formation, recherche et développement, transfert de technologie", contre 48,47 % pour les postes "Habitat et urbanisme, et service à la population" ; ceci montre bien que cet argent n'est pas destiné au développement, mais plutôt à ce que certains appellent des "Achats de conscience".
QUESTION 516
Posée par Véronique et Olivier NAUDIN, le 18/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 30 octobre 2013 : transformations locales et aménagement du territoire :
Phase chantier : de quels outils juridiques vont se doter les différents maîtres d'ouvrages publics ou privés pour faire en sorte que nos entreprises meusiennes (notamment) puissent bénéficier de retombées économiques positives, dans le strict respect des règles communautaires et nationales de la commande publique ?
Réponse du 06/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’Andra mène depuis plusieurs années une politique volontariste visant le développement des relations avec le tissu économique local. Depuis quatre ans, cette politique est rythmée notamment par la manifestation annuelle « Devenez prestataire de l’Andra » qui est destinée aux PME locales. Ces rencontres permettent aux entreprises de se familiariser avec les exigences et les procédures de l’Andra et de se préparer aux marches futurs. L’association Energic ST 52/55, qui fédère des entreprises de l’énergie et du BTP, contribue également à valoriser les compétences et entretient une relation partenariale avec l’Andra.
Cette politique conjointe s’avère payante. En 2011, les deux régions ont émis 10 % du montant total des facturations (HT) liées au projet Cigéo. Cela représente une collaboration avec plus de 250 établissements locaux (publics ou privés), implantés pour 60 % d’entre eux en Lorraine et 40 % en Champagne-Ardenne. Les départements de Meuse et de Haute-Marne regroupent chacun 30 % du total des établissements concernés. Des incitations à recruter localement seront demandées aux entreprises impliquées pendant la phase de construction de Cigéo tout en respectant les dispositions règlementaires de passation des marchés. Ainsi, au niveau de ses commandes et de ses contrats, l’Andra prévoit des règles d’équité sous forme de clauses destinées à juger de la valeur sociale des offres qui lui permettront notamment de prendre en compte le recours à l’emploi local et la formation des acteurs locaux.
Ces mesures ont déjà fait leurs preuves pour le Laboratoire souterrain et les Centres de l’Andra dans l’Aube. Leurs activités ont généré annuellement plusieurs millions d’euros de commandes à des entreprises locales (Meuse, Haute-Marne, Aube). En 2012, dans les Centres de l’Aube, plus de 35% des commandes ont été passées à des entreprises locales. Il en résulte que le nombre d’entreprises locales travaillant avec l’Andra et donc capables de travailler avec l’Andra à l’avenir augmente. La pratique montre également que les grands groupes qui répondent à nos appels d’offres ont souvent recours à des co-traitants, antennes ou filiales locaux.
Réponse apportée par Bertrand Thuillier, docteur ès sciences :
Cette question montre bien vos doutes sur les apports en emplois locaux ; cette phase chantier sera la seule réellement pourvoyeuse d'emplois pendant 7 ans, et risque de ne pas profiter aux entreprises meusiennes. En effet, étant par ailleurs chef d'entreprise, je crains que les outils juridiques ne puissent pas répondre à votre demande : Comment demander à des entreprises de taille réduite, mais même moyenne, de répondre à des appels d'offres nécessitant des couvertures financières, des exigences de certification, et des garanties qui sont à mille lieux des entreprises auxquelles vous pensez. Ces emplois ne sont prévus qu'en sous-traitance et aucune entreprise meusienne n'aura les capacités à répondre aux centaines de pages de ces dossiers d'appels d'offres. Peut-être des co-contrats de sous-sous-traitance pourront être envisagés, mais avec des niveaux de rémunération et d'intérêt qui risquent encore, de ne pas être au niveau de vos attentes, les entreprises de travaux publics des pays de l'est étant, pour l'esssentiel, les plus aptes à répondre à ces derniers types de co-contrats.
QUESTION 515
Posée par Damien GIRARD, le 18/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 30 octobre 2013 : transformations locales et aménagement du territoire : Bonjour, Le projet de cigéo est pour l'instant qu'un projet. Analysons ce qui ce fait aujourd'hui pour avoir l'expérience du vécu. Les habitants et les élus de Pontfaverger-Moronvilliers (situé à 22 km de Reims, 6 km des vignes champenoises) ont fait confiance aux scientifique du nucléaire depuis 50 ans. Résultat, le site va être abandonné avec une garantie de gardiennage de 2 ans, aucun contrôle par un organisme indépendant (criirad, accro), pas de suivi médical à long terme pour des sous traitants, pas d'étude épidémiologique ... 25 maisons à vendre, un centre commercial ou il n'y a aucun investisseur qui veut s'implanter idem pour la zone artisanal, une nappe phréatique qui est polluée suivant la Dréal mais ne dépasse pas les normes en vigueur. Pensez vous que dans 100 ans (votre enfant/petit enfant qui vient de naitre verra cela), les investisseurs viendront investir, que la population restera, que la production agricole pourra être vendu en gardant l'étiquette "made in Bure" ? Ou ce sera une zone morte ? (et votre petit fils vous en voudra à mort)
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) :
Dans le cadre de ses activités, le CEA a mené des expérimentations qui ont mis en œuvre de l’uranium sur le site de Moronvilliers. A ce titre, il mène un programme de surveillance qui permet d’en évaluer l’impact sur l’environnement. Ce programme est basé sur les prescriptions réglementaires et est validé par l’autorité de sûreté. Le marquage en uranium de la nappe à l’aplomb du site est déclaré dans la base nationale de données BASOL relative aux sites et sols pollués. Le suivi de la nappe, réalisé dans le cadre de la surveillance au titre de cette déclaration BASOL, est effectué au moyen de piézomètres (forages instrumentés permettant d’accéder à la nappe et d’effectuer des prélèvements). Les mesures sont effectuées en période de hautes et basses eaux (mars et octobre) afin de prendre en compte la cinétique de la nappe. Les valeurs maximales relevées se situent à un facteur 3 en dessous de la recommandation de l’organisation mondiale de la santé (OMS) relative à l’eau destinée à la consommation humaine, et fixée à 30 microgrammes par litre d’eau.
Concernant le suivi des travailleurs, les expositions aux risques identifiés sur le Polygone d’expérimentation de Moronvilliers (PEM) pour le personnel des entreprises sous-traitantes est strictement identique à celui des personnels CEA. Aucun écart aux limites réglementaires n’a été relevé jusqu’à ce jour sur les mesures effectuées. Celles – ci sont systématiquement adressées aux médecins du travail de ces entreprises extérieures pour leur exploitation.
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Cigéo est conçu pour protéger l’Homme et l’environnement. S’il est autorisé, l’impact du Centre en termes de radioactivité sera très inférieur à celui de la radioactivité naturelle et n’aura donc aucun impact sur la qualité des productions agricoles. L’Andra a créé l’Observatoire pérenne de l’environnement, qui a pour mission d’assurer un suivi détaillé de l’évolution de l’environnement du stockage. Cela permettra de lever ainsi toute inquiétude en démontrant que le stockage n’a pas d’impact sur les activités agricoles de proximité. Cet observatoire labellisé s’inscrit dans un grand nombre de réseaux scientifiques nationaux ou internationaux. Par ailleurs, le retour d’expérience de l’implantation de l’Andra dans l’Aube depuis 20 ans montre que l’implantation d’un centre de stockage de déchets radioactifs n’est en aucun cas incompatible, même en termes d’image, avec des activités agricoles de premier choix (lait, viande, légumes, viticulture...). L'industrie et l’agriculture ont toujours coexisté et de nombreuses installations industrielles y compris nucléaires sont installées en France à proximité de zones de production agricoles dont des zones géographiques protégées ou encore des zones d'appellation contrôlée.
Réponse apportée par Bertrand Thuillier, docteur ès sciences :
Je ne suis pas certain d'avoir quelque chose à rajouter ; ceci est bien la démonstration de la différence sémantique entre développement économique qui permet une valorisation du territoire après une action de développement, et une activité économique, pur feu de paille qui génèrera nuisances et dégradations multiples après le passage des "enfouisseurs".
QUESTION 514
Posée par YAO MING, le 18/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 30 octobre 2013 - transformations locales et aménagement du territoire :
Bonsoir,
Y a-t-il un risque que les productions agricoles soient contaminées par de la radioactivité provenant des déchets stockés dans cigéo ? Merci de votre réponse.
Réponse du 11/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’impact du Centre en termes de radioactivité sera très inférieur à celui de la radioactivité naturelle et n’aura donc aucun impact sur la qualité des productions agricoles. L’Andra a créé un observatoire pérenne de l’environnement (OPE), qui a pour mission d’assurer un suivi détaillé de l’évolution de l’environnement du stockage. Cela permettra de lever ainsi toute inquiétude en démontrant que le stockage n’a pas d’impact sur les activités agricole de proximité. Si vous souhaitez plus d’informations sur cet observatoire, vous pouvez consulter le site http://www.andra.fr/ope/.
Réponse apportée par Bertrand Thuillier, docteur ès sciences :
Une contamination peut en effet être présente, mais le problème se situe plutôt dans l'image qui sera véhiculée sur les productions locales. Je vous invite à lire ce qui est dit concernant le beurre de la Hague dans Wikipédia : "En 1905 est fondée une coopérative autour de la laiterie de Gréville. En 1962, elle s'associe à d'autres coopératives du Cotentin au sein de l'UCALMA qui devient en 1985, les Maîtres laitiers du Cotentin. Jusqu'à sa fermeture, la laiterie de Gréville fabrique un beurre vendu sous le nom de « beurre de la Hague », puis rebaptisé en beurre « Val de Saire » à cause de la mauvaise image donnée par l'usine de la Cogema.". Non seulement, il apparaît que l'appelation a dû être changée, mais finalement, cela n'a pas empêché la fermeture de la laiterie.
QUESTION 513
Posée par Anne-Marie RENARD, le 18/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 30 octobre 2013 - transformations locales et aménagement du territoire :
Maire de Biencourt sur Orge, 7 km de Bure, comment peut on se préparer à recevoir une importante population quand nous n'avons pas les moyens de réaliser des besoins de base tels que l'assainissement ?...
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par le Directeur du schéma interdépartemental de développement du territoire :
La mise aux normes des conditions et des réseaux d'assainissement est une obligation réglementaire qui s'impose à toutes les communes. Dans le cas des développements autour du projet d'implantation du centre industriel de stockage, et compte tenu des opportunités d'accueil de nouveaux ménages, il reviendra aux communes de se déterminer pour anticiper et prévoir les objectifs et les moyens de leurs développements. A l'issue des interviews menées auprès des maires dans le cadre de l'élaboration du projet de Schéma Interdépartemental de Développement du Territoire, la majeure partie des communes souhaitent un développement maîtrisé pour préserver les services aux populations, les écoles et les offres de loisirs (y compris associatives) dans les villages. L'ambition reprise dans la rédaction du projet de Schéma entend "préserver l'identité des bourgs et des villages et le patrimoine bâti" (principe IV.3). Ces objectifs reprendront également, sur la base de prospectives qualifiées, les besoins et les attentes des ménages qui s'installeraient, en rapport avec leurs modes de vie et ainsi construire une offre d'habitats et de services adaptée.
A ce jour, pour prévoir et anticiper les éventuels développements, il est donc proposé aux communes de réfléchir aux moyens qu'elle entendent mettre en œuvre pour répondre aux objectifs qu'elles se seront fixés. L'élaboration de documents d'urbanisme, si possible intercommunaux, intégrant les Programmes Locaux de l'Habitat procède de ces objectifs. Dans l'agenda de réalisation et de mise en service du centre industriel, l'Etat et les collectivités locales sont en outre prêts à accompagner les réflexions et les investissements, en ingénieries et en financements prévus au titre de l'accompagnement économique.
Réponse apportée par Bertrand Thuillier, docteur ès sciences :
Il est nécessaire de considérer que les emplois les plus nombreux seront uniquement durant la période de construction (pendant 7 ans), et exclusivement des emplois de sous-traitance, et qu'après 2031, le nombre d'emplois après la fermeture du laboratoire ne sera que de 100 à 150 supérieur à ce qu'il est actuellement. Il serait par conséquent extrêmement dangereux financièrement de se lancer dans des investissements qui ne seraient utiles que pour une période aussi courte ; en outre, je doute que les personnes employées sur le site dans l'exploitation de Cigéo, et bien au fait des informations sur les nuisances, n'installent leurs familles aussi près du site.
QUESTION 512
Posée par MAIRIE DE JOINVILLE, le 18/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 30 octobre 2013 - transformations locales et aménagement du territoire :
Quelle gouvernance afin de coordonner de manière équitable le développement des territoires concernés par le projet Cigeo ? Bertrand Ollivier maire de Joinville
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par le Directeur du Schéma interdépartemental de développement du territoire :
L'implantation du centre industriel Cigéo ne manquera pas d'impacter le développement des territoires dans le sud de la Meuse et le nord de la Haute-Marne. Le projet de Schéma Interdépartemental de Développement du Territoire a posé les enjeux pour que l'ensemble des territoires puisse bénéficier de ces retombées. Elles sont d'ordre économique avec l'installation d'entreprises dans la sous-traitance et l'économie locale générée par l'implantation de ménages. Elles sont également d'ordre organisationnelle puisque les territoires, et notamment ceux qui sont au plus près, vont bénéficier des infrastructures (desserte en eau, desserte numériques et infrastructures de transports) à mettre en place dans le cadre de cette implantation.
L'enjeu à court terme pour les collectivités locales est de s'organiser et d'anticiper ce développement dans un agenda qui tienne compte des décisions d'installation et de réalisation des infrastructures. La planification urbaine et la programmation de l'habitat sont des outils qui permettent cette anticipation. Il en existe d'autres, comme les outils de programmation dévolus aux GIP Haute-Marne et Objectif Meuse. Compte tenu du caractère exceptionnel du projet industriel (de par le nombre d'emplois et les spécificités industrielles), l'Etat souhaite accompagner les collectivités locales, dans un premier temps dans l'élaboration d'un Schéma de Développement Interdépartemental Meuse Haute-Marne, dans un second temps, dans sa mise en œuvre. Quels que soient les modes de développement et de gouvernance retenus, les compétences de mise en œuvre du développement des territoires ne relèveront pas uniquement de l'Etat. Certaines compétences relèvent des régions, des départements, et des communautés de communes, voire des communes. Au delà de la coordination entre les ambitions et les objectifs de chacun des territoires, il est nécessaire d'en réguler les effets. Lors du dernier Comité de Haut Niveau, la Ministre de l'Ecologie du Développement Durable et de l'Energie a demandé à Madame la préfète de la Meuse, préfète coordinatrice, de faire des propositions à l'issue du débat public sur la gouvernance du développement territorial qui serait impacté par Cigéo.
Réponse apportée par Bertrand Thuillier, docteur ès sciences :
Avant une gouvernance, il est nécessaire de considérer que les emplois les plus nombreux seront uniquement durant la période de construction (pendant 7 ans), et exclusivement des emplois de sous-traitance, et qu'après 2031, le nombre d'emplois après la fermeture du laboratoire envisagée en 2030, le nombre de postes ne sera que de 100 à 150 supérieur à ce qu'il est actuellement. Le développement ne semble pas, par conséquent, le terme le plus approprié, il y aura plutôt une activité industrielle imposée, qui génèrera beaucoup de nuisances et qui obèrera tout le développement potentiel viticole et touristique de la région de Joinville par la dégradation de son image. Il suffit de se rappeler de l'importance de son activité viticole au 19ème siècle, et à l'importance du patrimoine naturel et architectural non exploité à sa juste mesure actuellement.
QUESTION 510
Posée par THIERRY PAQUET, Adjoint à la mairie de Joinville et vice président CCMR, le 18/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 30 octobre 2013 - transformations locales et aménagement du territoire :
La formation doit se structurer dans les centres les plus proches du projet Cigéo en collaboration avec les élus locaux et les équipes enseignantes. Qu'allez vous mettre en œuvre ?
Réponse du 31/01/2014,
Réponse apportée par le Directeur du Schéma interdépartemental de développement du territoire :
Dans le cadre du projet industriel Cigéo, les besoins de la formation sont à mettre au regard des besoins des entreprises appelées à intervenir sur le chantier et en exploitation. Ils sont aussi à mettre en perspective des besoins dans la sous-traitance des activités économiques et du développement local induit. La compétence, les savoir-faire et les qualifications des hommes et des femmes sont des enjeux d'attractivité et de localisation des activités économiques induites par l'implantation du centre industriel.
Pour faire coïncider une offre d'emplois avec les besoins en fonction des différentes phases du projet industriel, la maison de l'Emploi de la Meuse et la CCI 52 ont d'ores et déjà lancé une analyse des compétences territoriales dans un dispositif des Contrats de Plan Etat-Région. Dans un premier temps, l'analyse des compétences requises (elle devra s'affiner au fil de la conception industrielle du projet) devra définir les métiers, compétences et profils de postes. Dans un second temps seront analysées les compétences disponibles sur le territoire, ainsi que la cartographie des formations dispensées, dans l'objectif de faire converger une offre de formation avec les besoins des entreprises.
Les collectivités locales et les branches industrielles sont également parties prenantes de cette gestion prévisionnelle des compétences locales, compte tenu de la mobilisation des dispositifs de formation et des investissements à mettre en œuvre.
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La typologie des emplois associés a été identifiée et les principaux métiers traditionnellement mobilisés feront très largement appel à des populations non cadres (agents de maîtrise et ouvriers de niveau CAP à BAC+3) sur les métiers de travaux publics et de génie civil (coffreur-bancheur, chaudronnier, grutier, conducteur d’engins, mécanicien, électricien, électromécanicien, soudeur…).
Réponse apportée par Bertrand Thuillier, docteur ès sciences :
Cette question reste virtuelle en considérant l'absence de centres de formation dans le domaine nucléaire déjà présents dans la région, d'autant que les emplois les plus nombreux seront uniquement durant la période de construction (pendant 7 ans). Ce serait exclusivement des emplois de sous-traitance après un appel d'offres où, à ma connaissance, aucune entreprise haute-marnaise ne pourra espérer remporter un tel contrat au vu des exigences de qualification, de taille, de capitalisation et de niveau de certification requis. Il reste qu'après 2031, le nombre d'emplois après la fermeture du laboratoire ne sera que de 100 à 150 personnes supérieur à ce qu'il est actuellement. Et si ces personnes ont été formées en Haute-Marne, elle seraient bien entendu alors obligées de quitter le département après la fin du chantier, vers 2030.
QUESTION 509
Posée par UNKNW, le 18/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 30 octobre 2013 - transformations locales et aménagement du territoire :
Est-il acceptable que le GIP Haute-Marne posséde plusieurs millions d'euros placés en banque alors que les routes pour aller à Epizon sont en si mauvais état ? En d'autres termes, est-il acceptable que le GIP HAute-Marne reçoive une rente et n'en fasse pas profiter le département ?
Réponse du 09/01/2014,
Réponse apportée le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
L’article L. 542-11 du code de l'environnement définit les missions des GIP. Ils ont pour missions :
« 1° De gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation du laboratoire ou du centre de stockage ;
2° De mener, dans les limites de son département, des actions d'aménagement du territoire et de développement économique, particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils généraux concernés ».
Sur la période 2007-2012, le GIP Haute-Marne a accordé 176 millions d’euros de financements pour un montant d’investissement cumulé de 775 millions d’euros.
Par ailleurs, des travaux sont en cours pour la rénovation de la route conduisant à Epizon.
Réponse apportée par Bertrand Thuillier, docteur ès sciences :
Sans vouloir défendre le GIP, il peut être possible qu'il y ait des décalages entre le versement des fonds et l'attribution de ces derniers ; maintenant, est-il normal de compenser par des fonds avec de tels montants la présence d'un laboratoire, ce qui à ma connaissance, ne se serait jamais fait, si ce n'est que de considérer que c'est la présence même d'un stockage de déchets qui est à l'origine de cette compensation. Mais, alors comment légalement débloquer des fonds pour un projet non encore décidé ??
QUESTION 508
Posée par MAIRIE DE JOINVILLE, le 18/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 30 octobre 2013 - transformations locales et aménagement du territoire : Les bourg centres des deux départements doivent percevoir l'aide au budget de fonctionnement qui aujourd'hui ne permet que de subvenir à des besoins non structurant pour le territoire. Que pensez vous faire pour aller dans ce sens ? Paquet Thierry, Adjoint et vice president CCMR
Réponse du 10/02/2014,
Réponse apportée par la préfecture de la Meuse :
Les dispositions d'attribution des crédits GIP pour les budgets des collectivités sont définies par la loi du 28 juin 2006 et ne peuvent être modifiées en l'état actuel des choses. La répartition des retombées fiscales ultérieures sur le territoire devra faire l'objet d'une concertation pour définir les modalités les plus justes et efficaces de dotation des collectivités. Cette discussion se tiendra lorsque des données plus précises sur le coût de Cigéo seront disponibles dans la mesure où des liens étroits existent entre le coût global du projet et la masse fiscale reversée sur le territoire.
QUESTION 507
Posée par UNKNW, le 18/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 30 octobre 2013 - transformations locales et aménagement du territoire :
Peut-on considérer que la participation du GIP Haute-Marne au financement d'actions à Langres participe au developpement local ?
Réponse du 09/01/2014,
Réponse apportée le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
L’article L. 542-11 du code de l'environnement définit les missions des groupements d’intérêt public (GIP) constitués en Haute-Marne et en Meuse. Chaque GIP a notamment pour mission « de mener, dans les limites de son département, des actions d'aménagement du territoire et de développement économique ». Les instances de gouvernance des GIP (conseil d’administration, assemblée générale) statuent sur les demandes de subventions, le programme annuel d’activités du GIP et le budget correspondant, et vérifient la cohérence des actions du GIP avec les missions définies par la loi du 28 juin 2006.
Réponse apportée par Bertrand Thuillier, docteur ès sciences :
La réponse ne peut pas être totalement négative ou positive, l'installation de la fibre optique en Haute-Marne est une excellente opération, et il me semble que le GIP Haute-Marne y contribue sensiblement. En revanche, savoir que le GIP Meuse n'a consacré en 2011 que 2,83% de ces fonds pour les questions de "Formation, recherche et développement, transfert de technologie", contre 48,47 % pour les postes "Habitat et urbanisme, et service à la population" montre bien que cet argent n'est pas destiné au développement, mais à ce que certains appellent des "Achats de conscience".
QUESTION 506
Posée par Catherine , le 18/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 30 octobre 2013 - transformations locales et aménagement du territoire :
Quelle alternative au projet CIGEO proposez-vous pour développer un département comme la Meuse qui est en plein déclin économique ?
Réponse du 05/12/2013,
Réponse apportée par Bertrand Thuillier, docteur ès sciences :
Premièrement, il me semble nécessaire de continuer les recherches, car il apparaît très léger de commencer à exploiter une installation avant même d'avoir eu le temps de recueillir et prendre en compte les résultats scientifiques, comme par exemple, les tests de scellements ou de comportement à terme des colis à enfouir. Cette continuité permettrait alors de conserver les 400 emplois environ du laboratoire (estimation Andra 2015). Il faut savoir qu'en exploitation, Cigéo ne demande que 500 emplois au maximum, soit uniquement 100 à 150 emplois de plus qu'actuellement pour 2031 en considérant la fermeture du laboratoire prévue en 2030. Ensuite, dans ce canton de Meuse, il vient d'être confirmé que la géothermie est très présente, et pourrait alors être sans doute valorisable dans des serres bio ; cette activité serait bien plus adaptée à la structure agricole du canton, et cette dernière serait compétitive de par cet avantage énergétique. Pour la Haute-Marne, il faudrait revenir vers la viticulture, Saint-Dizier était le premier port viticole vers Paris au 19ème avant le phylloxéra ; 5% de la production champenoise représente 1500 emplois pérennes et 6000 postes en période de vendanges. Les coteaux haut-marnais vierges d'exploitation depuis 1905 permettraient également des cultures bio, et profiteraient à terme du réchauffement climatique et de la remontée de la culture de la vigne vers le Nord (du vin est maintenant produit en Angleterre, par exemple).
QUESTION 505
Posée par MAIRIE D'EPIZON, le 18/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 30 octobre 2013 - transformations locales et aménagement du territoire :
Quelle sécurité du site ?
Réponse du 05/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Cigéo est conçu pour être sûr pendant sa construction, son exploitation et après sa fermeture.
Pour garantir la sûreté de ses installations, l’Andra identifie toutes les sources potentielles de dangers, qu’elles soient d’origine naturelle ou non. L’ensemble de ces risques est pris en compte dès la phase de conception de Cigéo. Cela permet de mettre en œuvre les dispositions nécessaires pour prévenir ces risques, réduire leur probabilité et limiter leurs effets sur les installations (que ce soit pour les installations de surface ou les installations souterraines). Sont étudiés par exemple les situations de séismes, inondations, conditions climatiques extrêmes, incendies, explosions, chutes d’avion, environnement industriel (voies de circulation, présence d’autres installations présentant des risques…).
Pour connaitre en détail l’ensemble des dispositions prévues pour garantir la sûreté du centre, nous vous invitons à consulter le chapitre 5 du Dossier du maître d’ouvrage : ../docs/dmo/chapitres/DMO-Andra-chapitre-5.pdf
Pour que le projet puisse être autorisé, l’Andra doit démontrer aux évaluateurs du projet (Autorité de sûreté nucléaire (ASN), Commission nationale d’évaluation (CNE) qu’elle maîtrise tous les risques, que ce soit pour la sûreté de Cigéo pendant son exploitation ou après sa fermeture. L’ASN effectuera également des inspections (plusieurs par an, dont certaines inopinées) pour vérifier que la sûreté du site est bien assurée par l’Andra. Dans le cas contraire l’ASN peut imposer des prescriptions supplémentaires si elle considère qu’un risque n’est pas maîtrisé correctement, voire mettre à l’arrêt l’installation.
Réponse apportée par Bertrand Thuillier, docteur ès sciences :
Une sécurité basée sur une conception d'alvéoles MAVL "cathédrales" de 400 m de long sur 6 à 9 m de diamètre en multipliant les risques présents : Hydrogène, gaz hautement explosif (1 million de L/an au total), bitume, fortement combustible (9 700 tonnes de bitume pur au total), ventilation très importante (500 à 600 m3/s), et batteries de forte puissance (étincelles et inflammation) me semble encore très aléatoire vis-à-vis du risque incendie.
QUESTION 504
Posée par MAIRIE D'EPIZON, le 18/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 30 octobre 2013 - transformations locales et aménagement du territoire :
Quelle garantie d'étanchéité du site ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée à l’Andra, maître d’ouvrage :
Le stockage géologique a pour principe de confiner la radioactivité des déchets sur de très longues échelles de temps. En s’appuyant sur l’ensemble des recherches menées sur le site depuis 1994, l’Andra a montré que le site étudié en Meuse/Haute-Marne présente des caractéristiques favorables pour assurer la sûreté à long terme d’un éventuel stockage. La Commission nationale d’évaluation mise en place par le Parlement pour évaluer sur le plan scientifique les travaux de l’Andra souligne ainsi dans son rapport 2012 : « le site géologique de Meuse/Haute-Marne a été retenu pour des études poussées, parce qu’une couche d’argile de plus de 130 m d’épaisseur et à 500 m de profondeur, a révélé d’excellentes qualités de confinement : stabilité depuis 100 millions d’années au moins, circulation de l’eau très lente, capacité de rétention élevée des éléments ».
Après la fermeture du stockage, au-delà de la durée de vie des ouvrages industriels, la couche d’argile très peu perméable, de plus de 130 mètres d’épaisseur, dans laquelle sera installé le stockage souterrain, servira de barrière naturelle pour retenir les radionucléides contenus dans les déchets et freiner leur déplacement. Le stockage permettra ainsi de garantir leur confinement sur de très longues échelles de temps. Seuls quelques-uns de ces radionucléides, les plus mobiles et dont la durée de vie est longue, pourront migrer de manière très étalée dans le temps (plus d’une centaine de milliers d’années) et atteindre en quantités extrêmement faibles les couches géologiques situées au-dessus et au-dessous de l’argile et dans lesquelles l’eau peut circuler.
Dans une démarche prudente, l’Andra suppose dans son évaluation d’impact sur l’homme et l’environnement à long terme que les eaux de ces couches pourraient être captées par forage et utilisées pour des usages du type de ceux qui peuvent être pratiqués aujourd’hui (jardin, boisson, abreuvement des animaux). Les études montrent que même dans ce cas, l’impact du stockage reste inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire et ne présente pas de risque pour la santé.
Réponse apportée par Bertrand Thuillier, docteur ès sciences :
Une garantie basée sur des modélisations qui n'ont pas pu être validées expérimentalement (d'après la NEA, Nuclear Energy Agency) me semble assimilable à une promesse qui n'engage que ceux qui l'écoute.
QUESTION 503
Posée par UNKNW, le 18/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 30 octobre 2013 - transformations locales et aménagement du territoire :
Est-ce que le retraitement des déchets nucléaires à La Hague a eu un impact sur les ventes de camembert de Normandie ?
Réponse du 04/02/2014,
Réponse apportée par AREVA :
AREVA ne dispose pas de données concernant l’évolution des ventes de camembert de Normandie.
Le développement de l’activité de recyclage des combustible usés à l’usine de la Hague est marqué par une volonté de dialogue constant avec les parties prenantes locales et notamment les acteurs économiques locaux. Ainsi, des réunions périodiques de travail sont notamment organisées. Elles réunissent les plus gros employeurs du Nord-Cotentin (dont les Maîtres Laitiers de la région) et où les principaux enjeux de chacun sont discutés.
Réponse apportée par Bertrand Thuillier, docteur ès sciences :
A ce sujet, je pense qu'il vous sera très facile de vous référer à Wikipédia à propos du beurre de la Hague : "En 1905 est fondée une coopérative autour de la laiterie de Gréville. En 1962, elle s'associe à d'autres coopératives du Cotentin au sein de l'UCALMA qui devient en 1985, les Maîtres laitiers du Cotentin. Jusqu'à sa fermeture, la laiterie de Gréville fabrique un beurre vendu sous le nom de « beurre de la Hague », puis rebaptisé en beurre « Val de Saire » à cause de la mauvaise image donnée par l'usine de la Cogema.". Non seulement, il ressort que l'appellation a dû être changée, mais finalement, cela n'a pas empêché la fermeture de la laiterie.
QUESTION 502
Posée par J-F GIROUD, le 18/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 30 octobre 2013 - transformations locales et aménagement du territoire :
Ayant travaillé dans un office de tourisme de Meuse, je peux vous dire qu'à part Verdun et Madine, il y a peu de tourisme sur le sud du département. Environ 10000 sur Bar-le-Duc et 5000 sur Ligny. Le labo a reçu près de 14000 visiteurs en 2012.
Réponse du 09/12/2013,
Réponse apportée par Bertrand Thuillier, docteur ès sciences :
En effet, le tourisme est encore peu développé dans le sud du département de la Meuse, mais la dégradation de l'image par le stockage des déchets ne se portera pas uniquement sur cette partie du département, mais sur la totalité du département, voire même sur l'ensemble de la région dans la mesure où les touristes n'ont qu'une étiquette ou une image très globale d'un territoire ; pouvez-vous citer précisément tous les départements du sud de la France, il est plus courant de passer ses vacances dans une région déterminée, voire même de communiquer uniquement sur le Sud-Est ou sur le Sud-Ouest de la France ?
QUESTION 501
Posée par MAIRIE D'EPIZON, le 18/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 30 octobre 2013 - transformations locales et aménagement du territoire :
Comment sera assurée la réversibilité ?
Réponse du 02/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le Parlement a demandé que le stockage soit réversible pendant au moins 100 ans afin de laisser aux générations suivantes la possibilité de faire évoluer le stockage si elles le souhaitent. En réponse à cette demande, l’Andra propose des conditions de réversibilité, durant le siècle d’exploitation, qui ne compromettent pas la sûreté du stockage et qui sont réalisables sur le plan technique. Ces propositions concernent à la fois la technique et le pilotage du stockage.
Pouvoir récupérer les colis de déchets après leur stockage :
De nombreuses dispositions techniques sont mises en œuvre pour faciliter une opération éventuelle de retrait de colis du stockage. Ces dispositions prennent en compte le retour d’expérience d’autres installations, en France et à l’étranger. Les colis utilisés pour le stockage des déchets, en béton ou en acier, sont indéformables. Des espaces suffisants sont ménagés entre les colis pour permettre leur retrait. Les tunnels de stockage (alvéoles de stockage) ont un revêtement en béton ou en acier pour éviter les déformations. L’exploitant disposera d’une connaissance précise de l’emplacement de chaque colis et de ses conditions de stockage. Des essais de retrait de colis ont d’ores et déjà été réalisés à l’échelle 1. Des nouveaux tests de retrait seront réalisés dans le stockage avant que la mise en service de Cigéo ne puisse être autorisée, puis pendant toute l’exploitation de Cigéo.
Un calendrier de fermeture progressif et révisable dans le temps :
Pour assurer la mise en sécurité définitive des déchets radioactifs, le stockage devra être fermé. La conception de Cigéo offre la possibilité d’une fermeture progressive des alvéoles de stockage, des galeries souterraines puis des puits et des descenderies. Chaque étape de fermeture rendra plus complexe le retrait de colis (nécessité de rouvrir l’alvéole et de réinstaller les équipements de manutention) mais permettra d’ajouter des dispositifs de sûreté passive. Compte tenu de leur importance, l’Andra propose que le franchissement de ces étapes fasse l’objet d’une autorisation spécifique. Le Parlement a d’ores et déjà décidé que seule une loi pourrait autoriser la fermeture définitive du stockage.
Des rendez-vous réguliers avec l’ensemble des acteurs pour décider ensemble :
L’Andra propose que des rendez-vous soient programmés régulièrement avec l’ensemble des acteurs (riverains, collectivités, évaluateurs, État…) pour contrôler le déroulement du stockage et préparer les étapes suivantes. Ces rendez-vous seront alimentés par les résultats des réexamens périodiques de sûreté, fixés au moins tous les 10 ans par l’Autorité de sûreté nucléaire, de la surveillance du stockage et par les progrès scientifiques et technologiques. Le premier de ces rendez-vous pourrait avoir lieu cinq ans après le démarrage du centre.
Les conditions de réversibilité constituent l’un des sujets majeurs discutés dans le cadre du débat public. Les échanges alimenteront la préparation de la future loi qui fixera les conditions de réversibilité du stockage. Cette loi sera votée avant que la création de Cigéo ne puisse être décidée.
Pour en savoir plus sur les propositions faites par l’Andra en matière de réversibilité du stockage, voir ../docs/rapport-etude/fiche-reversibilite-cigeo.pdf
Réponse apportée par Bertrand Thuillier, docteur ès sciences :
C'est une bonne question, celle-ci est possible quand elle n'est pas nécessaire, mais impossible quand elle devient impérieuse ; en effet, en cas d’incendie, il faudra récupérer des colis bitumineux qui auront coulés (30°C maximum), avec des galeries détériorées : « la structure porteuse des installations du fond est conçue pour rester stable au feu 2 heures », et des rails de manutention déformés dans les alvéoles MAVL (Moyenne Activité à Vie Longue). Et en ce qui concerne les alvéoles HA (Haute Activité), les tests de récupérabilité ont été réalisés sur des tronçons soudés, sur 30 à 40 m, à température ambiante, alors que ces alvéoles seraient constituées de tronçons non soudés, de 80 à 100 m, avec des différentiels de pression (fluage des terrains), et à plus de 90°C.
QUESTION 500
Posée par JC, le 18/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 30 octobre 2013 - transformations locales et aménagement du territoire :
Bonjour, le projet cigéo est censé se développer dans une zone ne contenant aucune ressource qui puisse intéresser les générations futures. Alors pourquoi, ce site doit se faire dans des roches argileuses? Alors que l'Hélium3 (H3), qui est pressenti pour être le carburant du future, est justement contenu dans les roches argileuses. Pourquoi ne tenons-nous pas compte du fait que dans le future nos descendants risques de devoir exploiter ce site?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maitre d’ouvrage :
L’ensemble des investigations géologiques réalisées depuis plus de 20 ans a montré que le site étudié pour l’implantation de Cigéo ne présente pas d’intérêt exceptionnel en termes de ressources souterraines exploitables. Par ailleurs, il serait tout à fait possible d’exploiter des ressources dans le sous-sol de la région en dehors du périmètre de 30 km² dans lequel serait implanté Cigéo. Par précaution, l’Andra prend en compte dans ses études de sûreté un scénario d’exploitation du sous-sol au niveau du stockage dont on aurait perdu la mémoire. Les analyses ont montré que même dans ce cas le stockage conserverait de bonnes capacités de confinement.
Concernant le cas de l’Hélium 3, celui-ci pourrait effectivement servir de carburant pour les futurs réacteurs de fusion. Il est actuellement utilisé dans le nucléaire dans certains réacteurs de recherche. Il a été montré qu’en Lorraine l’Hélium 3 est produit par dégazage du manteau avec le même taux que sous les océans et se piège dans les grès du Trias du fait de la forte imperméabilité des formations du Lias au dessus. Même dans ce cas sa concentration ne dépasse pas quelques 10-15 mol/g d’eau (voir l’article « Geochemical evidence for efficient aquifer isolation over geological timeframes » de Bernard Marty, Sarah Dewonck et Christian France-Lanord, paru dans la revue Nature, vol 425 du 4/09/2003 pp 55-58).
Réponse apportée par Bertrand Thuillier, docteur ès sciences :
Sans aller jusqu'à penser utiliser l'hélium, il existe déjà des ressources géothermiques utilisables, mais niées à dessein par l'Andra, et qui pourraient par exemple, être mobilisées pour le chauffage de serres bio, activité bien plus en phase avec la structure et la destination agricole du canton de Bure.
QUESTION 499
Posée par MAIRIE D'EPIZON, le 18/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 30 octobre 2013 - transformations locales et aménagement du territoire :
Quelle sera la sécurité du transport et par quels moyens ?
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) :
Environ 900 000 colis de substances radioactives sont transportés chaque année. 85 % des colis transportés sont destinés aux secteurs de la santé, de l’industrie non-nucléaire ou de la recherche, dits "nucléaire de proximité", dont 30 % environ pour le seul secteur médical. L’industrie nucléaire ne représente qu’environ 15 % du flux annuel de transports de substances radioactives. On estime à environ 11 000 le nombre annuel de transports nécessaires au cycle du combustible, pour 141 000 colis. Le contenu des colis est très divers : leur radioactivité varie sur plus de douze ordres de grandeur, soit de quelques milliers de becquerels pour des colis pharmaceutiques de faible activité à des millions de milliards de becquerels pour des combustibles irradiés. Leur masse varie de quelques kilogrammes à une centaine de tonnes.
L’ASN est chargée du contrôle de la sûreté. La sûreté est l’ensemble des dispositions techniques et organisationnelles prises en vue de prévenir les accidents ou d’en limiter les effets.
Les risques majeurs des transports de substances radioactives sont les suivants :
- le risque d’irradiation externe de personnes dans le cas de la détérioration de la « protection biologique des colis », matériau technique qui permet de réduire le rayonnement au contact du colis ;
- le risque d’inhalation ou d’ingestion de particules radioactives dans le cas de relâchement de substances radioactives ;
- la contamination de l’environnement dans le cas de relâchement de substances radioactives ;
- le démarrage d’une réaction nucléaire en chaîne non contrôlée (risque de « sûreté-criticité») pouvant occasionner une irradiation des personnes, en cas de présence d’eau et de non-maîtrise de la sûreté de substances radioactives fissiles.
La prise en compte de ces risques conduit à devoir maîtriser le comportement des colis pour éviter tout relâchement de matière et détérioration des protections du colis dans le cas :
- d’un incendie ;
- d’un impact mécanique consécutif à un accident de transport ;
- d’une entrée d’eau dans l’emballage (l’eau facilitant les réactions nucléaires en chaîne en présence de substances fissiles) ;
- d’une interaction chimique entre différents constituants du colis ;
- d’un dégagement thermique important des substances transportées, pour éviter la détérioration éventuelle avec la chaleur des matériaux constitutifs du colis.
Cette approche conduit à définir des principes de sûreté pour les transports de substances radioactives :
- la sûreté repose avant tout sur le colis : des épreuves réglementaires et des démonstrations de sûreté sont requises par la réglementation pour démontrer la résistance des colis à des accidents de référence ;
- le niveau d’exigence, notamment concernant la définition des accidents de référence auxquels doivent résister les colis, dépend du niveau de risque présenté par le contenu du colis. Ainsi, les colis qui permettent de transporter les substances les plus dangereuses doivent être conçus de façon à ce que la sûreté soit garantie y compris lors d’accident de transport. Ces accidents sont représentés par les épreuves suivantes :
- trois épreuves en série (chute de 9 m sur une surface indéformable, chute de 1 m sur un poinçon et incendie totalement enveloppant de 800 °C minimum pendant 30 minutes) ;
- immersion dans l’eau d’une profondeur de 15 m (200 m pour les combustibles irradiés) pendant 8 h.
La sûreté des transports est également fondée sur la fiabilité des opérations de transport qui doivent satisfaire à des exigences réglementaires notamment en matière de radioprotection. L'ASN assure le contrôle de la sûreté des transports de matières radioactives. Enfin, la gestion des situations accidentelles est régulièrement testée lors d'exercices.
Réponse apportée par Guillaume Blavette, association Haute Normandie Nature Environnement :
Dans le dossier du maitre d'ouvrage, page 47, l'ANDRA déclare que le "transport par voie ferroviaire est privilégié" et précise que "cela représenterait au maximum une centaine de trains par an (avec une dizaine de wagons par train), soit de l’ordre de deux trains par semaine en pic, avec une moyenne de deux trains par mois sur la durée d’exploitation." Si on peut se féliciter de ces déclarations de bonnes intentions on peut cependant douter de leur exactitude.
L'expérience prouve que les matières radioactives ne sont pas transportées prioritairement par rail. La route reste dominante en particulier pour les déchets de faible et moyenne activité. Chaque semaine des camions partent des installations nucléaires de base vers les centres de stockage de l'ANDRA de Soulaines et Morvilliers. Quelques 8 camions arrivent chaque jour sur chacun de ces sites sans compter les transports de matériels destinés à l'entretien des installations.
Ainsi donc on peut imaginer, en dépit des déclarations du maitre d'ouvrage, qu'une part non négligeable des déchets destinés à être stockés à Bure sera acheminé par la route. C'est le cas en particuliers des déchets métalliques de moyenne activité aujourd'hui entreposés dans les piscines de désactivation des 58 réacteurs nucléaires en exploitation. On peut aussi penser aux matières radioactives des anciens réacteurs dits graphite gaz. Des milliers de tonnes de métaux et de graphites sont aujourd'hui entreposés sur les sites de la Loire notamment en attente de modalités de gestion durable. Fort est à parier, faute de raccordement ferroviaire des centrales nucléaires, qu'ils seront acheminés sur tout ou partie du trajet vers Cigéo par la route.
Si on compare ces prévisions de trafic avec les transports qui ont lieu aujourd'hui. Cigéo entrainerait un doublement du nombre de convois de matières radioactives à l'échelle de la France avec une concentration des flux en Meuse et Haute-Marne.
Un dispositif de gestion de crise est prévu dans le cas où un accident surviendrait. Il vise à limiter les conséquences des incidents ou accidents et en particulier à mettre en place les mesures éventuelles nécessaires pour la protection du public. La mise en œuvre des plans d'urgence est coordonnée par le préfet et fait intervenir à la fois les pouvoirs publics et l'industriel.
Comme souvent dans le domaine du nucléaire, on doit reconnaître les efforts faits pour envisager une stratégie efficiente pour intervenir sur un accident technologique et en limiter les conséquences. Cependant entre la théorie et la pratique l'écart est important. Des exercices de crise et des expériences passées donnent à voir que la prise en charge d'une situation accidentelle est difficile et déroge toujours aux scénarios conçus dans des bureaux.
Concrètement. Si un accident survient sur un transport de matières radioactives, les dispositifs classiques prévus par les plans d'urgence (PUI-TMR) et les plans d'organisation des secours (ORSEC) seront mis en œuvre (sirènes, messages radiophoniques, etc.) Mais la population saura t elle quoi faire pour se protéger ? Beaucoup ne céderont ils pas à la panique ? Quelques curieux ne se mettront ils pas en danger ? Voilà des questions qui se posent dans un pays où la culture du risque est encore balbutiante.
Il conviendrait de préciser à l'occasion du débat Cigéo, projet qui impliquerait au bas mot un doublement du nombre de transports de matières radioactives pendant un siècle, la doctrine de gestion de crise et les modalités d'information du public.
Réponse apportée par Guillaume Blavette, association Haute Normandie Nature Environnement :
Le maître d'ouvrage n'a pas apporté de réponses convaincantes au cours de ce débat public pour préciser quels seront les moyens mis en œuvre pour garantir la sécurité des transports. Le dossier du maître d'ouvrage esquive totalement cette question se contentant d'indiquer quels seraient les moyens et les itinéraires utilisés pour acheminer les colis de déchets sur le site de Cigéo.
Lors du débat contradictoire du 23 octobre 2013, Igor Le Bars de l'IRSN a été très évasif pour répondre aux questions du public concernant la sécurité des transports pour la simple raison que cela ne relève pas de son champ de compétence. Il s'est donc contenté de rappeler quelques considérations générales en vigueur aujourd'hui (verbatim du débat du 23 octobre pages 12 et 16). Si l'IRSN suit les transports de matières radioactives ce n'est pas tant pour veiller à leur sécurité mais surveiller leur sûreté. La sécurité relève du ministère de l'intérieur et du haut fonctionnaire de défense rattaché au ministère de l'environnement comme l'a rappelé Christophe Quintin à l'occasion de la 25e conférence nationale des CLI qui s'est tenu le 11 décembre dernier à Vincennes.
Tout cela ne nous dit pas grand chose sur les moyens qui pourraient être mis en œuvre pour garantir la sécurité des transports qui apporteront les dizaines de milliers de mètres cubes de déchets que l'Andra veut enfouir à Cigéo. En tout cas, il convient de bien distinguer ce qui relève de la sureté et ce qui relève de la sécurité. Le ministère de l'environnement définit de la manière suivante ces deux principes :
La sûreté nucléaire est l’ensemble des dispositions techniques et des mesures d’organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, à l’arrêt et au démantèlement des installations nucléaires de base, ainsi qu’au transport des substances radioactives, prises en vue de prévenir les accidents ou d’en limiter les effets.
La sécurité nucléaire comprend la sûreté nucléaire, la radioprotection, la prévention et la lutte contre les actes de malveillance, ainsi que les actions de sécurité civile en cas d’accident.
La sécurité englobe donc la sureté et la radioprotection, dont il a été largement question le 23 octobre, pour y adjoindre non seulement la prévention d'actes dits "de malveillance" mais la protection des convois. Ainsi, la nature particulière des activités nucléaires justifie l’existence d’un cadre juridique spécifique pour la sécurité nucléaire, avec une autorité spécialisée pour en contrôler la mise en œuvre. Ce cadre juridique est notamment basé sur la loi relative à la Transparence et à la Sécurité en matière Nucléaire (dite « loi TSN »).
Pour en revenir à la question, vous me demandez quelles seront les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des transports. La réponse est simple au titre de la sécurisation du trafic de matières radioactives, le transporteur fait appel à des moyens de protection et de maintien de l'ordre. Les matières les plus dangereuses, comme par exemple le plutonium qui circule chaque semaine sur les routes entre La Hague et Marcoule, sont escortés par des gendarmes. Les convois ferroviaires quant à eux déterminent la mobilisation de force de l'ordre tout le long du trajet prompt à intervenir au moindre événement. Au cours des dernières années, les convois de déchets vitrifiés à destination de Gorleben en Allemagne ont donné lieu à des interventions "musclés" contre les militants antinucléaires s'opposant au passage de ces matières radioactives.
Il s'agit à présent d'imaginer au regard de la réglementation en vigueur le nombre des forces de l'ordre qui seront nécessaires pour sécuriser les flux pour Bure. Avec Philippe Guiter, j'ai pu établir que Cigéo impliquera au bas mot un doublement pendant un siècle des flux de matières radioactives sur les routes et les voies ferrées de France. Cela devrait donc entrainer un doublement des moyens de sécurité. On touche là à un impensé de l'évaluation du coût du nucléaire aujourd'hui étudié par une commission d'enquête parlementaire créée le 11 décembre 2013 par l'Assemblée nationale. Combien coûtera en hommes et en euros la nécessaire protection des convois ? C'est au ministère de l'intérieur de fournir une évaluation de ces coûts à l'occasion de ce débat public.
Personne ne remettra jamais en cause une protection des convois nucléaires s'il s'agit d'empêcher un acte de malveillance voire une action terroriste. En effet dès que des matières radioactives circulent existe le risque d'un attentat mais aussi la possibilité d'un vol des dites matières. Une des failles de l'industrie nucléaire qui a motivé le Bundestag à mettre un terme à l'exploitation industrielle de l'énergie atomique est le risque de prolifération, c'est à dire qu'une organisation ou un Etat se saisissent de matières radioactives à des fins de destruction. Ce risque est indéniable pour les transports par route souvent isolés. Le haut fonctionnaire de défense en charge des transports de matière radioactive a lui-même reconnu le 12 décembre dernier que le vol d'une source de Cobalt 60 n'était pas à écarter complètement en France...
La sécurité pose donc des problèmes très différents de ceux que la sureté est en charge de maitriser. Nous avons parlé de la protection des convois. Reste l'autre déclinaison de la sécurité, à savoir l'organisation des secours et la prise en charge des blessés voire de morts. Le récent accident ferroviaire survenu à Drancy prouve que la sureté et la sécurité sont en jeu. Manifestement le "chateau" qui a déraillé portait des traces de contamination à un niveau non négligeable puisque mesurable. Comment dès lors organiser des secours sans mettre en péril les équipes d'intervention ? Comment organiser les secours sans provoquer une dissémination des matières radioactives ? Dans quelles conditions peut on entreposer provisoirement ces matières impactées par l'accident en garantissant une protection complète de l'environnement et de la santé publique ? Comment réparer le confinement qui a pu être détérioré et poursuivre l'acheminement de ces matières vers leur destination ? Ce ne sont pas là des questions abstraites mais des problèmes très concrets auxquels nous exposent les transports de matières dangereuses !
L'Etat est il en mesure de faire face à plusieurs accidents simultanés de transports de matières radioactives au fin fond de la Champagne ou de la Lorraine ? La question mérite d'être posée aux responsables de la sécurité civile et au ministère de l'intérieur. Les moyens de secours arriveront ils à temps ? Beaucoup d'éléments objectifs amènent à douter de cela notamment le contexte financier actuel.
Somme toute rien aujourd'hui ne peut garantir pleinement la sécurité des transports de matières dangereuses. Les services chargés de la surveillance de ces convois semblent parfois plus préoccupés d'empêcher des actions militantes non-violentes plutôt que d'assurer une protection efficiente des convois. Quant aux moyens de secours, il conviendrait de les développer, de les moderniser et de leur donner des moyens de mobilités adaptés à toutes les configurations climatiques. Cela implique que les collectivités locales et l'Etat acceptent de mettre en œuvre des équipes, des matériels et des modes d'organisation adaptés à la sécurisation des transports.
QUESTION 498
Posée par MAIRIE D'EPIZON, le 18/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 30 octobre 2013 - transformations locales et aménagement du territoire :
Question à Me Andriot : Comment pouvez-vous justifier que des filières techniques aient été supprimées au Lycée de Joinville alors que les élus locaux réclament depuis un certain temps le développement de celui-ci et ont étés obligés de se mobiliser pour en éviter la fermeture ? Damien THIERIOT Président de la CODECOM du Canton de Poissons
Réponse du 10/01/2014,
Réponse apportée par Patricia Andriot, vice-présidente du Conseil Régional Champagne-Ardenne :
Je tiens d'abord à préciser que la décision de suppression de filières techniques au Lycée de Joinville a relevé du recteur, qui se faisant n'a pas tenu compte de l'avis que le conseil régional à donné à l'époque. La décision du rectorat a été motivée par les effectifs sur plusieurs recrutements, et l'offre globale existant sur la région dans le même secteur. Il y a eu dans la gestion de la carte de formation, une logique soucieuse d'économie qui mise sur la mobilité régionale des jeunes. De mon point de vue, cela reste très discutable car la dimension aménagement du territoire n'est pas prise en compte et que la réalité de la mobilité des jeunes est par ailleurs très discutable.
Sur l'argument selon lequel une telle décision est en contradiction avec l'implantation de cigeo et la volonté de maintenir un développement de ce territoire, nous avons pour notre part (je parle de mon groupe politique au sein du CR) toujours défendu l'idée de développer des filières de formation préparant au démantèlement du nucléaire. Sans succès jusqu'à ce jour.
QUESTION 497 - Réalisation de scénarios d'incidents
Posée par jc BENOIT, L'organisme que vous représentez (option) (RENNES), le 15/11/2013
Bonjour, il y aurait il un site équivalent de Bure, où vous pourriez faire un modèle réduit du site CIGEO et réaliser de scénarios d'incidents de différentes gravités :innondations, incendies, explosions dans des alvéoles, dans les conduits d'accès et voir ce qui serait faisable ou non en situations accidentelles ?
Réponse du 12/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’Andra retient pour la conception de Cigéo des techniques robustes qui ont été éprouvées dans d’autres secteurs (industrie nucléaire, exploitation d’ouvrages souterrains, transport de personnes…). Par ailleurs, des essais de qualification sont réalisés pour valider le dimensionnement de certains composants (par exemple résistance des colis de stockage à la chute, à l’incendie et à l’explosion). Les essais déjà réalisés sont présentés à l’Espace technologique de l’Andra situé à Saudron. Par ailleurs, l’exploitant d’une installation nucléaire doit mener un programme d’essais complet avant d’être autorisé à mettre en service son installation. Si la création de Cigéo est autorisée, l’Andra devra donc mener des essais sur l’ensemble des fonctions d’exploitation avant la mise en service. Le programme d’essais aura pour objet de valider le comportement satisfaisant des équipements, y compris dans les scénarios incidentels décrits dans le rapport préliminaire de sûreté de l’installation.
L’Andra collabore également avec les services départementaux et de secours (SDIS) de Meuse et de Haute-Marne. Les besoins exprimés par les pompiers pour faciliter leur intervention dans la future installation sont ainsi pris en compte dès la conception du projet. Le personnel sera formé à l’incendie et des exercices réguliers d’intervention seront organisés comme cela est déjà le cas dans les galeries du Laboratoire souterrain, dans les mines et dans toute installation nucléaire. Les besoins d’infrastructures d’entraînement permettant de tester les conditions d’intervention et les matériels opérationnels seront déterminés en lien avec les SDIS afin de renforcer la qualité des opérations menées par les acteurs de secours.
QUESTION 496
Posée par Gaëlle ARNOZ (VECQUEVILLE), le 14/11/2013
Les éoliennes sont-elles dangereuses pour la santé des personnes sensibles? Les déchets nucléaires stockés sont sans danger pour la terre car il y a pas mal de champs agricoles autour de Bure. Merci pour la réponse que vous m'avez envoyé ça rassure quand on n'y connais rien sur le sujet.
Réponse du 10/02/2014,
Réponse apportée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Il y a 50 000 éoliennes dans le monde, dont certaines en fonctionnement depuis plus de 20 ans : aucun problème général de santé publique n’a été identifié par les autorités sanitaires des pays concernés.
En France, l'Académie de médecine a publié le 14 mars 2006, un rapport intitulé "le retentissement des éoliennes sur la santé de l'homme". L’Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (Afsset), saisie le 27 juin 2006 par les ministères en charge de la santé et de l’environnement afin d’analyser les préconisations de l’Académie, a remis le 1er mars 2008 un rapport sur les «Impacts sanitaires du bruit généré par les éoliennes». Fort d'un état des lieux national et mondial de la filière éolienne, l'Afsset soulignait dès 2008 que la France disposait d’une des réglementations les plus protectrices pour les riverains.
Toutefois, le législateur a souhaité, à l'occasion du vote de la loi dite "Grenelle II", renforcer les dispositifs de précaution à l'égard des conséquences potentielles des éoliennes sur la santé humaine. La loi a par conséquent inscrit, dans son article 90, le respect d'une distance minimale de 500m entre les habitations existantes et toute nouvelle éolienne. Elle a par ailleurs assujetti les éoliennes à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE).
D'autre part, s'agissant des nuisances sonores émises par les éoliennes installées par des particuliers, dès que le mât est inférieur à 12 m, les éoliennes sont soumises aux dispositions du code de la santé publique relatives à la lutte contre le bruit (articles R. 1334-30 à R.1334-37).
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les déchets les plus radioactifs destinés à Cigéo sont des déchets dangereux, qui le resteront plusieurs dizaines à centaines de milliers d’années. Ces déchets, produits en France depuis les années 1960, sont actuellement entreposés provisoirement dans des bâtiments sur leurs sites de production, principalement à La Hague (Manche), Marcoule (Gard), Cadarache (Bouches-du-Rhône) et, pour un volume limité, à Valduc (Côte-d’Or), dans l’attente d’une solution de gestion à long terme.
La sûreté est au cœur du projet Cigéo. Pour que le projet puisse être autorisé, l’Andra doit démontrer à l’Autorité de sûreté nucléaire que l’installation permet de maîtriser les risques liés aux déchets radioactifs, pendant son exploitation et après sa fermeture. Le but du stockage profond est de protéger l’homme et l’environnement de la dangerosité de ces déchets sur de très longues durées. Si Cigéo est autorisé, il donnera ainsi la possibilité aux générations suivantes de mettre en sécurité de manière définitive ces déchets. Que ce soit pendant son exploitation ou après sa fermeture, son impact sera nettement inférieur à celui de la radioactivité naturelle présente dans l’environnement. Comme c’est le cas aujourd’hui dans les régions où sont déjà implantées des centres de stockage de l’Andra ou des installations nucléaires, l’implantation de Cigéo restera compatible avec des activités agricoles et n’aura pas de conséquences sur les productions locales ni leur qualité.
L’Andra a créé l’Observatoire pérenne de l’environnement, qui a pour mission d’assurer un suivi détaillé de l’évolution de l’environnement du stockage. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, il permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Cela permettra de lever ainsi toute inquiétude en démontrant que le stockage n’a pas d’impact sur les activités agricoles de proximité. Par ailleurs, comme toutes les exploitations nucléaires, Cigéo sera en permanence soumis au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire, qui fait faire régulièrement par des laboratoires indépendants des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant.
QUESTION 495
Posée par Rémy OURION (VELAINES), le 14/11/2013
La plateforme de stockage à Velaines, que va-t-elle stocker?
Réponse du 20/12/2013,
Réponse apportée par Edf :
La plate-forme de Velaines a été mise en service en 2011. Il s’agit d’une plate-forme logistique de pièces de rechange pour les centrales nucléaires EDF. Elle réceptionne les pièces livrées par les fournisseurs d’EDF, qui sont ensuite expédiées aux centrales en fonction de leurs besoins de maintenance. 67 personnes travaillent dans cette plate-forme, qui vient de se doter d’un bâtiment dédié aux composants électroniques, et qui fera l’objet en 2017 d’une extension de surface de plus de 60%, créant 30 emplois supplémentaires.
QUESTION 494
Posée par Jasmine , le 14/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 23 octobre 2013 - les transports de déchets :
M. Guiter, pourquoi voulez-vous laisser les déchets à la Hague alors que certains disent que le site n’est pas assez sécurisé et qu’il n’est pas adapté à un stockage de longue durée ?
Réponse du 02/12/2013,
Réponse apportée par Philippe Guiter, syndicat Sud Rail :
Il fallait y réfléchir avant. Il n'y a pas eu de réelle concertations sur le sujet. Le site de La Hague est condamné et Cigéo va condamner une autre région pendant que l'usine de La Hague continuera à retraiter inutilement les déchets futurs.
QUESTION 493
Posée par Stef , le 14/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 23 octobre 2013 - les transports de déchets :
Une question pour vos invités : malgré l'actualité de ces derniers mois, le transport ferroviaire reste quand même beaucoup plus sûr que le transport routier. Pourquoi ne pas l'imposer ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Si Cigéo est mis en œuvre, le transport des colis de déchets depuis leurs lieux d’entreposage jusqu’à Cigéo se ferait principalement par voie ferrée, le réseau ferré national permettant d’acheminer les convois jusqu’à proximité de Cigéo. Seul un volume limité de colis de déchets serait acheminée par voie routière, ceux provenant du site du CEA de Valduc. Le transport des colis de déchets jusqu’à Cigéo sera réalisé sous la responsabilité des producteurs de déchets (Areva, CEA, EDF).
Plus d’information : Le transport des colis de déchets (chapitre 4.3)../docs/dmo/chapitres/DMO-Andra-chapitre-4.pdf
Réponse apportée par Philippe Guiter, syndicat Sud Rail :
Oui, mais le mieux est de ne pas avoir de transports du tout. Il est inconcevable que sous le prétexte de vider le site de La Hague, on expose inutilement les salariés et la population à de tels risques.
QUESTION 492
Posée par Alain ROULET, le 14/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 23 octobre 2013 - les transports de déchets :
Question sur le réseau ferroviaire et le terminal d’Orsan en Vallée du Rhône (dossier Maître d’Ouvrage page 47)
La solution de desserte ferroviaire est privilégiée, ce qui va dans le sens du développement durable. Toutefois, on peut s’interroger de l’impact du projet Cigéo sur les infrastructures existantes en vallée du Rhône. Le terminal d’Orsan est aujourd’hui enclavé entre le village, la ligne ferroviaire, et la route. Il est peu utilisé par rapport à celui de Valognes, et ne permet a priori pas de charger plus de trois wagons. Il parait donc peu réaliste d’envisager son utilisation en l’état pour les flux de transport du projet Cigeo. Au-delà du SIDT en région Meuse Haute Marne, comment seront organisés les aménagements d’infrastructure en Vallée du Rhône nécessaire à cet acheminement ferroviaire ? Des emballages de plus de 100 tonnes pour l’évacuation des déchets vitrifiés de Marcoule pourront-ils bien être acheminés par un terminal ferroviaire de proximité ?
Réponse du 20/12/2013,
Réponse apportée par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) :
Le CEA examine les modalités de transport de ses déchets entre ses sites et CIGEO dans le sens du développement durable. Pour cette raison, et dans la mesure où l’arrivée des colis de déchets sur CIGEO doit s’effectuer par voie ferroviaire, les scénarios étudiés mettant en œuvre ce mode de transport sont privilégiés. L’utilisation du terminal ferroviaire de Marcoule (ex Orsan) appartient logiquement à un des scénarios étudiés par effet de proximité. Le CEA déterminera à terme le scénario de transport de référence sur la base d’éléments de sûreté et de sécurité, techniques et environnementaux, et dans une recherche d’optimum technico- économique. L’objectif du CEA est d’optimiser ses expéditions en choisissant les emballages de transport les plus adaptés aux flux envisagés de réception sur le site Cigéo.
Réponse apportée par Philippe Guiter, syndicat Sud Rail :
Nous n'avons pas encore de vision de ce que sera le terminal pour cigéo.
QUESTION 491
Posée par Alain ROULET, le 14/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 23 octobre 2013 - les transports de déchets :
La réglementation des transports de substances radioactives définit des exigences liées à l’activité radiologique, le niveau le plus élevé étant le « Type B ». Parmi la totalité des déchets destinés au stockage, pourriez-vous préciser combien de colis (emballages) seraient « de Type B », soumis à un agrément de l’ASN, c’est-à-dire similaires aux emballages de transport actuel de combustibles usés ou de déchets vitrifiés ? Pourriez-vous également préciser si les solutions de transport (conception et agrément par l’ASN des « modèles de colis » ou emballages) sont aujourd’hui disponibles pour les déchets concernés ?
Réponse du 15/01/2014,
Réponse apportée par EDF, AREVA et le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives :
Les déchets de moyenne activité à vie longue qui pourraient être stockés dans Cigéo représentent un volume d'environ 70.000 m3, soit de l'ordre de 180.000 colis. Environ 90 à 95% de ces déchets seraient transportés en emballages de transport de type B soumis à l'agrément de l'Autorité de Sûreté Nucléaire. Les déchets de haute activité représentent quant à eux un volume de 10.000 m3, soit environ 60.000 colis. La totalité de ces déchets seraient transportés en emballage de type B.
Conformément à la réglementation et aux exigences de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, qui contrôle le transport des substances radioactives, les emballages sont conçus en fonction des caractéristiques des déchets qu'ils devront transporter. Les solutions techniques pour transporter les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue existent, comme en attestent les emballages utilisés pour le retour des déchets du traitement de combustibles usés étrangers vers leur pays d'origine. Ce type d’emballage comporte des couches successives de matériaux d’une épaisseur totale de 40 centimètres, dont 30 centimètres d’acier forgé, afin de protéger les populations et l’environnement des substances radioactives qu’il contient. Ce type d'emballage a subi toutes les épreuves règlementaires qui démontrent sa résistance aux situations les plus extrêmes : chute de 9 mètres sur surface indéformable, chute d’un mètre sur poinçon, tenue à un feu de 30 minutes et immersion jusqu’à 200 mètres. La vérification de la résistance de l’emballage à ces épreuves, garantissant la résistance des emballages à des conditions accidentelles sévères, a été validée par un agrément des autorités compétentes.
QUESTION 490
Posée par Florence LAMAZE, le 14/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 23 octobre 2013 - les transports des déchets :
Il arrive aux trains d'avoir des accidents , de dérailler. N'est-ce pas faire courir un risque majeur aux populations qui vivent aux alentours de ces trajets ferroviaires?
Réponse du 20/12/2013,
Réponse apportée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) :
Environ 900 000 colis de substances radioactives sont transportés chaque année. 85 % des colis transportés sont destinés aux secteurs de la santé, de l’industrie non-nucléaire ou de la recherche, dits "nucléaire de proximité", dont 30 % environ pour le seul secteur médical. L’industrie nucléaire ne représente qu’environ 15 % du flux annuel de transports de substances radioactives. On estime à environ 11 000 le nombre annuel de transports nécessaires au cycle du combustible, pour 141 000 colis. Le contenu des colis est très divers : leur radioactivité varie sur plus de douze ordres de grandeur, soit de quelques milliers de becquerels pour des colis pharmaceutiques de faible activité à des millions de milliards de becquerels pour des combustibles irradiés. Leur masse varie de quelques kilogrammes à une centaine de tonnes.
L’ASN est chargée du contrôle de la sûreté. La sûreté est l’ensemble des dispositions techniques et organisationnelles prises en vue de prévenir les accidents ou d’en limiter les effets.
Les risques majeurs des transports de substances radioactives sont les suivants :
- le risque d’irradiation externe de personnes dans le cas de la détérioration de la « protection biologique des colis », matériau technique qui permet de réduire le rayonnement au contact du colis ;
- le risque d’inhalation ou d’ingestion de particules radioactives dans le cas de relâchement de substances radioactives ;
- la contamination de l’environnement dans le cas de relâchement de substances radioactives ;
- le démarrage d’une réaction nucléaire en chaîne non contrôlée (risque de « sûreté-criticité») pouvant occasionner une irradiation des personnes, en cas de présence d’eau et de non-maîtrise de la sûreté de substances radioactives fissiles.
La prise en compte de ces risques conduit à devoir maîtriser le comportement des colis pour éviter tout relâchement de matière et détérioration des protections du colis dans le cas :
- d’un incendie ;
- d’un impact mécanique consécutif à un accident de transport ;
- d’une entrée d’eau dans l’emballage (l’eau facilitant les réactions nucléaires en chaîne en présence de substances fissiles) ;
- d’une interaction chimique entre différents constituants du colis ;
- d’un dégagement thermique important des substances transportées, pour éviter la détérioration éventuelle avec la chaleur des matériaux constitutifs du colis.
Cette approche conduit à définir des principes de sûreté pour les transports de substances radioactives :
- la sûreté repose avant tout sur le colis : des épreuves réglementaires et des démonstrations de sûreté sont requises par la réglementation pour démontrer la résistance des colis à des accidents de référence ;
- le niveau d’exigence, notamment concernant la définition des accidents de référence auxquels doivent résister les colis, dépend du niveau de risque présenté par le contenu du colis. Ainsi, les colis qui permettent de transporter les substances les plus dangereuses doivent être conçus de façon à ce que la sûreté soit garantie y compris lors d’accident de transport. Ces accidents sont représentés par les épreuves suivantes :
- trois épreuves en série (chute de 9 m sur une surface indéformable, chute de 1 m sur un poinçon et incendie totalement enveloppant de 800 °C minimum pendant 30 minutes) ;
- immersion dans l’eau d’une profondeur de 15 m (200 m pour les combustibles irradiés) pendant 8 h.
La sûreté des transports est également fondée sur la fiabilité des opérations de transport qui doivent satisfaire à des exigences réglementaires notamment en matière de radioprotection. L'ASN assure le contrôle de la sûreté des transports de matières radioactives. Enfin, la gestion des situations accidentelles est régulièrement testée lors d'exercices.
Réponse apportée par Philippe Guiter, syndicat Sud Rail :
Avec l'augmentation de ces convois hautement radioactifs, l'augmentation statistique du risque d'accident grave est d'actualité. Par ailleurs nous contestons les seuils de résistance au feu et aux chocs des emballages actuels ainsi que le mélange de différents produits chimiques dans ces convois qui font courir le risque de sur-accident.
QUESTION 489 - transparence nucléaire et mémoire de Masao Yoshida
Posée par Marie-Hélène PONCET, L'organisme que vous représentez (option) (MONTPELLIER), le 12/07/2013
Il y a deux jours, l'ancien directeur de la centrale de Fukushima est mort d'un cancer de la gorge. C'est on peut le dire, un héros. Que pensez-vous de la transparence de Tepco qui indique que le cancer de l'oesophage qui l'a tué ne serait pas du aux radiations? "Cet homme qui était arrivé en juin 2010 à Fukushima Daiichi est décédé mardi à l’âge de 58 ans d’un cancer de l’oesophage qui, affirme son employeur Tokyo Electric Power (Tepco), ne serait pas lié aux radiations (de 70 millisieverts) encaissées entre le 11 mars 2011, jour de l’accident, et la mi-novembre 2011 quand, malade, il a dû quitter ses fonctions." http://www.lavoixdunord.fr/france-monde/le-directeur-de-la-centrale-de-fukushima-est-mort-d-un-cancer-ia0b0n1400661
Réponse du 10/01/2014,
L'actuelle Commision du débat public (Cpdp) s'inscrit dans un cadre juridique précis. Elle a été nommée pour organiser un débat public sur le projet de stockage de déchets radioactifs en Meuse/Haute-Marne et pour permettre aux citoyens de s'exprimer sur l'opportunité de réaliser ou non ce stockage et si oui, sur les modalités de sa réalisation.
La transparence de Tepco déborde largement le cadre du projet Cigéo, et la Cpdp n’a aucune légitimité pour aborder un tel sujet.
En revanche, vos interrogations sur les impacts de la radioactivité sur la santé des salariés ou des riverains ont été largement au cœur du débat public ; des opinions nombreuses et diverses ont été émises, dont le compte rendu du débat rendra compte.
QUESTION 488
Posée par Marine BERNARD (HAUTE MARNE), le 14/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 23 octobre 2013 - les transports de déchets :
Qui sera responsable en cas de grave accident lors du transports des colis de déchets? la société de transport ou les producteurs de déchets ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par Edf :
Le producteur de déchets reste toujours responsable des déchets qu’il fait transporter. Il doit ainsi s’assurer que le transporteur auquel il confie l’acheminement de ses déchets mette en œuvre toutes les mesures nécessaires pour garantir la protection des populations et de l’environnement. Comme pour tous les transports de substances radioactives réalisés aujourd’hui en France, les transports des déchets jusqu’à Cigéo seront soumis à la réglementation internationale. La conception des emballages de transport et la formation des personnels font partie de ces règles, dont le respect est soumis au contrôle de l'Autorité de Sûreté Nucléaire. Le contrôle de la protection des transports contre les actions de malveillance est, lui, du ressort du Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité auprès du ministre de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie. La mise en oeuvre de ces mesures permet de réaliser quotidiennement des transports en toute sécurité, comme en témoigne l'absence d'accident ayant affecté les populations ou l'environnement.
Réponse apportée par Guillaume Blavette, association Haute Normandie Nature Environnement :
Deux principes servent de base à la réglementation internationale du transport de matières radioactives :
- l’expéditeur (et non le transporteur) est le premier responsable de la sûreté au cours du transport ;
- la sûreté repose sur le concept de défense en profondeur dont la première composante est la robustesse de l’emballage. Celle-ci doit être adaptée à la matière transportée et à des conditions prédéfinies d’accident de transport.
QUESTION 487
Posée par Laurine DEROY, le 14/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 23 octobre 2013 - les transports de déchets :
Que se passera-t-il en cas de collision avec un autre véhicule durant l'acheminement routier ?
Réponse du 20/12/2013,
Réponse apportée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) :
Environ 900 000 colis de substances radioactives sont transportés chaque année. 85 % des colis transportés sont destinés aux secteurs de la santé, de l’industrie non-nucléaire ou de la recherche, dits "nucléaire de proximité", dont 30 % environ pour le seul secteur médical. L’industrie nucléaire ne représente qu’environ 15 % du flux annuel de transports de substances radioactives. On estime à environ 11 000 le nombre annuel de transports nécessaires au cycle du combustible, pour 141 000 colis. Le contenu des colis est très divers : leur radioactivité varie sur plus de douze ordres de grandeur, soit de quelques milliers de becquerels pour des colis pharmaceutiques de faible activité à des millions de milliards de becquerels pour des combustibles irradiés. Leur masse varie de quelques kilogrammes à une centaine de tonnes.
L’ASN est chargée du contrôle de la sûreté. La sûreté est l’ensemble des dispositions techniques et organisationnelles prises en vue de prévenir les accidents ou d’en limiter les effets.
Les risques majeurs des transports de substances radioactives sont les suivants :
- le risque d’irradiation externe de personnes dans le cas de la détérioration de la « protection biologique des colis », matériau technique qui permet de réduire le rayonnement au contact du colis ;
- le risque d’inhalation ou d’ingestion de particules radioactives dans le cas de relâchement de substances radioactives ;
- la contamination de l’environnement dans le cas de relâchement de substances radioactives ;
- le démarrage d’une réaction nucléaire en chaîne non contrôlée (risque de « sûreté-criticité») pouvant occasionner une irradiation des personnes, en cas de présence d’eau et de non-maîtrise de la sûreté de substances radioactives fissiles.
La prise en compte de ces risques conduit à devoir maîtriser le comportement des colis pour éviter tout relâchement de matière et détérioration des protections du colis dans le cas :
- d’un incendie ;
- d’un impact mécanique consécutif à un accident de transport ;
- d’une entrée d’eau dans l’emballage (l’eau facilitant les réactions nucléaires en chaîne en présence de substances fissiles) ;
- d’une interaction chimique entre différents constituants du colis ;
- d’un dégagement thermique important des substances transportées, pour éviter la détérioration éventuelle avec la chaleur des matériaux constitutifs du colis.
Cette approche conduit à définir des principes de sûreté pour les transports de substances radioactives :
- la sûreté repose avant tout sur le colis : des épreuves réglementaires et des démonstrations de sûreté sont requises par la réglementation pour démontrer la résistance des colis à des accidents de référence ;
- le niveau d’exigence, notamment concernant la définition des accidents de référence auxquels doivent résister les colis, dépend du niveau de risque présenté par le contenu du colis. Ainsi, les colis qui permettent de transporter les substances les plus dangereuses doivent être conçus de façon à ce que la sûreté soit garantie y compris lors d’accident de transport. Ces accidents sont représentés par les épreuves suivantes :
- trois épreuves en série (chute de 9 m sur une surface indéformable, chute de 1 m sur un poinçon et incendie totalement enveloppant de 800 °C minimum pendant 30 minutes) ;
- immersion dans l’eau d’une profondeur de 15 m (200 m pour les combustibles irradiés) pendant 8 h.
La sûreté des transports est également fondée sur la fiabilité des opérations de transport qui doivent satisfaire à des exigences réglementaires notamment en matière de radioprotection. L'ASN assure le contrôle de la sûreté des transports de matières radioactives. Enfin, la gestion des situations accidentelles est régulièrement testée lors d'exercices.
Réponse apportée par Guillaume Blavette, association Haute Normandie Nature Environnement :
Une collision entre un transport de matières radioactives et un autre véhicule peut entrainer le déclenchement par la sécurité civile d'un plan d'urgence (voir réponse à la question n°484). L'enjeu est d'empêcher toute dissémination de matières radioactives dans l'environnement. Problème d'autant plus important que la contamination n'est pas perceptible sans des équipements appropriés.
Cependant un autre problème plus spécifique au projet Cigéo se pose en cas d'accident d'un transport. L'enfouissement implique un confinement parfait des matières afin de garantir la sureté du stockage (voir réponse à la question n°420). Or si un accident survient l'intégrité du colis peut être atteinte même si aucune dissémination de matières radioactives a lieu.
On touche là à une des faiblesses du projet de l'ANDRA. Cigéo implique une noria de transports qui sont chacun exposés à des risques, à des accidents ou à des défaillances. Nous avons donc affaire à un projet qui multiplierait des risques déjà trop important aujourd'hui.
Cela doit nous rappeler que la concentration en quelques lieux des déchets n'est pas forcément la solution la plus efficiente. Afin de limiter les risques, il conviendrait d'envisager comme cela fut proposé à l'occasion du précédent débat public sur la gestion des déchets un entreposage sur site, c'est à dire dans les installations nucléaires déjà existantes. Chaque transport évité est une garantie de sureté.
QUESTION 486
Posée par Marine BERNARD (HAUTE MARNE), le 14/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 23 octobre 2013 - les transports de déchets :
Sachant que les opposants au stockage vont être de plus en plus tenace, comment aller-vous faire pour ne pas avoir d'incident avec ces opposants ?
Réponse du 15/01/2014,
Réponse apportée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
En France, le transport de matières nucléaires est soumis au Code de la Défense. Le Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité, placé auprès du ministre de l'Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE) est chargé du respect des règles de confidentialité. Celles-ci s'imposent à tous les intervenants (pouvoirs publics, exploitants, transporteurs, etc.) lors de la préparation et l'exécution des transports de matières nucléaires.
QUESTION 485
Posée par Raymond CHAUSSIN, le 14/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 23 octobre 2013 - les transports de déchets :
Les conducteurs ont-ils des badges mesurant leur exposition aux rayonnements?
Réponse du 20/12/2013,
Réponse apportée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) :
Conformément à l'article 1.7.2. de l'ADR (accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route), les expositions professionnelles résultant des activités de transport font l'objet d'une surveillance. Ainsi, tout chauffeur transportant des substances radioactives susceptible d'être exposé au-delà de la limite réglementaire annuelle (1 millisievert par an pour le public) doit porter un dispositif de surveillance de l'exposition aux rayonnements, appelé dosimètre.
Réponse apportée par Philippe Guiter, syndicat Sud Rail :
Non, seuls les quelques agents de manœuvres intervenant directement dans les terminaux des centrales sont équipés et suivis médicalement.
QUESTION 484
Posée par Marine BERNARD (HAUTE MARNE), le 14/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 23 octobre 2013 - les transports de déchets :
Comment sera informée la population en cas d'accident lors de transport des colis? Que prévoyez-vous en cas d'accident?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) :
En cas d'accident relatif à un transport de matières radioactives (TMR), les personnes seront informées par le préfet à travers les médias locaux ainsi que par les services d’intervention (gendarmerie, police, pompiers).
L’ASN a également un devoir d'information de la population et des médias (site Internet, communiqués de presse, réseaux sociaux).
La direction des opérations de secours (DOS) est assurée par le préfet du département concerné.
Si un périmètre d’exclusion est mis en place (100 mètres en mode réflexe, pouvant être étendu jusqu’à 1 kilomètre), l'alerte des populations se fait au moyen de véhicules équipés de haut-parleurs ou en porte-à-porte.
Toutes ces actions sont prévues dans le plan ORSEC-TMR élaboré dans chaque département français et régulièrement testé lors d'exercices de crise.
Réponse apportée par Guillaume Blavette, association Haute Normandie Nature Environnement :
Les transports de matières radioactives (TMR) et le droit à l'information ne font pas bon ménage en France. Au titre de la sécurité des transports c'est à dire de la prévention des actes terroristes, l'Etat est très discret sur ce genre de convois. Ni les populations ni les élus locaux sont informés du passage de trains de déchets ou de la circulation routière de matières radioactives. Si un accident survient sur un transport des dispositifs de secours, clairement présentés par M. Le Bars lors du débat contradictoire qui a eu lieu le 23 octobre, existent. En principe la sécurité civile départementale avec l'appui technique du transporteur et de l'IRSN intervient en cas d'accident.
Un dispositif de gestion de crise est prévu dans le cas où un accident surviendrait. Il vise à limiter les conséquences des incidents ou accidents et en particulier à mettre en place les mesures éventuelles nécessaires pour la protection du public. La mise en oeuvre des plans d'urgence est coordonnée par le préfet et fait intervenir à la fois les pouvoirs publics et l'industriel.
Comme souvent dans le domaine du nucléaire, on doit reconnaître les efforts faits pour envisager une stratégie efficiente pour intervenir sur un accident technologique et en limiter les conséquences. Cependant entre la théorie et la pratique l'écart est important. Des exercices de crise et des expériences passées donnent à voir que la prise en charge d'une situation accidentelle est difficile et déroge toujours aux scénarios conçus dans des bureaux.
L'accident survenu à Rouen le 25 janvier 2013 prouve que l'information du public est le maillon faible des dispositifs de crise tels qu'ils sont mis en œuvre en France. La sécurité civile face au problème causé par une défaillance d'une unité de production de l'usine Lubrizol n'a pas su communiquer concentrant son action sur le traitement de la crise et le retour à l'état initial de l'installation. Des prouesses techniques ont été réalisées avec l'appuis de l'INERIS pour éviter une catastrophe mais la population est restée de longues heures dans l'incertitude. Que ce serait il passé s'il avait fallu évacuer les populations riveraines ? La question reste entière.
Concrètement. Si un accident survient sur un transport de matières radioactives, les dispositifs classiques prévus par les plans d'urgence (PUI-TMR) et les plans d'organisation des secours (ORSEC) seront mis en oeuvre (sirènes, messages radiophoniques, etc.) Mais la population saura t elle quoi faire pour se protéger ? Beaucoup ne céderont ils pas à la panique ? quelques curieux ne se mettront ils pas en danger ? Voilà des questions qui se posent dans un pays où la culture du risque est encore balbutiante.
Il conviendrait de préciser à l'occasion du débat Cigéo, projet qui impliquerait au bas mot un doublement du nombre de transports de matières radioactives pendant un siècle, la doctrine de gestion de crise et les modalités d'information du public.
QUESTION 483
Posée par Raymond CHAUSSIN, le 14/11/2013
Question posée lors du débat contraidctoire du 23 octobre 2013 - les transports de déchets :
Lorsqu'un convoi sera bloqué dans une gare, sera-t-elle interdite au public?
Réponse du 20/12/2013,
Réponse apportée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) :
Hors situation incidentelle, l’exposition aux rayonnements ionisants à proximité d’un convoi de substances radioactives reste très limitée.
La réglementation applicable au transport de matières radioactives par route et par rail dispose que l’intensité de rayonnement dans les conditions de transport de routine ne doit pas dépasser 0,1 milliSievert (mSv) par heure à 2 mètres de la surface externe du véhicule. Il faudrait donc qu’une personne reste au moins 10 heures à 2 mètres d’un wagon contenant des substances radioactives pour atteindre la limite de dose annuelle fixée pour le public (1 mSv). Hors situation incidentelle, il n’y a donc pas lieu d’interdire l’accès à une gare où stationne un convoi de substances radioactives.
Si un accident grave conduisait à un niveau de radioactivité susceptible de porter atteinte à la santé publique, le préfet du département déclencherait un plan de secours préparé à l’avance. Ce plan prévoit des modalités d’évacuation ou de mise à l’abri des personnes à proximité du lieu de l’accident.
Réponse apportée par Philippe Guiter, syndicat Sud Rail :
Non, seulement quelques « triages » sont habilités pour recevoir ces convois. La plupart du temps, en cas d'aléas, et c'est souvent, les convois sont stationnés dans des gares ouvertes aux usagers.
QUESTION 482
Posée par Marine BERNARD (HAUTE MARNE), le 14/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 23 octobre 2013 - le transports de déchets :
Pourra-t-on reconnaître un train transportant des déchets lors de sa circulation?
Réponse du 20/12/2013,
Réponse apportée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) :
Le transport ferroviaire de substances radioactives en France est régi par le « Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses » (RID). Celui-ci prévoit, au chapitre 5.3, que les wagons transportant des colis contenant des substances radioactives comportent, de chaque côté, une plaque-étiquette 7D (plaque carrée de 25 cm de côté sur laquelle figure la mention « Radioactive » et un trèfle) ainsi qu’un panneau orange indiquant, dans sa moitié supérieure, le code de danger « 70 » et, dans sa moitié inférieure, le numéro ONU de la substance transportée. Ces numéros sont définis au chapitre 3.2 du RID.
Réponse apportée par Philippe Guiter, syndicat Sud Rail :
Oui, il y a le sigle jaune et noir et l'annotation « radioactive » présents de chaque coté. Il est beaucoup plus difficile de savoir s'il est vide ou chargé.
QUESTION 481
Posée par Raymond CHAUSSIN, le 14/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 23 octobre 2013 - Les transports de déchets :
Alors ça donne quoi à 1000 degrès?
Réponse du 06/01/2014,
Réponse apportée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) :
Les colis de type B, qui permettent de transporter les substances les plus dangereuses, doivent être conçus de façon à ce que la sûreté soit garantie, y compris lors d’accident de transport. Ces accidents sont représentés par les épreuves suivantes :
- trois épreuves en série :
- chute de 9 m sur une surface indéformable ;
- chute de 1 m sur un poinçon ;
- incendie totalement enveloppant de 800 °C minimum pendant 30 minutes ;
- immersion dans l’eau d’une profondeur de 15 m (200 m pour les combustibles irradiés) pendant 8 h.
Ces tests, qui s’apparentent aux « crash-tests » de l’industrie automobile, ont été préconisés par l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Ils ont été conçus afin, d’une part, de couvrir la très grande majorité des accidents les plus sévères et, d’autre part, dans le souci qu’ils soient aisément reproductibles d’un pays à un autre. Ainsi, ces tests sont reconnus et appliqués très largement par les États membres de l’AIEA. Leur réalisation est obligatoire au sein de l’Union européenne.
L’ASN est chargée de délivrer des certificats d’agrément pour les modèles de colis présentant les plus forts enjeux de sûreté. Pour cela, elle vérifie que ces modèles de colis conservent leurs fonctions de sûreté à l’issue des épreuves réglementaires.
Dans le cadre de l’instruction des demandes d’agrément, l’ASN ne vérifie pas le comportement des colis lors d’un incendie de plus de 800°C.
QUESTION 480 - Aurais-je une réponse ?
Posée par Vincent PASCALE (DOMRÉMY), le 16/05/2013
Y aura-t-il d'autres débats pour les prochains centres d'enfouissements, qui immanquablement ne sauraient tarder si ce climat d'irresponsabilité perdure, ou bien le débat actuel fera-t-il office de jurisprudence ?
Pour ma part, j'accuse l'Andra, et nos dirigeants qui l'appuient, de crime contre l'humanité et crime contre la descendance de l'humanité.
Réponse du 13/06/2013,
Le présent débat public porte exclusivement sur le projet de stockage profond en Meuse-Haute Marne. Si un projet similaire était proposé dans une autre région, il ferait l'objet d'un nouveau débat public.
la Commission du débat public vous laisse la responsabilité de votre quelification de "crime contre l'humanité"
QUESTION 479
Posée par Pascale VINCENT, CITOYEN DU MONDE (DOMRÉMY EN ORNOIS), le 22/05/2013
Il est possible d'arrêter toutes les centrales nucléaires en France dès aujourd'hui en changeant un tout petit peu nos habitudes. Le Japon nous le prouve depuis 2 ans avec seulement 2 réacteurs en fonction sur les 54 existants. Alors pourquoi nos dirigeants ne prennent-ils pas la décision d'arrêter les centrales nucléaires, au constat de l'importance du danger de la production, du danger de l'enfouissement ou de toute autre gestion des déchets ? Pourquoi les déchets continuent-ils à être produits ? Faudra-t-il attendre la catastrophe en France pour que les décideurs deviennent matures ? J'accuse l'ANDRA, et nos dirigeants qui l'appuient, de crime contre 'humanité et crime contre la descendance de l'humanité.
Réponse du 05/12/2013,
Réponse apportée le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Le Président de la République a décidé d’engager la transition énergétique, cette transition reposant d'une part sur la sobriété et l’efficacité énergétique, et d'autre part sur la diversification des sources de production et d'approvisionnement.
Concernant la diversification de nos sources d’énergies, le Président de la République a fixé un cap : réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% d'ici 2025. Parallèlement, le Président de la République a indiqué que la transition énergétique serait fondée sur deux principes : l'efficacité énergétique d'une part, et la priorité donnée aux énergies renouvelables d'autre part. Cette mutation prendra du temps et supposera des étapes d’évaluation en fonction des progrès technologiques et scientifiques et des prix relatifs de chaque source d’énergie.
Pour le quinquennat, le Président de la République a pris quatre engagements en cohérence avec cette perspective : la plus ancienne de nos centrales – Fessenheim – sera arrêtée ; le chantier du réacteur EPR de Flamanville sera conduit à son terme ; le système de traitement – recyclage des combustibles usés et la filière qui l’accompagne seront préservés ; aucune autre centrale ne sera lancée durant ce mandat.
Un arrêt immédiat de l’ensemble du parc nucléaire français n’est pas envisageable sans remettre en cause l’approvisionnement électrique du pays. La France ne dispose pas de moyens de production alternatifs capables de se substituer intégralement au parc nucléaire dès aujourd’hui.
La situation du Japon diffère sensiblement de celle de la France. En effet, avant l’accident de Fukushima, la part de nucléaire dans le mix électrique japonais était de l’ordre de 27%. Elle était en France de près de 75% en 2012, soit près de trois fois plus en proportion.
A la suite de l’accident de Fukushima, le Japon a fait face à la situation d’arrêt de ses réacteurs nucléaires en augmentant le recours au gaz et en demandant des efforts importants aux particuliers et aux entreprises.
En effet, le Japon a remis en service d’anciennes centrales thermiques pour soutenir la production d’électricité et fait fonctionner intensément son parc thermique. Ainsi, selon les données de l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE), la production d’électricité des centrales thermiques est passée de 680 TWh en 2009 à 880 TWh en 2012, soit une production additionnelle d’environ 200 TWh, compensant une large majorité des 274TWh que produisait le parc nucléaire japonais avant l’accident de Fukushima. La demande gazière japonaise s’est ainsi accrue de près de 30 % entre 2010 et 2012, dégradant fortement la balance commerciale japonaise.
Vos accusations de « crimes contre l’humanité » sont offensantes à l’encontre des personnes qui œuvrent à la protection de nos concitoyens et des générations futures. Le principe même du stockage est de protéger l’homme et l’environnement sur le très long terme de la dangerosité des déchets les plus radioactifs et de ne pas reporter leur charge sur les générations futures.
QUESTION 478
Posée par , le 23/07/2013
Comment s'assurer que les spécifications d'acceptation de CIGEO ne vont pas "mettre des déchets dehors" et que l'on ne se retrouve pas avec des déchets non acceptables à CIGEO? (ce qui revient à mettre le déchet au centre de la réflexion et pas les problèmes d'ingénierie comme cela parait être actuellement).
On entend dans les médias, les responsables de l'ANDRA et de l'IRSN parler de sûreté et se servir de ce mot pour justifier de choix de conception sans que l'on ait accès aux analyses de sûreté qui ont permis de faire les choix entre les differents scénarios, ni aux différentiels de coûts générés par ce choix et encore moins aux marges prises. Au vue des coûts qui fuitent dans la presse et qui semblent énormes, comme l'ANDRA va travailler pour les diminiuer au plus tôt (d'autant plus que les grands projets ont une facheuse tendance à exploser leurs budget)?
Pourquoi le projet CIGEO est-il parti sur une architecture bi-tube avec deux tubes quasi identiques? Cela augmente les problèmes d'intersection, cela multiplie par plus de 2 les volumes excavés (le plus que 2 est du aux intersections et autres singularités qui proviennent du choix bi-tube). Si le choix est bati par rapport à une exigence de sûreté" et de protection du personnel, n'aurait-il pas été judicieux de prévoir un schéma monotube auquel est attaché une galerie de secours pour l'évacuation des personnels?
Réponse du 18/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Concernant votre première question
La loi du 28 juin 2006 prévoit que « Après entreposage, les déchets radioactifs ultimes ne pouvant pour des raisons de sûreté nucléaire ou de radioprotection être stockés en surface ou en faible profondeur font l'objet d'un stockage en couche géologique profonde ». L’Andra étudie le projet Cigéo pour répondre à ce besoin. Le rôle de l’Andra est de garantir que ce stockage permettra de protéger les travailleurs, les populations et l’environnement pendant son exploitation et après sa fermeture. Une partie importante des études porte sur le comportement des colis de déchets dans le stockage. Sur cette base, l’Andra définit les critères d’acceptation à respecter par les colis de déchets. L’Andra vérifiera que les colis de déchets respectent ces exigences avant d’autoriser leur mise en stockage. En tout état de cause, l’Andra refusera le colis s’il présente des caractéristiques rédhibitoires pour la sûreté du stockage. Le cas échéant, un nouveau conditionnement devra être réalisé par le producteur du déchet pour respecter les exigences de sûreté de Cigéo.
Concernant votre deuxième question
L’Andra a le souci permanent d’optimiser le coût du stockage, mais sans réduire le niveau de sûreté qui reste notre priorité absolue. Les études de conception industrielle du projet Cigéo ont démarré en 2012. L’Andra s’attache à identifier les risques techniques, qui pourraient augmenter le coût du projet, mais aussi les opportunités, qui peuvent être sources d’économies. Les essais réalisés au Laboratoire souterrain ont permis de réaliser des avancées significatives. Par exemple des essais ont permis de montrer la faisabilité d’alvéoles d’une centaine de mètres de longueur pour le stockage de déchets de haute activité. Cet allongement est favorable pour la sûreté à long terme et permet de réduire le nombre d’alvéoles.
Concernant votre troisième question
A l’issue des études d’esquisse industrielle, l’Andra a retenu une architecture souterraine permettant de séparer la zone nucléaire de la zone en travaux, en rendant ces deux parties de l’installation complètement indépendantes dans toutes les situations de fonctionnement, normales ou accidentelles. L’architecture bitube retenue offre une plus grande robustesse industrielle qu’une architecture monotube. En situation d’incendie, elle permet d’avoir deux directions d’évacuation et deux points d’intervention pour les véhicules de secours. Les études ont également permis d’optimiser cette solution et de gagner près de 15 % sur le linéaire de galeries à construire.
QUESTION 477 - réversibilité
Posée par catherine TOUSSAINT, L'organisme que vous représentez (option) (ARBIGNY SOUS VARENNES), le 10/11/2013
Pourquoi le principe de réversibilité est -il si important ? Combien cela coutera-t-il d'aller rechercher les colis si nécessaire ?
Réponse du 27/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le projet Cigéo est conçu pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets français les plus radioactifs et ne pas reporter leur charge sur les générations futures. Il est également important de laisser aux générations suivantes la possibilité de faire évoluer cette solution si elles le souhaitent. C’est pourquoi le Parlement a demandé que le stockage, prévu pour être définitif, soit réversible pendant au moins 100 ans. Les conditions de réversibilité seront définies par une future loi avant que la création de Cigéo ne puisse être autorisée. Les générations suivantes pourront ainsi contrôler le déroulement du stockage et récupérer les déchets si elles le souhaitent.
L’Andra prévoit dès la conception de Cigéo des dispositifs techniques destinés à faciliter le retrait éventuel de colis de déchets stockés. Les tunnels pour stocker les colis de déchets seront ainsi revêtus d’une paroi en béton ou en acier pour éviter les déformations, avec des espaces ménagés entre les colis et les parois pour permettre leur retrait. Des capteurs permettront de surveiller le comportement des ouvrages. Des essais de retrait de colis pourront être réalisés périodiquement dans le stockage pendant son exploitation.
Le coût d’une opération de retrait de déchets stockés dépend de la situation considérée (volume de déchets concernés, date de mise en œuvre, devenir des colis retirés du stockage…). Au coût de l’opération de retrait proprement dite, qui serait a priori d’un ordre de grandeur analogue à celui des opérations de mise en stockage des déchets, il conviendrait d’ajouter celui des nouvelles installations à construire pour accueillir les déchets et celui du transfert des déchets dans ces nouvelles installations.
Pour en savoir plus sur les propositions faites par l’Andra en matière de réversibilité du stockage, voir : ../docs/rapport-etude/fiche-reversibilite-cigeo.pdf
QUESTION 476
Posée par Daniel RUHLAND, Conseiller Général (MONTIERS SUR SAULX), le 08/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 30 octobre 2013 - transformations locales et aménagement du territoire :
Enfin, parmi les questions qui nécessitent également une réponse, l’environnement : Stocker des roches extraites du sous-sol relève de l’évidence puisque des kilomètres de tunnel sont envisagés pour le stockage pérenne… Si, comme les opposants l’ont signalé, ces roches argileuses se dégradent en présence d’eau, que va devenir le paysage (recouvert d’environ 10 mètres de remblais sur des centaines d’hectares), va-t-il y avoir des pollutions locales induites par ces remblais « dégradables » ? Quel va être l’effet sur la faune giboyeuse et la végétation ?
Réponse du 28/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’Andra dispose d’un retour d’expérience d’une dizaine d’années sur la verse du Laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne. Leur impact sur l’environnement est maîtrisé et elles n’ont pas d’effet sur la faune giboyeuse et la végétation.
Les études d’avant-projet permettront de définir les dispositions à mettre en œuvre pour leur insertion paysagère et pour protéger l’environnement des effets liés au lessivage des verses par les eaux de pluie. Plusieurs dispositions techniques peuvent être utilisées (modelage, végétalisation, mise en place de bassins de collecte des eaux de ruissellement, dispositifs de traitement de ces eaux avant rejet vers le milieu naturel si nécessaire). Elles pourront faire l’objet d’échanges avec les acteurs locaux.
Ces dispositions seront décrites dans l’étude d’impact jointe à la demande d’autorisation de création du projet Cigéo, qui sera soumise à enquête publique.
Réponse apportée par Bertrand Thuillier, docteur ès sciences :
Dans une réunion publique, il me semble que c'était à Ligny en Barrois, à une question sur la qualité de l'environnement et sur la beauté de nos forêts actuelles, j'avais pu répondre que nous nous retrouverons devant la beauté de beaux tas de terres, il faudra en effet s'habituer à ces beautés désertiques et inanimées.
QUESTION 475
Posée par Daniel RUHLAND, Conseiller Général (MONTIERS SUR SAULX), le 08/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 30 octobre 2013 - transformations locales et aménagement du territoire:
En effet, en dehors du transport possible des salariés, les remblais liés à l’extraction de dizaines de milliers de tonnes de roche (situés à moins de 500m) et le transport des matériaux de construction (ciment – sable - granulats, etc.) vont entraîner des passages qui pourraient être de l’ordre de quelques centaines de camions par jour (1 par minute environ). La résolution des nombreuses nuisances acoustiques, vibratoires, poussières, etc. passe par une étude qui n’est pas réellement évoquée dans le document du Maître d’Ouvrage (DMO). Comment protéger nos concitoyens de ces nuisances ?
Réponse du 28/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Si Cigéo est autorisé, l’Andra privilégiera une gestion des roches extraites lors du creusement des galeries souterraines à proximité immédiate des installations de surface de Cigéo pour limiter les transports associés. Pendant la phase de construction initiale des installations, des flux de matériaux seront nécessaires entre la zone descenderies et la zone puits, qui sont distantes d’environ 5 km. La desserte entre les deux zones devra être définie en concertation avec les acteurs locaux dans le cadre du schéma interdépartemental de développement du territoire. Après la phase de construction initiale, l’ensemble des matériaux excavés seront extraits par les puits et stockés directement dans les verses attenantes à cette zone, ce qui limitera les flux de transports de matériaux entre les deux sites.
L’approvisionnement des matériaux nécessaires à la construction de Cigéo relèvera de la responsabilité des entreprises qui seront chargées de la construction de Cigéo. Les modes de transport qu’elles utiliseront dépendront des infrastructures à proximité des sites de production de ces matériaux et des infrastructures disponibles à proximité de Cigéo. A ce titre, l’Andra souhaite examiner avec les acteurs locaux les infrastructures qui pourraient être réalisées pour encourager l’utilisation du transport ferroviaire et du transport fluvial.
Ce schéma local de transports doit être défini dans le cadre du schéma interdépartemental de développement du territoire, avec le double objectif d’assurer une desserte de Cigéo permettant de limiter autant que possible les nuisances liées aux transports et de contribuer au développement du territoire. Ces dispositions seront présentées dans l’étude d’impact du projet jointe à la demande d’autorisation de création de Cigéo, qui fera l’objet d’une enquête publique.
Réponse apportée par Bertrand Thuillier, docteur ès sciences :
Je constate que vous êtes bien au fait de ces nuisances, il existait, il y a quelques années des panneaux qui indiquaient en arrivant en Haute-Marne que "la qualité de la vie" ou "la vie était ici", de mémoire. Ces panneaux ont maintenant disparu, il ne restera plus qu'à partir ou disparaître comme ces panneaux, si ce projet se poursuit et sans mobilisation générale, et si l'on ne veut pas subir ces effets.
QUESTION 474
Posée par Daniel RUHLAND, Conseiller Général (MONTIERS SUR SAULX), le 08/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 30 octobre 2013 - transformations locales et aménagement du territoire :
Compte tenu de la taille du chantier associé à CIGEO se pose la question des transports, de la qualité des routes et peut-être du prolongement d’une voie de chemin de fer (entre Gondrecourt et Bure/Saudron ?). Comment la population peut-elle être associée à ces évolutions envisagées ? Ou subira-t-elle les nuisances induites par les transports ?
Réponse du 11/12/2013,
Réponse apportée par le Directeur du Schéma interdépartemental de développement du territoire :
Lors du dernier Comité de Haut Niveau, la Ministre de l'Ecologie du Développement Durable et de l'Energie a demandé à Madame la préfète de la Meuse, préfète coordinatrice, de faire des propositions à l'issue du débat public sur la gouvernance du développement territorial qui serait impacté par Cigéo. La mise en œuvre du Schéma Interdépartemental de Développement du territoire passe en effet par une évolution de la gouvernance du projet de territoire, qui tient compte des investissements à réaliser, ainsi que du point de vue des communes et intercommunalités les plus impactées par les développements envisagés. Il est clair que la mise à niveau des infrastructures bénéficiera également aux déplacements des populations et des activités économiques du territoire. Ces opérations d’aménagement seront soumises à leurs propres concertations publiques.
Réponse apportée par Bertrand Thuillier, docteur ès sciences :
La population n'a déjà pas été associée aux décisions sur ce projet ; on peut même dire qu'elle a été trompée dès l'origine par une communication sur l'implantation uniquement d'un centre de recherches, et assez étonnamment, quelques années après, un projet de centre de stockage de déchets nucléaires est annoncé à l'endroit même où se situe ce centre de recherches. La population n'a pas été, n'est, et par conséquent ne sera bien entendu pas associée aux décisions, mais subira par voie de conséquence ces nuisances, que ce soit par les transports, par la ventilation des installations et du chantier, et par les risques potentiels qu'un tel projet fait peser sur l'environnement.
QUESTION 473
Posée par Daniel RUHLAND, Conseiller Général (MONTIERS SUR SAULX), le 08/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 30 octobre 2013 - transformations locales et aménagement du territoire :
L’achat de terrains agricoles par l’ANDRA sera-t-il un facteur d’augmentation des prix des terres agricoles et/ou un moyen de limiter encore la population des agriculteurs, réelle force vive du canton ?
Réponse du 05/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
En tant qu’exploitant de Cigéo, si celui-ci est autorisé, l’Andra devra être propriétaire des terrains où seraient implantées les installations de surface du Centre et où seraient aménagées les voies d’accès nécessaires. L’Andra est consciente que cette obligation pourrait engendrer la disparition ou la déstructuration d’exploitations agricoles. Afin d’éviter toute expropriation, l’Andra a engagé des acquisitions foncières en Meuse et en Haute-Marne (exploitations, terres agricoles et terrains boisés) lui permettant de constituer une réserve pour procéder à des échanges (par des actes notariés ou par des actes administratifs amiables) ou pour restructurer les exploitations concernées si besoin. Cette démarche a déjà été conduite pour la construction du Centre industriel de regroupement, d’entreposage et de stockage (Cires) ouvert dans l'Aube en août 2003. Ce système avait correctement fonctionné et permis d'obtenir les terrains nécessaires par de simples actes de ventes ou d'échanges.
Afin de ne pas remettre en cause la viabilité des exploitations et proposer des modalités appropriées, l’Andra sera d’autant plus vigilante concernant les élevages dont les contraintes sont les plus fortes (notamment en ce qui concerne l’alimentation ou l’abreuvement des animaux). Rappelons également que l’emprise des installations de surface de Cigéo, occuperait environ 300 hectares, soit un peu plus que la superficie d’une exploitation agricole moyenne en Meuse, ce qui ne déstabilisera pas la production agricole locale.
Concernant les prix, l’Andra achète systématiquement au prix du marché, ce qui est régulé et contrôlé par les Safer et France Domaine.
Réponse apportée par Bertrand Thuillier, docteur ès sciences :
Il est certain qu'un opérateur aussi important, qui a déjà acheté des centaines d'hectares avec une politique d'achat systématique via la SAFER de toutes les surfaces disponibles en Meuse et en Haute-Marne, ne peut que faire monter les prix. Cela est bien entendu au détriment des capacités d'installation de jeunes agriculteurs, qui par définition, ne disposent pas de ces moyens. De plus, il me semblait que cette même SAFER avait justement pour vocation et destination, de faciliter ces nouvelles installations agricoles.
QUESTION 472
Posée par Daniel RUHLAND, Conseiller Général (MONTIERS SUR SAULX), le 08/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 30 octobre 2013 - transformations locales et aménagement du territoire :
Il existe de nombreuses productions agricoles de haute qualité et de leurs transformations industrielles (en nombre plus restreint). L’image « déchets », radioactifs de surcroît, est-elle porteuse d’une image positive pour permettre un redéploiement industriel et agricole, nécessaires pour le devenir du canton ?
Réponse du 11/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Cigéo est conçu pour protéger l’Homme et l’environnement. L’impact du Centre en termes de radioactivité sera très inférieur à celui de la radioactivité naturelle et n’aura donc aucun impact sur la qualité des productions agricoles. L’Andra a créé l’Observatoire pérenne de l’environnement, qui a pour mission d’assurer un suivi détaillé de l’évolution de l’environnement du stockage. Cela permettra de lever ainsi toute inquiétude en démontrant que le stockage n’a pas d’impact sur les activités agricoles de proximité. Cet observatoire labellisé s’inscrit dans un grand nombre de réseaux scientifiques nationaux ou internationaux. Par ailleurs, le retour d’expérience de l’implantation de l’Andra dans l’Aube depuis 20 ans montre que l’implantation d’un centre de stockage de déchets radioactifs n’est en aucun cas incompatible, même en termes d’image, avec les activités agricoles.
Réponse apportée par Bertrand Thuillier, docteur ès sciences :
Je suis en complet accord avec ce que vous pensez ; ce canton est à dominante agricole, et la dégradation de l'image de ces productions va bien entendu à l'encontre d'un développement harmonieux et pérenne de ces territoires. Vous pourrez vous référer à mes autres réponses sur ce même sujet du développement.
QUESTION 471
Posée par Daniel RUHLAND, Conseiller Général (MONTIERS SUR SAULX), le 08/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 30 octobre 2013 - transformations locales et aménagement du territoire :
Si cela se passe comme pour la construction de l’EPR de Flamanville (centrale nucléaire en construction en Normandie), plusieurs dizaines de nationalités différentes se côtoieraient sur le chantier gigantesque pour le canton. Comment alors, au nom du bien-être maintenu (plutôt amélioré ?) des habitants, aborder cette réelle question ?
Réponse du 11/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Des incitations à recruter localement seront demandées aux entreprises impliquées pendant la phase de construction de Cigéo tout en respectant les dispositions règlementaires de passation des marchés. Ainsi, au niveau de ses commandes et de ses contrats, l’Andra prévoit des règles d’équité sous forme de clauses destinées à juger de la valeur sociale des offres qui lui permettront notamment de prendre en compte le recours à l’emploi local et la formation des acteurs locaux.
Ces mesures ont déjà fait leurs preuves pour le Laboratoire souterrain et les Centres de l’Andra dans l’Aube. Leurs activités ont généré annuellement plusieurs millions d’euros de commandes à des entreprises locales (Meuse, Haute-Marne, Aube). En 2012, dans les Centres de l’Aube, plus de 35% des commandes ont été passées à des entreprises locales. Il en résulte que le nombre d’entreprises locales capables de travailler avec l’Andra à l’avenir augmente. La pratique montre également que les grands groupes qui répondent à nos appels d’offres ont souvent recours à des co-traitants, antennes ou filiales locaux.
L’accueil des travailleurs en déplacement est discuté dans le cadre du schéma interdépartemental de développement du territoire élaboré sous l’égide de la préfecture de la Meuse. L’hébergement en structures provisoires à proximité du chantier, en gîtes ou en logements meublés est proposé parmi les services pouvant être mis à leur disposition. Le schéma permettra de coordonner les acteurs du logement pour mettre à disposition une offre locative adaptée aux besoins. Le retour d’expérience d’autres grands chantiers, tels que celui de Flamanville, pourra être approfondi pour veiller à mettre en œuvre des modalités d’accueil qui permettent des relations harmonieuses avec les riverains.
Réponse apportée par Bertrand Thuillier, docteur ès sciences :
L'exemple que vous citez est une bonne illustration pour un chantier de cette importance, et c'est bien ce qui risque de se passer. En outre, la faible densité de population de nos cantons ruraux accroîtra sans nul doute bien encore ce sentiment et cette situation que vous décrivez.
QUESTION 470
Posée par Daniel RUHLAND, Conseiller Général (MONTIERS SUR SAULX), le 08/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 30 octobre 2013 - transformations locales et aménagement du territoire :
Si les travaux doivent durer moins de 20 ans, peut-on envisager la création de logements « en dur » dans le canton pour une durée aussi limitée ? Si oui, cela pourrait autoriser, pour autant que ces travailleurs viennent avec leurs familles, la présence de médecins, de commerces, d’écoles, fortement désirée par les habitants. Si non, parce qu’ils viennent seuls, où vont-ils habiter ? Cette question d’un possible « ghetto » doit être abordée. En effet, s’ils occupent des logements provisoires de type « ALGECO » au voisinage du chantier, comment vont-ils pouvoir être associés/assimilés à la population actuelle ? S’ils viennent des villes avoisinantes, qu’apporteront-ils à l’économie locale du canton, en dehors des passages de bus les transportant à leur travail ?
Réponse du 09/12/2013,
Réponse apportée par le Directeur du Schéma interdépartemental de développement du territoire :
Cette question relève en effet des enjeux auxquels le territoire doit faire face pour l'accueil de nouvelles populations. La phase de chantier s'étend entre 2017 et 2025 mais également sur une durée de 20 ans compte tenu de la concomitance des activités industrielles de stockage avec la poursuite des travaux des phases ultérieures. Cette période peut être considérée comme suffisamment large pour un accueil durable des travailleurs (et de leurs familles) en déplacement. Si on regarde ce qui a été fait sur d'autres opérations "grands chantier", on s'aperçoit que cette durée est plus vaste qu'un chantier d'infrastructure (ligne TGV, par exemple) et que dans le cas de Cigéo, l'intégration dans le territoire des travailleurs et de leur famille est une réalité. Les expériences menées dans le cadre de ces "grands chantiers" sont nombreuses pour permettre le logement des employés en s'intégrant aux tissus ruraux de leurs implantations.
La question du logement est centrale, en effet, pour la revitalisation du cadre bâti et pour les impacts de l'implantation de ménages sur l'économie locale. A l'instar des "grands chantier" français, sur une période aussi longue, les conditions d'accueil des ménages ont été proposées suivant différentes formes:
- logements temporaires proposés par les entreprises à leurs employés
- accueil dans les gîtes ruraux (ce qui est la cas actuellement pour les déplacements liés au laboratoire, avec un taux de remplissage élevé), avec information interactive des disponibilités
- logements meublés (pour les familles en déplacements), logements locatifs proposés par l'entreprise ou dans un conventionnement avec les bailleurs sociaux ou acquisitions de logements neufs ou anciens.
Le projet de Schéma interdépartemental de développement du territoire Meuse-Haute-Marne a identifié ces enjeux et propose de les anticiper dès à présent, dans une programmation de l'offre de logements et un accompagnement des communes (qu'elles soient à proximité ou plus éloignées) afin qu'elles élaborent leurs propres stratégies de développement en fonction des objectifs qu'elles se seront fixés et en tenant compte des hypothèses de localisations temporaires (sur une vingtaine d'années) ou durables des ménages. Des solutions peuvent également être mises en œuvre avec les entreprises qui interviendront sur le chantier et qui ont en partie la responsabilité de loger leurs employés. Des solutions peuvent également être mises en œuvre pour proposer une offre de logements modulables qui pourraient se voir adaptés à la demande en fonction des phases du projet. L'élaboration des documents de planification procède de cette démarche, en particulier les Schémas de cohérence territoriale
Réponse apportée par Bertrand Thuillier, docteur ès sciences :
En ce qui concerne votre question sur la durée du chantier et sur la création de logements "en dur", cette durée est d'environ 7 ans ; après 2031 et la fermeture du laboratoire, le nombre d'emplois sur le site ne sera que de l'ordre de 100 à 150 de plus qu'actuellement. Dans ces conditions, des logements de type "Algeco" risquent en effet d'être la règle, et particulièrement en cas de sous-traitance faisant appel, comme on peut le craindre, à des travailleurs issus d'Europe de l'Est.
QUESTION 469 - Comment allez vous financer les coûts dont vous n'avez pas tenu compte?
Posée par Serge GRÜNBERG, SDN27 (SAINT AUBIN SUR GAILLON (27600)), le 06/11/2013
La Cour des Comptes dans son rapport public de janvier 2012 "les coûts de la filière électronucléaire" souhaite que soit rapidement fixé le nouveau devis sur le coût de stockage profond, de la manière la plus réaliste possible...dans le respect des décisions de l'ASN" Vous n'en avez tenu aucun compte !(14 M€ de provisions contre plus de 35M€). Elle demande, en plus, que soit chiffré le coût d' un éventuel stockage du MOX (1700t) et de l'URE (24000t). Vous n'avez pas bougé.. POURQUOI ? Vos coûts sont largement sous-estimés et ne veulent pas dire grand chose..; Allons nous les laisser à la charge des générations futures?
Réponse du 06/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le chiffrage officiel arrêté par l’Etat en 2005 au stade des études de faisabilité scientifique et technique était d’environ 15 milliards d’euros. En 2009, l’Andra a réalisé une estimation préliminaire d’environ 35 milliards d’euros avant le lancement de la phase de conception industrielle et des optimisations en cours d’étude. Avant de finaliser un nouveau chiffrage, l’État a demandé à l’Andra de poursuivre les études permettant de prendre en compte les suites du débat public, les recommandations des évaluateurs et les pistes d’optimisation identifiées en 2013. Ce chiffrage sera finalisé par l’Andra en 2014. Conformément à la loi du 28 juin 2006, c’est le ministre chargé de l’énergie qui arrêtera l’évaluation des coûts et la rendra publique, après avoir recueilli les observations des producteurs de déchets radioactifs et l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire.
Le Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs 2013-2015 a demandé à l’Andra de mettre à jour d’ici 2015 l’évaluation de faisabilité qu’elle avait présentée en 2005 sur le stockage direct des combustibles usés. Cette mise à jour intégrera une nouvelle évaluation des coûts du stockage direct des combustibles usés MOX et URE. Les données d’entrée de cette étude ont été mises à jour en 2012 (données quantitatives par typologie de combustible, conditionnement des assemblages combustibles, nombre de colis, hypothèses d’ordonnancement et flux de livraison et de mise en stockage des colis de combustibles, puissance thermique des combustibles à la mise en stockage). Le rapport d’étape est consultable sur le site du débat public : ../docs/rapport-etude/rapport-stockage-direct-combustibles-uses.pdf
Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat. Un travail important est réalisé par l’Andra sur les outils et méthodes de chiffrage pour apporter le maximum de robustesse à l’évaluation du coût du stockage. Pour réaliser les études de conception industrielle du projet Cigéo, qui ont été lancées en 2012, l’Andra s’appuie sur des ingénieries spécialisées qui apportent leur retour d’expérience sur d’autres grands projets industriels.
QUESTION 468
Posée par Maurice MICHEL, Président de l'ASODEDRA, le 06/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 23 octobre - Les transports de déchets
- A l’examen de la carte portée en page 47 du dossier du maître d’ouvrage, il apparaît que les convois de transport ferroviaire des déchets radioactifs passeront, notamment, par les gares de Dijon et Lyon sur l’axe Nord/Sud, et par celles, soit de Paris et Caen, soit de Reims, Amiens, Rouen et Caen, sur l’axe Est/Ouest.
Quand et comment les maires, et plus largement les élu(e)s de ces villes, ont-ils été associés à ces choix aux conséquences dangereuses pour les populations riveraines ?
- D’autres localités seront traversées par les trains de déchets nucléaires destinés à Bure. Nous en avons demandé communication. Le ministère chargé de l’énergie nous a répondu que le transport des matières nucléaires est couvert par des règles de confidentialité et que, après choix du trajet par les autorités, les services de secours et d’intervention nationaux et locaux seraient informés 48 heures avant le transport (voir question/réponse N° 202 sur le site Internet de la CPDP).
Dès lors et à défaut d’avoir été informées à temps, comment les populations des localités concernées, pourraient, si elles le souhaitaient, exercer leur « droit de retrait » avant le passage des trains de déchets radiotoxiques (voir question N° 338 sur le site Internet de la CPDP) ?
Réponse du 10/02/2014,
Réponse apportée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
En France, le transport de matières nucléaires est soumis au Code de la Défense. Le Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité, placé auprès du ministre de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie (MEDDE) est chargé du respect des règles de confidentialité. Celles-ci s'imposent à tous les intervenants (pouvoirs publics, exploitants, transporteurs, etc.) lors de la préparation et l'exécution des transports de matières nucléaires.
La réglementation relative au transport des combustibles usés et des déchets radioactifs impose au transporteur de ne pas communiquer les itinéraires précis pour des raisons de sécurité. Le trajet emprunté est validé par les autorités compétentes et sa diffusion est restreinte.
48 heures avant le transport, le COGIC (Centre Opérationnel de gestion interministérielle de crises) informe l’ensemble des autorités compétentes et les services de sécurité de l’Etat au niveau national ainsi que les services de sécurité et d’intervention dans les régions et les départements concernés.
S’agissant du transport de substances radioactives, le transporteur est tenu de respecter la réglementation en vigueur et de s’assurer de l’absence de danger pour les populations et l’environnement. Les autorités et services de sécurité de l’Etat compétents sont informés du parcours du transport afin d’être en mesure d’agir et d’informer la population si cela le nécessitait.
Dans une entreprise, le droit de retrait correspond au droit, pour un salarié confronté à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, d’arrêter son travail et, si nécessaire, de quitter les lieux pour se mettre en sécurité.
Réponse apportée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) :
La sûreté des transports de substances radioactives à usage civil est contrôlée en France par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), sur la base d’inspections et de l’instruction de demandes d’agrément d’emballages. Ce contrôle vise à assurer la protection des personnes et de l’environnement. Il porte sur la conception des emballages et les opérations de transports qui sont soumises à des contraintes réglementaires rigoureuses.
Les emballages doivent notamment assurer un confinement des substances radioactives transportées et fortement réduire le rayonnement à l’extérieur du colis.
De façon plus spécifique, le débit de dose à proximité du véhicule ne doit pas dépasser certains plafonds. En pratique, les niveaux relevés sont en général beaucoup plus faibles que ces plafonds. Même si ces plafonds étaient atteints, une personne devrait rester 10 heures à deux mètres du véhicule pour que le rayonnement reçu atteigne la limite annuelle d’exposition du public.
Concernant les risques en cas d’accident, les modèles de colis sont soumis à des épreuves réglementaires destinées à démontrer leur résistance lors du transport. Le niveau d’exigence de ces épreuves est proportionné à la dangerosité des substances transportées. À titre d’exemple, les modèles de colis correspondant aux substances les plus dangereuses doivent conserver leurs fonctions de sûreté, y compris en cas d’accident (simulé par une chute de 9 m sur une surface indéformable, une chute de 1 m sur un poinçon, un incendie d’hydrocarbure totalement enveloppant de 800° C minimum pendant 30 mn, une immersion dans l’eau à une profondeur de 200 m).
Les autorités se sont naturellement interrogées depuis plusieurs années sur le comportement des colis agréés dans des cas d’agressions allant au-delà de ces épreuves réglementaires décrites précédemment.
Des études ont été menées en France et à l’étranger, notamment par l’IRSN, AREVA, l’autorité allemande BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung) et le laboratoire national américain SANDIA, afin d’évaluer le comportement des colis contenant des substances radioactives dans des conditions réalistes d’impact mécanique et de feu et pouvant aller au-delà des sollicitations prévues par les épreuves réglementaires. Ainsi, la tenue de ces types de colis dans des conditions de feu plus contraignantes (en termes de durée et de température) et dans des conditions de chute plus réalistes (en termes de surface d’impact et de hauteur de chute) a été étudiée. Par exemple, une étude de l’IRSN consultable sur le site Internet de l’institut[1] permet de comparer l’écrasement du colis sur une surface indéformable, comme prévu dans les épreuves réglementaires et sur des surfaces représentatives de cibles réelles : par exemple des sols en sable, argile ou des cibles métalliques représentatives de l’environnement des emballages durant le transport dont l’essieu de wagon et le longeron de wagon. Cette étude a montré que les colis considérés dans l’étude conserveraient leur capacité de confinement en cas d’accident réel et que leurs équipements additionnels (châssis et râtelier) ainsi que les cibles absorberaient une part importante de l’énergie d’impact et augmenteraient ainsi les marges de sûreté.
D’autres études ont été réalisées à l’étranger concernant le transport ferroviaire de colis de substances radioactives. Par exemple :
- l’institut allemand (BAM) a réalisé des essais visant à représenter un scénario d’accident impliquant une explosion d’un wagon citerne chargé de propane à proximité d’un colis de type CASTOR contenant du combustible irradié De façon à être plus pénalisant, le colis de combustible n’était pas muni de ses capots amortisseurs. L’essai a entraîné une boule de feu ainsi que des flammes allant au-dessus du point d’explosion. Le colis de substances radioactives a été projeté à 7 m de sa position initiale et s’est enfoncé de 1 mètre dans le sol. Toutefois, les tests d’étanchéité, réalisés après essai, ont montré que l’emballage restait étanche, il n’y a donc pas eu d’augmentation des conséquences de l’accident lié au caractère radiologique du contenu de l’emballage transporté[2].
- Le BAM a également réalisé une simulation numérique visant à évaluer l’impact d’une chute sur des rails à une hauteur de 14 m d’un colis contenant des déchets vitrifiés de haute activité qui aurait été préalablement endommagé par une entaille de 12 cm. Le BAM a conclu que l’emballage restait intact[3].
- La « Central Electricity Generating Board for England and Wales » a organisé un crash-test public consistant à faire entrer en collision un train de 140 t roulant à 160 km/heure dans un colis de combustible irradié de type B. Les vidéos du crash-test disponibles sur Internet montrent que le combustible est resté confiné dans l’emballage[4].
En France, aucun accident ferroviaire ayant impliqué des colis de combustible usé n’a à ce jour été rapporté.
La dernière ligne de défense de la sûreté des transports de substances radioactives repose sur les moyens d’intervention mis en œuvre face à un incident ou un accident. Les pouvoirs publics, l’ASN et les exploitants se préparent donc à la gestion des situations de crise impliquant un transport de substances radioactives à travers les plans ORSEC et au moyen d’exercices.
Réponse apportée par AREVA :
Les flux, modes et itinéraires envisagés pour le transport des déchets destinés à Cigéo sont décrits dans le projet présenté au débat public.
Pour Cigéo, le transport ferroviaire est privilégié, notamment parce que ce mode se prête mieux au transport d’emballages de masses élevées, ce qui est le cas pour une grande partie des déchets concernés. C’est aussi la solution privilégiée sur de longues distances du fait d’un bilan carbone plus favorable. Par ailleurs, les principaux sites d’entreposage des déchets destinés à Cigéo disposent à proximité d’infrastructures permettant un transport routier et ferroviaire.
Le réseau ferré national permet d’acheminer les convois jusqu’à proximité de Cigéo. Différents itinéraires sont étudiés depuis les sites expéditeurs jusqu’à un terminal ferroviaire spécifique. Celui-ci peut être implanté soit sur une voie ferroviaire existante, ce qui nécessite un transfert des emballages du rail à la route pour un acheminement jusqu’à Cigéo, soit sur le site même de Cigéo, ce qui implique un prolongement du réseau ferré actuel.
La loi de 2006 relative à la Transparence et à la Sécurité en matière Nucléaire, aujourd’hui codifiée dans le Code de l’environnement, fixe notamment les conditions d’information autour des transports de substances radioactives. Ainsi, pour garantir la sécurité du transport afin d’empêcher tout détournement, les itinéraires, dates et horaires ne sont pas communiqués.
Les transports de substances radioactives répondent aux exigences de l’AIEA (Agence Internationale de l’Energie Atomique) contre le détournement de substances.
Le transporteur dispose d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente en matière de sécurité dont il est responsable.
Le COGIC, sous l’autorité du Ministère de l’Intérieur, informe l’ensemble des parties prenantes au transport : les autorités nationales et départementales, les services de l’Etat concernés ainsi que les intervenants dans l’éventuelle mise en œuvre d’un plan ORSEC, notamment les Préfets des départements concernés. Le Président de la Commission Locale d’Information CLI peut être également informé de la réalisation d’un transport quelques jours avant sa date.
[1] http://www.irsn.fr/FR/Larecherche/publications-documentation/aktis-lettre-dossiers-thematiques/RST/RST-2002/Documents/Chap03_art1.pdf
[2] http://www.tes.bam.de/de/umschliessungen/behaelter_radioaktive_stoffe/dokumente_veranstaltungen/pdf/rmtp1999104231.pdf
[3] http://www.tes.bam.de/en/umschliessungen/behaelter_radioaktive_stoffe/behaelterpruefungen/index.htm
[4] http://www.britishrailways.tv/train-videos/2012/100mph-nuclear-flask-train-crash-test/
QUESTION 467 - stockage de déchets étrangers
Posée par jean-Christophe BENOIT, L'organisme que vous représentez (option) (RENNES), le 04/11/2013
Ne pourrait on pas stocker des déchets radio-actifs des pays européens voisins sur ce site afin qu'il rapporte de l'argent plutot que d'en couter ?
Réponse du 05/12/2013,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Le centre de stockage en projet Cigéo ne deviendra pas un centre de stockage des déchets radioactifs des autres pays européens. Depuis la loi de 1991, le Parlement a interdit le stockage en France de déchets radioactifs en provenance de l’étranger. Cette interdiction figure aujourd’hui à l’article L. 542-2 du Code de l’environnement. Cette législation est cohérente avec la directive européenne du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre des combustibles usés et des déchets radioactifs, qui réaffirme la responsabilité de chaque État dans la gestion de ses déchets radioactifs.
QUESTION 466 - Prolongation de la durée de vie des centrales et CIGEO
Posée par jean-Christophe BENOIT, L'organisme que vous représentez (option) (RENNES), le 04/11/2013
Est-ce que la prolongation possible de la durée de vie des centrales nucléaires françaises jusqu'à 50-60 ans de fonctionnement retarde d'autant la mise en service du site CIGEO et donne l'occasion de voir sur un temps et une durée humaine (certes très insuffisant) comment évolue ce site à vide ?
Réponse du 06/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Il n’est pas nécessaire d’attendre la fin de l’exploitation des centrales nucléaires existantes pour commencer à mettre en œuvre une solution de gestion à long terme pour les déchets les plus radioactifs. Ces déchets ont été produits en France depuis plus d’un demi-siècle et représentent aujourd’hui un stock de plus de 40 000 m3. La prolongation éventuelle des centrales nucléaires actuelles jusqu’à 50 ou 60 ans ne modifie donc pas le besoin de mise en service de Cigéo pour ne pas reporter sur les générations suivantes la gestion de ces déchets alors qu’elles n’auront pas bénéficié de l’électricité procurée par leur production.
Si Cigéo est autorisé, le démarrage de l’exploitation se fera de manière progressive. Des premiers colis de déchets radioactifs pourraient être pris en charge à l’horizon 2025. Le stockage des déchets de moyenne activité à vie longue (MA-VL) débuterait en 2025 et se poursuivrait pendant plusieurs dizaines d’années. Une zone pilote serait également réalisée en 2025 pour stocker une petite quantité de déchets de haute activité (HA). Cette zone serait ainsi observée pendant une cinquantaine d’années et permettrait d’avoir un retour d’expérience important avant de commencer la phase de stockage des déchets HA à l’horizon 2075. Ces déchets sont les plus radioactifs et se caractérisent par un dégagement de chaleur important. Une période d’entreposage de refroidissement sur leur site de production est nécessaire préalablement à leur stockage.
L’évolution du stockage sera surveillée tout au long de l’exploitation de Cigéo. Dans le cadre de la réversibilité de Cigéo, l’Andra propose que des rendez-vous soient programmés régulièrement avec l’ensemble des acteurs (riverains, collectivités, évaluateurs, État…) pour contrôler le déroulement du stockage (../docs/rapport-etude/fiche-reversibilite-cigeo.pdf). Ces rendez-vous seront alimentés par les résultats de la surveillance du stockage et des réexamens périodiques de sûreté, fixés au moins tous les 10 ans par l’Autorité de sûreté nucléaire, ainsi que par les progrès scientifiques et technologiques. Le premier de ces rendez-vous pourrait avoir lieu cinq ans après le démarrage du centre.
QUESTION 465 - Dégagement d'hydrogène
Posée par jean-christophe BENOIT, L'organisme que vous représentez (option) (RENNES), le 04/11/2013
Quels sont les déchets dégageant de l'hydrogène et en quelle quantité totale par exemple journalière, mensuelle, annuelle ? Cet hydrogène est-il relaché librement dans l'atmosphere ? et avec quelles conséquences ? ou alors peut-il être récupéré ? à partir de quel pourcentage en teneur d'hydrogène dans l'atmosphère du site, il y a -t- il des risques d'explosion ?
Réponse du 06/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Certains colis de déchets MA-VL produisent de l’hydrogène, gaz non radioactif. Celui-ci provient :
- des matériaux hydrogénés et de l’eau (matériaux utilisés pour le conditionnement des déchets (bitume, liant hydraulique), du vinyle, du PVC…) qui, par radiolyse, c’est-à-dire par décomposition de la matière sous l’effet des rayonnements ionisants, produisent de l’hydrogène,
- des métaux réactifs (aluminium, magnésium, sodium…) qui produisent de l’hydrogène par réactions chimiques avec l’eau,
- des métaux (acier non allié, acier allié….) qui, par corrosion en l’absence d’oxygène, produisent de l’hydrogène.
Ces matériaux se retrouvent dans la constitution de certaines familles de colis de tous les producteurs de déchets (CEA, AREVA et EDF). L’ordre de grandeur du dégagement de ces colis est de quelques litre/an. Il dépend des quantités de ces matériaux présents dans les colis et de la composition substances radioactives des déchets.
Les ¾ des colis de déchets MA-VL destinés à Cigéo dégagent peu d’hydrogène (moins de 3 litres par an et par colis), voire pas du tout. Les colis les plus dégazants émettent jusqu’à quelques dizaines de litres par an.
Au-delà d’une certaine quantité et en présence d’oxygène, cet hydrogène peut présenter un risque d’explosion. Pour maîtriser ce risque pendant l’exploitation de Cigéo, l’Andra fixe une limite stricte aux quantités d’hydrogène émises par chaque colis. Des contrôles seront mis en place et aucun colis ne sera accepté s’il ne respecte pas cette limite. Pour éviter l’accumulation de ce gaz, les installations souterraines et de surface seront ventilées en permanence pendant leur exploitation, comme le sont les installations d’entreposage dans lesquelles se trouvent actuellement ces déchets. Les modélisations d’aéraulique montrent que la ventilation prévue par la conception de Cigéo permet d’éviter toute zone de concentration d’hydrogène au sein des alvéoles de stockage.
Le système de ventilation du stockage fait par ailleurs l’objet de dispositions pour réduire le risque de panne (redondance des équipements, maintenance..) et des dispositifs de surveillance seront mis en place pour détecter toute anomalie sur son fonctionnement, notamment la présence d’hydrogène dans l’air à de très faibles concentrations... Des situations de perte de la ventilation sont étudiées malgré tout. Les études montrent que, dans le pire des cas, on disposera de plus d’une dizaine de jours pour rétablir la ventilation, ce qui permettra de mettre en place une ventilation de secours. Les conséquences d’une explosion sont tout de même évaluées afin d’envisager tous les scénarios possibles : les résultats montrent que les colis concernés ne seraient que faiblement endommagés, sans aucune perte de confinement des substances qu’ils contiennent.
QUESTION 464
Posée par , le 24/07/2013
Que l'on poursuive ou pas la production d'énergie par le nucléaire, que préconisez-vous comme solution responsable vis-à-vis de nos descendants pour les déchets déjà produits?
Réponse du 27/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
2 700 m3 de déchets radioactifs de haute activité (HA) et 40 000 m3 de déchets de moyenne activité à vie longue (MA-VL) sont actuellement entreposés de manière provisoire, principalement sur les sites de La Hague (Manche), de Marcoule (Gard) et de Cadarache (Bouches-du-Rhône), dans l’attente d’une solution de gestion à long terme. Ces déchets ont été produits depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires aujourd’hui arrêtées et par les installations nucléaires actuelles. Quels que soient les choix énergétiques futurs, il est nécessaire de mettre en œuvre une solution pour protéger l’homme et l’environnement sur le très long terme de la dangerosité de ces déchets.
Il est de la responsabilité des générations actuelles de proposer une solution pour mettre en sécurité de manière définitive ces déchets et ne pas reporter leur charge ni les décisions sur les générations futures en misant sur le fait qu’elles trouveront peut-être d’autres solutions. En effet, personne ne peut garantir aujourd’hui que d’autres solutions émergeront dans le futur, ni que ces hypothétiques alternatives présenteraient les mêmes performances de sûreté à long terme que le stockage. Les solutions d’entreposage, qu’elles soient en surface ou à faible profondeur, ne peuvent assurer le confinement à long terme de la radioactivité.
Après 15 années de recherches, leur évaluation et un premier débat public sur la politique nationale de gestion des déchets radioactifs, le Parlement a retenu en 2006 le stockage réversible profond comme solution de référence. Le Parlement a demandé à l’Andra de concevoir un projet de stockage et a souhaité qu’un débat public soit organisé sur le projet étudié par l’Andra avant le dépôt de la demande d’autorisation de création du stockage. C’est ce projet, résultat des études menées par l’Andra depuis 2006, qui est aujourd’hui présenté au débat public.
QUESTION 463 - les déchets du futur
Posée par Philippe DUJET, L'organisme que vous représentez (option) (GARD), le 30/10/2013
Bonsoir Cigeo est prévu pour stocker les déchets historiques et ceux issus de notre actuel parc de réacteur . Mais qu'en est il de l'EPR en cours de construction ainsi que du générateur de GEN IV dont le prototype ASTRID (maillon essentiel pour la transmutation) doit voir le jour prochainement ? Les déchets qu'ils produiront seraient ils acceptables par CIGEO ou va t'il falloir prévoir un exutoire spécifique ?
Réponse du 06/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’inventaire détaillé des déchets radioactifs pris en compte dans les études de conception du projet Cigéo est disponible sur le site du débat public (../docs/rapport-etude/dechets-pris-en-compte-dans-etudes-conception-cigeo.pdf). Cet inventaire a été établi en lien avec les producteurs de déchets (Areva NC, CEA, EDF).
Cigéo est conçu pour prendre en charge les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue produits par les installations nucléaires existantes. Les déchets qui seront produits par les installations nucléaires en cours de construction sont également pris en compte, dont ceux qui seront produits par le réacteur EPR de Flamanville.
Le prototype ASTRID et les ateliers de fabrication et de traitement des combustibles associés sont actuellement en cours d’étude par le CEA. Les déchets qui seraient produits par ces installations, si elles sont autorisées, n’ont pas été pris en compte à ce stade dans l’inventaire pour la conception de Cigéo.
La nature et les quantités de déchets autorisés pour un stockage dans Cigéo seront fixées par le décret d’autorisation de création du Centre. Toute évolution notable de cet inventaire devra faire l’objet d’un nouveau processus d’autorisation, comprenant notamment une enquête publique et un nouveau décret d’autorisation.
QUESTION 462 - et demain?
Posée par dove BELHASSEN, MA FAMILLE (PARIS), le 14/12/2013
jusqu’à quand allons nous accepter la politique à court terme? on trouve bien au dessus des chiottes le panneau "laissez cet endroit aussi propre que lorsque vous êtes arrivé" pourquoi pour la planète cela ne s'applique pas?
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestions sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site.
QUESTION 460
Posée par Lionel DORVEAUX, Conseiller juridique (DUGNY SUR MEUSE), le 28/10/2013
Quelle est la date approximative à laquelle les travaux terminés de l'ouvrage et opérationnel en Meuse?
Réponse du 27/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra à l’État après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création du centre en 2015 conformément au calendrier fixé par la loi du 28 juin 2006. Ce processus comprendra notamment l’évaluation de la sûreté par l’Autorité de sûreté nucléaire, l’évaluation des recherches scientifiques par la Commission nationale d’évaluation, l’avis des collectivités territoriales, le vote d’une nouvelle loi fixant les conditions de réversibilité, la mise à jour de la demande de création de Cigéo par l’Andra suite à cette loi, et une enquête publique. Si Cigéo est autorisé, les travaux de construction pourraient débuter en 2019 pour une mise en service en 2025, sous réserve de l’autorisation de l’Autorité de sûreté nucléaire.
QUESTION 459
Posée par Jasmine , le 28/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 16 octobre 2013 - Risques et sécurité :
M. Thuillier, si vous pensez qu'il faut arrêter de produire des déchets, soit, mais que préconisez-vous pour les déchets déjà produits ?
Réponse du 27/11/2013,
Réponse apportée par Bertrand Thuillier, docteur ès sciences :
Beaucoup de déchets en effet sont déjà produits, il est urgent de prendre en considération en priorité ceux qui peuvent être les plus sensibles, comme ceux entreposés en piscines de refroidissement à proximité des centrales, et l'accident de Fukushima a bien mis en évidence la vulnérabilité de ces derniers. Il est donc souhaitable de prévoir des entreposages à sec bunkerisés à proximité de ces lieux de production comme le font les allemands et les américains. Ensuite, il sera temps de se préoccuper de ces déchets qui ne peuvent pas être enfouis avant cette période de refroidissement, et c'est bien pour cela qu'il faut continuer les recherches sur les entreposages de longue durée, et continuer en parallèle les tests et les recherches sur le stockage souterrain, mais sur des temps longs pour la sécurité, pour les scellements et pour les comportements des colis dans ces conditions. Le stockage souterrain ne peut être qu'une solution envisageable ultime, de long terme, seulement pour solder la question de ces déchets après avoir terminé les cycles de production de ces déchets, après avoir réellement évacué toute solution alternative de neutralisation ou de valorisation, et enfin, après avoir réellement testé les questions de sécurité et de scellement des installations à prévoir ; ceci n'est toujours pas le cas, selon la Commission Nationale d'Evaluation, et d'après également les travaux de la NEA (Nuclear Energy Agency).
QUESTION 458
Posée par Michel JABELOT, le 28/10/2013
Question posée par le débat contradictoire du 16 octobre 2013 - Risques et sécurité :
J'ai déjà participé à une réunion avec Mr Thuillier. Je ne comprend pas, Mr Thuillier, pensez-vous avoir plus de compétences scientifiques que les centaines de chercheurs et ingénieurs de l'Andra qui travaillent sur l'enfouissement depuis plus de 20 ans ?
Réponse du 27/11/2013,
Réponse apportée par Bertrand Thuillier, docteur ès sciences :
Ma formation est double, scientifique avec un Diplôme d'Agronomie Approfondie (DAA), un diplôme d'ingénieur agronome INA-PG, un doctorat de biologie de l'Université de Reims, et par ailleurs, économique, avec un diplôme de l'Asian Institute of Management de Manille et des suivis d'enseignements à HEC. Mes connaissances de ce dossier proviennent de la lecture des dossiers de conception du projet de l'Andra : Argile 2005 et Argile 2009 (environ 4000 pages). Maintenant, cette double formation plus associée à une approche multi-factorielle, multi-relationnelle, et holistique qui est d'une certaine manière le propre des caractéristiques d'un écosystème et des systèmes biologiques, m'a sans doute permis d'appréhender ce projet avec une vision plus globale et plus pragmatique.
QUESTION 456
Posée par BACHER, le 28/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 16 octobre 2013 - Risques et sécurité :
L'opportunité
Qu’on le veuille ou non, les déchets nucléaires à vie longue ou à forte activité (HAVL) existent. Comme l’ont affirmé les responsables successifs de l’ANDRA, la question de leur devenir se pose, que l’on poursuive ou que l’on arrête le programme nucléaire. Les deux questions qui se posent, vis à vis des générations futures, sont dès lors les suivantes : vaut-il mieux les garder en surface ou sous terre ? Le stockage profond peut-il être considéré comme sûr ?
Réponse du 06/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les déchets radioactifs destinés à Cigéo sont des déchets dangereux, qui le resteront plusieurs dizaines à centaines de milliers d’années. Le seul et unique objectif du stockage profond est de protéger l’homme et l’environnement de ces déchets sur de très longues durées.
Ces déchets, produits depuis les années 1960, sont actuellement entreposés de manière sûre mais provisoire dans des bâtiments sur leurs sites de production, dans l’attente d’une solution de gestion à long terme. Ces installations d’entreposage ne sont pas conçues pour confiner la radioactivité à très long terme. En cas de perte de contrôle de telles installations, les conséquences radiologiques sur l’homme et l’environnement ne seraient pas acceptables.
La sûreté est au cœur du projet Cigéo. L’ensemble des risques est caractérisé et l’installation est dimensionnée en conséquence pour garantir une sûreté maximale. L’Andra doit démontrer qu’elle maîtrise tous ces risques pour que la création de Cigéo puisse être autorisée. Par ailleurs, si Cigéo est autorisé, sa construction se fera de manière très progressive pour contrôler toutes les étapes de son développement. Tout ceci se fait sous le contrôle d’évaluateurs scientifiques et de sûreté indépendants, notamment la Commission nationale d’évaluation et l’Autorité de sûreté nucléaire qui orientent les travaux de l’Andra. Les avis des évaluateurs sont disponibles sur le site du débat public : ../informer/documents-complementaires/avis-autorites-controle-et-evaluations-permanentes.html
Réponse apportée par Jean-Claude Zerbib, ancien ingénieur en radioprotection du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) :
Les déchets HA-VL et MA-VL existent en effet et quel que soit l’évolution du programme nucléaire retenu et mis en œuvre par les gouvernements, d’autres déchets seront produits, dans les années à venir, par les réacteurs qui resteront encore en fonctionnement.
Pour les déchets HA, qui dégagent une énergie thermique importante, une phase de refroidissement d’une soixantaine d’années s’impose, ce qui nécessite une phase de stockage préalable en surface. Elle est et sera assurée en très grande partie au niveau de la zone de production (Marcoule 580m3 et La Hague 11157m3, fin 2012).
Mais il faudra cependant réaliser sur le site de stockage, une INB chargée de recevoir les divers colis radioactifs en transit avant l’enfouissement. Le délai qui nous sépare de la date, pour un enfouissement des colis THA devenu possible, montre qu’il reste du temps pour explorer d’autres technologies de conditionnement et de gestion. Cette liberté ne concerne pratiquement que les combustibles "usés" non encore retraités. Il n’est en effet pas envisageable de reprendre les déchets vitrifiés afin de les reconditionner.
Garder les déchets en surface, c’est :
- soit parier sur la transmission de la mémoire et le maintien d’un entreposage sûr durant des siècles, en acceptant les coûts que cela implique[1] pour la génération présente et celles à venir,
- soit se laisser du temps pour trouver une solution plus fiable que le stockage géologique.
Entreposer en profondeur géologique c’est :
- S’assurer qu’il n’existe pas de raisons particulières qui conduisent à faire des sondages profonds pour rechercher des matières (pétrole, gaz, minéraux divers, géothermie) lorsque la mémoire du stockage aura été perdue.
- Choisir une roche d’accueil qui permettra d’isoler très longtemps les déchets de l’atteinte des eaux souterraines, qui finiront toujours par attaquer et dissoudre l’enveloppe des colis puis les matières qu’ils renferment.
- Stocker des colis qui ne peuvent endommager la roche d’accueil (dégagement thermique excessif entraînant des températures supérieures à 90-100°C).
- Réduire au minimum les risques durant la phase de remplissage du site (lutte contre l’inondation et l’incendie notamment).
Afin de garantir le confinement des déchets sur de très longues périodes de temps, s’assurer d’une fermeture étanche des voies d’accès aux zones de stockage (4 puits verticaux, descenderie).
[1] Une installation d’entreposage des déchets de moyenne ou haute activité est conçue pour une durée comprise entre 60 et 100 ans.
QUESTION 455
Posée par Christian HAGER, le 28/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 16 octobre 2013 - Risques et sécurité :
Que comptez-vous faire pour la protection et la sécurité incendie qui doit être drastique et hyper professionnelle? Les conséquences d'un incendie pourraient être incalculables : effondrement des galeries avec contamination des eaux souterraines, dégagement de fumées radioactives contaminant la région, tout l'Est de la France et au delà. (Je suis d'accord avec l'analyse de M. Bertrand Thuillier parue dans l'Est Républicain le 13/10/2013).
Réponse du 29/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le risque incendie est bien sûr pris en compte dès la conception de Cigéo : pour réduire le risque d’incendie, une première mesure consiste à limiter la quantité de produits combustibles ou inflammables dans les équipements du stockage. Par exemple, si Cigéo est réalisé, les câbles électriques seront ignifugés et les véhicules à moteur thermique seront interdits dans l’installation nucléaire souterraine de Cigéo. De plus, des dispositifs de détection incendie seront répartis dans les installations pour détecter rapidement et localiser tout départ de feu. Plusieurs systèmes d’extinction automatiques seront installés dans l’installation souterraine. Des systèmes embarqués d’extinction automatique (gaz, poudre...) seront placés sur les engins de transfert des colis de déchets et sur les engins de manutention en alvéole, afin d’éteindre tout départ de feu. Des systèmes d’extinction automatique seront également disposés dans certaines zones de l’installation souterraine telles que les locaux électriques et les zones de soutien logistique. Ces dispositifs seront mis en place en complément de moyens de lutte contre l’incendie plus traditionnels de types extincteurs, points de raccordement à un réseau d’alimentation en agent extincteur (eau, mousse…) etc.
Malgré toutes ces dispositions, une situation d'incendie est quand même considérée par prudence. Dans les installations de surface, les mêmes principes seront appliqués que dans les installations nucléaires de base : en cas d’incendie, les locaux concernés seraient isolés du reste de l’installation, les moyens d’extinction et d’intervention seraient déclenchés et le personnel serait évacué. Dans l’installation souterraine, compte tenu de sa géométrie spécifique, ces dispositions sont adaptées dès la conception. Des systèmes de compartimentage et de ventilation sont prévus pour limiter la propagation du feu. Des équipements d’intervention seront prépositionnés dans l’installation souterraine en permanence. L'architecture souterraine retenue pour le stockage permettra aux secours d'intervenir dans des galeries à l'abri des fumées et facilite l'évacuation du personnel.
Outre la mise à l’abri du personnel, la maîtrise du risque incendie vise aussi à protéger les colis contenant les substances radioactives des effets de l’incendie afin de maintenir le confinement de ces substances. Pour cela, les colis seront disposés dans des équipements qualifiés pour résister au feu (cellules résistantes au feu munies de portes coupe-feu, hotte de protection pour le transfert dans l’installation souterraine). Les conteneurs de stockage sont également conçus pour assurer une protection contre l’incendie. Ces dispositions permettent d’exclure tout effet domino entre les colis stockés.
La définition de l’ensemble de ces dispositifs associe les services compétents des sapeurs-pompiers et fait l’objet de contrôle par l’Autorité de sûreté nucléaire. Cigéo ne sera jamais autorisé si l’Andra ne démontre pas qu’elle maîtrise tous les risques, dont le risque d’incendie.
Réponse apportée par Jean-Claude Zerbib, ancien ingénieur en radioprotection du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) :
Le problème incendie, notamment dans les alvéoles de stockage des déchets bitumeux, est très sérieux pour au moins trois raisons :
- il est difficile de lutter contre un feu de bitume. Il existe une quantité importante de fûts de bitume (10 000m3) appelés à être stockés.
- l’inflammation de l’hydrogène produit des températures élevées (environ 2000°C)
- l’expérience des situations accidentelles a montré qu’il était très difficile de lutter contre un incendie dans un tunnel routier ou dans une mine, du fait de la propagation plus rapide du feu, des gaz chauds, et des réflexions sur les parois qui produisent un effet de "four".
Les zones de stockage devront être très cloisonnées afin d’éviter les transferts de feu. Des dispositifs de lutte automatique devront être développés dans des zones où l’intervention humaine ne sera pas possible, du fait de la charge radioactive des déchets.
QUESTION 454
Posée par DEBAT SMS, le 28/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 16 octobre 2013 - Risques et sécurité :
Comment vous mesurez les impacts? C est fait par qui? Par l'Andra? Par un labo independant?
Réponse du 11/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement et vérifier qu’il ne présente pas de risques pour les travailleurs, les populations riveraines et l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. Ce programme de surveillance devra être approuvé par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Pendant toute l’exploitation de Cigéo, l’ASN contrôlera la fiabilité des mesures réalisées par l’Andra et pourra mandater des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement. La Commission locale d’information pourra également demander des contre-expertises indépendantes de l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
Réponse apportée par Jean-Claude Zerbib, ancien ingénieur en radioprotection du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) :
L’exploitant va préciser à l’ASN, dans le projet de dossier de Sureté de l’INB, les types et la nature des contrôles qu’il compte mettre en œuvre pour assurer la surveillance de l’installation et de son environnement. Il assurera ces contrôles, mais pourra en sous-traiter tout ou partie, tout en restant responsable de leur qualité. L’ASN peut demander des modifications du programme de surveillance et exiger des contrôles complémentaires. Les inspecteurs des INB vérifieront à intervalle régulier l’application de ces contrôles. L’ASN peut également demander à son soutien technique, l’IRSN, de procéder à certaines mesures, vérifications et analyses critiques des résultats obtenus par l’exploitant.
QUESTION 453
Posée par DEBAT SMS, le 28/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 16 octobre 2013 - Risques et sécurité :
Monsieur THUILLIER est, à en croire internet, ingénieur en agronomie. Qu'est-ce qui en fait un expert compétent pour le débat de ce soir qui ne parle pas d'agriculture ?
Réponse du 25/11/2013,
Réponse apportée par M. Thuillier :
Ma formation scientifique avec un doctorat en sciences m'a seulement permis une lecture attentive des dossiers de conception du projet de l'Andra : Argile 2005 et Argile 2009 (environ 4000 pages) ; j'ai en outre une expérience de 4 ans dans la gestion et la mise en place de projets de restructuration industrielle en Europe chez un grand groupe agro-alimentaire. Il est également à retenir que les risques que je restitue sont seulement les risques qui ont déjà été mentionnés dans les dossiers de conception du projet de l'Andra et qui n'avaient pas été communiqués sous une forme assimilable auprès du public.
QUESTION 452
Posée par Clémence , le 28/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 16 octobre 2013 - Risques et sécurité :
Mr Thuillier, pourquoi y a t'il moins de risque en entreposage alors que ce sont les mêmes déchets ?
Réponse du 27/11/2013,
Réponse apportée par Bertrand Thuillier, docteur ès sciences:
L'entreposage en surface ou en sub-surface permet une surveillance, des interventions en cas de problèmes, et des retraits en cas de solution alternative que le stockage souterrain ne permet pas en raison des accès et des ouvertures, par définition, limités, voire impossibles. Dans mon esprit, il apparaît que l'enfouissement ne devrait être que l'ultime solution pour solder la question de ces déchets après avoir terminé les cycles de production de ces déchets afin d'avoir une visibilité sur la nature et les quantités de ces derniers, mais également après avoir pu réellement évacuer toute solution alternative de neutralisation ou de valorisation, et enfin, après avoir réellement testé les questions de sécurité et de scellement des installations à prévoir ; ceci n'est toujours pas le cas, selon la Commission Nationale d'Evaluation, et d'après également les travaux de la NEA (Nuclear Energy Agency).
QUESTION 451
Posée par DEBAT SMS, le 28/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 16 octobre 2013 - Risques et sécurité :
Mr Thuillier, qu'elle est votre expérience en matière de cindynique ?
Réponse du 27/11/2013,
Réponse apportée par Bertrand Thuillier, docteur ès sciences :
Peut-être avez-vous pu suivre les cours de M. Georges-Yves Kervern, et j'en suis heureux pour vous ; les risques que je restitue sont seulement les risques qui ont déjà été mentionnés dans les dossiers de conception du projet de l'Andra : Argile 2005 et Argile 2009 (environ 4000 pages), et qui n'avaient pas été portés à la connaissance du public sous une forme synthétique.
QUESTION 450
Posée par Patricia ANDRIOT, le 28/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 16 octobre 2013 - Risques et sécurité :
Malgré les explications qui précèdent, je n'ai toujours pas compris comment rendre compatibles et sures les cheminées de dégagement d'hydrogène et le caractère hermétique du site. La perspective des études complémentaires ne me paraît pas apporter des réponses permettant d'éclairer le législateur dans les délais actuellement prévus. Que pensent les experts de cette incompatibilité de calendrier ?
Réponse du 06/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Concernant votre première question
S’il est autorisé, Cigéo sera à l’origine de rejets gazeux en très faibles quantités uniquement pendant sa durée d’exploitation. Comme c’est le cas aujourd’hui pour les entrepôts qui accueillent provisoirement les déchets les plus radioactifs destinés au stockage profond, le relâchement contrôlé de ces gaz n’est pas incompatible avec le confinement des substances radioactives contenues dans les déchets. En effet, les colis de déchets, ainsi que les conteneurs dans lesquels seront placés ces colis pour leur stockage, sont conçus de manière à permettre l’évacuation des gaz produits par certains déchets tout en garantissant le confinement des substances solides contenues dans les déchets.
Concernant votre seconde question
La loi du 28 juin 2006 prévoit que l’Andra dépose un dossier support à l’instruction de la demande d’autorisation de création de Cigéo en 2015. Ce dossier devra contenir les résultats des études permettant de montrer la faisabilité et la sûreté de Cigéo pendant son exploitation et après sa fermeture. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra à l’État après un long processus qui durera plusieurs années. Ce processus comprendra notamment l’évaluation de la sûreté par l’Autorité de sûreté nucléaire, l’évaluation des recherches scientifiques par la Commission nationale d’évaluation l’avis des collectivités territoriales, le vote d’une nouvelle loi fixant les conditions de réversibilité, la mise à jour du dossier déposé par l’Andra suite à cette loi et une enquête publique. S’il s’avère que les études sont insuffisantes pour autoriser le stockage, l’Etat demandera à l’Andra de compléter ses études.
Réponse apportée par Jean-Claude Zerbib, ancien ingénieur en radioprotection du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) :
Les volumes d’hydrogène produits par les 10 000m3 de bitume ont été évalués par l’ANDRA à environ 1 000m3 par an soit environ 3m3 par jour. La ventilation est importante (plusieurs centaines de m3 par seconde). L’ANDRA doit prévoir des systèmes de secours qui permettent, en cas de panne du système de ventilation, une reprise de la fonction, au plus tard, au bout de quelques jours, et ceci pendant les 100 ans de fonctionnement du site.
QUESTION 449
Posée par Raymond CHAUSSIN, le 28/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 16 octobre 2013 - Risques et sécurité :
Quels seront les éléments de protection à porter?
Réponse du 23/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les mesures de protection des travailleurs qui seraient appliquées pour Cigéo, si celui-ci était autorisé, serait identiques à celles prises actuellement dans les installations nucléaires existantes et notamment celles accueillant les déchets radioactifs destinés au stockage. Comme pour toute installation nucléaire, le choix et le dimensionnement de ces protections suivront le principe « ALARA* » qui vise à limiter autant que possible l’exposition des personnes aux rayonnements et la réglementation en vigueur édictée par le code de la santé publique et le code du travail.
Dans la zone d’exploitation, les colis de déchets radioactifs seront transférés en souterrain dans des hottes qui feront écran aux radiations émises par les déchets. Ainsi le personnel pourra circuler dans les galeries souterraines pendant l’exploitation notamment pour assurer la surveillance de l’installation et la maintenance des équipements.
Pour plus d’information voir la circulaire relative aux mesures de prévention des risques d’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants a été élaborée conjointement par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et la direction générale du travail http://www.asn.fr/index.php/S-informer/Actualites/2010/Prevention-des-risques-d-exposition-des-travailleurs-aux-rayonnements-ionisants
*As Low As Reasonably Achievable
Réponse apportée par Jean-Claude Zerbib, ancien ingénieur en radioprotection du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) :
Le centre de stockage sera une Installation nucléaire de base (INB) dans laquelle plusieurs zones réglementaires seront établies. Dans le cas d’interventions particulières, la protection individuelle sera adaptée à chacune d’elle, notamment la protection contre la contamination par des poussières (tenues étanches) ou des gaz (masque avec cartouche filtrante). Pour l’irradiation externe, c’est généralement sur la limitation du temps d’exposition que l’on peut agir et non sur le port d’une protection. Les tabliers plombés, portés par les radiologues, sont adaptés à la protection contre le rayonnement X mais sont inopérants contre les rayonnements "gamma" ou neutroniques émis par les déchets radioactifs.
QUESTION 448
Posée par Raymond CHAUSSIN, le 28/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 16 octobre 2013 - Risques et sécurité :
A l'intérieur de la mine comment une intervention humaine sera possible?
Réponse du 23/01/2014,
Réponse apportée à l’Andra, maître d’ouvrage :
Les activités de chantier et les activités nucléaires seront séparées sur les installations de Cigéo, et seront donc exploitées comme deux entités indépendantes. Pour cela :
- dans l’installation souterraine, la zone d’exploitation et la zone chantier seront physiquement séparées,
- l’accès aux différentes zones se fera par des accès distincts : par la descenderie pour la zone en exploitation, par les puits verticaux pour la zone chantier,
- chaque zone aura un circuit de ventilation dédié.
Dans la zone d’exploitation, les colis de déchets radioactifs seront transférés en souterrain dans des hottes qui feront écran aux radiations émises par les déchets. Ainsi le personnel pourra circuler dans les galeries souterraines pendant l’exploitation notamment pour assurer la surveillance de l’installation et la maintenance des équipements.

Réponse apportée par Jean-Claude Zerbib, ancien ingénieur en radioprotection du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) :
Le site de stockage sera une installation nucléaire de base (INB) dans laquelle les conditions de travail et d’intervention seront celles en vigueur dans toutes les INB comme les réacteurs de l’EDF ou les usines de La Hague. Les dispositions relatives à la protection contre les rayonnements des travailleurs qui interviennent dans les zones dites "surveillées" ou "contrôlées", figurent dans des articles du Code du travail (Article R4451 alinéas 62 à 92).
Des balises spécifiques mesureront le débit de dose externe et l’activité des atmosphères de travail. Ces mesures collectives s’accompagnent du port de détecteurs individuels.
QUESTION 447
Posée par Franck MORALES (PARIS), le 28/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 16 octobre 2013 - Risques et sécurité :
En quoi Mr Thuillier est-il un expert ? d'où vient-il ? quelle est sa formation ?
Réponse du 25/11/2013,
Réponse apportée par M. Thuillier :
Ma formation est double, scientifique avec un Diplôme d'Agronomie Approfondie (DAA), un diplôme d'ingénieur agronome INA-PG, un doctorat de biologie de l'Université de Reims, et par ailleurs, économique, avec un diplôme de l'Asian Institute of Management de Manille et des suivis d'enseignements à HEC. Mes connaissances de ce dossier proviennent de la lecture des dossiers de conception du projet de l'Andra : Argile 2005 et Argile 2009 (environ 4000 pages).
QUESTION 446
Posée par Raymond CHAUSSIN, le 28/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 16 octobre 2013 - Risques et sécurité :
On est bien d'accord : à terme il y aura toujours des stockages en surface avec les colis les plus dangereux et un en profondeur. Quel est l'intérêt?
Réponse du 06/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’intérêt du projet Cigéo est de proposer une solution pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets français les plus radioactifs, produits depuis plusieurs dizaines d’années par les installations nucléaires passées et actuelles et qui sont entreposés aujourd'hui de manière provisoire dans des installations en surface. Cela permettrait de ne pas reporter la charge de la gestion de ces déchets sur les générations suivantes, tout en leur laissant la possibilité d’adapter cette solution si elles le souhaitent grâce à la réversibilité. A terme, si Cigéo est mis en œuvre, ces déchets hautement radioactifs seront progressivement transférés de leurs entrepôts de surface vers le stockage profond pour être mis en sécurité à 500 mètres de profondeur dans une couche d’argile capable de confiner la radioactivité sur le très long terme.
Réponse apportée par Jean-Claude Zerbib, ancien ingénieur en radioprotection du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) :
Il faut adapter les moyens de stockage à la toxicité potentielle des déchets.
Au bout de deux à trois siècles, les déchets de faible et très faible activité (FA-TFA) ne présenteront plus de risque significatif, ce qui n’est pas le cas des déchets de haute activité tels que les déchets vitrifiés, ni celui des combustibles usés ou des déchets de moyenne activité et à vie longue. Leur toxicité sera encore significative après de dizaines de millénaires.
Les coûts du m3 stocké, pour les grandes familles de déchets, peuvent différer d’un facteur important. Les déchets stockés en surface tels que les TFA coûtent 340€/m3, les FA environ 3000€/m3 (facteur voisin de 9), selon la Cour des comptes[1]. Nous ne disposons pas de données pour les déchets MA-VL et HA-VL, mais il faudra compter plus d’un facteur 10 pour les MA-VL par rapport aux FA et un autre supérieur à 10 pour les HA-VL[2].
[1] Cour des comptes, Les coûts de la filière électronucléaire - janvier 2012
[2] Dans une alvéole destinée au stockage dans CIGEO, l’ANDRA met les déchets HA-VL, comme les produits vitrifiés CSD-V, en les groupant à raison de 8 colis/alvéole, occupant 400 m² (soit 50m²/colis). Les déchets MA-VL, comme les produits compactés CSD-C, sont groupés à raison de 10368 colis/alvéole occupant 8100 m² (soit 0,78m²/colis). Est-ce que les prix seront dans le rapport des surfaces occupées (facteur 64) ?
QUESTION 445
Posée par Marine BERNARD, le 28/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 16 octobre 2013 - Risques et sécurité :
Cela fait des décennies que la question du traitement des déchets a été négligée, ne pensez-vous pas que les décisions sont précipitées aujourd'hui ?
Réponse du 06/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question des déchets radioactifs a été abordée dès les années 1950 et les débuts de la production d’électricité d’origine nucléaire. C’est au cours des années 1960 et 1970 que le stockage a commencé à être considéré comme une possibilité de gestion au sein de la communauté scientifique internationale et notamment le stockage profond pour les déchets de haute activité et à vie longue. Dans les années 1980, des investigations étaient prévues pour rechercher des sites susceptibles d’accueillir des laboratoires souterrains. Mais les discussions sont restées limitées aux experts techniques et scientifiques et l’opinion publique s’est opposée aux projets. Le Parlement s’est alors saisi de la question des déchets radioactifs et a voté en 1991 une première loi qui a défini un programme de recherche pour les déchets de haute activité et à vie longue. Après 15 ans de recherche, leur évaluation et un débat public, une seconde loi a été votée en 2006. Elle a retenu le stockage profond comme solution de gestion à long terme de ces déchets pour protéger l’homme et l’environnement sur le très long terme et afin de limiter la charge de leur gestion sur les générations futures.
La décision éventuelle de créer Cigéo n’est pas prise. Elle reviendra à l’État après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo. Ce processus comprendra notamment l’évaluation de la sûreté par l’Autorité de sûreté nucléaire, l’évaluation des recherches scientifiques par la Commission nationale d’évaluation, l’avis des collectivités territoriales, le vote d’une nouvelle loi fixant les conditions de réversibilité, la mise à jour de la demande de création de Cigéo par l’Andra suite à cette loi, et une enquête publique.
Réponse apportée par Jean-Claude Zerbib, ancien ingénieur en radioprotection du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) :
Lorsqu’une nouvelle technologie se développe, il est habituel de voir ses promoteurs nier, négliger voire totalement occulter l’importance des déchets, produits de manière inévitable. Les pionniers du nucléaire n’ont pas été des pionniers en matière de prise en charge des déchets.
Fin 1969, le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) a ouvert un site (qui deviendra le "Centre Manche") jouxtant le centre de La Hague qu’il confie à un exploitant privé ("Infratome"), afin de répondre aux besoins de l’usine de La Hague et des centres du CEA. Onze ans plus tard, (loi du 30/12/1981) un établissement public, l’agence ANDRA est créée, après la montée en puissance du programme électronucléaire français décidé après le choc pétrolier de 1973.
Les premiers travaux sur la gestion à moyen et long termes des déchets ont démarré avec la Commission Castaing en 1982. Les critères de choix de site, proposés par cette commission, ont été pris en compte pour le stockage en surface. Ils ont permis de retenir, dans l’Aube, un site de stockage en subsurface pour les déchets de faible et moyenne activité (FMA). Le Centre Manche ne respectait pas les critères définis par la Commission Castaing (milieu faillé avec de nombreuses lentilles d’eau). La nappe phréatique présente d’ailleurs aujourd’hui une contamination significative au tritium.
En 1985, L’Andra définit un agrément pour recevoir un déchet dans un site de stockage. En juillet 1987 le site de l’Aube est officiellement créé. C’est une installation nucléaire de base (INB) qui sera mise en exploitation en janvier 1992 avec une capacité d’un million de m3. Le 1er site de stockage (527 225m3), sera fermé fin juin 1994.
En 1991, dans le cadre d’une 1ère loi sur la gestion des déchets, l’Assemblée nationale rend l’ANDRA indépendante du CEA et définit un programme pour les 15 années à venir. Un plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR) est établi et mis à jour tous les trois ans. Voici donc une trentaine d’années que la gestion des déchets se développe. Il est difficile de parler jusque-là de précipitation.
Cependant les déchets de haute activité ne pourront être mis en couche géologique avant une cinquantaine d’années "a minima", sous peine de détruire la roche d’accueil par un dégagement thermique excessif (plus de 90°C). Cela donne du temps pour en étudier l’organisation et dans ce cas, la critique est plus recevable. Il n’y a pas urgence à décider.
La Commission Castaing avait retenue l’idée de 2 laboratoires avec un choix porté sur le meilleur. Il est clair que cette solution est chère et le choix entre les deux sites explorés pourrait ne pas être aussi facile que prévu (quelles priorités données aux différents critères de choix ?). Cette approche n’a pas été retenue, probablement pour des raisons de coût et d’acceptabilité sociale d’un second laboratoire.
Mais ce point important n’a pas été débattu !
QUESTION 444 - Maîtrise des risques
Posée par Nathalie CHRETIEN, NI DANS LE SOULAINOIS-BRIENNOIS,NI AILLEURS (HAMPIGNY), le 27/10/2013
A La Hague, géré par AREVA, l’ASN relève en moyenne trois incidents nucléaires par an (manutention, rejets, incendie, etc. ), avec une tendance à la hausse ces dernières années. Comment l’ANDRA va t-elle faire pour limiter ces risques sur CIGéo ?
Réponse du 28/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Conformément à la loi du 13 juin 2006 sur la transparence et la sécurité nucléaire, tous les événements qui surviennent sur une installation nucléaire de base (INB) font systématiquement l’objet d’une déclaration immédiate à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et d’une information du public. La gravité des événements déclarés est évaluée grâce à une échelle internationale de gravité, l’échelle INES, qui comprend 7 niveaux. L’ASN valide l’évaluation de la gravité de chaque événement. Les événements de niveaux 1 à 3, sans conséquence significative sur les populations et l'environnement, sont qualifiés d'incidents. En 2012, sur les installations nucléaires françaises, 110 incidents de niveau 1 ont été recensés, seulement deux de niveau 2 et aucun de niveau supérieur.
Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Si Cigéo est autorisé, le démarrage de l’exploitation se fera de manière progressive. Des premiers colis de déchets radioactifs pourraient être pris en charge à l’horizon 2025. Dans son avis du 16 mai 2013, l’ASN a recommandé une phase de « montée en puissance » progressive de l’exploitation du stockage. Comme toutes les installations nucléaires, Cigéo fera l’objet régulièrement de réexamens complets de sûreté, en accord avec les exigences de l’ASN qui impose un réexamen périodique de sûreté au moins tous les 10 ans. Tout au long de l’exploitation du stockage, l’ASN pourra imposer des prescriptions supplémentaires voire mettre à l’arrêt l’installation si elle considère qu’un risque n’est pas maîtrisé correctement, comme c’est le cas pour toute installation nucléaire placée sous son contrôle.
QUESTION 443
Posée par Michel GUERITTE (VILLE-SUR-TERRE), le 08/01/2014
Question posée dans le cahier d'acteurs n°97 de M. Michel GUERITTE : Pourquoi la décision finale de construire ce pharaonique stockage n'est-elle pas prise par le pouvoir législatif : Chambre des députés et Sénat?
Réponse du 11/02/2014,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Si elle est décidée, l’autorisation de création de Cigéo sera donnée par décret en Conseil d’État après une procédure spécifique incluant notamment le vote par le Parlement d’une loi fixant les conditions de réversibilité du stockage. Ce mécanisme d’autorisation a été défini par le Parlement dans la loi 2006-739 relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs (article 12 aujourd’hui codifié à l’article L.542-10-1du code de l’environnement).
QUESTION 442
Posée par Raymond CHAUSSIN, le 24/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 16 octobre 2013 - Risques et Sécurité :
On va donc laisser aux générations futures les fameux colis bitumineux! Alors pourquoi faire toutes ces manipulations dangereuses soit disant pour des raisons éthiques, ne pas laisser aux générations futures la gestion des déchets.
Réponse du 10/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le procédé de bitumage a été largement utilisé depuis les années 1960 pour conditionner les boues issues du traitement des effluents radioactifs. Ce type de conditionnement avait été retenu car il permet d’immobiliser les substances radioactives et d’empêcher leur dispersion (par exemple en cas de chute de colis de déchets lors d’une opération de manutention), en enrobant ces substances dans une matrice de bitume. Ces déchets sont actuellement entreposés sur les sites de Marcoule (CEA) et de La Hague (Areva NC) dans l’attente d’une filière de stockage. Pour concevoir Cigéo, l’Andra prend bien sûr en compte les risques spécifiques induits par ces déchets qui contiennent des substances inflammables. Le stockage de ces déchets dans Cigéo ne pourra être autorisé par l’Autorité de sûreté nucléaire que si l’Andra démontre qu’elle maîtrise les risques associés à leur stockage.
Réponse apportée par Jean-Claude Zerbib, ancien ingénieur en radioprotection du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) :
Lorsque l’on ouvrage des matières, quelles soient radioactives ou non, l’on produit des déchets sous forme solide et liquide. Dans ce dernier cas, l’entreposage d’effluents ou de boues[1], pose toujours, sur le long terme, des problèmes (corrosions, fuites, contaminations, etc.).
L’idée consistait donc à ramener le déchet liquide sous la forme d’un résidu sec qui sera inséré dans une matrice solide. Le choix de cette matrice s’est porté sur le bitume qui permet, à chaud, d’obtenir un mélange homogène du résidu radioactif (ou d’une boue radioactive) et de la matrice.
Mais le bitume est constitué d’hydrocarbures qui, comme le nom l’indique, sont constitués uniquement d’hydrogène et de carbone. La présence de radionucléides qui émettent des particules alpha de fortes énergies va entraîner des ruptures de liaisons qui unissent l’hydrogène au carbone, constitutifs des molécules d’hydrocarbures.
L’hydrogène ainsi libéré va produire des microbulles qui vont migrer dans la matrice et finir par sortir du conteneur et se répandre dans le lieu de stockage. Un risque physico-chimique survient alors, car au-delà d’une teneur en hydrogène de 4% dans l’air, le mélange peut exploser ou s’enflammer spontanément.
Ce mélange de matières radioactives à du bitume, qui est un combustible inflammable, pose donc un problème qui invite à ne pas poursuivre ce type de conditionnement.
En 2008, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a d’ailleurs interdit le conditionnement de boues de traitement de La Hague (STE2), mais les bitumes déjà conditionnés à Marcoule (7578m3) et à La Hague[2] (75m3 STE2 et 2428m3 de la STE3) sont là, et il faut les prendre en compte comme d’autres déchets conditionnés.
[1] Les boues radioactives résultent de traitement d’effluents radioactifs en vue de leur épuration.
[2] Les stations de traitement des effluents (STE) de Marcoule (STE1) et de La Hague (STE2 et STE3) produisent des boues qui sont entreposées dans des fosses dans l’attente d’un conditionnement. Le traitement par bitumage avait été retenu à Marcoule puis à La Hague, où un total de 10080m3 a été produit. AREVA doit mettre en œuvre une autre technique pour conditionner les boues entreposées. Elles seront séchées et compactées sous forme de pastilles qui seront conditionnées dans des fûts en acier inoxydables. Du sable sera rajouté pour combler les vides interstitiels.
QUESTION 441
Posée par Raymond CHAUSSIN, le 24/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 16 octobre 2013 - Risques et Sécurité :
Que pensez-vous de la découverte inattendue en Belgique de matières visqueuses qui s'écoulent de fûts de déchets?
Réponse du 28/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Lors d’une opération de contrôle, Belgoprocess (filiale de l’Ondraf, Organisme national de gestion déchets radioactifs et des matières fissiles) a identifié la formation d’un gel à la surface d’une matrice en béton utilisée par certaines centrales nucléaires en Belgique pour confiner des déchets de faible activité. Un vaste programme d’inspection et de contrôle a été mis en place par l’Ondraf (cf. http://www.ondraf.be/sites/default/files/20140107_Communique%20de%20presse-ONDRAF_FR.pdf). Une alcali-réaction dans le béton pourrait être à l’origine de ce phénomène.
Pour se prémunir du risque d’alcali-réaction, l'Andra impose un cahier des charges précis pour les matériaux utilisés pour la fabrication des colis de stockage. Les granulats et le ciment sont choisis pour garantir leur stabilité chimique. Par ailleurs, le béton pouvant également réagir au contact de certains déchets, l’Andra interdit le mélange de certaines familles de déchets avec ce type de matériau. Pour s'assurer du respect de ces spécifications, l’Andra procède à des contrôles en complément de ceux réalisés par les producteurs de déchets, qui sont responsables de la qualité des colis livrés sur les centres de stockage. A travers ces différents contrôles, l'Andra vérifie la maîtrise globale de la qualité des colis qu'elle reçoit. Si une erreur est observée, l’agrément d’une famille de déchets pour le stockage peut être suspendu.
Réponse apportée par Jean-Claude Zerbib, ancien ingénieur en radioprotection du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) :
Les experts de l'Office national belge des déchets radioactifs (Ondraf) ont repéré une "substance gélatineuse", sur 42 fûts de béton qui contiennent des déchets radioactifs, provenant de la centrale de Doel, entreposés sur le site de l'entreprise Belgoprocess, à Dessel, près de la frontière néerlandaise. Pour expliquer le phénomène, Electrabel, filiale de GDF Suez qui exploite les réacteurs de Doel, évoque de manière " quasi sûre " une réaction chimique (alcali-silice) qui se serait produite dans le béton où sont coulés les déchets nucléaires.
L'Ondraf confirme, pour sa part, que la matrice en béton des fûts est restée étanche et empêche toute fuite radioactive. Le problème reste cependant important car 7300 fûts ont été stockés à Dessel depuis trente ans et le gouvernement belge doit, en principe, adopter prochainement un plan pour le stockage en sous-sol (à - 200m dans une couche d’argile) des déchets moyennement et hautement radioactifs.
QUESTION 440
Posée par Patricia ANDRIOT, le 24/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 16 octobre 2013 - Risques et Sécurité :
Pouvez-vous revenir sur la question de la sécurisation des transports et nous redire le nombre de camions ou trains qui arriveront sur la zone ?
Réponse du 06/01/2014,
Réponse apportée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) :
Environ 900 000 colis de substances radioactives sont transportés chaque année. 85 % des colis transportés sont destinés aux secteurs de la santé, de l’industrie non-nucléaire ou de la recherche, dits "nucléaire de proximité", dont 30 % environ pour le seul secteur médical. L’industrie nucléaire ne représente qu’environ 15 % du flux annuel de transports de substances radioactives. On estime à environ 11 000 le nombre annuel de transports nécessaires au cycle du combustible, pour 141 000 colis. Le contenu des colis est très divers : leur radioactivité varie sur plus de douze ordres de grandeur, soit de quelques milliers de becquerels pour des colis pharmaceutiques de faible activité à des millions de milliards de becquerels pour des combustibles irradiés. Leur masse varie de quelques kilogrammes à une centaine de tonnes.
L’ASN est chargée du contrôle de la sûreté. La sûreté est l’ensemble des dispositions techniques et organisationnelles prises en vue de prévenir les accidents ou d’en limiter les effets.
Les risques majeurs des transports de substances radioactives sont les suivants :
- le risque d’irradiation externe de personnes dans le cas de la détérioration de la « protection biologique des colis », matériau technique qui permet de réduire le rayonnement au contact du colis ;
- le risque d’inhalation ou d’ingestion de particules radioactives dans le cas de relâchement de substances radioactives ;
- la contamination de l’environnement dans le cas de relâchement de substances radioactives;
- le démarrage d’une réaction nucléaire en chaîne non contrôlée (risque de « sûreté-criticité») pouvant occasionner une irradiation des personnes, en cas de présence d’eau et de non-maîtrise de la sûreté de substances radioactives fissiles.
La prise en compte de ces risques conduit à devoir maîtriser le comportement des colis pour éviter tout relâchement de matière et détérioration des protections du colis dans le cas :
- d’un incendie ;
- d’un impact mécanique consécutif à un accident de transport ;
- d’une entrée d’eau dans l’emballage (l’eau facilitant les réactions nucléaires en chaîne en présence de substances fissiles) ;
- d’une interaction chimique entre différents constituants du colis ;
- d’un dégagement thermique important des substances transportées,pour éviter la détérioration éventuelle avec la chaleur des matériaux constitutifs du colis.
Cette approche conduit à définir des principes de sûreté pour les transports de substances radioactives :
- la sûreté repose avant tout sur le colis : des épreuves réglementaires et des démonstrations de sûreté sont requises par la réglementation pour démontrer la résistance des colis à des accidents de référence ;
- le niveau d’exigence, notamment concernant la définition des accidents de référence auxquels doivent résister les colis, dépend du niveau de risque présenté par le contenu du colis. Ainsi, les colis qui permettent de transporter les substances les plus dangereuses doivent être conçus de façon à ce que la sûreté soit garantie y compris lors d’accident de transport. Ces accidents sont représentés par les épreuves suivantes :
- trois épreuves en série (chute de 9 m sur une surface indéformable, chute de 1 m sur un poinçon et incendie totalement enveloppant de 800 °C minimum pendant 30 minutes) ;
- immersion dans l’eau d’une profondeur de 15 m (200 m pour les combustibles irradiés) pendant 8 h.
La sûreté des transports est également fondée sur la fiabilité des opérations de transport qui doivent satisfaire à des exigences réglementaires notamment en matière de radioprotection. L'ASN assure le contrôle de la sûreté des transports de matières radioactives. Enfin, la gestion des situations accidentelles est régulièrement testée lors d'exercices.
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le transport des colis de déchets radioactifs représenterait en moyenne deux trains par mois sur la durée d’exploitation de Cigéo (le pic serait au maximum de l’ordre de deux trains par semaine). L’arrivée des trains s’effectuerait dans un terminal ferroviaire dédié. Deux options sont présentées au débat public : ce terminal pourrait être construit soit sur le site de Cigéo, avec la création d’une voie de raccordement au réseau ferré existant par exemple sur l’ancienne ligne entre Gondrecourt-le-Château et Joinville, soit à une vingtaine de kilomètres de Cigéo, sur le réseau ferré existant. Dans ce dernier cas, les emballages de transport contenant les colis de déchets devraient alors être transportés par camions entre le terminal et Cigéo. Pour décharger un train, qui transporte en moyenne une dizaine de wagons, une dizaine de rotations d’un camion entre le terminal ferroviaire et Cigéo seraient nécessaire.
Réponse apportée par Guillaume Blavette, association Haute Normandie Nature Environnement :
Dans la mesure où il n'existe aucune installation en fonctionnement comparable au projet Cigéo, il n'est pas possible de quantitifier exactement le nombre de transports qui arriveront sur site. Cela dépend de choix économiques et techniques faits par les expéditeurs et les transporteurs.
Dans le dossier du maitre d'ouvrage, page 47, l'ANDRA déclare que le "transport par voie ferroviaire est privilégié" et précise que "cela représenterait au maximum une centaine de trains par an (avec une dizaine de wagons par train), soit de l’ordre de deux trains par semaine en pic, avec une moyenne de deux trains par mois sur la durée d’exploitation." Si on peut se féliciter de ces déclarations de bonnes intentions on peut cependant douter de leur exactitude.
L'expérience prouve que les matières radioactives ne sont pas transportées prioritairement par rail. La route reste dominante en particulier pour les déchets de faible et moyenne activité. Chaque semaine des camions partent des installations nucléaires de base vers les centres de stockage de l'ANDRA de Soulaines et Morvilliers. Quelques 8 camions arrivent chaque jour sur chacun de ces sites sans compter les transports de matériels destinés à l'entretien des installations.
Ainsi donc on peut imaginer, en dépit des déclarations du maitre d'ouvrage, qu'une part non négligeable des déchets destinés à être stockés à Bure seront acheminés par la route. C'est le cas en particuliers des déchets métalliques de moyenne activité aujourd'hui entreposés dans les piscines de désactivation des 58 réacteurs nucléaires en exploitation. On peut aussi penser aux matières radioactives des anciens réacteurs dits graphite gaz. Des milliers de tonnes de métaux et de graphites sont aujourd'hui entreposés sur les sites de la Loire notamment en attente de modalités de gestion durable. Fort est à parier, faute de raccordement ferroviaire des centrales nucléaires, qu'ils seront acheminés sur tout ou partie du trajet vers Cigéo par la route.
Si on compare ces prévisions de trafic avec les transports qui ont lieu aujourd'hui. Cigéo entrainerait un doublement du nombre de convois de matières radioactives à l'échelle de la France avec une concentration des flux en Meuse et Haute-Marne.
QUESTION 439
Posée par Florence LAMAZE, le 24/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 16 octobre 2013 - Risques et Sécurité :
Il arrive aux trains d'avoir des accidents, de dérailler. N'est-ce pas faire courir un risque majeur aux populations qui vivent aux alentours de ces trajets ferroviaires?
Réponse du 05/12/2013,
Réponse apportée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) :
Les modèles de colis sont soumis à des épreuves réglementaires destinées à démontrer leur résistance lors du transport. Le niveau d’exigence de ces épreuves est proportionné à la dangerosité des substances transportées. À titre d’exemple, les modèles de colis correspondant aux substances les plus dangereuses doivent conserver leurs fonctions de sûreté, y compris en cas d’accident (simulé par une chute de 9 m sur une surface indéformable, une chute de 1 m sur un poinçon, un incendie d’hydrocarbure totalement enveloppant de 800° C minimum pendant 30 mn, une immersion dans l’eau à une profondeur de 200 m).
Les autorités se sont naturellement interrogées depuis plusieurs années sur le comportement des colis agréés dans des cas d’agressions allant au-delà de ces épreuves réglementaires décrites précédemment.
Des études ont été menées en France et à l’étranger, notamment par l’IRSN, AREVA, l’autorité allemande BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung) et le laboratoire national américain SANDIA, afin d’évaluer le comportement des colis contenant des substances radioactives dans des conditions réalistes d’impact mécanique et de feu et pouvant aller au-delà des sollicitations prévues par les épreuves réglementaires. Ainsi, la tenue de ces types de colis dans des conditions de feu plus contraignantes (en termes de durée et de température) et dans des conditions de chute plus réalistes (en termes de surface d’impact et de hauteur de chute) a été étudiée. Par exemple, une étude de l’IRSN consultable sur le site Internet de l’institut[1] permet de comparer l’écrasement du colis sur une surface indéformable, comme prévu dans les épreuves réglementaires et sur des surfaces représentatives de cibles réelles : par exemple des sols en sable, argile ou des cibles métalliques représentatives de l’environnement des emballages durant le transport dont l’essieu de wagon et le longeron de wagon. Cette étude a montré que les colis considérés dans l’étude conserveraient leur capacité de confinement en cas d’accident réel et que leurs équipements additionnels (châssis et râtelier) ainsi que les cibles absorberaient une part importante de l’énergie d’impact et augmenteraient ainsi les marges de sûreté.
D’autres études ont été réalisées à l’étranger concernant le transport ferroviaire de colis de substances radioactives. Par exemple :
- l’institut allemand (BAM) a réalisé des essais visant à représenter un scénario d’accident impliquant une explosion d’un wagon citerne chargé de propane à proximité d’un colis de type CASTOR contenant du combustible irradié de façon à être plus pénalisant, le colis de combustible n’était pas muni de ses capots amortisseurs. L’essai a entraîné une boule de feu ainsi que des flammes allant au-dessus du point d’explosion. Le colis de substances radioactives a été projeté à 7 m de sa position initiale et s’est enfoncé de 1 mètre dans le sol. Toutefois, les tests d’étanchéité, réalisés après essai, ont montré que l’emballage restait étanche, il n’y a donc pas eu d’augmentation des conséquences de l’accident lié au caractère radiologique du contenu de l’emballage transporté[2].
- Le BAM a également réalisé une simulation numérique visant à évaluer l’impact d’une chute sur des rails à une hauteur de 14 m d’un colis contenant des déchets vitrifiés de haute activité qui aurait été préalablement endommagé par une entaille de 12 cm. Le BAM a conclu que l’emballage restait intact[3].
- la « Central Electricity Generating Board for England and Wales » a organisé un crash-test public consistant à faire entrer en collision un train de 140 t roulant à 160 km/heure dans un colis de combustible irradié de type B. Les vidéos du crash-test disponibles sur Internet montrent que le combustible est resté confiné dans l’emballage[4].
En France, aucun accident ferroviaire ayant impliqué des colis de combustible usé n’a à ce jour été rapporté.
La dernière ligne de défense de la sûreté des transports de substances radioactives repose sur les moyens d’intervention mis en œuvre face à un incident ou un accident. Les pouvoirs publics, l’ASN et les exploitants se préparent donc à la gestion des situations de crise impliquant un transport de substances radioactives à travers les plans ORSEC et au moyen d’exercices.
[1] http://www.irsn.fr/FR/Larecherche/publications-documentation/aktis-lettre-dossiers-thematiques/RST/RST-2002/Documents/Chap03_art1.pdf
[2] http://www.tes.bam.de/de/umschliessungen/behaelter_radioaktive_stoffe/dokumente_veranstaltungen/pdf/rmtp1999104231.pdf [3] http://www.tes.bam.de/en/umschliessungen/behaelter_radioaktive_stoffe/behaelterpruefungen/index.htm
[4] http://www.britishrailways.tv/train-videos/2012/100mph-nuclear-flask-train-crash-test/
Réponse apportée par Philippe Guiter, syndicat Sud Rail :
Avec l'augmentation de ces convois hautement radioactifs, l'augmentation statistique du risque d'accident grave est d'actualité. Par ailleurs nous contestons les seuils de résistance au feu et aux chocs des emballages actuels ainsi que le mélange de différents produits chimiques dans ces convois qui font courir le risque de sur-accident.
QUESTION 438
Posée par REMIFASOL, le 24/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 16 octobre 2013 - Risques et sécurité :
Qu'en est-il du risque innondation?
Réponse du 17/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Comme pour toute installation nucléaire, le risque inondation est pris en compte pour la conception de Cigéo dès le choix de site d’implantation. Ainsi les implantations envisagées pour les installations de surface de Cigéo sont en dehors des zones inondables par des crues de cours d’eau.
De nombreuses mesures seront prises pour prévenir d’éventuelles arrivées d’eau accidentelles dans l’installation souterraine de Cigéo :
- Protection des puits et de la descenderie contre les intempéries,
- Étanchéification des puits et des descenderies au niveau des couches de roche aquifères traversées au-dessus de la couche d’argilite,
- Systèmes de drainage des eaux issues des couches de roche supérieures peu productives et pompage de ces eaux jusqu’à la surface,
- Protection des canalisations d’eau interne et mécanismes de fermeture automatique en cas de rupture.
Ces dispositions sont largement éprouvées dans l’industrie minière.
Par précaution, des scénarios accidentels d’arrivées d’eau (par exemple suite à la défaillance d’une canalisation ou suite à une panne dans le système de drainage des eaux provenant des couches de roche supérieures) sont pris en compte dans les études de sûreté menées pour Cigéo, au même titre que pour n’importe quelle installation nucléaire. Compte tenu des origines possibles, ce débit sera nécessairement limité (pour mémoire le débit drainé par chacun des puits du Laboratoire souterrain est de l’ordre de 10 m3/jour en moyenne, ou moins, ce qui est très faible par comparaison à certains sites miniers). Un tel évènement resterait très localisé dans le stockage et n’aurait qu’un effet très limité sur l’argile qui sera protégée par les revêtements. En tout état de cause, ce type d’incident ne remettra pas en cause la sûreté du stockage.
Réponse apportée par Jean-Claude Zerbib, ancien ingénieur en radioprotection du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) :
Comme l’ennemi N°1 pour les déchets c’est leur contact avec l’eau, il faut éviter toute intrusion d’eau dans la zone de stockage. La remontée d’eaux qui se serait infiltrées jusqu’au niveau - 500m n’est pas un problème technique trivial. L’étanchéité de toutes les entrées au niveau-sol, de la descenderie, comme le cloisonnement en profondeur des zones de stockage doit être la règle.
QUESTION 436 - Coût
Posée par Brice MABIRE, L'organisme que vous représentez (option), le 24/10/2013
Si en plus des risques encourus et de l'impact environnemental on ajoute au coût de l'enfouissement de déchets les salaires des agents de surveillance sur des milliers d'années, 7j/7, 24h/24, comment un tel projet peut-il être soutenable?
Réponse du 06/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’impossibilité de garantir la capacité de la société à surveiller les déchets radioactifs pendant des milliers d’années est justement une des raisons qui a conduit au choix de la solution du stockage profond pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs. Contrairement à un entreposage de longue durée, le stockage dans une couche géologique assurant le confinement des éléments radioactifs à l’échelle de plusieurs centaines de milliers d’années permet de protéger l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets sans nécessité d’action humaine. La géologie prend ainsi le relais de l’homme pour garantir la sûreté sur le très long terme. La surveillance du site pourra néanmoins être maintenue aussi longtemps que les générations futures le souhaiteront et contribuera au maintien de la mémoire du stockage.
Si vous souhaitez plus d’informations sur la sûreté de Cigéo, vous pouvez consulter le chapitre 5 du dossier de présentation du projet : ../docs/dmo/chapitres/DMO-Andra-chapitre-5.pdf
QUESTION 435
Posée par Raymond CHAUSSIN, le 23/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 9 octobre 2013 - Principes de précaution et réversibilité :
En écoutant tous les intervenants sur les générations futures, ils devraient être tous d'accord pour arrêter immédiatement le nucléaire, non?
Réponse du 05/12/2013,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Le Président de la République a décidé d’engager la transition énergétique, cette transition reposant d'une part sur la sobriété et l’efficacité énergétique, et d'autre part sur la diversification des sources de production et d'approvisionnement.
Concernant la diversification de nos sources d’énergies, le Président de la République a fixé un cap : réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% d'ici 2025. Parallèlement, le Président de la République a indiqué que la transition énergétique serait fondée sur deux principes : l'efficacité énergétique d'une part, et la priorité donnée aux énergies renouvelables d'autre part. Cette mutation prendra du temps et supposera des étapes d’évaluation en fonction des progrès technologiques et scientifiques et des prix relatifs de chaque source d’énergie.
Pour le quinquennat, le Président de la République a pris quatre engagements en cohérence avec cette perspective :
- la plus ancienne de nos centrales – Fessenheim – sera arrêtée ;
- le chantier du réacteur EPR de Flamanville sera conduit à son terme ;
- le système de traitement – recyclage des combustibles usés et la filière qui l’accompagne seront préservés ;
- aucune autre centrale ne sera lancée durant ce mandat.
Un arrêt immédiat de l’ensemble du parc nucléaire français n’est pas envisageable sans remettre en cause l’approvisionnement électrique du pays. La France ne dispose pas de moyens de production alternatifs capables de se substituer intégralement au parc nucléaire dès aujourd’hui.
Réponse apportée par Monique Sené, physicienne nucléaire, chercheuse au CNRS, vice-présidente du comité consultatif de l'ANCCLI :
Il est vrai que notre pensée envers les générations futures est curieuse. Le nucléaire traverse les générations : les centrales actuelles vont atteindre leur quarante ans entre 2017 et 2035, mais il a fallu les construire. Elles ornent nos fleuves et mers depuis environ 50 ans donc 2 générations.
Et si nous mettons nos déchets très actifs en 2070 par le fond, quelqu’un né en 2000, aura donc 70 ans….. Quand on fermera vers les années 2139, personne n’aura connu les débuts du site. On parle de rendez-vous, mais avec qui ? et surtout quelles connaissances résisteront au temps ?
QUESTION 434
Posée par WEBER, le 23/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 9 octobre 2013 - Principes de précaution et réversibilité :
Si les déchets sont irréversibles et posent tant de problèmes, pourquoi ne démantèle-t-on pas de toute urgence les centrales nucléaires?
Réponse du 20/12/2013,
Réponse apportée par Edf :
90% des déchets issus de la production électronucléaire disposent aujourd’hui de solutions de gestion pérennes, et Cigeo viendra compléter ce dispositif pour les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue. La loi du 13 juillet 2005 (Loi de Programmation et d’Orientation pour l’Energie) a fixé les objectifs du pays en matière énergétique : développement des énergies renouvelables, développement des économies d’énergie, poursuite de la production électronucléaire. Une nouvelle loi de transition énergétique est en préparation, et sera discutée au Parlement en 2014. Les orientations de cette nouvelle loi seront, comme celles de la loi actuelle, mises en œuvre par EDF, qui est actuellement le premier producteur d’électricité nucléaire dans le monde, mais aussi le premier producteur d’énergies renouvelables en France et l’acteur principal du programme d’économies d’énergie dans les bâtiments défini par la loi, via le mécanisme des Certificats d’Economies d’Energie.
Réponse apportée par Monique Sené, physicienne nucléaire, chercheuse au CNRS, vice-présidente du comité consultatif de l'ANCCLI :
Pour plusieurs raisons il faudrait savoir s’arrêter : tout d’abord un programme énergétique cohérent doit reposer sur les économies d’énergie et une diversification des sources : reposer à 75% sur le nucléaire pour la production d’électricité n’est pas correct. S’il y a un problème grave de sûreté on se trouverait sans source d’énergie.
QUESTION 433
Posée par Michel GUERITTE, le 23/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 9 octobre 2013 - Principes de précaution et réversibilité :
Alors, personne n'a posé la question de l'argilite qui se délite en 16 minutes ?
Réponse du 16/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra maître d’ouvrage :
Deux questions ont été posées sur ce thème. Vous trouverez les réponses apportées par l’Andra sur le site du débat public. Nous vous invitons cependant à venir visiter le Laboratoire souterrain et rencontrer les scientifiques qui y travaillent et qui pourront vous expliquer comment ce phénomène, parfaitement connu et présenté dans le Dossier 2005 de l’Andra, est étudié depuis de nombreuses années et pourquoi un massif argileux de 130 mètres d’épaisseur a un comportement différent d’un échantillon placé dans un verre d’eau. Par ailleurs, cette visite vous permettra également de vérifier par vous-même que les galeries du laboratoire sont intactes bien que la roche ne soit pas protégée des infiltrations d’eau, la roche devant rester à nu pour pouvoir être étudiée (dans Cigéo, s’il est autorisé, les galeries et les alvéoles seront revêtues d’acier ou de béton).
Réponse apportée par Monique Sené, physicienne nucléaire, chercheuse au CNRS, vice-présidente du comité consultatif de l'ANCCLI :
Le discours ANDRA gomme effectivement les problèmes rencontrés et ceci peut lui être reproché. Il est dommage que l’ANDRA ne prenne pas en compte les incertitudes résultant de ses propres études.
Cependant des questions sont posées par l’ASN et l’IRSN. L’inconvénient est de vouloir continuer à marche forcée sans avoir procédé aux expérimentations : il y a trop de modélisations dans leurs explications et pas assez d’expérimentations pour confirmer les calculs. Il est certain que l’eau est un problème et l’IRSN a posé des conditions :
« D’une manière générale, l’IRSN considère que l’Andra devra présenter, dans le dossier accompagnant la DAC, les dispositifs de maîtrise des eaux qui seront mis en place au niveau du Barrois dans les puits et dans la descenderie.
Pour ce qui concerne les dispositifs d’étanchéité, l’Andra devra préciser leur objectif de performance, les dispositions de contrôle de leur efficacité, ainsi que les conséquences d’un éventuel défaut et les dispositions associées pour y remédier. Pour ce qui concerne les dispositifs de collecte et d’évacuation des eaux drainées, l’Andra devra justifier, au regard des quantités d’eau susceptibles d’être recueillies, le dimensionnement des capacités de rétention et des débits d’évacuation. En outre, l’Andra devra évaluer, sur la base de premières investigations de terrain, la présence éventuelle de poches karstiques à proximité des liaisons jour-fond et prés ».
Un morceau d'argilite de Bure mis dans un verre d'eau se délite et on obtient une boue. Mais lorsqu'on est dans la veine d'argilite, celle-ci est en pression elle ne tombe pas en poussière : il faut cependant pomper et évacuer l'eau pour protéger son intégrité. Il n'empêche qu'il y a un certain effritement des parois de l'alvéole et surtout une zone d'endommagement qui pourrait permettre à de l'eau de venir attaquer l'emballage donc on prévoit la reprise de l'eau et des gaz. Tout ceci reste à tester en vraie grandeur pour trouver les solutions les plus adaptées.
Pour le moment, il est urgent d’avoir des entreposages de qualité, avec des emballages suffisamment robustes pour pouvoir continuer des recherches et pouvoir mettre les déchets en un lieu permettant de garantir la santé des travailleurs et des riverains. Il est certain qu’une partie des déchets devra attendre près de 50 ans pour avoir suffisamment refroidis pour ne pas dégrader la roche protectrice.
QUESTION 432
Posée par Raymond CHAUSSIN, le 23/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 9 octobre 2013 - Principes de précaution et réversibilité :
Pour mesurer l'évolution des tunnels devra-t-on faire confiance uniquement à des capteurs ou une intervention humaine sera-t-elle possible pour vérifier également les capteurs?
Réponse du 28/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
S’il est autorisé, Cigéo fera l’objet d’une surveillance systématique, comme toute installation nucléaire. Cette surveillance s’appuie sur un ensemble de dispositifs permettant de contrôler les différents paramètres (radiologique, thermique, mécanique, hydrique…). Cette surveillance sera effectuée par l’Andra et sera contrôlée par l’Autorité de sûreté nucléaire.
Les tunnels de l’installation souterraine seront accessibles au personnel, à l’exception des alvéoles où seront stockés les déchets radioactifs. Des dispositifs spécifiques de surveillance sont étudiés par l’Andra pour ces alvéoles, en s’appuyant notamment sur le retour d’expérience acquis dans l’industrie nucléaire pour inspecter des zones à fort niveau de radiation, par exemple dans les centrales nucléaires. En particulier, les équipements utilisés sont « durcis », c’est-à-dire conçus pour pouvoir opérer dans ces zones irradiantes.
Réponse apportée par Monique Sené, physicienne nucléaire, chercheuse au CNRS, vice-présidente du comité consultatif de l'ANCCLI :
Les capteurs seront surveillés et testés par des homme au début. Sera-t-il possible de les réparer ? Rien n’est moins sûr puisqu’il ne faut pas de trous dans la fermeture. Et combien de temps durera un capteur ?
QUESTION 431
Posée par TAMBOUR, le 23/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 9 octobre 2013 - Principes de précaution et réversibilité :
Comment osez faire croire qu'un enfouissement des déchets sera sans conséquence ? le nucléaire est mort !
Réponse du 10/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La sûreté est au cœur du projet Cigéo. Pour que le projet puisse être autorisé, l’Andra doit démontrer à l’Autorité de sûreté nucléaire que l’installation permet de maîtriser les risques liés aux déchets radioactifs, pendant son exploitation et après sa fermeture. Si vous souhaitez plus d’informations sur la démarche de sûreté, vous pouvez consulter le chapitre 5 du dossier du maître d’ouvrage
../docs/dmo/chapitres/DMO-Andra-chapitre-5.pdf. Quels que soient les choix énergétiques futurs, c’est la responsabilité de notre génération de proposer aux générations suivantes une solution permettant de mettre définitivement en sécurité les déchets plus radioactifs, qui ont été produits en France depuis plusieurs dizaines d’années.
Réponse apportée par Monique Sené, physicienne nucléaire, chercheuse au CNRS, vice-présidente du comité consultatif de l'ANCCLI :
Je ne sais pas s’il est mort, il suffit de se rappeler Tchernobyl et de constater comment on oublie Fukushima. Il est évident que le fait d’avoir (malgré des mises en gardes diverses) le programme que nous subissons (58 réacteurs), sans avoir eu la mise en place d’un programme énergétique diversifié s’appuyant d’abord sur des économies puis sur toutes les sources disponibles, nous met dans une situation difficile. Cependant, si, d’une part l’arrêt de tous les réacteurs est difficilement envisageable, d’autre part si on ne commence pas l’arrêt des réacteurs les plus vieux, on risque de graves problèmes.
QUESTION 430
Posée par RÉSEAU DES ECOLOGISTES SOCIALISTES POUR LA SORTIE DES ENERGIES CARBONÉES, le 23/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 9 octobre 2013 - Principes de précaution et réversibilité : Le mieux étant l'ennemi du bien, y a t il plusieurs options pour la réversibilité et quels sont leurs couts respectifs ?
Réponse du 10/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le projet Cigéo est conçu pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets français les plus radioactifs et ne pas reporter leur charge sur les générations futures. Le Parlement a également demandé que ce stockage, prévu pour être définitif, soit réversible pendant au moins 100 ans pour laisser des choix aux générations suivantes et notamment la possibilité de récupérer des déchets stockés. Les conditions de cette réversibilité seront définies dans une future loi.
L’Andra prévoit dès la conception de Cigéo des dispositifs techniques destinés à faciliter le retrait éventuel de colis de déchets stockés. Les déchets seront stockés dans des conteneurs indéformables, en béton ou en acier. Les tunnels pour stocker ces conteneurs (alvéoles de stockage) seront revêtus d’une paroi en béton ou en acier pour éviter les déformations, avec des espaces ménagés entre les conteneurs et les parois pour permettre leur retrait. Les robots utilisés pour placer les conteneurs dans les alvéoles pourront également les retirer. Des essais à l’échelle 1 ont d’ores et déjà été réalisés avec des prototypes.
L’Agence pour l’énergie nucléaire de l’OCDE a établi une échelle internationale de récupérabilité montrant l’évolution du niveau de récupérabilité (complexité d’une opération de retrait de colis de déchets) avec les étapes successives de fermeture du stockage (fermeture des alvéoles, des galeries d‘accès à ces alvéoles, fermeture des puits et descenderies entre la surface et l’installation souterraine). Cette échelle est illustrée dans le dossier de l’Andra (../docs/dmo/chapitres/DMO-Andra-chapitre-7.pdf, page 79).
Plusieurs options sont ouvertes pour Cigéo, comme par exemple fermer rapidement les alvéoles lorsque les colis de déchets sont stockés ou, au contraire, temporiser cette étape. Le planning de fermeture pourra être réexaminé à chaque étape du projet. Chaque étape de fermeture permettra d’ajouter des dispositifs de sûreté passive. Néanmoins, elle rendra plus complexe le retrait éventuel des colis stockés. L’Andra propose donc que le franchissement de chaque nouvelle étape de fermeture, notamment le scellement des alvéoles de stockage, fasse l’objet d’une autorisation spécifique. Le Parlement a d’ores et déjà décidé que seule une loi pourrait autoriser la fermeture définitive du stockage.
L’Andra propose un partage équitable du financement de la réversibilité entre les générations. Les générations actuelles provisionnent l’ensemble des coûts nécessaires pour permettre la mise en sécurité définitive des déchets radioactifs qu’elles produisent, ainsi que des déchets anciens qui ont été produits depuis le début des années 1960. Ces provisions couvrent également les propositions techniques retenues pour assurer la réversibilité de Cigéo pendant le siècle d’exploitation. Si les générations suivantes décidaient de faire évoluer leur politique de gestion des déchets radioactifs, par exemple si elles décidaient de récupérer des déchets stockés, elles en assureraient le financement. La prise en compte de la réversibilité dès la conception du stockage permet de limiter cette charge potentielle.
Pour en savoir plus sur les propositions de l’Andra sur la réversibilité de Cigéo : ../docs/rapport-etude/fiche-reversibilite-cigeo.pdf
QUESTION 429
Posée par SAUVONS LE CLIMAT, le 23/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 9 octobre 2013 - Principes de précaution et réversibilité :
Vu les coûts, la mutualisation de certains déchets est-elle envisageable entre grands/petits pays?
Réponse du 05/02/2014,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Le projet de stockage Cigéo ne pourra pas devenir un centre de stockage mutualisé avec d’autres pays (petits ou grands), car depuis la loi « Bataille » de 1991, le Parlement a interdit le stockage en France de déchets radioactifs en provenance de l’étranger. Cette interdiction figure aujourd’hui à l’article L. 542-2 du Code de l’environnement. Cette législation est cohérente avec la directive européenne du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre des combustibles usés et des déchets radioactifs, qui réaffirme la responsabilité de chaque État dans la gestion de ses déchets radioactifs. Par ailleurs, dans le cadre de la plateforme européenne de recherches sur le stockage géologique Implementing Geological Disposal Technical Platform (http://www.igdtp.eu/), les pays les plus avancés, en particulier la Finlande, la France et la Suède, partagent avec les autres pays leurs résultats d’essais, d’études et de recherches. Cela permet de transférer le savoir-faire acquis et d’envisager pour ces pays une réduction de certains coûts d’études et de recherches pour leurs propres programmes de développement de stockages.
Réponse apportée par Monique Sené, physicienne nucléaire, chercheuse au CNRS, vice-présidente du comité consultatif de l'ANCCLI :
C’est plus ou moins prévu dans la directive européenne. Mais c’est interdit dans la loi française.
QUESTION 428
Posée par Bernard LAPONCHE, le 23/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 9 octobre 2013 - Principes de précaution et réversibilité :
Dans le document de projet CIGEO, point 4.5, il est écrit : "la fermeture du stockage se fera de manière progressive".
Est-ce que cette phrase est bien annulée par l'engagement de l'Andra sur la récupérabiliité de tout colis pendant toute la période d'exploitation de cent ans au moins?
Réponse du 06/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le stockage profond des déchets radioactifs est une installation destinée à être fermée définitivement pour limiter les charges supportées par les générations futures.
La fermeture du stockage sera réalisée de manière progressive, depuis la fermeture des alvéoles jusqu’au scellement des puits et des descenderies. Chaque étape de fermeture ajoute des dispositifs supplémentaires de sûreté « passive » et réduit la nécessité d’actions humaines pour contrôler la sûreté.
L’échelle de récupérabilité publiée par l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’OCDE montre la progression de la sûreté passive du stockage au fur et à mesure des étapes de fermeture. Elle montre aussi que la récupération des colis de déchets sera de plus en plus complexe avec le franchissement de ces étapes, qui constitueront les décisions les plus marquantes au cours de l’exploitation de Cigéo. Cette échelle est présentée au chapitre 7.2 du dossier de présentation du projet (page 79 - ../docs/dmo/chapitres/DMO-Andra-chapitre-7.pdf).
Un planning de référence des étapes de fermeture sera fixé dans le cadre de l’autorisation de création de Cigéo. Il donnera une visibilité à l’ensemble des acteurs sur le calendrier de décision. Ce planning pourra être modifié au cours de l’exploitation, la conception de Cigéo permettant de temporiser chaque étape de fermeture. Chaque étape de fermeture du stockage devra faire l’objet d’une autorisation spécifique.
Réponse apportée par Monique Sené, physicienne nucléaire, chercheuse au CNRS, vice-présidente du comité consultatif de l'ANCCLI :
Effectivement il y a une contradiction : après la fermeture, il ne sera plus question de revenir ou bien ce seront des fermetures provisoires. Mais l’ANDRA admet que la récupérabilité des premiers colis ne sera pas possible sur 100 ans.
D’ailleurs aura-t-on des capteurs (même en les changeant) capables d’un fonctionnement sur des temps si longs ? et pourra-t-on changer une technique si on s’est trompé ?
QUESTION 427
Posée par NC, le 23/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 9 octobre 2013 - Principes de précaution et réversibilité :
La réversibilite n’est-elle pas là juste pour faire accepter l’enfouissement?
Réponse du 02/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Non, la réversibilité n’est pas là juste pour faire accepter le stockage. Le Parlement a demandé à l’Andra que le stockage soit réversible pendant au moins 100 ans pour laisser des portes ouvertes aux générations qui nous succéderons et la possibilité de faire évoluer cette solution si elles souhaitent. L’Andra place cette demande de la société au cœur du projet. Elle a ainsi fait des propositions concrètes pour pouvoir récupérer les colis de déchets si besoin et laisser des choix possibles aux générations suivantes. Dans le cadre de la réversibilité, l’Andra propose d’organiser des points de rendez-vous réguliers qui permettront notamment de suivre les avancées des recherches sur la gestion des déchets radioactifs. Si d’autres solutions étaient découvertes dans le futur, les générations concernées pourront décider de faire évoluer leur politique de gestion des déchets.
Les conditions de réversibilité seront définies par une future loi avant que la création de Cigéo ne puisse être autorisée. Pendant au moins 100 ans, les générations suivantes pourront contrôler le déroulement du stockage et récupérer les déchets si elles le souhaitent. En fonction de l’expérience acquise lors de l’exploitation de Cigéo, elles pourront décider de commencer la fermeture par étapes du stockage. Après une centaine d’années d’exploitation, si elles décident de fermer définitivement le stockage, la sûreté sera assurée de manière passive, sans nécessité d’action humaine.
Pour en savoir plus sur les propositions faites par l’Andra en matière de réversibilité du stockage, voir : ../docs/rapport-etude/fiche-reversibilite-cigeo.pdf
Réponse apportée par Monique Sené, physicienne nucléaire, chercheuse au CNRS, vice-présidente du comité consultatif de l'ANCCLI :
Un stockage réversible doit être expérimenté avant tout autre construction. En effet une construction sur laquelle on peut revenir ne peut pas être semblable à une construction qu’on ferme par palier, sachant alors que le retour en arrière sera impossible si on ne l’a pas prévu dès le début.
QUESTION 426
Posée par Eric SUTRE, le 23/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 9 octobre 2013 - Principes de précaution et réversibilité :
C'est vrai qu'une fois refermé, le stockage ne pourra pas être ré-ouvert, même si c'est cher ? Après tout, si on a su le creuser on peut le refaire ?
Réponse du 10/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le but du stockage est de mettre en sécurité de manière définitive les déchets radioactifs, pour ne pas reporter leur charge sur les générations futures. A long terme, la protection de l’homme et de l’environnement doit être assurée sans nécessité d’intervention humaine (sûreté « passive »). La décision de fermer le stockage pour assurer la sûreté de manière passive reviendra aux générations suivantes et la loi du 28 juin 2006 prévoit que seule une loi pourra l’autoriser. La surveillance du site pourra être maintenue aussi longtemps que les générations suivantes le souhaiteront. Il pourrait toujours être envisagé de revenir dans le stockage au moyen de techniques minières adaptées, mais le confinement apporté par la roche et les ouvrages de fermeture ne serait alors plus assuré.
Réponse apportée par Monique Sené, physicienne nucléaire, chercheuse au CNRS, vice-présidente du comité consultatif de l'ANCCLI :
Ce n’est pas seulement une question d’argent, mais il faut garantir la sûreté et la radioprotection. Reprendre des déchets très radioactifs est difficile et dangereux pour les travailleurs.
De plus il faut prévoir l’endroit où ils seront entreposés si on les remonte en surface.
Si on recreuse ce ne sera pas dans les conditions premières, il faudra ne pas toucher aux galeries et utiliser des robots. Si c’est tout au début qu’on s’aperçoit des problèmes on pourra peut être réparer, mais les expériences passées montrent la difficulté de l’exercice lorsque le temps a passé et que les déchets se sont entassés.
QUESTION 425
Posée par CEDRA, le 23/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 9 octobre 2013 - Principes de précaution et réversibilité :
Pourquoi abuser l’opinion publique en disant que le stockage souterrain à Bure serait sûr et qu’il serait réversible, alors que les chercheurs indépendants démontrent à présent :
- que la roche (argilite) se déliterait après le creusement des galeries et alvéoles s’il elle était en contact avec de l’eau
- que de l’eau il y en a énormément au-dessus de l’argilite (présence de plusieurs aquifères)
- que cette eau ne demanderait qu’à descendre dans l’énorme gruyère creusé pour un stockage : par les puits, par la descenderie, par les failles anciennes, colmatées mais qui se rouvriraient par les séismes tous proches des Vosges
Sûreté ? Réversibilité ? Et l’Andra, documents à l’appui, a affirmé pendant des années qu’il n’y avait pas d’eau. A quel jeu joue l’Andra, et les organismes qui disent la surveiller ?
Réponse du 17/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Concernant le délitement de l’Argile
Le phénomène de délitement d’un échantillon d’argile placé dans un verre d’eau est connu de tous. Il ne peut être transposé aussi simplement à un massif de roche d’argile de 130 mètres d’épaisseur à 500 mètres de profondeur : la roche argileuse est solide alors qu’elle contient environ 10 % d’eau en masse (18 % en volume). Compte tenu de son volume très important, le massif argileux ne pourrait se déliter en présence de venues d’eau externes que de façon très localisée. Dans Cigéo, les parois des galeries seront recouvertes d’un soutènement en béton qui protège la roche, avec des caniveaux pour drainer les éventuelles venues d’eau vers des points de collecte. La roche sera à nu uniquement au niveau des fronts de creusement.
Concernant la présence d’aquifères
L’Andra a toujours été claire à ce sujet : le projet de stockage Cigéo est prévu d’être implanté dans la couche argileuse du Callovo-Oxfordien, située à une profondeur d’environ 500 m et dont l’épaisseur varie de 140 à 160 m environ sur le site étudié. Au sens de la définition générale d’un aquifère (ou nappe phréatique), il existe trois formations aquifères situées de part et d’autre de la couche du Callovo-Oxfordien :
- en surface, les calcaires du Barrois : d’une épaisseur de quelques dizaines de mètres, il s’agit d’un aquifère généralement de type karts. Cet aquifère est exploité localement pour l’alimentation en eau potable,
- de part et d’autre de la couche du Callovo-Oxfordien, l’Oxfordien carbonaté au-dessus et le Dogger en dessous :
- l’Oxfordien carbonaté d’environ 300 mètres d’épaisseur est à une profondeur de 200 m. L’aquifère est en fait constitué de deux aquifères séparés par des marnes. L’aquifère le plus proche de la couche du Callovo-Oxfordien est située environ de 40 m et 100 m de cette dernière,
- le Dogger a une épaisseur d’environ 300 m. On y distingue aussi deux aquifères séparés par des marnes (marnes de Longwy) d’environ 30 m d’épaisseur : l’un, le Bathonien, est situé en partie supérieure du Dogger, avec une épaisseur moyenne de 100 m environ ; l’autre, le bajocien, est en partie basse. Sur le site, la distance entre la base du Callovo-Oxfordien et le bathonien aquifère varie de 20 m à 40 m environ.
Sur la zone de transposition, les aquifères de l’Oxfordien et du Dogger présentent des caractéristiques hydrogéologiques faibles, parfois désignés sous le nom d’aquitards. Ils ne sont de ce fait exploités qu’en dehors de la zone où pourrait être implanté Cigéo, là où leurs caractéristiques hydrogéologiques sont plus favorables.
Concernant l’arrivée d’eau accidentelle dans Cigéo
De nombreuses mesures seront prises pour prévenir d’éventuelles arrivées d’eau accidentelles dans l’installation souterraine de Cigéo :
- Protection des puits et de la descenderie contre les intempéries,
- Étanchéification des puits et des descenderies au niveau des couches de roche aquifères traversées au-dessus de la couche d’argilite,
- Systèmes de drainage des eaux issues des couches de roche supérieures peu productives et pompage de ces eaux jusqu’à la surface,
- Protection des canalisations d’eau interne et mécanismes de fermeture automatique en cas de rupture.
Ces dispositions sont largement éprouvées dans l’industrie minière.
Par précaution, des scénarios accidentels d’arrivées d’eau (par exemple suite à la défaillance d’une canalisation ou suite à une panne dans le système de drainage des eaux provenant des couches de roche supérieures) sont pris en compte dans les études de sûreté menées pour Cigéo, au même titre que pour n’importe quelle installation nucléaire. Compte tenu des origines possibles, ce débit sera nécessairement limité (pour mémoire le débit drainé par chacun des puits du Laboratoire souterrain est de l’ordre de 10 m3/jour en moyenne, ou moins, ce qui est très faible par comparaison à certains sites miniers). Un tel évènement resterait très localisé dans le stockage et n’aurait qu’un effet très limité sur l’argile qui sera protégée par les revêtements. En tout état de cause, ce type d’incident ne remettra pas en cause la sûreté du stockage.
Réponse apportée par Monique Sené, physicienne nucléaire, chercheuse au CNRS, vice-présidente du comité consultatif de l'ANCCLI :
Le discours ANDRA gomme effectivement les problèmes rencontrés et ceci peut lui être reproché. Il est dommage que l’ANDRA ne prenne pas en compte les incertitudes résultant de ses propres études.
Cependant des questions sont posées par l’ASN et l’IRSN. L’inconvénient est de vouloir continuer à marche forcée sans avoir procéder aux expérimentations : il y a trop de modélisations dans leurs explications et pas assez d’expérimentations pour confirmer les calculs.
Il est certain que l’eau est un problème et l’IRSN a posé des conditions :
« D’une manière générale, l’IRSN considère que l’Andra devra présenter, dans le dossier accompagnant la DAC, les dispositifs de maîtrise des eaux qui seront mis en place au niveau du Barrois dans les puits et dans la descenderie. Pour ce qui concerne les dispositifs d’étanchéité, l’Andra devra préciser leur objectif de performance, les dispositions de contrôle de leur efficacité, ainsi que les conséquences d’un éventuel défaut et les dispositions associées pour y remédier.
Pour ce qui concerne les dispositifs de collecte et d’évacuation des eaux drainées, l’Andra devra justifier, au regard des quantités d’eau susceptibles d’être recueillies, le dimensionnement des capacités de rétention et des débits d’évacuation. En outre, l’Andra devra évaluer, sur la base de premières investigations de terrain, la présence éventuelle de poches karstiques à proximité des liaisons jour-fond et prés »
Pour le moment, il est urgent d’avoir des entreposages de qualité, avec des emballages suffisamment robustes pour pouvoir continuer des recherches et pouvoir mettre les déchets en un lieu permettant de garantir la santé des travailleurs et des riverains. Il est certain qu’une partie des déchets devra attendre près de 50 ans pour avoir suffisamment refroidis pour ne pas dégrader la roche protectrice.
QUESTION 424
Posée par NC, le 23/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 9 octobre 2013 - Principes de précaution et réversibilité :
Si problème, qu'elles conséquences ? En gros, quel est le rapport bénéfice/risque ?
Réponse du 06/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les déchets les plus radioactifs destinés à Cigéo sont des déchets dangereux, qui le resteront plusieurs dizaines à centaines de milliers d’années. Ces déchets, produits en France depuis les années 1960, sont actuellement entreposés de manière sûre mais provisoire dans des bâtiments sur leurs sites de production, dans l’attente d’une solution de gestion à long terme. Ces installations d’entreposage ne sont pas conçues pour confiner la radioactivité à très long terme. En cas de perte de contrôle de telles installations, les conséquences radiologiques sur l’homme et l’environnement ne seraient pas acceptables.
Le but du stockage profond est de protéger l’homme et l’environnement de la dangerosité de ces déchets sur de très longues durées. Si Cigéo est autorisé, il donnera ainsi la possibilité aux générations suivantes de mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs. La réversibilité leur permettra également de faire évoluer cette solution si elles le souhaitent.
Pour que le projet puisse être autorisé, l’Andra doit démontrer à l’Autorité de sûreté nucléaire qu’elle maîtrise les risques liés à l’installation, que ce soit pendant son exploitation ou après sa fermeture. Ainsi, conformément au principe de défense en profondeur, tous les dangers potentiels qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation sont identifiés en amont de la conception. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels montre que leurs conséquences resteraient limitées, et nettement en deçà des normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire.
Réponse apportée par Monique Sené, physicienne nucléaire, chercheuse au CNRS, vice-présidente du comité consultatif de l'ANCCLI :
Il est exact que lorsqu’on enterre des fûts dans la terre, inévitablement ils vont se détruire au fil des années : le problème est en combien de temps ? Il faut retarder la sortie des produits présentant un danger radioactif et chimique. Il est probable mais pas certain que par 450 m de profondeur la remontée sera lente . Cependant ce sont les générations suivantes qui seront confrontées au problème. Faut-il mieux leur léguer un site où il est possible d’intervenir ou cacher des produits en site qui ne devra jamais être possible de retrouver. L’expérience montre que rien n’est jamais inaccessible.
QUESTION 423
Posée par Eric SUTRE, le 23/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 9 octobre 2013 - Principes de précaution et réversibilité :
C'est tout de même un peu court de dire "il n'y a pas de solution" ! Serait-ce pour masquer une argumentation scientifique et technique mal assurée ? N'est-ce pas un argument d'autorité, pour se dispenser et dispenser les autres de réfléchir ?"
Réponse du 06/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
De nombreuses solutions pour gérer les déchets radioactifs ont été imaginées depuis 50 ans : les envoyer dans l’espace, au fond des océans ou dans le magma, les entreposer plusieurs centaines d’années en surface ou à faible profondeur, les transmuter… Seul le stockage profond est aujourd’hui reconnu en France et à l’étranger comme une solution robuste pour mettre en sécurité ces déchets à très long terme. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra à l’État après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création du stockage, après plus de 20 ans d’études et de recherches. Ce processus comprendra notamment l’évaluation de la sûreté par l’Autorité de sûreté nucléaire, l’évaluation des recherches scientifiques par la Commission nationale d’évaluation, l’avis des collectivités territoriales, le vote d’une nouvelle loi fixant les conditions de réversibilité et une enquête publique.
Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de ces déchets. Grâce à la réversibilité, ces générations garderont la possibilité de faire évoluer cette solution. L’Andra propose ainsi que des rendez-vous réguliers soient programmés pendant une centaine d’années pour faire le point sur l’exploitation du stockage et préparer les étapes suivantes. Ces rendez-vous seront notamment alimentés par les résultats des recherches qui continueront à être menées sur la gestion des déchets radioactifs et les avancées technologiques. A chaque étape, il sera possible de décider de poursuivre le processus de stockage tel qu’initialement prévu ou de le modifier, par exemple si des solutions alternatives sont identifiées.
Réponse apportée par Monique Sené, physicienne nucléaire, chercheuse au CNRS, vice-présidente du comité consultatif de l'ANCCLI :
Il n’y a pas de solution suffisamment étudiée : il est préférable de s’appuyer sur des entreposages où les bâtiments seront bien conçus et où l’on recueillera tous les effluents tant gazeux que liquides. On pourra faire un suivi des divers conteneurs de déchets, refaire les emballages si nécessaire. Ceci permettra de poursuivre des recherches pour évaluer vraiment l’apport d’un site profond : 13 ans (2000 -2013) sont insuffisants pour avoir des réponses en géologie. L’IRSN qui travaille depuis 1990 sur le site de Tournemire en Ariège n’a pas encore terminé l’étude de certaines expériences commencées il y a plus de 15 ans.
QUESTION 422
Posée par Raymond CHAUSSIN, le 23/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 9 octobre 2013 - Principes de précaution et réversibilité :
Faire croire qu'on a trouvé une solution définitive de la gestion des déchets n'est-ce pas uniquement le but de l'enfouissement pour continuer le tout nucléaire?"
Réponse du 27/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Non, car même si l’arrêt de la production électronucléaire était décidé, cela ne supprimerait pas la nécessité de trouver une solution pour protéger sur le très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets radioactifs existants et de ceux qui seront inévitablement produits par les installations nucléaires existantes et par leur démantèlement, quels que soient les choix énergétiques futurs. 2 700 m3 de déchets de haute activité et 40 000 m3 de déchets de moyenne activité à vie longue sont actuellement entreposés dans l’attente d’une solution de gestion à long terme. Ces déchets ont été produits depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles. Il est de la responsabilité de notre génération de mettre en place une solution de gestion sûre et définitive pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de la gestion de ces déchets sur les générations suivantes.
Monique Sené, physicienne nucléaire, chercheuse au CNRS, vice-présidente du comité consultatif de l'ANCCLI :
Il est certain que le monde nucléaire doit démontrer qu’il est capable de maîtriser les nuisances induites par les installations qui lui sont reliées. Or les déchets sont encore difficiles à gérer : les premiers sites doivent être décontaminés et les premiers déchets doivent être reconditionnés. Ces opérations sont très pénalisantes pour les travailleurs. J’ai toujours pensé qu’on n’aurait dû y penser dès le début et ne construire que ce qu’on était capable de traiter, mais on a pensé : la science résoudra les problèmes et ceci était une grossière erreur. En effet, si les déchets ont été mal conditionnés, leur reprise devient très pénalisante en terme de dose mais aussi en terme de contamination de l’environnement.
QUESTION 420
Posée par Thierry COURILLON, le 23/10/2013
- fréquence d'arrivée des convois ?
- type de déchets par convoi ?
- que faire si emballage HS ?
- volume de déchets par convoi ?
- surveillance, sécurité des convois ?
Réponse du 06/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les opérations de transport des colis de déchets sont réalisées sont la responsabilité des producteurs de déchets (Areva, CEA et EDF).
Si Cigéo est autorisé, le transport des colis de déchets se ferait majoritairement par voie ferrée. Le réseau ferré national permet d’acheminer les convois jusqu’à proximité de Cigéo. La desserte locale de Cigéo est étudiée dans le cadre du schéma interdépartemental de développement du territoire (voir carte). L’arrivée et le déchargement des trains se feraient dans un terminal ferroviaire spécifique. Deux options sont possibles :
- Soit le terminal ferroviaire est implanté sur une voie ferroviaire existante en Meuse ou en Haute-Marne. Le transport final jusqu’à Cigéo serait alors réalisé par voie routière.
- Soit le terminal ferroviaire est implanté sur le site même de Cigéo, ce qui nécessiterait de créer un raccordement ferroviaire d’environ 15 km.
Plus d’information :
Le transport des colis de déchets (chapitre 4.3)
../docs/dmo/chapitres/DMO-Andra-chapitre-4.pdf
Réponse apportée par EDF :
Les déchets à stocker dans Cigéo y seront acheminés par voie ferroviaire. Il y aura en moyenne deux trains de déchets par mois, pendant les 100 années d'exploitation de Cigéo, avec un maximum de deux trains par semaine pendant les périodes les plus chargées. Les convois seront constitués d'environ 10 wagons, chaque wagon transportant un emballage contenant les déchets. Compte tenu des capacités des emballages de transport connues à ce jour, il est estimé, qu'en moyenne, un convoi ferroviaire transporterait environ 30m3 de déchets de moyenne activité à vie longue. Pour les déchets de haute activité, le volume serait de l'ordre 70 m3 de déchets par convoi ferroviaire.
Les emballages dans lesquels seront transportés les déchets sont conçus pour être étanches et le rester même en cas d’accident sévère (collision, incendie, immersion). La fiabilité de ces transports repose sur le respect des règles prévues par le règlement pour le transport des marchandises dangereuses. La conception des emballages de transport et la formation des personnels font partie de ces règles, dont le respect est soumis au contrôle de l'Autorité de Sûreté Nucléaire. Le contrôle de la protection des transports contre les actions de malveillance est, lui, du ressort du Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité auprès du ministre de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie.
Réponse apportée par AREVA :
Les déchets radioactifs HA/MA-VL sont transportés dans des « emballages » de haute technologie et agréés par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN). Le retour d’expérience de plusieurs dizaines d’années confirme le haut niveau de sûreté mis en œuvre : aucun accident ayant eu des conséquences radiologiques n’est à déplorer. La résistance des emballages est testée en conditions extrêmes. En effet, pour les opérations de transport, la sûreté nucléaire repose d’abord sur l’emballage. Les emballages utilisés sont conçus pour assurer la protection des personnes et de l’environnement en toutes circonstances, tant dans des conditions normales que dans des situations accidentelles.
Les emballages destinés aux transports des déchets radioactifs de type HA/MA-VL sont conçus pour être étanches et le rester même en cas d’accident (collision, incendie, immersion…). Leur étanchéité maintenue même en situation extrême permet de prévenir le risque de contamination. Par ailleurs, ces emballages sont composés de plusieurs types de matériaux permettant de réduire les niveaux d’exposition aux rayonnements pour les rendre inferieurs aux limites fixées par la réglementation. Celle-ci établit que la quantité de rayonnements reçus par une personne qui resterait à 2 m du véhicule pendant une heure n’excède pas la limite de 0,1 mSv quel que soit le type de déchets transporté. A titre de comparaison, l’exposition moyenne annuelle de la population française à la radioactivité naturelle est de 2,4 mSv.
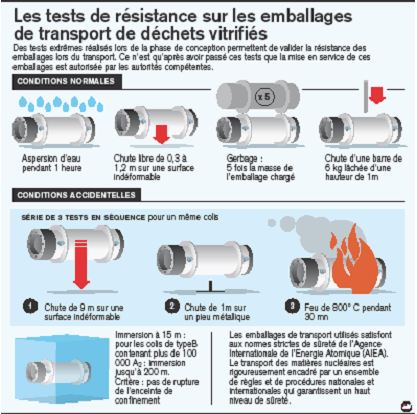
Les transports sont réalisés dans le cadre des réglementations internationales (AIEA, ADR, RID…) et nationales en vigueur. Ces réglementations sont établies en fonction de la nature de la matière transportée et du mode de transport utilisé. En France, l’ASN est responsable du contrôle de la sûreté des transports de substances radioactives pour les usages civils.
Le transport de substances radioactives est assuré par des sociétés spécialisées et autorisées par les autorités compétentes.
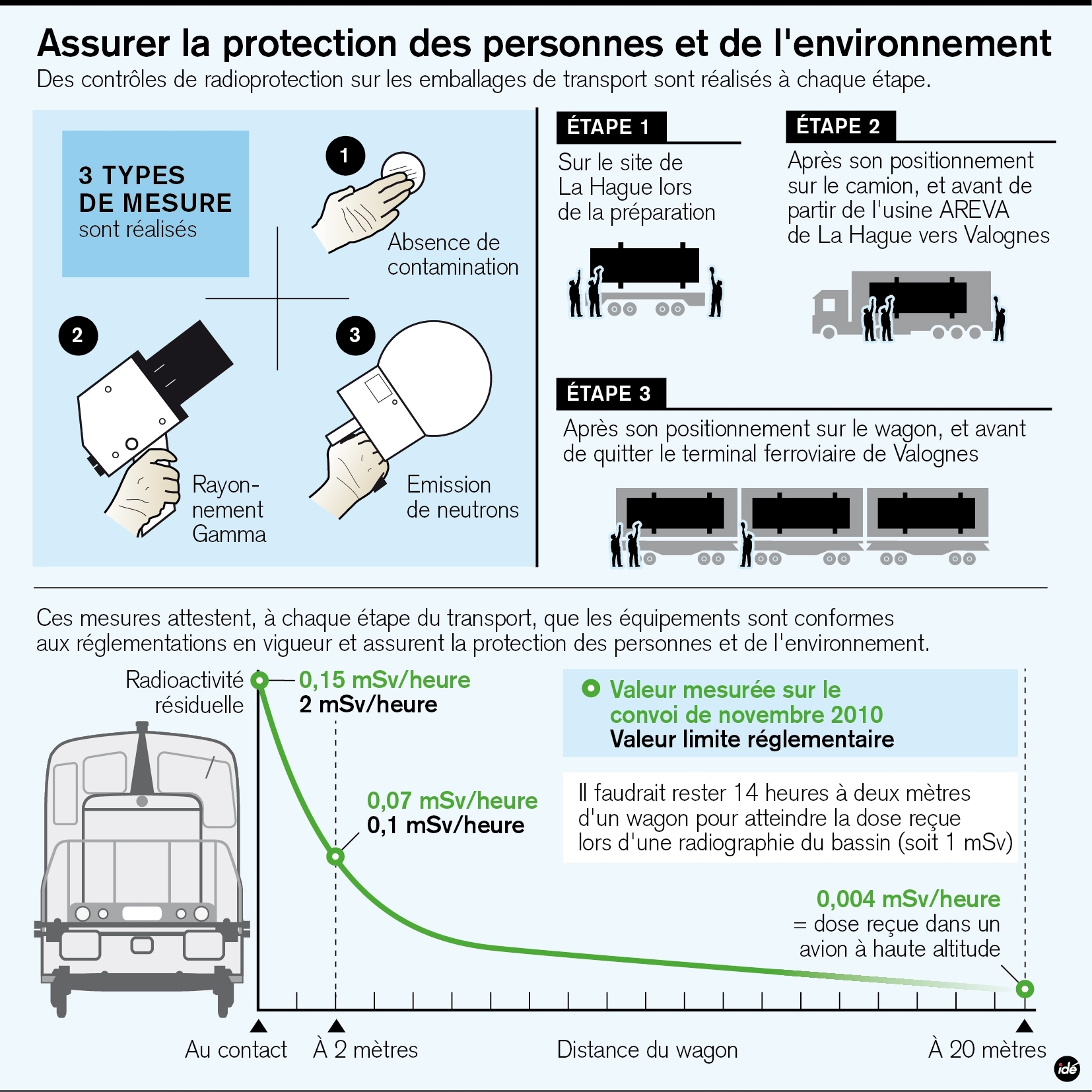
Le niveau de rayonnement et la non-contamination des emballages sont vérifiés par les exploitants et des organismes indépendants à chaque étape du transport, y compris lors de changements de modes de transport. Ces mesures attestent, à chaque étape du transport (cf. figure ci-contre), que les équipements sont conformes aux réglementations en vigueur et assurent la protection des personnes et de l’environnement. Elles peuvent être vérifiées à tout moment et sur le terrain par l’ASN. Le transport en toute sûreté de plus 6000 colis de déchets de Haute Activité et Moyenne activité à vie Longue, principalement par le rail illustre la maîtrise des risques de contamination et d’exposition aux rayonnements.
En complément de ce dispositif de prévention éprouvé, la France a mis en place un dispositif national pour gérer de potentiels accidents. Les autorités s’appuient sur les dispositifs mis en place dans le cadre des plans ORSEC et à leur déclinaison départementale. Les Préfectures sont averties par le Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle de Crises (COGIC) des transports transitant par leur département ; ce dernier assure, entre autres missions, sous l’autorité du Ministère de l’Intérieur, des responsabilités opérationnelles dans le domaine de la gestion et du suivi des transports. AREVA au travers de sa filiale AREVA TN dispose, par ailleurs, d’un plan d’urgence interne spécifique appelé PUI-T. Celui-ci couvre les phases d’alerte, d’analyse de la situation et d’intervention sur le terrain suite à un incident ou un accident de transport de matières radioactives. Il permet à AREVA TN de mettre à la disposition des autorités compétentes des moyens humains spécialisés et des matériels spécifiques. L’ensemble de ce dispositif est testé, en moyenne, chaque année à l’échelon national avec les principaux acteurs et notamment les autorités compétentes.
Les schémas de transport envisagés pour Cigéo sont assez proches de ceux mis en œuvre avec succès depuis plus de 30 ans. En effet, le réseau ferré national est actuellement utilisé pour l’acheminement des emballages de combustibles usés depuis les centrales du parc EDF, jusqu’au terminal ferroviaire de Valognes, situé à 40 km de l’usine de la Hague, puis par la route ; les emballages y sont alors transférés sur des camions pour transport jusqu’au site. Ce flux correspond à environ 200 transports de combustible usé par an. Par ailleurs les déchets HA, MAVL issus du traitement des combustibles usés étrangers transitent également par le terminal ferroviaire de Valognes avant d’être retournés vers leur pays d’origine.
Ce sont ainsi de l’ordre de 800 emballages transférés chaque année au terminal ferroviaire de Valognes correspondant à environ 1 train/par semaine.
Réponse apportée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) :
La sûreté des transports de substances radioactives à usage civil est contrôlée en France par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), sur la base d’inspections et de l’instruction de demandes d’agrément d’emballages. Ce contrôle vise à assurer la protection des personnes et de l’environnement. Il porte sur la conception des emballages et les opérations de transports qui sont soumises à des contraintes réglementaires rigoureuses.
Les emballages doivent notamment assurer un confinement des substances radioactives transportées et fortement réduire le rayonnement à l’extérieur du colis.
De façon plus spécifique, le débit de dose à proximité du véhicule ne doit pas dépasser certains plafonds. En pratique, les niveaux relevés sont en général beaucoup plus faibles que ces plafonds. Même si ces plafonds étaient atteints, une personne devrait rester 10 heures à deux mètres du véhicule pour que le rayonnement reçu atteigne la limite annuelle d’exposition du public.
Concernant les risques en cas d’accident, les modèles de colis sont soumis à des épreuves réglementaires destinées à démontrer leur résistance lors du transport. Le niveau d’exigence de ces épreuves est proportionné à la dangerosité des substances transportées. À titre d’exemple, les modèles de colis correspondant aux substances les plus dangereuses doivent conserver leurs fonctions de sûreté, y compris en cas d’accident (simulé par une chute de 9 m sur une surface indéformable, une chute de 1 m sur un poinçon, un incendie d’hydrocarbure totalement enveloppant de 800° C minimum pendant 30 mn, une immersion dans l’eau à une profondeur de 200 m).
Les autorités se sont naturellement interrogées depuis plusieurs années sur le comportement des colis agréés dans des cas d’agressions allant au-delà de ces épreuves réglementaires décrites précédemment.
Des études ont été menées en France et à l’étranger, notamment par l’IRSN, AREVA, l’autorité allemande BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung) et le laboratoire national américain SANDIA, afin d’évaluer le comportement des colis contenant des substances radioactives dans des conditions réalistes d’impact mécanique et de feu et pouvant aller au-delà des sollicitations prévues par les épreuves réglementaires. Ainsi, la tenue de ces types de colis dans des conditions de feu plus contraignantes (en termes de durée et de température) et dans des conditions de chute plus contraignants (en matière de surface d’impact et de hauteur de chute) a été étudiée. Par exemple, une étude de l’IRSN consultable sur le site Internet de l’institut permet de comparer l’écrasement du colis sur une surface indéformable, comme prévu dans les épreuves réglementaires et sur des surfaces représentatives de cibles réelles : par exemple des sols en sable, argile ou des cibles métalliques représentatives de l’environnement des emballages durant le transport dont l’essieu de wagon et le longeron de wagon. Cette étude a montré que les colis considérés dans l’étude conserveraient leur capacité de confinement en cas d’accident réel et que leurs équipements additionnels (châssis et râtelier) ainsi que les cibles absorberaient une part importante de l’énergie d’impact et augmenteraient ainsi les marges de sûreté.
En France, aucun accident ferroviaire ayant impliqué des colis de combustible usé n’a à ce jour été relevé. Néanmoins, cette éventualité est envisagée par les pouvoirs publics.
Ainsi, la dernière ligne de défense de la sûreté des transports de substances radioactives repose sur les moyens d’intervention mis en œuvre face à un incident ou un accident. Les pouvoirs publics, l’ASN et les exploitants se préparent donc à la gestion des situations de crise impliquant un transport de substances radioactives à travers les plans ORSEC et au moyen d’exercices.
Réponse apportée par Guillaume Blavette, association Haute Normandie Nature Environnement :
- Fréquence d'arrivée des convois ?
Des convois arriveront chaque semaine, voire chaque jour, sur le site tout au long de la phase d'exploitation. Il est impossible à ce jour d'apporter de réponse plus précise.
- Type de déchets par convoi ?
Il ne sera possible de répondre à cette question que quand nous disposerons d'un inventaire précis des matières destinées à être stockées à Bure. Le HCTISN comme l'ASN regrettent les imprécisions des informations fournies à ce jour par l'ANDRA.
Cependant, il convient de ne pas oublier qu'en principe Cigéo est destiné à accueillir les déchets les plus nocifs et les plus durables accumulés depuis cinquante ans sur les principaux sites d'AREVA, du CEA et d'EDF. Ce sont des déchets dits de haute et moyenne activité à vie longue pour l'essentiel. Mais quelques déchets opportunément classés "faible activité" pourraient eux aussi être enfouis à Bure.
Somme toute, le trou de Bure a pour l'ANDRA vocation à recevoir tout ce dont les exploitants nucléaires ne veulent plus parce que leur gestion est contraignante et leur hypothétique valorisation hors de prix. Cigéo est le tonneau des danaïdes d'une industrie prodigue en déchets durablement nocifs.
- Que faire si emballage HS ?
La défaillance des emballages est un des problèmes majeur du projet. L'ANDRA assure que les colis seront strictement contrôlés, voire renvoyés à l'expéditeur s'ils ne présentent pas de garanties de sureté suffisantes pour envisager leur stockage. On peut cependant imaginer à la lumière des déclarations du maitre d'ouvrage que des déchets seront "conditionnés" sur place, dans des installations de surface. Mais Nous ne disposons que de trop peu d'information à ce sujet.
En tout cas une chose est certaine. La sureté du projet Cigéo repose pour grande part sur la qualité et la pérennité de "l'emballage" des déchets destinés à être enfouis. Or de nombreux aléas peuvent porter atteinte à l'intégrité des colis.
Le premier d'entre eux est le temps puisque certains colis sont déjà anciens. D'aucuns peuvent douter de l'efficience du confinement des matières radioactives après plusieurs décennies d'entreposage. De la sorte il est impératif de contrôler chaque colis avant son expédition.
Le second aléas est le transport. Un incident n'est jamais à exclure ne serait ce qu'un modeste problème de manutention. Cela implique donc un second contrôle des colis sur site.
Toujours est il, que ce soit chez les expéditeurs ou sur les sites de l'ANDRA, il convient aujourd'hui de garantir la qualité des emballages, première barrière protégeant l'environnement de la nocivité des matières radioactives. L'enjeu est de taille. Il s'agit d'éviter que les installations de stockage ne pollue l'environnement et menace la santé des riverains.
Avant de s'aventurer dans le projet Cigéo, l'ANDRA devrait d'abord veiller au confinement des déchets entreposés en France et effectuer les travaux sur ces installations notamment à Digulleville.
- Volume de déchets par convoi ?
Si on s'en tient aux déclarations du maitre d'ouvrage, le "transport par voie ferroviaire est privilégié" et précise que "cela représenterait au maximum une centaine de trains par an (avec une dizaine de wagons par train), soit de l’ordre de deux trains par semaine en pic, avec une moyenne de deux trains par mois sur la durée d’exploitation."
En considérant que ces trains transporteraient des déchets vitrifiés de haute activité à vie longue, il est possible de les comparer avec les convois de déchets allemands qui ont traversé la France au cours des dernières années.
Le convoi organisé en 2011 comprenait 11 wagons transportant un colis de type « Castor HAW 28 M » contenant chacun 28 canisters CSD-V (conteneur de déchets vitrifiés), sauf le dernier colis qui n’en contient que 21. Un canister CSD-V permet de conditionner 56 kg de produits de fission dans une matrice de verre au sein d’un conteneur métallique. La masse totale d’un CSD-V est de 490 kg dont 400 kg de verre. Ces 28 canisters CSD-V correspondent - aux déchets de haute activité et à vie longue issus du retraitement de plus de 80 assemblages combustibles (soit la moitié du coeur d'un réacteur de 900 MWe). Le cumul de la radioactivité de ce transport s’élevait à 3756,5 péta becquerels (Pbq), soit 3,75 milliards de milliards de becquerels. En comparant l’ensemble des radioéléments d’une période de vie supérieur à un an, ce convoi représente dix fois les rejets de Tchernobyl ! (total Tchernobyl / plus d’un an = 260 PBq)
Un des deux laboratoires indépendants en France en la matière, l'Association pour le contrôle de la radioactivité de l'Ouest (ACRO), a jugé que la radioactivité du convoi de déchets nucléaires allemands n'était pas anodine.
Les valeurs, relevées par le laboratoire sur le convoi, respectent la réglementation sur les transports des matières radioactives mais elles sont loin d’être anodines pour des convois qui circulent et stationnent dans des lieux où des personnes du public peuvent être présentes.
Le laboratoire a pu, pour la première fois, effectuer des relevés sur un convoi de déchets nucléaires, sous l'égide de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) qui habituellement confie ce travail uniquement à l'IRSN (Institut national de radioprotection). A 2 mètres d'un wagon, les niveaux d'exposition sont respectivement de 150 fois la radioactivité naturelle en termes de rayon gamma et 2.500 fois en termes de neutrons, a précisé Pierre Barbey, de l'ACRO, à l'AFP.
A 31 mètres, les niveaux d'exposition sont respectivement 100 fois supérieurs à la radioactivité naturelle en termes de rayonnement neutroniques et 5 fois en termes de rayon gamma. L'ACRO estime que la population devrait être informée du passage de ces convois radioactifs dans ses communes et s'inquiète en particulier du sort des cheminots. Il y a un an, sur un convoi similaire, l'association avait constaté que, contrairement aux forces de l'ordre qui accompagnent les convois, les cheminots ne portaient pas de dosimètres, selon le communiqué.
Un cheminot (qui est assimilé à une personne du public) qui passerait une dizaine d’heures par an à 2 m de tels wagons dépasserait le seuil maximum de 0,3 mSv/an recommandé par la Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR) pour une exposition à une même source radioactive, selon l'Acro.
QUESTION 419 - Vous rendez vous compte?
Posée par Brice MABIRE, HUMAIN, le 22/10/2013
Le fait même qu'après 40ans d'exploitation nous ne trouvions comme solution que l'enfouissement des déchets prouve qu'il est pressant de sortir du nucléaire. Comment quelques dizaines d'années de production d'électricité pourraient justifier tous ces moyens? Gâchés!?
Réponse du 11/02/2014,
Réponse apportée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
En France, le nucléaire occupe une place prépondérante dans le mix électrique, assurant près de 75% de la production française d’électricité. L’utilisation de l’énergie nucléaire a apporté durant plusieurs années un bénéfice important à la France, du point de vue économique tant par une filière industrielle de premier plan mondial que par des prix de l’électricité parmi les plus bas d’Europe et du point de vue environnemental, par des émissions de gaz à effet de serre également parmi les plus basses d’Europe.
Compte tenu de la durée nécessaire à la construction de moyens de production d’électricité de substitution, un arrêt à court terme de l’ensemble du parc nucléaire n’est pas envisageable sans remettre en cause l’approvisionnement électrique du pays, c’est à dire sans coupures très importantes d’électricité pour les consommateurs. Il apparaît donc extrêmement difficile de ne plus produire de nouveaux déchets radioactifs provenant de l’industrie électronucléaire à très court terme.
Depuis plusieurs dizaines d’années, la France a mis en place une politique de gestion responsable de ses déchets radioactifs. En 2006, après quinze années de recherches encadrées par la loi « Bataille », d’avis des évaluateurs et d’un débat public, le Parlement a fait le choix du stockage réversible profond pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations futures.
La question des coûts de long terme du nucléaire et du mécanisme de leur financement a été traitée dans le rapport de la Cour des Comptes de 2012 (../docs/docs-complementaires/docs-avis-autorites-controle-evaluations/rapport-thematique-filiere-electronucleaire.pdf), qui indique que le coût du stockage des déchets est de l’ordre de 1 à 2 % du coût du kWh d’électricité.
Enfin, en matière de mix électrique, le Président de la République a fixé le cap suivant pour la France : réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% d'ici 2025. Parallèlement, le Président de la République a indiqué que la transition énergétique serait fondée sur deux principes : l'efficacité énergique d'une part, et la priorité donnée aux énergies renouvelables d'autre part. Cette mutation prendra du temps et supposera des étapes d’évaluation en fonction des progrès technologiques et scientifiques et des prix relatifs de chaque source d’énergie.
QUESTION 418
Posée par NC, le 22/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 9 octobre 2013 - Principe de précaution et réversibilité :
Comment on fera si un déchet, placé tout au fond d'une galerie commence à fuir et qu'on veut le récupérer?
Réponse du 10/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les déchets livrés par les producteurs seront contrôlés par l’Andra pour s’assurer de leur état et du respect des exigences techniques pour leur stockage (non contamination, confinement…). Ils seront stockés dans des conteneurs épais, en acier ou en béton, prévus pour résister aux incidents d’exploitation qui pourraient survenir dans l’installation (par exemple une chute ou un incendie). Ces colis de stockage sont conçus pour rester intègres pendant toute la durée d’exploitation de Cigéo. Les galeries dans lesquelles les colis seront stockés (appelées alvéoles de stockage) seront surveillées pour contrôler leur évolution dans le temps.
Pour retirer un colis placé tout au fond d’une alvéole de stockage, si une telle opération était jugée nécessaire, il serait nécessaire de retirer au préalable les colis placés devant celui-ci et de les transférer dans une autre alvéole, avant de retirer le colis ciblé. Si ce colis est contaminé ou détérioré, des précautions particulières seraient prises pour son transfert dans les installations et des opérations spécifiques seraient mises en œuvre (par exemple décontamination ou reconditionnement). L’opération de retrait, qui pourrait nécessiter plusieurs mois après son autorisation pour vider une alvéole longue, ne serait pas réalisée dans l’urgence. En effet, les alvéoles de stockage assurent pendant l’exploitation un second système de confinement en cas de défaillance du confinement assuré par les colis.
Réponse apportée par Monique Sené, physicienne nucléaire, chercheuse au CNRS, vice-présidente du comité consultatif de l'ANCCLI :
Si la galerie est close il faudra rouvrir : ces opérations n’ont pas encore été étudiées.
Et au fur et à mesure du remplissage ce sera de plus en plus difficile. En effet ce sont des colis très radioactifs, il faut donc tenir compte de ce problème et travailler avec des robots pour préserver les humains. Cette récupérabilité des colis est encore en étude.
Dernier point, lorsqu’on approchera du remplissage des dernières galeries on ne pourra plus revenir en arrière.
QUESTION 417
Posée par Christian VARETTE (TOURLAVILLE), le 21/10/2013
Pourquoi stocker les déchets en métropole et non pas au centre de la Guyane département quasi inhabité?
Réponse du 02/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le stockage profond devant assurer la protection de l’homme et de l’environnement sur le très long terme, ce sont les caractéristiques géologiques qui sont considérées pour la recherche de site. Ainsi, le choix du site de Meuse/Haute/Marne est le résultat de nombreuses années de recherches scientifiques et de reconnaissances géologiques qui ont permis de démontrer qu’il présentait des caractéristiques favorables à l’implantation d’un tel stockage. Suite au vote de la loi de 1991, des recherches ont été menées en France pour implanter un laboratoire souterrain. Plusieurs sites se sont portés candidats et ont été étudiés, dont les départements de Meuse et de Haute-Marne. En 1999, après l’évaluation scientifique du site, la consultation des collectivités locales et une enquête publique, le Gouvernement a autorisé l’Andra à construire un laboratoire souterrain à la limite entre les deux départements de Meuse et de Haute-Marne pour étudier la couche d’argile du Callovo-Oxfordien. En s’appuyant sur l’ensemble des recherches menées sur le site depuis 1994, l’Andra a montré qu’il présente des caractéristiques favorables pour assurer la sûreté à long terme du stockage. La Commission nationale d’évaluation mise en place par le Parlement pour évaluer sur le plan scientifique les travaux de l’Andra souligne ainsi dans son rapport 2012 : « le site géologique de Meuse/Haute-Marne a été retenu pour des études poussées, parce qu’une couche d’argile de plus de 130 m d’épaisseur et à 500 m de profondeur, a révélé d’excellentes qualités de confinement : stabilité depuis 100 millions d’années au moins, circulation de l’eau très lente, capacité de rétention élevée des éléments ».
QUESTION 416 - géologie
Posée par pierre ROBIN, L'organisme que vous représentez (option) (WISSOUS), le 16/10/2013
L'argile étant un milieu favorable à la rétention des radionucléides et le bassin parisien étant sismiquement très stable, Bure est parmi les sites de stockage européens favorables. L'Europe se construisant politiquement, ne peut-on pas imaginer que Bure devienne un centre européen de stockage? Cela permettrait de ne pas courir de risque avec un "mauvais" stockage étranger à nos frontières.
Réponse du 05/12/2013,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Le centre de stockage en projet Cigéo ne deviendra pas un centre européen de stockage. Depuis la loi de 1991, le Parlement a interdit le stockage en France de déchets radioactifs en provenance de l’étranger. Cette interdiction figure aujourd’hui à l’article L. 542-2 du Code de l’environnement Cette législation est cohérente avec la directive européenne du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre des combustibles usés et des déchets radioactifs, qui réaffirme la responsabilité de chaque État dans la gestion de ses déchets radioactifs.
QUESTION 415 - Activité d'ingénierie - SIDT page 14
Posée par Jean-Bernard HERGOTT, CCI HAUTE-MARNE (SAINT-DIZIER), le 15/10/2013
Le SIDT page 14 inscrit l’implantation locale d’activités d’ingénierie en lien avec la sous-traitance parmi les quatre propositions visant à développer l’excellence dans les métiers du nucléaire et des travaux souterrains. Comment l’ANDRA envisage-t-elle de mettre en œuvre cette proposition ?
Réponse du 30/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’ambition inscrite dans le schéma interdépartemental de développement du territoire en faveur de l’implantation locale d’activités d’ingénierie en lien avec la sous-traitance est une action de fond à laquelle s’attachent tant les services de l’Etat que les organismes consulaires ou les industriels de la filière nucléaire et l’Andra. Elle vise à favoriser le rapprochement entre les ingénieries et les entreprises qui interviennent sur les marchés de l’Andra et des producteurs d’énergie. Elle mobilise des actions collectives promues par l’Etat et associant les entreprises souhaitant entrer dans la démarche ; elle est soutenue par les initiatives des industriels (voir par exemple le cahier d’acteurs de la société d’ingénierie ALORIS et celui d’Energic 52-55). La faisabilité de créer un pôle de compétences sur les métiers liés aux travaux souterrains est étudiée par le GIP Objectif Meuse et la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de la Meuse. L’Andra et Areva sont associés à ces réflexions.
QUESTION 414 - Rapport parlementaire de MM. BOUILLON et AUBERT
Posée par Jean-Bernard HERGOTT, CCI HAUTE-MARNE (SAINT-DIZIER), le 15/10/2013
Le rapport d’information parlementaire de MM Christophe BOUILLON et Julien AUBERT, présenté le 3 juillet dernier, propose la création d’une zone d’intérêt nationale qui « traduira la confiance collective nationale dans l'avenir de ce territoire (Meuse Haute-Marne) et la volonté de réaffirmer sa place au cœur d'un avenir partagé ». Quelle est la position de l’Etat sur la proposition des parlementaires de créer une zone d’intérêt nationale ?
Réponse du 05/12/2013,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Concernant les déchets les plus radioactifs, le rapport d’information parlementaire de MM Christophe BOUILLON et Julien AUBERT de 2013, propose de créer une « Zone d’intérêt National » (ZIN), afin de marquer la reconnaissance de la nation vis-à-vis des territoires accueillant, s’il est autorisé, le projet Cigéo.
En accueillant, sous réserve d’autorisation, les déchets les plus radioactifs, le projet Cigéo présente un enjeu majeur pour la France. L’insertion du projet Cigéo dans le contexte territorial, afin de permettre et faciliter son implantation et son développement, revêt donc une importance toute particulière. Le gouvernement a également à cœur de garantir que le projet Cigéo soit porteur de développement économique pour les territoires qui l’accueillent. Il s’attache à ce que l’industrie nucléaire poursuive et intensifie l’accompagnement économique autour d’une opération industrielle essentielle et structurante.
L’ensemble de ces questions sont discutées avec les territoires dans un comité de haut niveau, qui se réunit annuellement sous la présidence du ministre chargé de l’énergie. Il examinera prochainement les outils de gouvernance appropriés pour assurer le développement des territoires concernés. La création d’une zone d’intérêt national fait bien sûr partie des choix possibles.
QUESTION 413 - Question complémentaire à la question n°168
Posée par Jean-Bernard HERGOTT, CCI HAUTE-MARNE (SAINT-DIZIER), le 15/10/2013
Qui sera en charge de la mise en œuvre du schéma interdépartemental de développement, quelle en sera la gouvernance ?
Réponse du 27/11/2013,
Réponse apportée par le Directeur du Schéma Interdépartemental de Développement du Territoire :
La mise en place d'un Schéma Interdépartemental de Développement du Territoire a été décidée lors du Comité de Haut Niveau de 2009 (instance présidée par le ministre en charge de l'énergie et qui réunit les parlementaires et les présidents des Conseils généraux de Meuse et de Haute-Marne, ainsi que l'Andra et les entreprises qui participent à l'accompagnement économique du Laboratoire de Bure). Son élaboration sous l’égide de la préfecture de la Meuse a pu démarrer en 2011 grâce à la mise à disposition d’un cadre par l'Etat. Dans un contexte de décentralisation et de compétences d'aménagement du territoire et de développement économique qui sont dévolues aux collectivités locales, l'implication de l'Etat dans le développement du territoire autour de l'implantation de Bure-Saudron, démontre son intérêt pour l'intégration du projet industriel dans les contextes environnementaux et sociaux. Comme dans tout projet de développement de territoires, la maîtrise d'ouvrage des opérations revient à chacun selon son domaine de compétences, Etat, collectivités locales, opérateurs publics ou privés, dans une gouvernance partagée au sein de laquelle les enjeux et les orientations de développement sont communs. Dans le cadre de cette gouvernance partagée, les modalités de financement des investissements seront définies au cas par cas.
La mise en œuvre du Schéma Interdépartemental de Développement du territoire passe en effet par une évolution de la gouvernance du projet de territoire, qui tient compte des investissements à réaliser, ainsi que du point de vue des communes et intercommunalités les plus impactées par les développements envisagés. Lors du dernier Comité de Haut Niveau, la Ministre de l'Ecologie du Développement Durable et de l'Energie a demandé à Madame la préfète de la Meuse, préfète coordinatrice, de faire des propositions à l'issue du débat public sur la gouvernance du développement territorial qui serait impacté par Cigéo. Pour mettre en œuvre les actions préalables (anticipation, planification) à l'arrivée de Cigéo, dans son calendrier prévisionnel, elle a également décidé de renforcer les moyens que l'Etat met à disposition dans une mission spécifique, à l'instar de ce qui se fait pour l'accompagnement des grands chantiers sur le territoire national.
QUESTION 412 - Question complémentaire à la question n° 166
Posée par Jean-Bernard HERGOTT, CCI HAUTE-MARNE (SAINT-DIZIER), le 15/10/2013
Pourquoi le campus national SOMET ne s’appuie-t-il pas aussi sur la Champagne-Ardenne au travers ses structures d’enseignement et la contractualisation Etat/Région ?
Réponse du 05/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le campus national SOMET est une Infrastructure de recherche, labellisée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Elle se compose, à ce jour, de trois équipements de recherche de l’Andra : le Laboratoire souterrain, l'Observatoire pérenne de l'Environnement (OPE) et l’Ecothèque. A ce titre, les recherches qui y sont associées peuvent faire et font appel aux compétences des universités de Champagne-Ardenne, comme en témoigne la chaire industrielle à Troyes, en cours de montage et qui devrait notamment porter sur les capteurs en milieu souterrain et sur l'analyse de leurs résultats pour l'aide à la décision.
L'Andra souhaite compléter cette infrastructure SOMET avec une station pédagogique pouvant accueillir des étudiants en maîtrise et des élèves ingénieurs, qui pourront ainsi bénéficier, dans le cadre de stages, de ces équipements exceptionnels. Cette station pédagogique a vocation à être ouverte à l'ensemble des formations universitaires et des grandes écoles du territoire national, voire européen, comme le sont par exemple les stations pédagogiques sur la biologie marine. L’Andra s’y emploie en cherchant notamment l’appui des différentes entités régionales liées au site de Cigéo. Les premières réflexions sur ce projet ont porté sur l'enseignement des disciplines aujourd'hui au cœur des activités de recherche de l'Andra, les Géosciences, qui sont principalement représentées en Lorraine et peu en Champagne-Ardenne. Cependant, la participation de la région Champagne-Ardenne à la définition des programmes pédagogiques puis à l'activité de cette station pédagogique est bien évidemment recherchée et souhaitée, par exemple dans le domaine du Génie et du Management de l'Environnement, ainsi que de l'aménagement des territoires, thématiques développées aussi bien à Reims qu'à Troyes.
QUESTION 411 - Exigence de territorialité
Posée par Jean-Bernard HERGOTT, CCI HAUTE-MARNE (SAINT-DIZIER), le 15/10/2013
Le territoire ne pourra se mobiliser que s’il existe un débouché certain sur des commandes. En conséquence, les fournisseurs doivent répondre à une exigence de territorialité. L’exigence de territorialité est inscrite dans le SIDT page 14. Sera-t-elle inscrite dans les appels d’offres de l’ANDRA ?
Réponse du 06/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’Andra mène depuis plusieurs années une politique volontariste visant le développement des relations avec le tissu économique local. Depuis quatre ans, cette politique est rythmée notamment par la manifestation annuelle « Devenez prestataire de l’Andra » qui est destinée aux PME locales. Ces rencontres permettent aux entreprises de se familiariser avec les exigences et les procédures de l’Andra et de se préparer aux marchés futurs. L’association Energic ST 52/55, qui fédère des entreprises de l’énergie et du BTP, contribue également à valoriser les compétences et entretient une relation partenariale avec l’Andra.
Cette politique conjointe s’avère payante. En 2011, les deux régions ont émis 10 % du montant total des facturations (HT) liées au projet Cigéo. Cela représente une collaboration avec plus de 250 établissements locaux (publics ou privés), implantés pour 60 % d’entre eux en Lorraine et 40 % en Champagne-Ardenne. Les départements de Meuse et de Haute-Marne regroupent chacun 30 % du total des établissements concernés. Des incitations à recruter localement seront demandées aux entreprises impliquées pendant la phase de construction de Cigéo tout en respectant les dispositions règlementaires de passation des marchés. Ainsi, au niveau de ses commandes et de ses contrats, l’Andra prévoit des règles d’équité sous forme de clauses destinées à juger de la valeur sociale des offres qui lui permettront notamment de prendre en compte le recours à l’emploi local et la formation des acteurs locaux.
Ces mesures ont déjà fait leurs preuves pour le Laboratoire souterrain et les Centres de l’Andra dans l’Aube. Leurs activités ont généré annuellement plusieurs millions d’euros de commandes à des entreprises locales (Meuse, Haute-Marne, Aube). En 2012, dans les Centres de l’Aube, plus de 35% des commandes ont été passées à des entreprises locales. Il en résulte que le nombre d’entreprises locales travaillant avec l’Andra et donc capables de travailler avec l’Andra à l’avenir augmente. La pratique montre également que les grands groupes qui répondent à nos appels d’offres ont souvent recours à des co-traitants, antennes ou filiales locaux.
QUESTION 410 - sécurité
Posée par Marine BERNARD, L'organisme que vous représentez (option) (VARENNES SUR AMANCE), le 15/10/2013
Nul n'est à l'abri d'une nouvelle guerre mondiale ou d'un acte de terrorisme, pensez vous que la sécurité de Cigéo serait maintenue dans ces cas ?
Réponse du 27/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Du fait de son implantation à 500 mètres de profondeur, le stockage est une installation peu vulnérable. En particulier, après sa fermeture, le stockage sera complètement inaccessible à toute agression depuis la surface. Les installations de surface, nécessaires pendant la phase d'exploitation pour le contrôle et la préparation des colis de stockage, sont conçues pour protéger les opérateurs et les riverains des différents risques qui peuvent survenir. En particulier, le risque de malveillance est pris en compte par l'Andra. Des dispositions appropriées (contrôle des accès, gardiennage, résistance des bâtiments…) sont prévues pour assurer la protection des installations. Comme pour toute installation nucléaire, ces dispositions sont contrôlées par le Haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère en charge de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Pour être autorisées, les installations de Cigéo - en surface et en souterrain - devront répondre aux exigences des autorités de contrôle, qui ont été renforcées suite aux attentats de 2001.
QUESTION 409 - solution
Posée par Marine BERNARD, L'organisme que vous représentez (option) (VARENNES SUR AMANCE), le 15/10/2013
Concernant ceux qui sont contre la solution d' un stockage géologique en profondeur, quelle meilleure(s) solution(s) proposeriez-vous ?
Réponse du 27/11/2013,
Réponse apportée par Bertrand Thuillier, docteur ès sciences :
L'entreposage en surface ou en sub-surface permet une surveillance, des interventions en cas de problèmes, et des retraits en cas de solution alternative que le stockage souterrain ne permet pas en raison des accès et des ouvertures, par définition, limités, voire impossibles.
L’entreposage à sec à proximité des lieux de production, d’une durée de 200 à 300 ans renouvelables, est déjà la solution adoptée et éprouvée aux Etats-Unis, par exemple dans le démantèlement de la centrale de Surry, y compris pour ses combustibles usés.
Dans mon esprit, il apparaît que l'enfouissement ne devrait être que l'ultime solution pour solder la question de ces déchets après avoir terminé les cycles de production de ces déchets afin d'avoir une visibilité sur la nature et les quantités de ces derniers, mais également après avoir pu réellement évacuer toute solution alternative de neutralisation ou de valorisation, et enfin, après avoir réellement testé les questions de sécurité et de scellement des installations à prévoir ; ceci n'est toujours pas le cas, selon la Commission Nationale d'Evaluation, et d'après également les travaux de la NEA (Nuclear Energy Agency).
QUESTION 408
Posée par Richard DUDLEY, le 15/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 23 septembre 2013 - Les expériences internationales :
Je ne pense pas que la France soit le premier pays à vouloir un stockage profond. Qui le fait déjà?
Réponse du 27/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Aux Etats-Unis, le WIPP (Waste Isolation Pilot Plant) stocke depuis une dizaine d’années, à environ 700 m de profondeur dans une formation géologique de sel, des déchets de moyenne activité à vie longue (MA-VL) issus des activités de défense américaines. En Finlande et en Suède, les demandes d’autorisation de création de centres de stockage dans le granite pour les combustibles usés sont en cours d’instruction. De nombreux autres pays mènent également des recherches en vue de la mise en œuvre d’un stockage profond (Allemagne, Belgique, Canada, Chine, Japon, Royaume-Uni, Suisse…). L’Union européenne considère également que le stockage géologique constitue actuellement la solution la plus sûre et la plus durable en tant qu’étape finale de la gestion des déchets de haute activité (directive européenne du 19 juillet 2011).
Réponse apportée par Jean-Marie Brom, physicien nucléaire, universitaire et chercheur :
Aucun pays nucléarisé n'enfouit actuellement ses déchets nucléaires. Sous différentes formes, ces déchets sont actuellement stockés et surveillés en surface, ou à faible profondeur. Il s'agit de stockages temporaires, et donc par nature réversibles complètement.
La plupart des pays envisagent cependant d'enfouir leurs déchets nucléaires. Les pays les plus "avancés" dans ce domaine sont clairement la Finlande, la Suède et la France. Avec une différence essentielle : Il n'y a qu'en France où l'on prévoit d'enfouir de façon définitive les déchets issus du retraitement. Dans les autres pays, il s'agit d'un stockage souterrain complètement réversible de combustibles irradiés dans les centrales nucléaires.
Quelques exemples :
En Suède (10 réacteurs et décision prise d'arrêter le nucléaire), le lieu d'un tel stockage a été identifié, les demandes d'autorisations sont en cours depuis deux ans environ.
Aux Etats-Unis (104 réacteurs), la décision a été prise de stocker les combustibles irradiés à sec dans des galeries creusées à flanc de montagne. Après plusieurs années de négociations, le site prévu des Yucca Mountains a été abandonné, et les USA ont relancé un processus pour trouver un lieu approprié… et accepté par la population. Pour le moment, les combustibles sont stockés dans des fût en béton sur le site des centrales.
La Finlande (4 réacteurs) envisage de stocker ses combustibles sur l'Ile d’Olkiluoto, à 300m de profondeur. Les travaux sont en cours.
Encore une fois : les projets existent, mais aucun pays n'est encore passé au stade effectif de l'enfouissement souterrain des déchets. Les projets les plus optimistes prévoient le début de l'enfouissement pour les années 2025 à 2030. Le problème principal auquel se heurtent les projets actuels tient dans la difficulté de convaincre les populations locales de la sécurité pour des périodes très longues (les projets finlandais et suédois prévoient des durée 100 000 ans…).
Il est dommage qu'en France, on commence à se préoccuper de l'avis des populations concernées après que la décision ait été prise, et actée par la loi.
QUESTION 407
Posée par Michel GUERITTE, le 15/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 23 septembre 2013 - Les expériences internationales :
La maîtrise des risques est un vaste mensonge : par erreur : l'ANDRA a stocké à Morvilliers des grenades de la Guerre 14. L'ANDRA a stocké à Soulaines des détecteurs de fumée en provenance de Valduc... Merci
Réponse du 05/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La maîtrise des risques consiste à concevoir des installations robustes pour gérer de manière sûre les incidents qui peuvent survenir dans toute activité industrielle. Les incidents que vous mentionnez n’ont eu aucune conséquence pour l’homme et l’environnement. L’Andra a informé immédiatement et en toute transparence la commission locale d’information et la presse.
http://www.andra.fr/download/andra-aube-fr/document/communiques_de_presse/22102012.pdf.
http://www.andra.fr/download/andra-aube-fr/document/communiques_de_presse/reprise_activites_cstfa_2011.pdf.
Réponse apportée par Jean-Marie Brom, physicien nucléaire, universitaire et chercheur :
Le problème n'est pas tant de "savoir" stocker que d'être capable de savoir ce que l'on stocke et de surveiller correctement. D'être capable aussi de revenir sur une décision prise dans une certaine ignorance scientifique, sous la contrainte de lois extrêmement permissives. Mais je préfère laisser l'ANDRA vous répondre.
QUESTION 406
Posée par Michel GUERITTE, le 15/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 23 septembre 2013 - Les expériences internationales :
Avant de vouloir stocker à 500m sous terre, il faudrait d'abord apprendre à entreposer en surface, non?
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par LE COMMISSARIAT À L’ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES (CEA) :
L’entreposage des déchets radioactifs dans des installations nucléaires dédiées représente une expérience industrielle de plusieurs décennies des exploitants nucléaires CEA, AREVA et EDF. Il en va de même à l’international. Les exploitants nucléaires sont ainsi responsables d’installations d’entreposage, soumises aux autorisations, inspections et contrôles des autorités de sureté nucléaires civiles et défense. L’Autorité de sûreté nucléaire édite ainsi régulièrement les bilans de ses inspections. Le CEA, exploitant nucléaire, édite annuellement, conformément à la loi TSN, un rapport public sur le bilan des activités menées sur ses centres, dont les installations d’entreposage de déchets.
Réponse apportée par AREVA :
Dans l’attente de la mise en service de Cigéo les colis de déchets HA et MA-VL déjà produits sont provisoirement entreposés à sec dans des bâtiments sur leur site de production, principalement à La Hague (Manche), Marcoule (Gard), Cadarache (Bouches-du-Rhône) et, pour un volume limité, à Valduc (Côte-d’Or). Une installation d’entreposage pour certains déchets issus de l’exploitation et du démantèlement des réacteurs est en cours de construction sur le site de Bugey (Ain). Il est important de rappeler que 30 % des déchets HA et 60 % des déchets MA-VL destinés à Cigéo sont déjà produits. Ils sont donc entreposés de manière sûre, pour certains déchets depuis plusieurs décennies dans des installations d’entreposage dédiées. A titre d’exemple les déchets vitrifiés sont entreposés en toute sûreté à La Hague depuis plus de 20 ans.
Les entreposages ne sont donc que des briques d’une solution globale de gestion des déchets radioactifs issus de la production électronucléaire. Cigéo en étant la dernière.
Le concept retenu pour ces installations est modulaire ; il permet d’étendre progressivement la capacité actuelle.
L’inauguration récente de l’installation d’entreposage de déchets vitrifiés « EEVLH » illustre cette modularité et la flexibilité opérationnelle associée. Cette installation d’une durée de vie d’une centaine d’année vient ainsi compléter les capacités aujourd’hui disponibles sur le site de la Hague.
Réponse apportée par Jean-Marie Brom, physicien nucléaire, universitaire et chercheur :
Le problème n'est pas tant de "savoir" stocker que d'être capable de savoir ce que l'on stocke et de surveiller correctement. D'être capable aussi de revenir sur une décision prise dans une certaine ignorance scientifique, sous la contrainte de lois extrêmement permissives. Mais je préfère laisser l'ANDRA vous répondre.
QUESTION 405
Posée par Damien GIRARD, le 15/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 23 septembre 2013 - Les expériences internationales :
Est-il normal que la France ne respecte pas les standards de sûreté de l'AIEA sur le centre d'expérimentation nucléaire de Pontfaverger-Moronvilliers, des déchets nucléaires y sont abandonnés en pleine terre, sans aucun contrôle de l'ANDRA?
Réponse du 06/01/2014,
Réponse apportée par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) :
Dans le cadre du recensement des sites et sols pollués, le CEA a déclaré le site du Polygone d’expérimentation de Moronvilliers (PEM), dans la base de données BASOL en mai 1997. L’ensemble du site fait l’objet d’une surveillance environnementale renforcée dont les résultats sont régulièrement transmis à l’Autorité de sûreté nucléaire défense (ASND) et au Préfet.
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le site de Moronvilliers est contrôlé par le CEA et non par l’Andra.
QUESTION 404
Posée par Michel GUERITTE, le 15/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 23 septembre 2013 - Les expériences internationales :
On vient de découvrir une substance mystérieuses sur des fûts de déchets nucléaires belges. Une sorte de gloubi-boulga radioactif. Jean-Paul MINON pourrait-il nous donner une rapide explication?
Réponse du 12/12/2013,
Réponse apportée par Jean-Paul Minon, directeur genéral de l'ONDRAF :
Lors de campagnes d’inspection, la présence d’une matière ayant les caractéristiques d’un gel a été observée à la surface de colis de concentrats d’évaporateur cimentés.
Les analyses montrent que ce gel est composé de silicate sodique hydraté. Le phénomène à l’origine de la formation de ce gel est une réaction de type alcali-silice (ASR). Il s’agit d’une réaction entre les alcalins présents dans l’eau de pore de la matrice et les agrégats siliceux (gravier) entrant dans la composition du béton. Les alcalins proviennent du ciment et des concentrats (ajout de soude pour neutralisation). Cette pathologie des bétons est bien connue dans les ouvrages d’arts et autres structures en béton, elle n’est pas spécifique aux déchets radioactifs ici concernés.
Les inspections réalisées jusqu’à présent indiquent que cette réaction n’a pas porté préjudice à l’intégrité des colis (pas de gonflement ou de déformation des colis). Par ailleurs aucune corrosion de l’acier des emballages métalliques n’a été constatée.
Les études se poursuivent en vue d’évaluer d’une part le potentiel de réactivité restant au sein des colis et les conséquences pour leur gestion ultérieure (entreposage et dépôt final).
QUESTION 403
Posée par Michel GUERITTE, le 15/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 23 septembre 2013 - Les expériences internationales :
Stefan Mayer, pouvez-vous me mailer la liste de tous les experts internationaux reconnus qui ont décidés l'enfouissement?
Réponse du 19/12/2013,
Réponse apportée par Stefan Mayer, chef du service des études sur le stockage des déchets, Agence Internationale de l'Energie Atomique :
Il m'est difficile de répondre de façon précise à cette question - sauf à indiquer qu'une liste trop longue pour être citée d'organisations et d'experts individuels, dans tous les pays ayant un besoin de développer des solutions pérennes de gestion de déchets radioactifs a haute activité - œuvrent pour développer un programme de stockage géologique.
En plus des organisations et des équipes de recherche d'instituts ou d'universités françaises, que vous connaissez probablement, j'inclus ci-dessous quelques sites web proposant une information en anglais (voire en français pour la Belgique, le Canada et la Suisse), dans différents pays, comme point de départ pour s'informer sur le contexte international. J'inclus aussi les liens vers les sites web de l'AIEA et de l'AEN.
Cette liste est très loin d'être exhaustive et ne peut être comprise que comme un premier point de départ pour obtenir une première appréciation des efforts consacres mondialement au développement de stockages géologiques.
J'attache aussi en référence le guide de sûreté spécifique au stockage géologique publie par l'AIEA. Il inclus en référence une liste d'experts ayant contribues a sa production, ainsi qu'une liste d'experts ayant appartenu au "Waste Safety Standards Committee".
IAEA:
http://www.iaea.org/OurWork/ST/NE/NEFW/Technical_Areas/WTS/home.html
http://www-ns.iaea.org/tech-areas/waste-safety/disposable.asp?s=3&l=24
NEA:
http://www.oecd-nea.org/rwm/rwmc.html
Sweden:
http://www.skb.se/default____24417.aspx
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/In-English/About-the-Swedish-Radiation-Safety-Authority1/The-site-for-a-spent-nuclear-fuel-repository1
Finland:
http://www.posiva.fi/en
http://www.stuk.fi/en_GB/
Switzerland:
http://www.nagra.ch/fr
http://www.ensi.ch/fr/
Belgium:
http://www.ondraf.be/content/gestion-%C3%A0-long-terme
http://www.fanc.fgov.be/fr/page/les-dechets-radioactifs/1094.aspx
Canada:
http://www.nwmo.ca/accueil?language=fr_FR&
http://nuclearsafety.gc.ca/fr/index.cfm
USA:
http://energy.gov/sites/prod/files/Strategy%20for%20the%20Management%20and%20Disposal%20of%20Used%20Nuclear%20Fuel%20and%20High%20Level%20Radioactive%20Waste.pdf
http://www.nrc.gov/waste/hlw-disposal/yucca-lic-app.html
Germany:
http://www.dbetec.de/en/services/
http://www.bfs.de/en/endlager/erkundungsbergwerk_gorleben
UK:
http://www.nda.gov.uk/rwmd/
http://www.hse.gov.uk/nuclear/wastemanage.htm
Réponse apportée par Jean-Marie Brom, physicien nucléaire, universitaire et chercheur :
Bien que je ne sois pas Stéphane Mayer, je me permets d'apporter ma contribution : il n'y a pas "d'experts internationaux reconnus" qui ont décidé l'enfouissement. Chaque pays est en effet responsable de la gestion de ses déchets nucléaires.
Dans un premier temps, l'attitude des instances nucléaires a été de se "débarrasser" des déchets nucléaires en les immergeant (pour la France et une partie de l'Europe occidentale, dans la fosse des Gasquet de 600m de profondeur). Une étude de Greenpeace en 2000 a montré que les fûts – irrécupérables – fuyaient. On estime qu'une quantité de 60 TBq a été immergée et continue de se répandre dans l'océan.
Cependant, cette logique a été poursuivie : devant l'impossibilité technique, énergétique, financière d'éliminer les déchets radioactif, il est vital de retarder au maximum le moment où ces déchets peuvent être mis en contact avec la biosphère (l'homme). Et de ce fait, l'enfouissement a été jugé comme la moins mauvaise des "solutions".
Il n'y a pas eu besoin de réunion "d'experts" pour arriver à cette conclusion. Mais il existait d'autres solutions, qui bien sûr nous mettaient en face de nos responsabilités.
Disons que le rôle des "experts" dans l'enfouissement aura été de dire aux pouvoirs politiques que l'enfouissement définitif permettait non pas d'éliminer le problème, mais, si tout se passe bien, de retarder au maximum les effets de ce problème.
QUESTION 402 - Stockage de dechets issus d'ITER ?
Posée par jean BENOIT, L'organisme que vous représentez (option) (RENNES), le 14/10/2013
CIGEO est-il prevu pour stocker des déchets du demonstrateur ITER ? si oui, sachant qu'iTER est un projet international et qu'il est interdit de stocker des déchets radio-actifs étrangers sur notre territoire est-ce légal ?
Réponse du 10/02/2014,
Réponse apportée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Il est effectivement prévu de stocker les déchets du projet ITER dans Cigéo, ce qui est tout à fait légal. La loi française indique qu’ « est interdit le stockage en France de déchets radioactifs en provenance de l'étranger ainsi que celui des déchets radioactifs issus du traitement de combustibles usés et de déchets radioactifs provenant de l'étranger ». Les déchets d’ITER seront produits en France. L’installation ITER, même si elle est financée par plusieurs autres pays, est soumise aux mêmes règles que les installations nucléaires de base françaises pour les questions relatives à la sûreté et à la gestion des déchets.
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La création de l’installation de recherche ITER sur le site de Cadarache (Bouches-du-Rhône) a été autorisée par décret du 9 novembre 2012. Les déchets radioactifs qui seront produits par l’exploitation et par le démantèlement de cette installation sont pris en compte dans l’inventaire du projet Cigéo, comme indiqué page 15 du dossier du maître d’ouvrage, et pourront être stockés dans Cigéo, s’il est autorisé, sous réserve de respecter les spécifications d’acceptation du stockage.
QUESTION 401 - Risques d'incendie et oxygène
Posée par jean BENOIT, L'organisme que vous représentez (option) (RENNES), le 14/10/2013
Afin d'éviter et de diminuer le risque d'incendie, est-il envisagée de réduire drastiquement ou d'enlever l'oxygène des alvéoles de stockage des déchets ? mais ce qui impliquerait de se déplacer avec des équipements respiratoires ?
Réponse du 02/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Non il n’est pas prévu d’enlever l’oxygène des alvéoles de stockage. Pour des besoins industriels, la ventilation sera nécessaire en phase d’exploitation, pour le personnel et pour éviter l’accumulation de l’hydrogène produit par certains colis de déchets MA-VL.
De nombreuses mesures seront prises dans Cigéo pour maîtriser le risque d’incendie. Pour réduire ce risque, une première mesure consiste à limiter la quantité de produits combustibles ou inflammables dans les équipements du stockage. Par exemple, si Cigéo est réalisé, les câbles électriques seront ignifugés et les véhicules à moteur thermique seront interdits dans l’installation nucléaire souterraine de Cigéo. De plus, des dispositifs de détection incendie seront répartis dans les installations pour détecter rapidement et localiser tout départ de feu. Plusieurs systèmes d’extinction automatiques seront installés dans l’installation souterraine. Des systèmes embarqués d’extinction automatique (gaz, poudre...) seront placés sur les engins de transfert des colis de déchets et sur les engins de manutention en alvéole, afin d’éteindre tout départ de feu. Des systèmes d’extinction automatique seront également disposés dans certaines zones de l’installation souterraine telles que les locaux électriques et les zones de soutien logistique. Ces dispositifs seront mis en place en complément de moyens de lutte contre l’incendie plus traditionnels de types extincteurs, points de raccordement à un réseau d’alimentation en agent extincteur (eau, mousse…) etc.
Malgré toutes ces dispositions, une situation d'incendie est quand même considérée par prudence. Dans les installations de surface, les mêmes principes seront appliqués que dans les installations nucléaires de base : en cas d’incendie, les locaux concernés seraient isolés du reste de l’installation, les moyens d’extinction et d’intervention seraient déclenchés et le personnel serait évacué. Dans l’installation souterraine, compte tenu de sa géométrie spécifique, ces dispositions sont adaptées dès la conception. Des systèmes de compartimentage et de ventilation sont prévus pour limiter la propagation du feu. Des équipements d’intervention seront prépositionnés dans l’installation souterraine en permanence. L'architecture souterraine retenue pour le stockage permettra aux secours d'intervenir dans des galeries à l'abri des fumées et facilite l'évacuation du personnel.
Outre la mise à l’abri du personnel, la maîtrise du risque incendie vise aussi à protéger les colis contenant les substances radioactives des effets de l’incendie afin de maintenir le confinement de ces substances. Pour cela, les colis seront disposés dans des équipements qualifiés pour résister au feu (cellules résistantes au feu munies de portes coupe-feu, hotte de protection pour le transfert dans l’installation souterraine). Les conteneurs de stockage sont également conçus pour assurer une protection contre l’incendie. Ces dispositions permettent d’exclure tout effet domino entre les colis stockés.
La définition de l’ensemble de ces dispositifs associe les services compétents des sapeurs-pompiers et fait l’objet de contrôle par l’Autorité de sûreté nucléaire. Cigéo ne sera jamais autorisé si l’Andra ne démontre pas qu’elle maîtrise tous les risques, dont le risque d’incendie.
Réponse apportée par Jean-Claude Zerbib, ancien ingénieur en radioprotection du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) :
C’est la ventilation qui permettra de rester significativement en dessous d’une teneur de 4% en hydrogène dans l’air, concentration à partir de laquelle le risque d’explosion ou d’inflammation spontanée est possible. Durant la phase d’exploitation du site, c’est donc sur la fiabilité du système de ventilation, des mesures de la teneur en hydrogène dans l’air, de l’alimentation électrique et des dispositifs de ventilation de secours, que reposera la "sécurité hydrogène". Les déchets bitumineux, qui présentent à la fois le risque hydrogène et le risque feu, seront mis dans des casemates en béton ventilées.
Pendant la phase d’exploitation, il faudra s’assurer, par la mise en œuvre de divers cloisonnements, qu’un démarrage de feu, dans la zone où travaillent divers intervenants, ne puisse pas gagner les alvéoles de stockage.
QUESTION 398 - stockage sousterrain à bure
Posée par Gérard BESSIERES, CITOYEN (VARENNES SUR AMANCE), le 09/10/2013
Bonjour Pourquoi tromper l'opinion en affirmant comme le fait l'Andra que le stockage sous terrain de Bure est sûr et de plus réversible alors que c'est un secret de polichinelle la roche d' argilite se délite en présence d'eau dans un temps très court. Que se passera t il lors du creusement des galeries et alvéoles si elles venaient à être en contact d'eau notamment si cette eau empruntait les nombreuses failles actives ou anciennes qui pourraient se réactive par exemple après un séismes si fréquents à Bure? Donc le fameux coffre fort comme du béton selon l'Andra n'est que chimères. On sait aujourd'hui qu'il y a de l'eau en abondance au dessus de l'argilite . L 'Andra pour sa part a nié cette présence en abondance d'eau pendant des années. Que penser des organismes de contrôle?
Réponse du 17/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’Andra n’a jamais trompé l’opinion. Le phénomène de délitement d’un échantillon d’argile placé dans un verre d’eau est connu de tous. Il ne peut être transposé aussi simplement à un massif de roche d’argile de 130 mètres d’épaisseur à 500 mètres de profondeur : la roche argileuse est solide alors qu’elle contient environ 10 % d’eau en masse (18 % en volume). Compte tenu de son volume très important, le massif argileux ne pourrait se déliter en présence de venues d’eau externes que de façon très localisée. Dans Cigéo, les parois des galeries seront recouvertes d’un soutènement en béton qui protège la roche, avec des caniveaux pour drainer les éventuelles venues d’eau vers des points de collecte. La roche sera à nu uniquement au niveau des fronts de creusement.
De nombreuses mesures seront prises pour prévenir d’éventuelles arrivées d’eau accidentelles dans Cigéo :
- Protection des puits et de la descenderie contre les intempéries,
- Étanchéification des puits et des descenderies au niveau des couches de roche aquifères traversées au-dessus de la couche d’argilite,
- Systèmes de drainage des eaux issues des couches de roche supérieures peu productives et pompage de ces eaux jusqu’à la surface,
- Protection des canalisations d’eau interne et mécanismes de fermeture automatique en cas de rupture.
Ces dispositions sont largement éprouvées dans l’industrie minière.
Par précaution, des scénarios accidentels d’arrivées d’eau (par exemple suite à la défaillance d’une canalisation ou suite à une panne dans le système de drainage des eaux provenant des couches de roche supérieures) sont pris en compte dans les études de sûreté menées pour Cigéo, au même titre que pour n’importe quelle installation nucléaire. Compte tenu des origines possibles, ce débit sera nécessairement limité (pour mémoire le débit drainé par chacun des puits du Laboratoire souterrain est de l’ordre de 10 m3/jour en moyenne, ou moins, ce qui est très faible par comparaison à certains sites miniers). Un tel évènement resterait très localisé dans le stockage et n’aurait qu’un effet très limité sur l’argile qui sera protégée par les revêtements. En tout état de cause, ce type d’incident ne remettra pas en cause la sûreté du stockage.
Les résultats de la campagne de géophysique 3D menée par l’Andra confirment par ailleurs l’absence de failles de rejet supérieur à 3 m recoupant la couche argileuse, comme constaté dans le Laboratoire souterrain. La qualité des données acquises a confirmé une remarquable continuité latérale de la couche du Callovo-Oxfordien. Par ailleurs aucune fracture naturelle (non induite par les creusements) n’a été détectée dans les centaines de forages carottés horizontaux et verticaux réalisés au Laboratoire souterrain. Les résultats de l’Andra ont fait l’objet d’une évaluation par l’Autorité de sûreté nucléaire. L’expertise réalisée par l’IRSN sur la campagne de sismique 3D de 2010 est disponible sur http://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_gp/Documents/Dechets/IRSN_Rapport-GP_Cigeo_2013-00001-Tome3.pdf
La très faible sismicité de la zone d’implantation du laboratoire souterrain a également été confirmée par les scientifiques qui ont travaillé sur ce site depuis plus de 20 ans. Le site de Meuse/Haute-Marne appartient à un domaine géologique stable (voir carte), particulièrement favorable pour l’installation d’un stockage. L’activité sismique est en effet extrêmement faible, comme le prouvent les enregistrements de sismicité instrumentale (écoute sismique depuis 1961 à l’échelle de la France) qui sont capables de détecter des microséismes, et les chroniques historiques (séismes ayant été ressentis et/ou ayant occasionné des dégâts au cours des derniers 1 000 ans). Au-delà de ces données, la stabilité et la très faible sismicité du site s’expliquent par sa situation géographique dans le bassin parisien qui est protégé des mouvements liés à la tectonique des plaques (collision du continent africain avec l’Europe).
L’Andra n’a jamais nié la présence d’eau dans les couches géologiques au-dessus de la couche d’argilite étudiée pour l’implantation du stockage. Lors du creusement des puits du Laboratoire souterrain, il a été constaté que ces niveaux aquifères sont peu productifs. Les forages hydrogéologiques réalisés permettent d’avoir une très bonne connaissance de l’hydrogéologie du secteur étudié, que ce soit pour les couches géologiques situées au-dessus ou en-dessous de la couche d’argile.
Les avis des organismes de contrôle sur les travaux menés par l’Andra sont consultables sur le site du débat public :
../informer/documents-complementaires/avis-autorites-controle-et-evaluations-permanentes.html
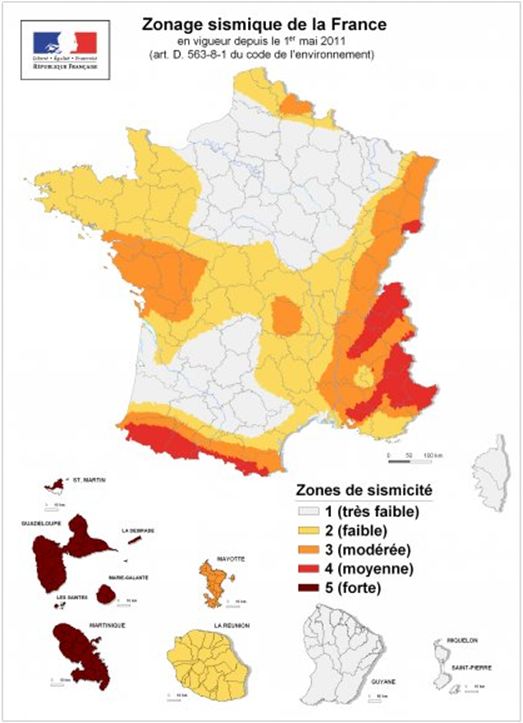
QUESTION 397
Posée par Christian CHOLIN (CHANCENAY), le 09/10/2013
Est-ce que les nappes phréatiques ne seront pas contaminées d'ici 50 ans par des fuites radioactives venant des stockages?
Réponse du 20/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Pendant l’exploitation du Centre, afin d’éviter tout risque de contamination des nappes phréatiques, les effluents liquides susceptibles d’être contaminés seront systématiquement collectés et contrôlés.
Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement afin de contrôler l’impact de ses activités. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, il permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement et l’absence de contamination des nappes phréatiques. L’Andra a déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
De plus, Cigéo sera en permanence soumis au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
Après la fermeture du stockage, au-delà de la durée de vie des ouvrages industriels, la couche d’argile très peu perméable, de plus de 130 mètres d’épaisseur, dans laquelle sera installé le stockage souterrain, servira de barrière naturelle pour retenir les radionucléides contenus dans les déchets et freiner leur déplacement. Le stockage permet ainsi de garantir leur confinement sur de très longues échelles de temps. Seuls quelques-uns de ces radionucléides, les plus mobiles et dont la durée de vie est longue, pourront migrer de manière très étalée dans le temps. Ils ne sortiraient pas de cette couche avant 100 000 ans et atteindraient en quantités extrêmement faibles la surface et les nappes phréatiques. Leur impact radiologique serait alors plusieurs dizaines de fois inférieur à la radioactivité naturelle (qui est de 2,4 mSv par an en moyenne en France).
QUESTION 396
Posée par Gilles HENNEQUIERE (SAINT-DIZIER), le 08/10/2013
J'aimerais avoir sur papier le compte-rendu du débat du 23/09 sur les expérimentations menées dans les pays concernés. Combien d'éoliennes seraient necessaires pour égaler la production moyenne d'une centrale nucléaire? Ne serait-il pas plus utile d'expérimenter les pistes sur les économies d'énergie à tous les échelons?
Réponse du 05/12/2013,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Une éolienne terrestre a une puissance moyenne de 1 à 3 MW environ. C’est une énergie intermittente : la production d’électricité par les éoliennes dépend de la force du vent à un instant donné et est par conséquent variable. Par exemple, en 2012, le facteur de charge[1] de l’énergie éolienne était de 24 %. Pour atteindre la production d’électricité d’un réacteur de 900 MW (dont le facteur de charge est d’environ 80%), il faudrait donc environ en moyenne 1500 éoliennes. Par ailleurs il convient de préciser que, comme les éoliennes ne produisent pas constamment de l’électricité, elles doivent être accompagnées par d’autres moyens de production : une politique énergétique ne peut pas se baser uniquement sur l’énergie éolienne.
Le Président de la République a décidé d’engager la France dans la transition énergétique. Cette transition est fondée sur deux principes : l'efficacité énergique d'une part, et la priorité donnée aux énergies renouvelables d'autre part. Les économies d’énergie ont donc un rôle majeur à jouer pour la transition énergétique.
[1] le rapport entre l'énergie électrique effectivement produite sur une période donnée et l'énergie qu'elle aurait produit si elle avait fonctionné à sa puissance nominale durant la même période.
QUESTION 395 - Il faut pérenniser la réversibilité de l'enfouissement
Posée par Jean-Jack FRANÇOIS, L'organisme que vous représentez (option) (BAR-LE-DUC), le 07/10/2013
La préservation de la réversibilité de l’enfouissement des déchets nucléaires constitue à mon avis la clef de voûte du projet CIGEO. Elle engage, pour quasiment l’éternité, l’avenir de notre pays et celui de notre descendance. La réversibilité telle qu’elle nous est présentée actuellement dans le projet CIGEO ne sera effective que pendant un siècle. Après, les déchets seront livrés à eux-mêmes, à leur destin. En agissant ainsi, nous nous interdisons, pour toujours, de reprendre la main, même en cas de nécessité absolue. C’est tout simplement insensé et irresponsable. A-t-on pensé que le site de Bure se situe dans le bassin hydrologique de la Seine ? A-t-on conscience que l’eau de la Seine alimente en eau potable la région parisienne ? Des scientifiques aussi persuasifs que ceux qui prônaient, il y a quelques temps, l’alimentation des bovins avec les farines animales, nous affirment aujourd’hui que le sous-sol meusien ne comporte aucune fissure géologique et qu’il n’y a aucun danger de pollution de la nappe phréatique. Et si, malgré tout, l’eau de la Seine était polluée par des nucléides ? Quelles seraient les conséquences, humaines et financières, d’une telle catastrophe pour notre pays ? Est-on certain de bien maîtriser les risques d’explosion de l’hydrogène émanant des déchets en sous-sol ? Une éventuelle explosion ne risquerait-elle pas de provoquer des fissures ? C’est facile d’être aussi affirmatif sur l’absence de risques quand il n’y a pas de sanction à la clef. Ces scientifiques seraient-ils prêts à gager leur vie dans cette affaire ? Ils pourraient le faire sans risque, dès lors qu’ils sont sûrs d’eux à 100%..... Mais ils ne le feront pas, car ils vous répondront que le zéro défaut n’existe pas. On l’a vu bien vu avec l’affaire des farines animales. Gouverner, c’est prévoir, même si cela peut paraître, à première vue, improbable. Sans être contre l’enfouissement des déchets nucléaires qui constitue un excellent rempart contre les attaques aériennes terroristes qui pourraient viser les sites de stockage en surface (rappelons-nous du 11 septembre 2001), il est primordial de préserver dans le temps cette notion de réversibilité, même si cela doit coûter beaucoup plus d’argent. La sécurité n’a pas de prix. D’ailleurs, c’est dans cet état d’esprit que la dissuasion nucléaire française a été mise en place. Ma question : Pour ce faire, ne pourrait-on pas envisager un centre de stockage souterrain divisé en deux parties, une remplie de déchets et l’autre vide ? Au bout d’un laps de temps, à déterminer, il suffirait de transférer les déchets d’une partie dans l’autre. Au cours du transfert, l’étanchéité des conteneurs serait contrôlée et renforcée si nécessaire. Compte tenu du développement actuel de la robotique, il est très probable que ce travail puisse être assuré rapidement par des robots. Ainsi, ce transfert périodique d’une partie à l’autre permettrait de s’assurer du comportement des déchets dans le temps et d’apporter les correctifs nécessaires. Peut être que dans plusieurs siècles, l’Homme sera capable de trouver une solution, autre que le simple enfouissement, pour traiter ces déchets. Dans cette hypothèse, nos enfants seront en mesure de les sortir des galeries de stockage et de procéder aux travaux d’élimination nécessaires. Ainsi, l’Homme aura gardé la maîtrise de son destin. Il pourra nous dire merci pour notre sagesse et notre clairvoyance.
Réponse du 30/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Concernant la durée de la réversibilité
Le rôle du stockage profond est de mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs, pour ne pas reporter leur charge indéfiniment sur les générations futures.
Conformément à la demande du Parlement, l’Andra étudie un stockage qui soit réversible pendant au moins 100 ans, ce qui permet de laisser des choix ouverts aux générations suivantes. L’Andra retient les meilleures techniques d’ingénierie disponibles pour offrir aux générations suivantes le maximum de flexibilité pour la gestion dans le temps de l’installation. En fonction de l’expérience acquise lors de l’exploitation de Cigéo et des recherches sur la gestion des déchets radioactifs, les générations suivantes seront libres de décider du devenir de Cigéo, en particulier de son calendrier de fermeture et elles pourront périodiquement réévaluer la période de réversibilité. C’est aux générations suivantes qu’il reviendra de décider dans un siècle si elles souhaitent fermer définitivement le stockage ou temporiser cette étape.
Dans son avis sur les recherches menées dans le cadre de la loi de 1991, publié en 2006, l’Autorité de sûreté nucléaire considère que, sur le plan des principes, la réversibilité ne peut avoir qu’une durée limitée. A long terme, la protection de l’homme et de l’environnement doit être assurée sans nécessité d’intervention humaine (sûreté « passive »). Dans cette optique, Cigéo est conçu pour être refermé après la centaine d’années nécessaires à son exploitation.
Chaque étape de fermeture est indispensable pour la sûreté à très long terme du stockage. Les opérations de fermeture conduiront à obturer définitivement les alvéoles où seront stockés les déchets, puis à obturer en totalité les galeries souterraines, les puits et les descenderies. Ces opérations permettront de progresser vers une sûreté de plus en plus passive. Elles rendront la récupérabilité des colis de déchets plus difficile. Compte tenu de leur importance, l’Andra propose que chaque étape de fermeture fasse l’objet d’une autorisation spécifique.
Après la fermeture définitive du stockage, que seule une loi pourra autoriser, la sûreté sera assurée de manière passive et ne nécessitera aucune action humaine. Une surveillance du site pourra néanmoins être maintenue aussi longtemps que les générations futures le souhaiteront et des actions seront menées pour conserver et transmettre sa mémoire. Il pourrait toujours être envisagé de revenir dans le stockage au moyen de techniques minières adaptées, mais le confinement apporté par la roche et les ouvrages de fermeture ne serait alors plus assuré.
Concernant le danger de pollution de la nappe phréatique
La protection à très long terme de l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Les générations futures pourront continuer à assurer une surveillance du site aussi longtemps qu’elles le souhaiteront. Néanmoins, le stockage restera sûr même si le site venait à être oublié, contrairement à un entreposage, qu’il soit en surface ou en subsurface.
Les recherches menées depuis 1994 sur le site étudié en Meuse/Haute-Marne ont permis aux scientifiques de reconstituer de manière détaillée son histoire géologique, depuis plus de 150 millions d’années. Le site étudié se situe dans la partie Est du bassin de Paris qui constitue un domaine géologiquement simple, avec une succession de couches de calcaires, de marnes et de roches argileuses qui se sont déposées dans d’anciens océans. Les couches de terrain ont une géométrie simple et régulière. Cette zone géologique est stable et caractérisée par une très faible sismicité. La couche argileuse étudiée pour l’implantation éventuelle du stockage, qui s’est déposée il y a environ 155 millions d’années, est homogène sur une grande surface et son épaisseur est importante (plus de 130 mètres). Aucune faille affectant cette couche n’a été mise en évidence sur la zone étudiée.
Cette analyse s’appuie sur des investigations géologiques approfondies : plus de 40 forages profonds ont été réalisés, complétés par l’analyse de plus de 300 kilomètres de géophysique 2D et de 35 km² de géophysique 3D. Environ 50 000 échantillons de roche ont été prélevés.
La roche argileuse a une perméabilité très faible, ce qui limite fortement les circulations d’eau à travers la couche et s’oppose au transport éventuel des radionucléides par convection (c’est-à-dire par l’entraînement de l’eau en mouvement). Cette très faible perméabilité s’explique par la nature argileuse, la finesse et le très petit rayon des pores de la roche (inférieur à 1/10 de micron). L’observation de la distribution dans la couche d’argile des éléments les plus mobiles comme le chlore ou l’hélium confirme qu’ils se déplacent majoritairement par diffusion et non par convection. Cette « expérimentation », à l’œuvre depuis des millions d’années, confirme que le transport des éléments chimiques se fait très lentement (plusieurs centaines de milliers d’années pour traverser la couche). Les études menées par l’Andra ont montré que l’impact du stockage serait nettement inférieur à celui de la radioactivité naturelle à l’échelle du million d’années.
Concernant la maîtrise des risques d’explosion de l’hydrogène émanant des déchets en sous-sol
Certains déchets de moyenne activité à vie longue dégagent de faibles quantités d’hydrogène gazeux (quelques litres par an et par fût), non radioactif. Au-delà d’une certaine quantité, l’hydrogène présente un risque d’explosion en présence d’oxygène. Pour maîtriser ce risque, l’Andra fixe une limite stricte aux quantités d’hydrogène émise par chaque colis de déchets, qui fera l’objet de contrôles. Pour éviter l’accumulation d’hydrogène, les installations souterraines et de surface seront ventilées pendant leur exploitation, comme le sont les installations d’entreposage dans lesquelles se trouvent actuellement ces déchets. Compte tenu de sa contribution à la sûreté de l’installation, la ventilation fait l’objet de mesures de fiabilisation pour réduire le risque de panne. De plus, des dispositifs de surveillance seront mis en place pour détecter toute anomalie sur le fonctionnement de la ventilation. Des situations de perte de la ventilation ont été envisagées. Les analyses de l’Andra montrent que, dans ce cas, on disposera alors de plus d’une dizaine de jours pour la rétablir, ce qui permettra de mettre en place les dispositions nécessaires. Les conséquences d’une explosion au sein d’une alvéole de stockage ont néanmoins été évaluées. Les résultats montrent que les colis de stockage ne seraient que faiblement endommagés, ce qui ne compromettrait pas le confinement des substances qu’ils contiennent. Lorsque la décision de fermer ces alvéoles de stockage sera prise, des massifs en béton seront construits et la ventilation ne sera plus nécessaire (en l’absence d’oxygène, l’hydrogène ne présente pas de risque d’explosion).
Concernant la sécurité
Du fait de son implantation à 500 mètres de profondeur dans une couche d’argile épaisse assurant le confinement de la radioactivité, le stockage est effectivement une installation peu vulnérable.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation …) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée, après avis des collectivités territoriales et enquête publique. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Les personnes de l’Andra qui travaillent sur les sites de stockage et habitent à proximité sont les premières concernées par la sécurité. Croyez-vous qu’elles accepteraient de travailler sur un site dont la sûreté ne serait pas garantie ?
Concernant votre proposition relative à la réversibilité
Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de ces déchets. Grâce à la réversibilité, les générations suivantes garderont la possibilité de faire évoluer cette solution si elles le souhaitent. L’Andra place cette demande de la société au cœur du projet. Elle a ainsi fait des propositions concrètes pour pouvoir récupérer les colis de déchets si besoin et laisser des choix possibles aux générations suivantes (../docs/rapport-etude/fiche-reversibilite-cigeo.pdf).
L’Andra prévoit dès la conception de Cigéo des dispositifs techniques destinés à faciliter le retrait éventuel de colis de déchets stockés. Les déchets seront stockés dans des conteneurs indéformables, en béton ou en acier. Les tunnels pour stocker ces conteneurs (alvéoles de stockage) seront revêtus d’une paroi en béton ou en acier pour éviter les déformations, avec des espaces ménagés entre les conteneurs et les parois pour permettre leur retrait. Les robots utilisés pour placer les conteneurs dans les alvéoles pourront également les retirer. Des essais à l’échelle 1 ont d’ores et déjà été réalisés avec des prototypes.
Dans l’hypothèse d’une opération de retrait d’un nombre important de colis de déchets, de nouvelles installations devraient être créées pour prendre en charge ces déchets. Selon le scénario de gestion retenu, ces installations seraient à construire soit en souterrain tel que vous le proposez (par exemple transfert des déchets d’une alvéole vers une nouvelle alvéole de stockage) soit en surface (reconditionnement éventuel, expédition, entreposage, traitement…). A titre indicatif, le délai nécessaire pour construire et équiper un tunnel de stockage est de l’ordre de 2 ans (cas d’une alvéole pour des déchets de moyenne activité à vie longue) et de l’ordre de 5 ans pour une nouvelle installation nucléaire en surface. Le délai des opérations de retrait serait a priori analogue à celui des opérations de mise en stockage.
L’Andra propose que des rendez-vous réguliers soient organisés avec l’ensemble des acteurs (riverains, collectivités, évaluateurs, État…) pour contrôler le déroulement du stockage et pour préparer chaque décision importante concernant les étapes suivantes. Ces rendez-vous permettront de faire le bilan de l’exploitation du stockage, de discuter des perspectives à venir, de faire un point sur l’avancement des recherches en France et à l’étranger sur la gestion des déchets radioactifs et de réexaminer les conditions de réversibilité ainsi que le calendrier prévisionnel de fermeture du stockage. A chaque étape, il sera possible de décider de poursuivre le processus de stockage tel qu’initialement prévu ou de le modifier, par exemple si des solutions alternatives sont identifiées.
Le débat public de 2005/2006 s’était conclu sur la question : faut-il faire confiance à la géologie ou à la société ? La conviction de l’Andra est qu’il faut faire confiance à la géologie ET à la société. C’est notre définition du stockage réversible.
QUESTION 394 - OPE
Posée par Philippe VUILLAUME, L'organisme que vous représentez (option) (BAZINCOURT/SAULX), le 05/10/2013
L'OPE a lancé un programme APRIOS sur l'eau. Pourquoi ce type de démarche ne serait pas initié sur d'autres compartiments environnementaux (sol, forêt, air, faune, ...)? L'état des lieux et son suivi élargi au maximum peut être une opportunité pour garantir l’éventuelle absence de conséquences ou de survenue d'accidents. Ne pouvez-vous pas élargir la gouvernance de l'OPE et lui adjoindre une sorte de comité éthique?
Réponse du 06/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La démarche Apprios (« approche pluraliste pour la priorisation des substances ») a été mise en place au niveau national par l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) dans le cadre du plan national santé-environnement. L’objectif est la construction d'un outil de hiérarchisation des substances dont les rejets dans l'environnement doivent être gérés en priorité.
Cette démarche est actuellement mise en œuvre par l’Andra en Meuse/Haute-Marne sur le milieu aquatique. C’est l’une des toutes premières fois que cette démarche est appliquée à un cas réel en France. Elle consiste à demander à un panel composé d’experts mais également de représentants du public ou d’organisations professionnelles d’établir de façon concertée la liste des substances qu’il leur semblerait pertinent de suivre dans le cadre de l’Observatoire pérenne de l’environnement « OPE » (http://www.andra.fr/ope) sur le long terme. Si cette première phase donne satisfaction au panel, il est prévu de continuer le travail de concertation progressivement sur les autres milieux (sol, air, …).
L’intérêt montré par de nombreuses parties prenantes aux travaux de l’OPE conduit l’Andra à réfléchir à élargir sa gouvernance en incluant une participation de la société civile. La démarche Apprios constitue une première expérimentation en ce sens. Nous notons avec grand intérêt votre proposition, qui devra être partagée avec les acteurs locaux.
QUESTION 393
Posée par Joséphine ERRECART (MONTMEDY), le 04/10/2013
Souhaite si possible suivre les débats publics sur Internet car nous sommes trop éloignés de Bar-le-Duc pour y participer. Sinon recevoir par courriel des élèments des débats. Merci
Réponse du 16/10/2013,
Les débats contradictoires sont retransmis en direct sur le site internet du débat public : ../. Le jour du débat, la bannière centrale de la page d'accueil permet d'accéder à la retransmission en format vidéo ou audio.
Vous avez la possibilité de poser vos questions depuis le site, par SMS (envoyez DEBAT au 32321 suivi de votre question. Service gratuit hors coût du SMS) via Facebook, Twitter ou par mail.
Voici le calendrier des débats à venir :
• mercredi 16 octobre à 19h
"Risques et sécurité pour les salariés du site, les citoyens et l'environnement"
• mercredi 23 octobre à 19h
" Les transports des déchets"
• mercredi 30 octobre à 19h
" Transformations locales et aménagement du territoire"
• mercredi 13 novembre à 19h
" Coûts et financement"
• date à définir "Le processus décisionnel et la gouvernance"
Vous trouverez les enregistrements vidéo, audio et la retranscription des précédents débats sur la page : ../informer/comment-ca-marche.html.
QUESTION 392
Posée par Gilles PEROTIN (DAMMARIE-SUR-SAULX), le 04/10/2013
Si le Projet CIGEO se réalise, en cas d'incendie voire d'accident, les colis peuvent-ils être réversible? Comment est prévenue la population proche en matière de transport voire de fuite de colis ou dispersion d'hydrogène dans l'air ou l'eau?
Réponse du 28/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les déchets radioactifs seront placés dans des conteneurs épais, en acier ou en béton, prévus pour résister aux incidents d’exploitation qui pourraient survenir dans l’installation de stockage (par exemple une chute ou un incendie). Ces colis de stockage sont conçus pour rester intègres pendant toute la durée d’exploitation de Cigéo. L’hydrogène produit par certains déchets est un gaz non radioactif. Il est évacué et dilué par la ventilation des installations et ne présente aucun risque pour les riverains.
En cas d’accident, l’installation sera remise en sécurité par la pose rapide d’équipements provisoires (ventilation, barrière de confinement…) et non par une opération de retrait de colis. Une fois la mise en sécurité réalisée, l’exploitant examinera les dispositions à mettre en œuvre pour reprendre l’exploitation normale. Le maintien en stockage de colis, même endommagés, ou leur retrait éventuel pourra alors être décidé sans caractère d’urgence. S’il était nécessaire de récupérer un colis contaminé ou détérioré, des précautions particulières seraient prises pour son transfert dans les installations et des opérations spécifiques seraient mises en œuvre (par exemple décontamination ou reconditionnement).
Conformément à la loi du 13 juin 2006 sur la transparence et la sécurité nucléaire, tous les événements dans les installations nucléaires font systématiquement l’objet d’une déclaration immédiate à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), organisme de contrôle indépendant, et d’une information du public. Les exploitants des installations nucléaires doivent aussi déclarer à l’ASN les écarts par rapport au fonctionnement normal des installations, même s’ils n’ont aucune importance du point de vue de la sûreté.
Réponse apportée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) :
La sûreté des transports, basée sur le concept de défense en profondeur, repose sur :
- le colis (emballage chargé de son contenu),
- la fiabilité des opérations de transport,
- la gestion de crise dans les situations accidentelles.
Les modèles de colis sont soumis à des épreuves réglementaires destinées à démontrer leur résistance lors du transport. Le niveau d’exigence de ces épreuves est proportionné à la dangerosité des substances transportées. À titre d’exemple, les modèles de colis correspondant aux substances les plus dangereuses doivent conserver leurs fonctions de sûreté, y compris en cas d’accident (simulé par une chute de 9 m sur une surface indéformable, une chute de 1 m sur un poinçon, un incendie d’hydrocarbure totalement enveloppant de 800° C minimum pendant 30 mn, une immersion dans l’eau à une profondeur de 200 m).
En France, aucun accident majeur ayant impliqué des colis de déchets de haute activité n’a à ce jour été rapporté. Toutefois, si un accident survenait et remettait en cause le confinement du colis, la dernière ligne de défense de la sûreté des transports de substances radioactives reposerait sur les moyens d’intervention mis en œuvre face à un incident ou un accident.
En cas d'accident impliquant un transport de substances radioactives, des actions sont prévues dans le plan ORSEC-TMR élaboré dans chaque département français. Les personnes seraient alertées par les services de la préfecture (gendarmerie, police, pompiers). Si un périmètre d'exclusion devait être mis en place (périmètre de 100 m en phase réflexe, pouvant être étendu jusqu'à 1 km), l'alerte des populations se ferait principalement au moyen de véhicules équipés de haut-parleur.
QUESTION 391
Posée par Marc ALAIMO (SORCY SAINT MARTIN), le 04/10/2013
Pourrait-il y avoir un impact sur les sols et les nappes phréatiques avoisinantes? Si une fissure se créait au niveau des parois de stockage?
Réponse du 07/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif de Cigéo est de protéger l’homme et l’environnement et d’éviter toute dispersion incontrôlée de radioactivité dans l’environnement.
Pendant l’exploitation du Centre, par exemple, les effluents liquides susceptibles d’être contaminés seront systématiquement collectés et contrôlés afin d’éviter tout risque de contamination des sols et des nappes phréatiques. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvements permettant de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité afin de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. L’Andra a déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. De plus, Cigéo sera en permanence soumis au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement afin de vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
Après la fermeture du stockage, au-delà de la durée de vie des ouvrages industriels, la couche d’argile très peu perméable, de plus de 130 mètres d’épaisseur, dans laquelle sera installé le stockage souterrain, servira de barrière naturelle pour retenir les radionucléides contenus dans les déchets et freiner leur déplacement. Le stockage permet ainsi de garantir leur confinement sur de très longues échelles de temps. Seuls quelques-uns de ces radionucléides, les plus mobiles et dont la durée de vie est longue, pourront migrer de manière très étalée dans le temps. Ils ne sortiraient pas de cette couche avant 100 000 ans et atteindraient en quantités extrêmement faibles la surface et les nappes phréatiques. Leur impact radiologique serait alors plusieurs dizaines de fois inférieur à la radioactivité naturelle (qui est de 2,4 mSv par an en moyenne en France).
Concernant le site de Meuse/Haute-Marne :
Les résultats de la campagne de géophysique 3D menée par l’Andra confirment par ailleurs l’absence de failles de rejet supérieur à 3 m recoupant la couche argileuse, comme constaté dans le Laboratoire souterrain. La qualité des données acquises a confirmé une remarquable continuité latérale de la couche du Callovo-Oxfordien. Par ailleurs aucune fracture naturelle (non induite par les creusements) n’a été détectée dans les centaines de forages carottés horizontaux et verticaux réalisés au Laboratoire souterrain. Les résultats de l’Andra ont fait l’objet d’une évaluation par l’Autorité de sûreté nucléaire. L’expertise réalisée par l’IRSN sur la campagne de sismique 3D de 2010 est disponible sur http://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_gp/Documents/Dechets/IRSN_Rapport-GP_Cigeo_2013-00001-Tome3.pdf
La très faible sismicité de la zone d’implantation du Laboratoire souterrain a également été confirmée par les scientifiques qui ont travaillé sur ce site depuis plus de 20 ans. Le site de Meuse/Haute-Marne appartient à un domaine géologique stable (voir carte), particulièrement favorable pour l’installation d’un stockage. L’activité sismique est en effet extrêmement faible, comme le prouvent les enregistrements de sismicité instrumentale (écoute sismique depuis 1961 à l’échelle de la France) qui sont capables de détecter des microséismes, et les chroniques historiques (séismes ayant été ressentis et/ou ayant occasionné des dégâts au cours des derniers 1 000 ans). Au-delà de ces données, la stabilité et la très faible sismicité du site s’expliquent par sa situation géographique dans le bassin parisien qui est protégé des mouvements liés à la tectonique des plaques (collision du continent africain avec l’Europe).
QUESTION 390
Posée par Jean-pierre MASTALERZ (VARENNES SUR AMANCE), le 04/10/2013
Comment être sûr de la réversibilité du stockage sur des milliers d'années?
Réponse du 18/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le projet Cigéo est conçu pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter leur charge sur les générations futures. Le Parlement a également demandé que ce stockage, prévu pour être définitif, soit réversible pendant au moins 100 ans. Les conditions de cette réversibilité seront définies dans une future loi.
Pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets radioactifs, Cigéo devra être refermé après son exploitation. L’Andra conçoit Cigéo pour qu’il puisse être refermé de manière progressive et propose que chaque étape de fermeture fasse l’objet le moment venu d’une autorisation spécifique. En effet, ces étapes permettront de progresser vers une sûreté de plus en plus passive mais rendront plus complexe le retrait éventuel de colis stockés. Le Parlement a d’ores et déjà décidé que seule une loi pourrait autoriser la fermeture définitive du stockage.
Après la fermeture du stockage, la sûreté sera assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Une surveillance du site pourra néanmoins être maintenue aussi longtemps que la société le souhaitera et des actions seront menées pour conserver et transmettre la mémoire du stockage.
Pour en savoir plus sur la réversibilité de Cigéo : ../docs/rapport-etude/fiche-reversibilite-cigeo.pdf
QUESTION 389
Posée par Jocelyne GUGLIELMETTI (VERDUN), le 04/10/2013
J'ai entendu à la radio que au bout d'un certain temps, les fputs où sont mis les déchets avaient de la mousse dessu. Est-ce vrai? Comment cela se fait-il que l'on n'est jamais d'exercice en cas de fuite surtout à Verdun?
Réponse du 12/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Lors d’une opération de contrôle, Belgoprocess (filiale de l’Ondraf, Organisme national de gestion déchets radioactifs et des matières fissiles) a identifié la formation d’un gel à la surface d’une matrice en béton utilisée par certaines centrales nucléaires en Belgique pour confiner des déchets de faible activité. Un vaste programme d’inspection et de contrôle a été mis en place par l’Ondraf (cf. http://www.ondraf.be/sites/default/files/20140107_Communique%20de%20presse-ONDRAF_FR.pdf). Une alcali-réaction dans le béton pourrait être à l’origine de ce phénomène.
Pour se prémunir du risque d’alcali-réaction, l'Andra impose un cahier des charges précis pour les matériaux utilisés pour la fabrication des colis de stockage. Les granulats et le ciment sont choisis pour garantir leur stabilité chimique. Par ailleurs, le béton pouvant également réagir au contact de certains déchets, l’Andra interdit le mélange de certaines familles de déchets avec ce type de matériau. Pour s'assurer du respect de ces spécifications, l’Andra procède à des contrôles en complément de ceux réalisés par les producteurs de déchets, qui sont responsables de la qualité des colis livrés sur les centres de stockage. A travers ces différents contrôles, l'Andra vérifie la maîtrise globale de la qualité des colis qu'elle reçoit. Si une erreur est observée, l’agrément d’une famille de déchets pour le stockage peut être suspendu.
Concernant votre question sur les exercices de sécurité
Il n’y a pas de site nucléaire à Verdun qui justifierait l’organisation d’exercices.
Sur ses sites de stockage en exploitation, l’Andra organise régulièrement des exercices de sécurité, en lien avec les services départementaux et de secours (SDIS). Cependant, contrairement à ce qui peut être fait sur les sites des centrales nucléaires, ces exercices n’associent pas les populations locales, car les scénarios accidentels sur les installations de stockage ont des conséquences limitées, et nettement en deçà du seuil réglementaire qui imposerait des mesures de protection des populations (mise à l’abri, évacuation).
Il en sera de même pour Cigéo s’il est autorisé.
QUESTION 387
Posée par REMIFASOL, le 03/10/2013
Pouvez-vous expliquer quels moyens de transport vont être utilisés ?
Réponse du 20/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les modalités d’acheminement des colis de déchets depuis les sites où ils sont entreposés jusqu’à Cigéo sont étudiées par les producteurs de déchets (Areva, CEA et EDF). Le transport des colis par voie ferroviaire est privilégié. Le réseau ferré national permet d’acheminer les convois jusqu’à proximité de Cigéo. Différents itinéraires sont étudiés depuis les sites où sont entreposés les colis de déchets (voir carte).
La desserte locale de Cigéo est étudiée dans le cadre du schéma interdépartemental de développement du territoire. L’arrivée et le déchargement des trains se feraient dans un terminal ferroviaire spécifique. Deux options sont possibles :
- Soit le terminal ferroviaire est implanté sur une voie ferroviaire existante en Meuse ou en Haute-Marne. Le transport final jusqu’à Cigéo serait alors réalisé par voie routière;
- Soit le terminal ferroviaire est implanté sur le site même de Cigéo, ce qui nécessiterait de créer un raccordement ferroviaire d’environ 15 km.
Plus d’information : Le transport des colis de déchets (chapitre 4.3)
../docs/dmo/chapitres/DMO-Andra-chapitre-4.pdf

QUESTION 386
Posée par REMIFASOL, le 03/10/2013
J’ai entendu dire qu’il y avait de gros problèmes avec des déchets radioactifs enfouis, en Allemagne, je crois, pouvez vous confirmer ou infirmer ?
Réponse du 27/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Effectivement, le BfS (Office allemand de protection contre les radiations) a estimé que l’ancienne mine de sel d’Asse utilisée pour stocker des déchets radioactifs entre 1967 et 1978 était peu sûre en raison d’infiltrations d’eau et a recommandé que les 126 000 fûts stockés soient retirés. Pour rappeler le contexte : le stockage à Asse a été réalisé au titre du droit minier et non des réglementations de la sûreté nucléaire telles qu’elles existent aujourd’hui. Il s’agit d’une ancienne mine de sel qui a été reconvertie en un stockage de déchets radioactifs en 1967. Lors du creusement de la mine, aucune précaution n’avait été prise pour préserver le confinement assuré par le milieu géologique. Le stockage n’avait pas non plus été conçu au départ pour être réversible. Les conditions de stockage sont critiquées, certains fûts ayant été stockés en vrac, déversés depuis le haut des fosses de stockage, remblayées ensuite avec du sel. Les difficultés rencontrées aujourd’hui à Asse illustrent pleinement l’importance d’une démarche d’étude scientifique et d’évaluation préalablement à la décision de mettre en œuvre un projet de stockage.
QUESTION 385
Posée par LE PRISONNIER, le 03/10/2013
Alors que notre génération sait d’ores et déjà quoi faire des déchets radioactifs, trouvez-vous acceptable de dire à nos enfants que c’est à eux de gérer l’entreposage de nos déchets en attendant que leur "science du future" découvre une hypothétique solution pour les faire disparaître ?
Réponse du 28/10/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Personne ne peut garantir aujourd’hui que les scientifiques trouveront dans le futur une solution pour faire disparaître les déchets radioactifs. Les recherches menées depuis plus de 20 ans ont notamment montré qu’il n’était pas possible de « détruire » ou de faire disparaître les déchets radioactifs au moyen de la transmutation.
Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs produits en France depuis plus d’un demi-siècle. Grâce à la réversibilité, les générations suivantes garderont la possibilité de faire évoluer cette solution pendant au moins 100 ans. La fermeture du stockage permettra aux générations suivantes, si elles le souhaitent, de ne plus avoir à intervenir pour assurer la protection de l’homme et de l’environnement contre la dangerosité de ces déchets sur de très longues échelles de temps.
QUESTION 384
Posée par FELIX, le 03/10/2013
Avez vous pu réaliser un inventaire complet des déchets susceptibles d'être stockés dans Cigeo ?
Y compris le démantèlement à venir de la totalité des centrales nucléaire ?
Avez vous également envisagé l'enfouissement du mox usagé dans Cigeo ?
Les études de l'Andra vont-elles dans ce sens ?
Réponse du 05/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Concernant vos deux premières questions
L’inventaire détaillé des déchets radioactifs susceptibles d’être stockés dans Cigéo a été établi en lien avec les producteurs de déchets.
Le document est disponible sur le site du débat public : ../docs/rapport-etude/dechets-pris-en-compte-dans-etudes-conception-cigeo.pdf.
Cet inventaire comprend les déchets de démantèlement relevant de Cigéo qui seront produits par le démantèlement de toutes les installations nucléaires aujourd’hui autorisées. Il est à noter que la majorité du volume des déchets radioactifs produits par les opérations de démantèlement sont faiblement radioactifs et relèvent de filières de stockage en surface.
Concernant vos deux questions suivantes
La faisabilité de principe et la sûreté du stockage profond des combustibles usés, y compris des combustibles MOX usés, a été démontrée par l’Andra en 2005.
Dans le cadre de la politique énergétique actuelle en France, les combustibles usés (dont les combustibles MOX) issus de la production électronucléaire ne sont pas considérés comme des déchets mais comme des matières pouvant être valorisées, notamment dans des réacteurs de quatrième génération. A ce titre, ils ne sont pas destinés à être stockés dans Cigéo. Seuls les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue, issus du traitement de combustibles usés, sont destinés à Cigéo. Par précaution, des volumes supplémentaires (environ 20 % du volume de déchets MA-VL à stocker) sont également prévus en réserve dans Cigéo pour certains déchets de faible activité à vie longue qui, le cas échéant, ne pourraient pas être stockés dans le stockage à faible profondeur à l’étude par l’Andra.
Cigéo est néanmoins conçu pour pouvoir s’adapter à d’éventuels changements de la politique énergétique et à ses conséquences sur la nature et les volumes de déchets qui devraient alors être stockés. A la demande du ministère en charge de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, l’Andra, EDF et Areva ont étudié l’impact des différents scénarios établis dans le cadre du débat national sur la transition énergétique sur la production de déchets radioactifs et sur le projet Cigéo : ../docs/rapport-etude/20130705-courrier-ministere-ecologie.pdf. Compte tenu du volume des déchets existants déjà à stocker, l’impact d’un changement de politique énergétique n’aurait pas de conséquences sur l’exploitation de Cigéo avant l’horizon 2070/2080.
Dans le cadre du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, l’État a demandé à l’Andra de vérifier par précaution que les concepts de stockage de Cigéo restent compatibles avec l’hypothèse d’un stockage direct de combustibles usés si ceux-ci étaient un jour considérés comme des déchets. L’Andra a remis fin 2012 un rapport d’étape publié sur le site du débat : ../docs/rapport-etude/rapport-stockage-direct-combustibles-uses.pdf.
La nature et les quantités de déchets autorisés pour un stockage dans Cigéo seront fixées par le décret d’autorisation de création du centre. Toute évolution notable de cet inventaire devra faire l’objet d’un nouveau processus d’autorisation, comprenant notamment une enquête publique et un nouveau décret d’autorisation.
QUESTION 383
Posée par Raymond CHAUSSIN, le 03/10/2013
Bonjour,
Ayant travaillé dans l'industrie chimique la principale mesure pour éviter tout risque d'incendie ou explosion est l'inertage. Lorsque une réaction produisait ou mettait en œuvre de l'hydrogène les mesures de sécurité étaient particulièrement renforcées: capteurs redondants, réacteur isolé dans une cellule, installation électrique anti déflagrante soignée, continuité électrique et mise à la terre pour éviter l'électricité statique, etc...
Mettre sous terre des déchets produisant de l'hydrogène sans pouvoir inerter l'atmosphère avec comme seule mesure pour éviter l'incendie la ventilation n'est pas sérieux. Comment être sûr qu'au fond d'une galerie il n'y aura pas accumulation d'hydrogène? Une ventilation efficace doit assurer une vitesse d'atmosphère dans les galeries qu'en est-il dans les silos forcément borgnes?
Des travaux de forage sont incompatibles avec une production d'hydrogène à proximité, gestion des travaux très compliquée sur 100 ans! Non?
Réponse du 06/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Certains déchets MA-VL, notamment ceux contenant des composés organiques, dégagent de l'hydrogène non radioactif produit par radiolyse : les ¾ des colis de déchets MA-VL destinés à Cigéo dégagent peu d’hydrogène (moins de 3 litres par an et par colis), voire pas du tout. Au-delà d’une certaine quantité et en présence d’oxygène, cet hydrogène peut présenter un risque d’explosion. Pour maîtriser ce risque pendant l’exploitation de Cigéo, l’Andra fixe une limite stricte aux quantités d’hydrogène émises par chaque colis. Des contrôles seront mis en place et aucun colis ne sera accepté s’il ne respecte pas cette limite. Pour éviter l’accumulation de ce gaz, les installations souterraines et de surface seront ventilées en permanence pendant leur exploitation, comme le sont les installations d’entreposage dans lesquelles se trouvent actuellement ces déchets. Les alvéoles de stockage de colis MAVL ne sont pas borgnes et sont ainsi balayées par le flux de ventilation. Les modélisations d’aéraulique montrent que la ventilation prévue par la conception de Cigéo permet d’éviter toute zone de concentration d’hydrogène au sein des alvéoles de stockage.
Le système de ventilation du stockage fait par ailleurs l’objet de dispositions pour réduire le risque de panne (redondance des équipements, maintenance..) et des dispositifs de surveillance seront mis en place pour détecter toute anomalie sur son fonctionnement, notamment la présence d’hydrogène dans l’air à de très faibles concentrations. Des situations de perte de la ventilation sont étudiées malgré tout. Les études montrent que, dans le pire des cas, on disposera de plus d’une dizaine de jours pour rétablir la ventilation, ce qui permettra de mettre en place une ventilation de secours. Les conséquences d’une explosion sont tout de même évaluées afin d’envisager tous les scénarios possibles : les résultats montrent que les colis concernés ne seraient que faiblement endommagés, sans aucune perte de confinement des substances qu’ils contiennent.
A l’issue des études d’esquisse industrielle, l’Andra a retenu une architecture souterraine permettant de séparer la zone nucléaire de la zone en travaux, en rendant ces deux parties de l’installation complètement indépendantes dans toutes les situations de fonctionnement, normales ou accidentelles. Ainsi il n’y aura jamais de travaux de forage dans la zone où sont stockés les déchets.
QUESTION 382
Posée par Jacques MERY, le 03/10/2013
Bonjour,
En page 15 du verbatim du débat du 11 juillet 2013 est abordée la question en objet de la comparaison des coûts entre stockage et entreposage.
Dire que cela ne se compare pas, pourquoi pas, mais il faut le justifier car en effet les économistes n'ont pas inventé et raffiné le concept d'actualisation pour rien (cf. Kula, Bayer, Gollier, Stern...) !
Il est possible que cela ne puisse se comparer mais il faut le justifier sur des bases philosophiques et économiques solides, sachant qu'un taux annuel de 2% ou 3 % appliqué sur plusieurs siècles (voire millénaires ?), cela revient en effet à ne pas tenir compte des générations futures les plus éloignées : quel pourrait ainsi être l'horizon temporel pertinent de calcul pour les coûts d'entreposage ?
Y aura t-il bien un débat consacré plus spécifiquement aux aspects économiques ?
Meilleures salutations,
Réponse du 06/01/2014,
Réponse apportée l’Andra, maître d’ouvrage :
Le débat consacré aux solutions de gestion (stockage réversible, entreposage, séparation-transmutation) a eu lieu le 18 septembre 2013 et celui sur les aspects économiques le 13 novembre 2013.
La comparaison économique des coûts entre une stratégie fondée exclusivement sur l’entreposage ou une stratégie intégrant le stockage présente plusieurs limites :
- Dans son avis du 1er février 2006, l’Autorité de sûreté nucléaire a considéré qu’il ne serait pas raisonnable de retenir comme solution de référence la solution consistant à renouveler plusieurs fois un entreposage de longue durée, car elle suppose le maintien d’un contrôle de la part de la société et la reprise des déchets par les générations futures, ce qui semble difficile à garantir sur des périodes de plusieurs centaines d’années. Cette considération, faite sous l’angle de la maîtrise technique et de la sûreté, vaut aussi du point de vue économique : les travaux des économistes montrent que la défintion d’un taux d’actualisation à des échelles de temps de plus de cent ans est difficile compte tenu notamment des incertitudes prévalant sur la croissance de long terme à ces horizons de temps.
- La réversibilité du stockage pourra préserver les mêmes libertés de choix qu’une poursuite de la gestion en entreposage, mais ajoutera la possibilité de fermer le stockage pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et ne plus transmettre la charge de la gestion des déchets aux générations suivantes. Si on veut comparer les coûts et les bénéficie du stockage et de l’entreposage, il conviendrait de valoriser cette possibilité, sachant que l’évaluation devrait valoriser les projets qui laissent le plus de possibilités d’adaptation aux événements futurs.
A l’échelle séculaire, une approche globale des scénarios de gestion industrielle des déchets associant l’entreposage et le stockage a été proposée par l’Andra. Elle a montré qu’il est possible d’optimiser le système industriel constitué de l’entreposage et du stockage, ainsi que des moyens de transport entre les sites, en utilisant au mieux les capacités d’entreposage existantes ou en projet. Les flux de colis mis en stockage pourront croître progressivement pendant une première période après la mise en service de Cigéo prévue en 2025. Cela ouvre la possibilité d’une montée en puissance graduelle. Il est ensuite possible de stabiliser dans le temps le niveau d’activité industrielle de Cigéo. L’exercice a aussi montré l’intérêt d’une mise en stockage par campagnes de différentes familles de colis.
QUESTION 381 - Conditions d'emploi sur le site de Cigeo
Posée par jean-christophe BENOIT, L'organisme que vous représentez (option) (RENNES), le 03/10/2013
Les personnels ammenés à travailler sur le site seront-ils de statut privé ou fonctionnaire ? quels type d'emplois proposés : ouvrier, techniciens, ingenieurs, administratifs; - quels contrôles médicaux du travail et par qui ? - est-il possible de donner les conditions d'emploi salaires, avantages, Comité d'Entreprise,etc auront-ils à travailler le dimanche, les jours fériés, quels horaires, de nuit de jour, etc, récupération
Réponse du 27/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Si Cigéo est autorisé, on estime qu’il y aura entre 1 300 et 2 300 personnes qui travailleront sur le site pendant la première phase de construction. En phase d’exploitation ce seront entre 600 et 1 000 personnes qui travailleront de manière pérenne sur le site pour exploiter Cigéo et poursuivre en parallèle sa construction.
Les personnels de l’Andra qui travailleront sur le Centre auront un statut de droit privé. L’Andra applique aux salariés de tous ses établissements, les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie. Les prestataires appliqueront les conventions collectives des entreprises les concernant (BTP, Transport logistique…).
Tous métiers confondus, le niveau de qualification concernera environ 50 % d’ouvriers, 20 % d’agents de maîtrise, de techniciens ou d’employés et 30 % de cadres.
En matière de médecine du travail et de contrôles médicaux, le code du Travail classe les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants en deux catégories (articles R. 4451-44 à R. 4451-46 du Code du Travail) :
- Catégorie A : travailleurs ayant une exposition susceptible de dépasser les 3/10e de la limite d’exposition admissible sur 12 mois consécutifs, soit 6 milliSieverts corps entier ;
- Catégorie B : travailleurs exposés ne rentrant pas dans la catégorie A, c’est-à-dire ayant une exposition inférieure à 6 milliSieverts corps entier sur 12 mois consécutifs.
Concernant les conditions d’emplois
Les conditions d’emploi concernant la partie travaux de Cigéo font l’objet d’estimations qui peuvent être synthétisées de la façon suivante :
- Horaire normal (en journée) pour une partie du personnel en charge des travaux de creusement et pour l’ensemble des personnels affectés aux fonctions support : qualité, santé, ressources humaines, achats, comptabilité, finances, planification… L’ensemble des salariés affecté à ces missions représente env. 30 % de l’effectif considéré ;
- Horaires postés pour les personnels en charge des travaux de creusements et construction y compris l’encadrement (environ 70 % de l’effectif considéré).
Les conditions d’emploi concernant la partie exploitation de Cigéo font l’objet d’estimations qui peuvent être synthétisées de la façon suivante :
- Horaire normal (en journée) pour l’ensemble des personnels affectés aux fonctions support : sûreté, qualité, santé, sécurité, ressources humaines, achats, finances, programme… L’ensemble des salariés affectés à ces missions représente environ 50 % de l’effectif d’exploitation ;
- Posté 2*8 (deux postes de travail par jour) et horaire normal pour le personnel affecté aux tâches de production maintenance qui représente environ 35 % de l’effectif d’exploitation de Cigéo;
- Posté 5*8 (24 heures / jour, 365 jours / an) pour les personnels affectés aux tâches de gardiennage, protection physique, secours aux victimes et lutte contre l’incendie, la population concernée par ces activités représente environ 15 % de l’ensemble de l’effectif d’exploitation.
Ces estimations sont naturellement susceptibles d’évoluer en fonction de l’avancée des études.
QUESTION 380 - Stcoakage de déchets inflammables
Posée par jean-christophe BENOIT, L'organisme que vous représentez (option) (RENNES), le 03/10/2013
est- il prévu de stocker des déchets facilement inflammables de type sables ou résidus bitumeux ? - de quelle provenance - en quelles quantités et pourquoi ?
Réponse du 05/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Comme indiqué dans le document « Les déchets pris en compte dans les études de conception de Cigéo », disponible sur le site du débat public (../docs/rapport-etude/dechets-pris-en-compte-dans-etudes-conception-cigeo.pdf), le stockage de déchets bitumés dans Cigéo est étudié. En effet, ces déchets ne peuvent être stockés en surface ou à faible profondeur pour des raisons de sûreté nucléaire. Le procédé de bitumage a été largement utilisé depuis les années 1960 pour conditionner les boues issues du traitement des effluents radioactifs. Ce type de conditionnement avait été retenu car il permet d’immobiliser les substances radioactives et d’empêcher leur dispersion (par exemple en cas de chute de colis de déchets lors d’une opération de manutention), en enrobant ces substances dans une matrice de bitume.
Ces déchets sont actuellement entreposés sur les sites de Marcoule (CEA) et de La Hague (Areva NC) dans l’attente d’une filière de stockage. Les déchets bitumés de moyenne activité à vie longue représentent 13 600 m3. Plusieurs scénarios de gestion sont à l’étude pour les 12 000 m3 de déchets bitumés rattachés par le CEA à la catégorie des déchets de faible activité à vie longue. Par précaution, ces déchets sont pris en compte dans les réserves du projet Cigéo dans l’hypothèse où ils ne pourraient pas être stockés à faible profondeur.
Pour concevoir Cigéo, l’Andra prend bien sûr en compte les risques spécifiques induits par ces déchets qui contiennent des substances inflammables. Ils seront placés dans des conteneurs de stockage en béton épais (10 tonnes environ), qui assurent une protection en cas d’incendie et qui font l’objet d’essais de feu à l’échelle 1. L’Andra impose également une limitation drastique de toutes les charges calorifiques dans les équipements du stockage (par exemple les moteurs à diesel seront interdits dans la partie nucléaire de l’installation souterraine). Un départ de feu étant malgré tout toujours possible, des dispositifs de détection et d’extinction seront répartis dans le stockage et des systèmes de compartimentage excluront toute propagation d’un incendie. Des véhicules de pompiers seront prépositionnés en souterrain pour permettre d’intervenir rapidement si nécessaire.
Le stockage de ces déchets dans Cigéo ne pourra être autorisé par l’Autorité de sûreté nucléaire que si l’Andra démontre qu’elle maîtrise les risques associés à leur stockage.
QUESTION 379 - Procédures de vérification et de contrôle des déchets à leur arrivée
Posée par Jean-christophe BENOIT, L'organisme que vous représentez (option) (RENNES), le 03/10/2013
Lorqu'un colis ou des déchets radio-actifs arriveront sur le site, quels contrôles seront effectués :
- vérification systèmatique de tous les colis ou échantillonage ?
- verification uniquement sur les documents de livraisons ou vérifications physiques ? masse des colis, identification et quantité de chaque déchets, verification des containers,
- quelles procédures en cas de non conformité ?: ex : déchet non prévu, quantité non prévue, défaut sur conteneur, origine non identifiée, retour à l'envoyeur, etc
- le service ou les personnes affectées à ce contrôle ne seraient-ils pas soumis à des pressions afin de ne pas trop en faire ou laisser passer ?
Réponse du 06/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les colis reçus sur Cigéo devront respecter les critères d’acceptation définis par l’Andra. Avant expédition des colis, l’Andra s’assurera du respect de ces critères, au moyen de contrôles réalisés par les producteurs aux différentes étapes de production, d’entreposage, et de désentreposage des colis, et au moyen d’une surveillance exercée par l’Andra chez les producteurs. L’Andra effectuera par précaution de nouveaux contrôles à la réception des colis, à titre de vérification et de traçabilité.
Les colis destinés à être stockés dans Cigéo feront ainsi l’objet de contrôles systématiques (identification, intégrité physique, masse et dimensions, contrôles radiologiques, vérification de la cohérence entre les données déclarées par les producteurs et les valeurs mesurées…) avant départ du site producteur et à l’arrivée lors du déchargement sur Cigéo.
En cas de colis non conforme, celui–ci fera l’objet si nécessaire d’un reconditionnement et/ou d’un renvoi du colis chez le producteur le cas échéant.
Des contrôles de second niveau par échantillonnage seront également effectués sous la responsabilité de l’Andra par des entités indépendantes des équipes de production de l’Andra.
Les installations des producteurs tout comme celles de l’Andra sont soumises au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire qui vérifie entre autre au travers d’inspections régulières que le processus de contrôle de la qualité des colis est satisfaisant.
QUESTION 378
Posée par Guy PREVOT (ANDERNAY), le 02/10/2013
L'Etat s'est-il engagé à des compensations financières en contrepartie du stockage? Sur quelle durée? Pour quel montant?
Réponse du 23/12/2013,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Le projet Cigéo sera soumis à la fiscalité locale, notamment la taxe foncière et la contribution économique territoriale. Ces taxes seront versées par l’Andra pendant toute la durée de vie de l’installation. Les montants de fiscalité précis sont en cours d’évaluation dans le cadre du chiffrage du projet.
Le Comité de Haut Niveau, regroupant les élus locaux meusiens et haut-marnais, les producteurs de déchets, l’Andra et les services de l’Etat, a retenu le principe de la création d'une Zone Interdépartementale (ZID) regroupant les communes les plus proches de Cigéo. L’objectif de la ZID est de permettre de redistribuer de manière adéquate au sein des communes, des communautés de communes et des deux départements les revenus fiscaux générés par CIGEO. Cette ZID sera dotée d’une gouvernance afin d’accompagner le développement du territoire suite à l’implantation du stockage.
QUESTION 377
Posée par Nathalie BOFFY (AGEVILLE), le 02/10/2013
Qui travaille sur la réversibilité? Quelqu'un y travaille-t-il seulement? En combien de temps, le site de Bure sera-t-il plein? Avec les déchets français ou autres?
Réponse du 06/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Concernant votre première question
La réversibilité est au cœur des études menées par l’Andra sur le projet Cigéo (voir ../docs/rapport-etude/fiche-reversibilite-cigeo.pdf). Les propositions de l’Andra soumises au débat public visent à répondre aux attentes identifiées dans le cadre d’une large démarche d’échanges et de dialogue menée depuis 2006. Cette démarche a été conduite à la fois au niveau local (échanges avec le Comité local d’information et de suivi qui a mis en place une commission sur la réversibilité, rencontres avec les acteurs locaux et le public), au niveau national (colloques scientifiques, échanges avec les évaluateurs, rencontres avec des associations) et au niveau international (projet international sous l’égide de l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’OCDE, conférence internationale de Reims en décembre 2010). C’est ensuite le Parlement qui fixera les conditions de réversibilité du stockage.
Concernant votre seconde question
Si Cigéo est autorisé, son exploitation se fera de manière très progressive. La durée nécessaire pour stocker les déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue produits par les installations nucléaires passées et existantes en France est de l’ordre d’une centaine d’années. Pendant toute cette durée, l’Andra propose que des rendez-vous périodiques soient organisés avec l’ensemble des acteurs concernés (riverains, collectivités, évaluateurs, Etat…) pour contrôler le déroulement du stockage.
Concernant votre troisième question
La loi française interdit le stockage en France de déchets radioactifs en provenance de l’étranger. Cigéo est uniquement destiné aux déchets les plus radioactifs produits par les installations nucléaires françaises.
QUESTION 376
Posée par Raymond CHRETIEN (VAUDEVILLE LE HAUT), le 02/10/2013
Comment ferez-vous pour extraire les déchets enfouis en cas de nécessité sachant que les sous sols bougent continuellement?
Réponse du 27/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’Andra prévoit dès la conception de Cigéo des dispositifs techniques destinés à faciliter le retrait éventuel de colis de déchets stockés. En particulier, les alvéoles pour stocker les colis de déchets seront revêtues d’une paroi en béton ou en acier pour éviter les déformations et garantir l’accès aux colis de déchets, avec des espaces ménagés entre les colis et les parois pour permettre leur retrait. Les essais réalisés pour tester ces dispositions sont présentés en Meuse/Haute-Marne au Laboratoire souterrain et à l’Espace technologique de l’Andra.
Pour en savoir plus sur les propositions faites par l’Andra en matière de réversibilité du stockage, voir ../docs/rapport-etude/fiche-reversibilite-cigeo.pdf
QUESTION 375
Posée par Clément CONTER, le 01/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 18 septembre 2013 - Les solutions de gestion des déchets radioactifs :
Quelle est la durée de surveillance du site après la fin de l'entreposage et quelles sont les surveillances prévues?
Réponse du 02/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le principe du stockage profond est que sa sûreté à long terme ne repose pas sur des actions humaines, notamment sur une surveillance du site, mais sur le milieu géologique. La surveillance du site pourra néanmoins être maintenue aussi longtemps que les générations futures le souhaiteront et contribuera au maintien de la mémoire du stockage. L’Andra présentera dans sa demande d’autorisation de création du stockage les modalités envisagées pour la surveillance du stockage après sa fermeture (surveillance depuis la surface, à partir de forages à faible profondeur, surveillance de l’environnement…).
QUESTION 374
Posée par Cécile , le 01/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 18 septembre 2013 - Les solutions de gestion des déchets radioactifs :
Déjà 30 ans de recherche, ne pensez-vous pas que l'on a déjà trouvé et démontré que seul le stockage était la solution? Il est temps d'agir non?
Réponse du 20/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Effectivement, le stockage profond est aujourd’hui la seule solution robuste pour mettre en sécurité à très long terme les déchets les plus radioactifs. Cette solution est étudiée depuis plus de 20 ans.
Différentes solutions ont été étudiées dans le cadre du programme de recherches institué par la loi de 1991. Les résultats de ces recherches ont été évalués en 2005/2006 et un débat public a été organisé sur la politique nationale de gestion des déchets radioactifs. Sur la base de l’ensemble de ces éléments, le Parlement a fait le choix en 2006 du stockage profond réversible pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations futures. Le Parlement a demandé à l’Andra de préparer la mise en œuvre de cette solution.
Le débat public en 2013 est une étape importante pour le projet. L’Andra prendra en compte les recommandations issues du débat pour élaborer le dossier de demande d’autorisation de création de Cigéo. L’instruction de cette demande par les évaluateurs durera plusieurs années et les collectivités territoriales seront saisies pour avis. Une loi devra préciser les conditions de réversibilité du stockage. Une enquête publique sera également organisée. Ce n’est qu’après l’ensemble de ces étapes que le stockage pourra être mis en œuvre. Sa mise en service est prévue en 2025, s’il est autorisé.
Réponse apportée par Bernard Laponche, polytechnicien, docteur ès sciences en physique des réacteurs nucléaires, docteur en économie de l'énergie, membre de l'association Global Chance (www.global-chance.org) :
Les premiers programmes de recherche ne datent que du milieu des années 1990 (programme PACE du CNRS). Un des problèmes rencontrés par ces programmes était qu'ils devaient tenir compte du retraitement (imposé pour des raisons politiques) qui a de fait imposé de ne se préoccuper que des déchets les plus "dangereux". Il était déjà décidé que les déchets de moindre activité ou de durée de vie courte devaient être stockés et surveillés durant 300 à 800 ans.
C'est devant l'impossibilité technique, énergétique et financière que l'on a considéré l'enfouissement comme une "solution". Le résultat aujourd'hui est que lorsqu'un centre de stockage ou d'enfouissement sera saturé, on cherchera à en ouvrir un autre, autre part. Le plus simple serait probablement d'arrêter le nucléaire (qui pose également des risques d’accidents majeurs), a minima le temps de trouver une vraie solution.
Effectivement, aucune solution satisfaisante n’a été jusqu’ici trouvée pour éliminer les déchets radioactifs ni même pour en réduire les risques qu’ils présentent, jusqu’à des centaines de milliers d’années pour certains d’entre eux.
C’est dès l’origine de la découverte de la possibilité d’utiliser l’énergie nucléaire par la fission des noyaux d’uranium 235 que l’impossibilité de traiter la question des déchets aurait dû amener à renoncer à cette technique. Il n’en a rien été. Au contraire : en 1974 déjà, les scientifiques savaient que le problème des déchets nucléaires deviendrait crucial. Mais certains d'entre eux estimaient que "avant que ce problème ne soit crucial, les scientifiques auront trouvé une solution" (Louis Leprince-Ringuet). C'était encore l'époque de la confiance absolue en la science…
Conscients de cette impasse, certains pays qui avaient développé cette utilisation y ont renoncé et notamment deux des quatre principaux pays de l’Union Européenne, l’Italie et l’Allemagne. La position de l’Allemagne a été clairement exposée par Wolfgang Renneberg, directeur général chargé de la sûreté nucléaire au ministère de l’environnement de l’Allemagne, de novembre 1998 à novembre 2009, dans un discours prononcé à Madrid, le 24 Mai 2001 :
« Comme vous le savez tous, le gouvernement de l'Allemagne a décidé d'éliminer progressivement l'utilisation commerciale de l'énergie nucléaire. Je vais préciser quelques-unes des raisons les plus pertinentes qui fondent cette décision.
La décision du gouvernement d’éliminer cette utilisation résulte d'une réévaluation des risques que présente cette technologie. Nous ne disons pas que les centrales électriques en Allemagne ne sont pas sûres au regard des standards internationaux. Cependant, le gouvernement allemand est d'avis que l'ampleur des effets des accidents nucléaires possibles est telle que cette technique ne peut être justifiée, même si la probabilité d'un tel accident est faible.
Une raison supplémentaire est qu’aucune solution pratique au problème de l'élimination finale des déchets hautement radioactifs n'a encore été trouvée. Les déchets radioactifs sont un fardeau pour les générations futures. L’arrêt définitif de la production d’électricité d’origine nucléaire supprime la production de nouveaux déchets.
Une autre raison est que les nombreuses mesures qui sont nécessaires pour réduire les risques d’une utilisation des matériaux fissiles à des fins destructrices au niveau national et international ne peuvent remplir leur fonction de protection, de sûreté et de contrôle que si les pays concernés jouissent de conditions sociales, économiques et politiques stables. La fin de l'utilisation commerciale de l'énergie nucléaire en Allemagne et l'arrêt du retraitement du combustible allemand réduit le stock de matériaux « proliférants ». À cet égard, ce choix contribue à réduire les risques de prolifération. »
Et cela était dit bien avant Fukushima.
La même décision serait possible en France.
A tout le moins, il est en tout cas indispensable de réduire la quantité de déchets radioactifs produits et cela de trois façons complémentaires :
- réduire les consommations d’électricité, notamment pour les usages qui lui sont spécifiques (électroménager, audiovisuel, bureautique et informatique dans les secteurs résidentiel et tertiaire représentent environ la moitié de la consommation totale d’électricité en France) ;
- ne pas exporter d’électricité d’origine nucléaire (actuellement la réduction d’environ dix unités de 900 MW de puissance électrique, dont on garde en France les déchets nucléaires qui en résultent ;
- réduire la production d’origine nucléaire au profit de la production d’origine renouvelable (notamment éolien et photovoltaïque).
De plus, il est indispensable d’arrêter la production de plutonium par le retraitement des combustibles irradiés car c’est une industrie à haut risque et polluante, tant au niveau de l’usine de La Hague que de l’usine Melox de fabrication des combustibles MOX et des transports de plutonium. Sans parler du risque d’extension de la prolifération des armes nucléaires, l’une des raisons de la décision allemande.
QUESTION 373
Posée par GUINESS11, le 01/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 18 septembre 2013 - Les solutions de gestion des déchets radioactifs :
Pourquoi un entreposage à 500m de fond serait-il moins sûr que l'entreposage en surface? (argument des opposants au projet qui veulent laisser les déchets à la surface)
Réponse du 20/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
En France, toute installation nucléaire répond à des exigences de sûreté contrôlées par l’Autorité de sûreté nucléaire. Ainsi, quelle que soit sa situation, en surface ou en profondeur, une installation gérant des déchets radioactifs doit garantir le confinement de la radioactivité contenue dans les déchets. Cette garantie doit être apportée y compris en situation accidentelle. Par exemple, des mesures renforcées sont prises vis-à-vis du risque incendie pour une installation souterraine. En France comme à l’étranger, le stockage profond est privilégié car une installation située à 500 mètres de profondeur offre la possibilité de mettre en sécurité les déchets radioactifs sur le très long terme contrairement à un entreposage en surface. De plus une installation souterraine est par nature moins vulnérable aux agressions externes (conditions météorologiques extrêmes, chute d’avion, actes de malveillance…) qu’une installation située en surface.
Réponse apportée par Bernard Laponche, polytechnicien, docteur ès sciences en physique des réacteurs nucléaires, docteur en économie de l'énergie, membre de l'association Global Chance (www.global-chance.org) :
Nous avons exposé précédemment l’intérêt d’un entreposage de longue durée en sub-surface pour permettre à la fois la sécurisation des déchets par rapport à des agressions extérieures et le contrôle régulier de la sûreté de façon à pouvoir intervenir si des problèmes surgissent ou si l’on a trouvé une solution préférable.
L’inconvénient majeur de l’enfouissement en profondeur, solution qui serait probablement adoptée non seulement pour des déchets radioactifs mais aussi pour des déchets toxiques d’origines chimiques, serait la pollution de la croûte terrestre, en un nombre rapidement inconnu de sites, avec des conséquences qui peuvent être dramatiques sur l’eau et l’exploitation éventuelle des richesses du sous-sol (faites dans des conditions correctes), la géothermie par exemple.
De plus, le projet Cigeo lui-même présente suffisamment de risques de sûreté pendant toute la durée de son exploitation (incendies, explosions) pour qu’on puisse considérer qu’il est plus sûr que l’entreposage à sec en sub-surface que nous recommandons comme étant la moins mauvaise solution.
QUESTION 372
Posée par Florence LAVERGNE, le 01/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 18 septembre 2013 - Les solutions de gestion des déchets radioactifs :
Le dossier donne quelques exemples de stockages profonds dans des roches de natures très différentes, notamment argiles et granites. L'exposé du chapitre 3 du dossier explicite un choix par défaut dans une couche d'argile. Quelles sont les avantages versus les inconvénients de chacune des formations selon leur nature? Toutes les générations futures requièrent en effet la meilleure solution, et pas la solution par défaut q'un petit bout de la seule génération actuelle aurait refusé.
Réponse du 20/11/2013,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
Selon les pays et leur géologie, plusieurs types de roches sont étudiés pour l’implantation de stockages profonds. Dans tous les cas, la conception du stockage doit être adaptée aux caractéristiques de la roche hôte et du site d’implantation.
Le granite est une roche avec une résistance mécanique importante, ce qui facilite le creusement des ouvrages souterrains. Cette roche peut néanmoins présenter des fractures par lesquelles l’eau peut circuler. Les concepts de stockage dans le granite étudiés en Suède et en Finlande prévoient des conteneurs de stockage en cuivre protégés par de l’argile gonflante placée entre ces conteneurs et le granite pour assurer le confinement à long terme de la radioactivité. L’Andra a poursuivi ses recherches sur le milieu granitique jusqu’en 2005, en s’appuyant notamment sur les travaux menés dans les laboratoires souterrains d’autres pays. Ces recherches ont conduit l’Andra à conclure qu’un stockage dans les massifs granitiques ne présenterait pas de caractère rédhibitoire mais que la principale incertitude porte sur l’existence de sites en France avec un granite ne présentant pas une trop forte densité de fractures.
L’argile est très peu perméable et possède la propriété de pouvoir fixer un grand nombre d’éléments chimiques grâce à sa microstructure en feuillets. La roche étudiée par l’Andra au moyen du Laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne possède des propriétés favorables pour confiner la radioactivité à très long terme : l’eau n’y circule pas, la couche est homogène et son épaisseur est importante (plus de 130 mètres). Aucune faille affectant cette couche n’a été mise en évidence sur la zone étudiée. Contrairement au granite, les galeries souterraines doivent être soutenues avec un revêtement en béton ou en acier. Plusieurs pays étudient également l’option d’un stockage dans l’argile (Belgique, Japon, Suisse).
Réponse apportée par Bernard Laponche, polytechnicien, docteur ès sciences en physique des réacteurs nucléaires, docteur en économie de l'énergie, membre de l'association Global Chance (www.global-chance.org) :
Très brièvement : le granite présente l'avantage d'une bonne résistance aux radiations, et d'une bonne stabilité, mais compte tenu des multiples fractures qu'il contient, il est impossible de garantir que l'eau ne s'infiltrera jamais. L'argile présente l'avantage d'être étanche à l'eau (jusqu'à un certain point), et surtout d'être souple : l'argile se "refermerait" autour des colis de déchets, mais cela entraînerait qu'il serait impossible de récupérer les déchets, et même de connaître précisément leur localisation.
QUESTION 371
Posée par Roger NICOLAS, le 01/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 18 septembre 2013 - Les solutions de gestion des déchets radioactifs :
Je viens de lire les réponses aux lecteurs de Bernard Laponche dans l’Est Républicain et j’aimerais que M. Laponche explique ce qu’il entend par « stockage à sec en sub-surface » car il semble que ce soit la moins mauvaise solution. Merci d’avance.
Réponse du 18/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’article L. 542-1-2 du code de l’environnement définit les termes « stockage » et « entreposage » :
- « Le stockage de déchets radioactifs est l’opération consistant à placer ces substances dans une installation spécialement aménagée pour les conserver de façon potentiellement définitive dans le respect des principes énoncés à l’article L. 542-1 » [protection de la santé des personnes, de la sécurité et de l’environnement].
- « L’entreposage de matières ou de déchets radioactifs est l’opération consistant à placer ces substances à titre temporaire dans une installation spécialement aménagée en surface ou en faible profondeur à cet effet, dans l’attente de les récupérer ».
En aucun cas les déchets les plus radioactifs ne pourraient être stockés définitivement en surface ou en sub-surface à faible profondeur. En effet, les conséquences radiologiques sur l’homme et l’environnement à long terme ne seraient pas acceptables. Un stockage en sub-surface n’est donc pas une solution pour gérer de manière définitive les déchets les plus radioactifs, contrairement au stockage à 500 mètres de profondeur étudié par l’Andra dans une couche d’argile capable de confiner la radioactivité sur le très long terme.
Des études ont également été menées sur l’entreposage de longue durée en subsurface. Dans le cadre du programme de recherches mis en place par la loi du 30 décembre 1991, le CEA a ainsi étudié des concepts d’entrepôts en surface et en sub-surface dont la durée de vie irait jusqu’à 300 ans. Dans son avis du 1er février 2006, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) estime toutefois qu’il ne serait pas raisonnable de retenir comme solution de référence la solution consistant à renouveler plusieurs fois un entreposage de longue durée, car elle suppose le maintien d’un contrôle de la part de la société et la reprise des déchets par les générations futures, ce qui semble difficile à garantir sur des périodes de plusieurs centaines d’années. Dans ces conditions, l’ASN considère que l’entreposage de longue durée ne peut pas constituer une solution définitive pour la gestion des déchets radioactifs de haute activité à vie longue. L’avis de l’ASN est consultable sur le site du débat public : ../docs/docs-complementaires/docs-avis-autorites-controle-evaluations/01-02-06-recherche-gestion-dechets-havl.pdf
L’Andra a publié en 2012 un bilan des études et recherches qu’elle a menées sur l’entreposage pour les déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue. L’Andra a étudié des solutions d’entreposage en sub-surface (voir le chapitre 6 du bilan). Du point de vue de la robustesse, la possibilité pour des ouvrages souterrains d’offrir une grande résistance à une agression externe (chute d’avion en particulier) ne compense pas nécessairement un fonctionnement moins passif et une plus grande complexité des systèmes de refroidissement. De plus, il est possible d’assurer une protection efficace vis-à-vis du risque de chute d’avion au moyen du génie civil d’un entrepôt en surface. En Allemagne, la majorité des entrepôts renforcés vis-à-vis des agressions externes adoptent ainsi une implantation en surface. La comparaison entre installations en surface et installations réalisées en souterrain fait ainsi apparaître une plus grande complexité des secondes, sans contrepartie notable en matière de robustesse : difficulté accrue de mise en place d’une convection naturelle pour la ventilation, nécessité de protection de l’entrepôt vis-à-vis de l’eau souterraine, augmentation du nombre de ruptures de charges pour les manutentions... Ce diagnostic spécifique à des installations d’entreposage visant à des fonctions comparables ne s’applique pas à la comparaison entre une installation d’entreposage en surface et une installation de stockage en profondeur : si la première est effectivement plus simple et de moindre coût, elle ne permet de gérer les colis de déchets de manière sûre que sur une durée d’un siècle au plus, alors que la seconde apporte une solution qui peut devenir définitive, tout en laissant aux générations suivantes la possibilité de faire évoluer pendant au moins 100 ans cette solution si elles le souhaitent, grâce à la réversibilité. Le bilan des études et recherches menées par l’Andra sur l’entreposage est consultable sur le site du débat public : ../docs/decisions/Rapport-2012-Andra-entreposage.pdf
Réponse apportée par Bernard Laponche, polytechnicien, docteur ès sciences en physique des réacteurs nucléaires, docteur en économie de l'énergie, membre de l'association Global Chance (www.global-chance.org) :
Il y a dans la dénomination « stockage à sec en sub-surface » deux composantes : l’entreposage à sec qui est une technique et la sub-surface qui est un contenant.
L’entreposage à sec existe déjà en France pour plusieurs types de déchets :
- Les verres produits à La Hague qui contiennent les produits de fission et les actinides mineurs (éléments plus lourds que l’uranium, hors plutonium) qui sont issus des combustibles usés provenant des réacteurs et séparés par le retraitement : ils sont entreposés à La Hague dans des silos verticaux et, comme ils sont très chauds, ils sont refroidis par une ventilation naturelle forte et une ventilation forcée. Ce sont des déchets HA-VL (haute activité, vie longue).
- Le plutonium issu lui aussi du retraitement et non utilisé pour faire des combustibles MOX (un stock de 56 tonnes environ à La Hague fin 2012, dont 18,2t issues de combustibles usés d’origine étrangère) est lui aussi entreposé à sec « sur les étagères » à La Hague (le plutonium est très dangereux en cas d’inhalation ou d’ingestion mais émet peu de rayonnement gamma et n’a pas besoin d’être refroidi) .
- Les déchets MA-VL (moyenne activité, vie longue) et notamment les déchets en conteneurs de bitume sont entreposés à La Hague dans des hangars ventilés, sans autre protection.
Mais le plus intéressant est que, en Allemagne et surtout aux Etats-Unis, les combustibles usés (ou combustibles irradiés) qui sont considérés comme des déchets puisqu’ils ne sont pas retraités comme en France (qui est pratiquement le seul pays à le faire à grande échelle), ont développé et développent des entreposages de longue durée sur le site même des centrales nucléaires (ce qui évite les transports), à sec, pour les combustibles usés, après un séjour d’environ cinq ans dans les piscines de refroidissement situées auprès des réacteurs nucléaires. Les assemblages de combustibles sont placés chacun dans des conteneurs métalliques de type « Castor » (ceux utilisés pour le transport des assemblages pour retraitement à La Hague) ou dans des conteneurs en béton.
Aux Etats-Unis, la centrale de Surry (deux réacteurs de 840 MW de puissance électrique chacun, à uranium enrichi et eau sous pression, du même type que les 58 réacteurs des centrales nucléaires françaises) est la première centrale à avoir adopté le stockage à sec pour ses combustibles usés.
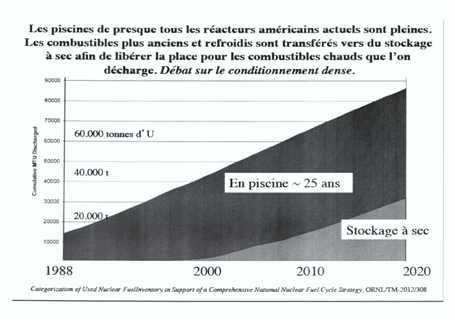
Source : Franck Von Hippel (International Panel on Fissile Material,
Quant à la « sub-surface », il s'agit de stocker les combustibles irradiés des centrales sans aucun retraitement dans des galeries creusées à faible profondeur, on dans le flanc de montagnes granitiques. De la sorte, on facilite la surveillance, et on garantit la possibilité d'extraire ces combustibles dans le cas d'une solution technique. C'est la solution préconisée (avec quelques variantes) par la plupart des pays nucléarisés.
Cette méthode peut s’appliquer également aux conteneurs (bien conditionnés) des déchets MA-VL existants, sachant que le meilleur entreposage de longue durée des verres HA existants est actuellement celui de La Hague.
QUESTION 370
Posée par , le 01/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 18 septembre 2013 - Les solutions de gestion des déchets radioactifs :
On parle beaucoup des déchets à produire, c'est très bien, mais que fait-on de ceux qui sont déjà produits?
Réponse du 18/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Aujourd’hui, 90 % du volume des déchets radioactifs produits chaque année en France dispose d’une solution de stockage opérationnelle. Il s’agit de déchets radioactifs de très faible activité ou de faible et moyenne activité à vie courte qui peuvent être pris en charge dans les centres de stockage de surface exploités par l’Andra. Ce système industriel reste à compléter pour les autres catégories de déchets radioactifs : ceux de faible activité à vie longue (FA-VL) pour lesquels l'Andra étudie des solutions de gestion et ceux de moyenne activité à vie longue (MA-VL) et de haute activité (HA), qui pourraient être accueillis dans Cigéo (projet de stockage géologique profond), s’il est autorisé.
A ce jour, environ 43 000 m3 de déchets HA et MA-VL ont déjà été produits, depuis une cinquantaine d’années. Dans l’attente d’une solution de gestion à long terme, ils sont provisoirement entreposés dans des bâtiments sur leur site de production, notamment à La Hague (Manche), Marcoule (Gard) et Cadarache (Bouches-du-Rhône) et, pour un volume limité, à Valduc (Côte d’Or). Ces bâtiments sont sûrs mais ne sont pas conçus pour confiner la radioactivité sur de longues échelles de temps. Le projet Cigéo vise en premier lieu à proposer une solution pour mettre en sécurité de manière définitive ces déchets, qui sont déjà produits.
D’autres déchets HA et MAVL seront inévitablement produits par le parc électronucléaire actuel dans les années à venir, quels que soient les choix énergétiques futurs. Cigéo, s’il est autorisé, permettra également de prendre en charge ces déchets « engagés ».
Réponse apportée par Bernard Laponche, polytechnicien, docteur ès sciences en physique des réacteurs nucléaires, docteur en économie de l'énergie, membre de l'association Global Chance (www.global-chance.org) :
Il y a effectivement une grande quantité et une grande variété de déchets déjà produits. Pour s’en tenir à ceux résultant de la production d’électricité à partie de la chaleur produite dans les réacteurs nucléaires, on trouve d’abord les combustibles irradiés qui sont entreposés dans les piscines voisines des réacteurs, puis dans la grande piscine de La Hague, en attente du retraitement (production de plutonium, séparation de l’uranium restant, dit uranium appauvri de retraitement, produits de fission et actinides autres que le plutonium). Le retraitement des combustibles irradiés qui permet cette séparation des composants des combustibles irradiés engendre de nouvelles catégories de déchets (tout en réduisant la quantité de combustibles irradiés) : les verres qui renferment les produits de fission et les actinides hors plutonium et sont entreposés pour plusieurs dizaines d’années à La Hague, des déchets liés aux opérations de retraitement (gaines des combustibles, boues de traitement des effluents, équipements usés radioactifs, etc.), du plutonium non réutilisé dans les combustibles MOX (environ 90 tonnes à La Hague dont une trentaine issus de combustibles irradiés étrangers). Il faut également noter que le retraitement ne s’applique qu’aux combustibles à uranium naturel enrichi, tandis que les combustibles MOX ne sont pas retraités et restent stockés dans les piscines de La Hague. Il faut ajouter à cette liste déjà longue les résidus des mines d’uranium exploitées en France dans le passé, l’uranium issu du retraitement des combustibles irradiés (24000 tonnes fin 2010), l’uranium appauvri issu de l’enrichissement de l’uranium naturel (271000 tonnes accumulées fin 2010), les déchets des usines de fabrication des combustibles (notamment du combustible MOX). Soulignons par ailleurs que l’utilisation du plutonium dans les combustibles MOX ne diminue la quantité de plutonium (entre combustible neuf et combustible irradié) que de 20% environ et que les combustibles MOX irradiés, outre le fait qu’il ne peuvent pas être retraités à de forts tonnages dans les conditions actuelles, sont beaucoup plus chauds et radiotoxiques que les combustibles irradiés issus de combustibles à uranium enrichi.
Pour les déchets de faible activité (qui proviennent actuellement surtout des usines de retraitement et des centrales nucléaires mais auxquels il faudra ajouter beaucoup de déchets provenant du démantèlement des réacteurs nucléaires lorsqu’ils seront arrêtés, il existe actuellement trois centres de stockage en surface gérés par l’Andra à Soulaine, Morvilliers et La Hague (centre de stockage de la Manche).
Ces différents stockages et entreposages ne sont pas sans poser des problèmes (notamment pour le centre de La Manche mais la situation la plus à risque se présente pour l’entreposage des combustibles irradiés (en particulier MOX) dans les piscines des centrales nucléaires et surtout celle de La Hague qui contient environ l’équivalent de cent chargements complets d’un réacteur de puissance (environ 1000 MW de puissance électrique). En effet, ces piscines ne sont pas sécurisées par rapport à des agressions extérieures naturelles, terroristes ou militaires), situation qui ne peut perdurer et a été soulignée par l’autorité de sûreté.
On a ainsi toute une gamme de déchets, depuis des matières entreposées dont une partie sera retraitée (les combustibles à uranium) jusqu’aux résidus des mines, en passant par toutes les catégories qui se distinguent par leur activité (haute activité HA, moyenne activité MA, faible activité FA) et la durée de vie (on parle de « demie vie » qui est le temps au bout duquel la quantité initiale du produit concerné a été réduite de moitié), celles-ci allant jusqu’à des centaines de milliers d’années pour certains produits.
Les déchets radioactifs prévus pour le stockage dans Cigeo (HAVL, les verres stockés à La Hague, et MAVL , en conteneurs de bitume ou de béton) ne constituent donc qu’une partie minoritaire de l’ensemble des déchets (non seulement en volume mais aussi en radioactivité) actuellement sur le territoire, que ceux-ci soient appelés dans le langage « nucléaire » déchets radioactifs ou matières récupérables (comme le plutonium), en sachant qu’une très grande partie ne sera probablement pas récupérée. Cela s’appliquant évidemment au plutonium qui est présent à la fois « sur les étagères » de La Hague et dans les combustibles MOX irradiés
Ce qui paraît de la première urgence est d’assurer la sécurité des stockages et entreposages actuels, avant de se lancer dans des opérations de stockage en profondeur. Ajoutons pour être complets que la France, qui a choisi le retraitement, ne retraite qu’un millier de tonnes de combustibles irradié par an, alors que nos centrales en "produisent " 1200 tonnes par an. Il y a donc accumulation progressive de combustibles irradiés non retraités qu’il va falloir entreposer dans des conditions de sécurité acceptables.
QUESTION 369
Posée par , le 01/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 18 septembre 2013 - Les solutions de gestion des déchets radioactifs :
La séparation-transmutation pourra-t-elle supprimer tous les déchets HA et MAVL déjà produits?
Réponse du 28/10/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Non, la séparation-transmutation ne peut pas supprimer les déchets de haute activité (HA) et de moyenne activité à vie longue (MAVL) déjà produit ou à produire. Les résultats des recherches menées depuis plus de 20 ans, notamment par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), ont montré que la séparation/transmutation ne supprime pas la nécessité d’un stockage profond car elle ne serait applicable qu’à certains radionucléides contenus dans les déchets (ceux de la famille de l’uranium). Par ailleurs, les installations nucléaires nécessaires à la mise en œuvre d’une telle technique produiraient des déchets qui nécessiteraient aussi d’être stockés en profondeur pour des raisons de sûreté. Il n’est donc pas possible de « détruire » ou de faire disparaître ces déchets radioactifs.
Plus de renseignements : Les rapports de recherche - Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) - Dossier 2012 – Tome 2 – Séparation-transmutation des éléments radioactifs à vie longue
../informer/documents-complementaires/rapports-autorites-evaluations-ponctuelles.html
Réponse apportée par Bernard Laponche, polytechnicien, docteur ès sciences en physique des réacteurs nucléaires, docteur en économie de l'énergie, membre de l'association Global Chance (www.global-chance.org) :
En aucun cas. Pour transmuter, il faut « sur-irradier » les déchets avec des neutrons. Et l’énergie de ces neutrons dépend des éléments contenus dans les déchets. Il faudrait donc séparer complètement tous les déchets (techniquement à peu près impossible, financièrement très élevé), et en outre, cela ne « supprime » pas les déchets. Cela diminue simplement la durée de vie d’une partie des déchets (de 10 000 ans à … quelques centaines d’années). La transmutation est encore étudiée par le CEA, mais cela ne concerne qu’une infime partie des déchets. Et le débat de 2006 à conclu que ce ne pouvait pas devenir une solution industrielle pour les dizaines de milliers de tonnes de déchets existants.
Mais le fait que cette voie de recherche paraisse décevante n’est pas une justification pour ne pas poursuivre les efforts de en vue de réduire la nocivité des déchets radioactifs. La poursuite de ce domaine de la recherche doit être une priorité.
QUESTION 368
Posée par Juliette GUILLARD, le 01/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 18 septembre 2013 - Les solutions de gestion des déchets radioactifs :
Pourquoi revient-on encore sur les décisions prises par le Parlement il y a 10 ans? Est-ce responsable de toujours reporter le problème et de ne jamais prendre de décisions?
Réponse du 20/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La France a été l’un des premiers pays à prendre conscience de la nécessité de mettre en place une politique responsable de gestion des déchets radioactifs. Après 15 années de recherches, leur évaluation et un premier débat public sur la politique nationale de gestion des déchets radioactifs, le Parlement a retenu en 2006 le stockage réversible profond comme solution de référence pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations futures. Le Parlement a demandé à l’Andra de concevoir un projet de stockage et a souhaité qu’un débat public soit organisé sur le projet étudié par l’Andra avant le dépôt de la demande d’autorisation de création du stockage. C’est ce projet, résultat des études menées par l’Andra depuis 2006, qui est aujourd’hui présenté au débat public.
La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra à l’État après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo en 2015 conformément au calendrier fixé par la loi du 28 juin 2006. Ce processus comprendra notamment l’évaluation de la sûreté par l’Autorité de sûreté nucléaire, l’évaluation des recherches scientifiques par la Commission nationale d’évaluation, l’avis des collectivités territoriales, le vote d’une nouvelle loi fixant les conditions de réversibilité, la mise à jour de la demande de création de Cigéo par l’Andra suite à cette loi, et une enquête publique. Si Cigéo est autorisé, les travaux de construction pourraient débuter en 2019 pour une mise en service en 2025, sous réserve de l’autorisation de l’Autorité de sûreté nucléaire.
Réponse apportée par Bernard Laponche, polytechnicien, docteur ès sciences en physique des réacteurs nucléaires, docteur en économie de l'énergie, membre de l'association Global Chance (www.global-chance.org) :
Comme le dit très bien la CPDP, une nouvelle loi peut modifier les choses. Et surtout, ne pas développer le stockage en couche géologique profonde, comme voudrait le faire le projet Cigeo, ne signifie en aucune façon que l’on ne fait rien. Dans la situation actuelle des déchets nucléaires en France, il est impératif de ne pas laisser les choses en l’état. Il y a des priorités sur la gestion des résidus des mines, sur le reconditionnement des déchets bitumés (Marcoule), sur la reprise du stockage de la Manche, sur la sécurisation des piscines qui contiennent les combustibles irradiés auprès des centrales nucléaires et surtout à La Hague (la piscine de La Hague contient l’équivalent du chargement de cent réacteurs, dont 13% de combustible MOX au plutonium qui ne seront pas retraités). Il faut également sécuriser les tonnes de plutonium séparé qui sont entreposées à La Hague, poursuivre activement les recherches sur la réduction possible de la quantité et la radioactivité des déchets nucléaires. Enfin, il faut construire des installations de stockage à sec sécurisées et en sub-surface pour les combustibles irradiés et les déchets de moyenne activité déjà actuellement entreposés dans des conditions qui ne sont pas acceptables.
QUESTION 367
Posée par J-F RENARD, le 01/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 18 septembre 2013 - Les solutions de gestion des déchets radioactifs :
Si le stockage est retenu, quels seront les déchets et en quelle quantité seront admis dans Cigéo?
Réponse du 27/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le projet de stockage profond Cigéo est conçu pour mettre en sécurité définitive les déchets dont le niveau de radioactivité et la durée de vie ne permettent pas de les stocker, de manière sûre à long terme, en surface ou à faible profondeur.
Les déchets concernés proviennent principalement du secteur de l’industrie électronucléaire et des activités de recherche associées ainsi que, dans une moindre part, des activités liées à la Défense nationale. Les déchets dits de « haute activité » (HA) correspondent principalement aux résidus hautement radioactifs issus du traitement des combustibles nucléaires usés utilisés pour la production d’électricité. Les déchets dits de « moyenne activité à vie longue » (MA-VL) ont des origines variées : résidus issus du traitement des combustibles nucléaires usés et de la fabrication de certains combustibles, composants (hors combustible) ayant séjournés dans les réacteurs nucléaires, déchets technologiques issus de la maintenance des installations nucléaires, de laboratoires, d’installations liées à la Défense nationale, du démantèlement...
Cigéo est conçu pour prendre en charge les déchets produits par les installations nucléaires existantes. Les volumes de déchets HA et MA-VL sont estimés à environ 10 000 m3 pour les déchets HA (soit environ 60 000 colis de déchets) et environ 70 000 m3 pour les déchets MA-VL (soit environ 180 000 colis de déchets) dans l’hypothèse d’une poursuite de la production électronucléaire* et d’une durée de fonctionnement des installations nucléaires existantes de 50 ans. Dans cette hypothèse, 30 % des déchets HA et 60 % des déchets MA-VL sont déjà produits. Par précaution, des volumes supplémentaires (environ 20 % du volume de déchets MA-VL à stocker) sont prévus en réserve dans Cigéo pour certains déchets de faible activité à vie longue qui, le cas échéant, ne pourraient pas être stockés dans le stockage à faible profondeur à l’étude par l’Andra.
Cigéo est conçu pour être flexible afin de pouvoir s’adapter à d’éventuels changements de la politique énergétique. En cas d’arrêt de la production électronucléaire et d’arrêt du traitement des combustibles nucléaires usés, environ 3 500 m3 de déchets HA, 59 000 m3 de déchets MA-VL et 90 000 m3 de combustibles usés non traités seraient destinés au stockage. A la demande du Ministère en charge de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, l’Andra, EDF et Areva ont étudié l’impact des différents scénarios établis dans le cadre du débat national sur la transition énergétique sur la production de déchets radioactifs et sur le projet Cigéo : ../docs/rapport-etude/20130705-courrier-ministere-ecologie.pdf
* Les déchets produits par un éventuel futur parc de réacteurs ne sont pas pris en compte.
Réponse apportée par Bernard Laponche, polytechnicien, docteur ès sciences en physique des réacteurs nucléaires, docteur en économie de l'énergie, membre de l'association Global Chance (www.global-chance.org) :
Ce qui est actuellement prévu dans le document de projet de l’Andra sont environ 10 000 m3 pour les déchets HA-VL (haute activité, vie longue), c’est-à-dire les déchets contenus dans des matrices de verre, soit de l’ordre de 60 000 conteneurs et environ 70 000 m3 pour les déchets MA-VL (moyenne activité, vie longue), de natures diverses, soit de l’ordre de 70 000 m3 (environ 180 000 conteneurs). Ces volumes correspondent aux déchets conditionnés par leur producteur. Ils seraient ensuite conditionnés en conteneurs de stockage sur le site de Cigeo et les volumes correspondants seraient de l’ordre de 30 000 m3 pour les déchets HA et de 350 000 m3 pour les déchets MA.
Les déchets HA dans leur grande majorité ne seraient chargés que 50 à 60 ans après l’ouverture du stockage car ils doivent encore refroidir pendant cette période (dans leur entreposage actuel à La Hague). Les déchets MA pourraient être chargés dès l’ouverture mais certaines catégories posent problème pour la sûreté de l’installation : les déchets bitumés (qui doivent être de toute façon reconditionnés par le producteur, à Marcoule) du fait du risque d’incendie, et les déchets contenant des matières organiques du fait de l’émission d’hydrogène du fait du risque d’incendie et même d’explosion.
QUESTION 366
Posée par Aurelie FABRE, le 01/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 18 septembre 2013 - Les solutions de gestion des déchets radioactifs :
Pourquoi ce n'est pas Areva qui pilote le Projet?
Réponse du 20/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le Parlement a confié à l’Andra, agence publique indépendante des producteurs de déchets, la mission de concevoir, d’implanter, de réaliser et d’assurer la gestion des centres de stockage de déchets radioactifs. Les producteurs de déchets (Areva, le CEA et EDF) sont responsables des caractéristiques des colis de déchets qu’ils livrent à l’Andra et de leur transport jusqu’au centre de stockage et ont en charge le financement des études et recherches, puis de la construction, de l’exploitation et de la fermeture de Cigéo s’il est autorisé. Une convention de coopération avec l’Andra permet, dans le respect des responsabilités de chacun, de faire bénéficier le projet de leur retour d’expérience d’exploitants d’installations nucléaires.
Réponse apportée par Bernard Laponche, polytechnicien, docteur ès sciences en physique des réacteurs nucléaires, docteur en économie de l'énergie, membre de l'association Global Chance (www.global-chance.org) :
Il est normal qu’un organisme spécifique se soit vu confier la responsabilité de la gestion des déchets radioactifs car ceux-ci proviennent de nombreuses origines : EDF, AREVA sont les principaux, mais aussi le CEA et des industriels comme des installations médicales.
Par contre il est dommage que les différentes voies de recherche sur la gestion des déchets n’aient pas été toutes confiées à l’Andra, ce qui lui eut permis de les développer en parallèle et de mieux les comparer entre elles car elles ne sont pas contradictoires. Le fait de n’avoir confié à l’Andra que le stockage en profondeur a très probablement faussé les choses.
Cet état de fait est probablement voulu : ni le pourvoyeur des combustibles (AREVA), ni l'utilisateur (EDF) ne sont responsables. C'est un cas très particulier.
QUESTION 365
Posée par Jean-Philippe BRETTE, le 01/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 18 septembre 2013 - Les solutions de gestion des déchets radioactifs :
La réversibilité n'est-elle pas surtout le moyen de retarder et rencherir les dernieres limites du nucléaire civil?
Réponse du 04/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La réversibilité du stockage n’est pas un moyen de retarder ni de renchérir les dernières limites du nucléaires civil. Quels que soient les choix énergétiques futurs, c’est la responsabilité de notre génération de proposer aux générations suivantes une solution permettant de mettre définitivement en sécurité les déchets les plus radioactifs qui sont produits en France depuis plusieurs dizaines d’années. Il est également important de laisser aux générations suivantes la possibilité de faire évoluer cette solution si elles le souhaitent. C’est pourquoi le Parlement a demandé que le stockage soit réversible pendant au moins 100 ans. L’Andra place cette demande de la société au cœur du projet. Elle a ainsi fait des propositions concrètes pour pouvoir récupérer les colis de déchets si besoin et laisser des choix possibles aux générations suivantes. Dans le cadre de la réversibilité, l’Andra propose d’organiser des points de rendez-vous réguliers qui permettront notamment de suivre les avancées des recherches sur la gestion des déchets radioactifs. Si d’autres solutions étaient découvertes dans le futur, les générations concernées pourront décider de faire évoluer leur politique de gestion des déchets.
Les conditions de réversibilité seront définies par une future loi avant que la création de Cigéo ne puisse être autorisée. Pendant au moins 100 ans, les générations suivantes pourront contrôler le déroulement du stockage et récupérer les déchets si elles le souhaitent. En fonction de l’expérience acquise lors de l’exploitation de Cigéo, elles pourront décider de commencer la fermeture par étapes du stockage. Après une centaine d’années d’exploitation, si elles décident de fermer définitivement le stockage, la sûreté sera assurée de manière passive, sans nécessité d’action humaine.
Pour en savoir plus sur les propositions faites par l’Andra en matière de réversibilité du stockage, voir : ../docs/rapport-etude/fiche-reversibilite-cigeo.pdf
Réponse apportée par Monique Sené, physicienne nucléaire, chercheuse au CNRS, vice-présidente du comité consultatif de l'ANCCLI :
Il est certain que le monde nucléaire doit démontrer qu’il est capable de maîtriser les nuisances induites par les installations qui lui sont reliées. Or les déchets sont encore difficiles à gérer : les premiers sites doivent être décontaminés et les premiers déchets doivent être reconditionnés. Ces opérations sont très pénalisantes pour les travailleurs. J’ai toujours pensé qu’on n’aurait dû y penser dès le début et ne construire que ce qu’on était capable de traiter, mais on a pensé : la science résoudra les problèmes et ceci était une grossière erreur. En effet, si les déchets ont été mal conditionnés, leur reprise devient très pénalisante en termes de dose mais aussi en termes de contamination de l’environnement. La réversibilité est ce qui permet de revenir en arrière : jamais les colis ne seront tous parfaits: il faut donc pouvoir les reprendre, mais bien sûr ce peut dévoyer la notion.
QUESTION 364
Posée par Cédric GAUTHIER, le 01/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 18 septembre 2013 - Les solutions de gestion des déchets radioactifs :
Imaginons le site de Bure dans 100 ans, celui-ci est bouché et pour une raison quelconque, nous devons extraire les déchets du site. Quel sera le coût au m3 extrait des déchets Ha? Quel serait le coût au m3 extrait des déchets Mavl?
Réponse du 04/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La sûreté de l’installation doit être acquise pour que la création de Cigéo puisse être autorisée. Un scénario de retrait de l’ensemble des colis de déchets après la fin de l’exploitation du stockage est peu vraisemblable. Dans une telle hypothèse, l’opération nécessiterait des modifications notables de l’installation, qui devraient faire à leur tour l’objet d’une autorisation spécifique. La nature de ces modifications et leur coût seraient à étudier en fonction de la situation considérée (familles de déchets concernées, volumes, planning de retrait, devenir des colis retirés du stockage…). Au coût de l’opération de retrait proprement dite, qui serait a priori d’un ordre de grandeur analogue à celui des opérations de mise en stockage des déchets, il conviendrait d’ajouter celui des nouvelles installations à construire pour accueillir les déchets et celui du transfert des déchets dans ces nouvelles installations.
Si Cigéo est autorisé, le démarrage de l’exploitation se fera de manière progressive. Des premiers colis de déchets radioactifs pourraient être pris en charge à l’horizon 2025. Dans son avis du 16 mai 2013, l’ASN a recommandé une phase de « montée en puissance » progressive de l’exploitation du stockage. En 100 ans, Cigéo aura fait l’objet d’au moins 10 réexamens complets de sûreté, en accord avec les exigences de l’ASN qui imposent un réexamen périodique de sûreté, au moins tous les 10 ans, pour toutes les installations nucléaires. Tout au long de l’exploitation du stockage, l’ASN pourra imposer des prescriptions supplémentaires voire suspendre la réception de nouveaux déchets si elle considère qu’un risque n’est pas maîtrisé correctement, comme pour toute installation nucléaire placée sous son contrôle. L’Andra propose que des rendez-vous soient programmés régulièrement pendant toute la durée d’exploitation du stockage avec l’ensemble des acteurs concernés (riverains, collectivités, évaluateurs, État…) pour contrôler le déroulement du stockage et préparer les étapes suivantes. A chaque étape, il sera possible de décider de poursuivre le processus de stockage tel qu’initialement prévu ou de le modifier et de réexaminer les conditions de réversibilité pour la phase suivante de développement du stockage.
QUESTION 363
Posée par Raymond CHAUSSIN, le 01/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 18 septembre 2013 - Les solutions de gestion des déchets radioactifs :
Comment peut-on assurer qu'il n'y aura pas de poches d'hydrogène dans les galeries même avec des ventillations? Impossible, risque d'incendie garantie
Réponse du 04/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Certains déchets MA-VL, notamment ceux contenant des composés organiques, dégagent de l'hydrogène non radioactif produit par radiolyse : les ¾ des colis de déchets MA-VL destinés à Cigéo dégagent peu d’hydrogène (moins de 3 litres par an et par colis), voire pas du tout. Au-delà d’une certaine quantité et en présence d’oxygène, cet hydrogène peut présenter un risque d’explosion. Pour maîtriser ce risque pendant l’exploitation de Cigéo, l’Andra fixe une limite stricte aux quantités d’hydrogène émises par chaque colis. Des contrôles seront mis en place et aucun colis ne sera accepté s’il ne respecte pas cette limite. Pour éviter l’accumulation de ce gaz, les installations souterraines et de surface seront ventilées en permanence pendant leur exploitation, comme le sont les installations d’entreposage dans lesquelles se trouvent actuellement ces déchets. Les modélisations d’aéraulique montrent que la ventilation prévue par la conception de Cigéo permet d’éviter toute zone de concentration d’hydrogène au sein des alvéoles de stockage.
Le système de ventilation du stockage fait par ailleurs l’objet de dispositions pour réduire le risque de panne (redondance des équipements, maintenance..) et des dispositifs de surveillance seront mis en place pour détecter toute anomalie sur son fonctionnement, notamment la présence d’hydrogène dans l’air à de très faibles concentrations... Des situations de perte de la ventilation sont étudiées malgré tout. Les études montrent que, dans le pire des cas, on disposera de plus d’une dizaine de jours pour rétablir la ventilation, ce qui permettra de mettre en place une ventilation de secours. Les conséquences d’une explosion sont tout de même évaluées afin d’envisager tous les scénarios possibles : les résultats montrent que les colis concernés ne seraient que faiblement endommagés, sans aucune perte de confinement des substances qu’ils contiennent.
Réponse apportée par Bertrand Thuillier, docteur ès sciences :
En effet, l'agencement des colis sera optimisé au sein des alvéoles, afin d'éviter toute perte d'espace, mais pourra constituer des barrières à la ventilation dans ces alvéoles MAVL (Moyenne Activité à Vie Longue) ; mais il faut savoir que même la hotte de stockage pour transporter les colis dans la descenderie dispose d'évents pour éviter au sein de celle-ci l'accumulation d'hydrogène lors de la descente des colis. On perçoit alors toute la difficulté de pouvoir éviter ces poches sur une longue durée, et l'impossibilité de contrôler ces teneurs dans tous ces espaces, sachant que par ailleurs, il a été écrit que les batteries du système d'auscultation, par conséquent les contrôles eux-mêmes, pouvaient constituer un danger vis-à-vis du risque de génération d'étincelles.
QUESTION 362
Posée par Hubert LUCHIER, le 01/10/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 18 septembre 2013 - Les solutions de gestion des déchets radioactifs :
L'usage du matériau plomb comme barrière de protection (dont je crois la caractéristique est de bloquer la radioactivité) a-t-il été envisagé pour la fabrication de l'enveloppe des colis ?
Réponse du 03/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’utilisation d’écrans de radioprotection (constitués avec du plomb ou avec d’autres matériaux) est classique dans l’industrie nucléaire. Elle permet de protéger les travailleurs des rayonnements émis par les substances radioactives. De tels écrans seront mis en œuvre dans Cigéo, notamment dans les équipements qui entourent les colis pendant leur transfert dans l’installation souterraine. Du plomb, placé entre deux épaisseurs d’acier, pourrait ainsi être utilisé comme matériau pour ces hottes de transfert.
Réponse apportée par Bernard Laponche, polytechnicien, docteur ès sciences en physique des réacteurs nucléaires, docteur en économie de l'énergie, membre de l'association Global Chance (www.global-chance.org) :
Le plomb est un bon absorbant des rayonnements gamma émis par les produits de fission, mais c’est aussi un élément très toxique qui contamine les eaux. C’est aussi un métal qui n’a pas de tenue mécanique s’il est porté en température, ce qui est le cas des colis standards de déchets vitrifiés qui sont très chauds. Comme c’est la dissipation thermique qui pose problème, car elle risque de détruire la roche d’accueil, le changement des matières absorbantes ne modifie pas la production de chaleur.
Les déchets vitrifiés (coulés à chaud) comme les déchets de structure (compactés sous forme de "galette") sont dans un conteneur cylindrique en acier réfractaire. Un couvercle est ensuite posé et soudé sur le conteneur. Le conteneur à pour fonction d’isoler les matières radioactives et non d’atténuer les rayonnements.
Il existe huit catégories de déchets dits de très haute activité (THA) dans lesquels se trouvent les déchets vitrifiés conditionnés à La Hague. Les déchets de structure compactés issus des combustibles retraités font partie de la famille des déchets de moyenne activité à vie longue (MA-VL) qui est très nombreuse (trente deux sortes de conditionnements). Ils témoignent du passé du nucléaire avant qu’il n’atteigne sa dimension industrielle.
QUESTION 361
Posée par Obama , le 30/09/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 18 septembre 2013 - Les solutions de gestion des déchets radioactifs :
Pourquoi construire Cigéo maintenant alors que les déchets n'arriveront que dans 70 ans?
Réponse du 05/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Si Cigéo est autorisé, il faudra du temps pour y transporter, stocker et mettre en sécurité de manière définitive les déchets radioactifs existants et en cours de production. Une centaine d’années seront ainsi nécessaires pour prendre en charge le stock de déchets radioactifs de moyenne activité à vie longue (MA-VL) et de haute activité (HA). Ces déchets sont produits depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires et sont en cours de production par les installations nucléaires actuelles. La première phase d’exploitation de Cigéo (2025-2075) permettrait de prendre en charge les déchets MA-VL et de créer une zone pilote pour le stockage d’une petite quantité de déchets HA. Cette zone sera observée pendant une cinquantaine d’années et permettra d’avoir un retour d’expérience important avant de commencer à stocker l’ensemble des colis de déchets HA, qui sont les plus radioactifs et qui se caractérisent par un dégagement de chaleur important. Le stockage des déchets HA commencerait donc effectivement à l’horizon 2075, après une période d’entreposage préalable de refroidissement sur leur site de production afin que la chaleur qu’ils dégagent ait suffisamment décru pour permettre leur stockage.
Réponse apportée par Bernard Laponche, polytechnicien, docteur ès sciences en physique des réacteurs nucléaires, docteur en économie de l'énergie, membre de l'association Global Chance (www.global-chance.org) :
Dans le projet Cigeo actuel, deux catégories de déchets sont prévues : d’une part les MAVL (moyenne activité, vie longue) et les HAVL (haute activité vie longue).
Les MAVL pourraient être chargés dès le début de l’exploitation, vers 2025-2030 (il est sage de prévoir des retards par rapport aux prévisions) mais beaucoup de ces déchets posent problème et en particulier les déchets bitumés du fait du risque d’incendie et à propos desquels l’ASN a dit qu’il ne faudrait pas les charger « dans une première phase ».
Les HAVL sont les déchets « vitrifiés » qui sont actuellement stockés à l’usine de La Hague où ils sont produits. Quelques-uns, anciens et en provenance de Marcoule (mise au point des prototypes industriels pour la vitrification des produits de fission et des actinides mineurs), pourraient être stockés au début mais ils ne représentent que des quantités très faibles. Ceux de La Hague ne pourraient effectivement être chargés que dans environ 70 ans.
Tout cela montre bien que la précipitation actuelle pour réaliser à tout prix le projet Cigeo n’a pas de véritable justification. Il y a actuellement d’autres priorités sur les stockages et entreposages existants (résidus des mines, stockages en surface, entreposage des combustibles irradiés en piscines), avant de se lancer dans le stockage profond (si tant est que celui-ci soit justifié, ce qui n’est pas le cas).
QUESTION 360
Posée par Pascal , le 30/09/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 18 septembre 2013 - Les solutions de gestion des déchets radioactifs :
L'option de la récupérabilité est-elle d'ors et déjà financée?
Réponse du 20/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
C’est le Parlement qui fixera les conditions de réversibilité. L’Andra propose un partage équitable du financement de la réversibilité entre les générations.
Les générations actuelles provisionnent l’ensemble des coûts nécessaires pour permettre la mise en sécurité définitive des déchets radioactifs qu’elles produisent, ainsi que des déchets anciens qui ont été produits depuis le début des années 1960. Ces provisions couvrent également les propositions techniques retenues pour assurer la réversibilité de Cigéo pendant le siècle d’exploitation.
Si les générations suivantes décidaient de faire évoluer leur politique de gestion des déchets radioactifs, par exemple si elles décidaient de récupérer des déchets stockés, elles en assureraient le financement. La prise en compte de la réversibilité dès la conception du stockage permet de limiter cette charge potentielle.
Réponse apportée par Bernard Laponche, polytechnicien, docteur ès sciences en physique des réacteurs nucléaires, docteur en économie de l'énergie, membre de l'association Global Chance (www.global-chance.org) :
Il reste une très grande incertitude sur le coût du projet Cigeo, même sans l’hypothèse d’une récupérabilité (possibilité de retirer certains déchets ou même leur totalité) assurée sur une durée d’au moins cent ans (période également hypothétique puisque la fermeture du stockage devrait être de la responsabilité du Parlement et donc ne doit pas être fixée a priori).
Le coût annoncé par l’Andra dans son document de projet, pour la construction et l’exploitation pendant cent ans, est de 16,5 milliards d’euros (2012).
Dans son rapport de janvier 2012 sur « Les coûts de la filière électronucléaire », la Cour des Comptes écrit (page 161) :
« La révision du devis 2005 (16,5 Md€2010) du centre de stockage profond divise l’ANDRA (chiffrage SI 2009 à 36 Md€2010) et les producteurs (projet STI à 14,4 Md€2010). Le projet STI présenté par les producteurs aboutit ainsi à un coût inférieur au devis de 2005 à partir duquel ils calculent leurs provisions actuellement. L’estimation officielle des coûts sera déterminée par arrêté ministériel avant 2015. Si cette estimation était supérieure à celle de 2005 et proche du montant révisé du devis de l’ANDRA, les producteurs devraient ajuster le montant de leurs provisions, de manière potentiellement significative ».
Quand on voit ce qui se passe pour une installation comme l’EPR de Flamanville (dont le coût est passé, alors qu’il n’est pas encore terminé) de 3 à 8,5 milliards d’euros, on peut penser que le coût de Cigeo se révèlerait très supérieur aux estimations actuelles.
D’autre part, seule une définition précise de la « récupérabilité » permettrait de chiffrer l’augmentation par rapport au coût affiché jusqu’ici.
QUESTION 359
Posée par Hervé , le 30/09/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 18 septembre 2013 - Les solutions de gestion des déchets radioactifs :
Quel suivi environnemental sera réalisé autour de cigeo pour suivre son impact?
Réponse du 27/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement*. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. Ce programme de surveillance devra être approuvé par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Pendant toute l’exploitation de Cigéo, l’ASN contrôlera la fiabilité des mesures réalisées par l’Andra et pourra mandater des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, le plan de surveillance permettra notamment de vérifier l’absence de contamination des nappes phréatiques. L’Andra a déjà initié depuis 2007, au travers de l’Observatoire pérenne de l’environnement (http://www.andra.fr/ope), la réalisation d’un état initial détaillé de l’environnement. Les résultats de la surveillance réalisée par l’Andra feront l’objet d’une rapport annuel public.
*Une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Réponse apportée par Bertrand Thuillier, docteur ès sciences :
Le suivi environnemental est prévu d'être effectué par un organisme appelé OPE (Observatoire Pérenne de l'Environnement) ; cet organisme a déjà été créé et travaille depuis 2007, bien avant avoir parlé de stockage des déchets !! Cet organisme annoncé par l'Andra comme un outil d'étude de la biodiversité locale a en réalité pour cahier des charges de contrôler, sur une surface de 900 km² autour du site, les possibles rejets de Chlore36, Sélénium79, Iode129, Radium226, Arsenic, Bore, Mercure..., et une directive européenne Euratom recommande même un suivi sanitaire des populations sur ces 900 km² de surface à surveiller. Ce contrôle est nécessaire, en vérité, bien peu rassurant, mais rien n'est dit sur l'origine de cette date de 2007, ni sur la possibilité d'actions correctives en cas de détections de pollutions.
QUESTION 358
Posée par David , le 30/09/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 18 septembre 2013 - Les solutions de gestion des déchets radioactifs :
L'entreposage en surface est une réponse des anti-nucléaires pour garder le débat en surface?
Réponse du 06/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’entreposage des déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue implique de renouveler périodiquement les bâtiments où sont placés ces déchets, avec les opérations associées de transferts de déchets radioactifs, de contrôler ces installations et de les maintenir. En cas de perte de contrôle de ces installations, les conséquences radiologiques sur l’homme et l’environnement ne seraient pas acceptables. Compte tenu de la durée pendant laquelle ces déchets resteront dangereux (plusieurs centaines de milliers d’années), l’entreposage - qu’il soit en surface ou à faible profondeur - ne peut être qu’une solution provisoire dans l’attente d’une solution définitive.
Le projet Cigéo propose une solution pour protéger sur le très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs produits en France depuis plus d’un demi-siècle. S’il est mis en œuvre, cela permettra de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations futures, alors qu’elles n’auront pas bénéficié de l’électricité procurée par la production de ces déchets. La réversibilité leur laissera la possibilité de contrôler la mise en œuvre de cette solution et de l’adapter si elles le souhaitent.
D’autres solutions ont été étudiées en France et à l’étranger depuis plus de 50 ans : envoi dans l’espace, au fond des océans, dans le magma, séparation-transmutation… Le stockage est aujourd’hui considéré dans tous les pays comme la meilleure solution pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter leur charge sur les générations suivantes. La directive européenne du 19 juillet 2011 considère ainsi que le stockage géologique constitue actuellement la solution la plus sûre et la plus durable en tant qu’étape finale de la gestion des déchets de haute activité.
Réponse apportée par Bernard Laponche, polytechnicien, docteur ès sciences en physique des réacteurs nucléaires, docteur en économie de l'énergie, membre de l'association Global Chance (www.global-chance.org) :
Le stockage en surface (considéré comme « définitif ») existe déjà pour des déchets de faible activité (centres de stockage Andra de Soulaines, Morvilliers, la Manche) et n’est pas sans poser des problèmes : il devrait être « contrôlé » pendant au moins 300 ans, voire 800 car il contient parfois du plutonium.
L’entreposage en surface (stockage temporaire) existe également pour les déchets de haute activité que sont les combustibles irradiés ou « usés » à la sortie du réacteur : ils sont tellement chauds et radioactifs qu’il faut les stocker pendant six mois au moins et souvent plus (au moins deux ans et demi pour les combustibles MOX) dans des « piscines », vastes bassins situés auprès des réacteurs et dans lesquels ils sont refroidis en permanence. Ces combustibles sont ensuite transportés à La Hague, également entreposés dans une piscine qui est actuellement la plus grande concentration au monde de déchets radioactifs (l’équivalent du chargement de cent réacteurs nucléaires). Ces piscines, auprès des réacteurs ou à La Hague, ne sont pas sécurisées vis-à-vis d’agressions extérieures graves (naturelles, terroristes ou militaires). La première urgence, et cela a été souligné par l’autorité de sûreté nucléaire » est la sécurisation de ces piscines, en premier lieu celle de La Hague.
En ce qui concerne l’avenir, il n’y a pas à mon avis de solution satisfaisante. Le stockage à grande profondeur présente des inconvénients majeurs, tant sur le plan général (pollution de la croûte terrestre par des « dépôts » de matières toxiques ou radioactives un peu partout dans le monde et dont la qualité » serait invérifiable, solution imposée aux générations futures) que sur le plan particulier du projet Cigeo (risque d’accidents graves notamment). A cet égard, je suis convaincu que dans moins d’un siècle, au vu de l’expérience de la pollution des océans et de l’atmosphère que l’on s’efforce aujourd’hui de réduire, une convention internationale interdira le stockage dans la croûte terrestre de tout déchet toxique ou radioactif.
La solution qui me paraît la moins mauvaise est l’entreposage réversible (on peut récupérer les déchets) et contrôlable, pendant une période d’environ 300 à 500 ans (période pendant laquelle il faudra de toute façon contrôler les stockages en surface), à sec (après le séjour indispensable dans des piscines qui seraient elles-mêmes sécurisées) et non pas en surface mais en sub-surface (à flanc de colline par exemple afin d’assurer l’accessibilité et la facilité de retirer éventuellement des déchets, par exemple pour les reconditionner).
Cela afin de permettre d’explorer par les efforts de la recherche, les moyens sinon de détruire les déchets, au moins d’en réduire la quantité et la radioactivité dans la durée.
QUESTION 357
Posée par Raymond CHAUSSIN, le 30/09/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 18 septembre 2013 - Les solutions de gestion des déchets radioactifs :
Les aveux d'impuissance de tous ces spécialites ne les font pas évoluer! On ne sait pas quoi en faire mais on continue d'en produire!
Réponse du 06/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
A quels aveux d’impuissance faites-vous référence ? Le stockage profond est aujourd’hui reconnu en France et à l’étranger comme une solution robuste pour mettre en sécurité sur de très longues durées les déchets les plus radioactifs. Aux Etats-Unis, le stockage du WIPP (Waste isolation pilot plant) stocke depuis une dizaine d’années à 700 m de profondeur les déchets de moyenne activité à vie longue issus des activités de défense américaines. En Suède et en Finlande, les demandes d’autorisations de création de stockages en milieu granitique sont en cours d’instruction. Le Canada, la Chine, la Belgique, la Suisse, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon ont également engagé des recherches sur le stockage géologique.
Même si la France arrêtait toute activité nucléaire, il serait nécessaire de mettre en œuvre une solution de gestion à long terme pour les déchets radioactifs produits par les installations nucléaires actuelles et anciennes. 60 % des déchets de moyenne activité à vie longue et 30 % des déchets de haute activité destinés à Cigéo sont déjà produits. En cas d’arrêt de la production électronucléaire et d’arrêt du traitement des combustibles nucléaires usés, ce seraient environ 3 500 m3 de déchets de haute activité, 59 000 m3 de déchets de moyenne activité à vie longue et 90 000 m3 de combustibles usés non traités qui seraient destinés au stockage.
La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra à l’État après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création du stockage, après plus de 20 ans d’études et de recherches. Ce processus comprendra notamment l’évaluation de la sûreté par l’Autorité de sûreté nucléaire, l’évaluation des recherches scientifiques par la Commission nationale d’évaluation, l’avis des collectivités territoriales, le vote d’une nouvelle loi fixant les conditions de réversibilité et une enquête publique.
Réponse apportée par Bernard Laponche, polytechnicien, docteur ès sciences en physique des réacteurs nucléaires, docteur en économie de l'énergie, membre de l'association Global Chance (www.global-chance.org) :
Effectivement, aucune solution satisfaisante n’a été jusqu’ici trouvée pour éliminer les déchets radioactifs ni même pour en réduire les risques qu’ils présentent, jusqu’à des centaines de milliers d’années pour certains d’entre eux.
C’est dès l’origine de la découverte de la possibilité d’utiliser l’énergie nucléaire par la fission des noyaux d’uranium 235 que l’impossibilité de traiter la question des déchets aurait dû amener à renoncer à cette technique. Il n’en a rien été. Au contraire : en 1974 déjà, les scientifiques savaient que le problème des déchets nucléaires deviendrait crucial. Mais certains d'entre eux estimaient que "avant que ce problème ne soit crucial, les scientifiques auront trouvé une solution" (Louis Leprince-Ringuet). C'était encore l'époque de la confiance absolue en la science…
Conscients de cette impasse, certains pays qui avaient développé cette utilisation y ont renoncé et notamment deux des quatre principaux pays de l’Union Européenne, l’Italie et l’Allemagne. La position de l’Allemagne a été clairement exposée par Wolfgang Renneberg, directeur général chargé de la sûreté nucléaire au ministère de l’environnement de l’Allemagne, de novembre 1998 à novembre 2009, dans un discours prononcé à Madrid, le 24 Mai 2001 :
« Comme vous le savez tous, le gouvernement de l'Allemagne a décidé d'éliminer progressivement l'utilisation commerciale de l'énergie nucléaire. Je vais préciser quelques-unes des raisons les plus pertinentes qui fondent cette décision.
La décision du gouvernement d’éliminer cette utilisation résulte d'une réévaluation des risques que présente cette technologie. Nous ne disons pas que les centrales électriques en Allemagne ne sont pas sûres au regard des standards internationaux. Cependant, le gouvernement allemand est d'avis que l'ampleur des effets des accidents nucléaires possibles est telle que cette technique ne peut être justifiée, même si la probabilité d'un tel accident est faible.
Une raison supplémentaire est qu’aucune solution pratique au problème de l'élimination finale des déchets hautement radioactifs n'a encore été trouvée. Les déchets radioactifs sont un fardeau pour les générations futures. L’arrêt définitif de la production d’électricité d’origine nucléaire supprime la production de nouveaux déchets.
Une autre raison est que les nombreuses mesures qui sont nécessaires pour réduire les risques d’une utilisation des matériaux fissiles à des fins destructrices au niveau national et international ne peuvent remplir leur fonction de protection, de sûreté et de contrôle que si les pays concernés jouissent de conditions sociales, économiques et politiques stables. La fin de l'utilisation commerciale de l'énergie nucléaire en Allemagne et l'arrêt du retraitement du combustible allemand réduit le stock de matériaux « proliférants ». À cet égard, ce choix contribue à réduire les risques de prolifération. »
Et cela était dit bien avant Fukushima.
La même décision serait possible en France.
A tout le moins, il est en tout cas indispensable de réduire la quantité de déchets radioactifs produits et cela de trois façons complémentaires :
- réduire les consommations d’électricité, notamment pour les usages qui lui sont spécifiques (électroménager, audiovisuel, bureautique et informatique dans les secteurs résidentiel et tertiaire représentent environ la moitié de la consommation totale d’électricité en France) ;
- ne pas exporter d’électricité d’origine nucléaire (actuellement la réduction d’environ dix unités de 900 MW de puissance électrique, dont on garde en France les déchets nucléaires qui en résultent) ;
- réduire la production d’origine nucléaire au profit de la production d’origine renouvelable (notamment éolien et photovoltaïque).
De plus, il est indispensable d’arrêter la production de plutonium par le retraitement des combustibles irradiés car c’est une industrie à haut risque et polluante, tant au niveau de l’usine de La Hague que de l’usine Melox de fabrication des combustibles MOX et des transports de plutonium. Sans parler du risque d’extension de la prolifération des armes nucléaires, l’une des raisons de la décision allemande.
QUESTION 356
Posée par David , le 30/09/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 18 septembre 2013 - Les solutions de gestion des déchets radioactifs :
Combien représente en volume ces déchets face aux concurrents énergétiques de l'énergie nucléaire? Sont-ils plus dangereux?
Réponse du 03/12/2013,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
A la fin de l’année 2010, il existait en France environ 1 320 000 m³ de déchets radioactifs. Cela représente une production de déchets radioactifs correspondant à un équivalent de 2 kg par an et par habitant.
Parmi ces déchets, à fin 2010, il existait 2700 m³ de déchets de haute activité (HA) et 40 000 m³ de déchets de moyenne activité à vie longue (MAVL), déchets qui sont destinés à être stockés dans le centre de stockage en projet CIGEO. 84 % des déchets HA et 68 % des déchets MAVL proviennent du secteur électronucléaire.
D’autres formes d’énergie que l’énergie nucléaire peuvent produire des déchets ou des pollutions, qui sont de nature très différente des déchets radioactifs. Par exemple, les centrales thermiques utilisant des énergies fossiles produisent notamment du CO2 (principal gaz à effet de serre).
Réponse apportée par Bernard Laponche, polytechnicien, docteur ès sciences en physique des réacteurs nucléaires, docteur en économie de l'énergie, membre de l'association Global Chance (www.global-chance.org) :
L’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins civiles se limite à la production d’électricité. C’est donc dans ce périmètre qu’il faut faire des comparaisons entre différentes solutions.
Il est tout d’abord évident mais insuffisamment souligné que, par rapport aux usages de l’électricité, la « source » d’énergie la moins dangereuse, qui engendre le moins de nuisance, qui n’est la cause d’aucun accident et ne produit aucun déchet est l’application à ces usages de la sobriété et de l’efficacité énergétique : consommer mieux et consommer moins d’électricité, c’est aussi produire moins de déchets, radioactifs notamment.
Si l’on regarde maintenant les différentes façons de produire de l’électricité, elles se divisent en trois grandes familles qui se distinguent par la source d’énergie primaire et la technique de leur transformation : production de chaleur puis d’électricité par des combustibles fossiles (charbon et gaz essentiellement, le pétrole étant de moins en moins utilisé pour cette production) ; production de chaleur puis d’électricité à partir de la fission de l’uranium par les centrales nucléaires ; production directe d’électricité sans passer par le production de chaleur par essentiellement l’hydraulique, l’éolien ou le photovoltaïque.
En termes de déchets, c’est sans contexte les centrales nucléaires qui produisent les déchets les plus dangereux et sur longue période et cela est universellement reconnu.
Mais il ne serait pas correct de se limiter à ce seul critère. On sait en effet que, outre les pollutions atmosphériques locales (diesel, fumées et particules dues à l’utilisation du charbon), les pollutions régionales et les accidents (marées noires, accidents dans les mines, dégâts causés par les grands barrages ...), la combustion des matières premières fossiles produit du gaz carbonique et les fuites de gaz (et les mines de charbon) du méthane, l’un et l’autre gaz à effet de serre qui conduisent à la menace de bouleversements climatiques. Du côté du nucléaire, les risques ne se limitent pas aux déchets mais comprennent également les risques d’accidents majeurs (Tchernobyl, Fukushima) et les pollutions radioactives tout au long de la chaîne des industries du combustible, de la mine aux usines de retraitement en passant par les centrales nucléaires.
L’examen de l’ensemble de ces risques conduit à la politique énergétique vers laquelle s’orientent, à des degrés divers, l’ensemble des pays de la planète : la transition énergétique qui permet de passer des systèmes énergétiques actuels basés sur les énergies de stock (pétrole, charbon, gaz, uranium) aux énergies renouvelables et surtout sur la maîtrise des consommations d’énergie par la sobriété et l’efficacité énergétiques. Les pays riches peuvent et doivent réduire rapidement leur consommation d’énergie par la sobriété et l’efficacité énergétiques, et l’assurer de façon croissante avec des énergies de flux renouvelables. Les pays émergents et les pays en développement pourront alors augmenter la leur sur la base de ce modèle plus sobre, plus efficace, dont le volet de l’offre sera également fondé sur une utilisation croissante des énergies de flux.
L’objectif fixé par le Président de la République à la suite du débat national sur la transition énergétique qui s’est déroulé en 2013 de réduire de 50% la consommation énergétique finale de la France à l’horizon 2050 est à cet égard tout à fait fondamental.
QUESTION 355
Posée par Pierre PRIOUX (BELLEVILLE SUR MEUSE), le 30/09/2013
Il existe un surgénérateur "PHENIX", qui consomme, pour son fonctionnement, une partie des déchets de fission. Pourquoi ne pas le multiplier?
Réponse du 05/12/2013,
Réponse apportée par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) :
La technologie des réacteurs à neutrons rapides (RNR) présente un intérêt dans le domaine de la gestion durable des matières et des déchets radioactifs. En effet, les neutrons rapides sont capables, pour des raisons de physique, de brûler tout type d’uranium, de multirecycler le plutonium et de transformer les éléments de longue vie les plus radiotoxiques des déchets (actinides mineurs) en éléments à vie plus courte.
Phénix est un prototype de RNR qui a fonctionné à Marcoule de 1974 à 2009. Son objectif était d’apporter la démonstration industrielle du fonctionnement d’un RNR, surgénérateur, refroidi au sodium. Il a atteint les objectifs qu’on lui a assignés, comme le développement des combustibles RNR ou les études de faisabilité du multirecyclage et de la transmutation. Notamment, à partir des années 80, le combustible Phénix a été traité puis réutilisé dans le réacteur, montrant la possibilité du recyclage. Par ailleurs, des essais de transmutation des actinides mineurs y ont été menés, dans le cadre de la loi de 91 sur la gestion des déchets.
Aujourd’hui, les outils, les technologies et les exigences dans le domaine du nucléaire ont progressé. Les nouveaux systèmes nucléaires à l’étude sont de 4ème génération, alors que Phénix correspondait à la deuxième génération. Il s’agit toujours de réacteurs à neutrons rapides, comme Phenix, mais porteurs d’ innovations importantes pour répondre aux critères assignés à la 4ème génération, établis par le forum international génération 4 (GIF) : sûreté renforcée, durabilité, économie, …
Dans ce cadre, le CEA développe notamment un projet de démonstrateur technologique de 4ème génération : c’est le projet Astrid, dont la conception bénéficie des progrès technologiques enregistrés depuis et du retour d’expérience résultant de l’exploitation de ses prédécesseurs.
Ces études sont menées en lien avec celles sur la gestion durable des matières et des déchets radioactifs avec deux objectifs :
- Le premier objectif vise à aller jusqu’au bout du recyclage du plutonium issu des combustible usés, afin de valoriser au maximum tout le potentiel énergétique.
- Sur le plus long terme, le CEA mène des études sur la transmutation des actinides mineurs, pour réduire le volume et la radiotoxicité des déchets ultimes.
Un bilan complet des recherches sur la gestion des matières et sur les systèmes nucléaires de 4ème génération, a été remis fin 2012 au gouvernement et est disponible sur le site internet du CEA www.cea.fr, dont le tome 5 constitue un résumé synthétique.
QUESTION 354
Posée par Bastien DELAUNAY (CHAUMONT), le 30/09/2013
Quels sont les impacts du Projet CIGEO en terme d'emplois (emplois crées, emplois non délocalisés, formations, insertion)?
Réponse du 06/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Sous réserve de son autorisation, entre 1 300 et 2 300 personnes travailleront à la construction des premières installations de Cigéo sur la période 2019-2025. Après la mise en service du Centre, entre 600 et 1 000 personnes travailleront pendant plus de 100 ans à la fois à son exploitation et sa construction (qui se poursuivra en parallèle). En plus de ces emplois directs implantés sur le site, l’activité générée entretiendra des emplois indirects, notamment auprès de fournisseurs ou prestataires de Lorraine et de Champagne-Ardenne et des emplois induits, répondant aux consommations courantes des salariés de Cigéo sur leur lieu de vie (achats, investissement en logement, etc). De plus, Cigéo contribuera au développement de l’activité des entreprises locales et, grâce à la garantie d’une activité sur plus d’un siècle, certaines entreprises feront très vraisemblablement la démarche de s’implanter localement, créant à leur tour une activité nouvelle sur le territoire.
Dès aujourd’hui, plusieurs initiatives ont été prises par les organismes de formation professionnelle les plus proches pour promouvoir certains métiers correspondant aux besoins futurs du projet. C’est le cas notamment au Lycée professionnel Blaise Pascal où un bac professionnel et un BTS « environnement nucléaire » forment les élèves au travail sur site nucléaire ou au sein des entreprises prestataires de service en maintenance, fabrication, logistique, et démantèlement. Le BTS forme de futurs responsables de chantier ou chargés d’affaires dans une installation nucléaire. Concernant les métiers de la sécurité, un premier partenariat a été mis en place entre le Lycée Emile Baudot de Wassy et les sites de Meuse/Haute-Marne et de l’Aube où l’Andra contribue à l’accueil de stagiaires et intervient dans le parcours pédagogique. Par ailleurs, en lien avec EDF, le Lycée Ligier-Richier de Bar-le-Duc propose une formation complémentaire soudage qui répond aux attentes des entreprises prestataires du nucléaire.
Si Cigéo est autorisé, un dispositif Emploi Formation sera nécessaire au démarrage du chantier Cigéo afin de répondre aux besoins en recrutement des entreprises intervenant sur le site ou concernées par la construction. L’enjeu est de permettre à ces entreprises de recruter, former et qualifier les personnels en privilégiant les candidats locaux, dont les personnes suivant un parcours d’insertion professionnelle.
Pour cela, l’Andra et les entreprises concernées s’associeront le moment venu avec les acteurs chargés de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle. En préparation de ce dispositif, la Maison de l’Emploi de Meuse et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Haute-Marne ont réuni les différents acteurs de ces domaines autour d’une action de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences territoriales qui s’attache à anticiper les besoins du chantier et ajuster l’offre de formation en conséquence.
L’insertion et le maintien dans l’emploi de personnes handicapées seront encouragés, de même que la formation de personnes issues de milieux socialement défavorisés pour permettre leur embauche sur le Centre.
QUESTION 353
Posée par Pierre CHAUCESSE (IS EN BASSIGNY), le 30/09/2013
Quel est le coût et le financement du projet?
Réponse du 05/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Conformément à la loi du 28 juin 2006, le ministre chargé de l’énergie arrête et publie l’évaluation du coût du stockage, sur la base de l’évaluation proposée par l’Andra et après avoir recueilli l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et les observations des producteurs de déchets (EDF, CEA, Areva). La dernière évaluation du coût du stockage validée par le ministère en charge de l’énergie date de 2005. Au stade des études de faisabilité scientifique et technique et selon les hypothèses techniques retenues à ce stade, le coût du stockage avait été estimé entre 13,5 et 16,5 milliards d’euros, répartis sur une centaine d’années. Cette évaluation couvrait notamment le stockage de tous les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue produits par les réacteurs nucléaires français pendant 40 ans.
L’Andra a lancé en 2012 les études de conception industrielle du projet Cigéo. Les données d’entrée du projet liées à l’implantation et à l’inventaire des déchets ont été précisées. L’Andra s’appuie sur des ingénieries spécialisées qui apportent leur retour d’expérience sur d’autres grands projets industriels. Sur cette base, un nouveau chiffrage est en cours d’élaboration par l’Andra. Ce chiffrage sera finalisé en 2014 pour prendre en compte les pistes d’optimisation identifiées en 2013, les recommandations des évaluateurs et pour intégrer les suites du débat public.
La Cour des comptes a réalisé une analyse des enjeux associés dans son rapport public thématique portant sur « Les coûts de la filière électronucléaire » (janvier 2012) disponible sur le site du débat :
../docs/docs-complementaires/docs-avis-autorites-controle-evaluations/
rapport-thematique-filiere-electronucleaire.pdf.
Pour un nouveau réacteur nucléaire sur l’ensemble de sa durée de fonctionnement, le coût du stockage des déchets radioactifs est de l’ordre de 1 à 2 % du coût total de la production d’électricité.
Les modalités de financement du projet Cigéo sont définies par la loi du 28 juin 2006. Les études et recherches sont actuellement financées par une taxe (dite taxe « de recherche ») additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base. La construction, l’exploitation et la fermeture de Cigéo seront également financées par les producteurs de déchets, au travers de conventions avec l’Andra. La clé de répartition sera liée notamment à l’inventaire de déchets de chaque producteur. Elle est aujourd’hui de 78 % pour EDF, 17 % pour le CEA et 5 % pour Areva. Dans le cadre du projet de loi de finances rectificative 2013, en cours d’examen par le Parlement, l’Etat envisage d’adapter ce dispositif en séparant du fonds « recherche » les études nécessaires à la conception, avec la création d'un fonds spécifique « conception ». Ce fonds serait également financé par les exploitants d’installations nucléaires.
QUESTION 352 - Centre de stockage à Bure
Posée par Jean-Claude LAUREAUX, L'organisme que vous représentez (option) (LANGRES), le 30/09/2013
Pourquoi pas un référendum? - Seul un référendum pourra donner à la population locale la possibilité de choisir ou non pour une telle installation sur le site. L'exercice de la démocratie directe évitera des enjeux et/ou des intérêts personnels et/ou particuliers dans un tel projet...avec confrontation d'idées...vrais débats...
Réponse du 05/12/2013,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Le projet Cigéo suit la procédure décrite à l’article L. 542-10 du Code de l’Environnement, dont le processus est illustré par les schémas présentés ci-dessous et qui ne prévoit pas la réalisation d’un référendum.
Comme cela est représenté sur les schémas, au cours de ce processus, plusieurs procédures de consultation sont organisées afin de recueillir l’avis des populations locales et nationales :
- un débat public en 2013, organisé afin de recueillir les avis de l’ensemble de la population au niveau local et national,
- un avis des collectivités locales à proximité du projet (horizon 2016),
- une enquête publique (horizon 2017-2018) préalable au décret d’autorisation de création.
Le Parlement fixe périodiquement les choix relatifs à la mise en œuvre de ce projet :
- loi du 30 décembre 1991, dite loi « Bataille », fixant un programme d’études et recherches de 15 années d’études et recherches sur les déchets radioactifs ;
- loi du 28 juin 2006, définissant le stockage géologique profond réversible comme solution de référence pour les déchets les plus radioactifs en vue, sous réserve de son autorisation, d’une mise en service en 2025 ;
- loi à venir sur la réversibilité du projet à horizon 2016.
En outre, l’Etat est en contact permanent avec les parties prenantes locales. Un important travail de concertation a été mené, notamment avec les exécutifs locaux, pour élaborer un projet de schéma interdépartemental du territoire.
L’avis des populations locales au travers des procédures de consultation et l’expression de leurs représentants au Parlement sont primordiaux. Dès aujourd’hui, à travers les outils d’expressions mis en place par la Commission Particulière du Débat Public (site internet, cahiers d’acteurs, débats interactifs), vous avez l’opportunité d’exprimer votre avis.
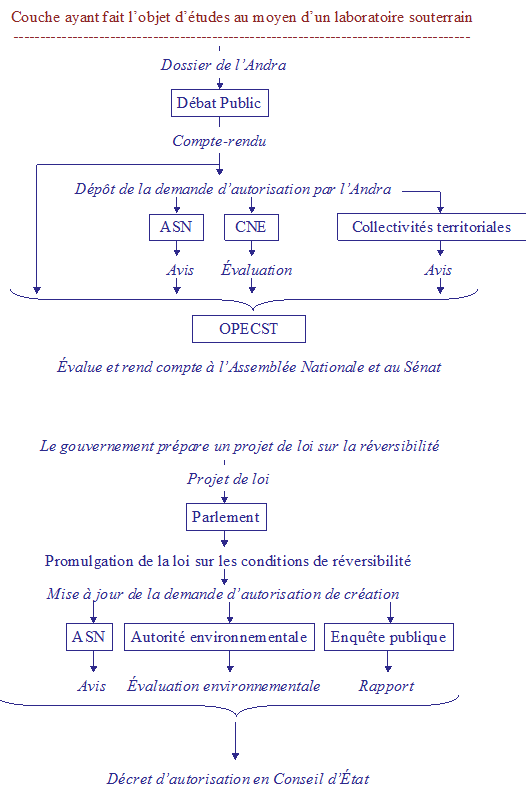
QUESTION 351
Posée par René VILLAIN, le 20/11/2013
J'ai visité le site hier, avant, j'étais inquiet et suite à cette visite, je le reste...
Comment transmettre aux générations futures la mémoire de ce site pendant 100 000 ans ?
Que se passera-t-il en cas de mouvements géologiques importants ?
Je préfère tout de même voir nos déchets bien encadrés que jetés dans la mer !
Vous souhaitant bonne réception.
Cordialement.
René VILLAIN
Réponse du 05/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Concernant la transmission de la mémoire du site aux générations futures
L’objectif fondamental de Cigéo est de protéger l’homme et l’environnement des déchets radioactifs sur de très longues échelles de temps. La sûreté à long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. C’est une des raisons qui a conduit, en 2006, le Parlement à retenir la solution du stockage profond. En effet, cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli, contrairement à l’entreposage. En cas de perte complète de la mémoire du stockage, une intrusion inopinée à 500 mètres sous terre apparaît peu plausible, du moins sans un minimum d’investigations préalables. L’Andra évalue cependant par précaution dans son analyse de sûreté les conséquences d’un forage à travers le stockage pour vérifier que le stockage resterait sûr.
Malgré cette robustesse du stockage même en cas d’oubli, l’Andra conçoit Cigéo avec l’objectif d’en conserver la mémoire et de la transmettre aux générations futures le plus longtemps possible. Des solutions d’archivage de long terme existent pour les centres de stockage de surface exploités par l’Andra et font l’objet de revues périodiques. Le retour d’expérience montre que ces solutions paraissent robustes pour au moins les 500 premières années. Ainsi, pour Cigéo, l’Andra prévoit qu’un centre de la mémoire perdurera sur le site. Il pourra accueillir le public et comprendra notamment les archives du Centre.
De manière générale, le maintien de la mémoire doit aussi impliquer les acteurs locaux, qui peuvent prendre le relai en cas de défaillance de l’Andra ou de l’État. L’Andra veille d’ores et déjà à les informer sur les enjeux associés à la mémoire et étudie avec des anthropologues, des philosophes ou encore des artistes les facteurs qui peuvent favoriser la transmission de la mémoire. La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
L’Andra a lancé en 2010 un programme d’études pour proposer des outils qui rendent cette transmission plus robuste sur une échelle de temps millénaire. Des pistes se dessinent tels des marqueurs de surface, mais aussi des rendez-vous réguliers à mettre en place au niveau des populations locales.
En tout état de cause, comme il est impossible de garantir notre capacité à communiquer avec des êtres vivant dans plusieurs milliers d’années, c’est chaque génération qui aura la responsabilité de contribuer à transmettre cette mémoire aux générations suivantes.
Concernant le risque de mouvements géologiques importants
La stabilité et la très faible sismicité de la zone d’implantation du laboratoire souterrain est confirmée par les scientifiques qui ont travaillé sur ce site depuis plus de 20 ans. Le site de Meuse/Haute-Marne appartient à un domaine géologique stable (voir carte), particulièrement favorable pour l’installation d’un stockage. L’activité sismique est en effet extrêmement faible, comme le prouvent les enregistrements de sismicité instrumentale (écoute sismique depuis 1961 à l’échelle de la France) qui sont capables de détecter des microséismes, et les chroniques historiques (séismes ayant été ressentis et/ou ayant occasionné des dégâts au cours des derniers 1 000 ans). Au-delà de ces données, la stabilité et la très faible sismicité du site s’expliquent par sa situation géographique dans le bassin parisien qui est protégé des mouvements liés à la tectonique des plaques (collision du continent africain avec l’Europe).
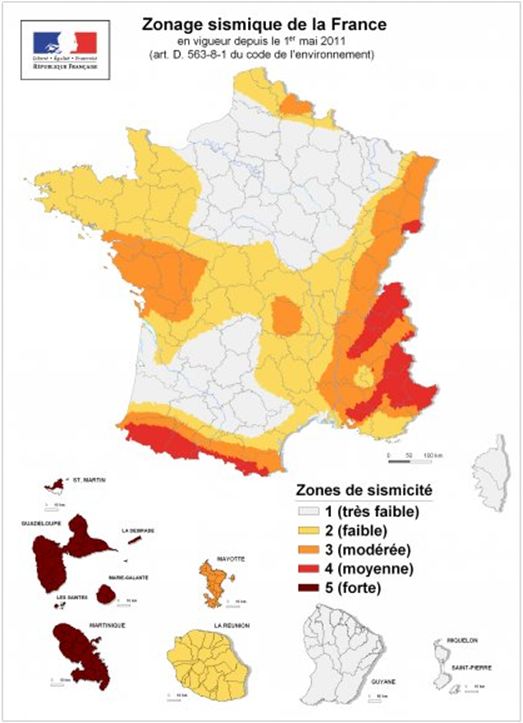
QUESTION 350 - Cause toujours !...
Posée par Bernard CHARAVIN (NYONS), le 30/09/2013
Une question me hante : à quoi sert un "débat public" alors que des travaux gigantesques ont déjà été réalisés dans le cadre de ce projet ? Tout sera donc arrêté si les citoyens se montrent opposés à l'enfouissement, et l'on cultivera des champignons dans ces galeries ? Dormez, braves gens, tout est calme ! J'ai comme le sentiment (une fois de plus) d'être pris pour un ... !
Réponse du 18/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Aujourd’hui, la décision de créer Cigéo n’est pas prise. L’Andra a justement souhaité que le débat public intervienne en 2013, quand le projet n’est pas encore finalisé, pour prendre en compte le débat public dans la suite de ses études en vue d’établir le dossier de demande d’autorisation de création du centre de stockage. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra à l’État après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo en 2015. Ce processus comprendra notamment une évaluation de sûreté par l’Autorité de sûreté nucléaire et une évaluation scientifique par la Commission nationale d’évaluation, l’avis des collectivités territoriales, le vote d’une nouvelle loi fixant les conditions de réversibilité et une enquête publique.
Les seules galeries souterraines existantes sont celles du Laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne. Ce laboratoire de recherche permet d’étudier à 500 mètres de profondeur les propriétés de la roche argileuse étudiée pour le stockage. Cette installation n’a en aucun cas été conçue pour accueillir un jour des déchets radioactifs.
QUESTION 349 - debats publics
Posée par Jean-Claude LAUREAUX, L'organisme que vous représentez (option) (LANGRES), le 30/09/2013
Sur vos infos relatives aux débats publics, je n'ai pas vu les endroits où se déroulent les débats prévus...merci de me faire parvenir les villes et les lieux où ces débats auront lieu dans les mois à venir. La ville de Langres est-elle concernée par de tels débats? Merci de votre réponse.
Réponse du 19/11/2013,
Les réunions publiques ont été annulées car la Commission ne pouvait pas les tenir. Elles étaient boycottées dès leur ouverture et aucun échange n'était possible.
Le débat public se poursuit donc autrement, par la participation aux débats contradictoires interactifs, les questions et avis, les contributions et les cahiers d’acteurs. Le débat continue sur internet, par courrier et à la permanence de la Cpdp (Bar-le-Duc).
Les débats contradictoires sont retransmis en direct sur le site internet du débat public : ../. Le jour du débat, la bannière centrale de la page d'accueil permet d'accéder à la retransmission en format vidéo ou audio.
Vous avez la possibilité de poser vos questions depuis le site, par SMS (envoyez DEBAT au 32321 suivi de votre question. Service gratuit hors coût du SMS) via Facebook, Twitter ou par mail.
Voici le calendrier des débats à venir :
• date à définir " Gouvernance, concertation publique et suites du débat"
Vous trouverez les enregistrements vidéo, audio et la retranscription des précédents débats sur la page : ../informer/comment-ca-marche.html.
QUESTION 348
Posée par Philippe PORTMANN (LANEUVILLE AU PONT), le 27/09/2013
Que pensez-vous faire pour les intervenants exterieurs qui se rendent sur le site et qui, à mon sens, ne sont pas pris en charge et impliqués en terme de sécurité, d'action à tenir en cas de problème, etc. La prise en charge et l'accueil sur le site de Bure est trop faible pour ne pas dire nul. Rigueur et sérieux n'est-il pas le mot d'ordre de ce projet?
Réponse du 15/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La sécurité des intervenants sur nos sites est bien évidemment notre priorité, qu’ils soient des prestataires, des visiteurs ou des agents de l’Andra. Les consignes de sécurité sont strictes. Aucune personne ne descend dans le Laboratoire souterrain sans habilitation et sans connaître les procédures d’évacuation, le mode de fonctionnement des ascenseurs et de l’Apeva, dispositif qui permet de respirer de façon autonome en cas de fumée toxique suite à un incendie. Qui plus est, un coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) est présent au Centre Meuse/Haute-Marne afin de définir l’ensemble des mesures visant à prévenir les risques liés à l’interférence des activités des différents intervenants sur les chantiers.
En surface, toute intervention d’une entreprise extérieure est soumise à un plan de prévention qui fixe les règles de sécurité et récapitule les actions à mener en cas d’accident ou d’incendie sur le site (numéro des secours, localisation des points de rassemblement…). Il précise également les règles de circulation à l’intérieur du site. Il est rempli et signé par le responsable de l’entreprise intervenante qui informe ses salariés de son contenu avant leur venue sur le site. Ces dispositions sont conformes au code du travail.
Nous vous invitons à prendre contact avec le Centre Meuse/Haute-Marne (info.meusehautemarne@andra.fr) si vous souhaitez nous faire part de manière plus précise de vos remarques.
QUESTION 347
Posée par René DEOM (VILLECLOYE), le 27/09/2013
Date à laquelle le centre de Bure sera opérationnel? Coût des travaux à l'heure actuelle?
Réponse du 18/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra à l’État après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo en 2015 conformément au calendrier fixé par la loi du 28 juin 2006. Ce processus comprendra notamment l’évaluation de la sûreté par l’Autorité de sûreté nucléaire, l’évaluation des recherches scientifiques par la Commission nationale d’évaluation, l’avis des collectivités territoriales, le vote d’une nouvelle loi fixant les conditions de réversibilité, la mise à jour de la demande de création de Cigéo par l’Andra suite à cette loi, et une enquête publique. Si Cigéo est autorisé, les travaux de construction pourraient débuter en 2019 pour une mise en service en 2025, sous réserve de l’autorisation de l’Autorité de sûreté nucléaire.
La dernière évaluation du coût du stockage validée par le ministère en charge de l’énergie date de 2005. Le coût du stockage avait été estimé entre 13,5 et 16,5 milliards d’euros, répartis sur une centaine d’années. Cette évaluation couvrait notamment le stockage de tous les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue produits par les réacteurs nucléaires français pendant 40 ans. Une nouvelle évaluation est en cours par l’Andra, pour intégrer les pistes d'optimisation et les nouveautés en termes de solutions techniques, de sécurité et de dimensionnement.
QUESTION 346
Posée par Claude EVRARD (CHAUMONT), le 27/09/2013
Transports des déchets (camion -voies ferrées - autres) : Quel itinéraire?
Réponse du 18/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les modalités d’acheminement des colis de déchets depuis les sites où ils sont entreposés jusqu’à Cigéo sont étudiées par les producteurs de déchets (Areva, CEA et EDF). Le transport des colis par voie ferroviaire est privilégié. Le réseau ferré national permet d’acheminer les convois jusqu’à proximité de Cigéo. Différents itinéraires sont étudiés depuis les sites où sont entreposés les colis de déchets (voir carte).
La desserte locale de Cigéo est étudiée dans le cadre du schéma interdépartemental de développement du territoire. L’arrivée et le déchargement des trains se feraient dans un terminal ferroviaire spécifique. Deux options sont possibles :
- Soit le terminal ferroviaire est implanté sur une voie ferroviaire existante en Meuse ou en Haute-Marne. Le transport final jusqu’à Cigéo serait alors réalisé par voie routière;
- Soit le terminal ferroviaire est implanté sur le site même de Cigéo, ce qui nécessiterait de créer un raccordement ferroviaire d’environ 15 km.
Plus d’information : Le transport des colis de déchets (chapitre 4.3)
../docs/dmo/chapitres/DMO-Andra-chapitre-4.pdf

QUESTION 345
Posée par Philippe VUILLAUME (BAZINCOURT SUR SAULX), le 27/09/2013
Y aura-t-il un stockage de déchets militaires? Si oui, aurez-vous la certitude de leur nature et qualification?
Réponse du 27/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les déchets radioactifs d’origine militaire produits en France sont recensés et gérés par l’Andra de la même manière que les déchets radioactifs provenant d’autres secteurs d’activité. L’ensemble des informations liées à ces déchets est publié dans l’Inventaire national des matières et déchets radioactifs (http://www.andra.fr/download/site-principal/document/editions/467.pdf).
Dans ce cadre, les déchets militaires les plus radioactifs (déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue) sont destinés à être stockés dans Cigéo. Il s’agit des déchets qui résultent des activités liées à la force de dissuasion et à la propulsion navale nucléaire menées par le CEA. Ils sont tous propriété du CEA et proviennent de trois origines :
- la production du plutonium nécessaire à la fabrication des armes nucléaires, réalisée à Marcoule dans la première usine française de traitement des combustibles usés (UP1) et arrêtée depuis 1995,
- les travaux de fabrication, de maintien en conditions opérationnelles et de démantèlement des armes nucléaires et les recherches et études associées, menées pour partie à Bruyères le Châtel (jusqu’en 1997) et pour partie à Valduc,
- le développement, la qualification et la maintenance de systèmes et équipements destinés aux chaufferies des bâtiments à propulsion nucléaire. Ces activités sont conduites dans les installations de la propulsion nucléaire situées sur le site de Cadarache.
Les déchets militaires de haute activité déjà produits représentent environ 250 m3 (soit 2,5 % du volume des colis de déchets HA destinés à Cigéo) et ceux de moyenne activité à vie longue environ 5 000 m3 (soit 7 % du volume des colis de déchets MA-VL). Ces déchets sont de nature similaire à ceux produits par le nucléaire civil.
QUESTION 344
Posée par Bernard JACQUINOT (VELAINES), le 27/09/2013
Esperons que le futur stockage souterraine soit dédié uniquement aux déchets produits en France? Est-ce que le transport des déchets sera plus sécurisé par voie ferrée que par la route?
Réponse du 10/02/2014,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Depuis la loi de 1991, le Parlement a interdit le stockage en France de déchets radioactifs en provenance de l’étranger. Cette interdiction figure aujourd’hui à l’article L. 542-2 du Code de l’environnement. Cette législation est cohérente avec la directive européenne du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre des combustibles usés et des déchets radioactifs, qui réaffirme la responsabilité de chaque État dans la gestion de ses déchets radioactifs.
Toutefois, ainsi que cela est indiqué en page 14 du rapport réalisé par le HCTISN pour le débat public de Cigéo (../docs/docs-complementaires/docs-avis-autorites-controle-evaluations/rapport-hctisn-gt-cigeo.pdf), certains contrats de traitement de combustibles usés passés dans les années 1970 avec des pays étrangers ne prévoyaient pas de clause de retour des déchets issus du traitement. Ces déchets représentent un volume limité. Ils ont été pris en compte pour établir l’inventaire prévisionnel du projet. Depuis 1980, les contrats de traitement de combustibles usés étrangers prévoient systématiquement le renvoi des déchets issus du traitement dans le pays d’origine.
Réponse apportée par AREVA :
Les transports de déchets HA, MAVL sont réalisés aujourd’hui et seront réalisés pour Cigéo dans le cadre des réglementations internationales (AIEA, ADR, RID…) et nationales en vigueur. Ces réglementations sont établies en fonction de la nature de la matière transportée et du mode de transport utilisé.
En France, l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) est responsable du contrôle de la sûreté des transports de substances radioactives pour les usages civils.
Le transport de ces substances radioactives est assuré par des sociétés spécialisées et autorisées par les autorités compétentes.
Pour Cigéo, le transport ferroviaire est privilégié, notamment parce que ce mode se prête mieux au transport d’emballages de masses élevées, ce qui est le cas pour une grande partie des déchets concernés. C’est aussi la solution privilégiée sur de longues distances du fait d’un bilan carbone plus favorable. Par ailleurs, les principaux sites d’entreposage des déchets destinés à Cigéo disposent à proximité d’infrastructures permettant un transport routier et ferroviaire.
QUESTION 343
Posée par Pierre CORNEVIN (CHANCENAY), le 27/09/2013
Quels sont les types de déchets qui seront enfouis et leur volume?
Réponse du 19/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le projet de stockage profond Cigéo est conçu pour mettre en sécurité définitive les déchets dont le niveau de radioactivité et la durée de vie ne permettent pas de les stocker, de manière sûre à long terme, en surface ou à faible profondeur.
Les déchets concernés proviennent principalement du secteur de l’industrie électronucléaire et des activités de recherche associées ainsi que, dans une moindre part, des activités liées à la Défense nationale. Les déchets dits de « haute activité » (HA) correspondent principalement aux résidus hautement radioactifs issus du traitement des combustibles nucléaires usés utilisés pour la production d’électricité. Les déchets dits de « moyenne activité à vie longue » (MA-VL) ont des origines variées : résidus issus du traitement des combustibles nucléaires usés et de la fabrication de certains combustibles, composants (hors combustible) ayant séjournés dans les réacteurs nucléaires, déchets technologiques issus de la maintenance des installations nucléaires, de laboratoires, d’installations liées à la Défense nationale, du démantèlement...
Cigéo est conçu pour prendre en charge les déchets produits par les installations nucléaires existantes. Les volumes de déchets HA et MA-VL sont estimés à environ 10 000 m3 pour les déchets HA (soit environ 60 000 colis de déchets) et environ 70 000 m3 pour les déchets MA-VL (soit environ 180 000 colis de déchets) dans l’hypothèse d’une poursuite de la production électronucléaire* et d’une durée de fonctionnement des installations nucléaires existantes de 50 ans. Dans cette hypothèse, 30 % des déchets HA et 60 % des déchets MA-VL sont déjà produits. Par précaution, des volumes supplémentaires (environ 20 % du volume de déchets MA-VL à stocker) sont prévus en réserve dans Cigéo pour certains déchets de faible activité à vie longue qui, le cas échéant, ne pourraient pas être stockés dans le stockage à faible profondeur à l’étude par l’Andra.
Cigéo est conçu pour être flexible afin de pouvoir s’adapter à d’éventuels changements de la politique énergétique. En cas d’arrêt de la production électronucléaire et d’arrêt du traitement des combustibles nucléaires usés, environ 3 500 m3 de déchets HA, 59 000 m3 de déchets MA-VL et 90 000 m3 de combustibles usés non traités seraient destinés au stockage. A la demande du Ministère en charge de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, l’Andra, EDF et Areva ont étudié l’impact des différents scénarios établis dans le cadre du débat national sur la transition énergétique sur la production de déchets radioactifs et sur le projet Cigéo : ../docs/rapport-etude/20130705-courrier-ministere-ecologie.pdf
* Les déchets produits par un éventuel futur parc de réacteurs ne sont pas pris en compte.
QUESTION 342
Posée par Bernard COLTE (SOULOSSE SOUS SAINT ELOPHE), le 27/09/2013
Tout est tronqué dès le départ. Les sommes pharaoniques versées par l'ANDRA aux élus locaux ou autres territorialités prouvent la malhonneteté du projet. A quoi sert un débat public quand les jeux sont faits? Ce n'est qu'une mascarade de plus.
Réponse du 23/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Il n’y a rien de malhonnête. L’accompagnement économique du projet a été décidé par le Parlement. Il est normal que les territoires qui acceptent de s’engager depuis une vingtaine d’années dans une démarche visant à mettre en œuvre un projet d’intérêt national en tirent un bénéfice concret. Deux groupements d’intérêt public ont été constitués en Meuse et en Haute-Marne en vue de gérer des équipements nécessaires à l’installation du Laboratoire souterrain ou du centre de stockage s’il est mis en œuvre, de mener des actions d’aménagement du territoire et de développement économique et de soutenir des actions de formation et la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques. Contrairement à ce que vous indiquez, l’accompagnement économique n’est pas versé par l’Andra. Il est financé par les producteurs de déchets au moyen d’une taxe sur les installations nucléaires.
La création de Cigéo n’est pas décidée. Le débat public est l’occasion de permettre à chacun de s’exprimer sur le projet présenté par l’Andra. Les conclusions du débat public seront prises en compte par l’Andra dans la poursuite des études.
Réponse apportée par la Commission du débat public :
Le débat public conformément aux articles L 121-1 et suivants organise la participation du public au processus d’élaboration des projets d’aménagement ou d’équipement d’intérêt national présentant de forts enjeux socio-économiques et des impacts significatifs sur l’environnement et l’aménagement du territoire. Le débat ne porte pas seulement sur les modalités de l’ouvrage mais sur son principe même. L’opportunité du projet fait d’ailleurs l’objet de nombreux questionnements sur le site du débat et est largement abordé dans les cahiers d’acteurs. Les mesures d’accompagnement économique n’engagent en rien les décisions qui seront prises par le gouvernement à l’horizon 2018.
En effet, le débat public s’inscrit dans un processus décisionnel qui prévoit après la publication du compte rendu du débat : une réponse sous 3 mois du maître d’ouvrage, un dépôt par l’ANDRA de la demande d’autorisation de création de Cigéo en 2015 puis entre 2015 et 2018 l’évaluation de cette demande par la Commission Nationale d’Evaluation, l’avis de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, le recueil de l’avis des collectivités territoriales, une loi fixant les conditions de réversibilité du stockage qui devrait être débattue et votée par le parlement en 2016. L’ANDRA devra alors mettre à jour sa demande d’autorisation qui sera instruite à nouveau par l’Autorité de Sûreté Nucléaire après enquête publique. La délivrance de l’autorisation de création si elle devait être donnée le serait ensuite par décret en Conseil d’Etat. L’ouverture de Cigéo reste donc conditionnée comme vous pouvez le voir à toute une série d’évaluations et d’instructions dont rien ne permet aujourd’hui de garantir qu’elles aboutissent à une décision favorable.
QUESTION 341
Posée par Claudine PHILBERT (SAINT DIZIER), le 26/09/2013
Dans 60 ans, avez-vous songé à d'éventuelles pannes informatiques et que l'ouvrage lui-même subisse des dommages auxquels vous n'aviez pas pensé, que se passera-t-il? Qu'envisagez-vous sur les dangers pour la nature et l'humanité?
Réponse du 06/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Comme c’est le cas pour d’autres installations nucléaires, des dispositions sont prises dès la conception de Cigéo pour maîtriser le risque de pannes informatiques et pouvoir mettre en sécurité le stockage en cas de telles pannes :
- des systèmes informatiques de rechange et de protection contre les effets d’éventuelles pannes seront mis en place,
- en cas de panne informatique, les équipements industriels devront pouvoir être opérés de manière électromécanique (par exemple au moyen d’armoires de commande).
Par ailleurs, les systèmes informatiques sont conçus pour être évolutifs afin de prendre en compte les évolutions technologiques pendant la durée d’exploitation du stockage.
La sûreté est au cœur du projet : Cigéo est conçu pour être sûr pendant sa construction, son exploitation et après sa fermeture. Pour cela, l’objectif principal de l’Andra est d’éviter la dispersion incontrôlée de radioactivité et faire en sorte que la quantité de radioactivité qui se retrouve au contact des travailleurs et des populations riveraines soit très faible et ne présente pas de risque pour la santé.
Pour garantir la sûreté de ses installations, l’Andra identifie ainsi toutes les sources potentielles de dangers (séisme, inondation, conditions climatiques extrêmes, incendie, explosion, chute d’avion, environnement industriel, voies de circulation, présence d’autres installations présentant des risques…). L’ensemble de ces risques est pris en compte dès la phase de conception afin de prendre les dispositions nécessaires pour les prévenir ou réduire leur probabilité quand c’est possible et limiter leurs effets sur les installations (que ce soit pour les installations de surface ou l’installation souterraine). Ces dispositions sont contrôlées par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Si Cigéo est autorisé, l’ASN effectuera également des inspections (plusieurs par an, dont certaines inopinées) pour vérifier que la sûreté du site est bien assurée par l’Andra. Dans le cas contraire l’ASN peut imposer des prescriptions supplémentaires si elle considère qu’un risque n’est pas maîtrisé correctement, voire mettre à l’arrêt l’installation.
Si vous souhaitez plus d’informations sur la démarche mise en œuvre pour garantir la sûreté de Cigéo, vous pouvez consulter le chapitre 5 du dossier du maître d’ouvrage : ../docs/dmo/chapitres/DMO-Andra-chapitre-5.pdf
QUESTION 340
Posée par Ghislaine HOUARD (SIONNE), le 26/09/2013
Pourquoi les Vosgiens vivant proche du site, ne peuvent-ils pas figurer parmi le panel "représentatif" pour la conférence de citoyens?
Réponse du 03/12/2013,
Rien n'empêche les Vosgiens de figurer parmi le panel de citoyens, au contraire. Un Institut de sondages opère un premier repérage de citoyens non spécialistes et intéressés à participer à cette expérience citoyenne (par une enquête d’opinion nationale sur 400 personnes et un appel téléphonique aléatoire de 400 autres personnes) jusqu’à l’obtention d’un groupe de citoyens de 20 personnes suffisamment diversifié (en termes d’âge, de sexe, de catégorie socioprofessionnelle), tout en étant non spécialistes (par leur profession ou leur engagement associatif) de la question des déchets nucléaires. Idéalement ce groupe devrait être composé de 2/3 d’habitants de la Haute Marne, de la Meuse et des Vosges, et d’un tiers d’habitants du reste de la France.
Cette composition du groupe se fera sous la responsabilité d’un comité de pilotage pluraliste et indépendant de la Commission du débat public (cf. composition sur le site de la CNDP), qui veillera à la diversité et au caractère profane de ce panel.
QUESTION 339
Posée par Pierre ROUSSELOT (GEVILLE), le 26/09/2013
Nous sommes pour le centre de stockage réversible profond de déchets radioactifs en Meusen Haute-Marne (CIGEO). Nous pensons que mieux vaut un centre surveillé près de chez soi que des dépots cachés (sauvages) à ciel ouvert et autres n'importe où dans le monde. Quand ouvrira-t-il réellement enfin? Il faut bien faire quelque chose avec ces déchets.
Réponse du 18/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra à l’État après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo en 2015 conformément au calendrier fixé par la loi du 28 juin 2006. Ce processus comprendra notamment l’évaluation de la sûreté par l’Autorité de sûreté nucléaire, l’évaluation des recherches scientifiques par la Commission nationale d’évaluation, l’avis des collectivités territoriales, le vote d’une nouvelle loi fixant les conditions de réversibilité, la mise à jour de la demande de création de Cigéo par l’Andra suite à cette loi, et une enquête publique.
Si Cigéo est autorisé, les travaux de construction pourraient débuter en 2019 pour une mise en service en 2025, sous réserve de l’autorisation de l’Autorité de sûreté nucléaire.
QUESTION 338
Posée par Maurice MICHEL (GRAND), le 25/09/2013
Monsieur le président, le transport ferroviaire de matières dangereuses fait courir des risques majeurs à la population riveraine. S’agissant des matières nucléaires, il y a bien sûr les risques inévitables d’irradiation et de contamination radioactive pour celles et ceux qui sont à proximité des wagons sur lesquels seront chargées les sources de radioactivité, mais il y a aussi l’amplification incommensurable du danger en cas d’accident. La catastrophe ferroviaire qui s’est produite en Belgique le 4 mai 2013 (deux morts, 17 blessés après le déraillement d’un train de produits chimiques) et celle de Lac-Mégantic au Canada survenue en pleine ville le 7 juillet dernier (47 morts à la suite du déraillement et de l’explosion d’un train de pétrole) sont là pour nous le rappeler douloureusement. Un des moyens de prévention les plus simples, pour la population concernée, de se prémunir des risques est de s’éloigner temporairement -ou définitivement- de la source de dangers. Personne ne peut sérieusement contester que nos concitoyens disposent d’une sorte de droit de retrait d’une situation dangereuse. Comment la population peut-elle exercer ce droit si elle n’est pas informée qu’elle se trouve sur un axe de transports de sources radioactives parce que la désignation du lieu où elle habite et par lequel transitent les convois de déchets est tenue secrète ?
Réponse du 10/02/2014,
Réponse apportée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
En France, le transport de matières nucléaires est soumis au Code de la Défense. Le Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité, placé auprès du ministre de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie (MEDDE) est chargé du respect des règles de confidentialité. Celles-ci s'imposent à tous les intervenants (pouvoirs publics, exploitants, transporteurs, etc.) lors de la préparation et l'exécution des transports de matières nucléaires.
La réglementation relative au transport des combustibles usés et des déchets radioactifs impose au transporteur de ne pas communiquer les itinéraires précis pour des raisons de sécurité. Le trajet emprunté est validé par les autorités compétentes et sa diffusion est restreinte.
48 heures avant le transport, le COGIC (Centre Opérationnel de gestion interministérielle de crises) informe l’ensemble des autorités compétentes et les services de sécurité de l’Etat au niveau national ainsi que les services de sécurité et d’intervention dans les régions et les départements concernés.
S’agissant du transport de substances radioactives, le transporteur est tenu de respecter la réglementation en vigueur et de s’assurer de l’absence de danger pour les populations et l’environnement. Les autorités et services de sécurité de l’Etat compétents sont informés du parcours du transport afin d’être en mesure d’agir et d’informer la population si cela le nécessitait.
Dans une entreprise, le droit de retrait correspond au droit, pour un salarié confronté à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, d’arrêter son travail et, si nécessaire, de quitter les lieux pour se mettre en sécurité.
Réponse apportée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) :
La sûreté des transports de substances radioactives à usage civil est contrôlée en France par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), sur la base d’inspections et de l’instruction de demandes d’agrément d’emballages. Ce contrôle vise à assurer la protection des personnes et de l’environnement. Il porte sur la conception des emballages et les opérations de transports qui sont soumises à des contraintes réglementaires rigoureuses.
Les emballages doivent notamment assurer un confinement des substances radioactives transportées et fortement réduire le rayonnement à l’extérieur du colis.
De façon plus spécifique, le débit de dose à proximité du véhicule ne doit pas dépasser certains plafonds. En pratique, les niveaux relevés sont en général beaucoup plus faibles que ces plafonds. Même si ces plafonds étaient atteints, une personne devrait rester 10 heures à deux mètres du véhicule pour que le rayonnement reçu atteigne la limite annuelle d’exposition du public.
Concernant les risques en cas d’accident, les modèles de colis sont soumis à des épreuves réglementaires destinées à démontrer leur résistance lors du transport. Le niveau d’exigence de ces épreuves est proportionné à la dangerosité des substances transportées. À titre d’exemple, les modèles de colis correspondant aux substances les plus dangereuses doivent conserver leurs fonctions de sûreté, y compris en cas d’accident (simulé par une chute de 9 m sur une surface indéformable, une chute de 1 m sur un poinçon, un incendie d’hydrocarbure totalement enveloppant de 800° C minimum pendant 30 mn, une immersion dans l’eau à une profondeur de 200 m).
Les autorités se sont naturellement interrogées depuis plusieurs années sur le comportement des colis agréés dans des cas d’agressions allant au-delà de ces épreuves réglementaires décrites précédemment.
Des études ont été menées en France et à l’étranger, notamment par l’IRSN, AREVA, l’autorité allemande BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung) et le laboratoire national américain SANDIA, afin d’évaluer le comportement des colis contenant des substances radioactives dans des conditions réalistes d’impact mécanique et de feu et pouvant aller au-delà des sollicitations prévues par les épreuves réglementaires. Ainsi, la tenue de ces types de colis dans des conditions de feu plus contraignantes (en termes de durée et de température) et dans des conditions de chute plus réalistes (en termes de surface d’impact et de hauteur de chute) a été étudiée. Par exemple, une étude de l’IRSN consultable sur le site Internet de l’institut[1] permet de comparer l’écrasement du colis sur une surface indéformable, comme prévu dans les épreuves réglementaires et sur des surfaces représentatives de cibles réelles : par exemple des sols en sable, argile ou des cibles métalliques représentatives de l’environnement des emballages durant le transport dont l’essieu de wagon et le longeron de wagon. Cette étude a montré que les colis considérés dans l’étude conserveraient leur capacité de confinement en cas d’accident réel et que leurs équipements additionnels (châssis et râtelier) ainsi que les cibles absorberaient une part importante de l’énergie d’impact et augmenteraient ainsi les marges de sûreté.
D’autres études ont été réalisées à l’étranger concernant le transport ferroviaire de colis de substances radioactives. Par exemple :
- l’institut allemand (BAM) a réalisé des essais visant à représenter un scénario d’accident impliquant une explosion d’un wagon citerne chargé de propane à proximité d’un colis de type CASTOR contenant du combustible irradié De façon à être plus pénalisant, le colis de combustible n’était pas muni de ses capots amortisseurs. L’essai a entraîné une boule de feu ainsi que des flammes allant au-dessus du point d’explosion. Le colis de substances radioactives a été projeté à 7 m de sa position initiale et s’est enfoncé de 1 mètre dans le sol. Toutefois, les tests d’étanchéité, réalisés après essai, ont montré que l’emballage restait étanche, il n’y a donc pas eu d’augmentation des conséquences de l’accident lié au caractère radiologique du contenu de l’emballage transporté[2].
- Le BAM a également réalisé une simulation numérique visant à évaluer l’impact d’une chute sur des rails à une hauteur de 14 m d’un colis contenant des déchets vitrifiés de haute activité qui aurait été préalablement endommagé par une entaille de 12 cm. Le BAM a conclu que l’emballage restait intact[3].
- La « Central Electricity Generating Board for England and Wales » a organisé un crash-test public consistant à faire entrer en collision un train de 140 t roulant à 160 km/heure dans un colis de combustible irradié de type B. Les vidéos du crash-test disponibles sur Internet montrent que le combustible est resté confiné dans l’emballage[4].
En France, aucun accident ferroviaire ayant impliqué des colis de combustible usé n’a à ce jour été rapporté.
La dernière ligne de défense de la sûreté des transports de substances radioactives repose sur les moyens d’intervention mis en œuvre face à un incident ou un accident. Les pouvoirs publics, l’ASN et les exploitants se préparent donc à la gestion des situations de crise impliquant un transport de substances radioactives à travers les plans ORSEC et au moyen d’exercices.
Réponse apportée par AREVA :
La sûreté des transports est un des facteurs clés du succès de Cigéo. En France, les premiers transports de substances radioactives liés à l’industrie électronucléaire ont débuté dans les années 60. Aujourd’hui, on estime à environ 11 000 par an le nombre total de transports nécessaires au cycle du combustible pour l’activité électronucléaire. Les exigences des autorités nationales et internationales en termes de sûreté et de sécurité de transport n’ont cessé de se renforcer. Les matières et déchets radioactifs sont transportés dans des « emballages » de haute technologie et agréés par l’Autorité de Sûreté Nationale. Le retour d’expérience de plusieurs dizaines d’années confirme le haut niveau de sûreté mis en œuvre : aucun accident ayant eu des conséquences radiologiques n’est à déplorer.
La résistance des emballages est testée en conditions extrêmes. En effet, la sûreté nucléaire repose d’abord sur l’emballage. Les emballages utilisés sont conçus pour assurer la protection des personnes et de l’environnement en toutes circonstances, tant dans des conditions normales que dans des situations accidentelles.
Les emballages destinés aux transports des déchets les plus radioactifs sont conçus pour être étanches et le rester même en cas d’accident (collision, incendie, immersion…). Leur étanchéité maintenue même en situation extrême permet de prévenir le risque de contamination. Par ailleurs, ces emballages sont composés de plusieurs types de matériaux permettant de réduire les niveaux d’exposition aux rayonnements pour les rendre inferieurs aux limites fixées par la réglementation. Celle-ci établit que la quantité de rayonnements reçus par une personne qui resterait à 2 m du véhicule pendant une heure n’excède pas la limite de 0,1 mSv quel que soit le type de déchets transporté. A titre de comparaison, l’exposition moyenne annuelle de la population française à la radioactivité naturelle est de 2,4 mSv. Enfin, la France a mis en place un dispositif national pour gérer de potentiels accidents. Les autorités s’appuient sur les dispositifs mis en place dans le cadre des plans ORSEC et à leur déclinaison départementale. Les Préfectures sont averties par le Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle de Crises (COGIC) des transports transitant par leur département ; ce dernier assure, entre autres missions, sous l’autorité du Ministère de l’Intérieur, des responsabilités opérationnelles dans le domaine de la gestion et du suivi des transports.
AREVA au travers de sa filiale AREVA TN dispose, par ailleurs, d’un plan d’urgence interne spécifique appelé PUI-T. Celui-ci couvre les phases d’alerte, d’analyse de la situation et d’intervention sur le terrain suite à un incident ou un accident de transport de matières radioactives. Il permet à AREVA TN de mettre à la disposition des autorités compétentes des moyens humains spécialisés et des matériels spécifiques. L’ensemble de ce dispositif est testé, en moyenne, chaque année à l’échelon national avec les principaux acteurs et notamment les autorités compétentes.
Concernant le dispositif d’information autour des transports, la loi de 2006 relative à la Transparence et à la Sécurité en matière Nucléaire, aujourd’hui codifiée dans le Code de l’environnement, fixe notamment les conditions d’information autour des transports de substances radioactives. Ainsi, pour garantir la sécurité du transport afin d’empêcher tout détournement, les itinéraires, dates et horaires ne sont pas communiqués.
Les transports de substances radioactives répondent aux exigences de l’AIEA (Agence Internationale de l’Energie Atomique) contre le détournement de substances. Le COGIC, sous l’autorité du Ministère de l’Intérieur, informe l’ensemble des parties prenantes au transport : les autorités nationales et départementales, les services de l’Etat concernés ainsi que les intervenants dans l’éventuelle mise en œuvre d’un plan ORSEC, notamment les Préfets des départements concernés. Le Président de la Commission Locale d’Information CLIs peut être également informé de la réalisation d’un transport quelques jours avant sa date.
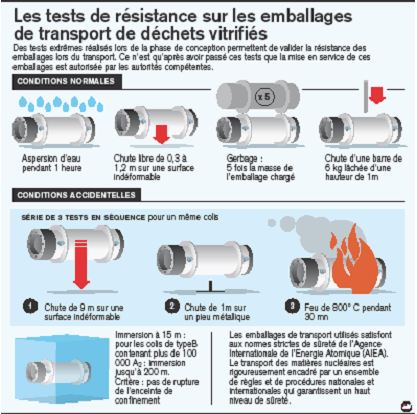
[1] http://www.irsn.fr/FR/Larecherche/publications-documentation/aktis-lettre-dossiers-thematiques/RST/RST-2002/Documents/Chap03_art1.pdf
[2] http://www.tes.bam.de/de/umschliessungen/behaelter_radioaktive_stoffe/dokumente_veranstaltungen/pdf/rmtp1999104231.pdf
[3] http://www.tes.bam.de/en/umschliessungen/behaelter_radioaktive_stoffe/behaelterpruefungen/index.htm
[4] http://www.britishrailways.tv/train-videos/2012/100mph-nuclear-flask-train-crash-test/
QUESTION 337
Posée par Maurice MICHEL, IGAS honoraire président de l'ASODEDRA (GRAND), le 25/09/2013
Questions posées le 24 septembre 2013 par Maurice MICHEL, Inspecteur général honoraire des affaires sociales
La littérature spécialisée est riche, en France et à l’Etranger, des leçons tirées des évaluations de sûreté des installations d’entreposage, en surface ou sub-surface, de déchets nucléaires hautement radiotoxiques. En revanche, nous n’avons pas trouvé d’évaluations de même nature, portant sur des sites civils en fonctionnement de stockage en profondeur de ces résidus [si on exclut les expériences en mines de sel, plutôt catastrophiques, de ASSE en Allemagne et de StocaMine en France, s’agissant d’ailleurs de déchets chimiques ultimes dans ce second cas].
Certes, le conditionnement des déchets à enterrer a été étudié par des spécialistes qualifiés. Il est vrai aussi que, dans notre pays, le laboratoire souterrain de Bure a permis à l’Andra en partenariat avec d’autres organismes d’étudier, à titre expérimental, depuis une petite dizaine d’années les caractéristiques du sous-sol et de ses composants à 500 m de profondeur. Mais, cela sur un seul site. Et surtout, à notre connaissance, aucune expérience réelle, in situ, n’aurait été réalisée sur les relations entretenues dans la durée, fut-elle courte, entre les radionucléides conditionnés et leur enveloppe géologique. En l’absence d’étude scientifique de ces interactions reposant sur l’expérience, l’Andra et les organismes qui coopèrent au projet Cigéo ont recours, pour délivrer un message garantissant dans le futur la sûreté et la sécurité de la fosse de Bure, à des analyses qualitatives et quantitatives tirées de modélisations et de simulations numériques. A l’instar, nous dit le Comité local d’information et de suivi du laboratoire de Bure (lettre N°13 de décembre 2012), de celles mises en œuvre en météorologie…Ce qui ne nous rassure pas vraiment.
Combien de sites civils de stockage en profondeur (ou en grande profondeur) de déchets radioactifs HA-MA/VL sont-ils opérationnels dans le monde, fut-ce à titre expérimental, et où sont-ils situés ?
Où peut-on trouver les premières évaluations de sûreté et de sécurité du fonctionnement de ces sites, ne serait-ce que sur une période de quelques dizaines d’années, voire de quelques années seulement ?
Réponse du 17/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La confiance dans la représentation des processus qui déterminent le comportement des radionucléides dans le milieu géologique sur de longues échelles de temps se fonde non seulement sur les études menées en laboratoires souterrains en France et à l’étranger mais également sur l’étude d’analogues naturels et anthropologiques (objets géologiques ou archéologiques similaires à des composants du stockage) dont l’observation renseigne sur l’évolution qu’ils ont subi à long terme : objets métalliques archéologiques vieux de plus de 2000 ans, gisements naturels de minerais radioactifs présentant des analogies avec un stockage comme par exemple le site d’Oklo au Gabon où la fission d’éléments radioactifs s’est produite naturellement il y a 2 milliards d’années…
Le centre de stockage profond du WIPP (Waste Isolation Pilot Plant) est en exploitation aux États-Unis depuis 1999 (http://www.wipp.energy.gov/). Ce stockage, situé dans le sel à 700 mètres de profondeur, prend en charge les déchets de moyenne activité à vie longue (MA-VL) issus des activités de défense américaines. En Europe, la Suède et la Finlande ont déposé une demande d’autorisation de création d’un stockage profond auprès de leurs gouvernements respectifs. Ces demandes sont en cours d’instruction par les autorités de sûreté suédoise et finlandaise. Les études sur ces deux projets sont accessibles sur les sites des agences SKB pour la Suède (http://www.skb.se) et Posiva pour la Finlande (http://www.posiva.fi/).
QUESTION 336 - risque d'incendie
Posée par Alain CORRÉA, STOP-EPR PENLY (ELBEUF), le 24/09/2013
L'incendie est probablement le plus grand péril qui guette les installations souterraines. En effet, le confinement amplifie et décuple l'effet calorifique de tout début d'incendie (voir l'incendie du tunnel du Mont Blanc en 1999 qui est parti très vite en quelques minutes et a demandé plus de 50 heures aux pompiers avant d’être maîtrisé. Pourtant on était en surface). La ventilation ne manquerait pas d'attiser le feu et l'emploi d'eau serait proscrit tant pour l’argilite (qui se délite au contact de l’eau), que pour le dégagement d’hydrogène à haute température. On peut raisonnablement penser qu'un incendie pourrait durer des jours, des semaines voire des années, à l’image de ce qui existe à Centralia aux USA où un feu de mine est non maitrisé depuis 1962 (oui oui, 1962 !) http://fr.wikipedia.org/wiki/Centralia_(Pennsylvanie) On peut aussi imaginer un dégagement de fumées radioactives lié à cet incendie non maitrisable, pendant des années sur la région.
Réponse du 03/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le risque d’incendie est pris en compte dans le dimensionnement de Cigéo au même titre que les autres risques et s’appuie notamment sur le retour d’expérience de l’accidentologie dans les tunnels et mines pour définir les meilleures pratiques permettant de se prémunir d’un incendie.
Les exemples que vous citez, tel que le déroulement des accidents du Mont Blanc ou de Centralia, sont étroitement liés à la nature et quantité de la charge calorifique mise en jeu (une quantité importante de combustibles liés aux camions et à leur chargement dans le premier cas et du charbon dans le second). Dans le cas de Cigéo, la première mesure prise dès la conception consiste à limiter la quantité de produits combustibles ou inflammables dans les équipements du stockage. Ainsi, les câbles électriques seront ignifugés et les véhicules à moteur thermique seront interdits dans l’installation nucléaire souterraine de Cigéo. De plus, des dispositifs de détection incendie seront répartis dans les installations pour détecter rapidement et localiser tout départ de feu. Plusieurs systèmes d’extinction automatiques seront installés dans l’installation souterraine. Des systèmes embarqués d’extinction automatique (gaz, poudre...) seront placés sur les engins de transfert des colis de déchets et sur les engins de manutention en alvéole, afin d’éteindre tout départ de feu. Des systèmes d’extinction automatique sont également disposés dans certaines zones de l’installation souterraine telles que les locaux électriques et les zones de soutien logistique. Ces dispositifs seront mis en place en complément de moyens de lutte contre l’incendie plus traditionnels de types extincteurs, points de raccordement à un réseau d’alimentation en agent extincteur (l’usage de l’eau est parfaitement possible dans les installations de Cigéo, cependant, dans certaines situations d’autres agents extincteurs peuvent être plus adaptés, comme la mousse).
Malgré toutes ces dispositions, une situation d'incendie est quand même considérée par prudence. Des systèmes de compartimentage et de ventilation sont prévus pour limiter la propagation du feu. Ainsi, la ventilation n’attisera pas le feu comme vous le craignez. Au contraire, elle participera à la maîtrise de l’incendie par un pilotage adapté, défini sur la base du retour d’expérience acquis dans le domaine des mines, des tunnels et de l’industrie nucléaire. Des équipements d’intervention seront prépositionnés dans l’installation souterraine en permanence. L'architecture souterraine retenue pour le stockage permet aux secours d'intervenir dans des galeries à l'abri des fumées et facilite l'évacuation du personnel.
La maîtrise du risque incendie vise aussi à protéger les colis contenant les substances radioactives des effets de l’incendie afin de maintenir le confinement de ces substances. Pour cela, les colis sont disposés dans des équipements qualifiés pour résister au feu. Les conteneurs de stockage assurent également une protection contre l’incendie. Ces dispositions permettent d’exclure tout effet domino entre les colis stockés, et donc le dégagement massif de fumées radioactives que vous évoquez.
QUESTION 335
Posée par Ghislain DENIS (BRIEULLES SUR MEUSE), le 24/09/2013
Y-a-t-il une autre solution pour nos déchets?
Réponse du 28/10/2013,
Réponse apportée à l’Andra, maître d’ouvrage :
Depuis plus de 50 ans, les chercheurs en France et à l’étranger ont imaginé beaucoup de solutions pour gérer les déchets radioactifs : les envoyer dans l’espace, au fond des océans ou dans le magma, les entreposer plusieurs centaines d’années en surface ou à faible profondeur, les transmuter… La solution du stockage profond est aujourd’hui reconnue dans tous les pays comme la meilleure solution pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter leur charge sur les générations futures. Et c’est justement parce que personne ne peut garantir aujourd’hui que d’autres solutions émergeront dans le futur, ni que ces hypothétiques alternatives présenteraient les mêmes performances de sûreté à long terme que le stockage, que le Parlement a demandé à l’Andra d’étudier la mise en œuvre du projet Cigéo. Cigéo est néanmoins prévu pour être réversible pendant au moins cent ans, ce qui permettra aux générations suivantes de faire évoluer cette solution si elles le souhaitent (notamment si des progrès scientifiques et technologiques futurs venaient à offrir de nouvelles possibilités).
QUESTION 334
Posée par Bernard CAZIN (DOULAINCOURT-SAUCOURT), le 24/09/2013
Lors de la visite de la galerie profonde à Bure, un responsable nous a affirmé que techniquement la réversibilité serait impossible. Ce spécialiste des tunnels est en contradiction avec les affirmations de l'ANDRA!
Réponse du 03/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Nous sommes très étonnés que cette affirmation ait pu vous être donnée lors de votre visite. Les entreprises de génie civil savent garantir des structures en béton pendant plus de 100 ans (par exemple 120 ans pour le tunnel sous la Manche). Pour les tunnels de Cigéo, les types de béton et leur épaisseur sont définis pour résister aux contraintes mécaniques exercées par la couche d’argile pendant toute l’exploitation du Centre. Des marges sont intégrées dans leur dimensionnement. Ils seront équipés de capteurs qui permettront de suivre leur comportement dans le temps. Des tests de retrait à l’échelle 1 ont d’ores et déjà été réalisés avec des prototypes, en surface, et ont permis de montrer que la réversibilité était techniquement possible. Des essais de retrait de colis seront également réalisés en souterrain dans le stockage avant sa mise en service. De nouveaux essais pourront également être réalisés périodiquement dans le stockage pendant son exploitation pour vérifier que la réversibilité reste assurée.
Pour en savoir plus sur les propositions faite par l’Andra en matière de réversibilité sur le stockage, voir ../docs/rapport-etude/fiche-reversibilite-cigeo.pdf
QUESTION 333
Posée par Dominique GRAVIER (DAMMARTIN SUR MEUSE), le 24/09/2013
Une fois tous les déchets enfouis, quels seront les contrôles à long terme?
Réponse du 18/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le principe du stockage profond est que sa sûreté à long terme ne repose pas sur des actions humaines, notamment sur une surveillance du site, mais sur le milieu géologique. La surveillance du site pourra néanmoins être maintenue aussi longtemps que les générations futures le souhaiteront et contribuera au maintien de la mémoire du stockage. L’Andra présentera dans sa demande d’autorisation de création du stockage les modalités envisagées pour la surveillance du stockage après sa fermeture (surveillance depuis la surface, à partir de forages à faible profondeur, surveillance de l’environnement…).
QUESTION 332
Posée par Jean MIKAELIS (ROBERT ESPAGNE), le 24/09/2013
Le choix technique de l'enfouissement en profondeur risque de présenter un problème lié à la notion de réversibilité à long terme? La Meuse étant un département vert, ce type de stockage risque de nuire à son image, qu'en est-il du volet environnemental, en particulier sur le risque de transmutation à long terme dans le bassin versant de la Saulx?
Réponse du 27/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Concernant votre première question
Le but du stockage profond est de mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs, pour ne pas reporter indéfiniment leur charge sur les générations futures. A long terme, la protection de l’homme et de l’environnement doit être assurée sans nécessité d’intervention humaine (sûreté « passive »). Dans cette optique, Cigéo est conçu pour être refermé après la centaine d’années nécessaires à son exploitation. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) considère que, sur le plan des principes, la réversibilité ne peut avoir qu’une durée limitée (avis de l’ASN du 1er février 2006 sur les recherches menées dans le cadre de la loi de 1991 sur la gestion des déchets radioactifs).
Si Cigéo est autorisé, l’Andra propose que des rendez-vous réguliers soient programmés pour faire le point sur l’exploitation du stockage et préparer les étapes suivantes. Les conditions de réversibilité et le calendrier de fermeture du stockage pourront être réexaminés lors de ces rendez-vous. C’est aux générations suivantes qu’il reviendra de décider dans un siècle si elles souhaitent fermer définitivement le stockage ou temporiser cette étape.
Après la fermeture du stockage, la sûreté sera assurée de manière passive. Une surveillance du site pourra néanmoins être maintenue aussi longtemps que les générations futures le souhaiteront et des actions seront menées pour conserver et transmettre sa mémoire. Il pourrait toujours être envisagé de revenir dans le stockage au moyen de techniques minières adaptées, mais le confinement apporté par la roche et les ouvrages de fermeture ne serait alors plus assuré.
Pour en savoir plus sur les propositions faites par l’Andra en matière de réversibilité du stockage, voir ../docs/rapport-etude/fiche-reversibilite-cigeo.pdf
Concernant votre seconde question
Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement afin de contrôler l’impact de ses activités. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, il permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement et l’absence de contamination des nappes phréatiques. L’Andra a déjà initié au travers de l’Observatoire pérenne de l’environnement (OPE) la mise en place de cette surveillance de l’environnement. De plus, Cigéo sera en permanence soumis au contrôle de l’ASN, qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public. Pour en savoir plus sur l’OPE, voir http://www.andra.fr/ope.
Le stockage sera implanté dans une couche d’argile qui garantit l’éloignement des déchets radioactifs de la surface. Seuls quelques radionucléides mobiles et dont la durée de vie est longue pourront migrer à travers la couche d’argile après plusieurs dizaines de milliers d’années, puis potentiellement atteindre ensuite la surface et les nappes phréatiques, après plus de 100 000 ans et en quantités extrêmement faibles. Leur impact radiologique serait alors plusieurs dizaines de fois inférieur à la radioactivité naturelle (qui est de 2,4 milliSievert par an en moyenne en France).
Dans une démarche prudente, l’Andra suppose dans son évaluation d’impact sur l’homme et l’environnement à long terme que les eaux de ces nappes phréatiques pourraient être captées par forage et utilisées pour des usages du type de ceux qui peuvent être utilisés aujourd’hui (jardin, boisson, abreuvement des animaux). Les études montrent que, même dans ce cas, l’impact du stockage reste inférieur aux normes réglementaires imposées par l’ASN et ne présente pas de risque pour la santé.
QUESTION 330
Posée par Jean-Pierre LAFLOTTE (LIGNY EN BARROIS), le 23/09/2013
Comment et par où, les déchets seront-ils transportés de façon très sécurisante pour la population?
Réponse du 13/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les modalités d’acheminement des colis de déchets depuis les sites où ils sont entreposés jusqu’à Cigéo sont étudiées par les producteurs de déchets (Areva, CEA et EDF). Le transport des colis par voie ferroviaire est privilégié. Le réseau ferré national permet d’acheminer les convois jusqu’à proximité de Cigéo. Différents itinéraires sont étudiés depuis les sites où sont entreposés les colis de déchets.
La desserte locale de Cigéo est étudiée dans le cadre du schéma interdépartemental de développement du territoire (voir carte). L’arrivée et le déchargement des trains se ferait dans un terminal ferroviaire spécifique. Deux options sont possibles :
- Soit le terminal ferroviaire est implanté sur une voie ferroviaire existante en Meuse ou en Haute-Marne. Le transport final jusqu’à Cigéo serait alors réalisé par voie routière.
- Soit le terminal ferroviaire est implanté sur le site même de Cigéo, ce qui nécessiterait de créer un raccordement ferroviaire d’environ 15 km.
Plus d’information :
Le transport des colis de déchets (chapitre 4.3)
../docs/dmo/chapitres/DMO-Andra-chapitre-4.pdf
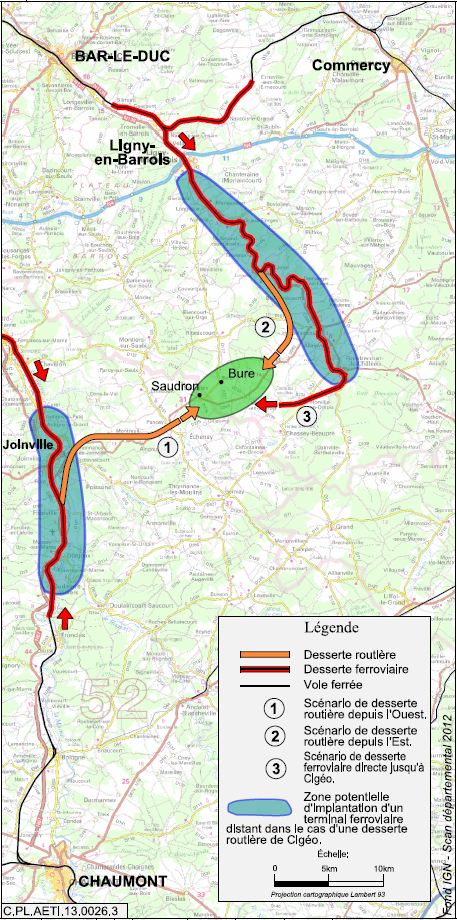
Réponse apportée par EDF :
EDF confiera à un opérateur spécialisé le transport des déchets radioactifs dont il est propriétaire entre l'usine AREVA de La Hague où ils sont actuellement entreposés et le site Cigéo. Il faut noter qu’AREVA a une forte expérience dans le transport de ce type de déchets, puisque cet opérateur assure actellement le retour par le rail vers l’Allemagne des déchets issus du traitement du combustible usé de plusieurs centrales nucléaires allemandes. Plusieurs options, présentées dans le Dossier du Maitre d’Ouvrage Cigéo, sont envisagées pour adapter les infrastuctures de transport aux convois de dechets. L'ASN se prononcera sur la solution proposée par le maitre d'ouvrage pour vérifier qu'elle satisfait bien tous les critères de sûreté et garantit la protection des populations et de l'environnement..
QUESTION 329 - international
Posée par jean COUDRY, L'organisme que vous représentez (option) (SAINT-DIZIER), le 23/09/2013
Pour les déchets nucléaires de haute activité et de moyenne activité à vie longue, il semble qu'il y a une orientation internationale pour le choix d'un stockage en couche géologique profonde (c'est même une recommandation de l'Europe) Y a-t-il des pays qui ont fait un choix différent pour ces mêmes déchets?
Réponse du 05/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Depuis plus de 50 ans, les chercheurs en France et à l’étranger ont étudié différents moyens de gestion des déchets radioactifs : envoi dans l’espace, au fond des océans, dans le magma, entreposage, séparation-transmutation… Le stockage est aujourd’hui considéré dans tous les pays comme la meilleure solution pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter leur charge sur les générations suivantes.
La directive européenne du 19 juillet 2011 considère effectivement que le stockage géologique constitue actuellement la solution la plus sûre et la plus durable en tant qu’étape finale de la gestion des déchets de haute activité. Tous les pays qui ont à gérer ce type de déchets s’orientent vers cette solution. Outre la France, c’est le cas par exemple des Etats-Unis, de la Finlande, de la Suède, du Canada, de la Chine, de la Belgique, de la Suisse, de l’Allemagne ou encore du Japon.
QUESTION 328 - Effet cumulatif
Posée par Benoît LEPLOMB, L'organisme que vous représentez (option) (METZ), le 30/10/2013
Bonjour, Plusieurs centaines de convois de déchets vont converger vers la descenderie. Avez vous une estimation de l'impact, aussi faible soit-il, du transit de ces déchets sur les populations et espaces traversés? Quel sera le niveau de radioactivité le long des axes après 100 ans d’exploitation ? Après la fermeture du site, le niveau de radioactivité sera-t-il comparable au niveau actuel ? Je vous remercie Cordialement
Réponse du 17/12/2013,
Réponse apportée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) :
Aucune radioactivité n’est déposée le long des itinéraires de transport.
La sûreté des transports de substances radioactives à usage civil est contrôlée en France par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), sur la base d’inspections et de l’instruction de demandes d’agrément d’emballages. Ce contrôle vise à assurer la protection des personnes et de l’environnement. Il porte sur la conception des emballages et les opérations de transports qui sont soumises à des contraintes réglementaires rigoureuses.
Les emballages doivent notamment assurer un confinement des substances radioactives transportées et fortement réduire le rayonnement à l’extérieur du colis.
De façon plus spécifique, le débit de dose à proximité du véhicule ne doit pas dépasser certains plafonds. En pratique, les niveaux relevés sont en général beaucoup plus faibles que ces plafonds. Même si ces plafonds étaient atteints, une personne devrait rester 10 heures à deux mètres du véhicule pour que le rayonnement reçu atteigne la limite annuelle d’exposition du public.
Concernant les risques en cas d’accident, les modèles de colis sont soumis à des épreuves réglementaires destinées à démontrer leur résistance lors du transport. Le niveau d’exigence de ces épreuves est proportionné à la dangerosité des substances transportées. À titre d’exemple, les modèles de colis correspondant aux substances les plus dangereuses doivent conserver leurs fonctions de sûreté, y compris en cas d’accident (simulé par une chute de 9 m sur une surface indéformable, une chute de 1 m sur un poinçon, un incendie d’hydrocarbure totalement enveloppant de 800° C minimum pendant 30 mn, une immersion dans l’eau à une profondeur de 200 m).
Les autorités se sont naturellement interrogées depuis plusieurs années sur le comportement des colis agréés dans des cas d’agressions allant au-delà de ces épreuves réglementaires décrites précédemment.
Des études ont été menées en France et à l’étranger, notamment par l’IRSN, AREVA, l’autorité allemande BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung) et le laboratoire national américain SANDIA, afin d’évaluer le comportement des colis contenant des substances radioactives dans des conditions réalistes d’impact mécanique et de feu et pouvant aller au-delà des sollicitations prévues par les épreuves réglementaires. Ainsi, la tenue de ces types de colis dans des conditions de feu plus contraignantes (en termes de durée et de température) et dans des conditions de chute plus réalistes (en termes de surface d’impact et de hauteur de chute) a été étudiée. Par exemple, une étude de l’IRSN consultable sur le site Internet de l’institut[1] permet de comparer l’écrasement du colis sur une surface indéformable, comme prévu dans les épreuves réglementaires et sur des surfaces représentatives de cibles réelles : par exemple des sols en sable, argile ou des cibles métalliques représentatives de l’environnement des emballages durant le transport dont l’essieu de wagon et le longeron de wagon. Cette étude a montré que les colis considérés dans l’étude conserveraient leur capacité de confinement en cas d’accident réel et que leurs équipements additionnels (châssis et râtelier) ainsi que les cibles absorberaient une part importante de l’énergie d’impact et augmenteraient ainsi les marges de sûreté.
D’autres études ont été réalisées à l’étranger concernant le transport ferroviaire de colis de substances radioactives. Par exemple :
- l’institut allemand (BAM) a réalisé des essais visant à représenter un scénario d’accident impliquant une explosion d’un wagon citerne chargé de propane à proximité d’un colis de type CASTOR contenant du combustible irradié De façon à être plus pénalisant, le colis de combustible n’était pas muni de ses capots amortisseurs. L’essai a entraîné une boule de feu ainsi que des flammes allant au-dessus du point d’explosion. Le colis de substances radioactives a été projeté à 7 m de sa position initiale et s’est enfoncé de 1 mètre dans le sol. Toutefois, les tests d’étanchéité, réalisés après essai, ont montré que l’emballage restait étanche, il n’y a donc pas eu d’augmentation des conséquences de l’accident lié au caractère radiologique du contenu de l’emballage transporté[2].
- Le BAM a également réalisé une simulation numérique visant à évaluer l’impact d’une chute sur des rails à une hauteur de 14 m d’un colis contenant des déchets vitrifiés de haute activité qui aurait été préalablement endommagé par une entaille de 12 cm. Le BAM a conclu que l’emballage restait intact[3].
- La « Central Electricity Generating Board for England and Wales » a organisé un crash-test public consistant à faire entrer en collision un train de 140 t roulant à 160 km/heure dans un colis de combustible irradié de type B. Les vidéos du crash-test disponibles sur Internet montrent que le combustible est resté confiné dans l’emballage[4].
En France, aucun accident ferroviaire ayant impliqué des colis de combustible usé n’a à ce jour été rapporté.
La dernière ligne de défense de la sûreté des transports de substances radioactives repose sur les moyens d’intervention mis en œuvre face à un incident ou un accident. Les pouvoirs publics, l’ASN et les exploitants se préparent donc à la gestion des situations de crise impliquant un transport de substances radioactives à travers les plans ORSEC et au moyen d’exercices.
[1] http://www.irsn.fr/FR/Larecherche/publications-documentation/aktis-lettre-dossiers-thematiques/RST/RST-2002/Documents/Chap03_art1.pdf
[2] http://www.tes.bam.de/de/umschliessungen/behaelter_radioaktive_stoffe/dokumente_veranstaltungen/pdf/rmtp1999104231.pdf
[3] http://www.tes.bam.de/en/umschliessungen/behaelter_radioaktive_stoffe/behaelterpruefungen/index.htm
[4] http://www.britishrailways.tv/train-videos/2012/100mph-nuclear-flask-train-crash-test/
QUESTION 327
Posée par Charlène OSSOLA (CHAUMONT), le 23/09/2013
Est-ce dangereux pour l'environnement et pour nous en cas de fuite comme au Japon? Va-t-il être en Haute Marne ou dans la Meuse exactement? D'ici combien de temps sera-t-il opérationnel? Combien d'emplois vont-ils être créés?
Réponse du 18/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Concernant la sûreté de Cigéo
Cigéo n’est pas une centrale nucléaire mais un centre de stockage situé à 500 mètres de profondeur, qui sera peu vulnérable aux activités humaines comme aux catastrophes naturelles à l’inverse d’une centrale comme celle de Fukushima au Japon. L’objectif fondamental de Cigéo est de confiner la radioactivité des déchets sur de très longues échelles de temps. Tout est mis en œuvre pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. Tous les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation sont identifiés en amont de la conception. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier.
Si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Cet impact restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France). Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, le plan de surveillance de Cigéo permettra notamment de vérifier l’absence de contamination des nappes phréatiques.
Concernant l’implantation de Cigéo
Si Cigéo est autorisé, l’installation souterraine du stockage serait implantée au sud de la Meuse, à quelques kilomètres du Laboratoire souterrain de l’Andra, dans la couche d’argile étudiée depuis une vingtaine d’années. L’installation de surface dédiée à la réception, au contrôle et à la préparation des colis de déchets serait implantée dans une zone contiguë à la Meuse et à la Haute-Marne, située autour du Laboratoire. Cette zone pourrait être desservie par une voie ferrée si cette option est retenue. L’installation de surface dédiée aux travaux de creusement serait implantée à quelques kilomètres de distance, en Meuse, à la verticale de l’installation souterraine. Les localisations étudiées pour l’implantation des différentes installations de Cigéo sont localisées dans la synthèse du dossier du maître d’ouvrage (voir la carte page 9, ../docs/smo/synthese-dmo-Andra-mars-2013.pdf).
Concernant la mise en service de Cigéo et le nombre d’emplois générés
La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra à l’État après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo en 2015 conformément au calendrier fixé par la loi du 28 juin 2006. Ce processus comprendra notamment l’évaluation de la sûreté par l’Autorité de sûreté nucléaire, l’évaluation des recherches scientifiques par la Commission nationale d’évaluation, l’avis des collectivités territoriales, le vote d’une nouvelle loi fixant les conditions de réversibilité, la mise à jour de la demande de création de Cigéo par l’Andra suite à cette loi, et une enquête publique. Si Cigéo est autorisé, les travaux de construction pourraient débuter en 2019 pour une mise en service en 2025, sous réserve de l’autorisation de l’Autorité de sûreté nucléaire.
Sous réserve de son autorisation, entre 1 300 et 2 300 personnes travailleront à la construction des premières installations de Cigéo sur la période 2019-2025. Après la mise en service du Centre, entre 600 et 1 000 personnes travailleront pendant plus de 100 ans à la fois à son exploitation et sa construction (qui se poursuivra en parallèle). En plus de ces emplois directs implantés sur le site, l’activité générée entretiendra des emplois indirects, notamment auprès de fournisseurs ou prestataires de Lorraine et de Champagne-Ardenne et des emplois induits, répondant aux consommations courantes des salariés de Cigéo sur leur lieu de vie (achats, investissement en logement, etc). De plus, Cigéo contribuera au développement de l’activité des entreprises locales et, grâce à la garantie d’une activité sur plus d’un siècle, certaines entreprises feront très vraisemblablement la démarche de s’implanter localement, créant à leur tour une activité nouvelle sur le territoire.
QUESTION 326
Posée par Michel VILTARD (VARENNES SUR AMANCE), le 20/09/2013
Je me demande si cet entreposage des déchets radioactifs ne va pas perturber les eaux souteraines même enfouis profondement !
Réponse du 18/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Non, la présence d’un stockage comme Cigéo, ne va pas perturber les eaux souterraines. Pendant l’exploitation du Centre, pour s’en assurer et afin d’éviter tout risque de contamination des nappes phréatiques, les effluents liquides susceptibles d’être contaminés seront systématiquement collectés et contrôlés.
Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement afin de contrôler l’impact de ses activités. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, il permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement et l’absence de contamination des nappes phréatiques. L’Andra a déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
De plus, Cigéo sera en permanence soumis au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
Après la fermeture du stockage, au-delà de la durée de vie des ouvrages industriels, la couche d’argile très peu perméable, de plus de 130 mètres d’épaisseur, dans laquelle sera installé le stockage souterrain, servira de barrière naturelle pour retenir les radionucléides contenus dans les déchets et freiner leur déplacement. Le stockage permet ainsi de garantir leur confinement sur de très longues échelles de temps. Seuls quelques-uns de ces radionucléides, les plus mobiles et dont la durée de vie est longue, pourront migrer de manière très étalée dans le temps. Ils ne sortiraient pas de cette couche avant 100 000 ans et atteindraient en quantités extrêmement faibles la surface et les nappes phréatiques. Leur impact radiologique serait alors plusieurs dizaines de fois inférieur à la radioactivité naturelle (qui est de 2,4 mSv par an en moyenne en France).
QUESTION 325
Posée par Béatrice LAOT (NEUFCHATEAU), le 17/09/2013
Pourquoi Bure, site éloigné des sites de production de déchets? Aux risques attachés au site de stockage, s'ajoutent ceux liés aux transports dans l'ignorance des populations traversées par ces convois à venir.
Réponse du 06/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le stockage profond devant assurer la protection de l’homme et de l’environnement sur le très long terme, ce n’est pas la proximité des sites de production de déchets qui a conduit à retenir le site mais les caractéristiques favorables de sa géologie.
Ainsi, le choix du site de Meuse/Haute/Marne est le résultat de nombreuses années de recherches scientifiques et de reconnaissances géologiques qui ont permis de démontrer qu’il présentait des caractéristiques favorables à l’implantation d’un tel stockage. Suite au vote de la loi de 1991, des recherches ont été menées en France pour implanter un laboratoire souterrain. Plusieurs sites se sont portés candidats et ont été étudiés, dont les départements de Meuse et de Haute-Marne. En 1999, après l’évaluation scientifique du site, la consultation des collectivités locales et une enquête publique, le Gouvernement a autorisé l’Andra à construire un laboratoire souterrain à la limite entre les deux départements de Meuse et de Haute-Marne pour étudier la couche d’argile du Callovo-Oxfordien. En s’appuyant sur l’ensemble des recherches menées sur le site depuis 1994, l’Andra a montré qu’il présente des caractéristiques favorables pour assurer la sûreté à long terme du stockage. La Commission nationale d’évaluation mise en place par le Parlement pour évaluer sur le plan scientifique les travaux de l’Andra souligne ainsi dans son rapport 2012 : « le site géologique de Meuse/Haute-Marne a été retenu pour des études poussées, parce qu’une couche d’argile de plus de 130 m d’épaisseur et à 500 m de profondeur, a révélé d’excellentes qualités de confinement : stabilité depuis 100 millions d’années au moins, circulation de l’eau très lente, capacité de rétention élevée des éléments ».
Réponse apportée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) :
Les modèles de colis sont soumis à des épreuves réglementaires destinées à démontrer leur résistance lors du transport. Le niveau d’exigence de ces épreuves est proportionné à la dangerosité des substances transportées. À titre d’exemple, les modèles de colis correspondant aux substances les plus dangereuses doivent conserver leurs fonctions de sûreté, y compris en cas d’accident (simulé par une chute de 9 m sur une surface indéformable, une chute de 1 m sur un poinçon, un incendie d’hydrocarbure totalement enveloppant de 800° C minimum pendant 30 mn, une immersion dans l’eau à une profondeur de 200 m).
Les autorités se sont naturellement interrogées depuis plusieurs années sur le comportement des colis agréés dans des cas d’agressions allant au-delà de ces épreuves réglementaires décrites précédemment.
Des études ont été menées en France et à l’étranger, notamment par l’IRSN, AREVA, l’autorité allemande BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung) et le laboratoire national américain SANDIA, afin d’évaluer le comportement des colis contenant des substances radioactives dans des conditions réalistes d’impact mécanique et de feu et pouvant aller au-delà des sollicitations prévues par les épreuves réglementaires. Ainsi, la tenue de ces types de colis dans des conditions de feu plus contraignantes (en termes de durée et de température) et dans des conditions de chute plus réalistes (en termes de surface d’impact et de hauteur de chute) a été étudiée. Par exemple, une étude de l’IRSN consultable sur le site Internet de l’institut[1] permet de comparer l’écrasement du colis sur une surface indéformable, comme prévu dans les épreuves réglementaires et sur des surfaces représentatives de cibles réelles : par exemple des sols en sable, argile ou des cibles métalliques représentatives de l’environnement des emballages durant le transport dont l’essieu de wagon et le longeron de wagon. Cette étude a montré que les colis considérés dans l’étude conserveraient leur capacité de confinement en cas d’accident réel et que leurs équipements additionnels (châssis et râtelier) ainsi que les cibles absorberaient une part importante de l’énergie d’impact et augmenteraient ainsi les marges de sûreté.
D’autres études ont été réalisées à l’étranger concernant le transport ferroviaire de colis de substances radioactives. Par exemple :
- l’institut allemand (BAM) a réalisé des essais visant à représenter un scénario d’accident impliquant une explosion d’un wagon citerne chargé de propane à proximité d’un colis de type CASTOR contenant du combustible irradié De façon à être plus pénalisant, le colis de combustible n’était pas muni de ses capots amortisseurs. L’essai a entraîné une boule de feu ainsi que des flammes allant au-dessus du point d’explosion. Le colis de substances radioactives a été projeté à 7 m de sa position initiale et s’est enfoncé de 1 mètre dans le sol. Toutefois, les tests d’étanchéité, réalisés après essai, ont montré que l’emballage restait étanche, il n’y a donc pas eu d’augmentation des conséquences de l’accident lié au caractère radiologique du contenu de l’emballage transporté[2].
- Le BAM a également réalisé une simulation numérique visant à évaluer l’impact d’une chute sur des rails à une hauteur de 14 m d’un colis contenant des déchets vitrifiés de haute activité qui aurait été préalablement endommagé par une entaille de 12 cm. Le BAM a conclu que l’emballage restait intact[3].
- la « Central Electricity Generating Board for England and Wales » a organisé un crash-test public consistant à faire entrer en collision un train de 140 t roulant à 160 km/heure dans un colis de combustible irradié de type B. Les vidéos du crash-test disponibles sur Internet montrent que le combustible est resté confiné dans l’emballage[4].
En France, aucun accident ferroviaire ayant impliqué des colis de combustible usé n’a à ce jour été rapporté.
La dernière ligne de défense de la sûreté des transports de substances radioactives repose sur les moyens d’intervention mis en œuvre face à un incident ou un accident. Les pouvoirs publics, l’ASN et les exploitants se préparent donc à la gestion des situations de crise impliquant un transport de substances radioactives à travers les plans ORSEC et au moyen d’exercices.
QUESTION 324 - Réversibilité ?
Posée par Jean-Marie PARENT, L'organisme que vous représentez (option) (SAINT-DIZIER), le 20/09/2013
Une visite du site de l'Andra m'a appris que le sous-sol était meuble et en mouvement. Dans ces conditions, qui peut sérieusement garantir qu'un container enfoui dans un trou cylindrique pourra être extrait dans quelques centaines d'années ? Merci
Réponse du 27/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif du stockage est de mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs pour protéger l’homme et l’environnement à très long terme. Le Parlement a également demandé que le stockage soit réversible pendant au moins 100 ans pour laisser des choix aux générations suivantes et notamment la possibilité de récupérer des déchets stockés.
L’Andra prévoit dès la conception de Cigéo des dispositifs techniques destinés à faciliter le retrait éventuel de colis de déchets stockés. En particulier, les alvéoles pour stocker les colis de déchets seront revêtues d’une paroi en béton ou en acier pour éviter les déformations et garantir l’accès aux colis de déchets pendant au moins 100 ans, avec des espaces ménagés entre les colis et les parois pour permettre leur retrait. Des capteurs permettront de surveiller le comportement des ouvrages.
Pour en savoir plus sur les propositions faites par l’Andra en matière de réversibilité du stockage, voir ../docs/rapport-etude/fiche-reversibilite-cigeo.pdf
QUESTION 323
Posée par Dominique GRENECHE (MARCOUSSIS), le 19/09/2013
En cas de tremblement de terre, des failles profondes peuvent se créer et modifier la circulation des eaux souterraines : est-ce un scenario crédible? Quelles conséquences?
Réponse du 20/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Ce ne sont pas les tremblements de terre qui produisent des failles, mais le jeu de ces failles qui produisent les tremblements de terre. Ces jeux sont la conséquence de la tectonique des plaques et des contraintes mécaniques engendrées au sein de la croûte terrestre. Il n’existe pas de failles sous le site Cigéo, et la création de nouvelles failles (liée à la tectonique des plaques, qui est très bien comprise aujourd’hui) au cours des prochains millions d’années, sur la durée de vie des déchets radioactifs, n’est pas envisageable.
Le site d’implantation de Cigéo (située à l’Est du Bassin de Paris) est à l’écart des zones actives où se produisent les jeux de failles qui absorbent le rapprochement des continents Afrique et Europe. Les mouvements tectoniques de grande amplitude et forts séismes qui en découlent se localisent pour l’essentiel en Méditerranée et dans les chaines de montagnes qui la bordent, et pour le reste (résidu) au niveau des grandes failles qui affectent la plaque européenne, comme les failles du fossé d’Alsace et des Vosges en bordure Est du bloc stable que constitue le Bassin de Paris. Ce dernier compte parmi les régions les plus stables du globe. Il est quasiment asismique avec des taux de déformations extrêmement faibles à l’échelle des temps géologiques, comptés en millions d’années.
L’analyse des directions et vitesses de déplacements relatifs des stations GPS installées en Europe, confirme que le Bassin de Paris constitue un bloc rigide et que les déformations (de faible amplitude) se font à ses frontières, comme le souligne la répartition des séismes. En conséquence, seules les failles majeures qui existent déjà sont susceptibles de glisser, avec des mouvements de très faible amplitude, par à-coups séparés dans le temps par plusieurs dizaines à centaines de milliers d’années.
Les failles et leur incidence sur les écoulements souterrains sont prises en compte dans le modèle hydrogéologique. Le jeu de ces failles dans le futur sera sans incidence sur les écoulements, tant à l’échelle régionale qu’à l’échelle du site et de la zone de fracturation qui se localise à l’Ouest du site Cigéo, en bordure de la vallée de la Marne, où les écoulements sont déjà guidés par les réseaux de fractures et guident la création des conduits karstiques dans les calcaires de l’Oxfordien.
QUESTION 322
Posée par Raymond CHAUSSIN, le 14/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 23 octobre 2013 : Les transports de déchets :
N'y aura-t-il pas des entreposages "temporaires" avec les déchets refusés par Cigéo?
Réponse du 09/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les colis reçus sur Cigéo devront respecter les critères d’acceptation définis par l’Andra. Avant expédition des colis, l’Andra s’assurera du respect de ces critères, au moyen de contrôles réalisés par les producteurs aux différentes étapes de production, d’entreposage, et de désentreposage des colis, et au moyen d’une surveillance exercée par l’Andra chez les producteurs. Ces mesures doivent permettre d’apporter le maximum de garanties sur la conformité des colis avant leur expédition vers Cigéo. L’Andra effectuera par précaution de nouveaux contrôles à la réception des colis, à titre de vérification et de traçabilité. En cas de colis non conforme, celui–ci fera l’objet si nécessaire d’un reconditionnement et/ou d’un renvoi chez le producteur le cas échéant.
Réponse apportée par Guillaume Blavette, association Haute Normandie Nature Environnement :
Le rapport de l'Office parlementaire sur les choix scientifiques et technologiques de janvier 2011, sur les déchets, s'intitulait "Déchets nucléaires : se méfier du paradoxe de la tranquillité". Ses auteurs faisaient alors valoir un certain nombre de réserves sur le projet d'enfouissement proposé par l'ANDRA reconnaissant l'existence de nombreuses incertitudes.
L'une des principales questions concerne les installations de surface. En effet Cigéo n'est pas seulement un dédale de galeries et alvéoles creusé 500 m sous terre. C'est un site industriel qui nécessite des installations pour l'accueil, le contrôle, le tri et l'entreposage temporaire des substances radioactives acheminées (sans parler des installations spécifiques à la phase de chantier). Le maitre d'ouvrage est peu disert à ce sujet. Seules 2 pages sont consacrées aux installations de surface dans le dossier du maitre d'ouvrage (page 44-45). Page 50, un court paragraphe traite de l'acceptation des colis de déchets dans Cigéo. Mais au final, nous ne disposons à l'occasion de ce débat public que de bien peu d'informations.
Le maitre d'ouvrage sait il comment seront aménagées et comment fonctionneront les installations de surface ? Tout porte à croire qu'il ne le sait pas exactement lui-même. L'avis de la commission nationale d'évaluation du 7 mars 2013 montre que les propositions de l'ANDRA sont loin d'être finalisées.
Par ailleurs, le dossier du maitre d'ouvrage ne donne aucune information sur la sureté des installations de surface (le chapitre 5 ne concerne que les installations souterraines).
Pourtant ce problème est loin d'être négligeable. A en croire l'ANDRA, la sureté de Cigéo admet la possibilité pour l'exploitant de refuser des colis qui ne présenteraient pas des garanties de sureté suffisantes. Les colis déficients seraient alors rendus à leur propriétaire, c'est-à-rire renvoyés.
Tout cela est intéressant mais contient des zones d'ombres inquiétantes en matière de risque et de sureté. La gestion logistique des déchets et autres colis n'est pas décrite par le maitre d'ouvrage. On ne connait ni les modalités de contrôle, ni les dispositifs qui seront mis en œuvre et encore moins les capacités des installations où auront lieu le traitement des déchets acheminés.
Nous ne pouvons à ce jour que rappeler un certain nombre de faits observés ailleurs et envisager les problèmes posés par le traitement sur site des colis :
- L'ANDRA nous explique qu'avant que les déchets soient descendus, ils seront conditionnés pour assurer l'intégrité du confinement. L'expression "surfutage" est employée pour désigner cette méthode. De telles opérations sont banales dans l'industrie nucléaire. Mais elles se font dans des installations classées qui doivent garantir la protection de l'environnement et des travailleurs. C'est à dire qu'en surface à Bure seront édifiés des installations nucléaires de base dont l'activité occasionnera des rejets quelques soient les précautions prises par l'exploitant. L'expérience prouve que l'objectif "zéro rejet" ne peut malheureusement pas être tenu...
- Si un colis voire un lot de colis ne satisfait pas les critères définis par l'ANDRA, rien ne garantit qu'ils soient renvoyés à l'expéditeur. Bien au contraire, la plus élémentaire prudence imposerait de reprendre sur site ces déchets afin d'éviter un transport dont le potentiel de risque est non négligeable. Ainsi donc les opérations qui pourraient avoir lieu dans les installations de surface deviennent très importantes. L'ANDRA compenserait les défauts du confinement réalisés par les exploitants. D'aucuns dès lors peuvent reconnaître que le coût économique et environnemental de cette nécessité ne sera pas négligeable.
- Puisque ces opérations de "re-confinement" sont très techniques pour ne pas dire dangereuses, on peut imaginer qu'elles soient faites progressivement. En d'autres termes, on peut admettre que des colis non conformes soient entreposés en surface à Bure en attente de traitement avant d'être descendus. Tout au long de l'exploitation du site, des déchets arriveront... certains seront descendus et beaucoup seront entreposés en surface sans que l'on puisse présager à ce jour de la proportion de déchets conformes aux attentes de l'ANDRA. Pendant plus d'un siècle des déchets resteront en surface...
Il y a aura donc bien à Bure un site d'entreposage en plus des installations de stockage en couche géologique profonde quoi qu'en dise aujourd'hui l'ANDRA. Il conviendrait dès lors que le maitre d'ouvrage précise très clairement quels dispositifs et autres équipements il compte mettre en œuvre pour garantir la sureté de cet entreposage. Il ne saurait être question de simples hangars. Le potentiel de risque des déchets HA, MA voire FA-VL destinés à Cigéo implique que les installations de surface soient conçues de la manière la plus sérieuse, que les modalités de leur exploitation soient précisées, que le traitement des déchets "de déchets" qu'elles généreront soit prévu...
Finalement, ce problème spécifique de l'entreposage temporaire des déchets refusés donne à voir les écueils du stockage en couche géologique profonde. Les précautions à prendre sont telles que Cigéo impliquerait des installations en surface très importantes, très sensibles et très onéreuses. Si seulement 10 % des colis acheminés nécessitent une reprise avant leur stockage, chacun doit prendre la mesure des quantités de matières qui devront être contrôlées, traitées et entreposées. Cigéo ne garantit nullement un stockage immédiat mais introduit une étape de plus dans une chaine du combustible qui est loin d'être maitrisée par les exploitants et l'ANDRA.
En tout cas une chose est sûre le confinement des déchets est loin d'être assuré en France. Plutôt que se lancer dans une aventure périlleuse, il conviendrait que l'ANDRA s'emploie dès aujourd'hui à sécuriser les sites existants et à garantir le confinement des déchets accumulés. Il sera alors possible de travailler plus précisément à un stockage sans succomber aux mirages de l'enfouissement, stratégie que personne ne maitrise aujourd'hui.
QUESTION 321 - Cahier d'acteur ?
Posée par Pascale VINCENT, CITOYEN DU MONDE (DOMRÉMY), le 19/09/2013
Bonjour, "Les contributions (cahier d'acteurs) sont à adresser sous format WORD ou OPEN OFFICE par courrier électronique à la CPDP. Les illustrations sont enregistrées au format PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR ou PDF en haute définition (300 DPI à la taille souhaitée pour l’image)." Ceci est un extrait des règles que vous édictez pour la rédaction des cahiers d'acteurs. Ma voisine, une personne agée, a rédigé un cahier d'acteur qu'elle veut vous envoyer sur papier, par la voie de la Poste. Est-ce à dire que son cahier d'acteur sera évincé ? Elle voudrait bien participer également au débat public mais elle ne dispose ni d'internet, ni d'un portable. Est-elle de fait rejetée du débat public ? Salutations.
Réponse du 28/10/2013,
Votre voisine peut envoyer son cahier d'acteurs, poser ses questions, s'abonner gratuitement aux publications du débat par un courrier à la Commission du débat public :
18, avenue Gambetta
55000 Bar-le-Duc
QUESTION 320 - Cout d'extraction
Posée par Cedric GAUTHIER, L'organisme que vous représentez (option) (LONGCHAMP), le 18/09/2013
Bonjour, imaginons dans 100ans, le stockage serait terminé ,et pour une raison quelconque, une extraction des dechets serait necessaire (catastrophe quelconque). Quel serait le coût par m3 extrait des dechets HA? Quel serait le coût par m3 extrait des dechets MA VL? Et ainsi de suite jusqu'à la totalite des déchets entreposés? Vous remerciant de votre reponse.
Réponse du 30/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La sûreté de l’installation doit être acquise pour que la création de Cigéo puisse être autorisée. Un scénario de retrait de l’ensemble des colis de déchets après la fin de l’exploitation du stockage est peu vraisemblable. Dans une telle hypothèse, l’opération nécessiterait des modifications notables de l’installation, qui devraient faire à leur tour l’objet d’une autorisation spécifique. La nature de ces modifications et leur coût seraient à étudier en fonction de la situation considérée (familles de déchets concernées, volumes, planning de retrait, devenir des colis retirés du stockage…). Au coût de l’opération de retrait proprement dite, qui serait a priori d’un ordre de grandeur analogue à celui des opérations de mise en stockage des déchets, il conviendrait d’ajouter celui des nouvelles installations à construire pour accueillir les déchets et celui du transfert des déchets dans ces nouvelles installations.
En matière de sûreté, il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées. Du fait de son implantation à 500 mètres de profondeur dans une couche d’argile épaisse assurant le confinement de la radioactivité, le stockage est en effet une installation peu vulnérable.
L’objectif du stockage profond est de protéger sur de très longues durées l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Contrairement à une gestion qui consisterait à maintenir les déchets dans des installations provisoires d’entreposage (qui impose d’extraire tous les déchets radioactifs HA et MAVL à la fin de l’exploitation des entrepôts pour les transférer dans de nouvelles installations à construire), les coûts résiduels du stockage après sa fermeture, dans une centaine d’années, seront très limités. La seule charge laissée aux générations futures sera d’assurer la mémoire du site aussi longtemps que possible. Les générations futures pourront également continuer à assurer une surveillance du site aussi longtemps qu’elles le souhaiteront. Néanmoins, le stockage restera sûr même si le site venait à être oublié, contrairement à un entreposage, qu’il soit en surface ou en subsurface.
Si Cigéo est autorisé, le démarrage de l’exploitation se fera de manière progressive. Des premiers colis de déchets radioactifs pourraient être pris en charge à l’horizon 2025. Dans son avis du 16 mai 2013, l’ASN a recommandé une phase de « montée en puissance » progressive de l’exploitation du stockage. En 100 ans, Cigéo aura fait l’objet d’au moins 10 réexamens complets de sûreté, en accord avec les exigences de l’ASN qui imposent un réexamen périodique de sûreté, au moins tous les 10 ans, pour toutes les installations nucléaires. Tout au long de l’exploitation du stockage, l’ASN pourra imposer des prescriptions supplémentaires voire suspendre la réception de nouveaux déchets si elle considère qu’un risque n’est pas maîtrisé correctement, comme pour toute installation nucléaire placée sous son contrôle. L’Andra propose que des rendez-vous soient programmés régulièrement pendant toute la durée d’exploitation du stockage avec l’ensemble des acteurs concernés (riverains, collectivités, évaluateurs, État…) pour contrôler le déroulement du stockage et préparer les étapes suivantes. A chaque étape, il sera possible de décider de poursuivre le processus de stockage tel qu’initialement prévu ou de le modifier et de réexaminer les conditions de réversibilité pour la phase suivante de développement du stockage.
QUESTION 319
Posée par David B, L'organisme que vous représentez (option) (CAEN), le 16/09/2013
Ce débat est le deuxième sur les déchets. Le précédent avait permis quelques avancées majeures en prenant en compte tous les déchets et les matières prétendument valorisables mais non valorisées. Il avait aussi proposé l'entreposage pérennisé comme alternative à l'enfouissement. Pourquoi ne pas avoir tenu compte des leçons du précédent débat ? Pourquoi ne pas avoir expliqué clairement pourquoi l'option entreposage est abandonnée ? Pourquoi ne pas avoir été plus clair sur l'inventaire de ce qui sera enfoui in fine ? Pourquoi ne pas avoir contacté en amont tous les contributeurs au précédent débat pour préparer celui-là ? Pourquoi aucun membre de l'ancien débat n'est dans la CPDP ? Cela aurait permis de faire la continuité. Bref, les citoyens ont, semble-t-il, une meilleure mémoire que les organisateurs du débat. Vous auriez dû le prendre en compte. Je crains que ce soit trop tard maintenant. L'ANCCLI avait proposé la création d'une structure permanente de débat sur les déchets. Cette idée n'a pas été retenue. Vous en payez le prix.
Réponse du 31/10/2013,
La Commission particulière du débat public prend bonne note de vos critiques. Néanmoins, lorsqu'elle considère le site internet extrêmement riche d'informations, et consulté plus de 53.000 fois depuis le 15 mai, les réponses aux centaines de questions, l'organisation de 9 débats contradictoires sur internet pour pallier le blocage total imposé par certains groupes , la Commission dresse le bilan du travail accompli.
QUESTION 318
Posée par Gilles BRUNET, Interface Facebook, le 16/09/2013
Réaction suite à la réponse de la question n°252 (id 269) R269 :
Intéressant pour ce qui est de la mémoire collective, mais l'arhcéologie démontre la difficulté à maintenir cette mémoire (ex: pyramides d'Egypte, civislisation Maya, ...). De plus je ne vois rien dans la prise en compte des changements climatiques engendrés par l'effet de serre, qui d'après toutes les projections scientifiques peuvent entrainer une modification drastique des conditions environnementales au dessus du site et dans son sous-sol. De plus, il semble qu'une couche géologique trop étanchement peut provoquer une mauvaise évacuation de l'énergie résiduel des déchets à haute activité. Toutes ces interrogations me font douter du bien fondé de ce type de stockage, surtout lorsque l'on prend en compte les REX des differents pays ayant tenté l'enfouissement dasn diverses couches géologiques.
Réponse du 11/02/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Concernant la prise en compte des changements climatiques
Les effets des évolutions climatiques sur l’évolution du milieu géologique sont pris en compte par l’Andra. Différents scénarios climatiques ont ainsi été étudiés dont :
- un scénario d’évolution fortement perturbée par les activités humaines, établi avec la communauté scientifique, fondé notamment une hypothèse pessimiste des rejets de CO2 au cours des prochains siècles. Ce scénario est caractérisé, par exemple, par un réchauffement élevé,
- un scénario non perturbé par les activités humaines qui tient compte des périodes de glaciation régulières.
Les effets de ces évolutions climatiques, en particulier sur l’érosion en surface et les circulations d’eau en profondeur ont été étudiées. Compte tenu de la profondeur du stockage (500 m), ces effets concernent au maximum de l'ordre de la première centaine de mètre du milieu géologique. Ils n'affectent pas la couche argileuse et ses propriétés, et ne remettent pas en cause la sûreté du stockage. Néanmoins, les évaluations d’impact à long terme ont été réalisées en supposant plusieurs environnements pour prendre en compte les évolutions climatiques possibles. Les évaluations d’impact considèrent ainsi en plus du climat tempéré actuel , la possibilité d’un climat plus chaud (exemple tropical) et plus froid (exemple glaciaire).
Concernant l’évacuation de l’énergie résiduelle des déchets des déchets de haute activité (HA) :
A l’instar de la radioactivité, la chaleur dégagée par ces déchets décroît dans le temps, principalement durant les premières centaines d’années : par exemple, la puissance thermique d’un colis de déchets HA est de l’ordre de 2 000 watts au moment de sa fabrication et diminue à 500 watts au bout d’une soixantaine d’années. Si Cigéo est autorisé, la majorité des déchets HA ne serait stockée qu’au-delà de 2075, après une phase d’entreposage de plusieurs dizaines d’années sur le site Areva de La Hague, le temps que leur puissance thermique diminue.
La chaleur résiduelle émise par les déchets HA s’évacuera dans la roche. Les coefficients de conduction thermique du Callovo-Oxfordien ont été déterminés au Laboratoire souterrain et validés à l’échelle de la formation. L’écartement des alvéoles dans le stockage est dimensionné pour garantir que la température dans la roche restera toujours inférieure à 100 °C.
QUESTION 317 - Risques nuls ?
Posée par Pascale VINCENT, CITOYEN DU MONDE (DOMRÉMY LANDÉVILLE), le 14/09/2013
A la lecture du document intitulé 'Compte général de l'Etat 2012' je constate que l'Etat accepte d'intervenir à concurrence de 331 M€ en 2012 sur le poste des 'Risques exceptionnels de transports et nucléaires'. Les risques ne sont donc pas nuls et c'est bien la preuve que les acteurs principaux en sont conscients puisque les exploitants nucléaires ont un seuil d'intervention équivalent. Il est évident également que les risques augmentent avec les années puisque les variations de ce poste tendent nettement à la hausse sur 3 ans (+ 16 M€). Quels sont les critères d'appréciation des risques et sur quoi sont-ils basés en matière d'assurance et de réassurance ? En cas de sinistre et si les dommages dépassent provisions, garanties, et assurance, à quoi doit s'attendre le contribuable ? Existe-t-il un sénario destiné à faire face globalement à la prise en charge financière des dommages et réparations, de quelques ordres soient-ils ? Avez-vous fait des études chiffrées en cas de sinistre, qu'il soit nucléaire ou de transport ? Où peut-on en prendre connaissance ? Où peut-on analyser les comptes relatifs au nucléaire que l'Etat est en devoir de tenir, conformément à la loi L 431-7 ? J'ai posé 6 questions, j'apprécierais d'avoir la réponse à chacune d'entre elles. Vous en remerciant par avance, salutations distinguées.
Réponse du 03/12/2013,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Concernant votre premier point
Dans le cadre de la garantie octroyée par l’Etat en application de l’article L.431-5 du code des assurances, la Caisse Centrale de Réassurance (CCR) peut réassurer des risques de transport et d’installations nucléaires.
Le montant que vous rappelez correspond au montant au-delà duquel l’Etat interviendrait. Il ne constitue pas un maximum d’intervention de l’Etat.
En l'absence de sinistres, les primes versées chaque année s'accumulent dans les comptes de la CCR qui peut donc couvrir des sinistres potentiels de montants de plus en plus importants sans que l'intervention de l'Etat soit nécessaire. C’est là l’origine de l’augmentation de seuil que vous rappelez qui ne résulte donc pas d’une augmentation de l’appréciation du risque lié aux activités de transport ou d’exploitation nucléaires.
Concernant les critères d’appréciation des risques
L'ensemble de l'industrie nucléaire civile est, à ce jour, entièrement couverte par des contrats d'assurance et de réassurance privés. Les primes d'assurance (que ce soit celles de la CRR ou celles d'une autre entité), comme pour tout contrat d'assurance, sont calculées en utilisant des méthodes actuarielles appréciant les sinistres potentiels et leurs probabilités.
Concernant l’impact sur les contribuables en cas de sinistre
Comme expliqué plus haut, la CCR bénéficie d'une garantie d'Etat pour un sinistre dépassant le seuil de déclenchement que vous rappelez (331 M€). Si un sinistre venait à dépasser ce seuil, la garantie de l’Etat serait donc amenée à intervenir.
Concernant la prise en charge financière des dommages et réparations
Le seuil de déclenchement n'étant pas un maximum mais un plancher d'intervention de l'Etat, tous les scénarios possibles sont envisagés.
Concernant les études chiffrées en cas de sinistre
Comme indiqué plus haut, la CCR, comme toute compagnie de réassurance, réalise des études actuarielles poussées pour calculer les primes de ses contrats. La CCR publie ses comptes chaque année (avec des annexes détaillées).
Concernant les comptes relatifs au nucléaire
Les documents comptables de la CCR contiennent, conformément à l’article L.431-7 du code des assurances, des comptes distincts retraçant notamment les engagements liés à la garantie prévue à l’article L.431-5 du code des assurances.
QUESTION 316 - avenir des dechets
Posée par jean pol CHARLIER, L'organisme que vous représentez (option) (COMMERCY), le 13/09/2013
que deviendront les déchets destinés à être enfouis à Bure si ce site n'est pas ouvert?
Réponse du 18/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Si la décision était prise de ne pas construire le stockage, alors les déchets radioactifs de haute activité (HA) et de moyenne activité à vie longue (MA-VL) existants resteront entreposés sur leurs sites de production. De nouvelles installations d’entreposage seront nécessaires au fur et à mesure pour accueillir les déchets radioactifs qui sont actuellement produits par l’industrie électronucléaire en France et pour remplacer les entrepôts qui arrivent en fin de vie (les premiers déchets radioactifs HA et MA-VL ont été produits dans les années 1960). Cette décision impliquerait que les générations actuelles décident de reporter sur les générations futures la responsabilité de mettre en œuvre une solution de gestion à long terme pour ces déchets radioactifs. Or c’est la responsabilité des générations actuelles de proposer une solution de gestion définitive pour ces déchets et de ne pas reporter les décisions sur les générations futures en misant sur le fait qu’elles trouveront peut-être d’autres solutions. En effet, personne ne peut garantir aujourd’hui que d’autres solutions émergeront dans le futur, ni que ces hypothétiques alternatives présenteraient les mêmes performances de sûreté à long terme que le stockage.
QUESTION 315 - Pourquoi ?
Posée par Vincent PASCALE, CITOYEN DU MONDE (DOMRÉMY), le 12/09/2013
Il est clair que la gestion du nucléaire coûte plus cher que ce qu'elle ne produit. Inconcevable dans notre système libéraliste austère actuel. Pourquoi un tel entêtement de l'Etat à la production de l'énergie nucléaire ?
Réponse du 03/12/2013,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
La Cour des Comptes a estimé dans son rapport de 2012 sur les coûts de la filière électronucléaire que le coût de production du MWh nucléaire était d'environ 50€. L'impact du programme de "grand carénage" d'EDF, qui prévoit 55 Md€ de dépenses dans les prochaines années pour la maintenance des centrales, aura, d'après ce même rapport, un impact de l'ordre de 10% sur le prix du MWh, soit un coût total de l'ordre de 55 €/MWh.
A titre de comparaison, voici ci-dessous les coûts de production de différentes formes d'énergies :
- énergie hydraulique : 15-20 €/MWh
- éolien terrestre : 80-90 €/MWh
- éolien en mer : plus de 220 €/MWh
- photovoltaïque : entre 230 et 370 €/Mwh selon la taille de l'installation
- charbon et gaz : entre 70 et 100 €/MWh (pour les nouveaux projets de centrales)
Il apparaît donc clairement que l'énergie nucléaire est une source d'énergie compétitive aujourd'hui par rapport aux autres sources d’énergie.
QUESTION 314
Posée par BERTHET JACQUES (NARCY), le 12/09/2013
Durant la phase d'exploitation du projet CIGEO, face aux risques sociétaux (qui peuvent d'ailleurs se cumuler) : déstabilisation totale de l'Etat, révolte populaire, terrorisme, guerre, crash financiers, disparition d'entités (EDF, AREVA, CEA, ANDRA...) Quelles sont les sécurités pérennes prévues?
Réponse du 05/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Du fait de son implantation à 500 mètres de profondeur, le stockage est une installation peu vulnérable. Les installations de surface, nécessaires pendant la phase d'exploitation pour le contrôle et la préparation des colis de stockage, sont conçues pour protéger les opérateurs et les riverains des différents risques qui peuvent survenir. En particulier, le risque de malveillance est pris en compte par l'Andra. Des dispositions appropriées (contrôle des accès, gardiennage, résistance des bâtiments…) sont prévues pour assurer la protection des installations.
Concernant votre crainte de voir la disparition d’entités, le Parlement a justement fait le choix de confier la gestion des déchets radioactifs sur le long terme à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat, et non à une société privée. Concernant la disponibilité des ressources financières, la loi du 28 juin 2006 a institué un dispositif de sécurisation du financement des charges nucléaires de long terme. Il prévoit la constitution d'un portefeuille d'actifs dédiés par les exploitants nucléaires, sous le contrôle de l’Etat.
QUESTION 313
Posée par Philippe RONDET (OCTEVILLE), le 12/09/2013
Il est temps de finaliser enfin la filière des déchets nucléaires. Trois questions : Impact sûreté de Fukushima sur le dimensionnement? Impact de coût? Et enfin, la taille du site n'est-elle pas déjà trop petite ou pas assez ambitieuse étant donné les coûts de structure et de fonctionnement? Où est-on limité par le site?
Réponse du 06/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Si Cigéo est autorisé, le Centre sera une installation nucléaire de base qui, à ce titre, sera soumise à la réglementation en vigueur concernant ce type d’installation et sera notamment placée sous le contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) comme les autres installations nucléaires de base en France. Conformément à cette réglementation, l’ASN contrôlera très régulièrement le respect des exigences de sûreté mises en œuvre par l’Andra. De nouvelles dispositions pourront être prises à tout moment en cas de retour d’expérience à intégrer ou de changement de normes. Ainsi, les exigences de sûreté ont d’ores et déjà été renforcées notamment suite à la catastrophe de Fukushima. Cigéo n’est cependant pas une centrale nucléaire mais un centre de stockage de déchets radioactifs stabilisés et conditionnés qui du fait de son implantation à 500 mètres de profondeur sera peu vulnérable aux activités humaines comme aux catastrophes naturelles à l’inverse d’une centrale comme celle de Fukushima au Japon.
Pour un nouveau réacteur nucléaire sur l’ensemble de sa durée de fonctionnement, le coût du stockage des déchets radioactifs est de l’ordre de 1 à 2 % du coût total de la production d’électricité. La dernière évaluation du coût du stockage validée par le ministère en charge de l’énergie date de 2005. Au stade des études de faisabilité scientifique et technique et selon les hypothèses techniques retenues à ce stade, le coût du stockage avait été estimé entre 13,5 et 16,5 milliards d’euros, répartis sur une centaine d’années. Cette évaluation couvrait notamment le stockage de tous les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue produits par les réacteurs nucléaires français pendant 40 ans. L’Andra a lancé en 2012 les études de conception industrielle du projet Cigéo. Sur cette base, un nouveau chiffrage du coût du stockage sera finalisé en 2014 pour prendre en compte les pistes d’optimisation identifiées en 2013, les recommandations des évaluateurs et pour intégrer les suites du débat public. La Cour des comptes a réalisé une analyse des enjeux associés dans son rapport public thématique portant sur « Les coûts de la filière électronucléaire » (janvier 2012) disponible sur le site du débat : ../docs/docs-complementaires/docs-avis-autorites-controle-evaluations/rapport-thematique-filiere-electronucleaire.pdf.
Le stockage est conçu pour accueillir les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue produits par les installations nucléaires françaises actuelles jusqu’à leur démantèlement ainsi que les déchets produits par les installations qui sont aujourd’hui arrêtées (Brennilis, Bugey, Chinon, Saint-Laurent, Superphénix…). Par précaution, des volumes supplémentaires sont prévus en réserve dans Cigéo pour certains déchets de faible activité à vie longue qui, le cas échéant, ne pourraient pas être stockés dans le stockage à faible profondeur à l’étude par l’Andra. Si Cigéo est autorisé, le stockage sera construit de manière progressive, au fur et à mesure des besoins. L’évaluation du coût du stockage correspond ainsi à des dépenses réparties pendant plus de 100 ans. L’Andra conçoit l’architecture du projet Cigéo de façon à ce qu’elle soit flexible pour pouvoir s’adapter à des évolutions de la politique énergétique française. Pour plus d’information sur les hypothèses retenues pour le dimensionnement de Cigéo, vous pouvez consulter le dossier du maître d’ouvrage (chapitre 1.5 – Les volumes de déchets prévus dans Cigéo) : ../docs/dmo/chapitres/DMO-Andra-chapitre-1.pdf
QUESTION 312
Posée par Patrice GAUCHOTTE (SAULVAUX), le 12/09/2013
Le transport des déchets va se faire comment? (route, rail). Avec quelle sécurité pour les villages qui vont être traversés? Quand on voit que l'Etat n'est pas capable de mettre notre village en sécurité par rapport à la RN4. Qu'une simple barrière nous protège par rapport aux poinds lourds transportant des matières dangereuses!
Réponse du 03/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les modalités d’acheminement des colis de déchets radioactifs depuis les sites où ils sont entreposés jusqu’à Cigéo sont étudiées par les producteurs de déchets (Areva, CEA et EDF). Le transport par voie ferroviaire est privilégié. Le réseau ferré national permet d’acheminer les convois jusqu’à proximité de Cigéo.
La desserte locale de Cigéo est étudiée dans le cadre du schéma interdépartemental de développement du territoire. L’arrivée et le déchargement des trains se feraient dans un terminal ferroviaire spécifique. Deux options sont possibles :
- soit le terminal ferroviaire est implanté sur une voie ferroviaire existante en Meuse ou en Haute-Marne. Le transport final jusqu’à Cigéo serait alors réalisé par voie routière,
- soit le terminal ferroviaire est implanté sur le site même de Cigéo, ce qui nécessiterait de créer un raccordement ferroviaire d’environ 15 km.
Pour plus d’informations sur les itinéraires étudiés pour le transport des colis de déchets, vous pouvez consulter le chapitre correspondant du dossier du maître d’ouvrage (4.3 – Le transport des colis de déchets): ../docs/dmo/chapitres/DMO-Andra-chapitre-4.pdf
Réponse apportée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) :
Environ 900 000 colis de substances radioactives sont transportés chaque année. 85 % des colis transportés sont destinés aux secteurs de la santé, de l’industrie non-nucléaire ou de la recherche, dits "nucléaire de proximité", dont 30 % environ pour le seul secteur médical. L’industrie nucléaire ne représente qu’environ 15 % du flux annuel de transports de substances radioactives. On estime à environ 11 000 le nombre annuel de transports nécessaires au cycle du combustible, pour 141 000 colis. Le contenu des colis est très divers : leur radioactivité varie sur plus de douze ordres de grandeur, soit de quelques milliers de becquerels pour des colis pharmaceutiques de faible activité à des millions de milliards de becquerels pour des combustibles irradiés. Leur masse varie de quelques kilogrammes à une centaine de tonnes.
Les risques majeurs des transports de substances radioactives sont les suivants :
- le risque d’irradiation externe de personnes dans le cas de la détérioration de la « protection biologique des colis », matériau technique qui permet de réduire le rayonnement au contact du colis ;
- le risque d’inhalation ou d’ingestion de particules radioactives dans le cas de relâchement de substances radioactives ;
- la contamination de l’environnement dans le cas de relâchement de substances radioactives;
- le démarrage d’une réaction nucléaire en chaîne non contrôlée (risque de « sûreté-criticité») pouvant occasionner une irradiation des personnes, en cas de présence d’eau et de non-maîtrise de la sûreté de substances radioactives fissiles.
La prise en compte de ces risques conduit à devoir maîtriser le comportement des colis pour éviter tout relâchement de matière et détérioration des protections du colis dans le cas :
- d’un incendie ;
- d’un impact mécanique consécutif à un accident de transport ;
- d’une entrée d’eau dans l’emballage (l’eau facilitant les réactions nucléaires en chaîne en présence de substances fissiles) ;
- d’une interaction chimique entre différents constituants du colis ;
- d’un dégagement thermique important des substances transportées, pour éviter la détérioration éventuelle avec la chaleur des matériaux constitutifs du colis.
Cette approche conduit à définir des principes de sûreté pour les transports de substances radioactives :
- la sûreté repose avant tout sur le colis : des épreuves réglementaires et des démonstrations de sûreté sont requises par la réglementation pour démontrer la résistance des colis à des accidents de référence ;
- le niveau d’exigence, notamment concernant la définition des accidents de référence auxquels doivent résister les colis, dépend du niveau de risque présenté par le contenu du colis. Ainsi, les colis qui permettent de transporter les substances les plus dangereuses doivent être conçus de façon à ce que la sûreté soit garantie y compris lors d’accident de transport.
Ces accidents sont représentés par les épreuves suivantes :
- trois épreuves en série (chute de 9 m sur une surface indéformable, chute de 1 m sur un poinçon et incendie totalement enveloppant de 800 °C minimum pendant 30 minutes) ;
- immersion dans l’eau d’une profondeur de 15 m (200 m pour les combustibles irradiés) pendant 8 h.
La sûreté des transports est également fondée sur la fiabilité des opérations de transport qui doivent satisfaire à des exigences réglementaires notamment en matière de radioprotection. L'ASN assure le contrôle de la sûreté des transports de matières radioactives. Enfin, la gestion des situations accidentelles est régulièrement testée lors d'exercices.
QUESTION 311
Posée par Jacques BERTHET (NARCY), le 12/09/2013
Suite à notre question n°13 du 16.05.2013 et à la réponse de l'ANDRA, nous avons bien pris note que les réacteurs à neutrons rapides de la 4ème génération marquent leurs limites sur le plan technique pour enlever la nocivité des déchets radioactifs. Par contre, les lasers de puissance permettent la transmutation avec, à ce jour, une forte demande d'énergie mais que l'on sait peu à peu réduire pour un même résultat. Il y a aussi les ultratempératures et sûrement d'autres voies encore. Ne serait-il pas urgent de mettre toutes nos capacités intellectuelles et financières dans ces autres voies de recherche plus éthiques que d'investir dans un enfouissement qui sera toujours bien problèmatique? Nous avons déja perdu beaucoup de temps et d'argent dans des impasses!
Réponse du 06/12/2013,
Réponse apportée par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) :
Le stockage et les recherches visant à diminuer la quantité et la radiotoxicité des déchets sont des voies complémentaires. Cette notion de complémentarité est d’ailleurs une des conclusions du débat sur les déchets qui s’était tenu en 2005. Ainsi, si la loi du 28 juin 2006 a retenu le stockage en couche géologique profonde comme solution de référence pour les déchets HA et MA-VL, elle a aussi confirmé l’intérêt des recherches sur l’entreposage et la séparation-transmutation, en soulignant leur complémentarité.
C’est dans ce cadre que la loi a confié au CEA la poursuite des études sur la séparation-transmutation. Il s’agit d’isoler puis de transformer ces éléments les plus radiotoxiques en les transmutant en d’autres éléments à vie plus courte. Comme indiqué dans la réponse précédente, ces recherches sont menées par le CEA en synergie avec celles menées sur les réacteurs nucléaires à neutrons rapides de 4ème génération, capables de réaliser la transmutation, et ont fait l’objet d’un rapport remis au gouvernement en décembre 2012. La transmutation d’actinides mineurs ne supprimera pas le besoin d’un stockage en couche géologique profonde (il y aura un résidu ultime à stocker), mais pourrait constituer une voie de progrès à long terme, notamment pour répondre à l’objectif de la loi de 2006, à savoir « la réduction de la quantité et de la nocivité des déchets radioactifs est recherchée ».
D’autres voies de recherches peuvent bien sûr aussi être explorées, au vue de cet objectif, puisque la gestion des déchets s’est toujours inscrite dans une démarche de progrès continu, s’intéressant aux possibilités d’optimisation pour l’avenir de la filière nucléaire.
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Dans le cadre de ses propositions sur la réversibilité, l’Andra suggère de faire périodiquement un point sur l’avancement des recherches en France et à l’étranger sur la gestion des déchets radioactifs. Les thématiques que vous évoquez pourraient être suivies dans ce cadre. Ces rendez-vous permettraient également de discuter des perspectives à venir, de faire le bilan de l’exploitation du stockage et de réexaminer les conditions de réversibilité.
Si vous souhaitez disposer de plus d’informations sur les propositions de l’Andra en matière de réversibilité, vous pouvez consulter le document de synthèse ../docs/rapport-etude/fiche-reversibilite-cigeo.pdf
QUESTION 310
Posée par Jacques MERY, le 04/09/2013
Quel pourrait ainsi être l'horizon temporel pertinent de calcul pour les coûts d'entreposage ?
Y aura t-il bien un débat consacré plus spécifiquement aux aspects économiques ?
Meilleures salutations,
Réponse du 06/01/2014,
Réponse apportée l’Andra, maître d’ouvrage :
Le débat consacré aux solutions de gestion (stockage réversible, entreposage, séparation-transmutation) a eu lieu le 18 septembre 2013 et celui sur les aspects économiques le 13 novembre 2013.
La comparaison économique des coûts entre une stratégie fondée exclusivement sur l’entreposage ou une stratégie intégrant le stockage présente plusieurs limites :
- Dans son avis du 1er février 2006, l’Autorité de sûreté nucléaire a considéré qu’il ne serait pas raisonnable de retenir comme solution de référence la solution consistant à renouveler plusieurs fois un entreposage de longue durée, car elle suppose le maintien d’un contrôle de la part de la société et la reprise des déchets par les générations futures, ce qui semble difficile à garantir sur des périodes de plusieurs centaines d’années. Cette considération, faite sous l’angle de la maîtrise technique et de la sûreté, vaut aussi du point de vue économique : les travaux des économistes montrent que la défintion d’un taux d’actualisation à des échelles de temps de plus de cent ans est difficile compte tenu notamment des incertitudes prévalant sur la croissance de long terme à ces horizons de temps.
- La réversibilité du stockage pourra préserver les mêmes libertés de choix qu’une poursuite de la gestion en entreposage, mais ajoutera la possibilité de fermer le stockage pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et ne plus transmettre la charge de la gestion des déchets aux générations suivantes. Si on veut comparer les coûts et les bénéficie du stockage et de l’entreposage, il conviendrait de valoriser cette possibilité, sachant que l’évaluation devrait valoriser les projets qui laissent le plus de possibilités d’adaptation aux événements futurs.
A l’échelle séculaire, une approche globale des scénarios de gestion industrielle des déchets associant l’entreposage et le stockage a été proposée par l’Andra. Elle a montré qu’il est possible d’optimiser le système industriel constitué de l’entreposage et du stockage, ainsi que des moyens de transport entre les sites, en utilisant au mieux les capacités d’entreposage existantes ou en projet. Les flux de colis mis en stockage pourront croître progressivement pendant une première période après la mise en service de Cigéo prévue en 2025. Cela ouvre la possibilité d’une montée en puissance graduelle. Il est ensuite possible de stabiliser dans le temps le niveau d’activité industrielle de Cigéo. L’exercice a aussi montré l’intérêt d’une mise en stockage par campagnes de différentes familles de colis.
QUESTION 309 - Convois qu'on voit ?
Posée par Pascale VINCENT, CITOYEN DU MONDE (ROUTE DES CONVOIS), le 04/09/2013
Comment comptez-vous répertorier et indemniser les futures familles malades du passage des convois irradiés ? Allez-vous prétendre comme à la Hague que l'accroissement des leucémies des enfants n'est pas dû au contact des radiations ? Où peut-on lire votre étude sur l'impact environnemental du passage des convois (2 par semaines selon vos dire pendant 100 ans) sur les hommes et leur environnement, sur les conducteurs des camions et ceux qui chargent, sur les réceptionneurs ? Où peut-on lire la législation en matière de santé sur les futurs méfaits des convois ? Où peut-on apprendre qu'elles seront les compensations offertes par l'Andra et les Conseils Généraux fournisseurs des toutes belles routes (cad l'Etat et donc nous citoyens et nos deniers) aux familles des morts et à leurs malades ? Méfaits, devrais-je dire cream contre l'humanité organisé à échelle nationale, que l'Andra et ses supporters auront provoqué sciemment au nom des parts de marché. Je recommande à tous les citoyens responsables de ne plus donner leurs sous à EDF, mais de se renseigner sur Enercoop. Arrêtons d'alimenter un système que nous réprouvons. Pourquoi EDF a-t-il le monopole du réseau éléctrique ? Monsieur le Censurier, je ne crois pas avoir été injurieuse ni même immodérée. Enercoop est-elle une entreprise censurée ? J'ai juste posé des questions humaines et présenté une autre voie pour aborder la question des déchets : ne pas en produire. Monsieur le Censurier, d'un point de vue humain, aimeriez-vous avoir un fût de déchet FAVL dans votre jardin ? Et vous, Monsieur le Ministre ? Et vous Madame la Directrice de l'Andra ? Allez Madame, vous n'habitez pas à Bure et vous administrez de loin, n'est-ce pas ? Vous voyez, vous êtes complètement capable d'avoir une relation humaine quand ça vous touche de près ! Voilà, vous touchez au but pour nous comprendre. Nous sommes concernés, nous autres habitants du jardin où vous voulez enfouir. Nous autres habitants qui allons avoir un accident avec un camion-convoi-radioactif (CCR) sur nos routes viroleuses étroites et mal signalisées. Il est temps que le dialogue n'aie plus pour unique résurgence l'argent, "l'économie". Il est temps que les décisions politiques reprennent dimension humaine. Et que la justice trouve sa balance.
Réponse du 18/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Madame,
Vous nous accusez d’un « crime contre l’humanité organisé à l’échelle nationale ».
Vos propos sont insultants pour toutes celles et tous ceux qui travaillent à la mise en œuvre de solutions sûres pour protéger les populations actuelles et futures des risques liés aux déchets radioactifs. Toutes les personnes qui travaillent à l’Andra partagent une même valeur : la responsabilité. Nous sommes responsables de la sûreté de nos installations. Nous sommes responsables devant les territoires qui nous accueillent. Nous sommes également responsables devant les générations futures. Les personnes de l’Andra qui travaillent sur les sites de stockage et habitent à proximité sont les premières concernées par la sécurité. Croyez-vous qu’elles accepteraient de travailler sur un site dont la sûreté ne serait pas garantie ?
Vous vous interrogez sur la sûreté des transports. Les déchets radioactifs seront transportés dans des emballages spécialement conçus pour protéger les travailleurs et les populations des radiations et empêcher le risque de dispersion de radioactivité dans l’environnement. Ces dispositions seront contrôlées par une autorité indépendante, l’Autorité de sûreté nucléaire.
Vous proposez une autre voie pour aborder la question des déchets : ne plus en produire. Il nous semble que, quels que soient les choix énergétiques futurs, c’est la responsabilité de notre génération de proposer aux générations suivantes une solution permettant de mettre définitivement en sécurité ces déchets, qui sont produits en France depuis plusieurs dizaines d’années.
QUESTION 308 - signalisation perenne dans les galeries
Posée par alain CORREA, L'organisme que vous représentez (option) (ELBEUF), le 28/08/2013
Bonjour Serait-il possible de mettre en place un groupe, une commission chargée d’élaborer un mode de communication pérenne qui puisse être compris dans le temps. Peut-être inclure des paléontologues, des égyptologues, aborigènes, des médiévistes et s’inspirer de ce que l’on a pu trouver dans les pyramides, les parchemins, les incunables, tous les supports anciens qui ont permis, au delà des mots et des langues, de transmettre un message, une information viable et compréhensible à travers le temps. Ne pas s’interdire d’utiliser des notions simplistes de « malin », qui ont perduré et portent la notion de « danger ». Le résultat final, présenté au public, pourrait être dupliqué et apposé sur plusieurs supports résistants, plaque d’acier et/ou verre trempé, en bas relief gravé au laser ou en lave émaillée qui est utilisée pour les tables d’orientation. Merci
Réponse du 27/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’Andra a déjà mis en place un dispositif mémoriel dont la robustesse a été évaluée suffisante pour assurer une pérennité sur plusieurs siècles, en se basant sur son expérience sur son Centre de stockage de la Manche (cf. § 5.6 du dossier du maitre d’ouvrage, et rubrique « Les solutions de gestion / Se souvenir » du site Internet de l’Andra). Ce dispositif en cinq volets a notamment été mis en place avec les Archives de France, des spécialistes des manuscrits médiévaux et une commission externe indépendante. Il est analysé par l’Autorité de sûreté nucléaire comme tous les autres dispositifs liés au stockage lors de chaque réexamen de sûreté, et il fait aussi l’objet d’une évaluation décennale par des tiers externes indépendants.
Pour des durées bien plus longues, l’Andra pilote depuis plusieurs années un projet baptisé « mémoire pour les générations futures » avec une trentaine d’études variées (linguistique, société, supports, marqueurs, archéologie, anthropologie…). Ce projet comporte également l’animation de plusieurs groupes de réflexion externes (un par région d’implantation) dont la composition très variée n’est pas fermée, ainsi que la participation active à un groupe international sous l’égide de l’OCDE/AEN avec 16 pays représentés.
QUESTION 307 - Etre responsable des déchets radiaoctifs qu'on a produits !
Posée par Joy VITTECOQ (PALAISEAU), le 23/08/2013
Pour avoir visité le Laboratoire souterrain de recherche de Bure en 2012, il me semble que la solution du stockage des déchets HAMVL à 500 m sous terre est aujourd’hui celle qui parait la plus adéquate. Beaucoup d’organismes de recherche ont travaillé sur cette problématique et de nombreux acteurs se sont impliqués pour aboutir à une solution. Mon interrogation est la suivante : si on ne décide pas aujourd’hui de construire ce stockage, qu’allons-nous faire de ces déchets ?
Réponse du 18/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Si la décision était prise de ne pas construire le stockage, alors les déchets radioactifs de haute activité (HA) et de moyenne activité à vie longue (MA-VL) existants resteront entreposés sur leurs sites de production. De nouvelles installations d’entreposage seront nécessaires au fur et à mesure pour accueillir les déchets radioactifs qui sont actuellement produits par l’industrie électronucléaire en France et pour remplacer les entrepôts qui arrivent en fin de vie (les premiers déchets radioactifs HA et MA-VL ont été produits dans les années 1960). Cette décision impliquerait que les générations actuelles décident de reporter sur les générations futures la responsabilité de mettre en œuvre une solution de gestion à long terme pour ces déchets radioactifs. Or c’est la responsabilité des générations actuelles de proposer une solution de gestion définitive pour ces déchets et de ne pas reporter les décisions sur les générations futures en misant sur le fait qu’elles trouveront peut-être d’autres solutions. En effet, personne ne peut garantir aujourd’hui que d’autres solutions émergeront dans le futur, ni que ces hypothétiques alternatives présenteraient les mêmes performances de sûreté à long terme que le stockage.
QUESTION 306
Posée par Gérard GRUNWALD (BUREY EN VAUX), le 07/08/2013
Depuis l'arrivée de l'ANDRA, une manne financière a arrosé le secteur : communes, entreprises, associations, collectivités territoriales, conseil général en particulier. Comment ne pas considérer cela comme un "trafic d'influence"?
Réponse du 11/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Il n’est pas acceptable de mettre en cause l’intégrité des acteurs locaux, qui expriment leurs avis sur le projet Cigéo en toute indépendance. Il est normal que les territoires qui acceptent de s’engager depuis une vingtaine d’années dans une démarche visant à mettre en œuvre un projet d’intérêt national en tirent un bénéfice concret. L’accompagnement économique a été décidé par le Parlement. Deux groupements d’intérêt public ont ainsi été constitués en Meuse et en Haute-Marne en vue de gérer des équipements nécessaires à l’installation du Laboratoire souterrain ou du Centre de stockage s’il est mis en œuvre, de mener des actions d’aménagement du territoire et de développement économique et de soutenir des actions de formation et la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques. Ils sont financés par les producteurs de déchets au moyen d’une taxe sur leurs installations nucléaires.
QUESTION 305
Posée par Michel IGAS, le 05/08/2013
Sur le territoire de quelle(s) commune(s), l'Andra privilégie-t-elle une gestion des déblais à proximité de Cigéo pour limiter les transports associés?
Réponse du 24/10/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Si Cigéo est autorisé, les installations liées à la zone « descenderie » seraient implantées sur le territoire des communes de Bure et de Saudron et celles liées à la zone « puits » seraient implantées sur le territoire des communes de Mandres-en-Barrois ou de Bonnet selon les scénarios étudiés (cf. chapitre 3 du dossier du maître d’ouvrage). Les déblais seraient gérés sur ces sites.
QUESTION 304 - sureté des entreposages
Posée par gerard BESSIERES, L'organisme que vous représentez (option) (VARENNES SUR AMANCE), le 30/07/2013
bonjour Pouvez vous actuellement être en mesure de tester les différents scénarios d'accident et de prouver que la sureté des stockages est assurée?
Réponse du 18/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Des essais sont effectivement d’ores et déjà réalisés ou prévus dans la suite des études afin de qualifier les équipements assurant la sûreté de Cigéo et de tester les dispositions techniques qui seraient mises en place dans Cigéo, d’une part pour prévenir les accidents qui pourraient survenir, d’autre part pour en limiter les conséquences afin de garantir que le stockage reste sûr.
A titre d’exemple, des essais de chute sont réalisés pour les conteneurs de stockage dans lesquels seront placés les colis, à des hauteurs supérieures à celles auxquelles ils seront manipulés dans Cigéo, afin de vérifier leur robustesse. Autre exemple, des essais de feu dans des conditions similaires à celles de la future installation souterraine sont réalisés afin de tester la résistance des colis en cas d’incendie, notamment des colis conteneurs en béton dans lesquels seront placés les colis de déchets bitumés. Des essais de freinage seront également réalisés sur le funiculaire qui permettra de transférer les colis de déchets de la surface vers l’installation souterraine afin de vérifier le bon fonctionnement des différents systèmes de sécurité prévus…
Les programmes d’essais et l’ensemble des résultats obtenus seront évalués par l’Autorité de sûreté nucléaire, avant d’autoriser la création du stockage.
QUESTION 303 - Devenir des captages de la Vallée de l'Orge
Posée par Anne Marie RENARD, PRÉSIDENT DU SYNDICAT DES EAUX DE LA VALLÉE DE L'ORGE ET MAIRE DE BIENCOURT SUR ORGE (RIBEAUCOURT), le 11/09/2013
Le 30 Juillet 2013 j'ai fait part à la CPDP par lettre RAR de mes inquiétudes quant au devenir des captages d'eau de RIBEAUCOURT et de BIENCOURT. Six semaines plus tard, en dehors de l'accusé de réception fourni par "LA POSTE", je n'ai eu AUCUN RETOUR. C'est pourquoi je demande par ce canal, ce que la CPDP entend faire pour que je puisse assurer au Comité Syndical de la Vallée de l'Orge que ses inquiétudes seront prises en compte à l'occasion du Débat Public National sur CIGEO.
Réponse du 10/10/2013,
La Commission du débat public a bien reçu votre courrier et a répondu par un mail en date du 6 août, à l'adresse figurant sur le courrier, que la question de la pérennisation des captages d'eau de Ribeaucourt et de Biencourt sur Orge était transmise à l'Andra afin qu'elle y apporte une réponse.
La réponse vous sera transmise dès réception par la Cpdp.
QUESTION 302
Posée par , le 25/07/2013
Comment peut-on dire que l'entreposage est sûr alors qu'il y a de tels problèmes avec les piscines de Fukushima?
Réponse du 20/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
En France, toute installation nucléaire répond à des exigences de sûreté contrôlées par l’Autorité de sûreté nucléaire. Ainsi, quelle que soit sa situation, en surface ou en profondeur, une installation gérant des déchets radioactifs doit garantir le confinement de la radioactivité contenue dans les déchets. Cette garantie doit être apportée y compris en situation accidentelle. Par exemple, des mesures renforcées sont prises vis-à-vis du risque incendie pour une installation souterraine.
Conformément à la réglementation, l’ASN contrôle très régulièrement le respect des exigences de sûreté mises en œuvre par les exploitants nucléaires. De nouvelles dispositions peuvent être prises à tout moment en cas de retour d’expérience à intégrer ou de changement de normes. Ainsi, les exigences de sûreté ont d’ores et déjà été renforcées notamment suite à la catastrophe de Fukushima.
L’entreposage actuel des déchets sur leurs sites de production est une solution sûre qui bénéficie d’un retour d’expérience de plusieurs dizaines d’années. Néanmoins cette solution ne peut être que provisoire. En effet, une installation d’entreposage, qu’elle soit en surface ou à faible profondeur, ne peut assurer le confinement de la radioactivité à très long terme. En cas de perte de contrôle de telles installations, les conséquences radiologiques sur l’homme et l’environnement ne seraient pas acceptables.
Le stockage à 500 mètres de profondeur dans une couche géologique assurant le confinement de la radioactivité à l’échelle de plusieurs centaines de milliers d’années permet de protéger l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs à très long terme. Du fait de son implantation à 500 mètres de profondeur, le stockage sera peu vulnérable aux activités humaines comme aux catastrophes naturelles à l’inverse d’une centrale comme celle de Fukushima au Japon.
Réponse apportée par Areva :
Dans l’attente de la mise en service de Cigéo les colis de déchets HA et MA-VL déjà produits sont provisoirement entreposés à sec dans des bâtiments sur leur site de production, principalement à La Hague (Manche), Marcoule (Gard), Cadarache (Bouches-du-Rhône) et, pour un volume limité, à Valduc (Côte-d’Or). Une installation d’entreposage pour certains déchets issus de l’exploitation et du démantèlement des réacteurs est en cours de construction sur le site de Bugey (Ain). Il est important de rappeler que 30 % des déchets HA et 60 % des déchets MA-VL destinés à Cigéo sont déjà produits. Ils sont donc entreposés de manière sûre, pour certains déchets depuis plusieurs décennies dans des installations d’entreposage dédiées. A titre d’exemple les déchets vitrifiés sont entreposés en toute sûreté à La Hague depuis plus de 20 ans.
Les entreposages ne sont donc que des briques d’une solution globale de gestion des déchets radioactifs issus de la production électronucléaire. Cigéo en étant la dernière.
Le concept retenu pour ces installations est modulaire ; il permet d’étendre progressivement la capacité actuelle.
L’inauguration récente de l’installation d’entreposage de déchets vitrifiés « EEVLH » illustre cette modularité et la flexibilité opérationnelle associée. Cette installation d’une durée de vie d’une centaine d’année vient ainsi compléter les capacités aujourd’hui disponibles sur le site de la Hague.
QUESTION 301
Posée par , le 25/07/2013
Comment grandir la surveillance d'un entreposage? S'il y a une révolution?
Réponse du 10/10/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’entreposage des déchets radioactifs en surface ou à faible profondeur nécessite l’intervention régulière de l’homme pour surveiller, maintenir et reconstruire les installations, ce qui ne peut être garanti sur le long terme. L'entreposage actuel des déchets sur leurs sites de production est donc une solution sûre mais provisoire car elle ne peut être pérennisée. En cas de perte de contrôle de telles installations, les conséquences radiologiques sur l’homme et l’environnement ne seraient pas acceptables.
C’est une des raisons qui a conduit au choix de la solution du stockage profond pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs.
Le stockage à 500 mètres de profondeur dans une couche géologique assurant le confinement à l’échelle de plusieurs centaines de milliers d’années permet de protéger l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue. La géologie prend ainsi le relais de l’homme pour garantir la sûreté sur le très long terme.
QUESTION 300
Posée par , le 25/07/2013
Attendre, n'est-ce pas adopter la politique de l'autruche? Et surtout dire aux générations futures : débrouillez-vous ?
Réponse du 10/10/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
C’est justement pour ne pas laisser aux générations futures la charge de la gestion des déchets radioactifs et les risques associés que le Parlement a fait le choix du stockage réversible profond, après 15 années de recherche et leur évaluation sur le plan scientifique et de la sûreté. A l’inverse de l’entreposage, le stockage permet de mettre en sécurité ces déchets de manière définitive. En effet, une fois fermé, sa sûreté est assurée sans intervention humaine.
Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs produits en France depuis plus d’un demi-siècle. Grâce à la réversibilité, ces générations garderont la possibilité de faire évoluer cette solution pendant au moins 100 ans. La fermeture du stockage leur permettra si elles le souhaitent de ne plus avoir à intervenir pour assurer la protection de l’homme et de l’environnement contre la dangerosité de ces déchets.
QUESTION 299
Posée par , le 25/07/2013
N'est-il pas plus urgent de montrer qu'on se préoccupe des déchets qui sont déjà là?
Réponse du 10/10/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Aujourd’hui, 90 % du volume des déchets radioactifs produits chaque année en France disposent d’une solution de stockage opérationnelle. Il s’agit de déchets radioactifs de très faible activité ou de faible et moyenne activité à vie courte qui peuvent être pris en charge dans les centres de stockage de surface exploités par l’Andra. Ce système industriel reste à compléter pour certains déchets, notamment ceux de haute activité (HA) et de moyenne activité à vie longue (MA-VL), qui sont les déchets les plus radioactifs.
Le stock actuel de déchets HA et MA-VL est de 43 000 m3. Ces déchets ont commencé à être produits depuis une cinquantaine d’années. Dans l’attente d’une solution de gestion à long terme, ils sont provisoirement entreposés dans des bâtiments sur leur site de production, notamment à La Hague (Manche), Marcoule (Gard) et Cadarache (Bouches-du-Rhône) et, pour un volume limité, à Valduc (Côte d’Or). Ces bâtiments ne sont pas conçus pour confiner la radioactivité sur de longues échelles de temps. Le projet Cigéo vise en premier lieu à proposer une solution pour mettre en sécurité de manière définitive ces déchets, « qui sont déjà là ».
D’autres déchets HA et MAVL seront inévitablement produits par le parc électronucléaire actuel dans les années à venir, quels que soient les choix énergétiques futurs. Cigéo, s’il est autorisé, permettra également de prendre en charge ces déchets « engagés ».
QUESTION 298
Posée par , le 25/07/2013
Pouvez-vous nous expliquer en quoi les recherches du CEA peuvent permettre de transformer les déchets ultimes, déjà produits? Où est-ce du "baratin" puisque tel est le mot que vous utilisez?
Réponse du 27/11/2013,
Réponse apportée par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) :
Les recherches menées par le CEA et ses partenaires dans le domaine des déchets radioactifs s’inscrivent dans une démarche de progrès continu, avec un objectif confirmé dans la loi de 2006 sur la gestion durable des matières et des déchets, à savoir : « la réduction de la quantité et de la nocivité des déchets radioactifs est recherchée ».
Aujourd’hui, la France retraite les combustibles usés issus de ses centrales nucléaires. Il s’agit d’extraire et de réutiliser toutes les matières valorisables (uranium et plutonium), ce qui permet déjà de répondre en partie à cet objectif et de valoriser une grande partie des combustibles usés. La partie restante, ce qu’on appelle les déchets ultimes, est vitrifiée et entreposée dans l’attente d’un site de stockage définitif.
Si le verre a été choisi comme matrice pour ces déchets ultimes constitués d’éléments radioactifs à vie longue, c’est justement pour ses propriétés de confinement, c’est-à-dire son aptitude à les incorporer et à les immobiliser durablement. L’ensemble des études menées par le CEA a prouvé la très bonne résistance de la matrice vitreuse à l’altération sur des temps très longs. De ce fait, il n’est à ce jour pas envisagé de récupérer les radioéléments une fois vitrifiés.
Dans ce contexte, les recherches du CEA visent à aller plus loin dans la démarche de valorisation des combustibles usés :
- Le premier objectif vise à aller jusqu’au bout du recyclage du plutonium issu des combustible usés, afin de valoriser au maximum tout le potentiel énergétique. Ces recherches sont menées en lien avec les recherches sur les systèmes nucléaires de 4ème génération, dits à neutrons rapides, capables d’effectuer ce multi recyclage du plutonium. En effet, aujourd’hui, les réacteurs à eau du parc actuel permettent de recycler une fois ce plutonium sous forme de combustible MOX (pour oxyde mixte d’uranium et de plutonium) ; des réacteurs à neutrons rapides permettraient de multi-recycler le plutonium issu des combustible MOX usés de façon récurrente, permettant ainsi de tirer le plein parti de cette ressource énergétique.
- Sur le plus long terme, le CEA mène des études pour réduire le volume et la radiotoxicité des déchets ultimes. L’idée est d’isoler les éléments les plus radiotoxiques des déchets actuels puis de les transformer en les transmutant en d’autres éléments moins radiotoxiques et à vie plus courte. C’est la séparation-transmutation/ Ces recherches sont aussi menées par le CEA en synergie avec celles menées sur les réacteurs nucléaires à neutrons rapides de 4ème génération, seuls capables de réaliser la transmutation. Elles ont fait l’objet d’un rapport remis au gouvernement en décembre 2012 et disponible à tout public sur le site internet http://www.cea.fr/. La séparation transmutation pourrait ainsi permettre une réduction supplémentaire du volume et de la radiotoxicité à long terme des déchets, mais ne supprimera jamais complètement la radioactivité des déchets ni la nécessité d’un stockage en couche géologique profonde. Comme indiqué plus haut, elle ne concerne pas les déchets actuels déjà vitrifiés et conditionnés.
Plus de renseignements : Les rapports de recherche - Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) - Dossier 2012 – Tome 2 – Séparation-transmutation des éléments radioactifs à vie longue ../informer/documents-complementaires/rapports-autorites-evaluations-ponctuelles.html
QUESTION 297
Posée par , le 25/07/2013
Plus de la moitié des déchets de CIGEO sont déjà produits, que proposez-vous pour les gérer pour éviter que nos enfants aient à s'en occuper?
Réponse du 18/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Effectivement, plus de 40 000 m3 de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue sont déjà produits. Ils sont actuellement entreposés de manière provisoire dans des bâtiments, en surface, notamment sur les sites de La Hague, Marcoule et Cadarache.
Ces déchets resteront dangereux plusieurs centaines de milliers d’années. Ils ne peuvent donc pas être stockés en surface car on ne peut garantir le maintien de protections adaptées sur de telles échelles de temps. C’est pourquoi le Parlement a retenu en 2006 le stockage profond, comme solution. Il s’agit, aujourd’hui, de la seule solution qui permette une mise en sécurité définitive et en toute sûreté des déchets les plus radioactifs. En effet, la profondeur du stockage, sa conception et son implantation dans une roche argileuse peu perméable et dans un environnement géologique stable permettent de mettre les déchets à l’abri des activités humaines et des événements naturels (érosions, séisme) sur de très longues échelles de temps.
Les autres pays utilisant l’énergie électronucléaire retiennent également tous le stockage profond pour une gestion définitive et sûre à long terme de leurs déchets les plus radioactifs.
QUESTION 296
Posée par Gérard BESSIERES, le 25/07/2013
L'Etat n'a plus d'argent pour financer les nouvelles autoroutes et les nouvelles lignes TGV. Où allez-vous trouver le financement pour CIGEO?
Réponse du 27/11/2013,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Le financement de la gestion des matières et déchets radioactifs est assuré, sous le contrôle de l’État, par les exploitants nucléaires, selon le principe « pollueur-payeur ».
Le projet Cigéo est donc entièrement financé par les exploitants nucléaires producteurs de déchets : EDF, Areva, CEA. Cela comprend donc les coûts des recherches, des études, de la construction, de l’exploitation, de la surveillance et de la fermeture.
Un dispositif de sécurisation du financement des charges nucléaires de long terme, est institué dans la loi du 28 juin 2006 codifiée au code de l'environnement. Il prévoit la constitution d'un portefeuille d'actifs dédiés par les exploitants nucléaires au cours de l'exploitation. Pour cela, les exploitants sont tenus d'évaluer l’ensemble de leurs charges de long terme parmi lesquelles figurent les charges liées au projet Cigéo. Ils doivent assurer dès à présent, la couverture de ces charges à venir par la constitution d'actifs dédiés qui doivent présenter un haut niveau de sécurité.
Ces opérations sont étroitement contrôlées par l’État. Pour exercer son contrôle, l'autorité administrative reçoit notamment des exploitants un rapport triennal sur l'évaluation des charges de long terme, les méthodes et les choix retenus pour la gestion des actifs dédiés, ainsi qu'un inventaire trimestriel des actifs dédiés. De plus, une Commission extraparlementaire (la CNEF) évalue le contrôle effectué par l'autorité administrative et remet un rapport triennal sur ses évaluations au Parlement, ainsi qu'au Haut Comité pour la Transparence et l'Information sur la Sécurité Nucléaire (HCTISN).
Réponse apportée par Edf :
Le financement de Cigéo, comme de l'ensemble des activités de stockage assurées par l'Andra, est financé par les producteurs de déchets radioactifs (EDF, AREVA et le CEA), au prorata de l'activité générée par chacun d'entre eux.
Conformément à la loi de juin 2006 sur la gestion des matières et déchets radioactifs, EDF anticipe le financement du stockage de ses déchets radioactifs en intégrant ces coûts futurs dans les coûts de production actuels, et donc dans les prix actuels de l'électricité.
EDF constitue ainsi des provisions financières, sous forme de placements dédiés sécurisés, placés sous le contrôle du Parlement. Au 31/12/2012, 7,1 milliards d'euros étaient déjà provisionnés dans les comptes d'EDF. Ce dispositif financier permet de garantir que les sommes nécessaires à la réalisation du stockage et à l'exploitation de Cigéo seront bien disponibles le moment venu, et de ne pas faire peser cette charge sur les générations futures.
QUESTION 295
Posée par Mireille , le 25/07/2013
La réversibilité est impossible quant aux déchets radioactifs. Si vous mettez un colis HA dans une alvéole... si vous laissez 5 ans par exple et qu'on peut le retirer... le colis ne sera plus le même en sortant et l'environnement de l'alvéole non plus. Quoi penser de cette notion?
Réponse du 18/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le stockage géologique est conçu pour être réversible pendant au moins cent ans. C’est une demande du Parlement, inscrite dans la loi du 28 juin 2006. En réponse à cette demande, de nombreuses dispositions techniques seront mises en œuvre dans Cigéo pour faciliter une opération éventuelle de retrait de colis du stockage. Elles prennent en compte le retour d’expérience d’autres installations, en France et à l’étranger. Les colis utilisés pour le stockage des déchets, en béton ou en acier, sont indéformables. Des espaces suffisants sont ménagés entre les colis pour faciliter leur retrait. Les tunnels de stockage (alvéoles de stockage) auront un revêtement en béton ou en acier pour éviter les déformations pendant quelques dizaines d’années. Des essais de retrait de colis ont d’ores et déjà été réalisés à l’échelle 1. Des nouveaux tests de retrait seront réalisés dans le stockage avant que la mise en service de Cigéo ne puisse être autorisée, puis pendant toute l’exploitation de Cigéo.
Pour en savoir plus sur la réversibilité de Cigéo : ../docs/rapport-etude/fiche-reversibilite-cigeo.pdf
QUESTION 293
Posée par Jean VILLERS, le 25/07/2013
La grande majorité des stériles miniers issus des mines d'uranium françaises ont été abandonnés voir dissiminés comme remblais (etc) une grande part classée MAVL. Pourquoi la maîtrise des déchets radioactifs (slogan de l'ANDRA) ne s'applique pas? Qu'adviendrait-il d'AREVA (qui a remplacé le fautif COGEMA) si ils devaient gérer ses déchets toxiques?
Réponse du 05/12/2013,
Réponse apportée par AREVA :
Les stériles miniers sont constitués de sols et roches excavées pour accéder aux zones valorisables ; ils correspondent à des déchets dont le niveau de radioactivité est comparable à celui des TFA.
La dernière mine d'uranium en France a fermé en 2001. Il existe plus de 250 anciens sites miniers en France, tous réaménagés, dont moins de la moitié a été exploitée par AREVA. Néanmoins, la gestion de la totalité de ces anciens sites a été confiée à AREVA.
La gestion de ces sites est régie par la circulaire du 22 juillet 2009 (voir http://www.asn.fr/index.php/Les-actions-de-l-ASN/La-reglementation/Cadre-legislatif/Circulaires-directives-instructions-guides/Circulaire-2009-132-du-22-juillet-2009).
Plus d'une centaine de spécialistes de la santé, de la radioprotection, de la géologie et de l’environnement assurent la surveillance environnementale des 250 anciens sites avec près de 10 000 analyses chaque année.
Les rapports et études réalisés jusqu’à aujourd’hui, et sous le contrôle des autorités, n’ont jamais relevé de problème sanitaire ou environnemental entraînant une remise en cause de la méthode de réaménagement des sites et de leur surveillance.
Le réaménagement et le suivi environnemental des anciennes mines sont effectués suivant une méthodologie rigoureuse, dans le respect de la réglementation en vigueur et font l’objet de contrôles réguliers des autorités (DREAL, IRSN et ASN).
AREVA entretient depuis longtemps des relations régulières avec les élus locaux, les associations locales et les riverains, dans une démarche de dialogue permanent.
QUESTION 292
Posée par Alain CORREA, le 25/07/2013
Et le stockage dans le synroc aux USA?
QUESTION 291
Posée par J-F RENARD, le 24/07/2013
Le stockage de combustibles usés doit-il donner lieu à une enquête publique spécifique?
Réponse du 04/10/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La nature et les quantités de déchets autorisés pour un stockage dans Cigéo seront fixées par le décret d’autorisation de création du centre. Toute évolution notable de cet inventaire devra faire l’objet d’un nouveau processus d’autorisation, comprenant notamment une enquête publique et un nouveau décret d’autorisation. Le stockage de combustibles usés constituerait une telle évolution. En effet, dans le cadre de la politique énergétique actuelle en France, les combustibles usés issus de la production électronucléaire ne sont pas considérés comme des déchets mais comme des matières pouvant être valorisées, notamment dans les réacteurs de quatrième génération. A ce titre, ils ne sont aujourd’hui pas destinés à être stockés dans Cigéo.
QUESTION 290
Posée par MIAUX, le 24/07/2013
L'enfouissement des déchets que vous dîtes "pérenne" ne permet-il pas de limiter l'augmentation du coût de l'éléctricité?
Réponse du 27/11/2013,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Le choix du stockage géologique réversible a été acté par la loi du 28 juin 2006, car c’est la solution qui est reconnue comme la plus sûre pour la gestion à long terme des déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue. Ce choix a été fait après un programme de quinze années d’études et recherches encadrée par la loi « Bataille » de 1991, un débat public en 2005-2006 et des avis des évaluateurs sur cette recherche. Il est conforté au niveau international par la directive européenne du 19 juillet 2011 qui considère que « il est communément admis que sur le plan technique, le stockage en couche géologique profonde constitue, actuellement, la solution la plus sûre et la plus durable en tant qu’étape finale de la gestion des déchets de haute activité et du combustible usé considéré comme déchet. »
En application du principe « pollueur-payeur » et conformément au Code de l’environnement, il revient dès lors aux producteurs de déchets radioactifs (EDF, AREVA, CEA) de financer le futur stockage géologique de leurs déchets. Pour cela, ils doivent constituer dès aujourd’hui des provisions qu’ils couvrent par des actifs dédiés, pour pouvoir disposer des sommes nécessaires le moment venu.
Réponse apportée par Edf :
Le stockage des déchets radioactifs de moyenne activité à vie longue et de haute activité a été décidé par la loi de juin 2006. Conformément à cette même loi, EDF anticipe le financement du stockage de ses déchets radioactifs en intégrant ces coûts futurs dans les coûts de production actuels, et donc dans les prix actuels de l'électricité. EDF constitue ainsi des provisions financières, sous forme de placements dédiés sécurisés, placés sous le contrôle du Parlement. Au 31/12/2012, 7,1 milliards d'euros étaient déjà provisionnés dans les comptes d'EDF. Ce dispositif financier permet de garantir que les sommes nécessaires à la réalisation du stockage seront bien disponibles le moment venu et de ne pas faire peser cette charge sur les générations futures.
QUESTION 289
Posée par Pascal MALLET, le 24/07/2013
Comment peut-on porter crédit à des organismes officiels qui se sont complètement décrédibilisés dans un nombre considérable de scandales?
Réponse du 04/10/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Pour pouvoir vous répondre, merci de préciser de quels scandales vous parlez.
QUESTION 288
Posée par Sylvine DESPRIS, le 24/07/2013
Faut-il comprendre que la France traite aujourd'hui ses déchets radioactifs de façon écologique en réduisant considérablement les volumes et en valorisant au maximum les éléments nobles (uranium et plutonium)?
Réponse du 27/11/2013,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Il est précisé dans la loi n°2006 –739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs que la réduction de la quantité et de la nocivité des déchets radioactifs doit être recherchée notamment par le traitement des combustibles usés et le traitement et le conditionnement des déchets radioactifs.
Le Conseil de politique nucléaire du 28 septembre 2012 présidé par le Président de la République a confirmé la stratégie de retraitement des combustibles usés et le réemploi dans les réacteurs français des matières fissiles extraites sous forme de combustibles MOX.
Réponse apportée par AREVA :
Tous les acteurs de la filière nucléaire française déploient des efforts conséquents pour réduire la génération de ces déchets au niveau le plus bas qu’il est possible d’atteindre dans les conditions technico-économiques du moment.
L’une des activités principales d’AREVA est précisément de développer et de mettre en œuvre des solutions permettant de réduire le volume de ces déchets et leur nocivité, pour son propre compte comme pour le compte des autres acteurs de la filière. Le traitement-recyclage est l’une de ces solutions.
AREVA contribue au travers du recyclage des combustibles usés issus du parc nucléaire français à la mise en œuvre d’une solution de gestion sûre des déchets radioactifs sur le long terme. Notre groupe mène une politique de gestion optimisée et responsable de ses propres déchets.
Le recyclage, comparé au stockage direct du combustible usé, permet de réduire significativement le volume de déchets ultimes et leur toxicité radiologique. Par ailleurs, les déchets ultimes conditionnés à l’issue du recyclage ne comportent de matières fissiles qu’à l’état de traces.
Le plutonium et l’uranium issus du traitement du combustible usé sont valorisables. Ils permettent la fabrication d’assemblages combustibles au plutonium (MOX) ou à l’uranium de recyclage (URE).
La politique de recyclage permet une diminution importante de l’emprise au sol de Cigéo. En outre, elle a un impact positif en matière d’économie de ressources naturelles, de développement industriel, d’avance technologique et soutient donc l’économie française. Cette politique est conforme aux orientations définies par le législateur visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets radioactifs.
Pour en savoir plus voir le cahier d’acteur d’AREVA sur le recyclage – cahier d’acteur n°10 : ../informer/cahier-acteurs.html
QUESTION 287 - Quatre questions
Posée par Jacques DELOUVRIER, RETRAITÉ (CASSAGNE, FRANCE), le 10/09/2013
J’ai eu l’honneur de participer à un certain nombre de mesures et d’études sur le site de la Vienne et de la Meuse/Haute Marne, et je suis intimement persuadé de la qualité de votre dossier. Toutefois, je me permets de vous demander des éclaircissements sur les thèmes suivants, avant d’émettre un avis définitif. Thème 1 J’ai compris que vous considérez que le site des argiles du Callovo-Oxfordien est optimal : ceci en particulier parce que des isotopes comme l’iode 129 et le chlore 36 auraient des radioactivités minimes après 100.000 ans de migration, ce qui pourraient les amener à être en contact avec des aquifères. Je suppose que des études de diffusivité pour ces deux produits ont été menées dans le laboratoire souterrain de Bure.
• Quelle a été la durée de ces études ?
• Quelle est le degré d’incertitude que l’on a sur l’extrapolation à 100.000 ans des résultats, par des logiciels adaptés ?
• Pourriez-vous me faire parvenir les publications pertinentes sur ces deux points ? Thème 2 J’ai compris que les habitants de la région étaient protégés pour au moins 100.000 ans. Mais que fait-on de l’oubli ? Comment garantir aujourd’hui qu’un « pétrolier ou autre stupide » ne viendra pas forer un puits juste à l’endroit du stockage ?
• Quelles sont les précautions prises concernant ce thème ?
• Pourriez-vous me faire parvenir les publications pertinentes sur ce point ? Thème 3 On « disait », à l’époque où j’étais impliqué dans l’étude du site de Bure, que des études analogiques, faites sur des bateaux ayant sombré il y a fort longtemps, avaient montré que les canons en cuivre de ces bateaux avaient remarquablement résisté à la corrosion par l’eau de mer.
• Pourquoi n’a-t-on pas choisi ce métal pour l’enveloppe des containers ? Thème 4 Le maintien en état opérationnel du laboratoire actuel de Bure, pendant la durée prévue des 100 ans d’observation du stockage définitif, est certainement une sécurité supplémentaire pour l’expérimentation en cas de problèmes sur le stockage lui-même. C’est aussi un moyen de tranquilliser l’opinion publique…
• Ce maintien en état opérationnel est-il prévu ?
• Si non, quelles alternatives ont été choisies pour l’expérimentation corrective à l’échelle de 100 ans ?
Merci d’avance.
Réponse du 17/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Concernant le premier thème abordé
L’Andra a mené de très nombreuses mesures de diffusion d’éléments en solution, notamment de type anions solubles et non sorbés comme le Chlore et l’Iode, sur échantillons carottés issus de forages et in situ au Laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne. Les mesures du coefficient de diffusion et de la porosité accessible à la diffusion ont été obtenues suivant des protocoles expérimentaux rigoureux, notamment quant à la durée pertinente des expériences. Plusieurs centaines de mesures de la diffusion des espèces en solution ont ainsi été acquises et couvrent en verticale toute l’épaisseur du Callovo-Oxfordien et en horizontale la zone de transposition. Toutes ces mesures donnent le même résultat :
- les valeurs du coefficient de diffusion sont faibles,
- les faibles différences entre les valeurs du coefficient de diffusion (moins d’un facteur 2) et de la porosité accessible à la diffusion des anions (moins de 10 %) couvrent à la fois la variabilité naturelle (faible) de ces paramètres dans la couche du Callovo-Oxfordien et l’incertitude des mesures. En outre, ces données expérimentales sont confirmées par l’analyse des profils de concentration de traceurs naturels dans le Callovo-Oxfordien, qui permet aussi de valider les conditions de transferts des solutés sur les échelles de temps géologiques.
Les valeurs de diffusion obtenues sont celles retenues dans les calculs de transfert de l’Iode 129 et du Chlore 36 dans le Callovo-Oxfordien depuis le stockage. Les codes de calcul utilisés par l’Andra font l’objet d’une validation numérique et d’une inter-comparaison afin de s’assurer de la qualité numérique des résultats.
La pertinence de l’analyse de la migration de l’Iode 129 et du Chlore 36 depuis le stockage dans la couche du Callovo-Oxfordien et des temps de transfert correspondants calculés repose donc sur l’association des travaux expérimentaux et des travaux de simulation numérique menés suivant une démarche scientifique rigoureuse.
Références :
Descostes, M., Blin, V., Bazer-Bachi, F., Meier, P., Grenut, B., Radwan, J., Schlegel M.L., Buschaert S., Coelho D. & Tevissen, E. (2008). Diffusion of anionic species in Callovo-Oxfordian argillites and Oxfordian limestones (Meuse/Haute–Marne, France). Applied Geochemistry, 23(4), 655-677.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883292707003174
Dewonck, S., Blin, V., Radwan, J., Filippi, M., Landesman, C., & Ribet, S. (2010). Long term in situ tracer diffusion tests in the Callovo-Oxfordian clay: Results and modeling. In Clays in Natural & Engineered Barriers for Radioactive Waste Confinement 4th International Meeting in March
http://www.nantes2010.com/doc/abstracts/data/pdf/629_630_P_MT_DIF_16.pdf
Gimmi, T., Leupin, O. X., Eikenberg, J., Glaus, M. A., Van Loon, L. R., Niklaus Waber, H., & Wittebroodt, C. (2014). Anisotropic diffusion at the field scale in a four-year multi-tracer diffusion and retention experiment–I: Insights from the experimental data. Geochimica et Cosmochimica Acta.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001670371300570X
Concernant le deuxième thème abordé
L’objectif fondamental de Cigéo est de protéger l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets radioactifs sur de très longues échelles de temps. La sûreté à long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage.
En cas de perte complète de la mémoire du stockage, une intrusion inopinée à 500 mètres sous terre apparaît peu plausible, du moins sans un minimum d’investigations préalables. L’Andra évalue cependant par précaution dans son analyse de sûreté les conséquences d’intrusions par des forages éventuels au travers du stockage. Les situations considérées font l’hypothèse de l’abandon d’un ou plusieurs forages (doublet de forages). Les situations étudiées sont pénalisantes car elles considèrent ces forages pérennes sur plusieurs centaines d’années et traversant un ouvrage du stockage. L’évaluation de sûreté du Dossier 2005 a permis de vérifier que le stockage resterait sûr (voir Dossier 2005 - Tome Evaluation de Sûreté du stockage géologique §7.4 pp567 à 634).
Malgré cette robustesse du stockage même en cas d’oubli, l’Andra conçoit Cigéo avec l’objectif d’en conserver la mémoire et de la transmettre aux générations futures le plus longtemps possible. Des solutions d’archivage de long terme existent pour les centres de stockage de surface exploités par l’Andra et font l’objet de revues périodiques. Le retour d’expérience montre que ces solutions paraissent robustes pour au moins les 500 premières années. Ainsi, pour Cigéo, l’Andra prévoit qu’un centre de la mémoire perdurera sur le site. Il pourra accueillir le public et comprendra notamment les archives du Centre.
De manière générale, le maintien de la mémoire doit aussi impliquer les acteurs locaux, qui peuvent prendre le relai en cas de défaillance de l’Andra ou de l’État. L’Andra veille d’ores et déjà à les informer sur les enjeux associés à la mémoire et étudie avec des anthropologues, des philosophes ou encore des artistes les facteurs qui peuvent favoriser la transmission de la mémoire. La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
L’Andra a lancé en 2010 un programme d’études pour proposer des outils qui rendent cette transmission plus robuste sur une échelle de temps millénaire. Des pistes se dessinent tels des marqueurs de surface, mais aussi des rendez-vous réguliers à mettre en place au niveau des populations locales.
En tout état de cause, comme il est impossible de garantir notre capacité à communiquer avec des êtres vivant dans plusieurs milliers d’années, c’est chaque génération qui aura la responsabilité de contribuer à transmettre cette mémoire aux générations suivantes.
Concernant le troisième thème abordé
L’Andra a retenu l’acier non ou faiblement allié pour constituer l’enveloppe des conteneurs de stockage pour les déchets de haute activité (HA). Ces aciers bénéficient d’un large retour d’expérience industriel ainsi que d’une codification et d’une normalisation des techniques d’élaboration et de contrôle, dont l’emploi garantit que les propriétés physiques (mécaniques, dimensionnelles, métallurgiques..) des objets réalisés sont reproductibles et constantes. La connaissance de sa corrosion généralisée, mécanisme dominant à moyen et long terme, permet d’évaluer l'épaisseur de métal corrodée en fonction du temps. Le conteneur en acier épais (65 mm) étudié par l’Andra permet d’empêcher l’arrivée d’eau sur le verre nucléaire pendant plusieurs centaines d’années au moins, le temps nécessaire pour que la température ait suffisamment baissé pour que l’arrivée d’eau de l’argilite au contact du déchet vitrifié n’induise pas de phénomène non maîtrisé conformément aux exigences de sûreté. Les déchets HA les plus exothermiques ne seront pas stockés avant l’horizon 2075 compte tenu du délai nécessaire à leur décroissance thermique (hormis certains déchets HA moyennement exothermiques qui seraient stockés à partir de 2025 dans une zone pilote si Cigéo est autorisé). Cela permet de laisser ouverte la possibilité d’étudier d’autres matériaux dans le futur. Des actions prospectives sont ainsi prévues dans le programme de R&D de l’Andra sur ce sujet.
Concernant le quatrième thème abordé
Les expérimentations menées au Laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne ont permis de qualifier in situ les propriétés de la roche argileuse, d’étudier les perturbations qui seraient induites par la réalisation d’un stockage (effets du creusement, de la ventilation, de la chaleur apportée par certains déchets…), de mettre au point des méthodes d’observation et de surveillance et de tester les procédés de réalisation qui pourraient être utilisés si Cigéo est mis en œuvre. L’étape suivante sera d’acquérir des informations complémentaires lors de la réalisation des premiers ouvrages de stockage. L’autorisation d’exploiter le Laboratoire a été prolongée jusqu’en 2030 pour accompagner la phase de démarrage du stockage et poursuivre les observations sur la durée. Sur certains ouvrages, on disposera ainsi d’un retour d’expérience de plus de 20 ans avant le démarrage de l’exploitation des premiers ouvrages de Cigéo. A l’horizon 2030, il conviendra d’examiner l’intérêt de poursuivre ces observations de longue durée en prolongeant l’exploitation du Laboratoire, en parallèle de Cigéo.
QUESTION 286
Posée par Gaston LEBOEUF, le 24/07/2013
l'ANDRA n'a pas répondu, combien va coûter CIGEO?
Réponse du 04/10/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La dernière évaluation du coût du stockage validée par le ministère en charge de l’énergie date de 2005. Le coût du stockage avait été estimé entre 13,5 et 16,5 milliards d’euros, répartis sur une centaine d’années. Cette évaluation couvrait notamment le stockage de tous les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue produits par les réacteurs nucléaires français pendant 40 ans. Une nouvelle évaluation est en cours par l’Andra, pour intégrer les pistes d'optimisation et les nouveautés en termes de solutions techniques, de sécurité et de dimensionnement.
La Cour des comptes a réalisé une analyse des enjeux associés à ces différents points dans son rapport public thématique portant sur « Les coûts de la filière électronucléaire » (janvier 2012) disponible sur le site du débat : ../docs/docs-complementaires/docs-avis-autorites-controle-evaluations/rapport-thematique-filiere-electronucleaire.pdf
QUESTION 285
Posée par Bernard PONS, le 24/07/2013
Quelle est la probabilité que les déchets arrivent dans 100.000 ans sans détruire la planète?
Réponse du 18/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Si un jour la société n’était plus en mesure de s’occuper des déchets radioactifs, ce qu’on ne peut exclure à l’horizon de plusieurs milliers d’années, ceux-ci pourraient être à l’origine de dommages inacceptables pour l’homme et l’environnement.
Le stockage profond permet de se prémunir contre ce risque.
L’objectif fondamental de Cigéo est de protéger l’homme et l’environnement sur le très long terme (plusieurs centaines de milliers d’années) sans nécessiter d’intervention humaine. Il est situé à 500 mètres de profondeur, dans une couche argileuse très peu perméable, ce qui permet de mettre les déchets à l’abri et de les isoler des activités humaines et des évènements naturels de surface, assez longtemps pour que la radioactivité diminue suffisamment afin de ne plus représenter de risque.
QUESTION 284 - date limite cahier d'acteur
Posée par Marie Claire RICHARD, L'organisme que vous représentez (option) (CHAUMONT), le 07/09/2013
la fin du débat public étant repoussée de 2 mois, la date limite pour déposer un cahier d'acteur est elle repoussée d'autant(15 /12:2013 au lieu de 15/10)
Réponse du 10/10/2013,
La date limite de dépot d'un cahier d'acteurs est effectivement repoussée. Si vous souhaitez réaliser un cahier d'acteurs, la Commission vous invite toutefois à le transmettre quelques semaines avant la clôture du débat car le processus de maquettage, validation de votre part, impression peut nécessiter deux-trois semaines.
QUESTION 283
Posée par Bernard LENAIL, le 24/07/2013
J'ai compris qu'il y avait une question sur le dimensionnement du projet. N'est-ce pas normal sauf à prévoir une enveloppe très grande? Et donc très couteuse car trop majorante?
Réponse du 05/12/2013,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
Le stockage est conçu pour accueillir tous les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue produits par les installations nucléaires françaises actuelles jusqu’à leur démantèlement ainsi que les déchets produits par les installations qui sont aujourd’hui arrêtées (Brennilis, Bugey, Chinon, Saint-Laurent, Superphénix…).
Par précaution, des volumes supplémentaires (environ 20 % du volume de déchets MA-VL à stocker) sont prévus en réserve dans Cigéo pour certains déchets de faible activité à vie longue qui, le cas échéant, ne pourraient pas être stockés dans le stockage à faible profondeur à l’étude par l’Andra.
Si Cigéo est autorisé, le stockage sera construit de manière progressive, au fur et à mesure des besoins. L’évaluation du coût du stockage correspond ainsi à des dépenses réparties pendant plus de 100 ans.
L’Andra conçoit l’architecture du projet Cigéo de façon à ce qu’elle soit flexible pour pouvoir s’adapter à des évolutions de la politique énergétique française. Le projet serait par exemple compatible avec le stockage direct de combustibles usés non traités si ces matières étaient un jour requalifiées en déchets radioactifs. Cette décision n’aurait toutefois pas d’incidence sur l’exploitation du stockage avant l’horizon 2070/2080.
Pour plus d’information sur les hypothèses retenues pour le dimensionnement de Cigéo, vous pouvez consulter le dossier du maître d’ouvrage (chapitre 1.5 – Les volumes de déchets prévus dans Cigéo) : ../docs/dmo/chapitres/DMO-Andra-chapitre-1.pdf
QUESTION 282
Posée par Bernard LENAIL, le 24/07/2013
Pourquoi les opposants au nulcéaires refusent-ils de participer au débat et viennent-ils ensuite empêcher un débat prévu par la loi? Sommes-nous en démocratie?
Réponse du 13/09/2013,
La Commission du débat public vous invite à adresser votre question aux intéressés, lesquels ont souvent des sites internet ou des blogs qui permettent de les contacter.Pour sa part la Commission du débat public a mis en place, a travers l'internet notamment (debats contradictoires, questions reponses) les moyens de developper l'information et la participation du public, en dépit du bliocage des reunions publiques.
QUESTION 281 - Réunion du 10 septembre
Posée par Sonia MARMOTTANT, L'organisme que vous représentez (option) (ST-MARTIN-D'HÈRES), le 06/09/2013
Lorsque j'ai consulté le site il y a deux mois, il était prévu une réunion le 10 septembre non loin de Bugey. Il n'y en a plus trace sur le site. Est-elle annulée ? Entre "réunions de proximité" réservées aux habitants d'un canton, et forum internet, ce débat si important ne sera donc que confidentiel et virtuel. Courage, fuyons ! La démocratie attendra.
Réponse du 31/10/2013,
Des réunions publiques ont été reportées voire annulées du fait de leur blocage par les opposants au débat public. Ces blocages sont un constat.
Les réunions de proximité sont un moyen de consulter la population en allant à la rencontre des gens au plus près, notamment pous échanger avec ceux qui seraient dans l'incapacité de se déplacer sur une réunion publique, de venir à la permanence de la Cpdp ou d'utiliser les outils numériques d'information et d'expression.
Ces réunions sont annoncées par différents moyens, de niveau communal, cantonal mais aussi département (journal Est Républicain) et elles sont bien sûr ouvertes à tous.
Enfin, la Commission fait en sorte de donner toute la visibilité possible à ce débat public :
• par la presse écrite, radio, télévisuelle, numérique, locale et nationale
• par la distribution de documents d'information sur le débat dans toutes les boites aux lettres de la Meuse, de la Haute-Marne et du nord des Vosges aux mois de mai et de septembre 2013
• par un site internet vivant : questions, avis, abonnement gratuit, contributions, cahiers d'acteurs, forum, réseaux sociaux ...
• par l'organisation de débats retransmis sur internet ou en audio et permettant aux auditeurs d'interpeller directement le maître d'ouvrage et les experts indépendants
• par la permanence à Bar-le-Duc ouverte à tous
QUESTION 280
Posée par Michel GUERITTE, le 24/07/2013
Si l'ANDRA fait un tri des colis MA-VL pour éviter ceux qui rejettent trop de H2, qu'en ferez-vous? Un entreposage en surface? Un entreposage prérenne est donc concevable et acceptable !
Réponse du 27/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Certains déchets de moyenne activité à vie longue (MA-VL), notamment ceux contenant des composés organiques, dégagent de l'hydrogène non radioactif produit par radiolyse. La majorité des colis de déchets MA-VL destinés à Cigéo dégagent peu d’hydrogène (moins de 3 litres par an et par colis), voire pas du tout. Au-delà d’une certaine quantité et en présence d’oxygène, cet hydrogène peut présenter un risque d’explosion. Pour maîtriser ce risque, l’Andra fixe une limite stricte aux quantités d’hydrogène émises par chaque colis, qui fera l’objet de contrôles.
La production d’hydrogène est directement liée au mode de conditionnement des déchets. Aussi il est possible de maîtriser celle-ci au travers des procédés de conditionnement. Par ailleurs, dans la mesure où la production d’hydrogène décroît avec le temps, pour la plupart des déchets, notamment les plus anciens, leur durée d’entreposage suffit à réduire largement la production d’hydrogène. En tout état de cause, l’Andra refusera tout colis qui présenterait des caractéristiques rédhibitoires pour la sûreté du stockage. Le cas échéant, un nouveau conditionnement devra être réalisé par le producteur du déchet pour respecter les exigences de sûreté de Cigéo.
QUESTION 279
Posée par Michel GUERITTE, le 24/07/2013
Dans le processus décisonnel de CIGEO, je constate que ce n'est pas le Parlement (Chambre des députés et Sénat) qui débattront et voteront la décision de faire ou de ne pas CIGEO. C'est un simple décret du premier ministre qui autorisera la contruction de ce projet aussi flou que fou. Ce processus est-il valable? Est-il en accord avec nos lois? Avec les lois européennes? Avec notre constitution?
Réponse du 18/11/2013,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Si elle est décidée, l’autorisation de création de Cigéo sera donnée par décret en Conseil d’État après une procédure spécifique incluant notamment le vote par le Parlement d’une loi fixant les conditions de réversibilité du stockage. Ce mécanisme d’autorisation a été défini par le Parlement dans la loi 2006-739 relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs (article 12 aujourd’hui codifié à l’article L.542-10-1du code de l’environnement).
QUESTION 278
Posée par Damien GIRARD, le 24/07/2013
La connaissance des déchets radioactifs produit par le Commissariat à l'énergie atomique sont classés secret défense, l'Autorité de la Sécurité Nucléaire n'a pas de compétence dans ce domaine. Alors que le centre de Soulaine ne devait accepter que des déchets de 300 ans de demi vie, aujourd'hui c'est plus de 30kg de plutonium qui est enfoui en Champagne. Pouvons-nous donc dire qu'il y a eu tromperie?
Réponse du 20/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Il n’y a jamais eu tromperie sur le Centre de stockage de l’Aube. Toutes les informations relatives aux déchets stockés sur le Centre sont rendues publiques et disponibles, en particulier dans l’Inventaire national des matières et des déchets radioactifs. En accord avec les règles de sûreté émises par l’Autorité de sûreté nucléaire, le stockage a été conçu et autorisé dès l’origine afin de pouvoir accueillir une certaine quantité de radionucléides à vie longue, tels que le plutonium, sans que cela ne remette en cause sa sûreté. La présence de radionucléides à vie longue dans les colis reçus reste limitée et l’ensemble des colis fait l’objet de contrôles pour vérifier que les limites imposées par l’Andra sont respectées. Les installations du CEA sont soumises aux mêmes exigences de la part de l’Andra que tous les producteurs de déchets radioactifs. Les nombreuses mesures effectuées chaque année dans le cadre de la surveillance du stockage montrent que l’impact du stockage reste largement inférieur aux limites réglementaires et à l’impact de la radioactivité naturelle.
Réponse apportée par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) :
De par ses activités civiles de recherche ou les activités liées à la Défense nationale, le CEA génère des déchets radioactifs qu’il traite et conditionne dans des colis. Ces colis sont entreposés sur ses sites, et expédiés vers les sites de stockages de surface opérés par l’Andra lorsqu’ils sont compatibles avec les critères d’acceptation définies par le stockeur et validés par l’ASN . Comme tous les déchets et les matières radioactifs produits en France, ils sont recensés annuellement par l’Andra qui met à jour et publie tous les trois ans un Inventaire national. La dernière édition, datant de juillet 2012, est disponible sur le site internet de l’Andra. Ces déchets sont bien soumis aux réglementations et aux autorisations des Autorités de sûreté nucléaire : Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ou Autorité de sûreté nucléaire de défense (ASND). Depuis 2001, un délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense (DSND) a été institué auprès du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie.
QUESTION 277
Posée par Damien GIRARD, le 24/07/2013
Comment pouvons-nous prédire l'avenir sur déjà 120 ans de ventilations des galeries (72h de pannes = catastrophe mondiale) en sachant que les pays ne sont pas stables (dernièrement, Sarkosy voulait vendre des centrales nucléaires à Kadafy, Pompidou au Cha d'Iran) et que les évènements climatiques (tornade localisée, innondation en 1999, la centrale du Bugey avait failli + le personnel + les infrastructures routières) ?
Réponse du 18/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Une panne de ventilation de 72h dans le stockage ne conduirait absolument pas à une catastrophe mondiale.
Les études montrent que, dans le pire des cas, à moins d’une panne de ventilation qui durerait plus d’une dizaine de jour, la concentration en hydrogène dans les alvéoles ne dépassera pas la limite d’explosivité. Au vu du retour d’expérience industriel et minier, ce laps de temps est suffisant pour mettre en place une ventilation de secours. Par précaution, les conséquences d’une éventuelle explosion sont tout de même évaluées afin d’envisager tous les scénarios possibles : les résultats montrent qu’une telle explosion serait de faible ampleur et n’entrainerait qu’un léger endommagement des colis concernés sans perte de confinement des substances radioactive qu’ils contiennent.
En tout état de cause, la question de la gestion de la ventilation n’est pas spécifique à Cigéo : une ventilation des colis de déchets produisant de l’hydrogène est nécessaire, aussi bien en stockage que dans les entrepôts dans lesquels ces déchets sont provisoirement entreposés aujourd’hui.
QUESTION 276
Posée par Damien GIRARD, le 24/07/2013
Le projet est orienté uniquement dans les départements Meuse/Haute-Marne (département fortement en décroissance). Pourquoi ne pas l'avoir baptisé Champagne/Lorraine? Est-ce à cause du vin mondialement connu qui pourrait être mis en concordance entre champagne et nucléaire que ce nom n'a pas été retenu? (les départements vont être appelés à disparaître au profit des régions)
Réponse du 05/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Ce sont les départements de Meuse et de Haute-Marne qui se sont portés candidats pour l’implantation d’un laboratoire souterrain suite au vote de la loi de 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, d’où le nom du projet (Centre industriel de stockage réversible profond de déchets radioactifs en Meuse/Haute-Marne). Les autres collectivités, que ce soient les communes, les intercommunalités ou les régions sont bien entendu également concernées par le projet.
QUESTION 275
Posée par , le 24/07/2013
Quelles sont les recherches menées par le CEA pour valoriser les déchets ultimes déjà produits?
Réponse du 27/11/2013,
Réponse apportée par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) :
Les recherches menées par le CEA et ses partenaires dans le domaine des déchets radioactifs s’inscrivent dans une démarche de progrès continu, avec un objectif confirmé dans la loi de 2006 sur la gestion durable des matières et des déchets, à savoir : « la réduction de la quantité et de la nocivité des déchets radioactifs est recherchée ».
Aujourd’hui, la France retraite les combustibles usés issus de ses centrales nucléaires. Il s’agit d’extraire et de réutiliser toutes les matières valorisables (uranium et plutonium), ce qui permet déjà de répondre en partie à cet objectif et de valoriser une grande partie des combustibles usés. La partie restante, ce qu’on appelle les déchets ultimes, est vitrifiée et entreposée dans l’attente d’un site de stockage définitif.
Si le verre a été choisi comme matrice pour ces déchets ultimes constitués d’éléments radioactifs à vie longue, c’est justement pour ses propriétés de confinement, c’est-à-dire son aptitude à les incorporer et à les immobiliser durablement. L’ensemble des études menées par le CEA a prouvé la très bonne résistance de la matrice vitreuse à l’altération sur des temps très longs. De ce fait, il n’est à ce jour pas envisagé de récupérer les radioéléments une fois vitrifiés.
Dans ce contexte, les recherches du CEA visent à aller plus loin dans la démarche de valorisation des combustibles usés :
- Le premier objectif vise à aller jusqu’au bout du recyclage du plutonium issu des combustible usés, afin de valoriser au maximum tout le potentiel énergétique. Ces recherches sont menées en lien avec les recherches sur les systèmes nucléaires de 4ème génération, dits à neutrons rapides, capables d’effectuer ce multi recyclage du plutonium. En effet, aujourd’hui, les réacteurs à eau du parc actuel permettent de recycler une fois ce plutonium sous forme de combustible MOX (pour oxyde mixte d’uranium et de plutonium) ; des réacteurs à neutrons rapides permettraient de multi-recycler le plutonium issu des combustible MOX usés de façon récurrente, permettant ainsi de tirer le plein parti de cette ressource énergétique.
- Sur le plus long terme, le CEA mène des études pour réduire le volume et la radiotoxicité des déchets ultimes. L’idée est d’isoler les éléments les plus radiotoxiques des déchets actuels puis de les transformer en les transmutant en d’autres éléments moins radiotoxiques et à vie plus courte. C’est la séparation-transmutation. Ces recherches sont aussi menées par le CEA en synergie avec celles menées sur les réacteurs nucléaires à neutrons rapides de 4ème génération, seuls capables de réaliser la transmutation. Elles ont fait l’objet d’un rapport remis au gouvernement en décembre 2012 et disponible à tout public sur le site internet http://www.cea.fr/. La séparation transmutation pourrait ainsi permettre une réduction supplémentaire du volume et de la radiotoxicité à long terme des déchets, mais ne supprimera jamais complètement la radioactivité des déchets ni la nécessité d’un stockage en couche géologique profonde. Comme indiqué plus haut, elle ne concerne pas les déchets actuels déjà vitrifiés et conditionnés.
Plus de renseignements : Les rapports de recherche - Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) - Dossier 2012 – Tome 2 – Séparation-transmutation des éléments radioactifs à vie longue ../informer/documents-complementaires/rapports-autorites-evaluations-ponctuelles.html
QUESTION 274
Posée par , le 24/07/2013
Pourquoi un "entreposage" à 500m de fond serait-il moins sûr que l'entreposage en surface? (argument des opposants au projet qui veulent laisser les déchets à la surface)
Réponse du 18/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
En France, toute installation nucléaire répond à des exigences de sûreté contrôlées par l’Autorité de sûreté nucléaire. Ainsi, quelle que soit sa situation, en surface ou en profondeur, une installation gérant des déchets radioactifs doit garantir le confinement de la radioactivité contenue dans les déchets. Cette garantie doit être apportée y compris en situation accidentelle. Par exemple, des mesures renforcées sont prises vis-à-vis du risque incendie pour une installation souterraine. En France comme à l’étranger, le stockage profond est privilégié car une installation située à 500 mètres de profondeur offre la possibilité de mettre en sécurité les déchets radioactifs sur le très long terme contrairement à un entreposage en surface. De plus une installation souterraine est par nature moins vulnérable aux agressions externes (conditions météorologiques extrêmes, chute d’avion, actes de malveillance…) qu’une installation située en surface.
QUESTION 273
Posée par Bernard LENAIL, le 24/07/2013
J'ai lu les conclusions de la CNE2 de septembre 2012. Après de telles conclusions, que reste-il à débattre juste demander des explications et écouter? Suis-je normal ou bon pour l'asile?
Réponse du 13/09/2013,
Les conclusions de CNE2 soulignent un certain nombre de points sur lesquels l'Andra doit apporter des réponses complémentaires.
De la même manière, des autorités de contrôle et d'évaluation tels que l'ASN, l'IRSN ou le Groupe des experts indépendants demandent au maître d'ouvrage de préciser son projet avant de formaliser une demande d'autorisation.
QUESTION 272
Posée par , le 24/07/2013
Attendre un peu pourquoi? Quelles sont les perspectives pour gérer ces déchets à 5 ans ou 10 ans?
Réponse du 18/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
On peut toujours remettre à demain ce que l’on pourrait commencer à faire aujourd’hui. Mais nos enfants pourraient nous reprocher de ne pas avoir préparé de solution pour gérer les déchets les plus radioactifs produits par les activités dont nous bénéficions au quotidien.
Cigéo n’étant pas encore autorisé, la seule perspective d’ici 5 à 10 ans pour gérer ces déchets est leur entreposage provisoire sur leur site de production.
Si Cigéo est autorisé, une alternative sera offerte aux générations suivantes d’ici une quinzaine d’années pour commencer à mettre en sécurité définitive les déchets radioactifs. Le stockage profond est aujourd’hui la seule solution robuste pour mettre en sécurité ces déchets à très long terme. Le stockage est prévu pour être réversible pendant au moins cent ans. Cela permettra aux générations suivantes de faire évoluer cette solution si elles le souhaitent, notamment dans l’hypothèse où des progrès scientifiques et technologiques offriraient de nouvelles possibilités.
QUESTION 270
Posée par Damien GIRARD, le 24/07/2013
J'habite à 20km de Reims en Champagne près d'un centre d'expérimentation nucléaire. Depuis 55 ans, les élus et les habitants ont fait confiance au Commissariat à l'Energie Atomique. Aujourd'hui, nous venons d'apprendre que le taux de radioactivité dans la nappe phréatique a augmenté considérablement (3.000%). Comment allez-vous maintenant nous démontrer qu'il n'y a plus de risque si ce n'est en reconnaissant les erreurs passées?
Réponse du 17/12/2013,
Réponse apportée par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) :
Dans le cadre de ses activités, le CEA a mené des expérimentations qui ont mis en œuvre de l’uranium. A ce titre, il mène un programme de surveillance qui permet d’en évaluer l’impact sur l’environnement. Ce programme est basé sur les prescriptions réglementaires et est validé par l’autorité de sûreté.
Le marquage en uranium de la nappe à l’aplomb du site est déclaré dans la base nationale de données BASOL relative aux sites et sols pollués.
Le suivi de la nappe, réalisé dans le cadre de la surveillance au titre de cette déclaration BASOL, est effectué au moyen de piézomètres (forages instrumentés permettant d’accéder à la nappe et d’effectuer des prélèvements). Les mesures sont effectuées en période de hautes et basses eaux (mars et octobre) afin de prendre en compte la cinétique de la nappe.
Les valeurs maximales relevées se situent à un facteur 3 en dessous de la recommandation de l’organisation mondiale de la santé (OMS) relative à l’eau destinée à la consommation humaine, et fixée à 30 microgrammes par litre d’eau.
QUESTION 269
Posée par Jean-Philippe BRETTE, le 24/07/2013
Vu que le démantèlement a prouvé aux USA sa faisabilité, et vu la robustesse des EPR, le devenir des déchets est-il la denirère condition pour légitimer le nucléaire comme réelle opportunité de production nettement plus propre pour sortir des énergies fossiles de façon réaliste? Le statut quo réclamé par les verts sert-il à temporiser la transition énergétique?
Réponse du 27/11/2013,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Depuis plusieurs dizaines d’années, la France a mis en place une politique de gestion responsable de ses déchets radioactifs. En 2006, après quinze années de recherches encadrées par la loi « Bataille », d’avis des évaluateurs et d’un débat public, le Parlement a fait le choix du stockage réversible profond pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations futures.
En matière de transition énergétique, le Président de la République a fixé le cap suivant pour le mix électrique français : réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% d'ici 2025. Parallèlement, le Président de la République a indiqué que la transition énergétique serait fondée sur deux principes : l'efficacité énergique d'une part, et la priorité donnée aux énergies renouvelables d'autre part. Cette mutation prendra du temps et supposera des étapes d’évaluation en fonction des progrès technologiques et scientifiques et des prix relatifs de chaque source d’énergie.
QUESTION 268
Posée par Huguette MARECHAL, le 24/07/2013
Comment protégez-vous les employés et les riverains des rayonnemnts ionisants polluant l'environnement sur plusieurs dizaines de mètres de large le long des voies ferrées, des routes, sur les aires de repos, lors des transports des déchets radioactifs?
Réponse du 27/11/2013,
Réponse apportée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) :
La sûreté des transports de substances radioactives à usage civil est contrôlée en France par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), sur la base d’inspections et de l’instruction de demandes d’agrément d’emballages. Ce contrôle vise à assurer la protection des personnes et de l’environnement. Il porte sur la conception des emballages et les opérations de transports qui sont soumises à des contraintes réglementaires rigoureuses.
Les emballages doivent notamment assurer un confinement des substances radioactives transportées et fortement réduire le rayonnement à l’extérieur du colis.
De façon plus spécifique, le débit de dose à proximité du véhicule ne doit pas dépasser certains plafonds. En pratique, les niveaux relevés sont en général beaucoup plus faibles que ces plafonds. Même si ces plafonds étaient atteints, une personne devrait rester 10 heures à deux mètres du véhicule pour que le rayonnement reçu atteigne la limite annuelle d’exposition du public.
Réponse apportée par Areva :
Dans le cadre du débat public, AREVA propose un cahier d’acteurs dédié aux transports de déchets : ../_script/ntsp-document-file_download.php?document_id=24&document_file_id=24
QUESTION 267
Posée par Jean-Marc CONVERS, le 24/07/2013
A propos "d'où viennent les déchets"?
Je ne pense pas me tromper en affirmant que la production d'électricité atomique est le fournisseur principal? Dans ce cas, n'est-ce pas simple d'arrêter d'en produire? Quelle technique préferez-vous pour cela?
A la Japonaise : suite au stress test Grandeur Nature, tous les réacteurs (sauf 2 temporairement) sont arrêtés en 1 an.
A l'Allemande : suite à des choix politiques, la sortie est engagée, les premiers réacteurs s'arrêtent, 350.000 emplois sont crées dans les économies d'énergie et les renouvelables, et sous la pression de la population, même la droite confirme cette sortie.
Réponse du 27/11/2013,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
L’énergie nucléaire constitue en effet la première source de production de déchets radioactifs.
En France, le nucléaire occupe une place prépondérante dans le mix électrique, assurant près de 75% de la production française d’électricité. Compte tenu de la durée nécessaire à la construction de moyens de production d’électricité de substitution, un arrêt à court terme de l’ensemble du parc nucléaire n’est pas envisageable sans remettre en cause l’approvisionnement électrique du pays, c’est à dire sans coupures très importantes d’électricité pour les consommateurs. Il apparaît donc extrêmement difficile de ne plus produire de nouveaux déchets radioactifs provenant de l’industrie électronucléaire à très court terme.
En matière de mix électrique, le Président de la République a fixé le cap suivant pour la France : réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% d'ici 2025. Parallèlement, le Président de la République a indiqué que la transition énergétique serait fondée sur deux principes : l'efficacité énergique d'une part, et la priorité donnée aux énergies renouvelables d'autre part. Cette mutation prendra du temps et supposera des étapes d’évaluation en fonction des progrès technologiques et scientifiques et des prix relatifs de chaque source d’énergie.
QUESTION 266
Posée par Philippe MIAUX, le 24/07/2013
Au point où on en est, les tremblements de terre étant encore imprévisibles, pourquoi ne pas étudier l'envoi des déchets non peu ou très radioactifs dans l'espace en garantissant un non-retour sur terre avant 24.400 ans?
Réponse du 04/10/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le scénario d’un envoi dans l’espace des déchets radioactifs a été étudié. La NASA notamment s’est penchée sur cette question dès la fin des années 70. Ce scénario n’a pas été retenu en raison du risque d’explosion de l’engin spatial au décollage ou en vol (1 accident sur 100 lancements en moyenne), qui provoquerait des retombées de poussières radioactives et contaminerait l’atmosphère. Qui plus est, les volumes de déchets concernés (80 000 m3 pour les déchets HA et MAVL destinés à Cigéo) nécessiteraient plusieurs dizaines de milliers de lancements, ce qui représenterait un coût très élevé pour la société (un seul lancement d’Ariane 5 coûte environ 150 millions d’euros). Envoyer des déchets radioactifs dans l’espace n’est donc pas réalisable en l’état actuel des technologies.
Le stockage profond a en revanche été retenu, car il s’agit, aujourd’hui, de la seule solution qui permette une mise en sécurité définitive et en toute sûreté des déchets les plus radioactifs. S’il est autorisé, sa mise en œuvre permettra de ne pas reporter la charge de la gestion de ces déchets sur les générations futures.
Enfin, les zones à risques sismiques sont connues de même que l’ordre de grandeur de l’intensité des tremblements de terre qui peuvent s’y produire. Ce qui n’est pas prévisible aujourd’hui, c’est le moment de leur déclenchement. La zone étudiée en Meuse/Haute-Marne pour le projet Cigéo est une zone géologique caractérisée par une très faible sismicité. Ce risque est pris en compte pour dimensionner les ouvrages du stockage.
QUESTION 265
Posée par Justin FRANCOIS, le 24/07/2013
Les suédois ne sont-ils pas en train de stocker des produits radioactifs nucléaires en profondeur?
Réponse du 04/10/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La Suède a engagé une démarche similaire à la démarche de la France. L’Agence suédoise en charge de la gestion des déchets radioactifs a déposé en 2010 une demande d’autorisation de création d’un centre de stockage profond de ses déchets de haute activité (combustibles usés de ses centrales nucléaires), en s’appuyant sur les recherches et expérimentations menées notamment dans le laboratoire souterrain d'Äspö, à 450 mètres de profondeur dans le granite.
Si le projet est autorisé, la construction du stockage des déchets radioactifs pourrait débuter à partir de 2020 pour un début d’exploitation en 2025.
QUESTION 264 - Pourquoi enfouir plutôt que stocker en surface?
Posée par Denise WEISBECKER, L'organisme que vous représentez (option), le 23/07/2013
En matière de nucléaire, seule la question de maitrise totale des événements liés à la sécurité doit prévaloir; la décision d'enfouir est elle LA réponse à un problème de sécurité par rapport au stockage en surface? Le stockage souterrain est il sûr à 100% pour les centaines d'années (milliers?) à venir? Si la réponse est non, la décision est criminelle
Réponse du 05/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les déchets radioactifs destinés à Cigéo sont des déchets dangereux, qui le resteront plusieurs dizaines à centaines de milliers d’années. Le seul et unique objectif du stockage profond est de protéger l’homme et l’environnement de ces déchets sur de très longues durées.
Ces déchets, produits depuis les années 1960, sont actuellement entreposés de manière sûre mais provisoire dans des bâtiments sur leurs sites de production, dans l’attente d’une solution de gestion à long terme. Ces installations d’entreposage ne sont pas conçues pour confiner la radioactivité à très long terme. En cas de perte de contrôle de telles installations, les conséquences radiologiques sur l’homme et l’environnement ne seraient pas acceptables.
La sûreté est au cœur du projet Cigéo. L’ensemble des risques est caractérisé et l’installation est dimensionnée en conséquence pour garantir une sûreté maximale. L’Andra doit démontrer qu’elle maîtrise tous ces risques pour que la création de Cigéo puisse être autorisée. Par ailleurs, si Cigéo est autorisé, sa construction se fera de manière très progressive pour contrôler toutes les étapes de son développement. Tout ceci se fait sous le contrôle d’évaluateurs scientifiques et de sûreté indépendants, notamment la Commission nationale d’évaluation et l’Autorité de sûreté nucléaire qui orientent les travaux de l’Andra. Les avis des évaluateurs sont disponibles sur le site du débat public : ../informer/documents-complementaires/avis-autorites-controle-et-evaluations-permanentes.html
QUESTION 263
Posée par Anne-Marie BERARD, le 23/07/2013
Doit-on récupérer nos déchets stockés dans des conditions inimaginables en Russie?
Réponse du 20/12/2013,
Réponse apportée par Edf :
Edf n'entrepose ni ne stocke aucun déchet radioactif à l'étranger. Un documentaire diffusé en 2009 à la télévision (Arte) a présenté à tort comme des déchets nucléaires des stocks d'uranium appauvri, propriété d'un industriel russe qui a effectué des opérations d'enrichissement d'uranium pour le compte d'EDF. En effet, l'uranium appauvri issu des opérations d'enrichissement reste toujours la propriété de l'industriel ayant effectué l'opération, qui en assure la gestion. L'enrichissement est l'une des étapes du processus de fabrication du combustible nucléaire. Elle produit d'une part de l'uranium enrichi, qui sera utilisé dans les centrales nucléaires actuelles, d'autre part de l'uranium appauvri, matière valorisable qui est stockée dans l'attente d'une future utilisation dans les réacteurs nucléaires de génération 4, à l'étude dans différents pays, dont la France et la Russie, et dont le déploiement industriel est envisagé dans la 2ème moitié du 21ème siècle. EDF confie les opérations d'enrichissement à différents fournisseurs, en France ou en Europe.
Il faut noter que le Haut Comité à la Transparence et à l’Information sur la Sûreté Nucléaire (HCTISN), saisi par le Ministre de l’Ecologie, a publié en 2010 un « Avis sur la transparence de la gestion des matières et des déchets nucléaires produits aux différents stades du cycle du combustible » qui précise "qu’une partie des matières issues du cycle du combustible ne font pas aujourd’hui effectivement l’objet d’une valorisation. Elles sont entreposées dans cette éventualité. Il s’agit cependant d’une perspective crédible grâce aux réacteurs de 4ème génération qui pourraient entrer en service à partir de 2040 (si les conditions techniques, économiques et politiques restent réunies)".
En 2012, une délégation du HCTISN s’est rendue en Russie, a visité les installations d’enrichissement, et conclu que "La Russie possède une vision stratégique claire de l’avenir de son industrie nucléaire. Ainsi, l’objectif de moyen terme affiché est un cycle du combustible nucléaire « fermé » grâce au développement d’un parc commercial de réacteurs à neutrons rapides intégrant les dernières avancées en matière de sûreté, fondé sur une expérience déjà longue et conséquente dans la filière sodium, et exportable à l'international. L’uranium appauvri entreposé en Russie (dont celui issu de l’uranium de retraitement français) fait partie intégrante de cette stratégie, en tant qu’une ressource future".
QUESTION 262
Posée par NOWAK, le 23/07/2013
Le minimum de sécurité à assurer pour ce site est de 15.000 ans. Comment allez-vous faire pour avoir un pouvoir politique qui sera capable d'assurer la sécurité de ce site pendant cette période?
Réponse du 30/09/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
C’est justement parce que les déchets destinés à Cigéo resteront dangereux plusieurs dizaines de milliers d’années et au-delà et parce que l’on ne peut pas garantir de stabilité sociale sur de telles durées, que le stockage profond a été retenu pour mettre en sécurité les déchets les plus radioactifs.
En effet, le principe du stockage profond est que sa sûreté à long terme ne repose pas sur des actions humaines, notamment sur une surveillance du site pendant 15 000 ans, mais sur le milieu géologique. Après la fermeture du stockage, la sûreté sera assurée de manière passive et ne nécessitera aucune action humaine. Une surveillance du site pourra néanmoins être maintenue aussi longtemps que les générations futures le souhaiteront et des actions seront menées pour conserver et transmettre sa mémoire.
QUESTION 261
Posée par Fréderic THORE, le 23/07/2013
N'y a-t-il pas plus à craindre de l'évolution des hommes que de la géologie? Quand on voit l'évolution de la société au cours des 200 dernières années, ses guerres, son influence sur l'évolution de la planète, comment être serein?
Réponse du 30/09/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La société et la géologie ont chacune leur rôle à jouer pour permettre une gestion sûre des déchets radioactifs. A l’échelle de quelques dizaines d’années, la société doit être en capacité d’assurer une gestion active des déchets radioactifs qu’elle produit. Au-delà de quelques centaines d’années, la pérennité d’un contrôle institutionnel ne peut être garantie. Compte tenu de la durée pendant laquelle les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue resteront dangereux (plusieurs centaines de milliers d’années), seul le stockage profond, qui assure le confinement de la radioactivité de manière passive grâce au milieu géologique, est à même de garantir la protection de l’homme et de l’environnement à très long terme.
QUESTION 260
Posée par Justin FRANCOIS, le 23/07/2013
Dans 100.000 ans, la période des produits radioactifs aura conduit à une radioactivité résiduelle proche de la radioactivité naturelle. L'opposant y a-t-il pensé?
Réponse du 30/09/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Du fait du niveau de radioactivité des déchets et de leur durée de vie, ceux-ci resteront dangereux pendant plusieurs centaines de milliers d’années. Le stockage permet de protéger l’homme et l’environnement sur de telles échelles de temps. Les études menées par l’Andra ont ainsi montré, qu’une fois fermé, Cigéo n’aura pas d’impact avant 100 000 ans et que celui-ci sera largement inférieur à l’impact de la radioactivité naturelle, comme vous l’indiquez.
QUESTION 259
Posée par Marc THIERRY, le 23/07/2013
Quand on visite le labo de Bure, l'ANDRA offre de l'argile dans des petits sachets. Si on le met dans l'eau, elle se dissout en 5min. S'il y a des infiltrations, quels dangers pour les déchets? Merci
Réponse du 05/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le phénomène de délitement d’un échantillon d’argile placé dans un verre d’eau est connu de tous. En visitant le Laboratoire, vous avez pu constater qu’il ne peut être transposé aussi simplement à un massif de roche d’argile de 130 mètres d’épaisseur à 500 mètres de profondeur : la roche argileuse est solide alors qu’elle contient environ 10% d’eau.
Compte tenu de son volume très important, le massif argileux ne pourrait se déliter en présence de venues d’eau externes que de façon très localisée. Dans Cigéo, les parois des galeries seront recouvertes d’un soutènement en béton qui protège la roche, avec des caniveaux pour drainer les éventuelles venues d’eau vers des points de collecte. La roche sera à nu uniquement au niveau des fronts de creusement.
De nombreuses mesures seront prises pour prévenir d’éventuelles arrivées d’eau accidentelles dans Cigéo :
- Protection des puits et de la descenderie contre les intempéries,
- Étanchéification des puits et des descenderies au niveau des couches de roche aquifères traversées au-dessus de la couche d’argilite,
- Systèmes de drainage des eaux issues des couches de roche supérieures peu productives et pompage de ces eaux jusqu’à la surface,
- Protection des canalisations d’eau interne et mécanismes de fermeture automatique en cas de rupture.
Ces dispositions sont largement éprouvées dans l’industrie minière.
Par précaution, des scénarios accidentels d’arrivées d’eau (par exemple suite à la défaillance d’une canalisation ou suite à une panne dans le système de drainage des eaux provenant des couches de roche supérieures) sont pris en compte dans les études de sûreté menées pour Cigéo, au même titre que pour n’importe quelle installation nucléaire. Compte tenu des origines possibles, ce débit sera nécessairement limité (pour mémoire le débit drainé par chacun des puits du Laboratoire souterrain est de l’ordre de 10 m3/jour en moyenne, ou moins, ce qui est très faible par comparaison à certains sites miniers). Un tel évènement resterait très localisé dans le stockage et n’aurait qu’un effet très limité sur l’argile qui sera protégée par les revêtements. En tout état de cause, ce type d’incident ne remettra pas en cause la sûreté du stockage.
QUESTION 258
Posée par Philippe MIAUX, le 23/07/2013
Si nos centrales nucléaires sont si sûres, pourquoi, après leur arrêt, ne pas y remettre leurs déchets?
Réponse du 04/10/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Contrairement au stockage profond, les centrales nucléaires ne sont en aucun cas conçues pour confiner la radioactivité pendant plusieurs centaines de milliers d’années.
S’il est autorisé, Cigéo sera implanté dans une couche d’argile très peu perméable dont les propriétés permettent d’assurer le confinement de la radioactivité sur de très longues échelles de temps. Sa profondeur permet de mettre les déchets radioactifs à l’abri des activités humaines et des événements naturels de surface (comme l’érosion) et d’isoler les déchets de l’homme et de l’environnement à très long terme.
QUESTION 257
Posée par Justin FRANCOIS, le 23/07/2013
L'entreposage des combustibles usés pour une réutilisation dans un siècle ne parait-il pas irréaliste?
Réponse du 20/12/2013,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Certains combustibles usés (MOX et URE) sont actuellement entreposés de façon sûre dans l’attente de leur utilisation ultérieure dans les réacteurs de 4ème génération. Les recherches sur la quatrième génération, génération qui permettrait de tirer parti complètement de tout le potentiel énergétique contenu dans l’uranium naturel, sont actuellement encadrées par les deux lois suivantes.
La loi de programme n°2005-781 du 13 juillet 2005 fixe les orientations de la politique énergétique, en particulier conserver le rôle de premier plan de la France dans le domaine de l’énergie nucléaire notamment en développant les technologies des réacteurs nucléaires du futur.
La loi de programme n°2006-739 du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs précise que des recherches doivent être poursuivies sur la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue, en relation avec celles menées sur les nouvelles générations de réacteurs nucléaires afin de disposer en 2012 d'une évaluation des perspectives industrielles de ces filières et de mettre en exploitation un prototype d'installation à l’horizon 2020. L’évaluation de 2012 est disponible sur le site www.cea.fr/energie/rapport-sur-la-gestion-durable-des-matieres-nucl-106009.
Ces recherches, conduites par le CEA, sont axées très fortement sur la filière des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium (RNR-sodium), filière qui est apparue la mieux placée pour être retenue pour la construction d'un démonstrateur industriel ASTRID*.
Au cas où cette filière venait à ne pas être déployée, les combustibles MOX et URE seraient alors considérés comme des déchets. Le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie a demandé à l’Andra d’étudier à titre de précaution la faisabilité du stockage de ces combustibles usés dans Cigéo.
*« Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration » : Réacteur à neutrons rapides refroidi au sodium de 4ème génération à vocation de démonstration technologique et industrielle.
Réponse apportée par Edf :
Dans l'objectif de réduire le volume de déchets radioactifs ultimes, et d'économiser les ressources en uranium naturel, EDF pratique le traitement de ses combustibles usés. La matière énergétique encore disponible dans le combustible usé peut ainsi être recyclée pour la fabrication de nouveaux assemblages combustibles (Mixed OXyde (Plutonium) et Uranium Retraité), utilisables dans les réacteurs actuels pour produire de l'électricité.
Ces assemblages de combustibles retraités, une fois usés, sont entreposés à l'usine Areva de La Hague, dans des installations d'une durée de vie supérieure au siècle, dans l'attente de leur traitement pour une réutilisation ultérieure dans des réacteurs de génération 4 (GEN 4), qui pourront les utiliser plus efficacement que les réacteurs actuellement en fonctionnement.
Les réacteurs de génération 4 sont à l'étude dans de nombreux pays (France, Russie, Inde, Chine, Japon) qui coordonnent leurs recherches, et leur déploiement industriel est envisagé dans la seconde moitié du 21ème siècle. En France, le CEA prévoit de réaliser un démonstrateur industriel de Génération 4 (projet Astrid) à horizon 2025.
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La nécessité de stocker des combustibles usés dépendra de la politique énergétique qui sera mise en œuvre par la France dans le futur.
Dans le cadre de la politique énergétique actuelle en France, les combustibles usés issus de la production électronucléaire ne sont pas considérés comme des déchets mais comme des matières pouvant être valorisées, notamment dans les réacteurs de quatrième génération. A ce titre, ils ne sont pas destinés à être stockés dans Cigéo. Seuls les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue, issus du traitement de combustibles usés, sont destinés à Cigéo.
Dans l’hypothèse où les combustibles usés devraient être stockés directement, après refroidissement, ils pourraient être stockés dans Cigéo, qui a été conçu pour être flexible afin de pouvoir s’adapter à d’éventuels changements de la politique énergétique et à ses conséquences sur la nature et les volumes de déchets qui devront alors être stockés. A la demande du Ministère en charge de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, l’Andra, EDF et Areva ont étudié l’impact des différents scénarios établis dans le cadre du débat national sur la transition énergétique sur la production de déchets radioactifs et sur le projet Cigéo : ../docs/rapport-etude/20130705-courrier-ministere-ecologie.pdf
La faisabilité de principe et la sûreté du stockage profond des combustibles usés ont par ailleurs été démontrées par l’Andra en 2005. Dans le cadre du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, l’État a demandé à l’Andra de vérifier par précaution que les concepts de stockage de Cigéo restent compatibles avec l’hypothèse d’un stockage direct de combustibles usés si ceux-ci étaient un jour considérés comme des déchets. L’Andra a remis fin 2012 un rapport d’étape. Dans l’hypothèse d’un stockage direct des combustibles usés, compte tenu du temps nécessaire de refroidissement, comme pour l’essentiel des déchets HA, leur stockage n’interviendrait pas avant l’horizon 2070/2080.
La nature et les quantités de déchets autorisés pour un stockage dans Cigéo seront fixées par le décret d’autorisation de création du centre. Toute évolution notable de cet inventaire devra faire l’objet d’un nouveau processus d’autorisation, comprenant notamment une enquête publique et un nouveau décret d’autorisation.
QUESTION 256
Posée par Bernard LENAIL, le 23/07/2013
Vu les performances de CIGEO, est-il raisonnable de penser que le site sera réservé aux déchets nucléaires (comme des déchets dangereux issus par exple du démentèlement des panneaux solaires qui contienne des produits dangereux) ?
Réponse du 30/09/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Cigéo a été conçu pour stocker les déchets les plus radioactifs, qui ne peuvent être stockés en surface ou à faible profondeur pour des raisons de sûreté. C’est leur haut niveau de radioactivité qui impose de développer une installation à 500 mètres de profondeur avec des moyens techniques spécifiques. Cette solution n’est donc pas adaptée pour d’autres types de déchets qui ne justifient la mise en œuvre de moyens aussi importants pour leur mise en sécurité.
QUESTION 255
Posée par Philippe MIAUX, le 23/07/2013
Pouvez-vous nous parler des conséquences autour des mines d'uranium françaises?
Réponse du 18/11/2013,
Réponse apportée par AREVA :
La dernière mine d'uranium en France a fermé en 2001. Il existe plus de 250 anciens sites miniers en France, tous réaménagés, dont moins de la moitié a été exploitée par AREVA. Néanmoins, la gestion de la totalité de ces anciens sites a été confiée à AREVA. La gestion de ces sites est régie par la circulaire du 22 juillet 2009.
Plus d'une centaine de spécialistes de la santé, de la radioprotection, de la géologie et de l’environnement assurent la surveillance environnementale des 250 anciens sites avec près de 10 000 analyses chaque année.
Les rapports et études réalisés jusqu’à aujourd’hui, et sous le contrôle des autorités, n’ont jamais relevé de problème sanitaire ou environnemental entraînant une remise en cause de la méthode de réaménagement des sites et de leur surveillance. Ces informations sont publiques et peuvent être consultées auprès des Directions Régionales de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement (DREAL), sur simple demande.
Le réaménagement et le suivi environnemental des anciennes mines sont effectués suivant une méthodologie rigoureuse, dans le respect de la réglementation en vigueur et font l’objet de contrôles réguliers des autorités (DREAL, IRSN et ASN).
QUESTION 254
Posée par François DUFAU, le 23/07/2013
Mon père a fait la résistance et c'est à ce titre que j'écris ces mots, en cas de conflits durs et violents des types du genre des SS qui brulaient nos villages en tuant femmes et enfant n'hésiteront pas à faire de ce site souterrain de Bure un vestige radiocatif à coups de grenades incendiaires de napalm (etc) se serait la politique de la terre brule radioactive ???
Lors d'une émission de "c'est pas sorcier" sur antenne 2 le dimanche matin de la fête des mères il y a + ou - 3 ans, ils ont parlé de ces sarchophage en acier dans lequel on coule le verre radioactif.. résultat, au bout de 400 ans, début de l'oxydation à 4 000 si je me souviens le métal a disparu or le contenant est isotopiquement radioactif pendant des centaines de milliers d'années. Supposons maintenant que nous soyons un peuple comme les egyptiens mais avec des poubelles nucléaires, l'obélisque serait peut-être radioactif ?
Réponse du 18/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les déchets radioactifs sont actuellement entreposés sur leurs sites de production, dans des bâtiments en surface. Si Cigéo est autorisé, ces déchets seront placés à 500 mètres de profondeur et seront donc peu accessibles. Le confinement de la radioactivité à très long terme sera assuré par la couche d’argile. Cigéo permettra ainsi de mettre ces déchets en sécurité de manière définitive et de protéger l’homme et l’environnement contre les dangers qu’ils présentent et contre l’évolution incertaine de notre société.
QUESTION 253
Posée par J LERAY, le 23/07/2013
Pourquoi la remise en question de l'enfouissement DEFINITIF (la reversibilité est un leurre, l'ANDRA le dit) n'est-elle pas reposée? Un panel d'experts de l'AIEA a décidé que c'était LA solution, hors ces gens sont juges et partie.
Réponse du 30/09/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
En 2006, après 15 années de recherche et un débat public sur la politique nationale de gestion des déchets radioactifs, le Parlement a fait le choix du stockage profond pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations futures. Cela dit, la décision d’autoriser ou non la création de Cigéo n’est pas encore prise. Elle reviendra à l’État, après l’évaluation par l'Autorité de sûreté nucléaire, la Commission nationale d'évaluation, les collectivités territoriales et l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, du dossier de demande d'autorisation que remettra l'Andra en 2015. L’AIEA n’intervient pas dans ce choix. Elle est une agence internationale sous l’égide de l’ONU, qui a pour but de promouvoir les usages pacifiques de l’énergie nucléaire et à limiter le développement de ses applications militaires. Elle a un rôle de conseil mais n’est pas décisionnaire.
L’objectif même de sûreté étant de confiner les éléments radioactifs sur une très longue échelle de temps sans nécessiter d’intervention humaine, les projets de stockage géologique, en France ou ailleurs, sont conçus pour être fermés au terme de leur exploitation. Pour autant la réversibilité n’est pas un leurre, l’Andra n’a jamais dit cela. Bien au contraire elle conçoit aujourd’hui Cigéo pour répondre à la demande du Parlement, qui a demandé que le stockage soit réversible pendant une période d’au moins cent ans. Les conditions précises de cette réversibilité seront définies par une future loi qui devra être votée avant que le stockage puisse être autorisé.
Le Parlement a également demandé que le stockage soit réversible pendant au moins 100 ans pour laisser la possibilité aux générations suivantes de faire évoluer cette solution si elles le souhaitent.
L’Andra n’a jamais dit que la réversibilité était un leurre ! Au contraire, elle place cette demande de la société au cœur du projet. Elle a ainsi fait des propositions concrètes pour laisser pouvoir récupérer les déchets si besoin et laisser des choix possibles aux générations suivantes.
L’AIEA considère effectivement que le stockage profond permet de mettre en sécurité les déchets radioactifs. Mais cette position est également partagée par l’Union Européenne, dont la directive européenne de juillet 2011 rappelle que le stockage géologique constitue actuellement la solution la plus sûre et la plus durable en tant qu’étape finale de la gestion des déchets de haute activité, et par l’ensemble des pays qui ont à gérer ce type de déchets et qui s’orientent tous vers cette solution.
QUESTION 252
Posée par Gilles BRUNET, le 23/07/2013
Comment allons-nous gérer l'enfouissement des déchets pour les milliers d'années à venir? Comment éviter que les prochaines civilisations ne creusent et fassent réapparaître les déchets enfouis?
Réponse du 13/09/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif fondamental de Cigéo est de protéger l’homme et l’environnement des déchets radioactifs sur de très longues échelles de temps. La sûreté à long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. C’est une des raisons qui a conduit, en 2006, le Parlement à retenir la solution du stockage profond. En effet, cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli, contrairement à l’entreposage. En cas de perte complète de la mémoire du stockage, une intrusion inopinée à 500 mètres sous terre apparaît peu plausible, du moins sans un minimum d’investigations préalables. L’Andra évalue cependant par précaution dans son analyse de sûreté les conséquences d’un forage à travers le stockage pour vérifier que le stockage resterait sûr.
Malgré cette robustesse du stockage même en cas d’oubli, l’Andra conçoit Cigéo avec l’objectif d’en conserver la mémoire et de la transmettre aux générations futures le plus longtemps possible. Des solutions d’archivage de long terme existent pour les centres de stockage de surface exploités par l’Andra et font l’objet de revues périodiques. Le retour d’expérience montre que ces solutions paraissent robustes pour au moins les 500 premières années. Ainsi, pour Cigéo, l’Andra prévoit qu’un centre de la mémoire perdurera sur le site. Il pourra accueillir le public et comprendra notamment les archives du Centre.
De manière générale, le maintien de la mémoire doit aussi impliquer les acteurs locaux, qui peuvent prendre le relai en cas de défaillance de l’Andra ou de l’État. L’Andra veille d’ores et déjà à les informer sur les enjeux associés à la mémoire et étudie avec des anthropologues, des philosophes ou encore des artistes les facteurs qui peuvent favoriser la transmission de la mémoire. La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
L’Andra a lancé en 2010 un programme d’études pour proposer des outils qui rendent cette transmission plus robuste sur une échelle de temps millénaire. Des pistes se dessinent tels des marqueurs de surface, mais aussi des rendez-vous réguliers à mettre en place au niveau des populations locales.
QUESTION 251 - Des réunions pourquoi faire ?
Posée par claude RENARD, L'organisme que vous représentez (option) (FRÉCOURT), le 22/07/2013
Bonjour, Grenoble : le CEA satisfait du démantèlement des installations nucléaires. Mercredi 27 février 2013 . L'ensemble des opérations a généré 8 tonnes de déchets à haute activités ( HA ) envoyés à Saclay et Cadarache en attendant que le Centre industriel de stockage géologique ( CIGEO )prévu à BURE SOIT DISPONIBLE - Le reste = 30 Tonnes ( MA ) -820 tonnes ( FA )+130 tonnes ( FA ) - 25 000 tonnes (TFA ) Je reste à votre disposition sur la ventilation de ces déchets. Pour le" laboratoire" de Bure depuis 1994 il est préférable d'utiliser le mot STOCKAGE ( HA ) Pourquoi des réunions, des conférences....etc.
Réponse du 13/09/2013,
Un débat public est organisé sur le projet de stockage de déchets radioactifs en Meuse/Haute-Marne afin de permettre aux citoyens de s'exprimer sur l'opportunité de réaliser ou non ce stockage et si oui, sur les modalités de sa réalisation.
Le laboratoire de Bure ne peut être qualifié de stockage. A l'heure actuelle, aucun déchet radioactif n'y a jamais été stocké.
QUESTION 250 - gestion
Posée par claude RENARD, L'organisme que vous représentez (option) (FRÉCOURT), le 22/07/2013
Bonjour, CIGEO est-il raccordé à un Ministère ? qui sont ses partenaires (finances) Cordialement cl.Renard
Réponse du 12/09/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’Andra (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs) est un établissement public, placé sous la triple tutelle des ministères en charge de l’énergie, de l’environnement et de la recherche.
Les modalités de financement du projet Cigéo sont définies par la loi du 28 juin 2006 :
▪ Les études et recherches sont financées par une taxe (dite taxe « de recherche ») additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base. Elle est collectée auprès des trois principaux producteurs de déchets : EDF, le CEA et Areva.
▪ La construction, l’exploitation et la fermeture de Cigéo seront également financées par les producteurs de déchets, au travers de conventions avec l’Andra.
La clé de répartition est aujourd’hui de 78 % pour EDF, 17 % pour le CEA et 5 % pour Areva.
QUESTION 249 - Gestion RFID des coques
Posée par ALAIN CORREA, STOP-EPR PENLY (ELBEUF), le 18/07/2013
Bonjour La société POLINORSUD, sous-traitant EDF de niveau 1, sur le site de Paluel (Seine-Maritime - 76), devrait mettre en place pour fin 2013, l’utilisation de « puces RFID » permettant l’identification des coques de déchets (fûts béton armé de 4 tonnes), ainsi que leur contenu précis. A l’heure actuelle, ces coques ne sont identifiées que par 2 étiquettes code-barres, simplement collées. Serait-il possible que l’ANDRA exige l’intégration de ce système d’identification passif auprès du constructeur des coques CDB http://www.socodei.fr/traitement-des-dechets/le-conditionnement-sur-site/conditionnement-site2/ sensiblement plus fiable et performant qu’une simple étiquette papier ? Ce système est déjà utilisé sur le site de Gravelines. D’autre part, actuellement, les exploitants (EDF) conservent tous les documents papiers relatifs aux déchets (hors combustible) sur leur site pendant 10 ans. Au-delà, l’ANDRA doit les récupérer et les stocker sur le site de Bure avec microfilmage, pendant une durée de 300 ans. Vous confirmez ? Merci.
Réponse du 03/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Concernant votre question sur le dispositif d’identification des colis de déchets
Le dispositif actuel mis en œuvre pour identifier les colis de déchets sur leur site de production dispose d’un large retour d’expérience. Ce dispositif éprouvé présente l’avantage d’être fiable, robuste et peu onéreux. L’utilisation de puces RFID pour identifier les colis de déchets fait l’objet d’essais sur certains sites producteurs. Pour élargir sa mise en œuvre, il sera nécessaire de vérifier que ce dispositif est adaptable sur l’ensemble des colis de déchets ainsi que sur l’ensemble des installations des producteurs, d’acquérir un retour d’expérience sur sa robustesse et sur son coût. S’il s’avère à l’avenir que ce dispositif est jugé comme la meilleure technologie disponible et éprouvée, il sera mis en place.
Concernant l’archivage
Les producteurs de déchets radioactifs doivent conserver sans limite de durée les informations concernant leurs déchets dans la mesure où ils en restent propriétaires, même après leur stockage dans une installation exploitée par l’Andra. Dans le cadre du projet Cigéo, l’Andra étudie la création d’un bâtiment dédié à la mémoire qui pourra accueillir les archives des producteurs si nécessaire en plus des archives de l’Andra.
La mémoire et en particulier le mode de conservation des informations font l’objet d’un programme de recherches de l’Andra. Dans l’état actuel des technologies, l’Andra a exclu de constituer la mémoire à partir de fichiers numériques ou de microfilms, leur durabilité étant insuffisante. L’Andra privilégie à ce stade une impression des documents à archiver sur du papier dit « permanent », qui respecte des exigences spécifiques de durabilité.
Pour plus d’informations sur la mémoire : http://www.andra.fr/pages/fr/menu1/les-solutions-de-gestion/se-souvenir-19.html
Réponse apportée par EDF :
EDF conserve toute la documentation relative à la production de tous les déchets conditionnés sur ses centrales nucléaires. Cette documentation sera transférée à l'Andra pour qu'elle en assure l'archivage à long terme.
Les techniques d'identification des colis de déchets sont définies conjointement par les producteurs de déchets et l'Andra. Elles évoluent d'un commun accord pour intégrer progressivement les meilleures technologies disponibles.
QUESTION 248 - Réversibilité
Posée par Francis BORDOZ, L'organisme que vous représentez (option) (CLERMONT FERRAND ), le 23/07/2013
La décision d'enfouir est un acte gravissime... sauf si la réversibilité est assurée. Est elle assurée? si oui je voudrais qu'on m'explique comment on fera(it) ? Si non c'est un acte insensé, irresponsable, le pire de tout ce que l'homme peut imaginer.
Réponse du 04/10/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
C’est la responsabilité de notre génération de proposer aux générations suivantes une solution permettant de mettre définitivement en sécurité les déchets les plus radioactifs que nous avons produits depuis plusieurs dizaines d’années. Depuis 1991, le Parlement s’est saisi de cette importante question. Après avoir évalué différentes solutions, le Parlement a retenu en 2006 le stockage profond pour assurer la protection de l’homme et de l’environnement à très long terme.
Il est également important de laisser aux générations suivantes la possibilité de faire évoluer cette solution si elles le souhaitent. C’est pourquoi le Parlement a demandé que le stockage soit réversible pendant au moins 100 ans. Les conditions de réversibilité seront définies par une future loi.
Quelles sont les propositions de l’Andra pour assurer cette réversibilité ? Durant le siècle d’exploitation, l’Andra propose des conditions de réversibilité qui ne compromettent pas la sûreté du stockage et qui sont réalisables sur le plan technique. Ces propositions concernent à la fois la technique et le pilotage du stockage.
1) Pouvoir récupérer les colis de déchets après leur stockage
De nombreuses dispositions techniques sont mises en œuvre pour faciliter une opération éventuelle de retrait de colis du stockage. Ces dispositions prennent en compte le retour d’expérience d’autres installations, en France et à l’étranger. Les colis utilisés pour le stockage des déchets, en béton ou en acier, sont indéformables. Des espaces suffisants sont ménagés entre les colis pour permettre leur retrait. Les tunnels de stockage (alvéoles de stockage) ont un revêtement en béton ou en acier pour éviter les déformations. L’exploitant disposera d’une connaissance précise de l’emplacement de chaque colis et de ses conditions de stockage. Des essais de retrait de colis ont d’ores et déjà été réalisés à l’échelle 1. Des nouveaux tests de retrait seront réalisés dans le stockage avant que la mise en service de Cigéo ne puisse être autorisée, puis pendant toute l’exploitation de Cigéo.
2) Un calendrier de fermeture progressif et révisable dans le temps
Pour assurer la mise en sécurité définitive des déchets radioactifs, le stockage devra être fermé. La conception de Cigéo offre la possibilité d’une fermeture progressive des alvéoles de stockage, des galeries souterraines puis des puits et des descenderies. Chaque étape de fermeture rendra plus complexe le retrait de colis (nécessité de rouvrir l’alvéole et de réinstaller les équipements de manutention) mais permettra d’ajouter des dispositifs de sûreté passive. Compte tenu de leur importance, l’Andra propose que le franchissement de ces étapes fasse l’objet d’une autorisation spécifique. Le Parlement a d’ores et déjà décidé que seule une loi pourrait autoriser la fermeture définitive du stockage.
3) Des rendez-vous réguliers avec l’ensemble des acteurs pour décider ensemble
L’Andra propose que des rendez-vous soient programmés régulièrement avec l’ensemble des acteurs (riverains, collectivités, évaluateurs, État…) pour contrôler le déroulement du stockage et préparer les étapes suivantes. Ces rendez-vous seront alimentés par les résultats des réexamens périodiques de sûreté, fixés au moins tous les 10 ans par l’Autorité de sûreté nucléaire, de la surveillance du stockage et par les progrès scientifiques et technologiques. Le premier de ces rendez-vous pourrait avoir lieu cinq ans après le démarrage du centre.
QUESTION 247
Posée par Roger BERDOLD (LE NEUFOUR), le 17/07/2013
Stockage : est-il réversible?
Réponse du 12/09/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Oui, le Parlement a demandé que le stockage soit réversible pendant au moins 100 ans. En réponse à cette demande, l’Andra propose des conditions de réversibilité, durant le siècle d’exploitation, qui ne compromettent pas la sûreté du stockage et qui sont réalisables sur le plan technique. Ces propositions concernent à la fois la technique et le pilotage du stockage.
1) Pouvoir récupérer les colis de déchets après leur stockage
De nombreuses dispositions techniques sont mises en œuvre pour faciliter une opération éventuelle de retrait de colis du stockage. Ces dispositions prennent en compte le retour d’expérience d’autres installations, en France et à l’étranger. Les colis utilisés pour le stockage des déchets, en béton ou en acier, sont indéformables. Des espaces suffisants sont ménagés entre les colis pour permettre leur retrait. Les tunnels de stockage (alvéoles de stockage) ont un revêtement en béton ou en acier pour éviter les déformations. L’exploitant disposera d’une connaissance précise de l’emplacement de chaque colis et de ses conditions de stockage. Des essais de retrait de colis ont d’ores et déjà été réalisés à l’échelle 1. Des nouveaux tests de retrait seront réalisés dans le stockage avant que la mise en service de Cigéo ne puisse être autorisée, puis pendant toute l’exploitation de Cigéo.
2) Un calendrier de fermeture progressif et révisable dans le temps
Pour assurer la mise en sécurité définitive des déchets radioactifs, le stockage devra être fermé. La conception de Cigéo offre la possibilité d’une fermeture progressive des alvéoles de stockage, des galeries souterraines puis des puits et des descenderies. Chaque étape de fermeture rendra plus complexe le retrait de colis (nécessité de rouvrir l’alvéole et de réinstaller les équipements de manutention) mais permettra d’ajouter des dispositifs de sûreté passive. Compte tenu de leur importance, l’Andra propose que le franchissement de ces étapes fasse l’objet d’une autorisation spécifique. Le Parlement a d’ores et déjà décidé que seule une loi pourrait autoriser la fermeture définitive du stockage.
3) Des rendez-vous réguliers avec l’ensemble des acteurs pour décider ensemble
L’Andra propose que des rendez-vous soient programmés régulièrement avec l’ensemble des acteurs (riverains, collectivités, évaluateurs, État…) pour contrôler le déroulement du stockage et préparer les étapes suivantes. Ces rendez-vous seront alimentés par les résultats des réexamens périodiques de sûreté, fixés au moins tous les 10 ans par l’Autorité de sûreté nucléaire, de la surveillance du stockage et par les progrès scientifiques et technologiques. Le premier de ces rendez-vous pourrait avoir lieu cinq ans après le démarrage du centre.
Les conditions de réversibilité constituent l’un des sujets majeurs à discuter dans le cadre du débat public. Les échanges alimenteront la préparation de la future loi qui fixera les conditions de réversibilité du stockage. Cette loi sera votée avant que la création de Cigéo ne puisse être décidée.
QUESTION 246 - déchets étrangers
Posée par L MATHIEU, L'organisme que vous représentez (option) (BESANÇON), le 16/07/2013
Actuellement, moins de 4% de ce qui sort des centrales nucléaires est réellement recyclé (cf le rapport du HCTISN). Plus de 90% de ce qui sort est classé en matière valorisables sans jamais être valorisées, mais pas en déchets. C'est donc une opération de blanchiment. Pourtant, une grande partie finira en déchets un jour et l'ANDRA devra proposer des solutions. Dommage qu'elle n'en parle pas. En particulier, toutes les matières dites "valorisables" d'origine étrangères peuvent rester sur le territoire français, même si l'on en fait rien. En cas de changement de politique, si ces matières deviennent "déchets", resteront-elles en France ou seront-elles renvoyées ? Si la décision intervient dans quelques décennies, quel pays sera prêt à les accepter ? Dans ce cas, l'ANDRA devra les gérer. Serait-il possible d'avoir un inventaire exhaustif de ses matières dites "valorisables" d'origine étrangères qui, si elles deviennent déchets, devront être prises en charge par l'ANDRA ? Et aussi les solutions qui sont envisagées pour leur gestion ?
Réponse du 10/02/2014,
Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Le Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs prescrit aux propriétaires de matières valorisables les études à mener à titre conservatoire sur les filières possibles de gestion dans le cas où ces matières seraient à l'avenir qualifiées de déchets. Ce plan est mis à jour tous les trois ans par le ministère chargé de l’énergie et par l’Autorité de sûreté nucléaire, en s’appuyant sur les échanges réalisés au sein d’un groupe de travail pluraliste comprenant notamment des associations de protection de l’environnement et des autorités d’évaluation et de contrôle, aux côtés des producteurs et gestionnaires de déchets radioactifs. Ce document et sa synthèse sont consultables sur le site du débat public : ../informer/documents-complementaires/documents-de-planification.html
Certains combustibles usés (MOX et URE) sont actuellement entreposés de façon sûre dans l’attente de leur utilisation ultérieure dans les réacteurs de 4ème génération. Les recherches sur la quatrième génération, génération qui permettrait de tirer parti complètement de tout le potentiel énergétique contenu dans l’uranium naturel, sont actuellement encadrées par les lois n°2005-781 du 13 juillet 2005 et la loi n°2006-739 du 28 juin 2006.
Au cas où cette filière venait à ne pas être déployée, ces combustibles MOX et URE, produits par les réacteurs nucléaires français, seraient alors considérés comme des déchets. Le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie a demandé à l’Andra d’étudier à titre de précaution la faisabilité du stockage de ces combustibles usés dans Cigéo.
Le Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire a publié un rapport qui fait précisément l’état sur le cycle du combustible, y compris les flux de matières en provenance et à destination de l’étranger. Ce rapport, ainsi que l’actualisation annuelle des flux et stocks de matières, est disponible sur le site du Haut Comité : http://www.hctisn.fr/article.php3?id_article=41
En application de l’article L.542-2-1 du code de l’environnement, les combustibles usés ne peuvent être introduits en France qu’à des fins de traitement, de recherche ou de transfert entre états. Cet article précise qu’une introduction à des fins de traitement doit être encadrée par un accord intergouvernemental et que les déchets radioactifs issus après traitement de ces substances ne doivent pas entreposés en France au-delà d'une date fixée par ces accords.
Depuis la loi de 1991, le Parlement a interdit le stockage en France de déchets radioactifs en provenance de l’étranger. Cette interdiction figure aujourd’hui à l’article L. 542-2 du Code de l’environnement. Cette législation est cohérente avec la directive européenne du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre des combustibles usés et des déchets radioactifs, qui réaffirme la responsabilité de chaque État dans la gestion de ses déchets radioactifs.
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La nécessité de stocker des combustibles usés dépendra de la politique énergétique qui sera mise en œuvre par la France dans le futur. Dans le cadre de la politique énergétique actuelle en France, les combustibles usés issus de la production électronucléaire ne sont pas considérés comme des déchets mais comme des matières pouvant être valorisées, notamment dans les réacteurs de quatrième génération. A ce titre, ils ne sont pas destinés à être stockés dans Cigéo. Seuls les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue, issus du traitement de combustibles usés, sont destinés à Cigéo.
Dans l’hypothèse où les combustibles usés devraient être stockés directement, après refroidissement, ils pourraient être stockés dans Cigéo, qui a été conçu pour être flexible afin de pouvoir s’adapter à d’éventuels changements de la politique énergétique et à ses conséquences sur la nature et les volumes de déchets qui devront alors être stockés. A la demande du Ministère en charge de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, l’Andra, EDF et Areva ont étudié l’impact des différents scénarios établis dans le cadre du débat national sur la transition énergétique sur la production de déchets radioactifs et sur le projet Cigéo : ../docs/rapport-etude/20130705-courrier-ministere-ecologie.pdf.
La faisabilité de principe et la sûreté du stockage profond des combustibles usés ont par ailleurs été démontrées par l’Andra en 2005. Dans le cadre du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, l’État a demandé à l’Andra de vérifier par précaution que les concepts de stockage de Cigéo restent compatibles avec l’hypothèse d’un stockage direct de combustibles usés si ceux-ci étaient un jour considérés comme des déchets. L’Andra a remis fin 2012 un rapport d’étape. Dans l’hypothèse d’un stockage direct des combustibles usés, compte tenu du temps nécessaire de refroidissement, comme pour l’essentiel des déchets HA, leur stockage n’interviendrait pas avant l’horizon 2070/2080.
La nature et les quantités de déchets autorisés pour un stockage dans Cigéo seront fixées par le décret d’autorisation de création du centre. Toute évolution notable de cet inventaire devra faire l’objet d’un nouveau processus d’autorisation, comprenant notamment une enquête publique et un nouveau décret d’autorisation.
Ces éléments sont présentés dans le chapitre 1 du dossier de l’Andra support au débat public : ../docs/dmo/chapitres/DMO-Andra-chapitre-1.pdf.
Réponse apportée par AREVA :
Après quelques années d’utilisation en réacteur, le combustible dit « usé » contient environ 95% d’uranium, 1% de plutonium, des produits de fission et d’autres éléments présents en très faible proportion, les actinides mineurs. L’usine AREVA de la Hague permet de traiter ces combustibles en séparant chimiquement les divers composants. Le plutonium et l’uranium issus du traitement du combustible usé sont valorisables. Le reste appelé « déchets ultimes » est conditionné dans la perspective d’un stockage sûr dans Cigéo.
Le plutonium et l’uranium permettent la fabrication d’assemblages combustibles au plutonium (MOX) ou à l’uranium de recyclage (URE). Plus de 5 000 assemblages combustibles MOX ou URE ont déjà été utilisés en France.
Des informations complémentaires sont données dans le cahier d’acteur « Recyclage » AREVA, cf. ../informer/cahier-acteurs.html.
La loi sur la gestion des déchets radioactifs et des matières valorisables du 28 juin 2006 précise qu’un accord intergouvernemental fixe les modalités définies dans tout contrat concernant le traitement des combustibles nucléaires, notamment la date limite d’entreposage sur le territoire français des déchets radioactifs issus après traitement, « les périodes prévisionnelles de réception et de traitement de ces substances et s’il y a lieu les perspectives d’utilisation des matières séparées lors du traitement ».
Conformément à l’article 542-2-1 du Code de l’environnement, AREVA remet chaque année au ministre chargé de l’énergie un rapport comportant l’inventaire des combustibles usés et des déchets radioactifs en provenance de l’étranger ainsi que des matières et des déchets radioactifs qui en sont issus après traitement qu’AREVA détient. Ce rapport est rendu public. Le rapport remis par AREVA pour l’année 2012 est disponible au lien ci-dessous :
http://www.areva.com/activities/liblocal/docs/BG%20aval/Recyclage/La%20hague/Rapport-AREVA-Art-8-2012.pdf
QUESTION 245 - déchets issus d'un accident
Posée par L MATHIEU, L'organisme que vous représentez (option) (BESANÇON), le 16/07/2013
L'accident nucléaire au Japon a généré d'énormes quantités de déchets radioactifs que le pays est bien en peine de gérer. Sachant que l'ASN et l'IRSN ne cessent de répéter qu'un accident nucléaire est possible en France, l'ANDRA a-t-elle sérieusement envisagé cette hypothèse en termes de gestion de déchets ? En cas de fusion du coeur d'un réacteur, quelle quantité de déchets supplémentaires cela engendrerait-il pour cigéo? J'attends une réponse précise et quantitative, pas du blabla lénifiant comme l'ANDRA sait faire.
Réponse du 05/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
En cas d’accident d’une centrale nucléaire, les déchets les plus radioactifs proviendraient de l’enceinte du site accidenté : déchets de haute activité provenant de la récupération des éléments combustibles, certains ayant fondus, déchets de moyenne activité à vie longue, de faible et moyenne activité à vie courte et déchets de très faible activité. L’Andra n’a pas connaissance à ce stade des volumes de déchets issus du site de la centrale accidentée de Fukushima. A Tchernobyl le volume de déchets issus de l’enceinte du site accidenté est d’environ 350 000 m3.
A l’extérieur du site on trouverait essentiellement des déchets de très faible activité. A Fukushima le volume de déchets à gérer à l’extérieur du site est estimé à 30 millions de mètres-cubes (sols, débris végétaux, déchets d’assainissement) ; à Tchernobyl le volume de sols contaminés a été estimé à 15 millions de mètres cubes.
En France, l’Autorité de sûreté nucléaire a mis en place un « Comité directeur pour la gestion de la phase post-accidentelle d'un accident nucléaire » (CODIRPA) en 2005 à la demande du Gouvernement. Il s’intéresse plus particulièrement à la gestion des territoires contaminés en dehors du site d’une installation qui serait accidentée. En 2012, le CODIRPA a publié un guide présentant les principes retenus pour soutenir la gestion post-accidentelle nucléaire. Il s’attache à présenter les principales actions à mettre en œuvre ou à engager dès la sortie de la phase d’urgence ainsi que les lignes directrices pour la gestion des périodes de transition et de long terme y compris la question de la gestion des déchets. L’Andra a participé à ces travaux. Pour plus d’information, vous pouvez accéder à ce guide sur le site de l’ASN à l’adresse suivante : http://www.asn.fr/index.php/Bas-de-page/Sujet-Connexes/Gestion-post-accidentelle/Comite-directeur-gestion-de-phase-post-accidentelle/Elements-de-doctrine-pour-la-gestion-post-accidentelle-d-un-accident-nucleaire-5-octobre-2012
Ce document ne traite que des déchets de très faible et faible activité, qui représenterait le principal flux de déchets à gérer dans une telle situation et qui peuvent être stockés en surface. Les déchets de moyenne activité à vie longue et de haute activité qui seraient produits sur le site accidenté lui-même feraient en priorité l’objet d’une mise en sécurité sur ce site. Leur transfert en stockage profond n’interviendrait que plusieurs années après. Les Japonais estiment ainsi à une quarantaine d’années le temps nécessaire au démantèlement des centrales nucléaires accidentées.
De tels déchets n’ont pas été pris en compte dans le dimensionnement du projet de stockage Cigéo car leur volume et leurs caractéristiques dépendraient du type d’accident. Il est clair qu’un tel accident bouleverserait la stratégie de gestion des déchets radioactifs et les conditions d’exploitation des stockages. Une fois les déchets de la zone accidentée mis en sécurité, il conviendrait de réexaminer le dimensionnement des centres de stockage en fonction des volumes à gérer.
QUESTION 244 - Pouvez-vous exclure qu'il y a des failles dans le périmètre du centre de stockage?
Posée par Pasdeloup ROSENBERG, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 11/07/2013
Pour exclure la possibilité d'infiltrations et mieux comprendre le risque de propagation de radionucléides il est nécessaire d'avoir une parfaite compréhension de la tectonique du site. Je vous prie de bien vouloir présenter les résultats de vos repérages tectoniques et une expertise qui exclut la présence de failles dans le périmètre du centre de stockage.
Réponse du 04/10/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La fracturation et l’évolution tectonique passée dans la région de Meuse/Haute-Marne ont fait l’objet de nombreuses études. Outre les analyses réalisées à partir de données publiées, des acquisitions de données nouvelles ont ainsi été réalisées par l’Andra selon plusieurs méthodes et à différentes échelles :
• cartographies en surface des différentes formations géologiques, complétées par des profils de résistivité électrique recoupant les zones de localisation des principales failles connues
• levés et analyses microtectoniques aux affleurements, en carrières et en tranchées sur failles
• forages géologiques profonds carottés et instrumentés, et notamment forages dirigés pour la reconnaissance d’éventuelles failles sous le site du laboratoire souterrain
• retraitement de profils sismiques pétroliers et réalisation de campagnes d’acquisition de profils sismiques en sismique réflexion haute résolution, investiguant jusqu’au socle
• campagnes sismiques de la surface jusqu’au substratum infra triasique
• observations géologiques et mesures microtectoniques dans les 2 puits d’accès au laboratoire souterrain
• analyses cartographiques, levés et analyses géomorphologiques, pouvant permettre la détection d’éventuels mouvements tectoniques pouvant s’être produits au cours du dernier million d’années
• écoute sismique avec un réseau permanent couvrant la région, permettant la détection et la localisation de séismes de très faibles magnitudes.
L’ensemble de ces travaux a permis d’établir une histoire géologique et tectonique précise de la région, et de construire des modèles géologiques 3D à l’échelle du bassin de Paris, du secteur et du site, avec les failles et les zones fracturées relevées. Ces résultats ont été présentés dans le dossier 2005 de l’Andra (chapitre 3 du tome évolution phénoménologique du stockage géologique http://www.andra.fr/download/site-principal/document/editions/269.pdf) qui a fait l’objet d’une évaluation indépendante par la Commission nationale d’évaluation (CNE) et l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).
Depuis 2005 un levé géologique systématique a été réalisé dans toutes les galeries du Laboratoire souterrain, représentant un cumul de 1.3 km dans les différentes directions en horizontale, ainsi que de tous les forages, verticaux et latéraux, réalisés dans le laboratoire souterrain dans le cadre des expérimentations.
Sur la zone retenue pour des recherches approfondies en vue d’implanter le stockage, Une campagnes sismiques 3D, avec un haut pouvoir de résolution (< 5m), de la surface jusqu’au substratum infra triasique a été réalisée en 2010.
Les résultats de cette campagne de sismique 3D confirment l’absence de failles de rejet supérieur à quelques mètres recoupant la couche argileuse, comme constaté dans le Laboratoire souterrain. La qualité des données sismiques acquises et des marqueurs sismiques a confirmé une remarquable continuité latérale de la couche du Callovo-Oxfordien. Par ailleurs aucune fracture naturelle (non induite par les creusements) n’a été détectée dans les centaines de forages carottés horizontaux et verticaux réalisés dans le Laboratoire souterrain. Les résultats de l’Andra ont fait l’objet d’une évaluation par l’Autorité de sûreté nucléaire avant validation du choix de la zone d’intérêt pour la reconnaissance approfondie (ZIRA : zone de 30 km² étudiée pour l’implantation de l’installation souterraine de Cigéo) par l’État. L’expertise réalisée par l’IRSN sur la campagne de sismique 3D de 2010 est disponible sur http://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_gp/Documents/Dechets/IRSN_Rapport-GP_Cigeo_2013-00001-Tome3.pdf
QUESTION 243 - Qui va surveiller le site pendant les prochains 100.000 ans?
Posée par Pasdeloup ROSENBERG, L'organisme que vous représentez (option) (PARIS), le 11/07/2013
Pour exclure l'accès aux déchets radioactifs le site doit être surveillé. Comment pouvez-vous assurer la surveillance pendant les prochains 100.000 ans?
Réponse du 12/09/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le principe du stockage profond est que sa sûreté à long terme ne repose pas sur des actions humaines, notamment sur une surveillance du site pendant 100 000 ans, mais sur le milieu géologique.
A l’issue de l’exploitation de Cigéo, les déchets radioactifs seront très difficilement accessibles : ils seront situés à 500 mètres de profondeur dans des alvéoles de stockage scellées. Tous les ouvrages souterrains auront été refermés : les galeries d’accès aux alvéoles seront remblayées et scellées, ainsi que les puits et les descenderies qui assurent les liaisons avec la surface.
La surveillance du site pourra néanmoins être maintenue aussi longtemps que les générations futures le souhaiteront et contribuera au maintien de la mémoire du stockage.
QUESTION 242 - Coûts divers
Posée par Philippe MIAUX, L'organisme que vous représentez (option) (BIOT), le 11/07/2013
Je souhaite connaître officiellement les estimations minimum et maximum : 1) du projet, 2) de l'enfouissement complet, 3) de la maintenance en toute sécurité, 4) de la remontée des déchets en cas de problème, dans une galerie (effondrement, glissement, inondation,...) et 5) coûts annexes. Remerciements.
Réponse du 05/12/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La dernière évaluation du coût du stockage validée par le ministère en charge de l’énergie date de 2005. Au stade des études de faisabilité scientifique et technique et selon les hypothèses techniques retenues à ce stade, le coût du stockage avait été estimé officiellement entre 13,5 et 16,5 milliards d’euros, répartis sur une centaine d’années. Les coûts de construction représentaient 27 % de cette estimation, les coûts d’exploitation 41 % (incluant la maintenance et la jouvence) et les coûts annexes 32 % (dont les impôts et assurances).
L’Andra a lancé en 2012 les études de conception industrielle du projet Cigéo. Les données d’entrée du projet liées à l’implantation et à l’inventaire des déchets ont été précisées. L’Andra s’appuie sur des ingénieries spécialisées qui apportent leur retour d’expérience sur d’autres grands projets industriels. Sur cette base, un nouveau chiffrage est en cours d’élaboration par l’Andra. Ce chiffrage sera finalisé en 2014 pour prendre en compte les pistes d’optimisation identifiées en 2013, les recommandations des évaluateurs et pour intégrer les suites du débat public.
Pour plus de renseignements sur l’évaluation des coûts de la gestion des déchets radioactifs, vous pouvez consulter l’analyse de la Cour des comptes dans son rapport public 2012 sur les coûts de la filière électronucléaire (chapitre 3) qui est disponible sur le site du débat public : ../docs/docs-complementaires/docs-avis-autorites-controle-evaluations/rapport-thematique-filiere-electronucleaire.pdf
Concernant votre question relative à la remontée des déchets :
En cas de problème dans une galerie, la priorité sera d’abord de mettre en sécurité l’installation. Une fois la mise en sécurité réalisée, l’exploitant examinera les dispositions à mettre en œuvre pour reprendre l’exploitation normale. Le retrait éventuel de colis de déchets ou leur maintien en stockage pourra être examiné, sans caractère d’urgence. Cette analyse et l’évaluation du coût des opérations dépend des spécificités de chaque situation (nombre de colis concernés, gestion des colis récupérés : remontée en surface, transfert vers une autre alvéole…). Les dispositions techniques retenues pour concevoir Cigéo facilitent le retrait éventuel de colis stockés et donc réduisent le coût de telles opérations par rapport à un stockage où la réversibilité n’aurait pas été prise en compte en amont lors des phases de conception.
Pour plus de renseignements sur la réversibilité de Cigéo : ../docs/rapport-etude/fiche-reversibilite-cigeo.pdf
QUESTION 241 - Gestion des transports de colis de déchets
Posée par François JUSTIN, L'organisme que vous représentez (option) (VILLEBON-SUR-YVETTE), le 11/07/2013
La gestion des transports a-t-elle été simulée en termes d'horaires ( éviter les heures de pointe par exemple ), éviter les zônes fortement peuplées...?
Réponse du 24/10/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les aménagements nécessaires pour la desserte de Cigéo sont étudiés dans le cadre du schéma interdépartemental de développement du territoire. Ce schéma est élaboré sous l’égide du préfet de la Meuse, préfet coordinateur du projet Cigéo, en concertation avec les acteurs locaux.
Dans ce cadre, des études sont menées pour définir les itinéraires à privilégier pour la desserte du site. Des simulations de trafic aux heures de pointe seront réalisées pour dimensionner les infrastructures nécessaires. L’Autorité environnementale a recommandé que ces aménagements soient intégrés dans l’étude d’impact du projet Cigéo.
Par ailleurs, le plan de déplacement d’entreprise de l’Andra visera à développer les possibilités de covoiturage et les transports collectifs.
QUESTION 240 - les combustibles usés
Posée par michel PELTIER, CFE-CGC U.D. HTE MARNE (DONJEUX), le 11/07/2013
Les combustibles usés peuvent-ils être stockés directement par CIGEO ?
Réponse du 02/08/2013,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La nécessité de stocker des combustibles usés dépendra de la politique énergétique qui sera mise en œuvre par la France dans le futur.
Dans le cadre de la politique énergétique actuelle en France, les combustibles usés issus de la production électronucléaire ne sont pas considérés comme des déchets mais comme des matières pouvant être valorisées, notamment dans les réacteurs de quatrième génération. A ce titre, ils ne sont pas destinés à être stockés dans Cigéo. Seuls les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue, issus du traitement de combustibles usés, sont destinés à Cigéo.
Dans l’hypothèse où les combustibles usés devraient être stockés directement, après refroidissement, ils pourraient être stockés dans Cigéo, qui a été conçu pour être flexible afin de pouvoir s’adapter à d’éventuels changements de la politique énergétique et à ses conséquences sur la nature et les volumes de déchets qui devront alors être stockés. A la demande du Ministère en charge de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, l’Andra, EDF et Areva ont étudié l’impact des différents scénarios établis dans le cadre du débat national sur la transition énergétique sur la production de déchets radioactifs et sur le projet Cigéo : ../docs/rapport-etude/20130705-courrier-ministere-ecologie.pdf
La faisabilité de principe et la sûreté du stockage profond des combustibles usés ont par ailleurs été démontrées par l’Andra en 2005. Dans le cadre du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, l’État a demandé à l’Andra de vérifier par précaution que les concepts de stockage de Cigéo restent compatibles avec l’hypothèse d’un stockage direct de combustibles usés si ceux-ci étaient un jour considérés comme des déchets. L’Andra a remis fin 2012 un rapport d’étape. Dans l’hypothèse d’un stockage direct des combustibles usés, compte tenu du temps nécessaire de refroidissement, comme pour l’essentiel des déchets HA, leur stockage n’interviendrait pas avant l’horizon 2070/2080.
La nature et les quantités de déchets autorisés pour un stockage dans Cigéo seront fixées par le décret d’autorisation de création du centre. Toute évolution notable de cet inventaire devra faire l’objet d’un nouveau processus d’autorisation, comprenant notamment une enquête publique et un nouveau décret d’autorisation.
QUESTION 239 - transport des dechets
Posée par mtherese DROUOY, L'organisme que vous représentez (option) (LANGRES), le 11/07/2013
Après l'accident au Canada de transport de carburant et la pollution qui va en résulter, pensez vous le transport de ces déchets monstreux et dangereux, combien de gendarmes aux kms carré et bien d'autres choses.
Réponse du 18/11/2013,
Réponse apportée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) :
Environ 900 000 colis de substances radioactives sont transportés chaque année. 85 % des colis transportés sont destinés aux secteurs de la santé, de l’industrie non-nucléaire ou de la recherche, dits "nucléaire de proximité", dont 30 % environ pour le seul secteur médical. L’industrie nucléaire ne représente qu’environ 15 % du flux annuel de transports de substances radioactives. On estime à environ 11 000 le nombre annuel de transports nécessaires au cycle du combustible, pour 141 000 colis. Le contenu des colis est très divers : leur radioactivité varie sur plus de douze ordres de grandeur, soit de quelques milliers de becquerels pour des colis pharmaceutiques de faible activité à des millions de milliards de becquerels pour des combustibles irradiés. Leur masse varie de quelques kilogrammes à une centaine de tonnes.
Les risques majeurs des transports de substances radioactives sont les suivants :
- le risque d’irradiation externe de personnes dans le cas de la détérioration de la « protection biologique des colis », matériau technique qui permet de réduire le rayonnement au contact du colis ;
- le risque d’inhalation ou d’ingestion de particules radioactives dans le cas de relâchement de substances radioactives ;
- la contamination de l’environnement dans le cas de relâchement de substances radioactives ;
- le démarrage d’une réaction nucléaire en chaîne non contrôlée (risque de « sûreté-criticité») pouvant occasionner une irradiation des personnes, en cas de présence d’eau et de non-maîtrise de la sûreté de substances radioactives fissiles.
La prise en compte de ces risques conduit à devoir maîtriser le comportement des colis pour éviter tout relâchement de matière et détérioration des protections du colis dans le cas :
- d’un incendie ;
- d’un impact mécanique consécutif à un accident de transport ;
- d’une entrée d’eau dans l’emballage (l’eau facilitant les réactions nucléaires en chaîne en présence de substances fissiles) ;
- d’une interaction chimique entre différents constituants du colis ;
- d’un dégagement thermique important des substances transportées, pour éviter la détérioration éventuelle avec la chaleur des matériaux constitutifs du colis.
Cette approche conduit à définir des principes de sûreté pour les transports de substances radioactives :
- la sûreté repose avant tout sur le colis : des épreuves réglementaires et des démonstrations de sûreté sont requises par la réglementation pour démontrer la résistance des colis à des accidents de référence ;
- le niveau d’exigence, notamment concernant la définition des accidents de référence auxquels doivent résister les colis, dépend du niveau de risque présenté par le contenu du colis. Ainsi, les colis qui permettent de transporter les substances les plus dangereuses doivent être conçus de façon à ce que la sûreté soit garantie y compris lors d’accident de transport.
Ces accidents sont représentés par les épreuves suivantes :
- trois épreuves en série (chute de 9 m sur une surface indéformable, chute de 1 m sur un poinçon et incendie totalement enveloppant de 800 °C minimum pendant 30 minutes) ;
- immersion dans l’eau d’une profondeur de 15 m (200 m pour les combustibles irradiés) pendant 8 h.
La sûreté des transports est également fondée sur la fiabilité des opérations de transport qui doivent satisfaire à des exigences réglementaires notamment en matière de radioprotection. L'ASN assure le contrôle de la sûreté des transports de matières radioactives. Enfin, la gestion des situations accidentelles est régulièrement testée lors d'exercices.
Réponse apportée par Edf :
Les transports des déchets jusqu’à Cigéo relèveront de la responsabilité des producteurs et seront soumis à la réglementation internationale comme pour tous les transports de substances radioactives réalisés aujourd’hui en France. Les emballages dans lesquels seront transportés les déchets les plus radioactifs sont conçus pour être étanches et le rester même en cas d’accident (collision, incendie, immersion). La fiabilité de ces transports repose sur le respect des règles prévues par le règlement pour le transport des marchandises dangereuses. La conception des emballages de transport et la formation des personnels font partie de ces règles, dont le respect est soumis au contrôle de l'Autorité de sûreté nucléaire. Le contrôle de la protection des transports contre les actions de malveillance est, lui, du ressort du Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité auprès du ministre de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Energie.
QUESTION 238 - Vidéos du débat contradictoire sur Internet
Posée par Pierre-Yves LOCHET, L'organisme que vous représentez (option) (PANTIN), le 11/07/2013
La vidéo du débat qui s'est tenu le 11 juillet sera t'elle disponible sur le site de la CPDP? (pour l'instant, la seule vidéo disponible sur le site est la déclaration de B Dessus, et il serait utile de mettre à disposition du public les réponses apportées par l'ANDRA et l'IRSN à ses propos)
Réponse du 12/09/2013,
Les enregistrements audio, vidéo et le verbatim (mot-à-mot) du débat contradictoire du 11 juillet sur les déchets radioactifs ont été diffusés sur le site du débat public dans les jours qui ont suivi.
Les questions adressées au cours de ce débat, et qui n'avaient pu être traitées en direct, ont été enregistrées dans le système classique des questions-réponses et sont également consultables sur le site du débat.
QUESTION 236 - rejets radioactifs
Posée par L MATHIEU, L'organisme que vous représentez (option) (BESANÇON), le 12/07/2013
J'ai lu quelque part que les déchets radioactifs génèrent des gaz radioactifs qu'il faudra évacuer du site de stockage par une cheminée. Mais je n'ai pas vu combien de temps ces rejets vont durer. Des centaines de milliers d'années comme le stockage ?
Réponse du 12/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Effectivement, comme présenté dans le Dossier du maître d’ouvrage page 57, Cigéo sera à l’origine de très faibles quantités de rejets radioactifs provenant pour la quasi-totalité d'émanation de carbone 14, tritium ou krypton 85 contenus dans certains colis de déchets de moyenne activité à vie longue (MA-VL). Ces rejets seront canalisés, mesurés et strictement contrôlés avant d’être relachés dans l'atmosphère.
L'Autorité de sûreté nucléaire fixera les limites autorisées pour ces rejets et en assurera un contrôle strict. Une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que leur impact serait de l’ordre de 0,01 milliSievert par an (mSv/an) à proximité du Centre, soit très largement inférieur à la norme règlementaire (1mSv/an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv/an en moyenne en France).
Ces rejets dureront uniquement le temps de l’exploitation du site. En effet, après la fermeture du stockage, les alvéoles dans lesquelles les déchets seront stockés auront été fermées et il n’y aura plus de rejets de ce type.
QUESTION 234 - REVERSIBILITE - SURETE de l'ARGILE
Posée par danielle BILLY, L'organisme que vous représentez (option) (ROUVRES), le 12/07/2013
Suite à la lecture du bulletin Cigéo Mag de décembre 2012 je pose plusieurs questions : 1 - Je comprends que Cigéo sera très surveillé pendant le temps de l'enfouissement et qu'à ce moment là la réversibilité du processus sera encore possible mais une fois le site refermé ...? Est-il exact que Cigéo sera définitivement inaccessible et les colis irrécupérables ? 2- Pouvez-vous affirmer ( et pas seulement espérer ) que le milieu géologique pourra contenir à lui seul ,sur le long terme, la colossale quantité de radioactivité contenue dans ce Titanic nucléaire ?
Réponse du 24/10/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Concernant votre première question :
Le rôle du stockage est de mettre en sécurité de manière définitive les déchets radioactifs, pour ne pas reporter leur charge sur les générations futures. A long terme, la protection de l’homme et de l’environnement doit être assurée sans nécessité d’intervention humaine (sûreté « passive »). Dans cette optique, Cigéo est conçu pour être refermé après la centaine d’années nécessaires à son exploitation.
Chaque étape de fermeture est indispensable pour la sûreté à très long terme du stockage. Les opérations de fermeture conduiront à obturer définitivement les alvéoles où seront stockés les déchets, puis à obturer en totalité les galeries souterraines, les puits et les descenderies. Ces opérations permettront de progresser vers une sûreté de plus en plus passive. Elles rendront la récupérabilité des colis de déchets plus difficile.
Après la fermeture du stockage, la sûreté sera assurée de manière passive et ne nécessitera aucune action humaine. Une surveillance du site pourra néanmoins être maintenue aussi longtemps que les générations futures le souhaiteront et des actions seront menées pour conserver et transmettre sa mémoire. Il pourrait toujours être envisagé de revenir dans le stockage au moyen de techniques minières adaptées, mais le confinement apporté par la roche et les ouvrages de fermeture ne serait alors plus assuré.
Concernant votre seconde question :
L’évaluation de sûreté du stockage se fonde sur l’ensemble des connaissances acquises par l’Andra depuis 20 ans, en particulier sur le site étudié pour l’implantation du stockage en Meuse/Haute Marne.
La couche argileuse étudiée est homogène sur une grande surface et son épaisseur est importante (plus de 130 mètres). Aucune faille affectant cette couche n’a été mise en évidence sur la zone étudiée. La roche argileuse possède des propriétés qui permettent le confinement à long terme de la radioactivité.
Les évaluations de sûreté ont montré que l’impact à très long terme du stockage resterait largement inférieur à celui de la radioactivité naturelle : celui-ci sera de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an dans 100 000 ans en évolution normale et resterait inférieur à 0,25 mSv/an, en situation dégradée (inférieur à la radioactivité naturelle de 2,4 mSv/an).
QUESTION 233 - Crime contre l'humanité?
Posée par Thierry LEGRAND, L'organisme que vous représentez (option) (RÉBÉNACQ), le 14/12/2013
L'enfouissement ne procède t-il pas de la même lâcheté que glisser la saleté sous un tapis... en plus grave?
Réponse du 13/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).
Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
QUESTION 232
Posée par Michel MARIE, le 23/07/2013
Comment des gens que l'on croit responsables peuvent-ils dire et faire croire que ceci est la SOLUTION aux déchets, sachant que ces catégories de déchets nucléaires vont rester dangereuses, radioactives, pendant plusieurs siècles? Ces stockages, pendant des siècles, vont être sources de multiples dangers : catastrophes naturelles, dangers aériens, terrorisme, relâchement radiocactifs, évènements imprévisibles, etc. Pourquoi tromper ainsi les gens en affirmant que ces déchets ont trouvé une "solution"?
Réponse du 24/10/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
C’est justement pour protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs qu’est étudié le stockage profond.
En France et à l’étranger, le stockage profond est considéré actuellement comme la solution la plus sûre et la plus durable en tant qu’étape finale de la gestion des déchets les plus radioactifs (voir par exemple la directive européenne du 19 juillet 2011 ainsi que le débat du 23 septembre 2013 sur la comparaison des expériences internationales). Le stockage ne fait pas disparaître les déchets radioactifs, mais il permet de ne pas reporter leur charge sur les générations futures en leur donnant la possibilité de les mettre en sécurité de manière définitive.
Située à 500 mètres de profondeur, l’installation souterraine de Cigéo sera peu vulnérable aux agressions d’origine externe. La couche d’argile dans laquelle est étudiée son implantation présente des propriétés favorables pour assurer le confinement de la radioactivité à très long terme.
Pour être autorisées, les installations de Cigéo - en surface et en souterrain - devront répondre aux exigences des autorités de sûreté, qui ont été renforcées suite aux attentats de 2001 et à la catastrophe de Fukushima. Si Cigéo est autorisé, il fera l’objet de réexamens périodiques de sûreté, fixés au moins tous les 10 ans. L’Andra propose également que des rendez-vous soient programmés régulièrement avec l’ensemble des acteurs (riverains, collectivités, évaluateurs, État…) pour contrôler le déroulement du stockage.
QUESTION 230 - Pourquoi ?
Posée par Bernard CHARAVIN, L'organisme que vous représentez (option) (NYONS), le 06/09/2013
Pourquoi les avis censés être classés par ordre "chronologique" sont-ils présentés en grand désordre ? Merci d'y remédier.
Réponse du 10/10/2013,
Le site propose deux classements des avis et des questions. Un classement thématique et un classement chronologique. Après vérification, le classement chronologique fonctionne parfaitement. peut-être faudrait-il rafraîchir la page internet de votre ordinateur pour l'actualiser (touche F5).
QUESTION 229 - L'imprévisible existe - Fukushima
Posée par Hervé GILBERT, SANS (SAVIGNY-LE-TEMPLE), le 10/07/2013
Le japon qui fait est quand même un pays "développé" avec une très forte technologie et beaucoup de sureté, a connu malheureusement un accident majeur. Est-ce que ceci a été pris en compte dans ce projet (et les suivants), et quelles sont les procédures prévues par les differents organismes "responsables" pour les populations qui seront impactées par un problème majeur imprévisible ? Et quelle suite (à très long terme) pour l'interdiction d'accès dans un périmètre autour du site (des sites) pollués ? Merci
Réponse du 24/10/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif fondamental de Cigéo est de confiner la radioactivité des déchets sur de très longues échelles de temps. Tout a été mis en œuvre pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du centre ou après sa fermeture. Ainsi, conformément au principe de défense en profondeur, tous les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation sont identifiés en amont de la conception. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier.
Les études montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire.
Cigéo sera une installation nucléaire de base qui, à ce titre, sera soumise à la réglementation en vigueur concernant ce type d’installation et sera notamment placée sous le contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) comme les autres installations nucléaires de base en France. Conformément à cette réglementation, l’ASN contrôlera très régulièrement le respect des exigences de sûreté mises en œuvre par l’Andra. De nouvelles dispositions pourront être prises à tout moment en cas de retour d’expérience à intégrer ou de changement de normes. Ainsi, les exigences de sûreté ont d’ores et déjà été renforcées suite aux attentats du 11 septembre 2001 et à la catastrophe de Fukushima.
Cigéo n’est cependant pas une centrale nucléaire mais un centre de stockage de déchets (stabilisés et conditionnés dans des fûts en béton ou en acier) qui du fait de son implantation à 500 mètres de profondeur sera peu vulnérable aux activités humaines comme aux catastrophes naturelles à l’inverse d’une centrale comme celle de Fukushima au Japon. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels montre que leurs conséquences resteraient limitées, et nettement en deçà du seuil réglementaire qui imposeraient des mesures de protection des populations (mise à l’abri, évacuation).
QUESTION 228 - Pourquoi le stockage sur du long Terme ?
Posée par Hervé GILBERT, L'organisme que vous représentez (option) (SAVIGNY-LE-TEMPLE), le 10/07/2013
Il y a un adage qui dit "Nettoyer, c'est bien, Ne pas salir c'est mieux". Plutot que de stocker des tonnes de déchets ne peut-on les réduire très fortement et ainsi ne plus avoir à réaliser de stockage sur du long terme. Ce coût est-il intégré dans le coût du nucléaire par rapport aux autres alternatives qui produisent aussi des déchets, mais qui peuvent se recycler sur du très court terme et sans danger pour les générations à venir ?
Réponse du 18/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
De nombreuses recherches ont été menées en France et à l’étranger pour essayer de réduire le volume et la dangerosité des déchets radioactifs. Ces études se poursuivent aujourd’hui avec le souci de réduire autant que possible les volumes de déchets de manière à économiser l’espace dans le stockage. En tout état de cause, les résultats montrent qu’il n’est pas possible de réduire suffisamment leur dangerosité pour qu’on puisse se dispenser d’un stockage profond. En effet, seul ce type de stockage permet de garantir que les déchets ne seront pas dangereux pour l'Homme et l'environnement sur plusieurs centaines de milliers d’années.
Concernant votre 2ème question : oui, le coût du stockage est intégré dans le coût du nucléaire ; pour un nouveau réacteur nucléaire sur l’ensemble de sa durée de fonctionnement, ce coût représente de l’ordre de 1 à 2 % du coût total de la production d’électricité.
QUESTION 227
Posée par Janine SLIWKA (SENON), le 15/07/2013
La valorisation de la Meuse est laissée pour compte. Elle devient le dépotoir des autres départements. Comment voulez-vous que leurs habitants soient réceptifs?
Réponse du 12/09/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La valorisation de la Meuse n’est pas laissée pour compte avec le projet Cigéo. Bien au contraire, s’il est autorisé, Cigéo participera pleinement à la vie de son territoire d’accueil meusien et haut-marnais et à son développement.
Le Centre de l’Andra en Meuse/Haute-Marne (Laboratoire souterrain, Espace technologique, Carothèque, Observatoire pérenne de l’environnement, Ecothèque) comprend d’ores et déjà plus de 300 emplois directs. Deux groupements d’intérêt public ont été créés en Meuse et en Haute-Marne pour gérer les équipements de nature à favoriser et faciliter l’installation et l’exploitation du Laboratoire ou de Cigéo, pour mener des actions d’aménagement du territoire et de développement économique et pour soutenir les actions de formation et de diffusion des connaissances scientifiques et technologiques. Ils ont été dotés de 30 millions d’euros par département en 2012. Par ailleurs, EDF, le CEA et Areva mènent une politique active en faveur du développement local.
Si Cigéo est autorisé, il constituera un projet industriel structurant pour le territoire. Entre 1 300 et 2 300 personnes travailleront à la construction des premières installations de Cigéo. Après la mise en service du Centre, entre 600 et 1 000 personnes travailleront de manière pérenne sur le site. Cigéo contribuera au développement de l’activité des entreprises locales et, grâce à la garantie d’une activité sur plus d’un siècle, certaines entreprises feront très vraisemblablement la démarche de s’implanter localement, créant à leur tour une activité nouvelle sur le territoire.
Le Gouvernement a également demandé l’élaboration d’un schéma de développement du territoire à l’échelle des deux départements de Meuse et de Haute-Marne. Ce schéma est élaboré sous l’égide du préfet de la Meuse, préfet coordinateur, en concertation avec les acteurs locaux (collectivités, chambres consulaires…). L’Andra et les entreprises de la filière nucléaire contribuent également à son élaboration.
Pour accéder à ce schéma : ../docs/docs-complementaires/docs-planification/SIDT-Final.pdf
QUESTION 226 - curiosité humaine
Posée par Marie-Hélène PONCET, L'organisme que vous représentez (option) (MONTPELLIER), le 12/07/2013
En enfouissant les déchets nucléaires de manière irréversible (dans 100 ans), c'est la voie vers l'oubli, et un jour, un humain curieux comme nous le sommes tous risque d'avoir une mauvaise surprise en ouvrant la boite après de nombreux efforts... Quelles mesures préconisez-vous pour éradiquer sur plusieurs millénaires la curiosité de l'homme? (D'autant plus qu'en le privant de la capacité de chercher des solutions pour le traitement des déchets, du fait du stockage irréversible, il n'aura pas eu le loisir d'exercer sa curiosité et ses recherches pour trouver de meilleurs moyens de gestion des déchets nucléaires.)
Réponse du 30/09/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le stockage profond est la seule solution qui permet de se prémunir contre les conséquences d’un oubli, qui ne peut être exclu sur plusieurs milliers d’années, que les déchets soient laissés en surface ou stockés en profondeur.
En effet, même en cas de perte complète de la mémoire du stockage, une intrusion inopinée à 500 mètres sous terre apparaît peu plausible, du moins sans un minimum d’investigations préalables. L’Andra évalue cependant par précaution dans son analyse de sûreté les conséquences d’un forage à travers le stockage pour vérifier que le stockage resterait sûr.
Le stockage n’est en aucune façon la voie vers l’oubli. L’une des missions de l’Andra est d’organiser le maintien de la mémoire de ce stockage le plus longtemps possible.
Depuis plus de 50 ans, les chercheurs en France et à l’étranger ont exercé leur curiosité et leurs recherches pour étudier différents moyens de gestion des déchets radioactifs : envoi dans l’espace, au fond des océans, dans le magma, entreposage, séparation-transmutation… Le stockage est aujourd’hui considéré dans tous les pays comme la meilleure solution pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter leur charge sur les générations suivantes. Si un autre moyen de gestion des déchets radioactifs était découvert dans le futur, les générations concernées pourront décider de faire évoluer leur politique de gestion des déchets.
Dans le cadre de ses propositions pour la réversibilité du stockage, l’Andra a avancé l’idée d’organiser des points de rendez-vous réguliers qui permettront notamment de suivre les avancées des recherches sur la gestion des déchets radioactifs, ce qui laisse donc toute latitude aux chercheurs pour continuer à exercer leur curiosité.
QUESTION 225
Posée par Thierry BONNETON (CHERBOURG), le 12/07/2013
Quels sont les dispositions prises à la conception puis en exploitation pour éviter les agressions internes et externes (innondation, séisme, incendie, ...) et limiter leurs conséquences? Quelles sont les règles d'exploitation qui s'appliquent?
Réponse du 30/09/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Cigéo est conçu pour être sûr pendant sa construction, son exploitation et après sa fermeture. Pour cela, l’objectif principal de l’Andra est d’éviter la dispersion incontrôlée de radioactivité et faire en sorte que la quantité de radioactivité qui se retrouve au contact des travailleurs et des populations riveraines soit très faible et ne présente pas de risque pour la santé.
Ainsi, pour garantir la sûreté de ses installations l’Andra identifie toutes les sources potentielles de dangers, qu’elles soient d’origine naturelle ou non. L’ensemble de ces risques est pris en compte dès la phase de conception afin de prendre les dispositions nécessaires pour prévenir ces risques, réduire leur probabilité pour ce qui est des risques d’origine humaine, et limiter leurs effets sur les installations (que ce soit pour les installations de surface ou les installations souterraines). Sont étudiés par exemple les situations de séismes, inondations, conditions climatiques extrêmes, incendies, explosions, chutes d’avion, environnement industriel (voies de circulation, présence d’autres installations présentant des risques…).
Pour connaitre en détail l’ensemble des dispositions prévues pour garantir la sûreté du centre, nous vous invitons à consulter le chapitre 5 du Dossier du maître d’ouvrage : ../docs/dmo/chapitres/DMO-Andra-chapitre-5.pdf
Pour que le projet puisse être autorisé, l’Andra doit donc démontrer aux évaluateurs du projet (Autorité de sûreté nucléaire, Commission nationale d’évaluation) qu’elle maîtrise tous les risques, que ce soit pour la sûreté de Cigéo pendant son exploitation ou après sa fermeture. L’ASN effectuera également des inspections (plusieurs par an, dont certaines inopinées) pour vérifier que la sûreté du site est bien assurée par l’Andra. Dans le cas contraire l’ASN peut imposer des prescriptions supplémentaires si elle considère qu’un risque n’est pas maîtrisé correctement, voire mettre à l’arrêt l’installation.
QUESTION 223 - CIGEO
Posée par François RICHÉ, F.R.S. SARL (LYON), le 10/07/2013
Bonjour, Pourquoi ce débat est-il caché ? Il est nécessaire d'avoir une vraie information, avec reportage sur les chaînes TV publics et privées, plus radio et presse. Rien n'est urgent, par contre les enjeux sont considérables sur un domaine neuf et avec des risques très fort sur l'avenir des générations futures. Une fois de plus, c'est la démonstration de l'incompétence et du manque de vision à long terme des dirigeants politiques depuis plus d'un demi siècle Cordialement François Riché Officier de Marine de réserve 06 36 73 62 00 112 quai Pierre Scize 69005 Lyon
Réponse du 05/08/2013,
Bonjour Monsieur,
Ce debat public n'est en aucune façon "caché". depuis le 15 mai, date de son ouverture, un site internet très abondant est ouvert a l'adresse www.debatpublic-cigeo.org. vous y trouverez non seulement le dossier du maitre d'ouvrage, mais aussi de nombeux rapports du Parlement, de la Cour des comptes, de l'Autorité de sureté nucléaire, des cahiers d'acteurs émanant des Conseils generaux des deux départements de Meuse et Haute Marne, des Elus, des Chambres consulaires, d'Asociations, ainsi que plus de 300 questions et de 200 avis émanant de personnes intéressées au sujet.
Par ailleurs, la presse locale comme les grands médias nationaux ont rendu compte du débat et du projet en cause.
Enfin, la commission du débat public vous adresera désormais l'ensemble des documents du débat.
QUESTION 222 - Securité incendie
Posée par gerard BESSIERES, L'organisme que vous représentez (option) (VARENNES SUR AMANCE ), le 09/07/2013
Bonjour Quels systèmes automatiques d'extinction d'incendie allez vous utiliser au fond des galeries de Cigéo?...
Réponse du 24/10/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Plusieurs systèmes d’extinction automatique seront installés dans l’installation souterraine. Des systèmes embarqués d’extinction automatique (gaz, poudre...) seront placés sur les engins de transfert des colis de déchets et sur les engins de manutention en alvéole, afin d’éteindre tout départ de feu. Des systèmes d’extinction automatique sont également disposés dans certaines zones de l’installation souterraine telles que les locaux électriques et les zones de soutien logistique. Ces dispositifs seront mis en place en complément de moyens de lutte contre l’incendie plus traditionnels de types extincteurs, points de raccordement à un réseau d’alimentation en agent extincteur (eau, mousse…) etc. Des équipes de surveillance et de maintenance vérifieront périodiquement le bon fonctionnement de ces équipements. Enfin, des véhicules de pompiers adaptés au milieu souterrain seront prépositionnés en permanence dans le stockage.
QUESTION 221 - argilite du site de Bure
Posée par Pierre BENOIT, L'organisme que vous représentez (option) (TROYES), le 08/07/2013
Que disent les diagraphies gamma ray de sondage dans les argilitites callovo oxfordiennes. Par ailleurs, quelles sont leur composition minéralogiques moyennes en argile (type d'argile observé: illite, kaolinite...) carbonates, carbone organique total et sulfures.. Quels sont les écarts types pour chaque fraction minéralogique observées et quel est le nombre d'échantillons analysés
Réponse du 24/10/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les diagraphies gamma-ray permettent de mesurer, le long de forages, le rayonnement gamma émis naturellement par les formations géologiques traversées. Les mesures se font en continue lors de la remontée d’un capteur gamma dans le forage. La variabilité du rayonnement le long du forage permet de distinguer les différentes formations géologiques et les éventuelles variations litho-stratigraphiques (sédimentaires) au sein d’une formation. La comparaison des mesures obtenues entre plusieurs forages permet d’établir les modèles géologiques (sédimentologiques et structuraux) du milieu géologique traversé, en trois dimensions. Le rayonnement gamma émis par les roches sédimentaires telles que les argilites du Callovo-Oxfordien (couche argileuse étudiée pour l’implantation du stockage profond) est lié à la présence naturelle de potassium 40 (40K), de thorium (232Th) et d’uranium (238U). Les diagraphies gamma-ray enregistrent ainsi en continu le long d’un forage les variations naturelles des teneurs en ces éléments.
Dans les argilites du Callovo-Oxfordien, les minéraux argileux constituent la principale source en potassium (fraction massique comprise entre 1 et 2,5 %) et en thorium (5-10 ppm, soit une fraction de 5 10-4 à 10-3 %). Les teneurs en uranium sont très faibles (1-2 ppm soit une fraction de 10-4 à 2 10-4 %) et sa présence est principalement associé à celle de la matière organique. La contribution de l’uranium étant relativement faible en comparaison de celles du thorium et du potassium, les diagraphies gamma-ray mises en œuvre dans les argilites renseignent majoritairement sur les teneurs en minéraux argileux en continu dans l’épaisseur de la couche d’argilite pour un forage et latéralement par corrélation entre différents forages la continuité de zones plus ou moins riches en minéraux argileux.
La composition détaillée des argilites en minéraux, notamment argileux, ainsi que la texture des argilites (disposition spatiale des minéraux entre eux) ont été obtenues par des analyses en laboratoire sur des échantillons de carottes prélevés dans des forages, suivant différentes méthodes indépendantes (diffraction des rayons X, observations aux microscopes optique et électronique, mesures de la teneur en carbonates, …). Les échantillons prélevés à intervalles réguliers (espacements allant de 1 à 3 m), sont issus d’une vingtaine de forages couvrant en verticale toute la couche du Callovo-Oxfordien et en latérale la zone étudiée pour l’implantation de l’installation souterraine de Cigéo. Au total, ce sont plus de 1 000 échantillons de Callovo-oxfordien qui ont été analysés. En complément des données diagraphiques, ces mesures minéralogiques sur échantillons ont permis d’établir le modèle 3D de composition minéralogique de la couche argileuse sur le secteur. Ce modèle souligne globalement une variabilité verticale de la composition minéralogique et une homogénéité latérale :
• La fraction argileuse massique représente en moyenne 42 % des minéraux (écart type de 11 %). 90% des minéraux argileux sont de l’illite et des inter-stratifiés illite/smectite, les autres minéraux argileux étant la kaolinite et la chlorite.
• Les carbonates représentent en moyenne 30 % des minéraux (écart type de 12%).
• Les tectosilicates composés essentiellement de quartz représentent en moyenne 25 % des minéraux (écart type de 8 %).
• Les minéraux dits accessoires dont les sulfures et les oxydes de Fer constituent moins de 4 % des minéraux.
• Enfin, la matière organique est présente à une teneur massique comprise entre 0,5 et 2 %. La teneur (mg/L) en Carbone Organique Total, somme totale du carbone organique, est comprise entre 0,5 et 1 %.
QUESTION 220 - spelothème
Posée par Pierre BENOIT, FAPNATE (TROYES), le 08/07/2013
Bonjour, les spéléothèmes fracturés par d'éventuels séismes quaternaires ont ils été recherché autour du site de Bure, par les spéloclubs départementaux (Aube, Haute Marne,Meuse). Si oui, quels sont les résultats et les éventuelles datations des événements par méthode thorium/uranium.
Réponse du 30/09/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La méthode Uranium/Thorium a été utilisée pour dater avec précision des anomalies de croissance de spéléothèmes (c’est-à-dire de stalactites et de stalagmites) prélevés dans des cavités karstiques de la région de Meuse/Haute-Marne (Référence : Pons-Branchu, E. (2001) Datation haute résolution de spéléothèmes (230Th/234U et 226Ra/238U). Application aux reconstitutions environnementales autour des sites du Gard et de Meuse/Haute-Marne. Thèse de doctorat de l’Université de Droit, d’Economie et des Sciences d’Aix-Marseille, soutenue le 12 décembre 2001).
L’analyse des résultats par des spécialistes en karstologie et géomorphologie montre que ces anomalies n’ont pas de lien avec des séismes. Elles sont liées aux évolutions dans le temps des écoulements d’eau dans ces réseaux karstiques, en fonction des variations climatiques et des séquences d’enfoncement des vallées.
Références :
• Jaillet S., Losson B., Brulhet J., Corbonnois J., Hamelin B., Pons-Branchu E. & Quinif Y. (2003) Apport des datations U/Th de spéléothèmes à la connaissance de l’incision du réseau hydrographique de l’Est du Bassin parisien. Revue de géographie physique de l’Est. Tome XLII, 4/2002, p.185-195
• Jaillet S., Pons-Branchu E., Brulhet J. & Hamelin B. (2004) Karstification as geomorphological evidence of river incision : the karst of Cousance and the Marne valley (eastern Paris Basin), Terra Nova, 16, 167-172, 2004
• Jaillet S., Pons-Branchu E., Maire R., Hamelin B., Brulhet J. (2006) Enregistrement de paléo-mises en charge holocènes dans deux stalagmites du réseau du Rupt-du-Puits (Barrois, France). Analyses morphologiques des lamines et datations U/Th en TIMS. Geologica Belgica (2006) 9/3-4 : 297-307
• Losson B., Corbonnois J., Argant J., Brulhet J., Pons-Branchu E., Quinif Y. (2006) Interprétation paléoclimatique des remplissages endokarstiques de la vallée de la Moselle à Pierre-la-Treiche (Lorraine, France). Géomorphologie, relief, processus, environnements, 2006, n°1, p. 37-43
• Pons-Branchu E., Hamelin B., Losson B., Jaillet S., Brulhet J. (2010) Speleothem evidence of warm episodes in North-east France during marine isotope stage 3, and implication for permafrost distribution in northern Europe. Quaternary Research, 2010.
De plus, même dans les régions dont la sismicité est significative, le résultat des études effectuées sur des cassures de spéléothèmes (datations, analyses des causes possibles, simulations mécaniques des cassures…) portent à douter que ces ruptures soient dues à des séismes. Les causes sont bien plutôt climatiques, vu que les âges des cassures correspondent à des périodes glaciaires. Durant les épisodes d’englacement de conduits karstiques, les contraintes mécaniques dues au fluage de la glace sont plus à même de les produire que la sismicité (y compris pour les concrétions de grande à très grande taille) observées en milieu endokarstique.
Référence :
Pons-Branchu, E., Hamelin, B., Brulhet, J. & Bruxelles, L. (2003) Les cassures de spéléothèmes en milieu endokarstique : origine tectonique ou climatique ? Datation U-Th d’événements de cassures dans l’Aven de la Salamandre (Gard, Sud-Est France). Bulletin de la Société Géologique de France, 175, 5, p. 473-479
QUESTION 219 - Pourquoi l'aspect sanitaire de l'impact des déchets stockés n'est-il pas mis en avant
Posée par Jean-Claude ARTUS, UNIVERSITÉ MÉDICALE DE MONTPELLIER I (NIMES), le 05/07/2013
Pour le "grand public" il y a la perception, l'imaginaire "poubelle nucléaire", "contaminations des populations futures", "les malformations" etc... les ayatollah du risque nul s'en chargent ! Ne pourrait-on pas dire à la population quel est l'ordre de grandeur du vrai risque pour la santé ? Bien sûr en l'absence de médecins spécialistes dans vos commissions cet aspect fondamental semble exclu ! Etonnant non ?
Réponse du 30/09/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif fondamental de Cigéo est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement des risques liés aux déchets radioactifs.
L’impact du stockage est apprécié par l’évaluation de l’exposition des personnes habitant à proximité du site. Cet impact est exprimé par une dose annuelle exprimée en millisieverts (mSv) par an, comme pour les autres installations nucléaires.
Une première évaluation, faite sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact des rejets pendant l’exploitation du site serait de l’ordre de 0,01 mSv par an à proximité du Centre, soit très largement inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France). A titre de comparaison, lors d’un scanner de l’abdomen, les doses reçues sont de l’ordre de 10 mSv.
Malgré ce très faible impact, et pour répondre à la demande exprimée à plusieurs reprises par les acteurs locaux et notamment le Clis (Comité local d’information et de suivi du Laboratoire souterrain), l’Andra s’est rapprochée des organismes de santé publique (Institut national de veille sanitaire, Observatoires régionaux de la santé de Lorraine et de Champagne-Ardenne) pour étudier les modalités possibles d’une surveillance de la santé autour du stockage. L’Andra a saisi ses ministères de tutelle pour que la gouvernance et l’organisation d’un tel dispositif soient précisées.
Après la fermeture du stockage, les études montrent que le stockage n’aura pas d’impact avant 100 000 ans et que celui-ci sera de l’ordre de 0,01 mSv/an en évolution normale. En situation dégradée (intrusion humaine, défaut d’un composant du stockage…), l’impact du stockage resterait inférieur à 0,25 mSv/an.
QUESTION 218 - Durée de la dangerosité des déchets enfouis
Posée par DENIS MARCHETTI, L'organisme que vous représentez (option) (VINCENNES), le 04/07/2013
Bonjour, pouvez-vous m'expliquer simplement pendant combien d'années la radioactivité des déchets enfouis à Cigéo représentera un danger sanitaire pour l'homme ? Merci
Réponse du 26/08/2013,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
Les déchets destinés à Cigéo resteront dangereux plusieurs centaines de milliers d’années. Un indicateur de cette dangerosité peut être donné par le rayonnement que produisent les déchets. Pour les déchets de haute activité, les plus radioactifs, au moment de leur mise en stockage, le rayonnement qui serait reçu à un mètre d’un colis sans protection est de plusieurs sieverts (Sv) par heure*. La dangerosité de ces déchets radioactifs diminuera au fil du temps du fait de la décroissance naturelle de la radioactivité qu’ils contiennent. Le rayonnement des déchets de haute activité sera ainsi divisé par environ mille dans mille ans.
Cigéo est justement conçu pour protéger à très long terme l’Homme et l’environnement de la dangerosité de ces déchets. Le stockage est situé à 500 mètres de profondeur pour isoler les déchets des activités humaines et des événements naturels de surface, comme l’érosion. Il est implanté dans une couche d’argile épaisse qui permet le confinement à très long terme de la radioactivité. Seuls certains radionucléides mobiles pourront migrer jusqu’aux limites de la couche d’argile après plusieurs dizaines de milliers d’années, puis potentiellement atteindre la surface en quantités extrêmement faibles. Les études menées par l’Andra ont montré que le stockage n’aura pas d’impact avant 100 000 ans et que celui-ci restera significativement inférieur à l’impact de la radioactivité naturelle*.
*La radioactivité naturelle est de 2,4 millisievert (mSv) par an en moyenne en France (le millisievert correspond à un millième de sievert). Les normes européennes et françaises de radioprotection imposent aux industries une exposition limitée du public à 1 mSv par an et par personne du fait de leurs rejets dans l’environnement. Cette dose-limite d’exposition correspond à l’équivalent de la dose reçue en trois radios pulmonaires.
QUESTION 217 - elevation probable du niveau de mer a + d 1 metre
Posée par francois DUFAU, LE FUTRU DE MES PETIS ENFANTS ET LEUR MONDE (MINIHY-TREGUIER), le 03/07/2013
S'il y a une élévation des mers à + d'un mètre dici à 300 ans, je pense même que l'on peut atteindre le pic des 70 cm avant la mort de mes petits enfants 7 ans et 4ans, les refugiés climatiques commencent déjà ... que se passera-t-il dans les couches profondes de la terre, salinisation, etc, élévation de toutes les nappes phréatiques. Je crains fort que le sarcophage nucléaire souterrain ne puisse résister à une élévation potentiellle des mers...
Réponse du 18/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Une élévation du niveau des mers n’aura aucune incidence sur le site de Meuse/Haute-Marne, situé à 350 m d’altitude et à plus de 300 km du littoral le plus proche, ni en surface pour les nappes phréatiques, ni sur les circulations hydrogéologiques dans les aquifères profonds situés de part et d’autre de la couche argileuse du Callovo-Oxfordien, retenu pour l’implantation de Cigéo.
En effet, au cours du dernier million d’année, durée considérée dans l’analyse de sûreté du projet Cigéo, l’amplitude de variation du niveau des mers a été de -150 m à +30 m, du fait des alternances de croissance et de fonte des grandes calottes glaciaires lors de la succession des périodes glaciaires et de réchauffement.
Ces variations du niveau des mers devraient se répéter naturellement au cours du prochain million d’années. Elles sont prises en compte, ainsi que celles liées au réchauffement climatique du fait des activités humaines pour estimer l’évolution future de la région et du site de stockage, et mener les analyses de sûreté du stockage Cigéo.
Les variations périodiques du niveau des mers modifient la géographie dans les régions littorales. Par exemple, au cours des périodes glaciaires la Manche est à sec, occupée par des vallées, et des nappes d’eau douce se créent en surface là où s’étend la mer aujourd’hui. Inversement, au cours des remontées du niveau des mers, des déplacements des fronts d’eau salée dans les nappes phréatiques se produisent au fur et à mesure du déplacement des rivages sur les zones inondées. Ce phénomène aujourd’hui s’observe à l’échelle historique sur le littoral atlantique français.
En amont, loin des régions littorales, ces variations n’affectent que la topographie des vallées par la succession de périodes d’érosion et de périodes d’alluvionnement au fil des cycles climatiques, et n’ont aucune incidence significative sur les couches géologiques profondes.
QUESTION 215 - Comment récuperer des fûts détériorés
Posée par Jean CROS, AUCUN (92300), le 07/07/2013
Madame, Monsieur, Ma question est de savoir, si la décision d’un enfouissement réversible et non définitive est prise, quelle serait la constitution de cet enfouissement? Comment peut on récupérer des fûts qui seraient détériorés et qui fuiraient. Les matériaux d’enfouissement seraient également contaminés et donc irrécupérables. J.CROS
Réponse du 18/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Si vous souhaitez des éléments sur la description des installations industrielles de Cigéo, vous pouvez vous reporter au chapitre 4 du dossier du maître d’ouvrage présenté au débat public : ../docs/dmo/chapitres/DMO-Andra-chapitre-4.pdf. Sur le site Cigeo.com, vous pourrez aussi voir une animation qui présente le fonctionnement du stockage http://www.cigeo.com/l-actu-de-cigeo/item/cigeo-en-bref.
L’Andra prévoit dès la conception du stockage de nombreuses dispositions pour faciliter d’éventuelles opérations de récupération de colis de déchets mis en stockage. Les fûts de déchets livrés par les producteurs seront contrôlés par l’Andra à leur arrivée sur le site pour s’assurer de leur état et du respect des exigences techniques pour leur stockage (non contamination, confinement…). Ils seront ensuite placés dans des conteneurs épais, en acier ou en béton, prévus pour résister aux incidents d’exploitation qui pourraient survenir dans l’installation (par exemple une chute ou un incendie). Ces colis de stockage sont conçus pour rester intègres pendant toute la durée d’exploitation de Cigéo. Les alvéoles souterraines dans lesquelles les colis seront stockés seront surveillées pour vérifier que l’installation évolue comme prévu. Si une opération de récupération de colis était décidée, la première étape du retrait consistera à contrôler précisément l’état du colis avant de le sortir de l’alvéole. Si celui-ci était contaminé ou détérioré, des précautions particulières seraient prises pour son transfert dans les installations et des opérations spécifiques seraient mises en œuvre (par exemple décontamination ou reconditionnement).
QUESTION 214 - Le débat sur les ondes
Posée par Sonia MARMOTTANT, L'organisme que vous représentez (option) (SAINT-MARTIN-D'HÈRES), le 02/07/2013
Bonjour, Je me demande pourquoi il n'y a que deux liens dans cette rubrique. Quitte à faire une rubrique presse, il faut qu'elle soit aussi exhaustive que possible.
Réponse du 31/10/2013,
Bien souvent, la consultation en ligne des articles de presse écrite est réservée aux abonnés des journaux en question. La Commission n'a donc pas la possibilité de publier gratuitement ce qui ne l'est pas par leurs auteurs. Et comme vous le soulignez, il est délicat de ne publier qu'une partie des articles relatifs au débat public. C'est pourquoi, la Commission du débat public a décidé de ne publier que les émissions radio elles-même consultables gratuitement par ailleurs.
QUESTION 213
Posée par Daniel PARMIGIANI (QUERQUEVILLE), le 05/07/2013
Quel serait l'impact sur ce stockage profond en cas de séisme de 5 ou 6 sur l'échelle de RICHTER, car nul ne peut prévoir les caprices de la nature.
Réponse du 30/09/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Même si les tremblements de terre ne sont pas prévisibles, les zones sismiques ou les zones à risque sont parfaitement connues. Les séismes ne se produisent pas n’importe où. Ils se produisent soit à la surface entre deux plaques de la croûte terrestre (exemple du séisme survenu au Japon) soit au niveau d’une faille existante (cas des séismes enregistrés en France).
En ce qui concerne le site étudié en Meuse/Haute-Marne, sa très faible sismicité est confirmée par les scientifiques qui ont travaillé sur ce site depuis plus de 20 ans. Le site de Meuse/Haute-Marne appartient à un domaine géologique stable, le bassin de Paris (voir carte), particulièrement favorable pour l’installation d’un stockage. L’activité sismique est en effet extrêmement faible à l’échelle du millénaire, comme le prouvent les enregistrements de sismicité instrumentale (écoute sismique depuis 1961 à l’échelle de la France) qui sont capables de détecter des microséismes, et les chroniques historiques (séismes ayant été ressentis et/ou ayant occasionné des dégâts au cours des derniers 1 000 ans).
Toutefois, des séismes sans précédent historique peuvent se produire sur une très longue durée, un million d’année dans le cas de Cigéo, compte tenu des faibles vitesses de déplacement de la croûte terrestre dans cette région. Ils se produiraient sur les failles les plus profondes existantes, c’est-à-dire le long de la vallée de la Marne, même si elles n’ont pas eu d’activité apparente dans le dernier million d’année.
Dans la conception de Cigéo, l’Andra prend donc en compte la possibilité qu’un ou plusieurs séismes puissent éventuellement survenir, après la fermeture du stockage, au niveau de ces failles. Par précaution, on évalue l’énergie maximale physiquement possible qui serait libérée par un séisme (c’est-à-dire la magnitude) compte tenu de la géométrie de ces failles. La magnitude maximale serait d’environ 6. Cigéo est conçu pour que plusieurs séismes de ce type n’altèrent pas sa capacité à confiner la radioactivité contenue dans les déchets stockés.
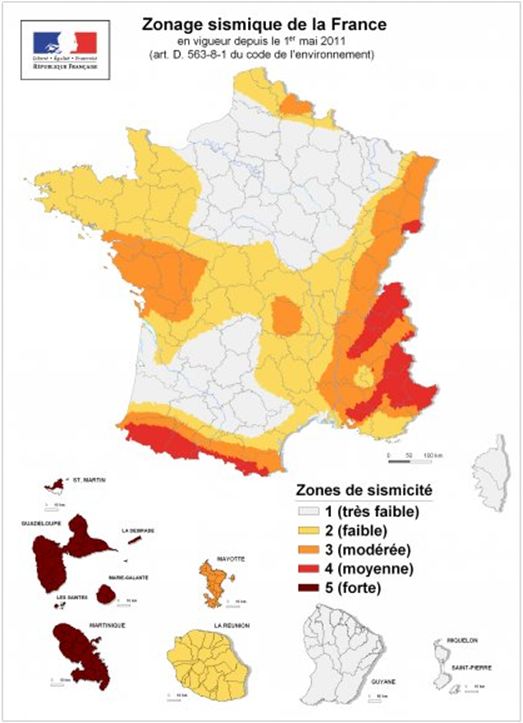
QUESTION 212
Posée par Cyril CROCQ, le 03/07/2013
Un benchmark est-il envisagé avec les USA, dont le projet de #YuccaMountain a été repoussé au-delà de 2020 par #DOE #NRC ?
Réponse du 27/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le modèle français pour la gestion des déchets radioactifs est cité en référence pour l’élaboration d’une nouvelle organisation dans ce domaine aux Etats-Unis. La Commission d’évaluation technique sur la gestion des déchets radioactifs aux Etats-Unis (Nuclear Waste Technical Review Board) a ainsi transmis au Congrès américain en septembre 2013 des recommandations sur la base de l’expérience acquise en France et en Suède (http://www.nwtrb.gov/corr/rce013.pdf). De nombreux échanges ont lieu entre l’Andra et les organismes américains chargés de la gestion des déchets radioactifs, en particulier un accord de coopération a été signé entre l’Andra et le Ministère américain de l’Énergie (Department of Energy).
Sur le plan technique, l’intérêt des américains pour l’expérience de conception d’un stockage dans l’argilite s’est intensifié depuis l’interruption du projet Yucca Mountain en 2010. L’Andra s’appuie de son côté sur le retour d’expérience acquis par l’exploitant du WIPP (Waste isolation pilot plant), qui a été mis en service en 1999. Ce stockage, situé dans le sel à 700 mètres de profondeur, prend en charge les déchets de moyenne activité à vie longue issus des activités de défense américaines.
QUESTION 211
Posée par Clément CONTER (DONCOURT LES CONFLANS), le 03/07/2013
Quelle est la durée de surveillance du site après la fin de l'entreposage et quelles sont les surveillances prévues ?
Réponse du 18/11/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le principe du stockage profond est que sa sûreté à long terme ne repose pas sur des actions humaines, notamment sur une surveillance du site, mais sur le milieu géologique. La surveillance du site pourra néanmoins être maintenue aussi longtemps que les générations futures le souhaiteront et contribuera au maintien de la mémoire du stockage. L’Andra présentera dans sa demande d’autorisation de création du stockage les modalités envisagés pour la surveillance du stockage après sa fermeture (surveillance depuis la surface, à partir de forages à faible profondeur, surveillance de l’environnement…).
QUESTION 210
Posée par Gaëlle ARNOL (VECQUEVILLE), le 02/07/2013
Pas vraiment d'avis car cela me fait peur pour l'avenir, il y a des risques pour notre santé future ? Cela est-il sûr à 100 % ? Pas de risque comme au Japon ?
Réponse du 24/10/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif fondamental de Cigéo est de confiner la radioactivité des déchets sur de très longues échelles de temps. Tout a été mis en œuvre pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du centre ou après sa fermeture. Ainsi, conformément au principe de défense en profondeur, tous les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation sont identifiés en amont de la conception. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier.
Les études montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire.
Cigéo sera une installation nucléaire de base qui, à ce titre, sera soumise à la réglementation en vigueur concernant ce type d’installation et sera notamment placée sous le contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) comme les autres installations nucléaires de base en France. Conformément à cette réglementation, l’ASN contrôlera très régulièrement le respect des exigences de sûreté mises en œuvre par l’Andra. De nouvelles dispositions pourront être prises à tout moment en cas de retour d’expérience à intégrer ou de changement de normes. Ainsi, les exigences de sûreté ont d’ores et déjà été renforcées suite aux attentats du 11 septembre 2001 et à la catastrophe de Fukushima.
Cigéo n’est cependant pas une centrale nucléaire mais un centre de stockage de déchets (stabilisés et conditionnés dans des fûts en béton ou en acier) qui du fait de son implantation à 500 mètres de profondeur sera peu vulnérable aux activités humaines comme aux catastrophes naturelles à l’inverse d’une centrale comme celle de Fukushima au Japon. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels montre que leurs conséquences resteraient limitées, et nettement en deçà du seuil réglementaire qui imposeraient des mesures de protection des populations (mise à l’abri, évacuation).
QUESTION 209
Posée par Bertrand GERMAIN (NEUFCHATEAU), le 02/07/2013
Quelles sont les modalités pour effectuer une visite des installations déjà existantes avec les élèves ? Merci
Réponse du 05/08/2013,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
Pour organiser une visite scolaire nous vous invitons à contacter, par téléphone ou par mail, le service communication du site de l’Andra que vous souhaitez visiter :
Pour visiter les installations sur le site de Meuse/Haute-Marne
• Par téléphone : 0 805 107 907 (appel gratuit depuis un poste fixe)
• Par courriel : visite.55.52@andra.fr
Pour visiter les installations sur le site de la Manche
• Par téléphone : 02.33.01.69.00 (appel gratuit depuis un poste fixe)
• Par courriel : marie-pierre.germain@andra.fr
Pour visiter les installations sur les sites de l’Aube
• Par téléphone : 0 800 31 41 51 (appel gratuit depuis un poste fixe)
• Par courriel : comm-centresaube@andra.fr
Vous pouvez également retrouver l’ensemble de ces informations sur le site internet www.andra.fr.
QUESTION 208
Posée par Ghislain QUETEL (EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE), le 02/07/2013
Dans le nucléaire la transparence de l'information est une véritable utopie ... Est-on en droit d'espérer un réel changement ? Peut-on avoir un total accès aux dossiers de sureté sans censure ? Est-il possible de faire confiance aux scientifiques qui sont bien souvent "juge et parti" ...
Réponse du 30/09/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La transparence de l’information et l’évaluation des recherches sont des conditions essentielles pour assurer la confiance vis-à-vis du travail mené par les scientifiques.
Les dossiers de sûreté, réalisés par l’Andra pour préparer le projet Cigéo, ainsi que les avis des autorités de contrôle et d’évaluation sont accessibles au public (voir notamment la rubrique « Les avis des autorités de contrôle et d’évaluation » du site du débat public ainsi que le site internet de l’Andra).
Concernant les travaux scientifiques :
Les recherches menées par l’Andra font appel à une large communauté scientifique (10 organismes et établissements universitaires partenaires, 70 laboratoires académiques, participation à 12 programmes de recherche européens depuis 2006…). Chaque année, les résultats des recherches font l’objet de 50 à 70 publications.
Dans son rapport d’évaluation en 2012, l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Aeres) considère que « l’Andra est probablement l’un des établissements les plus évalués de France y compris et surtout dans son activité de recherche ».
L’Autorité de sûreté nucléaire a souligné dans son avis du 16 mai 2013 la qualité des études et des recherches menées par l’Andra, notamment dans le Laboratoire souterrain ainsi que les points à approfondir. L’Andra a indiqué comment elle prenait en compte ces recommandations ../docs/rapport-etude/reponse-andra-avis-asn-20130516.pdf
La Commission nationale d’évaluation, mise en place par le Parlement pour évaluer les recherches menées sur la gestion des déchets radioactifs, rend public chaque année son rapport d’évaluation et le présente à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques ainsi qu’au Comité local d’information et de suivi (Clis) du Laboratoire souterrain. Le Clis commande également régulièrement des expertises sur les dossiers de l’Andra ou des sujets plus ciblés.
Tous ces éléments sont des gages de la robustesse de la démarche qui est mise en œuvre pour garantir la sûreté du projet.
QUESTION 207
Posée par Eric CAT (URVILLE-NACQUEVILLE), le 02/07/2013
Serait-il possible de prévoir le stockage de nos déchets radioactifs sous le Sahara, lieu désert ?
Réponse du 24/10/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Sur le plan réglementaire, la directive européenne du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre des combustibles usés et des déchets radioactifs stipule que les déchets radioactifs sont stockés dans l’Etat membre où ils ont été produits. L’utilisation d’une installation de stockage dans un autre pays est soumise à un accord intergouvernemental et implique de s’assurer que :
• le pays de destination a conclu un accord avec la Communauté Euratom ou est partie à la convention commune sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs,
• qu’il dispose de programmes de gestion et de stockage des déchets radioactifs dont les objectifs, d’un haut niveau de sûreté, sont équivalents à ceux fixés par la directive,
• que l’installation de stockage du pays de destination est autorisée à recevoir les déchets radioactifs à transférer, est en activité avant le transfert et qu’elle est gérée conformément aux exigences établies dans le cadre du programme de gestion et de stockage des déchets radioactifs de ce pays de destination.
Sur le plan technique, la conception d’un stockage sous un milieu désertique nécessiterait l’étude détaillée des propriétés géologiques du site pour concevoir un stockage adapté et s’assurer de sa capacité à protéger l’homme et l’environnement à très long terme. L’étude devrait également prendre en compte les évolutions climatiques possibles sur le long terme. A titre d’exemple, le Sahara a connu une période humide il y a environ 10 000 ans.
QUESTION 206
Posée par Robert BLAS (PINSAC), le 02/07/2013
Pourquoi l'argile est-elle considérée comme stable ?
Réponse du 12/09/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La couche argileuse du Callovo-Oxfordien, qui pourrait accueillir le stockage Cigéo en Meuse/Haute-Marne, est une couche sédimentaire épaisse (140 à 160 m environ) située à une profondeur d’environ 500 m sur la zone d’intérêt pour l’implantation de Cigéo. Elle s’est formée il y a 160 millions d’années en milieu marin, et est restée dans ce milieu pendant presque 100 millions d’années. Elle appartient à l’ensemble géologique du Bassin Parisien qui repose sur un socle cristallin profondément enfoui, vieux de plus de 500 millions d’années. A grande échelle, le bassin Parisien est considéré comme stable sur le plan géologique, ce qui ne signifie pas qu’il n’a pas été dans le passé et ne puisse pas être affecté dans le futur, par des phénomènes naturels (grands changements climatiques, mouvements tectoniques).
C’est par rapport aux effets de ces phénomènes naturels, susceptibles d’intervenir sur le prochain million d’années, sur sa capacité de confinement que la couche du Callovo-Oxfordien est qualifiée de stable.
Suite aux études menées depuis plus de quinze ans, notamment l’analyse de son passé géologique et l’évaluation de son évolution sur le prochain million d’années, cette couche est considérée comme stable pour les raisons suivantes :
• Les mouvements tectoniques, parfois importants, qu’elle a subis au cours des 160 millions d’années de son histoire n’ont pas créé de failles sur la zone d’intérêt pour le stockage et les processus physico-chimiques qu’ils ont induits ont même conduit au renforcement de ses propriétés par la diminution de sa porosité. Les mouvements tectoniques possibles sur le prochain million d’années, qui resteront limités, ne sont pas susceptibles de créer de nouvelles failles.
• Elle est suffisamment profonde pour ne pas avoir été ni être atteinte dans le futur par les processus liés à l’évolution climatique (gel lors des périodes glaciaires, érosion des formations superficielles).
QUESTION 205
Posée par Annick HOUSSIN (EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE), le 28/06/2013
Pourquoi limiter à 100 ans l'exploitation d'un site de stockage de déchets nucléaires potentiellement dangereux sur une durée estimée à 100 000 ans?
Réponse du 17/10/2013,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
Si Cigéo est autorisé, sa durée prévisionnelle d’exploitation sera d’environ 100 ans. C’est le délai qui est nécessaire pour prendre en charge le stock de déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue existants et en cours de production par les installations nucléaires actuelles. 100 ans, c’est aussi la durée minimale pendant laquelle la réversibilité du stockage devra être assurée. En fonction de l’expérience acquise lors de l’exploitation de Cigéo et des progrès scientifiques et technologiques, les générations suivantes seront libres de décider du devenir de Cigéo, en particulier de son calendrier de fermeture.
Le stockage profond donne la possibilité aux générations suivantes de mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et de ne pas reporter indéfiniment leur charge sur les générations futures. Pour cela, les ouvrages du stockage (alvéoles de stockage des déchets, galeries souterraines, puits, descenderies) devront être refermés. Ces opérations de fermeture pourront être réalisées de manière progressive. L’Andra propose que chaque étape de fermeture fasse l’objet d’une autorisation spécifique. Le Parlement a d’ores et déjà décidé que seule une loi pourrait autoriser la fermeture définitive du stockage.
Après la fermeture du stockage, la sûreté sera assurée de manière passive, sans nécessité d’action humaine. Une surveillance du site pourra néanmoins être maintenue aussi longtemps que les générations futures le souhaiteront et des actions seront menées pour conserver et transmettre sa mémoire.
QUESTION 204
Posée par Albert LESCOFFIER (NEUFCHÂTEAU), le 27/06/2013
Comment est géré l'échauffement des déchets? Quelle température maximum peut-être atteinte?
Réponse du 29/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Dans le stockage, la chaleur dégagée par les déchets de haute activité s’évacuera majoritairement dans la roche. Des expérimentations thermiques ont été réalisées au Laboratoire souterrain pour valider les paramètres thermiques de la roche.
Cigéo est conçu pour que la température dans la roche reste inférieure à 100 °C. Cela repose notamment sur l’espacement entre les alvéoles de stockage et sur la limitation de la puissance thermique des déchets stockés (la puissance thermique d’un colis de déchets vitrifiés de haute activité, de l’ordre de 2 000 watts moment de sa fabrication, sera descendue à 500 watts au bout d’une soixantaine d’années, avant leur mise en stockage).
QUESTION 203 - Des collectifs citoyens
Posée par Maurice MICHEL, ASODEDRA, le 26/06/2013
Tous les articles de presse consacrés à l’asphyxie du débat public sur Bure font référence aux « opposants » à l’enfouissement des déchets nucléaires (ou au projet Cigéo) et/ou aux opposants au débat public, les deux catégories n’étant pas forcément congruentes comme vous le savez. Mais aucun ne mentionne les associations ou collectifs locaux organisés créés pour soutenir le projet et/ou simplement «partisans » de sa réalisation.
Il pourrait être intéressant qu’une petite association, comme la nôtre, opposée à tout enfouissement de DRA et enracinée dans notre terroir puisse discuter, échanger avec une association homologue, favorable à ce mode de gestion des déchets nucléaires. Pour l’heure, nous ne pouvons discuter qu’avec des acteurs institutionnels : l’Etat ou ses représentants, les membres de la filière nucléaire (entreprises, organes de contrôle et d’accompagnement, experts et scientifiques, les organismes professionnels (groupements d’entreprises, syndicats d’employeurs et de salariés, compagnies consulaires, etc.), les collectivités et les élus, etc. Même s’il est un lieu naturel et intéressant d’échange, Le CLIS en fait partie.
Il ne s’agit pas de contester la légitimité de ces acteurs, ce n’est pas notre propos. Nous souhaitons simplement savoir si, en dehors de cet environnement institutionnel, comme il y a des associations locales ou des collectifs locaux d’«opposants » au projet de centre de stockage de Bure, il existe aussi des associations locales ou des collectifs locaux qui regroupent les « partisans » du projet dont l’indépendance ne serait pas sujette à caution parce qu’exempts de tout conflit d’intérêt [1]. Au plan national, deux grandes structures associatives sont, nous dit-on, « pro-enfouissement », mais à notre connaissance, elles ne répondent pas à la condition d’indépendance précitée et elles n’ont pas de déclinaison locale.
S’IL EXISTE, AU PLAN LOCAL, UNE OU PLUSIEURS STRUCTURES CITOYENNES FAVORABLES AU PROJET, ELLES SONT FORCÉMENT CONNUES PAR LE CLIS et la CPDP. POUVEZ-VOUS NOUS EN COMMUNIQUER LES COORDONNÉES ?
[1] Notre association ne bénéficie d'aucun financement public ou privé
Réponse du 12/09/2013,
La Commission n'a pas connaissance de l'existence d'associations locales favorables au projet de stockage des déchets nucléaires à Bure-Saudron. Les entités qui ont exprimé leur soutien au projet sont, pour l'essentiel, des élus, des collectivités territoriales, des chambres consulaires, des syndicats patronaux ou de salariés, des PME et des particuliers.
En revanche, au niveau national quelques associations se sont exprimées en faveur du projet. Vous trouverez leurs coordonnées complètes en première page de leurs cahiers d'acteurs. Il s'agit de :
• Sauvons Le Climat - SLC (cahier d'acteurs n°3)
• Société française d'Energie Nucléaire - SFEN (cahier d'acteurs n°13)
• SFEN jeune génération (cahier d'acteurs n°19)
• Confrontations Europe, présentée davantage comme un think tank et lobby d'intérêt général (cahier d'acteurs n°20)
QUESTION 202 - LE TRANSPORT DES DÉCHETS RADIOACTIFS (DRA)
Posée par Maurice MICHEL, ASODEDRA, le 26/06/2013
Nous sommes vivement préoccupés, vous le savez, par les dangers présentés par le projet Cigéo pour les populations qui résident dans les zones voisines du site. Nous le sommes aussi par les risques spécifiques au transport des colis de déchets hautement radioactifs, pour le public riverain des axes de transport, entre leurs lieux de production ou les lieux où ils sont actuellement entreposés (La Hague, Marcoule, Cadarache, etc.) et le site de Bure où il est prévu de les enterrer. Plusieurs membres du CLIS le sont aussi.
Notre inquiétude est d’autant plus forte que le dossier du maître d’ouvrage (DMO), élaboré pour nourrir le débat public, est muet sur les mesures réelles de sûreté et de sécurité adoptées ou envisagées, y compris en cas d’accident ou de catastrophe ferroviaire. Si on excepte les scénarios techniques de desserte de Bure (p. 48 et 49), il consacre une seule page au transport des déchets, sans aucun développement sur les dispositions de précaution ou de prévention des risques, alors que tous les préventeurs s’accordent à reconnaître que l’activité de transport est un des secteurs les plus accidentogénes de notre pays.
De surcroît, nous estimons que l’organisation du débat public définie par la commission nationale du débat public (CNDP) ne prend pas correctement en compte la population riveraine des axes de transport des déchets nucléaires (pas de réunion spécifique, pas d’interlocuteur qualifié sur ce thème dans les réunions). Ensuite, nous observons, à lecture du DMO, que la carte des « itinéraires étudiés » pour l’acheminement ferroviaire des colis de DRA vers Cigéo ne mentionne que quelques (rares) grandes villes situées sur leur passage, par exemple :
- Dijon et Lyon sur l’axe Sud / Nord
- Caen, Rouen, Amiens, Reims sur l’hypothèse Nord de l’axe Ouest /
Est, Caen sur les hypothèses Sud et médiane du même axe, Paris étant «tangenté » dans les trois hypothèses(?).
Il nous paraît indispensable que toute la population riveraine des convois de DRA, y compris celle des localités de la banlieue parisienne, soit informée des projets de transport des DRA qui les concernent au premier chef. C’est dans cet esprit que nous posons la question suivante : QUELLE EST LA LISTE EXHAUSTIVE DES LOCALITÉS (OU GARES) SITUÉES SUR CHAQUE ITINÉRAIRE PROPOSÉ (EN PAGE 47 DU DMO) ?
Nous avons posé à plusieurs reprises, mais en vain, cette question à Monsieur le président de la commission particulière du débat public.
Réponse du 21/08/2013,
Réponse apportée par le ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie :
En France, le transport de matières nucléaires est soumis au Code de la Défense. Le Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité, placé auprès du ministre de l'Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE) est chargé du respect des règles de confidentialité. Celles-ci s'imposent à tous les intervenants (pouvoirs publics, exploitants, transporteurs, etc.) lors de la préparation et l'exécution des transports de matières nucléaires.
La réglementation relative au transport des combustibles usés et des déchets radioactifs impose au transporteur de ne pas communiquer les itinéraires précis pour des raisons de sécurité. Le trajet emprunté est validé par les autorités compétentes et sa diffusion est restreinte.
48 heures avant le transport, le COGIC (Centre Opérationnel de gestion interministérielle de crises) informe l’ensemble des autorités compétentes et les services de sécurité de l’Etat au niveau national ainsi que les services de sécurité et d’intervention dans les régions et les départements concernés.
QUESTION 201 - Les localités retenues pour stocker les remblais
Posée par Maurice MICHEL, ASODEDRA, le 26/06/2013
Les volumes des remblais issus des travaux de creusement du puits et des galeries d’enfouissement sont considérables. On sait les nuisances liées à ce type d’activité : circulation d’engins de transports, bruit, dégagements de poussières, risque de transformation de ces zones de stockage de déblais en dépotoirs à ciel ouvert [comme dans le Var actuellement à partir de décharges de chantiers du BTP, d’abord maîtrisées et ensuite échappant à tout contrôle].
Par avenant du 01/10/2005 à la convention passée avec la Safer de Lorraine (voir en annexe notre analyse commentée de la convention [1]), l’Andra lui a confié la mission de recenser les sites potentiels d’accueil des remblais. Dans ce but, il est demandé à la Safer-L, de contacter les maires, d’abord dans les 22 communes de la « zone des 10km », puis par extension dans d’autres communes. A la suite de ces contacts, la Safer-L doit informer l’Andra des possibilités de stockage qu’elle a identifiées (« _à ciel ouvert ou souterrain_ », volume, conditions d’accès, puis contractualisation avec les propriétaires après accord de l’Andra au cas par cas).
L’avenant nous apprend aussi que, d’ores et déjà, la Safer-L a identifié des sites propices sur les communes DE JUVIGNY EN PERTHOIS, AULNOIS EN PERTHOIS, PAGNY SUR MEUSE, SAVONNIÈRES EN PERTHOIS ET VOID.
QUESTION : QUELLES SONT, EN SUS DES 5 COMMUNES PRÉCITÉES, LES COMMUNES RECENSÉES AU 31/05/2013 EN VUE D’ACCUEILLIR LES DÉBLAIS PROVENANT DU CREUSEMENT DE CIGÉO ?
[1] Il ne serait pas inintéressant de connaître les réponses de la Safer-L aux questions que pose cette convention. Nous mettons son directeur en copie.
Réponse du 29/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La gestion des déblais issus du creusement des installations de Cigéo fait l’objet d’une attention particulière de la part de l’Andra. A l’époque de la convention passée avec la SAFER de Lorraine, différentes hypothèses étaient étudiées. Parmi celles-ci, le transfert des déblais vers des carrières avait été envisagé.
L’Andra privilégie aujourd’hui une gestion des déblais à proximité de Cigéo pour limiter les transports associés. L’Andra étudie le stockage de ces déblais en surface, dans des verses qui feront l’objet d’un traitement spécifique afin d’être intégrées au paysage (utilisation de la topographie du site, couverture végétale, reboisement…) et en cherchant à limiter leur extension, en hauteur et en surface.
QUESTION 200 - Les propriétés et les réserves foncières de l'Andra (question posée à l'Andra), et l'analyse de la convention Andra/Safer-Lorraine (questions posées à la Safer)
Posée par Maurice MICHEL, ASODEDRA, le 26/06/2013
Depuis octobre 2010, il y a exactement 2 ans, nous cherchons à connaître précisément les acquisitions foncières du centre Meuse/Haute-Marne de l’Andra pour les besoins de son laboratoire de Bure et de son futur centre de stockage en profondeur des déchets nucléaires dits faiblement et moyennement actifs et à vie longue (FA et MA-VL) qui répond désormais à l’appellation de Cigéo (centre industriel de stockage géologique). Dans cet objectif, nous avons demandé leur localisation, la nature du terrain (forêt, terre agricole, carrière, etc.), l’adresse, la superficie, la date d’acquisition, le prix d’acquisition, l’identification du vendeur (nom, adresse) et leur affectation donnée ou prévue (entreposage, stockage), aménagement de locaux administratif, etc.).
Nous avons échangé avec le CLIS et l’Andra, moult courriers et courriels qui nous ont permis de n’avoir accès qu’à des informations parcellaires.
A l’occasion de ces échanges, nous avons toutefois appris que l’Andra constituait ses réserves foncières de deux façons, directe, en achetant elle-même des terres agricoles et/ou forestières, l’autre indirecte, en passant par les Safer (sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural) de Lorraine (Safer-L) et de Champagne-Ardenne (Safer-CA) dans le cadre de conventions conclues avec elles.
Dans la foulée, nous avons demandé copie de ces deux conventions dont la communication nous a été refusée d’abord par l’Andra, puis par les deux Safer. Après plusieurs échanges avec les deux organismes et deux saisines de la CADA (commission d’accès aux documents administratifs), les conventions ont finalement été communiquées au CLIS, dans sa séance du 14 mai 2012. Les deux Safer ont, chacune, accompagné leur communication de la production d’un tableau sur les terres mises en réserve pour le compte de l’Andra. La Safer-L a actualisé ses données en févier 2013 et l’Andra a transmis au CLIS une actualisation des siennes au 31/12/2012.
Les données communiquées par l’Andra et les Safer comportent des insuffisances et aboutissent à des chiffres difficiles à concaténer car ils sont pour partie inexacts et incohérents. En tout cas, la diversité des sources d’information et des dates d’actualisation n’en facilite pas l’agrégation. Sous réserve de ces remarques, nous estimons que l’Andra possède ou dispose en réserves foncières d’un peu plus de 1.500 HECTARES dans les départements de la Meuse et de la Haute-Marne.
>> SAFER Analyse convention
Ce n’est qu’une estimation. C’est pourquoi nous posons une question simplifiée par rapport à nos demandes initiales : QUELLE EST LA SUPERFICIE PAR COMMUNE AU 31 MAI 2013 DES PROPRIÉTÉS FONCIÈRES DE L’ANDRA ET DES RÉSERVES FONCIÈRES CONSTITUÉES POUR SON COMPTE, D’UNE PART, DANS LES DÉPARTEMENTS DE LA MEUSE ET DE LA HAUTE-MARNE, D’AUTRE PART, HORS DE CES DEUX DÉPARTEMENTS ?
Réponse du 23/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
En tant qu’exploitant de cigéo, si celui-ci est autorisé, l’Andra devra être propriétaire des terrains où seraient implantées les installations de surface du Centre et où seraient aménagées les voies d’accès nécessaires. L’Andra est consciente que cette obligation pourrait engendrer la disparition ou la déstructuration d’exploitations agricoles. Afin d’éviter toute expropriation, l’Andra a engagé des acquisitions foncières en Meuse et en Haute-Marne (exploitations, terres agricoles et terrains boisés) lui permettant de constituer une réserve pour procéder à des échanges (par des actes notariés ou par des actes administratifs amiables) ou pour restructurer les exploitations concernées si besoin. Cette démarche a déjà été conduite pour la construction du Centre industriel de regroupement, d’entreposage et de stockage (Cires) ouvert dans l'Aube en août 2003. Ce système avait correctement fonctionné et permis d'obtenir les terrains nécessaires par de simples actes de ventes ou d'échanges.
Les réserves foncières effectuées par l’Andra dans le cadre de Cigéo ne concernent que les départements de Meuse et de Haute-Marne. Vous trouverez dans le tableau ci-dessous, les acquisitions effectuées au 31 mai 2013.
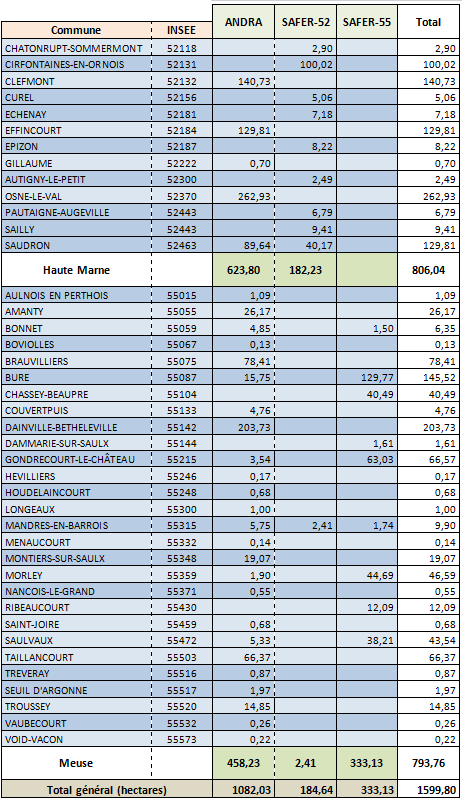
QUESTION 199
Posée par Francis ROCCHIA (NEUFCHÂTEAU), le 26/06/2013
La sincérité des incidents et des différents problèmes survenant en cours d'installation et d'utilisation sont-t-elles publiées et vérifiées par des commissions qualifiées, indépendantes, non permanentes? Il est souvent dit que nous aurons à faire à des incidents mineurs, quelle valeur y apporter!
Réponse du 24/10/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Conformément à la loi du 13 juin 2006 sur la transparence et la sécurité nucléaire, tous les incidents et accidents dans les installations nucléaires font systématiquement l’objet d’une déclaration immédiate à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), organisme de contrôle indépendant, et d’une information du public. Les exploitants des installations nucléaires doivent aussi déclarer à l’ASN les écarts par rapport au fonctionnement normal des installations, même s’ils n’ont aucune importance du point de vue de la sûreté.
La gravité des événements déclarés est évaluée grâce à une échelle internationale de gravité, l’échelle INES, qui comprend 7 niveaux. L’ASN valide l’évaluation de la gravité de chaque événement. Les événements de niveaux 1 à 3, sans conséquence significative sur les populations et l'environnement, sont qualifiés d'incidents. En 2012, sur les installations nucléaires françaises, 110 incidents de niveau 1 ont été recensés, seulement deux de niveau 2 et aucun de niveau supérieur.
QUESTION 198 - Caractéristiques de la géologie du stockage
Posée par Laurence LAVERGNE (CHÂTEL SAINT GERMAIN), le 25/06/2013
Le dossier donne quelques exemples de stockages profonds dans des roches de natures très différentes, notamment argiles et granites. L'exposé du chapitre 3 du dossier explicite un choix par défaut dans une couche d'argile. Quelles sont les avantages versus les inconvénients de chacune des formations selon leur nature ? Toutes les générations futures requièrent en effet la meilleure solution, et pas la solution par défaut qu'un petit bout de la seule génération actuelle aurait refusé.
Réponse du 24/10/2013,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
Selon les pays et leur géologie, plusieurs types de roches sont étudiés pour l’implantation de stockages profonds. Dans tous les cas, la conception du stockage doit être adaptée aux caractéristiques de la roche hôte et du site d’implantation.
Le granite est une roche avec une résistance mécanique importante, ce qui facilite le creusement des ouvrages souterrains. Cette roche peut néanmoins présenter des fractures par lesquelles l’eau peut circuler. Les concepts de stockage dans le granite étudiés en Suède et en Finlande prévoient des conteneurs de stockage en cuivre protégés par de l’argile gonflante placée entre ces conteneurs et le granite pour assurer le confinement à long terme de la radioactivité. L’Andra a poursuivi ses recherches sur le milieu granitique jusqu’en 2005, en s’appuyant notamment sur les travaux menés dans les laboratoires souterrains d’autres pays. Ces recherches ont conduit l’Andra à conclure qu’un stockage dans les massifs granitiques ne présenterait pas de caractère rédhibitoire mais que la principale incertitude porte sur l’existence de sites en France avec un granite ne présentant pas une trop forte densité de fractures.
L’argile est très peu perméable et possède la propriété de pouvoir fixer un grand nombre d’éléments chimiques grâce à sa microstructure en feuillets. La roche étudiée par l’Andra au moyen du Laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne possède des propriétés favorables pour confiner la radioactivité à très long terme : l’eau n’y circule pas, la couche est homogène et son épaisseur est importante (plus de 130 mètres). Aucune faille affectant cette couche n’a été mise en évidence sur la zone étudiée. Contrairement au granite, les galeries souterraines doivent être soutenues avec un revêtement en béton ou en acier. Plusieurs pays étudient également l’option d’un stockage dans l’argile (Belgique, Japon, Suisse).
QUESTION 197
Posée par Cédric PAILLARD, STE MCMS (LIFFOL LE PETIT), le 25/06/2013
Entrepreneur en construction métallique, je souhaiterai que mon entreprise participe à la réalisation de ce projet.
Réponse du 31/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Travailler avec les entreprises locales est un objectif prioritaire pour l’Andra. Chaque année, l’Andra organise avec l'association « Energic ST 52/55 » une manifestation « Devenez prestataires de l’Andra » destinée aux PME locales. Ces rencontres permettent aux entreprises de se familiariser avec les exigences et les procédures de l’Andra et de se préparer aux marchés futurs. Nous vous invitons à prendre contact avec le service achats du Centre de Meuse/Haute-Marne afin de participer à la prochaine de ces manifestations. Vous trouverez les contacts et toutes autres informations utiles dans le document : http://www.andra.fr/download/site-principal/document/editions/409b.pdf
Par ailleurs, pour prendre connaissance des différents appels d’offres en cours, n’hésitez pas à consulter notre site internet à l’adresse http://www.andra.fr/index.php?id=itemmenu_binddings_225_1_1
QUESTION 196 - Securité
Posée par Gerard BESSIERES, CITOYEN (VARENNES SUR AMANCE), le 24/06/2013
Bonjour
Comment pensez vous éteindre un éventuel incendie dans une ou plusieurs galeries au fond mais aussi en surface dans le pré-stockage? Quelles techniques dans la lutte contre l'incendie préconisez vous dans ces deux cas? Ne risquez vous pas d'avoir un effet "dominos"entre les colis stockés notamment en surface? Comment sécuriser votre personnel ?
Salutations
Réponse du 31/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Pour réduire le risque d’incendie, une première mesure consiste à limiter la quantité de produits combustibles ou inflammables dans les équipements du stockage. Ainsi, les câbles électriques seront ignifugés et les véhicules à moteur thermique seront interdits dans l’installation nucléaire souterraine de Cigéo. De plus, des dispositifs de détection incendie seront répartis dans les installations pour détecter rapidement et localiser tout départ de feu, ainsi que des systèmes automatiques de lutte contre l'incendie en vue d'éteindre rapidement tout départ de feu. Le personnel sera également formé et sensibilisé au risque d’incendie afin de réagir rapidement et efficacement, et des sapeurs-pompiers de formation seront présents pour assurer la sécurité des lieux et du personnel.
Malgré toutes ces dispositions, une situation d'incendie est quand même considérée par prudence. Dans les installations de surface, les mêmes principes sont appliqués que dans les installations nucléaires de base : en cas d’incendie, les locaux concernés sont isolés du reste de l’installation, les moyens d’extinction et d’intervention sont déclenchés et le personnel est évacué. Dans l’installation souterraine, compte tenu de sa géométrie spécifique, ces dispositions sont adaptées. Des systèmes de compartimentage et de ventilation sont prévus pour limiter la propagation du feu. Des équipements d’intervention seront prépositionnés dans l’installation souterraine en permanence. L'architecture souterraine retenue pour le stockage permet aux secours d'intervenir dans des galeries à l'abri des fumées et facilite l'évacuation du personnel.
Outre la mise à l’abri du personnel, la maîtrise du risque incendie vise aussi à protéger les colis contenant les substances radioactives des effets de l’incendie afin de maintenir le confinement de ces substances. Pour cela, les colis sont disposés dans des équipements qualifiés pour résister au feu (cellules résistantes au feu munies de portes coupe-feu, hotte de protection pour le transfert dans l’installation souterraine). Les conteneurs de stockage assurent également une protection contre l’incendie. Ces dispositions permettent d’exclure tout effet domino entre les colis stockés.
QUESTION 195
Posée par Patrick MONNET (LYON), le 24/06/2013
Madame, Monsieur,
Enfouir à 4 ou 500 mètres de profondeur des déchets radioactifs extrêmement dangereux nous amène à nous poser la question : Qui peut nous garantir que ce stockage en profondeur de déchets dangereux pendant des millions d’années ne laissera pas des éléments s’échapper ?
Il y a 40 ans, en Allemagne, les géologues étaient certains que la mine de sel d’Asse dans le Nord de l’Allemagne qui contient du sel stable depuis 150 millions d’année continuerait à être un stockage hermétique pour des millions d’années.
La mine accueille depuis plus de 40 ans des déchets nucléaires de faible activité (125 000 futs) et moyenne activité (1300 futs) à vie longue (FAVL et MAVL). Notons enfin la présence de 28 kg de plutonium (dont 10 microgrammes suffisent à tuer un être humain) au milieu des déchets de faible et moyenne activité…
Dès les premiers dépôts, ce « centre de recherche modèle », présenté comme parfaitement étanche était déjà sujet à des infiltrations d’eau. Aujourd’hui, ce ne sont pas moins de 12 m3 d’eau qui pénètrent chaque jour dans la mine ; des affaissements ont déjà eu lieu, les galeries fragilisées menacent de s’effondrer sur les déchets et la saumure dans laquelle baignent les fûts. Il y a un risque à moyen terme de contaminer les nappes phréatiques et les sols d’une région entière.
Devant cet état de délabrement dénoncé depuis des années par les populations locales, le Ministre de l’Environnement et de la Sûreté Nucléaire Norbert Röttgen préconise comme réponse provisoire de retirer de l’ancienne mine les 126 000 fûts, dont on ignore l’état de corrosion. Dix années au moins seront nécessaires pour cette opération, dont le coût est estimé par les autorités à 3,7 milliards d’euros. Les associations appellent à mettre en œuvre au plus vite cette option, la « moins pire de toutes ». Toutefois, elles soulignent que le problème des déchets n'en sera pas réglé pour autant, et continuent de dénoncer une gestion irresponsable.
Tirons les leçons de l’exemple allemand : renonçons dès à présent à l’enfouissement des déchets.
En tant que citoyen, je ne peux laisser cette solution se mettre en place et voir dans dix ans, cent ans, mille ans nos enfants nous accuser d’inconscience en leur léguant des sols, des nappes phréatiques contaminées qui mettent en danger, la vie, la santé, les conditions de toute une population.
Cordialement.
Réponse du 04/10/2013,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
En aucun cas la mine de Asse en Allemagne ne peut être comparée au projet Cigéo. Le stockage à Asse a été réalisé au titre du droit minier et non des réglementations de la sûreté nucléaire telles qu’elles existent aujourd’hui. Il s’agit d’une ancienne mine de sel qui a été reconvertie en un stockage de déchets radioactifs en 1967. Lors du creusement de la mine, aucune précaution n’avait été prise pour préserver le confinement assuré par le milieu géologique. Le stockage n’avait pas non plus été conçu au départ pour être réversible. Les difficultés rencontrées aujourd’hui à Asse illustrent pleinement l’importance d’une démarche d’étude scientifique et d’évaluation préalablement à la décision de mettre en œuvre un projet de stockage.
Cigéo ne pourra être autorisé qu'après un long processus d’études et de recherches, initié il y a plus de 20 ans par la loi de 1991. Les phénomènes induits par le creusement du stockage sur la roche argileuse sont étudiés au moyen du Laboratoire souterrain. La réversibilité est prise en compte dès la conception du stockage et des essais ont été réalisés pour confirmer sa faisabilité. Des autorités indépendantes (Commission nationale d’évaluation, Autorité de sûreté nucléaire, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire…) contrôlent l’avancement du projet à chaque étape. Les acteurs locaux sont impliqués notamment au travers du Comité local d’information et de suivi qui s’appuie également sur des expertises indépendantes.
Si Cigéo est autorisé, il sera construit progressivement. L’Andra propose que des rendez-vous soient programmés régulièrement avec l’ensemble des acteurs (riverains, collectivités, évaluateurs, État…) pour contrôler le déroulement du stockage. Ces rendez-vous seront notamment alimentés par les résultats des réexamens périodiques de sûreté, conduits au moins tous les 10 ans par l’Autorité de sûreté nucléaire, et par la surveillance du stockage. Le premier de ces rendez-vous pourrait avoir lieu cinq ans après le démarrage du centre.
QUESTION 194
Posée par Robert MASSENET (COUPRAY), le 24/06/2013
Réversibilité = 100 ans, décroissance des déchets = de quelques centaines à plusieurs centaines de milliers d'années? Parlez-vous bien de réversibilité?
Réponse du 12/09/2013,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
Le principe du stockage profond consiste à confiner les déchets radioactifs et à les isoler de l’homme et de l’environnement sur de très longues échelles de temps. La dangerosité des déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue diminuera progressivement du fait de la décroissance naturelle de la radioactivité qu’ils contiennent, à l’échelle de plusieurs centaines de milliers d’années.
Le Parlement a demandé à l’Andra que le stockage soit réversible pendant au moins 100 ans pour laisser des portes ouvertes aux générations suivantes. En fonction de l’expérience acquise lors de l’exploitation de Cigéo (en 100 ans, Cigéo aura fait l’objet d’au moins 10 réexamens complets de sûreté, en accord avec les exigences de l’Autorité de sûreté nucléaire qui impose un réexamen périodique de sûreté, au moins tous les 10 ans, pour toutes les installations nucléaires) et des progrès scientifiques et technologiques, les générations suivantes seront libres de décider du devenir de Cigéo, en particulier de son calendrier de fermeture. Elles pourront réévaluer la période de réversibilité. Au final, le but du stockage profond est de mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs pour ne pas reporter indéfiniment la charge de la gestion de ces déchets sur les générations futures.
Le débat public alimentera la préparation de la future loi qui fixera les conditions de réversibilité du stockage. Cette loi sera votée avant que la création de Cigéo ne puisse être décidée.
Pour en savoir plus sur les propositions de l’Andra sur la réversibilité de Cigéo : http://www.cigéo.com/images/cigeo/site/pdf/499.pdf
QUESTION 193 - SIDT
Posée par Jacky DUHAUT, CGT (METZ), le 22/06/2013
Pourquoi les Vosges sont exclues du schéma. Les Vosges de l'ouest, secteur de Neufchateau, proches géographiquement, sinistrées économiquement et socialement, doivent bénéficier des mesures d'aménagement du territoire.
Réponse du 17/07/2013,
Réponse apportée par le Directeur du Schéma interdépartemental de développement du territoire :
Dans le cadre de l'élaboration du Schéma de Développement du Territoire Meuse-Haute-Marne, les groupes de travail qui ont étudié les différentes problématiques de développement se sont attachés à construire leurs analyses dans un périmètre qui inclut les parties de départements concernées par les perspectives de l'installation du centre industriel, de ses emplois et des activités qui seront sous-traitées. Les thèmes repris relèvent du développement économique, des infrastructures et des transports, ainsi que de l'habitat et des services aux populations, du développement durable et des modes d'aménagement. Le nord du département des Vosges et le bourg de Neufchâteau sont concernés.
Néanmoins, dans une approche des actions et des politiques d'accompagnement du chantier potentiellement à venir, le schéma de développement du territoire tient compte des départements qui se sont engagés dans une politique d'accueil du Laboratoire souterrain de l’Andra, à savoir la Meuse et la Haute-Marne.
QUESTION 192 - classification des déchets
Posée par Béatrice BEAUFILS (PARIS), le 22/06/2013
Pourquoi la classification des durées de vie des déchets utilise t-elle 31 ans comme limite de classe (>31 ans) plutôt que 30? Est-ce à cause du césium 137?
Réponse du 15/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Effectivement, c’est la période du césium 137 (30,15 ans) qui a conduit à adopter dans la classification des déchets radioactifs une limite arrondie à 31 ans.
QUESTION 191
Posée par Claude RAVIER (LEMMECOURT), le 21/06/2013
- Aucune information FINANCIERE sur les coûts
- Il faut une loi pour OBLIGER TOUS les acteurs de l'énergie à mentionner sur TOUT document, facture... le libellé suivant: "GASPILLER DE L'ENERGIE TUE la planète" comme cela est fait pour le tabac.
Réponse du 28/08/2013,
Réponse apportée par le ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie :
La sensibilisation du consommateur aux économies d'énergie est un des axes de la loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique. Conformément à cette loi, le Gouvernement a décidé de prescrire aux entreprises vendant de l'énergie ou des services énergétiques, l'obligation d'incitation aux économies d'énergie dans le cadre de leurs messages publicitaires. Deux textes sont ainsi venus compléter le dispositif législatif existant :
• le décret n°2006-1464 du 28 novembre 2006, relatif à la promotion des économies d'énergie dans les messages publicitaires des entreprises du secteur énergétique ;
• l'arrêté du 28 novembre 2006 relatif à la publicité dans le domaine de l'énergie.
Tout message publicitaire concernant l'énergie ou visant à sa consommation effectué par ou pour une entreprise qui vend de l'énergie ou des services afférents à l'utilisation de l'énergie, doit comporter la mention obligatoire : « L'énergie est notre avenir, économisons-là ! ». Cette mention concerne l'ensemble des médias.
QUESTION 190 - quid des réunions de proximité ?
Posée par Agnès WEILL (LORRAINE), le 20/06/2013
Vous évoquez dans votre dernier communiqué des "réunions de proximité" à la place des débats publics.
Comment être informé des dates et lieux de celles-ci ? Prévoyez-vous un calendrier publié sur le site ?
Réponse du 24/07/2013,
Deux permanences locales ont été organisées au mois de juillet, signalées chacunes par un dispositif d'information locale à l'échelle du canton.
- Lundi 8 juillet à Rachecourt-sur-Marne, pour laquelle 100 affiches et 500 tracts ont été distribués dans les mairies et les commerces du canton de Chevillon.
- Mercredi 17 juillet à Bonnet :
. 100 affiches et 500 tracts distribués dans les mairies et les commerces du canton de Gondrecourt-le-Château.
. deux insertions ont annoncé la réunion dans l'Est Républicain.
. M. le Maire de Bonnet a distribué le tract d'information dans toutes les boites aux lettres de sa commune.
QUESTION 189 - Rédaction d'un avis
Posée par Jean-Pierre PERVES, RETRAITÉ ANCIEN DIRECTEUR DE CENTRES DE RECHERCHE DU CEA (BURES SUR YVETTE), le 19/06/2013
J'ai essayé de mettre un avis sur votre site, mais, une fois complété, l'action sur "OK" ne marche pas. Comment vous faire parvenir un avis et y a t-il des limites (tailles du texte ou autres: mon avis pèse environ 11000 caractères espaces compris.
Réponse du 24/07/2013,
La Commission du débat public a bien reçu une contribution de votre part qui a été enregistrée dans la rubrique des avis : "AVIS 131 - CIGEO: UN PROJET NÉCESSAIRE ET ÉTHIQUE".
Si les difficultés de validation que vous avez rencontrées concernent un autre avis, je vous invite à nous le transmettre de nouveau, soit par l'intermédiaire du site internet, soit à l'adresse contact@debatpublic-cigeo.org.
Il n'existe aucune limite en termes de nombres de caractères.
QUESTION 188
Posée par Olivier NAUDIN (CHARDOGNE), le 19/06/2013
Il faut en toute transparence donner à la population le détail des subventions déjà versées par l'ANDRA, EDF, AREVA aux collectivités locales et aux entreprises ; plus être très clair et honnête sur les connaissances scientifiques actuelles, concernant la géologie du sous-sol et la réversibilité éternelle.
Réponse du 09/09/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Comme toutes les entreprises, les installations de l’Andra en Meuse/Haute-Marne sont soumises à la fiscalité de droit commun (il ne s’agit en aucun cas de subventions). En 2012, les taxes versées par l’Andra en Meuse/Haute-Marne par l’Andra se sont élevées à 6,7 M€. Les activités de l’Andra génèrent également de l'activité locale en créant des emplois (plus de 300 emplois directs et 12,4 M€ de commandes en Meuse/Haute-Marne en 2012 (ce montant a augmenté de 50 % par rapport à 2011 avec la construction de 2 nouveaux bâtiments), dont 8,7 M€ de contrats annuels récurrents liés au Centre).
Des taxes payées par les producteurs de déchets radioactifs (EDF, le CEA, Areva) sont reversées à la Meuse et la Haute-Marne afin d’accompagner le développement du territoire dans le cadre du Laboratoire souterrain et dans le futur du projet Cigéo. Il s’agit des taxes d’accompagnement et de diffusion technologique qui sont reçues par deux groupements d’intérêt public (GIP) en Meuse et en Haute-Marne pour gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation du Laboratoire ou du centre de stockage, mener des actions d'aménagement du territoire et de développement économique, soutenir des actions de formation et en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques. Chacun des groupements d’intérêt public a reçu 30 M€ en 2012.
EDF, le CEA et Areva mènent également une politique active en faveur du développement économique local. Cela comprend notamment la création d’installations (plate-forme logistique de pièces de rechange EDF à Velaines, bâtiments d’archives EDF à Bure et d’Areva à Houdelaincourt, projet Syndièse du CEA en Haute-Marne), l’appui aux entreprises locales pour spécialiser leur savoir-faire et leur permettre de développer leur activité auprès des exploitants nucléaires, des actions en faveur de la maîtrise de la demande d’énergie et de réduction des émissions de CO2 par les bâtiments.
Concernant les connaissances scientifiques, celles-ci sont régulièrement évaluées par différentes instances, en particulier :
• la Commission nationale d’évaluation (CNE), dont le rapport annuel est transmis au Gouvernement et au Parlement (Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques), présenté au Comité local d’information et de suivi du Laboratoire de Bure et rendu public ;
• l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui s’appuie sur l’expertise scientifique et technique de l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) et sur des Groupes Permanents d’experts ;
• le Conseil scientifique de l’Andra.
Les grands dossiers scientifiques et techniques que l’Andra remet dans le cadre de la loi font l’objet, à la demande de l’État, de revues internationales sous l’égide de l’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN/OCDE).
L’Andra a été évaluée en 2012 par l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES).
Des expertises sont régulièrement commandées par le Comité local d’information et de suivi du Laboratoire souterrain sur les grands dossiers de l’Andra ou sur des sujets plus ciblés.
Les recherches conduites par l’Andra font l’objet de 50 à 70 publications scientifiques internationales par an depuis 10 ans.
Les avis des autorités de contrôle et d’évaluation sont disponibles sur le site du débat public :../informer/documents-complementaires/avis-autorites-controle-et-evaluations-permanentes.html
Les recherches menées depuis les années 1990 ont montré que la géologie du site de Meuse/Haute-Marne est favorable à l’implantation d’un stockage profond. Dans la synthèse de son rapport 2012, la Commission nationale d’évaluation indique ainsi : « le site géologique de Meuse/Haute-Marne a été retenu pour des études poussées, parce qu'une couche d'argile, de plus de 130 m d'épaisseur et à 500 m de profondeur, a révélé d'excellentes qualités de confinement : stabilité depuis 100 millions d'années au moins, circulation de l'eau très lente, capacité de rétention élevée des éléments. »
La réversibilité aura nécessairement une durée limitée, comme l’a souligné l’ASN dans ses avis en 2006 et en 2011. En effet, le principe même du stockage est de mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs. Chaque étape de fermeture du stockage (fermeture des alvéoles contenant les déchets radioactifs, puis des galeries souterraines, puis des liaisons vers la surface) rendra nécessairement plus complexe l’accès aux colis de déchets puisqu’il serait alors nécessaire d’excaver les remblais de fermeture et les scellements pour revenir dans le stockage. En contrepartie, ces opérations de fermeture permettront de progresser vers une sûreté de plus en plus passive du stockage, sans nécessiter d’action humaine à terme. Après la fermeture, la surveillance du site pourra être poursuivie par les générations futures aussi longtemps qu’elles le souhaiteront.
Cigéo est conçu pour être fermé de manière progressive et pour laisser la possibilité aux générations suivantes de modifier le planning de fermeture si elles le souhaitent. L’Andra propose que chaque étape de fermeture fasse l’objet d’une autorisation spécifique et que des rendez-vous réguliers soient programmés avec l’ensemble des acteurs pour faire le point sur l’exploitation du stockage et préparer les étapes suivantes. Ces rendez-vous seront alimentés par les réexamens de sûreté réguliers du stockage et sa surveillance. A chaque étape, il sera possible de décider de poursuivre le processus de stockage tel qu’initialement prévu ou de le modifier. Les conditions de réversibilité et le calendrier de fermeture du stockage pourront être réexaminés lors de ces rendez-vous.
Réponse apportée par Edf :
Les Groupements d’Intérêt Public de Meuse et de Haute-Marne, perçoivent chacun annuellement une somme prélevée sur les installations nucléaires d'Edf, du CEA et d'Areva (30 millions d'euros par département en 2013). Leur vocation est de soutenir des actions d'aménagement du territoire, de développement économique, et de développement des connaissances scientifiques et technologiques.
EDF mène de surcroit des actions d'accompagnement économique en Meuse et en Haute-Marne. Il s'agit :
• de prêts participatifs aux entreprises pour financer des investissements créateurs d'emplois (ce qui a permis le maintien ou la création de 1000 emplois en Meuse et Haute-Marne depuis 2006) ;
• d'aides (expertise et contribution financière) apportées aux collectivités locales, bailleurs sociaux et particuliers pour des opérations de maîtrise de la demande de l'énergie et de développement des énergies renouvelables (depuis 2006, 28 000 particuliers et 600 collectivités ont bénéficié de cet accompagnement, tandis que 7 000 logements sociaux ont été mis aux normes d'isolation thermique. Ces chantiers ont permis la création de 350 emplois chez les professionnels du bâtiment) ;
• du soutien (expertise et contribution financière) à la mise en place de formations pour les jeunes de Meuse et Haute-Marne, comme le Bac Pro et le BTS "Environnement nucléaire" ouverts au lycée Blaise Pascal de Saint-Dizier.
Réponse apportée par Areva :
La contribution d’EDF, AREVA et du CEA visant à participer à la dynamisation économique du territoire est synthétisée dans un rapport publié chaque année.
Réponse apportée par le Commissariat à l'Énergie Atomique et aux énergies alternatives (CEA) :
Le CEA et ses partenaires industriels portent depuis 2009 le projet de construction d’un démonstrateur BtL – « Biomass to Liquid » - de production de biocarburants de 2ème génération sur le site de Bure-Saudron. Ce projet, baptisé Syndièse, a pour objectif de démontrer la faisabilité technique et économique d’une chaîne complète de production BtL, sur un site unique, depuis la collecte de la biomasse jusqu’à la synthèse de carburant. L'introduction d’hydrogène dans le procédé pour optimiser le rendement massique constituera une première mondiale. Lire le rapport d'activité 2012
QUESTION 187 - Destruction des déchets vers le soleil
Posée par Didier RABIN (MARLY LE ROI), le 18/06/2013
Chers organisateurs du débats, Dans mon message du 21 mai dernier répertorié question 55, j'ai demandé l'avis des personnes éclairés sur la possibilité d'envoyer les déchets nucléaires dans le soleil versus le projet CIGEO. Ma question est toujours classée "en cours de traitement" mais pouvez-vous compléter en indiquant le nom du (des) organisme(s) contactés(s) et à quelle date et qui devrait (ent) apporter une réponse ? Pour étayer ma suggestion/question et j'espère permettre une bonne évaluation, je pourrai rajouter que les déchets nucléaires peuvent être amenés sur une trajectoire qui les ferait tomber dans le soleil via un train de voiles solaires. Le processus prend du temps par rapport à la mise sur orbite solaire par fusée mais c'est une solution qui peut se révéler économique. Le plus sûr pour amener des déchets nucléaires hautement toxiques dans l'espaces, ce serait un ascenseur spatial, voir (mais moins sûr) des ballons stratosphériques avec des "avions" spatiaux qui récupèrent les ballons en très haute atmosphère pour les amener en orbite. Je vois déjà des "sourires" de certains lecteurs de ce message en estimant que tout cela ne sont que des rêves, mais attention les rêves d'aujourd'hui (et merci qu'il y en a encore) peuvent être les solutions de demain et d'un demain proche, ceci n'est pas nouveau surtout quand on parle de déchet avec une nocivité mesurée en... milliers d'années ! Sans avoir une réponse totalement documentée bien sûre, j'attends tout de même recevoir une réponse assez convaincante et surtout honnête pour soit me dire que ma suggestion n'a pas été évaluée versus le projet CIGEO ou soit avec assez d'arguments pour me démontrer que le projet CIGEO est à l'heure actuelle la meilleure solution envisagée.
Réponse du 29/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’idée d’envoyer les déchets dans l’espace, voire le soleil, est une solution qui a été envisagée. La NASA notamment s’est penchée sur cette question dès la fin des années 70. Au stade actuel, cette solution n’a pas été retenue car l’envoi par engins spatiaux se heurte au risque d’explosion, au décollage ou en vol, et aux conséquences radiologiques qui en découleraient.
Concernant les possibilités techniques que vous évoquez, certaines, comme l’ascenseur spatial, sont étudiées depuis plusieurs dizaines d’années et ne sont pas réalisables en l’état actuel des connaissances.
C’est pourquoi, eu égard au principe de ne pas reporter la charge de la gestion des déchets radioactifs sur les générations futures, la solution de stockage profond a été retenue, car il s’agit, aujourd’hui, de la seule solution qui permette une mise en sécurité définitive et en toute sûreté des déchets les plus radioactifs. La loi française prévoit que le stockage profond soit réversible pendant au moins 100 ans. Ainsi, si Cigéo est autorisé, l’Andra propose que des rendez-vous réguliers soient programmés pour faire le point sur l’exploitation du stockage et préparer les étapes suivantes. Ces rendez-vous seront notamment alimentés par les résultats des recherches menées en France et à l’étranger sur la gestion des déchets radioactifs et les avancées technologiques. A chaque étape, il sera possible de décider de poursuivre le processus de stockage tel qu’initialement prévu ou de le modifier, par exemple si des solutions alternatives sont identifiées.
QUESTION 186 - questions en attente de réponse
Posée par Sylvie SAUVAGE (TULLY), le 16/06/2013
Lorsque vous indiquez "en attente de réponse", pourriez-vous indiquer également, pour chaque question, le nom du (ou des) organisme(s) contacté(s) et à quelle date ?
Merci -
Réponse du 13/09/2013,
L'affichage des questions-réponses ne permet pas de préciser l'auteur de la réponse lorsque celle-ci est en cours de rédaction. En revanche, il apparaît lorsque la réponse est publiée.
Dans le classement par thèmes, deux grandes catégories bien distinctes sont intitulées : les questions MO et les questions CPDP.
Une question relative au débat public sera traitée par la Commission du débat public.
Lorsque la question porte sur le projet, l'Andra, maître d'ouvrage, est saisie.
Il peut arriver que d'autres institutions soient compétentes pour répondre sur certains aspects connexes au projet :
• les autorités de contrôle en matière nucléaire : ASN, IRSN
• les autorités compétentes en matière de politique énergétique ou d'aménagement du territoire : Ministère compétent, Préfecture responsable du schéma interdépartemental de développement du territoire
• les producteurs de déchets radioactifs : EDF, Areva, CEA
QUESTION 185 - procédé synroc
Posée par Alain CORREA, STOP EPR PENLY (ELBEUF), le 14/06/2013
Bonjour,
Au détour d’une documentation de l’AIEA de 1989, on apprend que dans une installation de démonstration de Lucas Heights, en Australie, une équipe de scientifiques procède à des essais avec une roche synthétique, le synroc, devant servir à la stabilisation des déchets de haute activité. Etude menée en collaboration avec la Grande Bretagne, le Japon et l’Italie. Le Canada, les USA et l’Allemagne sont aussi partie prenante. Nous n’avons jamais entendu parler de ce procédé, pourtant plein de promesses à l’époque.
Concernant les conteneurs des déchets HA-VL, j’ai pu apprendre que le verre à l’intérieur du conteneur en inox est parcouru d’une multitude de fissures et n’est pas un monobloc comme on aurait pu s’y attendre. Des précisions sur ces deux points ?
Merci.
Réponse du 21/08/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le synroc (Synthetic Rock) est un matériau céramique constitué de différentes phases cristallines à base de zirconium et de titane. Il a été développé dès la fin des années 70 en Australie et étudié comme matrice de conditionnement par l’ANSTO (Australian Nuclear Science and Technology Organisation). Différentes études ont montré que ce matériau présentait de bonnes capacités d’insertion des radionucléides dans sa structure, une bonne stabilité sous auto-irradiation et enfin une bonne durabilité chimique au contact de l’eau. Cependant, le mode de préparation de telles céramiques (frittage à chaud sous pression) est plus complexe que celui des matrices en verre. C’est pourquoi le conditionnement des déchets de haute activité issus du retraitement des combustibles usés s’est orienté dès les années 80 vers la vitrification, procédé technologique le plus abouti à l’échelle industrielle et permettant d’obtenir des verres ayant de bonnes performances de confinement des radionucléides.
Concernant le déchet vitrifié, les contraintes mécaniques lors du refroidissement du verre après sa coulée engendrent effectivement une fracturation. Ce phénomène est connu et a fait l’objet de nombreuses études sur son étendue et son effet sur les propriétés de confinement du verre. Il ne remet pas en cause les propriétés très favorables du verre dont la dissolution s’étale sur plusieurs centaines de milliers d’années. La fracturation est intégrée dans les analyses de sûreté qui doivent prendre en compte notamment les vitesses auxquels les colis de déchets vont se dégrader dans le temps et relâcher les radionucléides.
QUESTION 184
Posée par Daniel DORGUIN (BAR LE DUC), le 14/06/2013
Je ne suis pas contre le stockage des déchets radioactifs mais que deviendra la réversibilité dans 100-500 ans et plus de celui-ci?
Réponse du 31/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le but du stockage profond est de mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs pour ne pas reporter indéfiniment la charge de leur gestion sur les générations futures. Dans son avis sur les recherches menées dans le cadre de la loi de 1991, publié en 2006, l’Autorité de sûreté nucléaire considère que, sur le plan des principes, la réversibilité ne peut avoir qu’une durée limitée. Par ailleurs, elle ne considère pas que la possibilité de reprendre aisément les colis de déchets soit acquise sur une durée de plusieurs siècles.
Conformément à la demande du Parlement, l’Andra étudie un stockage qui soit réversible pendant au moins 100 ans, ce qui permet de laisser des portes ouvertes aux générations suivantes. L’Andra retient les meilleures techniques d’ingénierie disponibles pour offrir aux générations suivantes le maximum de flexibilité pour la gestion dans le temps de l’installation : épaisseur des ouvrages, colis résistants, surveillance… En fonction de l’expérience acquise lors de l’exploitation de Cigéo, les générations suivantes seront libres de décider du devenir de Cigéo, en particulier de son calendrier de fermeture et elles pourront périodiquement réévaluer la période de réversibilité.
QUESTION 183
Posée par Jean FRANVILLE (VERDUN), le 13/06/2013
Bonjour,
J'ai été surpris, quand j'ai cliqué sur OK pour envoyer mon message intitulé : "refonder le débat sur ses véritables bases" de n'avoir aucune réaction de l'automate (ni récépissé, ni indication d'échec). Par ailleurs, je profite de ce nouveau message pour vous indiquer qu'une copie du précédent a été envoyée à certains organes de presse, et le sera sans doute encore à d'autres).
Réponse du 24/07/2013,
Si vous rencontrez toujours des difficultés au moment d'enregistrer votre avis par l'intermédiaire du site internet du débat, je vous invite à nous le transmettre de nouveau à l'adresse contact@debatpublic-cigeo.org.
QUESTION 182 - FERMETURE DEFINITIVE
Posée par François SIMON (MONT SAINT AIGNAN), le 13/06/2013
Quand sera t-il des galeries de ventilations lors de la fermeture définitive des galeries ? Sachant que dans 99 ans des containers chauds, radioactifs seront stockés, la ventilation devra être maintenue pendant un certains temps. Quel est votre estimation du temps nécessaire, après "fermeture définitive" du maintient de la ventilation ?
Réponse du 29/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Dans le stockage, la chaleur dégagée par les déchets de haute activité s’évacuera majoritairement dans la roche. Cigéo est conçu pour que la température dans la roche reste inférieure à 100 °C indépendamment de la présence ou non d’une ventilation dans les galeries. Cela repose notamment sur l’espacement entre les alvéoles de stockage et sur la limitation de la puissance thermique des déchets stockés*. La ventilation est nécessaire en phase exploitation pour le personnel. Lorsqu’il sera décidé de fermer le stockage, aucune ventilation ne sera plus nécessaire. Le stockage est conçu pour garantir une mise en sécurité définitive des colis de déchets, c’est-à-dire ne plus nécessiter d’action humaine une fois fermé.
*La puissance thermique d’un colis de déchets vitrifiés de haute activité est de l’ordre de 2 000 watts au moment de sa fabrication. Elle sera descendue à 500 watts au bout d’une soixantaine d’années, avant leur mise en stockage. Cette décroissance thermique est réalisée dans des bâtiments d’entreposage sur les sites de production des déchets.
QUESTION 181 - antidéflagration
Posée par François SIMON (MONT SAINT AIGNAN), le 13/06/2013
Question relative à l'encart page 77, en haut à gauche : RETRAIT DES COLIS. Les futurs engins de manipulations seront-ils prévus :
1/ en électroniques "durcies" afin de résister aux rayonnements ?
2/ antidéflagrant ? à noter que de l'acier qui ripe sur du béton engendre des étincelles, c'est gênant si il y à plus de 3% d'hydrogène dans la galerie.
Réponse du 31/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Concernant le point 1 :
Les déchets sont placés dans des conteneurs de stockage en acier ou en béton qui permettent d’atténuer une partie des rayonnements émis par les déchets. La protection contre l’irradiation des engins de manutention qui seront utilisés dans Cigéo ne nécessite pas l’utilisation de composants électroniques dits « durcis ». Leur protection vis-à-vis des rayonnements se fera par la mise en œuvre d’écrans de protection radiologique autour des composants. Tout au long de l’exploitation de Cigéo, ces engins feront l’objet d’une maintenance régulière.
Concernant le point 2 :
Les mesures de sûreté prises pour Cigéo ne nécessitent pas l’utilisation d’engins de manutention antidéflagrants. En effet, pour maîtriser le risque d’explosion :
- les quantités d’hydrogène émises par les colis de déchets MA-VL concernés seront strictement limitées. Pour pouvoir être acceptés sur Cigéo, les colis de déchets devront respecter cette limite et feront l’objet de contrôles par l’Andra pour vérifier que cette exigence est bien respectée,
- pour éviter l’accumulation d’hydrogène et ainsi éviter la formation d’atmosphère explosive, l’installation souterraine (liaisons surface-fond, galeries, alvéoles MA-VL) sera ventilée pendant son exploitation ; aucune opération ne sera autorisée dans l’alvéole si la ventilation de l’alvéole n’est pas en service,
- des mesures seront faites sur l’air extrait des alvéoles par la ventilation afin de vérifier que la teneur en hydrogène est conforme aux attentes avant de pouvoir autoriser un engin à pénétrer dans l’alvéole.
De ce fait, il n’y aura jamais d’opération de manipulation de colis s’il y a une concentration d’hydrogène pouvant présenter un risque.
QUESTION 180 - Les Cahiers d'Acteur
Posée par Claire MAYS, Institut Symlog (PARIS), le 12/06/2013
Bonjour,
Ma question porte sur la disponibilité en ligne des "cahiers d'acteur". Il s'agit des courtes contributions au débat sous forme de brochure imprimée et distribuée lors des réunions publiques. Ces cahiers permettent aux différents acteurs qui le souhaitent d'élaborer et d'exprimer leur point de vue, et aux citoyens d'en prendre connaissance. C'est utile à la réflexion de chacun. Ces cahiers seront-ils disponibles pour téléchargement ? Seront-ils archivés de façon permanente sur le site du débat ? Quand est-ce qu'on peut espérer les voir apparaître ? Et enfin, pouvez-vous confirmer que chacun peut contribuer un cahier tout au long de la période du débat ?
Merci.
Réponse du 02/07/2013,
Les cahiers d'acteurs sont consultables sur le site internet du débat public. A ce jour, sont publiés une dizaine de cahiers d'origines diverses : autorité de contrôle, associations, syndicats, producteurs de déchets nucléaires, chambre consulaires.
D'autres cahiers sont en cours de réalisation et seront diffusés dès leur validation.
Ces contributions sont archivées sur le site de la Commission particulière puis sur celui de la Commission nationale du débat public et enfin à la Bibliothèque Nationale de France.
Je vous confirme que chacun peut proposer un cahier d'acteurs. Vous trouverez ici les informations relatives à l'objet, la forme, le circuit de validation et la diffusion d'un cahier.
QUESTION 179 - responsabilités en cas de sinistre
Posée par Alain CORREA, STOP EPR PENLY (ELBEUF), le 12/06/2013
Bonjour,
En cas d’accident majeur (incendie, explosion, effluents divers, etc…) dans l’enceinte CIGEO (sous-sol et/ou surface), avec contamination de l’environnement, qui est légalement et pénalement responsable ? Y aura-t-il des finances de bloquées pour dédommager les victimes ? Y’aura-t-il une pérennité des responsabilités sur le très long terme ?
Merci.
Réponse du 05/08/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’Andra est un établissement public placé sous la tutelle de l’État. Pour Cigéo, comme tout industriel, l’Andra contractera des assurances destinées à couvrir les risques industriels classiques. De plus, Cigéo étant une installation nucléaire, elle est soumise au régime de responsabilité civile nucléaire. En cas d’accident nucléaire survenant sur le site de l’Andra, la responsabilité de cette dernière sera mise en cause sans que les victimes n’aient à prouver une faute de l’Andra. Ce régime a notamment pour intérêt de simplifier les recours des victimes qui ne sont pas obligées de multiplier les procédures à l’encontre des autres acteurs intervenant sur le site. Tant que les générations futures le souhaiteront, une surveillance du site pourra être assurée.
QUESTION 178 - la raison d'état et l'utilité du débat
Posée par Alain CORREA, STOP EPR PENLY (ELBEUF), le 12/06/2013
Bonjour
Comment peut-on raisonnablement imaginer qu’après avoir imposé la construction de 58 réacteurs nucléaires dont AUCUN n’est équipé pour supporter une possible fusion du cœur, la raison d’état puisse envisager d’annuler purement et simplement ce projet d’enfouissement dont dépend l’avenir du nucléaire civil français, sa force de frappe stratégique et toute la kyrielle d’industriels qui va avec ?
Merci.
Réponse du 21/08/2013,
Réponse apportée par le ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie :
En France, la sûreté des installations est contrôlée par une autorité indépendante, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). A la suite de l’accident de Fukushima, l’ASN a lancé une démarche d’évaluation complémentaire de la sûreté (ECS) des installations nucléaires civiles françaises répondant aux demandes exprimées par le Premier ministre le 23 mars 2011 et le Conseil européen les 24 et 25 mars 2011. Dans son rapport du 3 janvier 2012 sur les ECS l’ASN ne recommande la fermeture d’aucune des installations nucléaires examinées, mais émet toutefois un certain nombre de préconisations destinées à renforcer significativement la robustesse des installations face à des situations extrêmes, au-delà des marges dont elles disposent déjà. L’ASN a notamment imposé la mise en place de « noyaux durs » (bunkérisation des matériels assurant les fonctions les plus fondamentales de sûreté en cas de situation extrême : alimentation en électricité et en eau, locaux de crise...).
La loi du 28 juin 2006 a fait le choix du stockage réversible profond pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations futures. Elle demande à l’Andra d’étudier et d’implanter un Centre de stockage réversible profond de déchets radioactifs (Cigéo) en indiquant que « la demande d'autorisation de création [d’un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs] doit concerner une couche géologique ayant fait l'objet d'études au moyen d'un laboratoire souterrain ». L’Andra poursuit donc ses études en vue d’élaborer pour 2015 le dossier support à l’instruction de la demande d’autorisation de création de Cigéo en Meuse/Haute-Marne.
La décision d’autoriser ou non la création de Cigéo en Meuse/Haute-Marne n’est donc pas encore prise. Elle reviendra à l’Etat après l’évaluation du dossier remis par l’Andra en 2015 par l'Autorité de sûreté nucléaire et la Commission nationale d'évaluation, l’avis des collectivités territoriales, le vote d’une nouvelle loi fixant les conditions de réversibilité et une enquête publique.
Le projet Cigéo suit la procédure décrite à l’article L. 542-10 du Code de l’Environnement, dont le processus est illustré par les schémas présentés ci-dessous. Comme cela est représenté sur les schémas, au cours de ce processus, plusieurs procédures de consultation sont organisées afin de recueillir l’avis des populations locales et nationales :
• un débat public en 2013, organisé afin de recueillir les avis de l’ensemble de la population au niveau local et national ;
• un avis des collectivités locales à proximité du projet (horizon 2016) ;
• une enquête publique (horizon 2017-2018) préalable au décret d’autorisation de création.
Le Parlement fixe périodiquement les choix relatifs à la mise en œuvre de ce projet :
• loi du 30 décembre 1991, dite loi « Bataille », fixant un programme d’études et recherches de 15 années d’études et recherches sur les déchets radioactifs ;
• loi du 28 juin 2006, définissant le stockage géologique profond comme solution de référence pour les déchets les plus radioactifs et demandant sa mise en service en 2025 ;
• loi à venir sur la réversibilité du projet à horizon 2016.
En outre, l’Etat est en contact permanent avec les parties prenantes locales. Un important travail de concertation a été mené, notamment avec les exécutifs locaux, pour élaborer un projet de schéma interdépartemental du territoire.
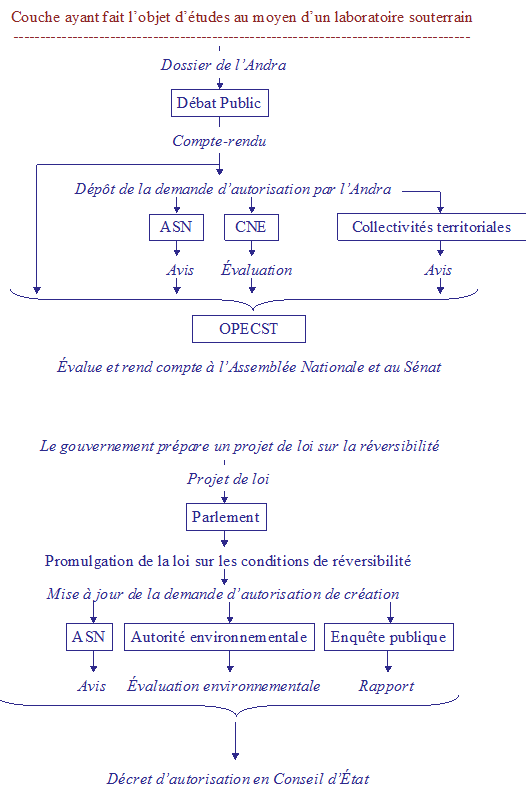
QUESTION 177 - loi Bataille
Posée par Gérard BESSIERES (VARENNES SUR AMANCE), le 12/06/2013
Bonjour
La loi Bataille prévoyait à l'origine 3 laboratoires. Au final nous avons 1 laboratoire situé à Bure. Nos élus nous ont juré qu'il s'agissait d'un labo et rien de plus. Nous en sommes à une usine à gaz nommée Cigéo avec en prime le laboratoire. Comment le citoyen peut il vous faire confiance puisqu'il a été manifestement trompé ?
Réponse du 29/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La loi de recherche du 30 décembre 1991 prévoyait la réalisation de laboratoires souterrains pour l’étude des possibilités de stockage dans les formations géologiques profondes. Suite à une mission de concertation lancée fin 1992 et à des premières analyses géologiques, quatre sites candidats avaient été identifiés dans les départements du Gard, de la Meuse, de la Haute-Marne (couches argileuses) et de la Vienne (couche granitique). L’Andra a été autorisée par le Gouvernement à mener des investigations géologiques dans le but de savoir s’il était intéressant d’y construire un laboratoire souterrain pour continuer les études. En 1996, l’Andra a déposé trois dossiers de demandes d’installation de laboratoires souterrains. Les résultats des investigations géologiques ont montré que la géologie du site en Meuse/Haute-Marne (les deux sites ont été fusionnés en une seule zone en raison de la continuité de la couche argileuse étudiée) était particulièrement favorable. Concernant le Gard, le site présentait une plus grande complexité scientifique liée à son évolution géodynamique à long terme et faisait l’objet d’oppositions locales. L’instruction du dossier relatif au site étudié dans la Vienne n’a pas abouti à un consensus scientifique sur la qualité hydrogéologique du massif granitique.
En 1998, le Gouvernement a décidé la construction d’un laboratoire de recherche souterrain en Meuse/Haute-Marne et la poursuite des études pour trouver un autre site dans une roche granitique. La recherche d’un site dans une roche granitique a finalement été abandonnée, la mission de concertation n’ayant pas abouti. L’Andra a toutefois poursuivi ses recherches sur le milieu granitique jusqu’en 2005, en s’appuyant notamment sur les travaux menés dans les laboratoires souterrains d’autres pays (Suède, Canada, Suisse). Ces recherches ont conduit l’Andra à conclure en 2005 qu’un stockage dans les massifs granitiques ne présenterait pas de caractère rédhibitoire mais que la principale incertitude porte sur l’existence de sites en France avec un granite ne présentant pas une trop forte densité de fractures.
La loi du 28 juin 2006 a fait le choix du stockage réversible profond pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations futures. Elle demande à l’Andra d’étudier et d’implanter Cigéo en stipulant que « la demande d'autorisation de création [d’un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs] doit concerner une couche géologique ayant fait l'objet d'études au moyen d'un laboratoire souterrain ». L’Andra poursuit donc ses études en vue d’élaborer pour 2015 le dossier support à l’instruction de la demande d’autorisation de création de Cigéo en Meuse/Haute-Marne, dans la couche d’argile dont les propriétés de confinement sont désormais reconnues.
La décision d’autoriser ou non la création de Cigéo en Meuse/Haute-Marne n’est cependant pas encore prise. Elle reviendra à l’Etat après l’évaluation du dossier remis par l’Andra en 2015, l’avis des collectivités territoriales, le vote d’une nouvelle loi fixant les conditions de réversibilité et une enquête publique. S’il était décidé d’étudier un autre site d’implantation pour le stockage, cela impliquerait de reprendre l’ensemble du processus de recherche de site, de caractérisation par un laboratoire souterrain et de conception d’un stockage adapté à ce nouveau site.
QUESTION 176 - sourcier
Posée par Alain CORREA, STOP-EPR PENLY (ELBEUF), le 12/06/2013
Bonjour
Accepteriez-vous qu’un sourcier équipé d’une baguette de coudrier, descende dans les galeries de CIGEO ?
Merci.
Réponse du 02/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Cigéo n’existe pas aujourd’hui. Le centre est actuellement au stade des études industrielles.
En revanche, les galeries du Laboratoire souterrain de l’Andra, situées à environ 500 mètres de profondeur, dans une couche de roche argileuse dans laquelle serait implanté Cigéo s’il est autorisé, se visitent. L’Andra y accueille tous les ans près de 3 000 visiteurs. Le fait d’être sourcier et muni d’une baguette de coudrier n’en interdit pas l’accès. Pour fixer une date, il suffit de prendre contact avec le service communication du Centre de Meuse/Haute-Marne.
QUESTION 175
Posée par Gilles HENNEQUIERE (SAINT-DIZIER), le 12/06/2013
Il est regrettable que les débats publics aient été supprimés pour au moins 2 raisons:
- le public voudrait pouvoir s'exprimer afin de se faire son propre sentiment
- en agissant ainsi, vous cautionnez les critiqueurs en leur laissant le champ libre
Réponse du 13/09/2013,
Les réunions publiques ont été annulées car la Commission ne pouvait pas les tenir. Elles étaient boycottées dès leur ouverture et aucun échange n'était possible. Il était donc malheureusement impossible pour le public "de se faire son propre sentiment" sur le projet dans de telles conditions.
Le débat public se poursuit donc autrement, par la participation aux débats contradictoires interactifs, les questions et avis, les contributions et les cahiers d"acteurs. Le débat continue sur internet, par courrier et à la permanence de la Cpdp.
QUESTION 174 - forum
Posée par Josezph DUPUIS (PARIS), le 11/06/2013
Comment fait-on pour rejoindre le forum citoyen ? Est-ce différent du site du débat ?
Réponse du 02/07/2013,
Le forum citoyen est accessible à partir du site du débat www.debatpublic-cigeo.org. La participation au forum est un outil du débat au même titre que la possibilité de poser des questions, donner son avis, rédiger un cahier d'acteurs, etc. Ce sont autant de modes d'expression complémentaires.
Le forum permet de créer une discussion avec d'autres internautes.
QUESTION 173 - Accessibilité
Posée par Patrick BURDIN (DUN SUR MEUSE), le 10/06/2013
Bonjour,
Je me déplace en fauteuil roulant. Les bâtiments où se tiennent les réunions publiques sont elles accessibles?
Réponse du 24/07/2013,
La Commission veille en effet autant que possible à l'accessibilité des salles de réunions publiques et aux facilités de parking.
QUESTION 172
Posée par Jacques TAMBORINI (MARLY LE ROI), le 06/06/2013
Un Président de séance pusillanime se laisse manœuvrer par une minorité . La mise en oeuvre de la démocratie nécessite du courage et de la fermeté . Cette minorité d'opposant (je le répète) ne veut surtout pas discuter et débattre... Cette réaction inappropriée va semer le doute chez ceux qui croient au débat public.
Réponse du 02/07/2013,
La suspension puis l'interruption de la réunion publique ont été décidées pour des questions de sécurité. Il était de la responsabilité de la Commission de ne pas mettre en danger les personnes présentes dans et à l'extérieur de la salle.
La Commission regrette également que la rencontre n'ait pu avoir lieu.
QUESTION 171 - Comment réagir avec un email sur le projet?
Posée par Richard NOWAK, CITOYEN DE L'UE (PONT À MOUSSON), le 10/06/2013
Dans les 104 pages de présentation du rapport public, il y a de nombreuses questions sur le fond et sur la forme qui surgissent à la lecture. Est-ce intentionnel ou n'est ce que la face visible d'un ensemble plus conséquent? Par exemple, sur les quantités, on parle de volumes, kg, tonnes, pourcentages. Tout est obscur. Est-ce volontaire, ou sont-ce les écrits du demandeur? Quel est le volume des espaces de stockage HA MA-VL? J'ai relevé de nombreux points. Comment les signaler dans les formes au président de la commission d'enquête publique?
Merci
Réponse du 31/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Résumer plus de 20 ans de recherche sur le stockage géologique est une tâche redoutable et, effectivement, ce rapport n’est que la partie émergée d’une somme conséquente d’études. Sur notre site http://www.andra.fr/index.php?id=itemmenu_edition_6_tout_1_1 vous aurez accès à une littérature technique et scientifique de haut niveau, qui vous permettra de vous faire une idée plus précise du travail accompli.
Concernant les différentes unités employées, l’Andra essaie d’employer les unités les plus significatives pour expliciter les éléments d’information apportés. Les caractéristiques des colis sont nombreuses, et il peut être utile de donner des informations sur leur masse comme sur leur volume. En ce qui concerne les pourcentages, comment s’en passer si l’on veut faire des comparaisons ? Toutes les données quantitatives sur les colis de déchets proviennent de l’Edition 2012 de l’Inventaire national des déchets et matières radioactives, où vous pourrez trouver des données plus complètes sur les quantités de déchets radioactifs.http://www.andra.fr/pages/fr/menu1/les-dechets-radioactifs/ou-sont-les-dechets-radioactifs-r-10.html
Le dossier du maître d’ouvrage indique que, dans le cadre d’un scénario de poursuite de la production électronucléaire, les volumes de déchets à stocker serait d’environ 10 000 m3 pour les déchets HA et environ 70 000 m3 pour les déchets MA-VL. Ces volumes correspondent aux déchets conditionnés par leur producteur. Ces colis seront ensuite placés dans un conteneur de stockage. Les volumes de déchets ainsi conditionnés en colis de stockage seront de l’ordre de 30 000 m3 pour les déchets HA et de l’ordre de 350 000 m3 de déchets MA-VL. L’emprise de l’installation souterraine dans laquelle seraient stockés ces déchets serait d’environ 15 km² au terme de la centaine d’années d’exploitation.
QUESTION 170 - quantité et types de déchets
Posée par Gerard BESSIERES, CITOYEN (VARENNES SUR AMANCE), le 07/06/2013
Bonjour
Pouvez-vous m'indiquer quels seront les types de déchets ainsi que les quantités totales de ces déchets qui seront enfouit à Bure.
Réponse du 31/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le projet de stockage profond Cigéo est conçu pour mettre en sécurité définitive les déchets dont le niveau de radioactivité et la durée de vie ne permettent pas de les stocker, de manière sûre à long terme, en surface ou à faible profondeur.
Les déchets concernés proviennent principalement du secteur de l’industrie électronucléaire et des activités de recherche associées ainsi que, dans une moindre part, des activités liées à la Défense nationale. Les déchets dits de « haute activité » (HA) correspondent principalement aux résidus hautement radioactifs issus du traitement des combustibles nucléaires usés utilisés pour la production d’électricité. Les déchets dits de « moyenne activité à vie longue » (MA-VL) ont des origines variées : résidus issus du traitement des combustibles nucléaires usés et de la fabrication de certains combustibles, composants (hors combustible) ayant séjournés dans les réacteurs nucléaires, déchets technologiques issus de la maintenance des installations nucléaires, de laboratoires, d’installations liées à la Défense nationale, du démantèlement...
Cigéo est conçu pour prendre en charge les déchets produits par les installations nucléaires existantes. Les volumes de déchets HA et MA-VL sont estimés à environ 10 000 m3 pour les déchets HA (soit environ 60 000 colis de déchets) et environ 70 000 m3 pour les déchets MA-VL (soit environ 180 000 colis de déchets) dans l’hypothèse d’une poursuite de la production électronucléaire* et d’une durée de fonctionnement des installations nucléaires existantes de 50 ans. Dans cette hypothèse, 30 % des déchets HA et 60 % des déchets MA-VL sont déjà produits. Par précaution, des volumes supplémentaires (environ 20 % du volume de déchets MA-VL à stocker) sont prévus en réserve dans Cigéo pour certains déchets de faible activité à vie longue qui, le cas échéant, ne pourraient pas être stockés dans le stockage à faible profondeur à l’étude par l’Andra.
Cigéo est conçu pour être flexible afin de pouvoir s’adapter à d’éventuels changements de la politique énergétique. En cas d’arrêt de la production électronucléaire et d’arrêt du traitement des combustibles nucléaires usés, environ 3 500 m3 de déchets HA, 59 000 m3 de déchets MA-VL et 90 000 m3 de combustibles usés non traités seraient destinés au stockage. A la demande du Ministère en charge de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, l’Andra, EDF et Areva ont étudié l’impact des différents scénarios établis dans le cadre du débat national sur la transition énergétique sur la production de déchets radioactifs et sur le projet Cigéo : ../docs/rapport-etude/20130705-courrier-ministere-ecologie.pdf
* Les déchets produits par un éventuel futur parc de réacteurs ne sont pas pris en compte.
QUESTION 169 - conservation de l'information
Posée par Alain CORREA, STOP EPR PENLY (ELBEUF), le 07/06/2013
Bonjour,
La NASA et le JPL, ont été confrontés à l’obsolescence numérique qui leur a occasionné des pertes d’informations importantes.
Comment envisagez-vous la conservation dans le temps, des documents relatifs au suivi du stockage (matières, quantités, localisations précises)?
Type de supports, formats, copies déportées, redondance des systèmes de lecture, etc…
Merci.
Réponse du 31/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La maîtrise des connaissances générées tout au long de la vie du stockage démarre dès leur acquisition : les connaissances acquises sont clairement établies et enregistrées pour pouvoir ensuite les transmettre. Cette démarche de gestion des connaissances, déjà mise en œuvre dans le cadre de la conception du projet, s’appuie sur l’expérience des grandes industries (nucléaire, sidérurgie, aéronautique…) qui ont défini des méthodes afin de transmettre et préserver l’expertise et le savoir-faire scientifique et industriel.
Concernant la pérennité des supports d’informations sur ces périodes, l’enregistrement de ces connaissances et données est réalisé sur des systèmes centralisés avec toutes les conditions de sécurité requises (duplication des serveurs, externalisation des sauvegardes, vérification des contenus). Ces données au format numérique sont suivies par des équipes spécialisées qui assurent régulièrement la migration vers de nouveaux formats si nécessaire (nouveaux formats de bases de données, nouveaux formats de fichiers pour les documents…). Les pertes de données de la Nasa ou du JPL concernent des enregistrements qui étaient stockés sur des supports qui n’étaient plus utilisés (bandes magnétiques) et qui ont été égarés. Les données et documents de l’Andra sont et resteront stockés sur des serveurs en exploitation, et faisant l’objet d’un suivi continuel, car ces informations seront nécessaires sur toute la durée de Cigéo.
Au-delà de la phase d’exploitation, des solutions d’archivage à long terme existent déjà et font l’objet de revues périodiques. Elles reposent sur un archivage sur des supports papier en plusieurs lieux distincts. Le retour d’expérience montre que ces solutions paraissent robustes pour au moins les 500 premières années.
QUESTION 168 - L'Etat français et le projet CIGEO
Posée par Jean-Bernard HERGOTT, CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE HAUTE-MARNE (SAINT-DIZIER), le 07/06/2013
Nos territoires faiblement peuplés porteront demain la solution au problème des déchets nucléaire de tous les français. Dans ce contexte, quelles mesures spécifiques la communauté nationale, incarnée par les parlementaires et le gouvernement, envisage-t-elle de mettre en œuvre pour permettre le développement durable de nos territoires et améliorer la qualité de vie des habitants (habitat, formation, services, mobilité) ?
Réponse du 29/07/2013,
Réponse apportée par le Directeur du Schéma interdépartemental de développement du territoire :
Dans le contexte de l'implantation de Cigéo, les mesures spécifiques sont prises pour le développement local avec l'élaboration et la mise en œuvre d'un schéma de développement du territoire qui reprend les principaux thèmes qui concourent au développement d'un territoire en fonction de ses propres spécificités :
• l'habitat, pour la mise en œuvre des politiques locales d'habitat qui tiennent compte de l'offre et de la demande à venir, dans le contexte de la ruralité et de l'organisation spatiale des bourgs et des agglomérations structurantes pour le territoire ;
• les services aux populations, par les loisirs et les services le plus pertinents pour rendre attractives les implantations de ménages, tout en tenant compte de l'évolution de la population et de ses besoins. C'est par exemple le cas des transports à la demande qui offrent une possibilité souple et adaptée de transports aux personnes âgées et d'accès aux services disponibles, mais également pour les déplacements professionnels et l'accès aux gares SCNF et TGV ;
• le développement durable pour des aménagements qui préservent l'identité des paysages et des patrimoines, et l'intégration des projets dans les contextes environnementaux ;
• le développement économique pour les entreprises locales et celles qui s'implanteront localement dans la dynamique de Cigéo, mais également pour l'accès à l'emploi, aux métiers et aux compétences requises. Sur ce point une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est d'ores et déjà en cours d'analyse pour faire coïncider l'offre d'emplois, la demande, et la carte des formations disponibles localement ;
• enfin, les infrastructures de transports pour maîtriser les transports industriels et les déplacements domicile-travail dont l'organisation revient à l'initiative des entreprises industrielles. L'approvisionnement des ressources industrielles est envisagé quant à lui pour les implantations mais également au bénéfice du développement et de la modernisation des réseaux locaux en eau ou en très Haut Débit Numérique qui en ont besoin.
A ce stade, un projet de Schéma a été élaboré avec les collectivités locales concernées. Son élaboration a été pilotée, par un comité sous l'égide du Ministre de l'Écologie, du développement Durable et de l'Énergie et associant les parlementaires de Meuse et de Haute-Marne, ainsi que les présidents de conseils généraux et l'ensemble des représentants des acteurs de développement (CCI, Communautés de communes...). Il sera suivi et actualisé, dans un agenda opérationnel pour tenir compte des échéances, pour anticiper les actions à mettre en place, pour tenir compte des recommandations issues du débat public, mais également pour intégrer les données de cadrage issues de la conception industrielle des projets (nature et caractéristiques des emplois et de leurs profils socio-économiques, nature et caractéristiques des transports et des infrastructures...).
En complément, ce schéma de développement du territoire est suivi et piloté au sein des services de l'État en préfecture de la Meuse par une mission spécifique, qui est composée de cadres du ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, à l'instar des missions "grand chantier" que l'on trouve à l'appui du développement local des grands chantiers (Iter à Cadarache, Flamanville…).
La solidarité nationale contribue également au développement du territoire dans l'accompagnement économique, par le biais de la ressource fiscale et des subventions accordées aux GIP Objectif Meuse et de Haute-Marne pour accompagner le développement du territoire en perspective de l'implantation de Cigéo. Les entreprises de la filière nucléaire, portent également leurs efforts dans ce sens. Ils sont plus particulièrement orientés vers les implantations de leurs unités, le développement économique local et le programme de maîtrise dans la demande en énergies pour l'habitat et les collectivités locales, dans un contexte de transition énergétique.
QUESTION 167 - CIGEO : vitrine de la technologie de l'enfouissement à vocation mondiale
Posée par Jean-Bernard HERGOTT, CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE HAUTE-MARNE (ST DIZIER), le 07/06/2013
3- Le laboratoire souterrain, dédié à la recherche et à la formation du personnel, accueille également des visiteurs avec un certain succès (2 000 personnes par an). Comment l’ANDRA envisage-t-elle de poursuivre cette ouverture vers le grand public ?
Réponse du 29/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L'Andra considère l'information sur ses activités comme primordiale. Les visites des sites sont un élément central de cette information car elles permettent de montrer aux visiteurs en toute transparence les travaux qui sont menés par l’Andra et de répondre aux questions qu’ils se posent. Il sera bien sûr possible de visiter Cigéo, comme c’est déjà le cas pour les différents sites de l’Andra (Centre de stockage de la Manche, Centres industriels de l’Andra dans l’Aube, Laboratoire souterrain…).
QUESTION 166 - CIGEO : vitrine de la technologie de l'enfouissement à vocation mondiale
Posée par Jean-Bernard HERGOTT, CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE HAUTE-MARNE (ST DIZIER), le 07/06/2013
2- Les structures de recherche et de développement créées par l’ANDRA permettent de concrétiser un campus national « SOMET » (structure pour l’observation et la mémoire de l’environnement et de la terre). De quoi s’agit-il ? Quel est l’ambition de ce campus, son fonctionnement et quelle sera sa capacité d’accueil ?
Réponse du 29/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
SOMET, « Structure pour l'observation et la mémoire de l'environnement de la Terre » a été conçu par l’Andra en Meuse/Haute-Marne et labellisé "Infrastructure nationale de recherche" par le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, afin d’ouvrir à la communauté scientifique, pour des travaux de recherche multidisciplinaire, l’ensemble unique en Europe d’équipements scientifiques et techniques que sont le Laboratoire souterrain, l’Observatoire pérenne de l’environnement et l’Ecothèque.
L’Andra propose la création d’une station pédagogique associée à SOMET avec comme objectif d’en faire un campus national accueillant en résidence des étudiants en formation (du niveau Licence à Master) dans des disciplines relevant notamment des sciences de l’univers et de l’environnement mais également de la métrologie, des travaux souterrains et des sciences humaines et sociales. Le nombre total d’étudiants reçus par an dans une phase initiale pourrait être de l’ordre de 400/an, pour des stages d’une semaine ouvrable.
Ce projet de campus s’inscrit dans le cadre de l’accord établi entre l’Andra et l’Université de Lorraine, en s’appuyant plus spécifiquement sur les pôles scientifiques OTELo (OSU-Observatoire Terre et Environnement de Lorraine) et A2F (Agronomie, Agroalimentaire, Forêt) de l’université de Lorraine et l’INRA Nancy Champenoux.
Ce campus pourrait être ouvert à la totalité des établissements d’enseignement français, avec une potentielle ouverture européenne favorisée par l’implantation géographique du Centre de Meuse/Haute Marne au cœur de l'Europe. Il pourrait également être ouvert aux personnels des entreprises de la recherche géologique, en mettant à leur disposition les moyens de formation offerts par les infrastructures de recherche existantes.
Afin de réunir les soutiens financiers nécessaires, l’Andra a proposé à l’État d’inscrire ce projet de station pédagogique dans le cadre du projet de schéma interdépartemental du développement du territoire de Meuse/Haute-Marne et dans le prochain contrat particulier État / Lorraine 2014-2016.
QUESTION 165 - CIGEO : vitrine de la technologie de l'enfouissement à vocation mondiale
Posée par Jean-Bernard HERGOTT, CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE HAUTE-MARNE (SAINT-DIZIER), le 07/06/2013
1- L’ANDRA développe 3 outils de R&D spécifiques à CIGEO : le laboratoire souterrain (1200 m de galeries), l’observatoire pérenne de l’environnement et des moyens de simulations et de calculs numériques. En quoi ces outils, particulièrement les deux premiers, ont-ils ou auront-ils demain une interaction avec/sur les entreprises locales et les territoires d’accueil ?
Réponse du 29/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maitre d’ouvrage :
En 2012, le montant total des commandes de l’Andra en Meuse/Haute-Marne s’est élevé à 12,4 M€, dont 8,7 M€ de contrats annuels récurrents liés au Centre. Ce montant a augmenté de 50 % par rapport à 2011 avec la construction de 2 nouveaux bâtiments.
Par ailleurs, l’Andra souhaite ouvrir à la communauté scientifique ses équipements scientifiques en Meuse/Haute-Marne (Laboratoire souterrain, Observatoire pérenne de l’environnement, Ecothèque) pour des travaux de recherche multidisciplinaire. Cet ensemble unique en Europe, baptisé SOMET (« Structure pour l’observation et la mémoire de l’environnement de la Terre), a été labellisé « Infrastructure de recherche » par le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et l’Alliance sur l’Environnement Allenvi.
L’Andra propose de plus la création d’une station pédagogique associée à SOMET avec comme objectif d’en faire un campus national accueillant en résidence des étudiants en formation (du niveau Licence à Master) dans des disciplines relevant notamment des sciences de l’univers et de l’environnement mais également de la métrologie, des travaux souterrains et des sciences humaines et sociales. Ce projet de campus s’inscrit dans le cadre de l’accord établi entre l’Andra et l’Université de Lorraine, en s’appuyant plus spécifiquement sur les pôles scientifiques OTELo (OSU-Observatoire Terre et Environnement de Lorraine) et A2F (Agronomie, Agroalimentaire, Forêt) de l’université de Lorraine et l’INRA Nancy Champenoux. Le campus pourrait être ouvert à la totalité des établissements d’enseignement français, avec une potentielle ouverture européenne favorisée par l’implantation géographique du Centre de Meuse/Haute Marne au cœur de l'Europe. Il pourrait également être ouvert aux personnels des entreprises de la recherche géologique, en mettant à leur disposition les moyens de formation offerts par les infrastructures de recherche existantes.
Afin de réunir les soutiens financiers nécessaires, l’Andra a proposé à l’État d’inscrire ce projet de station pédagogique dans le cadre du projet de schéma interdépartemental du développement du territoire de Meuse/Haute-Marne et dans le prochain contrat particulier État / Lorraine 2014-2016.
QUESTION 164 - CIGEO un projet important pour l'emploi
Posée par Jean-Bernard HERGOTT, CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE HAUTE-MARNE (ST DIZIER), le 07/06/2013
2- L’ANDRA intégrera-t-elle dans ses appels d’offres des clauses sociales en référence aux articles 14, 30 et 53 du code des marchés publics concernant les acheteurs publics ?
Réponse du 31/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’Andra n’est pas soumise au code des marchés publics mais à l’ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 et à son décret d’application 2005-1742 du 30 juin 2005. L’Agence a comme objectif d’intégrer dans ses appels d’offres des clauses sociales et travaille en ce moment à préparer des clauses d’insertion professionnelle, ceci par un nombre d’heures sur lequel les entreprises s’engagent lors de l’offre.
QUESTION 163 - CIGEO un projet important pour l'emploi
Posée par Jean-Bernard HERGOTT, CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE HAUTE-MARNE (SAINT-DIZIER), le 07/06/2013
Description *
1- Durant la phase de travaux (2019-2025), quelles sont les mesures qu’envisage de prendre l’ANDRA vis-à-vis de ses sous-traitants, à savoir la maîtrise d’œuvre et les entreprises de chantier, pour :
o Les inciter à recruter localement ?
o Susciter l’installation locale des équipes d’ingénierie et de direction des opérations ?
o Domicilier le personnel de chantier dans les villes et villages aux alentours du site.
Dans ces trois cas, des clauses contractuelles seront-elles prévues ?
3- Pendant la phase préparatoire (2016-2018) et la phase d’exploitation (à partir de 2025), l’ANDRA prévoit-elle d’acquérir localement un parc immobilier pour loger une partie de son personnel et ses cadres ?
Réponse du 31/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Dans le contexte de l'implantation de Cigéo, les mesures spécifiques sont prises pour le développement local avec l'élaboration et la mise en œuvre d'un Schéma interdépartemental de développement du territoire (SIDT) sous l’égide de la préfète de la Meuse. Ce schéma permet d’identifier les nombreux enjeux liés à l’implantation de Cigéo et notamment ceux liés au développement économique pour les entreprises locales et celles qui s'implanteront localement dans la dynamique de Cigéo, mais également ceux liés à l'accès à l'emploi, aux métiers et aux compétences requises, au logement... L’Andra contribue à l’élaboration de ce schéma.
Ainsi, l’Andra a fourni, dans le cadre du SIDT, un échéancier des besoins en compétences et emplois afin de permettre aux territoires de préparer les travaux liés à Cigéo et, notamment, de mettre en place des formations adaptées. L’Andra est également impliquée dans la démarche interdépartementale de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriales (GPECT) mise en place récemment sous la maitrise d’ouvrage de la Maison de l’Emploi meusienne et de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Haute-Marne.
Par ailleurs, depuis son implantation en Meuse/Haute-Marne, des efforts sont menés par l’Andra pour recruter localement. Sur les 130 salariés de l’Andra travaillant en Meuse/Haute-Marne, 33 % proviennent de la Meuse et 26 % de la Haute-Marne. L’Andra mène également depuis plusieurs années une politique volontariste visant le développement des relations avec le tissu économique local et favorable aux emplois indirect régionaux. Depuis quatre ans, cette politique est rythmée notamment par la manifestation annuelle « Devenez prestataire de l’Andra » qui est destinée aux PME locales. Ces rencontres permettent aux entreprises de se familiariser avec les exigences et les procédures de l’Andra et de se préparer aux marchés futurs. L’association Energic ST 52/55, qui fédère des entreprises de l’énergie et du BTP, contribue également à valoriser les compétences et entretient une relation partenariale avec l’Andra. Cette politique conjointe s’avère payante. En 2011, les deux régions ont émis 10 % du montant total des facturations (HT) liées au projet Cigéo. Cela représente une collaboration avec plus de 250 établissements locaux (publics ou privés), implantés pour 60 % d’entre eux en Lorraine et 40 % en Champagne-Ardenne. Les départements de Meuse et de Haute-Marne regroupent chacun 30 % du total des établissements concernés. Des incitations à recruter localement seront demandées aux entreprises impliquées pendant la phase de construction de Cigéo tout en respectant les dispositions règlementaires de passation des marchés.
S’agissant du logement des salariés Andra, il n’est pas envisagé d’acquérir un parc immobilier. L’insertion du projet Cigéo et sa réussite passe par une bonne intégration des salariés dans le tissu économique local. L’Andra mobilisera les organismes collecteurs (1% patronal), dans une logique d’anticipation pour prévoir les logements en nombre suffisant (réhabilitation, location, construction). Selon une enquête réalisée en 2010 auprès des salariés de l’Andra, 52 % des personnes résidaient à moins de 20 kilomètres du Centre et 97 % à moins de 45 kilomètres. Dans le cadre du SIDT, une réflexion spécifique est également menée pour les travailleurs en déplacement (hébergement en structures provisoires à proximité du chantier, en gîtes, en logements meublés mis à disposition…).
QUESTION 162 - Le projet CIGEO un projet majeur en terme de montant budgété de 30 milliards
Posée par Jean-Bernard HERGOTT, CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE HAUTE-MARNE (SAINT-DIZIER), le 07/06/2013
1- Sur une durée de vie de 100 ans, le coût du projet se réparti entre les investissements (27%), l’exploitation (41%) et les achats divers (32%). Comment évoluent ces proportions selon les différentes phases du projet : préparation (2016-2018), construction (2019-2025) et exploitation (à partir de 2025) ?
2- Quelle proportion des dépenses d’investissement, d’exploitation et des achats divers l’ANDRA estime-t-elle possible de réaliser auprès des entreprises locales lors des phase de préparation du chantier (2016-2018), de construction (2019-2025) et d’exploitation (à partir de 2025) ?
Réponse du 29/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Selon les hypothèses et périmètres retenus pour le chiffrage 2005, les dépenses d’investissement sont majoritaires pour la période de construction initiale (environ 75 %). Après la mise en service, l’exploitation représente de l’ordre de 50 %, les investissements et les autres dépenses représentent chacun de l’ordre de 25 %.
Les achats locaux s’inscrivent pleinement dans la politique Achats de l’Andra qui précise que l’Agence « s’efforce de développer ses achats auprès des territoires qui l’accueillent, notamment en consultant dès que possible les acteurs économiques locaux ». L’Andra mène une politique active en faveur du développement des achats locaux, notamment en organisant des événements pour présenter ses besoins futurs et ses procédures en matière d’achat. 110 entreprises locales ont ainsi participé à la 4ème manifestation « Devenez un prestataire de l’Andra » en 2012 organisée en Meuse/Haute-Marne. Des échanges sont également organisés, notamment dans le cadre du Schéma interdépartemental de développement du territoire, pour donner aux acteurs locaux une visibilité sur les différents besoins industriels liés à Cigéo (mécaniques, bâtiments, réseaux, terrassements…). A ce stade, il est néanmoins trop tôt pour estimer la part des dépenses qui pourraient être réalisées auprès des entreprises locales.
QUESTION 161 - Niveau de dangerosité de la zone
Posée par Bernard GUENIOT (NANCY), le 06/06/2013
Quel est le classement "type Seveso ou autre " prévu pour une telle zone ? Périmètre de protection ? Problème des déchets qui produisent de la chaleur ... Ventilation prévue ?
Réponse du 31/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
En réponse à la première question, Cigéo sera une installation nucléaire de base (INB). A ce titre, l’installation sera soumise à la réglementation en vigueur concernant ce type d’installation et sera notamment placée sous le contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) comme pour toutes les INB. C’est le préfet qui peut décider des actions de protection des populations à mettre en œuvre pour limiter les conséquences d’un accident éventuel, au travers d’un PPI (plan particulier d’intervention). Cependant, l’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels montre que leurs conséquences resteraient limitées, et nettement en deçà du seuil réglementaire qui imposeraient des mesures de protection des populations (mise à l’abri, évacuation).
Concernant les colis de déchets qui produisent de la chaleur et la ventilation : dans le stockage, la chaleur dégagée par les déchets de haute activité s’évacuera majoritairement dans la roche. Des expérimentations thermiques ont été réalisées au Laboratoire souterrain pour valider les paramètres thermiques de la roche. Cigéo est conçu pour que la température dans la roche reste inférieure à 100 °C indépendamment de la présence ou non d’une ventilation dans les galeries. Cela repose notamment sur l’espacement entre les alvéoles de stockage et sur la limitation de la puissance thermique des déchets stockés (la puissance thermique d’un colis de déchets vitrifiés de haute activité, de l’ordre de 2 000 watts moment de sa fabrication, sera descendue à 500 watts au bout d’une soixantaine d’années, avant leur mise en stockage). La ventilation est nécessaire en phase exploitation pour le personnel. Lorsqu’il sera décidé de fermer le stockage, aucune ventilation ne sera plus nécessaire.
QUESTION 160
Posée par Nicolas MATHIAN (AUBAGNE), le 06/06/2013
Il ressort des différentes lectures que j'ai faite sur le sujet que l'avis des défenseurs du projet relève de la pure conviction scientifique et que les arguments développés par les opposants ne pourront jamais les convaincre. En tant qu'ingénieur je ne peux que regarder d'un œil critique cette solution; l'expérience allemande de stockage dans la mine de sel d'Asse - elle aussi garantie 100% sûre - ne m'aide pas à mieux accepter la solution Made in France. En tant que citoyen je ne peux que m'indigner que l'on cherche à cacher ces preuves de notre cupidité et de notre irresponsabilité. Nous devons garder ces déchets bien en vue en surface, tels des totems de l'Ile de Pâques et non les enfouir dans le sol. Par ailleurs, je trouve que les aspects éthiques/moraux/philosophiques ne sont pas abordés dans les dossiers présentés. Ai-je raté quelque chose ?
Réponse du 05/08/2013,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
Le projet Cigéo est le fruit d’un long travail scientifique, mené depuis plus de 20 ans qui est régulièrement évalué de multiples façons (Autorité de sûreté nucléaire et son appui technique l’IRSN, Commission nationale d’évaluation mise en place par le Parlement, publications scientifiques, expertises indépendantes…). L’Andra écoute les arguments développés par les opposants et prend soin d’y apporter des réponses circonstanciées.
Le cas d’Asse en Allemagne illustre pleinement l’importance de cette démarche d’étude scientifique et d’évaluation préalablement à la décision de mettre en œuvre un projet de stockage. Le stockage à Asse a été réalisé au titre du droit minier et non des réglementations de la sûreté nucléaire telles qu’elles existent aujourd’hui. Il s’agit d’une ancienne mine de sel qui a été reconvertie en un stockage de déchets radioactifs en 1967. Lors du creusement de la mine, aucune précaution n’avait été prise pour préserver le confinement assuré par le milieu géologique. Le stockage n’a pas non plus été conçu au départ pour être réversible. En aucun cas la mine d’Asse ne peut être comparée aux concepts de stockage étudiés par l’Andra pour le projet Cigéo.
Le seul objectif de Cigéo est de protéger l’homme et l’environnement sur le très long terme. La réversibilité laisse des marges de manœuvre aux générations suivantes au travers du pilotage du processus de stockage. Laisser les déchets en surface implique de reporter entièrement la charge de leur gestion sur les générations futures, et leur impose de se protéger elles-mêmes contre la dangerosité de ces déchets, alors qu’elles n’auront pas bénéficié de l’électricité procurée par la production de ces déchets. Ces aspects « éthiques/moraux/philosophiques » ont été débattus lors du débat public de 2006 sur la politique de gestion des déchets radioactifs et c’est notamment sur cette base, ainsi que sur l’évaluation des recherches menées depuis 1991, que le Parlement a demandé à l’Andra de poursuivre ses études de conception du stockage profond réversible en vue d’une possible mise en œuvre, s’il est autorisé, à l’horizon 2025.
QUESTION 159 - sécurité incendie?
Posée par Régis LARCHER (BAR LE DUC), le 06/06/2013
Si un court circuit sur un engin de manutention déclenche un incendie (perspective que vous avez sûrement envisagé mais que vous passez sous silence) quid des émanations et de la soit disant réversibilité?
Réponse du 31/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Pour réduire le risque d’incendie (dont une cause pourrait être un court-circuit sur un engin de manutention), une première mesure consiste à limiter la quantité de produits combustibles ou inflammables dans les équipements du stockage. Ainsi les câbles électriques seront ignifugés et les véhicules à moteur thermique seront interdits dans l’installation nucléaire souterraine de Cigéo. De plus, des dispositifs de détection incendie seront répartis dans plusieurs endroits de l’installation souterraine y compris sur les engins de transfert et de manutention pour détecter rapidement et localiser tout départ de feu. Des systèmes d’extinction automatiques seront mis en place sur les engins de transfert. Un système de compartimentage est prévu pour contenir le feu et éviter sa propagation.
L'architecture souterraine du stockage permettra aux secours d'intervenir dans des galeries à l'abri des émanations de fumées et facilitera l'évacuation du personnel. L’installation sera mise en sécurité. Ensuite, les dispositions à mettre en œuvre pour reprendre l’exploitation normale seront examinées. Le maintien en stockage des colis ou leur retrait éventuel pourra alors être décidé sans un caractère d’urgence particulier.
QUESTION 158 - Sureté du stockage?
Posée par Régis LARCHER (BAR LE DUC), le 06/06/2013
Vous assurez que le stockage profond dans l'argile est SÛR. Il y a quelques années vous assuriez (vous les experts du nucléaire) que "LE SEUL STOCKAGE SÛR EST LE SEL". Nous voyons ce qui arrive au centre de stockage dans le sel de Asse (Allemagne).
En 30 ans votre certitude s'est effondrée et la pollution est avérée! Quand les premières fuites auront lieu sur le site de Bure, acceptez vous d'être pénalement responsables?
Réponse du 31/07/2013,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
A l’international, plusieurs roches sont étudiées pour le stockage, notamment l’argile, le granite et le sel, en fonction des caractéristiques géologiques locales. Le sel présente des propriétés favorables pour dissiper la chaleur émise par les déchets de haute activité. L’absence d’eau y assure le confinement de la radioactivité. Un enjeu particulier concerne la maîtrise de venues d’eau dans le massif de sel. Aux Etats-Unis, un centre de stockage dans le sel est exploité depuis 1999 à 650 mètres de profondeur, le Waste Isolation Pilot Plant (WIPP).
Le cas d’Asse en Allemagne illustre pleinement l’importance d’une démarche d’étude scientifique et d’évaluation préalablement à la décision de mettre en œuvre un projet de stockage. Le stockage à Asse a été réalisé au titre du droit minier et non des réglementations de la sûreté nucléaire telles qu’elles existent aujourd’hui. Il s’agit d’une ancienne mine de sel qui a été reconvertie en un stockage de déchets radioactifs en 1967. Lors du creusement de la mine, aucune précaution n’avait été prise pour préserver le confinement assuré par le milieu géologique. Le stockage n’a pas non plus été conçu au départ pour être réversible. En aucun cas la mine d’Asse ne peut être comparée aux concepts de stockage étudiés par l’Andra pour le projet Cigéo.
Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement afin de contrôler l’impact de ses activités. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, il permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement et l’absence de contamination des nappes phréatiques. L’Andra a déjà initié, au travers de l’Observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
L’Andra est pénalement responsable de ses activités, notamment au titre des dispositions du code de l’environnement issues de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, comme tout exploitant nucléaire.
QUESTION 157 - exposé comparatif des différents procédés de traitement étudiés et envisageables
Posée par Ronan LE POHER (COMMERCY), le 05/06/2013
Partant de la nécessité de traiter les déchets radioactifs HA-VL déjà produits et de la confusion bloquante qui pèse sur ce débat au point d'envisager de l'abréger voir même de la supprimer ce qui me semblerait extrêmement grave : ne pourrait-on pas scinder la problématique entre:
- d'une part la présentation d'une solution technique de traitement des déchets haute activité vie longue déjà produits,
- d'autre part l'avenir de la production d'électricité nucléaire: la France doit-elle ou non continuer à produire ce type de déchets à moyen terme de manière à débattre du projet CIGEO en le situant dans le champ des possibles et orienter "l'énergie" citoyenne à la recherche de la moins mauvaise solution de traitement. Pour cette question spécifique existe-t-il ou pourrait-on concevoir une présentation comparative de la palette des solutions envisagées avec leurs avantages et leurs inconvénients (humain, technique, financier, risque..etc)?
Réponse du 21/08/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Vous proposez de dissocier la problématique des déchets déjà produits de celle des déchets futurs.
1) Cigéo est conçu pour mettre en sécurité définitive les déchets radioactifs existants et futurs produits par les installations nucléaires existantes. En effet, quelles que soient les décisions à venir sur le devenir de ces installations (arrêt ou poursuite de leur exploitation par exemple), de nouveaux déchets seront produits, en particulier lors de leur démantèlement. Au même titre que pour les déchets déjà produits, il est de la responsabilité de notre génération de proposer une solution permettant de gérer ces déchets.
Le choix du stockage profond s’appuie notamment sur les résultats de quinze années de recherches menées dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991, qui avait identifié différents axes de recherche : est-il possible de réduire la quantité et la dangerosité des déchets radioactifs (la séparation/transmutation) ? est-il possible de les entreposer dans des bâtiments résistants sur plusieurs centaines d’années (l’entreposage de longue durée) ? est-il possible de les isoler définitivement de l’homme et de l’environnement en les stockant en profondeur (le stockage profond) ?
Les résultats des recherches menées sur ces 3 axes ont montré que :
- La séparation-transmutation ne supprime pas la nécessité d’un stockage profond car elle ne serait applicable qu’à certains radionucléides contenus dans les déchets (ceux de la famille de l’uranium, appelés les actinides mineurs). Par ailleurs, les installations nucléaires nécessaires à la mise en œuvre d’une telle technique produiraient des déchets qui nécessiteraient aussi d’être stockés en profondeur pour des raisons de sûreté.
- L’entreposage de longue durée impose de reprendre les déchets lorsque les entrepôts ont atteint leur fin de vie, éventuellement de les reconditionner, et de construire de nouveaux entrepôts. L’entreposage de longue durée ne constitue donc pas une solution de gestion définitive et reporte la charge de la gestion des déchets radioactifs sur les générations suivantes.
- Le stockage profond permet de mettre en sécurité de manière définitive les déchets radioactifs. Les évaluations scientifiques et de sûreté ont confirmé les résultats de l’Andra sur la faisabilité et la sûreté d’un stockage profond sur le site étudié en Meuse/Haute-Marne.
En 2006, après l’évaluation de ces recherches et un débat public sur la politique nationale de gestion des déchets radioactifs, le Parlement a retenu le stockage profond réversible pour la gestion à long terme des déchets radioactifs qui ne peuvent être stockés en surface ou à faible profondeur pour des raisons de sûreté. Les recherches sur la séparation/transmutation sont poursuivies en lien avec celles sur les futures générations de réacteurs (cf. ci-après) ainsi que les recherches sur l’entreposage en complémentarité avec le stockage.
2) Cigéo n’est pas conçu pour gérer les déchets qui seraient produits par un éventuel futur parc de réacteurs. Les générations suivantes devront elle-même décider de la façon dont elles souhaitent gérer ces déchets le cas échéant. Néanmoins, l’État a demandé à l’Andra et au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives d’étudier les déchets qui seraient produits par d’éventuelles futures installations nucléaires (réacteurs de 4e génération) afin que cette problématique soit prise en compte dans les décisions à venir concernant les choix énergétiques futurs.
L’Andra a évalué l’impact sur le stockage géologique de la mise en œuvre de diverses options de transmutation avec des réacteurs à neutrons rapides. Comme la transmutation ne peut s’effectuer que dans de futurs réacteurs nucléaires, ce n’est pas l’impact sur le projet Cigéo que l’Andra a étudié, mais l’impact sur son éventuel successeur.
La transmutation des actinides mineurs ne diminue pas le volume des déchets produits, qu’il s’agisse des déchets de haute activité vitrifiés ou bien des déchets de moyenne activité à vie longue. Il faudra stocker en profondeur ces deux types de déchets qu’il y ait ou non transmutation, bien que la transmutation permette d’en réduire la radiotoxicité.
Si elle n’impacte pas les volumes de déchets, la transmutation diminue la chaleur dégagée par les déchets de haute activité vitrifiés et cette chaleur décroît plus vite dans le temps. Cela permet une diminution de l’emprise occupée en souterrain par le stockage. Cette emprise dépend aussi de la durée préalable d’entreposage des déchets de haute activité avant leur stockage. En densifiant au maximum et en acceptant d’augmenter la durée d’entreposage jusqu’à 120 ans, l’emprise totale de l’installation souterraine, tous déchets confondus, pourrait diminuerait jusqu’à un facteur 3 environ avec la transmutation. Pour gérer les déchets d’un siècle supplémentaire de production électronucléaire avec des réacteurs à neutrons rapides, il faudrait 15 km2 en souterrain sans transmutation et 4 à 5 km2 avec. Pour comparaison, 15 km² correspond à l’emprise souterraine finale du projet Cigéo.
QUESTION 156 - Proximité de captage d'eau potable du site d'enfouissement
Posée par Jc BENOIT (RENNES), le 04/06/2013
Où se situent les points de captage d'eau potable les plus proches du site d'enfouissement et à quelle profondeur s'effectue le captage ? Quels contrôles de radioactivité effectués sur ces points de captage (notamment tritium, autres) Quelles normes de radioactivité sur l'eau potable ?
Réponse du 31/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
On dénombre 15 captages destinés à l’alimentation en eau potable (AEP) dans un rayon de 10 km autour de la zone étudiée pour l’implantation souterraine de Cigéo (ZIRA). Ces captages sont réalisés à des profondeurs allant de 3 à 330 mètres selon leur localisation (cf. carte jointe). Les captages les plus proches de la zone étudiée sont peu profonds. Aucun de ces captages n'atteint la couche d'argile étudiée pour l'implantation du stockage, qui ne présente pas de ressource en eau exploitable.
Les analyses des eaux potables issues des captages sont réalisées par des laboratoires agréés par le ministère chargé de la santé. L’ensemble des informations sur ces captages sont disponibles auprès des agences régionales de santé (ARS) de la Meuse et de la Haute-Marne.
Les limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine sont fixées par un arrêté du 11 janvier 2007. Concernant, la radioactivité, la référence de qualité porte sur la dose totale indicative (DTI), qui correspond à l’exposition annuelle résultant d’une consommation régulière de l’eau. Cette référence de qualité est fixée à 0,1 mSv.
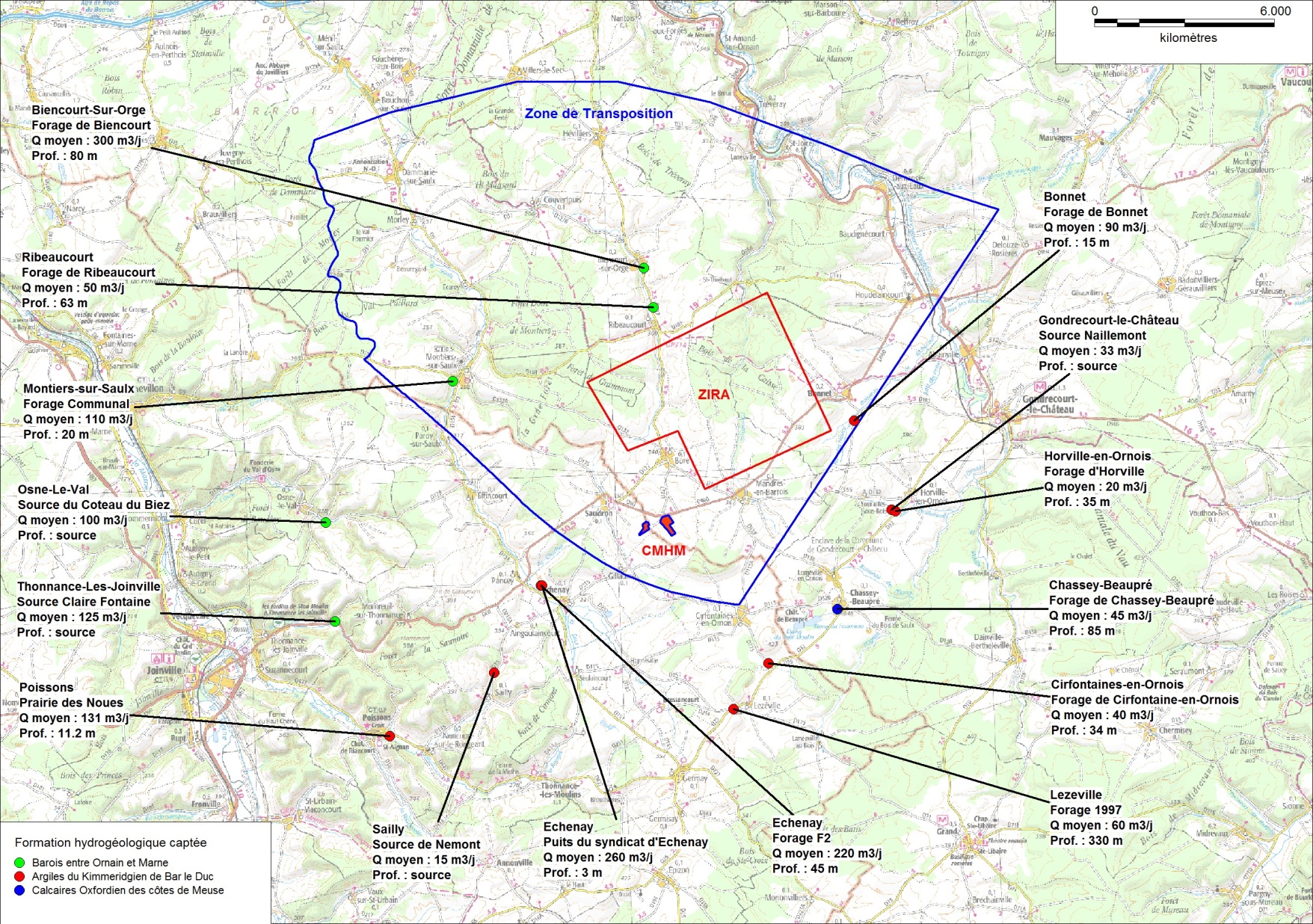
QUESTION 155 - Débat annulé - projet maintenu ?
Posée par Paul BAUMGARTNER (METZ), le 04/06/2013
Bonjour,
Je voudrais vous poser une question : que se passe-t-il si un "débat public" ne peut pas avoir lieu à cause des perturbations créées dans la salle par des opposants à un projet ? Est-ce que le projet "tombe à l'eau" ? Le projet peut-il quand même être validé ?
Merci de votre point de vue.
Réponse du 02/07/2013,
La loi ne définit pas précisément les modalités d'information et d'expression que devrait proposer un débat public.
Le débat se doit d’être ouvert à tous les publics et cela peut l’être par des formes de recueil des interrogations et préoccupations du public autres que des réunions publiques.
QUESTION 154
Posée par Pierre JEANNOT (CHENNEVIÈRES SUR MARNE), le 04/06/2013
Quelles sont les pistes sérieuses en cours de développement des méthodes de retraitement des déchets radioactifs. Objectif moins de 50 ans pour une solution afin d'éviter l'envahissement total des territoires par ses déchets irrécupérables pour des milliers d'années.
Réponse du 31/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La loi du 28 juin 2006 stipule que « la réduction de la quantité et de la nocivité des déchets radioactifs est recherchée notamment par le traitement des combustibles usés et le traitement et le conditionnement des déchets radioactifs ». Les études et recherches associées sont menées par les producteurs de déchets (Areva, CEA, EDF). Le Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs décrit les études et recherches relatives aux procédés de conditionnement et de traitement des déchets radioactifs. Les nouveaux modes de traitement s’appliquent essentiellement à des déchets encore à conditionner.
Par ailleurs, pour encourager cette démarche, l’État a élargi le champ d’action de l’Andra dans le cadre du contrat d’objectifs de l’Agence 2013-2016. Un fonds de 75 millions d’euros a ainsi été alloué à l’Andra dans le cadre des investissements d’avenir pour lui permettre de contribuer au développement de solutions innovantes de traitement des déchets radioactifs.
A plus long terme, des recherches sont également menées en France et à l’étranger sur les procédés de séparation-transmutation. Ce processus consiste dans un premier temps à séparer les uns des autres les différents radionucléides contenus dans les déchets puis dans une seconde étape, à transformer par une série de réactions nucléaires, les radionucléides à vie longue en radionucléides à vie plus courte. Les résultats des recherches menées notamment par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) montrent que la séparation/transmutation ne supprime pas la nécessité d’un stockage profond car elle ne serait applicable qu’à certains radionucléides contenus dans les déchets (ceux de la famille de l’uranium). Par ailleurs, les installations nucléaires nécessaires à la mise en œuvre d’une telle technique produiraient des déchets qui nécessiteraient aussi d’être stockés en profondeur pour des raisons de sûreté.
Réponse apportée par AREVA :
Une grande partie des déchets destinés au stockage profond provient des combustibles usés issus des centrales nucléaires. Le retraitement de ces combustibles usés permet déjà de réduire significativement le volume et la toxicité radiologique à long terme des déchets ultimes à stocker. Les exploitants ont en effet déployé des solutions industrielles qui ont permis de réduire, en moins de 30 ans, le volume de déchets induits par le retraitement d’une tonne de combustible d’environ 3 m3 de déchets HA MAVL au début des années 90 à environ 0,5 m3 de nos jours. Dans le même temps l’électricité produite par tonne de combustible a augmenté de 50 %.
Tout en poursuivant la mise en œuvre de pratiques visant à réduire les déchets à la source, les exploitants continuent leurs efforts de recherche et développement permettant de réduire plus encore le volume et la radiotoxicité des déchets ultimes.
QUESTION 153
Posée par Joël GLICA (PONT LA VILLE), le 04/06/2013
Zone stable à très faible sismicité? Sur des couches âgées de 160 millions d'années qui peut assurer la pérennité du futur site?
Réponse du 29/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La stabilité et la très faible sismicité de la zone d’implantation du laboratoire souterrain sont confirmées par les scientifiques qui ont travaillé sur ce site depuis plus de 20 ans. Le site de Meuse/Haute-Marne appartient à un domaine géologique stable (voir carte), particulièrement favorable pour l’installation d’un stockage. L’activité sismique est en effet extrêmement faible, comme le prouvent les enregistrements de sismicité instrumentale (écoute sismique depuis 1961 à l’échelle de la France) qui sont capables de détecter des microséismes, et les chroniques historiques (séismes ayant été ressentis et/ou ayant occasionné des dégâts au cours des derniers 1 000 ans).
Au-delà de ces données, la stabilité et la très faible sismicité du site s’expliquent par sa situation géographique dans le bassin parisien qui est protégé des mouvements liés à la tectonique des plaques (collision du continent africain avec l’Europe).
De fait, la couche d’argilite étudiée par l’Andra est une couche épaisse, profonde, ancienne qui n’a pas été modifiée de façon significative depuis sa formation, il y a 160 millions d’années. Passée la période de réversibilité du stockage qui doit durer une centaine d’années, l’accès depuis la surface sera scellé et les installations de surface seront démantelées. Dès lors, le stockage ne nécessitera plus d’actions humaines. Et c’est la couche d’argilite qui prendra le relai des barrières créées par l'homme (conteneurs de déchets et ouvrages de stockage) pour assurer le confinement de la radioactivité des déchets sur le long terme.
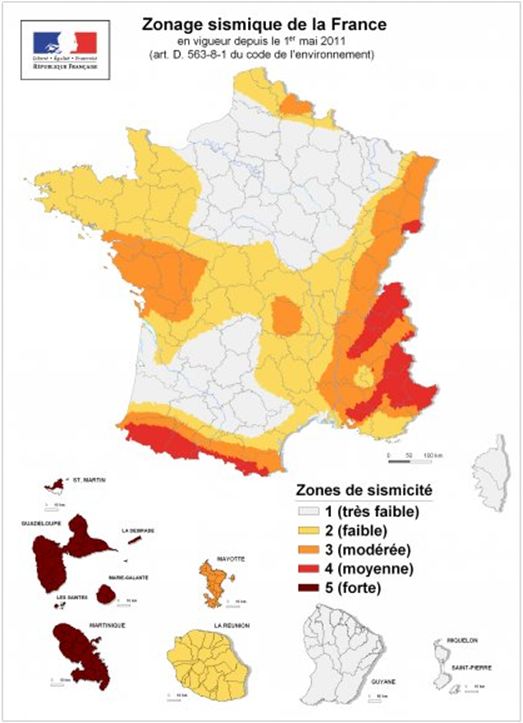
QUESTION 152 - lieu de réunion
Posée par Gerard BESSIERES, CITOYEN (VARENNES SUR AMANCE), le 03/06/2013
Pouvez-vous me dire pourquoi la Haute Marne du Sud n'est pas concernée par le débat public puisque aucune réunion n'est prévue
Réponse du 20/06/2013,
La Commission a voulu informer et consulter en priorité les habitants de la Meuse et de la Haute Marne les plus directement interessés, d'où la carte des réunions. La retransmission intégrale des réunions sur le site internet du débat www.debatpublic-cigeo.org peut pallier partiellement cet inconvénient.
QUESTION 151 - Débat et démocratie
Posée par Alain LASSERTEUX (PARIS), le 04/06/2013
Ma question: Au départ du projet d'enfouissement il était annoncé qu'il y aurait plusieurs sites proposés et qu'au final un choix serait fait; où sont donc les autres sites proposés ?
Réponse du 23/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La loi de recherche du 30 décembre 1991 prévoyait la réalisation de laboratoires souterrains pour l’étude des possibilités de stockage dans les formations géologiques profondes. Suite à une mission de concertation lancée fin 1992 et à des premières analyses géologiques, quatre sites candidats avaient été identifiés dans les départements du Gard, de la Meuse, de la Haute-Marne (couches argileuses) et de la Vienne (couche granitique). L’Andra a été autorisée par le Gouvernement à mener des investigations géologiques dans le but de savoir s’il était intéressant d’y construire un laboratoire souterrain pour continuer les études. En 1996, l’Andra a déposé trois dossiers de demandes d’installation de laboratoires souterrains. Les résultats des investigations géologiques ont montré que la géologie du site en Meuse/Haute-Marne (les deux sites ont été fusionnés en une seule zone en raison de la continuité de la couche argileuse étudiée) était particulièrement favorable. Concernant le Gard, le site présentait une plus grande complexité scientifique liée à son évolution géodynamique à long terme et faisait l’objet d’oppositions locales. L’instruction du dossier relatif au site étudié dans la Vienne n’a pas abouti à un consensus scientifique sur la qualité hydrogéologique du massif granitique.
En 1998, le Gouvernement a décidé la construction d’un laboratoire de recherche souterrain en Meuse/Haute-Marne et la poursuite des études pour trouver un autre site dans une roche granitique. La recherche d’un site dans une roche granitique a finalement été abandonnée, la mission de concertation n’ayant pas abouti. L’Andra a toutefois poursuivi ses recherches sur le milieu granitique jusqu’en 2005, en s’appuyant notamment sur les travaux menés dans les laboratoires souterrains d’autres pays (Suède, Canada, Suisse). Ces recherches ont conduit l’Andra à conclure en 2005 qu’un stockage dans les massifs granitiques ne présenterait pas de caractère rédhibitoire mais que la principale incertitude porte sur l’existence de sites en France avec un granite ne présentant pas une trop forte densité de fractures.
QUESTION 150 - Débat et démocratie
Posée par Alain LASSERTEUX (PARIS), le 03/06/2013
Je remarque que ce débat, qui se veut démocratique commence plutôt mal puisque des réunions sont différées et sur le nombre de questions posées ici peu ont obtenu une réponse.
Réponse du 20/06/2013,
Suite aux perturbations qui ont obligé la Commission à interrompre la première réunion publique, les deux suivantes ont été différées mais pas annulées.
En parallèle, la Commission envisage l’organisation de réunions locales, programmées en priorité dans des communes proches du site. Si l'expérimentation est positive, le dispositif sera étendu plus largement.
A ce jour, la Commission a reçu 195 questions. Près de 34 % d'entre elles ont reçu une réponse.
La CPDP traite les questions relatives au débat public et transmet au maître d'ouvrage les questions qui le concernent. Nous veillons à apporter des réponses complètes et personnalisées qui peuvent demander un certain temps de rédaction.
La CPDP vérifie que toutes les réponses répondent bien aux questions posées, de manière précise et transparente. Ce n'est qu'une fois ce processus terminé que les réponses sont publiées et envoyées à leurs auteurs.
Nous nous engageons à répondre dans un délai de 4 semaines. Jusqu'à présent, le délai entre la réception de la question et la publication de sa réponse se situe entre 8 et 26 jours.
QUESTION 149 - entrainement incendie
Posée par Alain CORREA, STOP-EPR PENLY (ELBEUF), le 03/06/2013
Bonjour Pour lutter contre les risques d’incendies, prévoyez-vous de construire une maquette à l’échelle 1 de l’entreposage CIGEO, à la manière des pompiers américains qui sont capables d’investir 4 millions de dollars dans une réplique de l’A380 pour s’y entrainer ?
http://www.air-journal.fr/2013-03-21-dallas-met-le-feu-a-un-a380-569869.html
Merci
Réponse du 29/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La conception de Cigéo vise avant tout à écarter autant que possible tout risque d’incendie (minimisation des produits inflammables, surveillance incendie, dispositifs d’extinction des départs de feu…). Malgré les mesures de prévention prises, l’Andra considère par précaution la possibilité d’un incendie, et la conception de Cigéo vise à garantir que, dans une telle éventualité, la sécurité des travailleurs et la sûreté de l’installation ne soient pas remises en cause. L’Andra collabore déjà avec les SDIS (Services départementaux d’intervention et de secours) de la Meuse et la Haute Marne pour identifier les éléments importants à prévoir lors de la conception pour garantir la bonne évacuation des personnes et l’intervention des secours. Ainsi, des moyens de secours sont prévus dans l’installation souterraine pour pouvoir intervenir à tout moment, le personnel travaillant en souterrain sera formé à l’incendie et des exercices réguliers d’intervention seront organisés comme cela est déjà le cas dans les galeries du Laboratoire souterrain, dans les mines et dans toute installation nucléaire.
La collaboration avec les SDIS porte également sur la préparation des compétences nécessaires chez les pompiers pour pouvoir intervenir sur Cigéo, si celui-ci est autorisé. En parallèle de la conception du stockage, les besoins en effectifs et en formation seront identifiés dans le cadre du schéma interdépartemental de développement du territoire piloté par la préfecture de la Meuse. Dans ce cadre, les besoins d’infrastructures d’entraînement, permettant de tester les conditions d’intervention et les matériels opérationnels, seront déterminés, afin de renforcer la qualité des opérations menées par les acteurs de secours.
QUESTION 148
Posée par Bernard WOHLEBER (CHARNY SUR MEUSE), le 03/06/2013
Existe-t-il une synthèse des arguments avancés par les opposants sur les déchets HA et MA-VL, sur les déchets à vie courte? Vos réponses?
Je suis pour la poursuite du projet.
Réponse du 13/09/2013,
La Commission du débat public ne dispose pas d'une synthèse des arguments avancés par les opposants au projet et n'a pas connaissance de l'existence d'un tel document. En revanche, certains opposants ont publié des contributions, des avis, des cahiers d'acteurs consultables sur le site du débat public.
QUESTION 147
Posée par Paul GUILLAUME (VERDUN), le 03/06/2013
Peut-on déjà évaluer, même approximativement, l'impact du coût des travaux sur l'impôt et serait-il mis en évidence sur les déclarations annuelles?
Réponse du 31/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’évaluation du coût total de Cigéo doit prendre en compte l’ensemble des coûts du stockage sur plus de 100 ans : les études, la construction des premiers ouvrages (bâtiments de surface, puits, descenderies), l’exploitation (personnel, maintenance, énergie…), la construction progressive des ouvrages souterrains, leur fermeture… Conformément à la loi du 28 juin 2006, le ministre chargé de l’énergie arrête et publie l’évaluation du coût, sur la base de l’évaluation proposée par l’Andra et après avoir recueilli l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et les observations des producteurs de déchets (EDF, CEA, Areva) qui financeront ces dépenses.
Des mises à jour régulières du chiffrage sont prévues pour prendre en compte les résultats des études menées par l’Andra. La dernière évaluation du coût du stockage validée par le ministère en charge de l’énergie date de 2005. Le coût du stockage avait été estimé entre 13,5 et 16,5 milliards d’euros, répartis sur une centaine d’années. Cette évaluation couvrait notamment le stockage de tous les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue produits par les réacteurs nucléaires français pendant 40 ans. Une nouvelle évaluation est en cours par l’Andra, pour intégrer les pistes d'optimisation et les nouveautés en termes de solutions techniques, de sécurité et de dimensionnement.
Ce coût sera financé intégralement par des conventions avec les producteurs de déchets (EDF, le CEA et Areva). Pour un nouveau réacteur nucléaire sur l’ensemble de sa durée de fonctionnement, ce coût représente de l’ordre de 1 à 2 % du coût total de la production d’électricité.
QUESTION 146 - Diffusion des documents et archivage
Posée par Alain CORREA, STOP-EPR PENLY (ELBEUF), le 01/06/2013
Bonjour,
Les documents (papiers et vidéos) du débat public concernant l’EPR de Penly3 ont été diffusés dans des bibliothèques universitaires par des militants associatifs qui ont dû prendre le relais de la CPDP.
Envisagez-vous de diffuser les documents du débat CIGEO dans des bibliothèques ainsi qu’au dépôt légal de la BNF ?
Merci.
Réponse du 20/06/2013,
Durant le débat public, les documents sont consultables dans les bureaux de la Cpdp à Bar-le-Duc et sur son site internet.
A l'issue du débat, ils sont archivés pour une part à la Commission nationale du débat public (située à Paris) et pour une autre part à la Bibliothèque Nationale de France.
QUESTION 145 - Abandon !
Posée par Sylvain LETHUILLIER (FÉNÉTRANGE), le 31/05/2013
Bonjour,
Je constate que la plupart des avis citoyens exprimés sont en faveur de l'abandon du projet, contrairement à celui des acteurs institutionnels qui perçoivent d'ores et déjà des fonds pour faire passer ce projet, via le GIP (départements, communes, etc.). La consultation organisée devra bien prendre acte de ce refus populaire, conformément à la convention d'Aarhus, notamment.
Pouvez-vous m'assurer que ce sera bien le cas et que la consultation est assez honnête pour que le projet puisse être abandonné en cas de refus par les citoyens ?
Réponse du 13/09/2013,
La Commission rédigera, à l'issue du débat public, un compte-rendu qui sera une synthèse de tous ce qui aura été porté au débat. La Commission se base sur l'ensemble des contributions : les avis, les questions et leurs commentaires, les cahiers d'acteurs, le forum, les réseaux sociaux et les réunions publiques.
Tous ces éléments sont publics, diffusés sur le site internet du débat et le resteront plusieurs années après la fin du débat. Ceci est un gage de transparence.
QUESTION 144 - chaleur à récupérer
Posée par Claude BUTTY, le 31/05/2013
Pourquoi enfouir des déchets qui créent de la chaleur alors que cette chaleur doit pouvoir être récupérée pour des applications diverses, sur des sites sécurisés?
Réponse du 29/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
A l’instar de la radioactivité, la chaleur dégagée par les colis de déchets dits de haute activité à vie longue (déchets vitrifiés) décroit dans le temps, principalement durant les premières centaines d’années : la puissance thermique de chaque colis est de l’ordre de 2 000 W au moment de sa fabrication, elle descend à 500 W au bout d’une soixantaine d’années, et continue à décroître ensuite plus lentement. Avant d’être placés dans le stockage profond, les colis de déchets vitrifiés sont entreposés en surface sur leur site de production, afin que la chaleur qu’ils dégagent ait suffisamment décru afin notamment de garantir des températures inférieures à 100°C dans la roche lorsqu’ils seront stockés (cela peut prendre entre 60 et 90 ans). L’Andra étudie les opportunités d’optimisation énergétique du Centre liées à la récupération de la chaleur ou d’air provenant du souterrain.
Réponse apportée par AREVA :
La conception de la dernière extension des entreposages sur le site de la Hague tire déjà parti du dégagement de chaleur pour auto entretenir par tirage naturel une circulation d'air, qui assure le refroidissement des colis de déchets de manière passive. En effet, la récupération de l'énergie des conteneurs impose la mise en œuvre d'une ventilation mécanique, alimentée électriquement, alors que la conception réalisée par AREVA repose sur une ventilation en tirage naturel entièrement autonome et intrinsèquement sûre.
QUESTION 143 - Débat
Posée par Fabienne BOUROVALI-ZADE, le 30/05/2013
Vous appelez ça un débat la majorité des questions sont sans réponses, le délais de réponse trop long, on ne peux pas contredire vos réponses, de plus les thèmes choisis nous sont imposés pourquoi ne pas avoir choisi un forum le débat serait certainement plus ouvert que ce système de questions / (non) réponses ? Vous révélez ainsi une démarche anti démocratique pour ce débat qui n'en n'est pas un, puisque tout à l'air décidé d'avance et que le résultat nous sera imposé
Réponse du 20/06/2013,
A ce jour, la Commission a reçu 195 questions. Près de 34 % d'entre elles ont reçu une réponse.
La CPDP traite les questions relatives au débat public et transmet au maître d'ouvrage les questions qui le concernent. Nous veillons à apporter des réponses complètes et personnalisées qui peuvent demander un certain temps de rédaction.
La CPDP vérifie que toutes les réponses répondent bien aux questions posées, de manière précise et transparente. Ce n'est qu'une fois ce processus terminé que les réponses sont publiées et envoyées à leurs auteurs.
Nous nous engageons à répondre dans un délai de 4 semaines. Jusqu'à présent, le délai entre la réception de la question et la publication de sa réponse se situe entre 8 et 26 jours.
Nous proposons un classement thématique parce que nombreuses sont les personnes qui apprécient de pouvoir prendre connaissance de tous les éléments publiés sur le sujet qui les intéresse sans être obligées de les chercher au milieu de centaines d'autres questions. Cette liste de thèmes n'est pas exhaustive, le débat est complètement ouvert et toutes les questions peuvent être posées.
Enfin, les questions-réponses et avis sont ouverts aux commentaires des autres internautes depuis le 15 juin.
QUESTION 142 - types de déchets
Posée par Gérard BESSIERES, CITOYEN (VARENNES SUR AMANCE), le 30/05/2013
Les déchets de mox issus des centrales seront-ils stockés à Bure avec les autres déchets à vie longue et fortement radioactifs
Réponse du 29/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La nécessité de stocker des combustibles usés MOX dépendra de la politique énergétique qui sera mise en œuvre par la France dans le futur.
Dans le cadre de la politique énergétique actuelle en France, les combustibles usés (dont les combustibles MOX) issus de la production électronucléaire ne sont pas considérés comme des déchets mais comme des matières pouvant être valorisées, notamment dans les réacteurs de quatrième génération. A ce titre, ils ne sont pas destinés à être stockés dans Cigéo. Seuls les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue, issus du traitement de combustibles usés, sont destinés à Cigéo.
Dans l’hypothèse où les combustibles usés (MOX ou autres) devraient être stockés directement, après refroidissement, ils pourraient être stockés dans Cigéo, qui a été conçu pour être flexible afin de pouvoir s’adapter à d’éventuels changements de la politique énergétique et à ses conséquences sur la nature et les volumes de déchets qui devront alors être stockés. A la demande du Ministère en charge de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, l’Andra, EDF et Areva ont étudié l’impact des différents scénarios établis dans le cadre du débat national sur la transition énergétique sur la production de déchets radioactifs et sur le projet Cigéo : ../docs/rapport-etude/20130705-courrier-ministere-ecologie.pdf
La faisabilité de principe et la sûreté du stockage profond des combustibles usés, y compris des combustibles MOX usés, a par ailleurs été démontrée par l’Andra en 2005. Dans le cadre du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, l’État a demandé à l’Andra de vérifier par précaution que les concepts de stockage de Cigéo restent compatibles avec l’hypothèse d’un stockage direct de combustibles usés si ceux-ci étaient un jour considérés comme des déchets. L’Andra a remis fin 2012 un rapport d’étape. Dans l’hypothèse d’un stockage direct des combustibles usés, compte tenu du temps nécessaire de refroidissement, comme pour l’essentiel des déchets HA, leur stockage n’interviendrait pas avant l’horizon 2070/2080.
La nature et les quantités de déchets autorisés pour un stockage dans Cigéo seront fixées par le décret d’autorisation de création du centre. Toute évolution notable de cet inventaire devra faire l’objet d’un nouveau processus d’autorisation, comprenant notamment une enquête publique et un nouveau décret d’autorisation.
QUESTION 141 - concerne l'étanchéité des alvéoles de confinement
Posée par Gerard BESSIERES, CITOYEN (VARENNES SUR AMANCE), le 30/05/2013
Comment garantir l'étanchéité des alvéoles de confinement afin d'éviter les fuites d'hydrogène des colis pendant des milliers d'années?
Réponse du 31/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Certains déchets MA-VL, notamment ceux contenant des composés organiques, dégagent de l'hydrogène non radioactif produit par radiolyse : les ¾ des colis de déchets MA-VL destinés à Cigéo dégagent peu d’hydrogène (moins de 3 litres par an et par colis), voire pas du tout. Au-delà d’une certaine quantité et en présence d’oxygène, cet hydrogène peut présenter un risque d’explosion. Pour maîtriser ce risque pendant l’exploitation de Cigéo, l’Andra fixe une limite stricte aux quantités d’hydrogène émises par chaque colis. Des contrôles seront mis en place et aucun colis ne sera accepté s’il ne respecte pas cette limite. Pour éviter l’accumulation de ce gaz, les installations souterraines et de surface seront ventilées en permanence pendant leur exploitation, comme le sont les installations d’entreposage dans lesquelles se trouvent actuellement ces déchets. Le système de ventilation du stockage fait l’objet de dispositions pour réduire le risque de panne (redondance des équipements, maintenance..) et des dispositifs de surveillance seront mis en place pour détecter toute anomalie sur son fonctionnement. Des situations de perte de la ventilation sont étudiées malgré tout. Les études montrent que, dans le pire des cas, on disposera de plus d’une dizaine de jours pour rétablir la ventilation, ce qui permettra de mettre en place une ventilation de secours. Les conséquences d’une explosion sont tout de même évaluées afin d’envisager tous les scénarios possibles : les résultats montrent que les colis concernés ne seraient que faiblement endommagés, sans aucune perte de confinement des substances qu’ils contiennent.
Après la fermeture du stockage, la présence d’hydrogène n’engendrera plus de risque d’explosion du fait de l’absence d’air. L’hydrogène qui sera présent dans les alvéoles après la fermeture proviendra d’une part des colis de déchets MA-VL, contenant notamment des matières organiques, d’autre part de la corrosion des matériaux métalliques des colis de déchets MA-VL et HA. Les études scientifiques et les expérimentations menées au laboratoire souterrain ont étudié le comportement de cet hydrogène dans le stockage après la fermeture : il va se dissoudre et diffuser très lentement dans les ouvrages de stockage ainsi que dans la couche argileuse. Cela va se traduire par une augmentation de la pression d’hydrogène durant les premiers milliers d’années, puis par une diffusion très progressive à travers la couche d’argile. Compte tenu de la lenteur du processus, aucun effet en surface ne sera décelable.
L’Andra vérifie, dans son analyse de la sûreté après fermeture du stockage, que cette présence d’hydrogène n’a pas d’impact sur la sûreté du stockage. En particulier, la pression maximale atteinte par l’hydrogène ne remet pas en cause les capacités de confinement de la couche d’argile.
QUESTION 140
Posée par Anne BELIN (BOULANGE), le 30/05/2013
Pourquoi avoir changé le nom du projet?
Réponse du 15/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Historiquement le nom du projet était « projet HA-MAVL ». Lorsque ce projet est entré en phase de conception industrielle, l’Andra a souhaité signifier ce changement au public en donnant au projet un nom plus concret. Le projet HA-MAVL est alors devenu le projet Cigéo, projet de Centre Industriel de stockage GEOlogique de déchets radioactifs.
QUESTION 139 - accès aux questions
Posée par Alain CORREA, STOP-EPR PENLY (ELBEUF), le 29/05/2013
Bonjour,
Serait-il possible de proposer un onglet qui permette d’avoir accès à toutes les questions par ordre chronologique et/ou numéro d'ordre, sans distinction de catégories ?
Merci.
Réponse du 13/06/2013,
Les avis et les questions sont désormais consultables sous deux classements :
• par thématiques
• par numéro d'ordre
QUESTION 138 - test en réel
Posée par Alain CORREA, STOP-EPR PENLY (ELBEUF), le 29/05/2013
Bonjour,
Pourquoi l’ANDRA ne réalise pas un stockage pilote HAVL réel à échelle 1, afin d’étudier tous les éléments en situation réelle sur place, comme fait n’importe quel industriel avant de lancer une production de masse?
Merci
Réponse du 23/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Un programme d’essais est d’ores et déjà mené au Laboratoire souterrain, dans la roche étudiée pour le stockage à 500 mètres de profondeur. Ce programme a notamment permis de tester des méthodes de construction (creusement, soutènement-revêtement), de surveillance et de fermeture. Des essais ont également été réalisés en surface (à l’échelle 1 mais sans colis de déchets réels) pour tester les moyens de mise en place et de retrait des colis de déchets. Ces essais sont présentés à l’Espace technologique de l’Andra à Saudron.
Si la création de Cigéo est autorisée, ces essais seront complétés par un programme de démonstration industrielle à l’échelle 1 dans Cigéo, avant la mise en exploitation de l’installation. Si à la fin du programme de démonstration, l’Autorité de sûreté nucléaire estime nécessaire de poursuivre les observations, elle pourra demander des compléments à l’Andra.
La phase de démarrage de l’exploitation sera progressive. Les premières alvéoles de stockage pour les déchets de moyenne activité à vie longue (MA-VL) seront fortement instrumentées pour permettre leur observation détaillée. Une zone pilote est prévue pour le stockage de premiers déchets de haute activité (HA)*.
Dans le cadre de ses propositions sur la réversibilité, l’Andra propose qu’un rendez-vous soit programmé 5 ans après la mise en exploitation pour évaluer la phase de démarrage et préparer le passage à une nouvelle phase d’exploitation.
*Les déchets HA se caractérisent par leur concentration en radioactivité, qui leur confère un caractère fortement irradiant et qui entraîne un dégagement de chaleur important en comparaison des déchets MA-VL. Leur stockage est prévu à l’horizon 2075.
QUESTION 137 - Alternatives
Posée par Divi KERNEIS (ELVEN), le 28/05/2013
Bonjour,
Avez-vous prévu des alternatives au projet dans le cas où l'avis de l'enquête publique serait défavorable? En d'autres termes, les citoyens ont-ils le choix d'accepter ou de refuser le projet que vous nous présentez?
Réponse du 09/09/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La loi du 28 juin 2006 a fait le choix du stockage réversible profond pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations futures. Elle demande à l’Andra d’étudier et d’implanter Cigéo en stipulant que « la demande d'autorisation de création [d’un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs] doit concerner une couche géologique ayant fait l'objet d'études au moyen d'un laboratoire souterrain ». L’Andra poursuit donc ses études en vue d’élaborer pour 2015 le dossier support à l’instruction de la demande d’autorisation de création de Cigéo en Meuse/Haute-Marne, dans la couche d’argile dont les propriétés de confinement sont désormais reconnues.
La décision d’autoriser ou non la création de Cigéo en Meuse/Haute-Marne n’est cependant pas encore prise. Elle reviendra à l’Etat après l’évaluation du dossier remis par l’Andra en 2015 par l'Autorité de sûreté nucléaire et la Commission nationale d'évaluation, l’avis des collectivités territoriales, le vote d’une nouvelle loi fixant les conditions de réversibilité et une enquête publique. S’il était décidé d’étudier un autre site d’implantation pour le stockage, cela impliquerait de reprendre l’ensemble du processus de recherche de site, de caractérisation par un laboratoire souterrain et de conception d’un stockage adapté à ce nouveau site, ce qui impliquerait de repousser le calendrier prévu par la loi pour l'implantation d'un tel centre.
Réponse apportée par le ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie :
Les citoyens ont la possibilité d’exprimer leurs avis sur la pertinence, les orientations et les choix du projet à travers les différentes étapes de consultation prévues par la procédure encadrant le projet Cigéo décrite à l’article L. 542-10 du Code de l’Environnement.
C’est donc en particulier le cas lors de l’enquête publique, cela l’est également au travers de chacune des procédures de consultation qui sont organisées afin de recueillir l’avis des populations locales et nationales pour le projet Cigéo :
• un débat public en 2013, organisé afin de recueillir les avis de l’ensemble de la population au niveau local et national. Conformément à l’article L. 121-1 du code de l’environnement, le débat « porte sur l'opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales du projet » ;
• un avis des collectivités locales à proximité du projet (horizon 2016) ;
• une enquête publique (horizon 2017-2018) préalable au décret d’autorisation de création. Conformément à l’article L. 123-1 du code de l’environnement, l’enquête publique « a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers ».
Chacun est invité à s’exprimer au travers des procédures de consultation et l’expression de ses représentants au Parlement. L’ensemble des avis émis dans le cadre des procédures de consultation sera examiné, pour déterminer des suites à donner au projet.
Ce n'est qu'à l'issue de ces procédures de consultation, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, de la Commission nationale d'évaluation et le vote d'une loi sur les conditions de la réversibilité, que la décision sera prise d'autoriser ou non la création Cigéo en Meuse/Haute Marne.
QUESTION 136 - Enfouissement et réchauffement climatique
Posée par Christian MICHAL (PARIS), le 28/05/2013
Dans les scénarios les plus pessimistes, les effets du réchauffement climatique risquent d'être énormes d'ici un siecle ou deux. L'ANDRA s'est-elle préoccupée de cette question et si oui quelles conclusions en a-t-elle tiré sur la sécurité du stockage?
Réponse du 23/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les effets des évolutions climatiques sur l’évolution du milieu géologique sont pris en compte par l’Andra. Différents scénarios climatiques ont ainsi été étudiés dont :
- un scénario d’évolution fortement perturbée par les activités humaines, établi avec la communauté scientifique, fondé notamment sur une hypothèse pessimiste des rejets de CO2 au cours des prochains siècles. Ce scénario est caractérisé, par exemple, par un réchauffement élevé.
- un scénario non perturbé par les activités humaines qui tient compte des périodes de glaciation régulières.
Ces différentes évolutions climatiques n’auront de conséquences significatives sur le milieu géologique qu’au-delà de plusieurs milliers d’années. Ces conséquences, en particulier l’érosion en surface et sur les circulations d’eau en profondeur ont été étudiées. Les phénomènes d’érosion se produisent principalement au sortir des périodes glaciaires, dans les périodes dites interglaciaires, du fait des abondantes circulations d’eau et de l’existence encore marquée des alternances de gel/dégel qui fractionnent les roches : il s’en suit notamment des éboulements des pentes, comme cela a pu être retrouvé sur des reliefs de cote comme en Meuse. Compte tenu de la profondeur du stockage (500 m), ces effets n'affectent pas les propriétés de la couche argileuse. Ils concernent au maximum de l'ordre de la première centaine de mètre du milieu géologique et ne remettent pas en cause la sûreté du stockage.
De plus, les évaluations d’impact à long terme sont également réalisées en supposant plusieurs environnements pour prendre en compte les évolutions climatiques possibles. Les évaluations d’impact considèrent ainsi en plus du climat tempéré actuel, la possibilité d’un climat plus chaud (exemple tropical) et plus froid (exemple –glaciaire).
QUESTION 135 - Non autorisation
Posée par Divi KERNEIS (ELVEN), le 28/05/2013
Bonjour,
Afin de contredire le fait que ce débat public n'est pas une mascarade démocratique, pouvez-vous citer un débat public où, malgré des avis scientifiques, de sûretés, des collectivités territoriales et une enquête publique favorable, la procédure n'ait pas abouti à une autorisation du projet du fait d'un débat public qui ait révélé l'hostilité du peuple au projet?
Merci.
Réponse du 11/06/2013,
Bonjour
Dans ses 11 ans d'existence sous sa forme actuelle, le débat public a contribué, souvent avec d'autres faits (prise de conscience des élus, pression des populations interessées, difficultés de financement etc) à modifier ouà différer des projets. C'est ainsi par exemple que la ligne à très haute tension entre la France et l'Espagne ne sera pas réalisée en aérien, mais en souterrain, ou que la liaison CDG Express pour les passagers de Roissy CDG n'a pas été mise en oeuvre. Le site www.debatpublic.fr peut vous apporter d'autres informations sur ce point.
QUESTION 134
Posée par Jacques RICOUR (ORLÉANS LA SOURCE), le 28/05/2013
Y aura-t-il des garanties financières déposées en cas d'accidents ou de reprise du dépôt s'il y a défaillance de l'ANDRA.
Réponse du 07/08/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’Andra est un établissement public placé sous la tutelle de l’État. Pour Cigéo, comme tout industriel, l’Andra contractera des assurances destinées à couvrir les risques industriels classiques. De plus, Cigéo étant une installation nucléaire, elle est soumise au régime de responsabilité civile nucléaire. En cas d’accident nucléaire survenant sur le site de l’Andra, la responsabilité de cette dernière sera mise en cause sans que les victimes n’aient à prouver une faute de l’Andra.
QUESTION 133
Posée par Jacques RICOUR (ORLÉANS LA SOURCE), le 28/05/2013
Lors de l'émission radio du 15/04/13, Madame DUPUIS a qualifié de "peut-être" la réversibilité du stockage?
La réversibilité du dépôt est-elle garantie (voir les difficultés sur STOCAMINES à la suite de l'incendie et les coûts de reprise).
Réponse du 31/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Vous faites certainement référence à l’émission « Le téléphone sonne » de France Inter consacrée à Cigéo le 15 mai 2013. Ce n’est pas Marie-Claude Dupuis, directrice générale de l’Andra, qui dit « peut-être » à propos de la réversibilité mais la journaliste Nathalie Fontrel.
Si rien n’est encore décidé concernant la création de Cigéo - comme Madame Dupuis a pu le rappeler par ailleurs - la réversibilité, elle, est garantie. C’est une disposition inscrite dans la loi du 28 juin 2006, suite au débat public de 2005/2006. Le Parlement a indiqué que l’autorisation de créer Cigéo ne pourrait pas être délivrée si la réversibilité n’est pas garantie.
Les conditions de réversibilité doivent être fixées par une future loi. La réversibilité constitue donc l’un des sujets majeurs à discuter dans le cadre du débat public pour alimenter la préparation de cette future loi. Les propositions détaillées de l’Andra sont décrites dans le document technique Propositions de l’Andra relatives à la réversibilité du projet Cigéo (le document est téléchargeable sur : ../informer/les-etudes-preparatoires.html).
En particulier, l’Andra prévoit des solutions techniques permettant de récupérer les colis en toute sûreté pendant la phase d’exploitation du Centre. Les colis de déchets radioactifs seront placés dans des conteneurs indéformables, en béton ou en acier épais. Ils seront placés dans des tunnels avec un revêtement en béton ou en acier afin qu’ils ne se déforment pas. Ces tunnels de stockage seront équipés de capteurs pour suivre leur évolution dans le temps. Ces dispositions seront financées dès la mise en œuvre du stockage. Des tests de récupérabilité ont d’ores et déjà été réalisés par l’Andra et ont montré la faisabilité du retrait. Ces tests pourront être renouvelés pendant toute l’exploitation de Cigéo.
Le retour d’expérience de Stocamine montre qu’il existe différents niveaux de récupérabilité d’un stockage, plus ou moins faciles, et que ces niveaux peuvent évoluer au fil du temps. Dans le domaine des déchets radioactifs, une échelle internationale a ainsi été mise en place pour définir différents niveaux de récupérabilité. L’Andra propose que les étapes successives de fermeture du stockage, qui permettront de progresser vers une sûreté de plus en plus passive mais qui conduiront à une diminution du degré de récupérabilité, fassent chacune l’objet d’une demande d’autorisation spécifique.
L’Andra propose également que des rendez-vous réguliers soient organisés avec l’ensemble des acteurs (riverains, collectivités, évaluateurs, État…) pour faire le point sur l’exploitation du stockage et les prochaines étapes. Ces discussions seront alimentées par les résultats des réexamens de sûreté et de la surveillance du stockage. Ces rendez-vous offriront aussi aux générations suivantes la possibilité de réexaminer périodiquement les conditions de réversibilité.
QUESTION 132
Posée par Eric ROSSIGNE, le 28/05/2013
BONJOUR
L'ASN ETANT UN ORGANISME DE SURETE, IL N'EST PAS PREVU DANS LA LOI QUE SES MISSIONS SOIENT DE DONNER SON AVIS DANS LE DEBAT ENERGETIQUE NATIONAL. JE DEMANDE DONC QU'ELLE S'EN RETIRE. A QUAND UN VRAI DEBAT PUBLIC DEMOCRATIQUE SUR L'AVENIR DES DECHETS NUCLEAIRES? UN REFERENDUM?
Réponse du 11/06/2013,
1- nous ne sommes pas dans le débat national sur la transition énergetique, mais dans le débat public sur le projet de stockage profond réversible en Meuse-Haute Marne intitulé CIGEO
2- les avis de l'ASN figurent au dossier du débat, l'ASN étant l'autorité indépendante d'évaluation de la sécurité dans le domaine nucléaire
3 la loi de 2006 sur la gestion des déchets prévoit un avis spécifique de l'ASN dans la procédure d'autorisation du projet de stockage
QUESTION 131 - mise en ligne des videos
Posée par Alain CORREA, STOP EPR PENLY (ELBEUF), le 27/05/2013
Bonjour,
Le débat de Bure a été enregistré en vidéo. M. Bernet et les membres de l'équipe technique, présents, me l'ont confirmé. Quand, sous quels formats et sur quel site les vidéos des débats seront disponibles ?
Merci.
Réponse du 02/07/2013,
Les enregistrements audio, video et les retranscriptions "mot à mot" des réunions publiques de Bure et de Bar-le-Duc sont consultables sur le site du débat public www.debatpublic-cigeo.org sous la rubrique "S'informer > Les réunions publiques".
QUESTION 130 - Que ferez-vous de l'argile extraite ?
Posée par Alain CORREA, STOP EPR PENLY (ELBEUF), le 27/05/2013
Bonjour,
Que ferez-vous de l'argile extraite du sous-sol lors du creusement des galeries? Où sera t-elle entreposée? Quels volumes seront extraits? Combien de camions seront necessaires pour la transporter?
Merci.
Réponse du 29/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les déblais d’argile excavés lors du creusement de l’installation souterraine représenteront un volume de l’ordre de 10 millions de mètres cubes, répartis sur une centaine d’années*. Environ 40 % des déblais seront réutilisés pour remblayer les ouvrages souterrains à la fermeture de Cigéo.
Les déblais seront stockés en surface dans des « verses ». Ces verses seront réalisées progressivement, sur une emprise estimée à terme de l’ordre de 130 hectares. Elles feront l’objet d’un traitement spécifique afin d’être intégrées au paysage (utilisation de la topographie du site, couverture végétale, reboisement…) en cherchant à limiter leur extension, en hauteur et en surface.
L’implantation des verses est étudiée à proximité immédiate des installations de Cigéo pour limiter les besoins en transports. Sur la période séculaire d’exploitation de Cigéo, le transport de l’argile excavée jusqu’aux verses correspondrait à un flux moyen de l’ordre d’une trentaine de camions par jour. Pendant la phase initiale du chantier, des transports de déblais seront nécessaires entre les 2 sites où seront implantées les installations de surface de Cigéo, avec des flux plus importants. Ces sites sont distants de l’ordre de 5 km. Plusieurs options sont étudiées pour ces transports (voie dédiée, convoyeur, télébenne…).
* A titre de comparaison, le volume de déblais générés par le creusement de grands tunnels est du même ordre de grandeur (environ 7 millions de mètres cubes pour le tunnel sous la Manche, environ 15 millions de mètres cubes pour le futur tunnel de base de la liaison ferroviaire Lyon-Turin) mais répartis sur une dizaine d’années.
QUESTION 129
Posée par Serge GRUNBERG, Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l'Ouest (ACRO) (HEROUVILLE ST CLAIR), le 27/05/2013
Ma question concerne la prise en compte des contraintes économiques dans la sureté (cf rapport de l'OPECST de Claude Birraux et Christian Bataille page 338): François Moussely ancien président d'EDF avait dit: "oui, il faut trouver un juste équilibre entre exigences économiques et impératifs de sécurité..."
André Claude Lacoste (ASN) a rappelé que, contrairement à ce qui a pu être dit, le cadre législatif et réglementaire français imposait, d'ores et déjà, à l'ASN d'intégrer à ses analyses en matière de sureté les contraintes économiques.
Comment, dans ce cas, assurer les populations concernées, que leur sécurité ne sera pas amoindrie en raison du coût? Qui pourrait accepter cela?
Réponse du 26/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le cadre législatif et réglementaire qui s’applique à l’Andra est très clair et donne la priorité à la sûreté. Outre les limites strictes imposées par les textes, ceux-ci imposent également aux exploitants d’abaisser autant que possible le niveau d’exposition des populations au-delà des limites fixées par la réglementation. L’Andra, comme tous les exploitants, est soumise à ces exigences réglementaires, qui sont de plus complètement cohérentes avec sa mission, qui est de mettre en sécurité les déchets radioactifs, afin de protéger l’homme et l’environnement.
Réponse apportée par l’Autorité de sûreté nucléaire :
Si sa création est décidée puis autorisée, un centre de stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde sera une installation nucléaire de base. Sa création, puis son suivi, seront donc notamment encadrés par les textes législatifs et règlementaires ci-dessous :
• La loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, codifiée au code de l’environnement et notamment au chapitre III du titre IX de son livre V (articles L.593-1 et suivants du code de l’environnement) ;
• La loi n°2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs, codifiée pour partie au code de l’environnement et notamment au chapitre II du titre IV de son libre V (articles L.542-1 et suivants) ;
• Le décret n°2010-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
• L’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base qui renvoie notamment à des principes énoncés dans le code de la santé publique.
Par ailleurs, cette réglementation est complétée par des décisions à caractère règlementaire de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et précisée dans des guides à caractère non opposable également rédigés par l’ASN. Ainsi, l’ASN a publié le 12 février 2008 un guide de sûreté relatif au stockage définitif de déchets radioactifs en formation géologique profonde.
L’Autorité de sûreté nucléaire, dans le cadre de l’instruction qu’elle mènera, le cas échéant, d’une demande d’autorisation de création d’une installation de stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde, suivra les principes précisés par ce cadre législatif et règlementaire. Ainsi :
• Comme pour toute activité nucléaire, l’autorisation de cette installation ne pourra être autorisée que si elle est justifiée. L’article L.1333-1 du code de la santé publique précise ainsi qu’ « une activité nucléaire ou une intervention ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par les avantages qu'elle procure, notamment en matière sanitaire, sociale, économique ou scientifique, rapportés aux risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de soumettre les personnes ». L’article L.542-1 du code de l’environnement dispose que « la recherche et la mise en œuvre des moyens nécessaires à la mise en sécurité définitive des déchets radioactifs sont entreprises afin de prévenir ou de limiter les charges qui seront supportées par les générations futures ». Cette activité est donc a priori justifiée;
• L’ASN ne pourra être favorable à la création de cette installation que si le risque associée à celle-ci est suffisamment faible et donc que si elle est intrinsèquement suffisamment sûre. Ce principe est décrit à l’article L.593-7 du code de l’environnement qui dispose en effet qu’une installation nucléaire de base ne peut être créée « que si, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, l’exploitant démontre que les dispositions techniques ou d’organisation prises ou envisagées […] sont de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients que l’installations présente »;
• Enfin, l’ASN ne pourra être favorable à son autorisation que si le niveau de risque qu’elle présente est le plus bas raisonnablement possible en prenant en compte des facteurs économiques et sociaux. L’article L.1333-1 du code de la santé publique précise ainsi que « l'exposition des personnes aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ou interventions doit être maintenue au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu de l'état des techniques, des facteurs économiques et sociaux et, le cas échéant, de l'objectif médical recherché ». A cet effet, l’article 1.2 de l’arrêté du 7 février 2012 susmentionné demande à l’exploitant de tirer parti « des meilleures techniques disponibles » afin notamment « d'atteindre, compte tenu de l'état des connaissances, des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement, un niveau des risques et inconvénients [pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement] aussi faible que possible dans des conditions économiquement acceptables ».
La prise en compte des facteurs économiques dans l’analyse de sûreté d’une installation de stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde, comme pour toute autre installation nucléaire, n’intervient donc qu’une fois qu’il est garanti que le risque associé ait été justifié et qu’il ait été démontré qu’il était suffisamment faible.
Ainsi, une installation ne peut pas être autorisée si elle ne présente pas les garanties de sûreté suffisantes. Pour autant, cela ne sera pas suffisant : une installation ne sera autorisée que s’il est également démontré qu’elle présente le niveau de sûreté le plus élevé qui puisse être raisonnablement atteint, en prenant en compte dans cette analyse les facteurs économiques et sociaux. C’est donc à ce niveau que les facteurs économiques entrent en compte dans l’analyse de l’ASN.
QUESTION 128
Posée par Claire PEUREUX (PAROY SUR SAULX), le 27/05/2013
Il aurait fallu prévenir les habitants de la zone concernée avec un prospectus ou courrier en boîte aux lettres afin qu'ils soient au courant de cette "réunion de ce soir" (à Bure le 23 Mai) et des suivantes. Du moins par courrier en mairie afin que les conseils municipaux puissent prendre les mesures pour le faire.
Réponse du 11/06/2013,
Madame, les 180.000 foyers de Meuse et Haute Marne ont reçu de la Commission, autour du 15 mai, un dossier comportant notamment le calendrier précis des réunions, ce qui répond à votre juste préoccupation. Vous avez du le recevoir, sauf si vous avez demandé la non distribution des publicités '"Stop Pub".
En parallèle, plusieurs exemplaires de cette documentation, ainsi que des affiches, ont été envoyés aux mairies, et des annonces ont été passées dans la presse régionale et locale.
QUESTION 127
Posée par Bernard STEPHAN (MONTIGNY LÈS METZ), le 27/05/2013
Y a-t-il des possibilités de GEOTHERMIE à proximité de la zone considérée?
Réponse du 29/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La géothermie dite de surface, qui permet d’alimenter des maisons individuelles et des immeubles collectifs ou tertiaires via des pompes à chaleur, est réalisable partout, avec des techniques adaptées en fonction des terrains. L’exploitation de ces ressources en surface ne serait pas incompatible avec Cigéo, même au droit des installations souterraines de Cigéo, qui seraient situées à 500 mètres de profondeur.
La géothermie profonde nécessite des investissements importants et est aujourd’hui mise en œuvre dans les zones avec à la fois des conditions géologiques favorables et des perspectives d’utilisation importante de la chaleur extraite. Concernant les conditions géologiques, un forage à 2000 mètres de profondeur dans les grès du Trias (Forage EST 433, Montiers-sur-Saulx) a été réalisé lors d’une campagne de reconnaissance menée en 2007-2008 afin de mesurer le potentiel du site. Les caractéristiques habituellement recherchées pour déterminer s’il existe un potentiel géothermique (salinité, température et productivité) ont été mesurées. Il en ressort que le sous-sol dans la zone étudiée pour l’implantation de Cigéo ne présente pas un caractère exceptionnel en tant que ressource potentielle pour une exploitation géothermique profonde. Dans son rapport n°4 de juin 2010, la CNE aboutit aux mêmes conclusions : « Le trias de la région de Bure ne représente pas une ressource géothermique potentielle attractive dans les conditions technologiques et économiques actuelles. »
QUESTION 126
Posée par Laurence PARISOT (MONTIER EN DER), le 27/05/2013
A quelle profondeur les déchets vont-ils être enfouis?
Réponse du 10/06/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Si Cigéo est autorisé, l’installation souterraine dans laquelle seront stockés les colis de déchets sera construite à environ 500 mètres de profondeur, au milieu d’une roche argileuse de plus de 130 mètres d’épaisseur.
QUESTION 125
Posée par Gilles GRANDVAL (SAINT-PRIEST), le 24/05/2013
Je suis absolument contre la solution retenue qui ne garantie aucune sécurité à l'horizon lointain de fin de vie des déchets. Où est la prise en compte des 40000 signatures contre le projet dans la présentation?
Réponse du 21/08/2013,
Réponse apportée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Dans votre question, vous mentionnez une pétition réalisée en 2005/2006 en Meuse et en Haute-Marne demandant la réalisation d’un référendum dans les deux départements. Le projet Cigéo suit la procédure décrite à l’article L. 542-10 du Code de l’Environnement, dont le processus est illustré par les schémas présentés ci-dessous et qui ne prévoit pas la réalisation d’un référendum.
Comme cela est représenté sur les schémas, au cours de ce processus, plusieurs procédures de consultation sont organisées afin de recueillir l’avis des populations locales et nationales :
• un débat public en 2013, organisé afin de recueillir les avis de l’ensemble de la population au niveau local et national ;
• un avis des collectivités locales à proximité du projet (horizon 2016) ;
• une enquête publique (horizon 2017-2018) préalable au décret d’autorisation de création.
Le Parlement fixe périodiquement les choix relatifs à la mise en œuvre de ce projet :
• loi du 30 décembre 1991, dite loi « Bataille », fixant un programme d’études et recherches de 15 années d’études et recherches sur les déchets radioactifs ;
• loi du 28 juin 2006, définissant le stockage géologique profond comme solution de référence pour les déchets les plus radioactifs et demandant sa mise en service en 2025 ;
• loi à venir sur la réversibilité du projet à horizon 2016.
En outre, l’Etat est en contact permanent avec les parties prenantes locales. Un important travail de concertation a été mené, notamment avec les exécutifs locaux, pour élaborer un projet de schéma interdépartemental du territoire.
L’avis des populations locales au travers des procédures de consultation et l’expression de leurs représentants au Parlement sont primordiaux. Dès aujourd’hui, à travers les outils d’expressions mis en place par la Commission Particulière du Débat Public (site internet, cahiers d’acteur, réunions), vous avez l’opportunité d’exprimer votre avis.
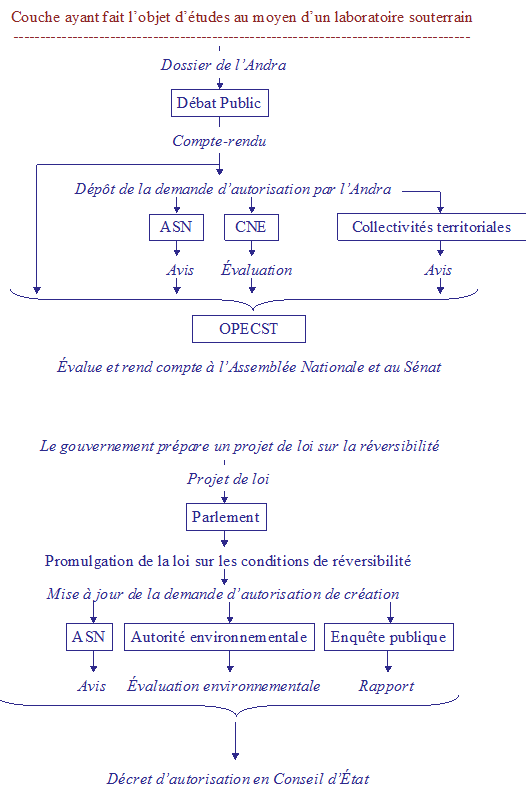
QUESTION 124 - Sommes versés aux elus et instances locales
Posée par Jc BENOIT (RENNES), le 25/05/2013
Quelles sont les montants financiers reversés aux communes, départements, Conseils généraux, conseils régionaux, élus, suite à ce projet de stockage? est-il possible d'avoir de la transparence à ce sujet (d'actualité) à savoir qui touche quoi et pendant combien de temps? il y a t-il un contrôle effectué et par qui ensuite sur l'affectation de ces sommes?
Réponse du 09/09/2013,
Réponse apportée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Le laboratoire de recherche et le Centre Technologique de l’Andra sont soumis à la fiscalité de droit commun (taxes foncières et contribution économique territoriale qui remplace aujourd’hui la taxe professionnelle) comme toutes les entreprises. La taxe foncière est due pendant toute la durée de vie des biens immobiliers, la contribution foncière des entreprises pendant toute la durée de vie de l’activité professionnelle de l’établissement.
Cette fiscalité de droit commun générée par le laboratoire et le Centre Technologique de Saudron est majoritairement reversée aux collectivités locales après les mécanismes de péréquations prévues par la loi (chiffres 2010) :
• communes : environ 1.2 M€ ;
• communautés de communes : environ 1.5 M€ ;
• conseil général de la Meuse : environ 2.4 M€.
Environ 0.1 M€ ont été versés à la région de la Lorraine.
Conformément à la réglementation, une partie de cette fiscalité est reversée à l’établissement public foncier local de Lorraine (environ 0,1M€) et à la chambre de commerce et d’industrie de région (environ 0,1 M€).
D’autre part, des taxes payées par les producteurs de déchets radioactifs sont reversées à la Meuse et Haute-Marne afin d’accompagner le développement du territoire dans le cadre du laboratoire souterrain et dans le futur du projet Cigéo. Il s’agit des taxes d’accompagnement et de diffusion technologique qui sont gérées par deux groupements d’intérêt public (GIP) en Meuse et en Haute Marne, afin de réaliser les actions suivantes décrites à l’article L. 542-11 du Code de l’environnement :
1° « gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation du laboratoire ou du centre de stockage » ;
2° « mener, dans les limites de son département, des actions d'aménagement du territoire et de développement économique, particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils généraux concernés » ;
3° « soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques, notamment dans les domaines étudiés au sein du laboratoire souterrain et dans ceux des nouvelles technologies de l'énergie. »
Il s’agit donc de sommes destinées au développement du territoire autour du projet, afin de faciliter son insertion dans le territoire Meusien et Haut-Marnais.
Chacun des groupements d’intérêt public a reçu 30 M€ en 2012. Le code de l’environnement prévoit qu’une partie de ces sommes soit automatiquement reversée par les GIP aux communes situées à moins de 10km du laboratoire. Ainsi, les communes de Meuse situées à moins de 10km ont reçu au global 1,8 M€ et les communes de Haute-Marne situées à moins de 10 km 1,3 M€ au titre de l’accompagnement économique.
Depuis 2007, les sommes reversées par les GIP aux collectivités locales meusiennes et haut-marnaises correspondent à 78% des dépenses.
Dans le cadre du contrôle de légalité, l’Etat contrôle que l'affectation de ces ressources fiscales et des dépenses des collectivités respectent la réglementation. Par ailleurs, l'Etat, est administrateur ou commissaire du gouvernement des GIP et vérifie dans ce cadre l’utilisation des ressources qui leur sont dévolues.
QUESTION 123 - et Si? alors que se passerait-il?
Posée par Martin LAPORTE (MAZEROLLES), le 27/05/2013
De plus (mais nos amis les animaux n'ont qu'à bien se tenir, l'Euro et le dollar parlent plus fort) nous apprenons chaque jour des choses nouvelles quant à leurs capacités de repérages ou leur organisation sociale , qui est capable de prévoir d'éventuels bouleversements à leur niveau?
Smart
Réponse du 23/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Toute implantation industrielle sur un site induit des évolutions dans son environnement, incluant la faune locale. L’étude d’impact du projet Cigéo, que l’Andra doit présenter au moment de sa demande d’autorisation de création, doit vérifier que le nouveau site ne va pas supprimer de sites naturels particulièrement sensibles ou d’intérêt écologique significatif et que l’aménagement du site limitera les impacts.
Une attention toute particulière a été portée à l’environnement dans un périmètre très large autour du site envisagé pour l’implantation de Cigéo. Un Observatoire pérenne de l’environnement, dispositif de recherche labellisé, en partenariat avec de nombreux organismes de recherche dans l’Environnement, est en place depuis plusieurs années et a vocation à accompagner le projet tout au long de son développement afin de mieux appréhender les évolutions écologiques, liées ou non au projet, à grande échelle et sur le long terme. Ce dispositif va très largement au-delà des prescriptions réglementaires qui sont imposées à un exploitant.
L’étude d’impact fera l’objet de réévaluations régulières au cours de la vie de Cigéo en intégrant les retours des observations mentionnées ci-dessus.
QUESTION 122 - et Si? alors que se passerait-il?
Posée par Martin LAPORTE, CIVIL (MAZEROLLES), le 24/05/2013
Et si dans 70 ans une étude sérieuse (voire plusieurs) prouve que malgré les mesures de sécurité sans précédent qui ont étés prises on se rend compte (allez savoir pourquoi? Quelque chose découvert entre temps, un composé environnemental qui n'avait pas été soupçonné... bref, on se rend compte) qu'un effet grave de la radioactivité est déclaré (admettons), que se passera-il? quel est le plan B? - on change de place la grosse poubelle? (et les terres irradiées avec) - on évacue le centre de la France et on se tasse autour de notre Tchernobyl national? - seuls les cancéreux et les séropositifs iront en retraite tous frais payés à Bure?
Smart
Réponse du 29/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Nous considérons que la fin de vos propos est scandaleuse et nous ne répondons donc qu’à la première partie de votre question.
L’autorisation d’exploiter Cigéo ne constituera pas un chèque en blanc de la part des autorités pour toute la durée de son exploitation. Ainsi, dans le cadre de la réversibilité de Cigéo, l’Andra propose l’organisation de rendez-vous réguliers avec l’ensemble des acteurs (riverains, collectivités, évaluateurs, État…) sans attendre les 70 ans que vous mentionnez. Lors de ces rendez-vous, un bilan sera fait en particulier sur l’exploitation du stockage, sa sûreté, et bien sûr son impact sur l’homme et son environnement notamment en regard des connaissances scientifiques et techniques du moment. A chaque étape, il sera possible de décider de poursuivre le processus de stockage tel qu’initialement prévu, de le modifier, voire de récupérer des colis de déchets si la société le juge nécessaire.
Les populations locales ont plusieurs fois exprimé leur souhait de voir une surveillance de la santé autour du stockage. Un groupe d’experts a été mis en place pour proposer des modalités techniques pour assurer cette surveillance. L’Andra a saisi ses ministères de tutelle pour que la gouvernance et l’organisation d’un tel dispositif soient précisées, sans aucune distinction de la population à surveiller.
QUESTION 121 - et Si? alors que se passerait-il?
Posée par Martin LAPORTE (MAZEROLLES), le 27/05/2013
De même mais j'imagine qu'une indemnisation à déjà été prévue, comment soutenir l'économie agricole de la Meuse avec un tel poids en son centre? Mangez local? elle est belle la France! il est donc temps d'investir dans les stations météo thermomètres baromètres heures et compteurs Geiger pour le particulier, non? enfin j'ai toute ma confiance dans la science et ma réserve pour la politique de chacun.
Smart
Réponse du 23/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Cigéo est conçu pour protéger l’Homme et l’environnement. L’impact du centre en termes de radioactivité sera très inférieur à celui de la radioactivité naturelle et n’aura donc aucun impact sur la qualité des productions agricoles. L’Andra a créé l’Observatoire pérenne de l’environnement, qui a pour mission d’assurer un suivi détaillé de l’évolution de l’environnement du stockage pendant plus de cent ans ; cela permettra de lever ainsi toute inquiétude en démontrant que le stockage n’a pas d’impact sur les activités agricole de proximité. Cet observatoire labellisé, s’inscrit dans un grand nombre de réseaux scientifiques nationaux ou internationaux.
De plus l’emprise des installations de surface de Cigéo, si l’autorisation de construction en est donnée, occuperont environ 300 hectares, soit un peu plus que la superficie d’une exploitation agricole moyenne en Meuse, ce qui ne déstabilisera pas la production agricole locale.
La sûreté du stockage étant garantie, est-ce que l’image des produits locaux pourrait être ternie par la présence de Cigéo ? L’expérience prouve que non : de nombreuses installations nucléaires coexistent en France avec des activités agricoles, sans qu’elles en souffrent. L’industrie et l’agriculture ont toujours coexisté en France, il n’y a pas de raison que cela ne dure pas.
QUESTION 120 - Quelle Durée de la connaissance du site
Posée par Jc BENOIT (RENNES), le 24/05/2013
Savez-vous si notre civilisation ou notre société sera toujours là dans 10.000 ou 200.000 ans? Comment est-il prévu d'informer les êtres vivants dans ce lointain futur sur l 'existence de ce site?
Réponse du 26/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Il est bien entendu impossible de prédire ce que deviendra notre société dans plusieurs milliers d’années. Le principe fondamental du stockage profond est que sa sûreté à long terme doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Il reste donc sûr, à long terme, même en cas d’oubli, contrairement à l’entreposage. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. En cas de perte complète de la mémoire du stockage, une intrusion inopinée à 500 mètres sous terre apparaît peu plausible, du moins sans un minimum d’investigations préalables. L’Andra évalue cependant par précaution dans son analyse de sûreté les conséquences d’un forage à travers le stockage pour vérifier que le stockage resterait sûr.
Cependant, l’Andra conçoit tout de même Cigéo avec l’objectif d’en conserver la mémoire et de la transmettre aux générations futures le plus longtemps possible. Des solutions d’archivage à long terme existent pour les centres de stockage de surface exploités par l’Andra et font l’objet de revues périodiques. Le retour d’expérience montre que ces solutions paraissent robustes pour au moins les 500 premières années. Pour Cigéo, l’Andra prévoit de réaliser un centre de la mémoire qui pourra perdurer sur le site. Il pourra accueillir le public et comprendra notamment les archives du Centre.
De manière générale, le maintien de la mémoire doit aussi impliquer les acteurs locaux, qui peuvent prendre le relai en cas de défaillance de l’Andra ou de l’État. L’Andra veille d’ores et déjà à les informer sur les enjeux associés à la mémoire et étudie avec des anthropologues, des philosophes ou encore des artistes les facteurs qui peuvent favoriser la transmission de la mémoire. La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
En 2010, l’Andra a lancé un vaste programme d’études pour renforcer ces dispositifs et pour développer la réflexion sur la mémoire plurimillénaire. Diverses pistes sont d’ores et déjà envisagées pour transmettre la mémoire sur de longues échelles de temps tels que des marqueurs de surface portant des messages clairs et compréhensibles ou l’organisation de rendez-vous réguliers à mettre en place au niveau des populations locales…
En tout état de cause, comme il est impossible de garantir notre capacité à communiquer avec des êtres vivant dans plusieurs milliers d’années, c’est chaque génération qui aura la responsabilité, si elle le juge nécessaire, de contribuer à transmettre cette mémoire aux générations suivantes.
QUESTION 119
Posée par Nicole LE BOT (LANGRESCOMBIEN), le 24/05/2013
Combien par an? Combien d'années?...!
Réponse du 24/06/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
En 2005, le coût du stockage avait été estimé entre 13,5 et 16,5 milliards d’euros répartis sur une centaine d’années, soit un coût moyen de l’ordre de 130 à 160 millions d’euros par an. Cette évaluation couvrait notamment le stockage de tous les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue produits par les réacteurs nucléaires français pendant 40 ans. Cette évaluation est en cours de mise à jour.
QUESTION 118
Posée par Francis COINCE (ST DIZIER), le 24/05/2013
Réversibilité à terme?
Réponse du 31/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Si Cigéo est autorisé, l’Andra propose que des rendez-vous réguliers soient programmés pour faire le point sur l’exploitation du stockage et préparer les étapes suivantes. Les conditions de réversibilité et le calendrier de fermeture du stockage pourront être réexaminés lors de ces rendez-vous. C’est aux générations suivantes qu’il reviendra de décider dans un siècle si elles souhaitent fermer définitivement le stockage ou temporiser cette étape.
QUESTION 117
Posée par Francis COINCE (ST DIZIER), le 24/05/2013
Argile = quelle résistance aux rayonnements au fil des siècles
Réponse du 09/09/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Dans le stockage, les rayonnements auxquels sera soumise l’argile seront atténués car les colis de déchets seront placés dans des conteneurs et tunnels dont les parois (en béton ou en acier) serviront d’écran de protection :
- des conteneurs en béton de quelques centimètres d’épaisseur et des parois en béton de plusieurs dizaines de centimètres pour les colis de déchets de moyenne activité à vie longue;
- des conteneurs et sur-conteneurs de plusieurs centimètres d’acier pour les colis de déchets de haute activité ainsi qu’un tubage métallique d’environ 2-3 centimètres dans l’alvéole dans laquelle ils seront placés.
De plus, l’intensité des rayonnements émis par les déchets diminue au fil du temps, du fait de la décroissance naturelle de la radioactivité qu’ils contiennent.
L’irradiation n’a donc pas d’effets qui pourraient modifier les propriétés de l’argile. Ces résultats sont confirmés par de nombreuses études, menées par l’Andra et par ses homologues étrangers, notamment concernant les processus susceptibles de modifier les propriétés des argiles (Ex d'études : Projet Européen CERBERUS - Heat and radiation effects on the near field of a HLW or spent fuel repository in a clay formation ; Thèse de doctorat : Étude des effets d’irradiation dans les montmorillonites. Application au stockage des déchets radioactifs (S. Sorieul)).
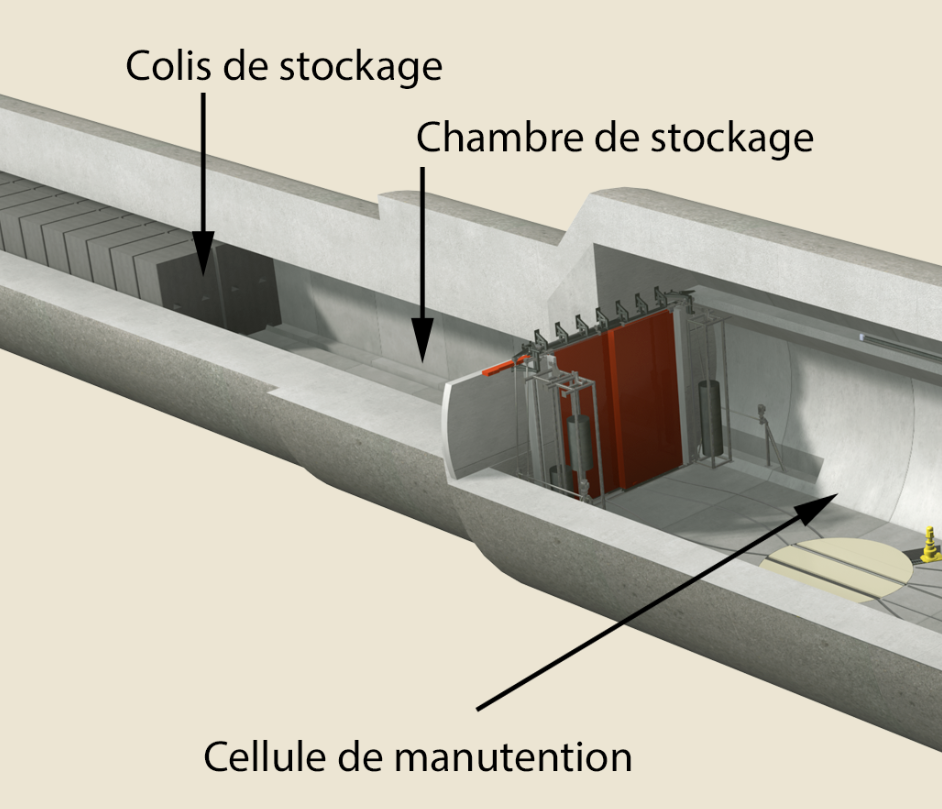
QUESTION 116
Posée par Patrick VARNEY (MONTSAUGEON), le 24/05/2013
Alors que les responsables de l'ANDRA parlent de non réversibilité au delà de 20 ans, comment penser qu'au bout de 100 ans, les colis pourront être récupérés? Comment une loi sur la réversibilité pourra être votée et sur quelles bases?
Réponse du 31/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le Parlement a demandé que le stockage soit réversible pendant au moins 100 ans. L’Andra conçoit Cigéo pour permettre la récupération de colis sur cette durée et pour laisser aux générations suivantes la possibilité de revenir sur les décisions prises aujourd’hui et modifier si elles le souhaitent le planning de fermeture du stockage.
De nombreuses dispositions techniques sont mises en œuvre pour faciliter une opération éventuelle de retrait de colis du stockage. Les colis utilisés pour le stockage des déchets, en béton ou en acier, sont indéformables. Des espaces suffisants sont ménagés entre les colis pour permettre leur retrait. Les emplacements où les déchets seront stockés (alvéoles de stockage) ont un revêtement en béton ou en acier pour éviter les déformations. L’exploitant disposera d’une connaissance précise de l’emplacement de chaque colis et de ses conditions de stockage. Des tests de retrait de colis ont d’ores et déjà été réalisés à l’échelle 1 et pourront être renouvelés pendant toute l’exploitation de Cigéo.
L’Andra propose des conditions de réversibilité qui ne compromettent pas la sûreté du stockage et qui sont réalisables sur le plan technique. Le débat public alimentera la préparation de la future loi qui fixera les conditions de réversibilité du stockage. Cette loi sera votée avant que la création de Cigéo ne puisse être décidée. Pour en savoir plus sur les propositions de l’Andra sur la réversibilité de Cigéo : http://www.cigéo.com/images/cigeo/site/pdf/499.pdf
QUESTION 115
Posée par Isabelle VOUAUX (POULANGY), le 24/05/2013
Page 05 fait référence à 40 000m3 de déchets HA&MA.VL déjà produits et entreposés dans des bâtiments. Ils devront être transférés à CIGEO qui disposera d'un entreposage de +/- 80 000m3 page 4.
Comment l'espace prévu peut-il être suffisant?
Réponse du 20/06/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les 80 000 m3 correspondent à l’estimation du volume total de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue destinés à Cigéo. La moitié de ces déchets (environ 40 000 m3) sont déjà produits et entreposés dans des bâtiments à La Hague, Marcoule et Cadarache.
Si Cigéo est autorisé, les opérations de transfert de ces déchets à Cigéo seront étalées sur une centaine d’années. L’installation souterraine de stockage, à 500 m de profondeur, sera construite progressivement, au fur et à mesure des besoins. Son étendue sera d’environ 15 km² au bout d’une centaine d’années.
En surface, il n’est pas prévu sur Cigéo de bâtiments se substituant aux entrepôts existants sur les sites de La Hague, Marcoule, Cadarache. Le bâtiment assurant les opérations de contrôle des colis de déchets et de préparation avant leur stockage en souterrain aura uniquement une capacité limitée (quelques centaines de m3 au maximum), pour des besoins logistiques.
QUESTION 114 - Stockage en profondeur
Posée par Elisabeth CARDOT, MOI, MES ENFANTS, MES FUTURS PETITS ENFANTS, LEURS DESCENDANTS SUR UN MILLIER OU PLUS DE GENERATIONS, le 24/05/2013
Je me questionne par ailleurs sur le choix de la France en terme d'énergie finançant exclusivement le nucléaire. Enfin je suis stupéfaite de l'argent distribué aux élus et aux populations pour acheter leurs voix : cela ne relève-t-il pas de la corruption?
Réponse du 09/09/2013,
Réponse apportée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Dans son rapport de janvier 2012 sur les coûts de la filière électronucléaire, la Cour des Comptes indique qu’en 2010, « les dépenses financées par des crédits publics se sont élevées à un montant estimé à 644M€ (414M€ de recherche publique et 230M€ pour la sécurité/sûreté/transparence). »
Elle précise par ailleurs que « leur montant est du même ordre de grandeur que celui de la taxe sur les INB, fiscalité spécifique payée par les exploitants (580M€ en 2010) et dont on peut considérer qu’elle est destinée à couvrir les dépenses publiques qui lui sont liées. »
D’autre part, des taxes prélevées sur les exploitants sont reversées à la Meuse et Haute-Marne afin d’accompagner le développement du territoire dans le cadre du laboratoire souterrain et dans le futur du projet Cigéo. Ainsi, les sommes issues des taxes d’accompagnement et de diffusion technologique sont gérées par deux groupements d’intérêt public (GIP) en Meuse et en Haute Marne, afin de réaliser les actions suivantes décrites à l’article L. 542-11 du Code de l’environnement :
1° « gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation du laboratoire ou du centre de stockage » ;
2° « mener, dans les limites de son département, des actions d'aménagement du territoire et de développement économique, particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils généraux concernés » ;
3° « soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques, notamment dans les domaines étudiés au sein du laboratoire souterrain et dans ceux des nouvelles technologies de l'énergie. »
Il s’agit donc de sommes destinées au développement du territoire autour du projet, afin de faciliter son insertion dans le territoire Meusien et Haut-Marnais.
Dans le cadre du contrôle de légalité, l’Etat contrôle que l'affectation des ressources fiscales et des dépenses des collectivités respectent la réglementation. De plus, l'Etat, est administrateur ou commissaire du gouvernement des GIP et vérifie dans ce cadre l’utilisation des ressources qui leur sont dévolues.
QUESTION 113 - stockage en profondeur
Posée par Elisabeth CARDOT, MOI, MES ENFANTS, MES FUTURS PETITS ENFANTS, LEURS DESCENDANTS SUR UN MILLIER OU PLUS DE GÉNÉRATIONS, le 24/05/2013
Comment penser qu'on peut maîtriser un stockage, enfoui, en profondeur, sur des milliers d'années alors qu'on sait pertinemment que les moyens de contrôle associés (contenats, sondes...) ne sont pas fiables au-delà d'une dizaine d'années ? Il me semble qu'on se donne bonne conscience en faisant semblant de prendre des précautions, qu'on cache la misère loin dans la tombe et puis Inch Allah, A Dieu va, qu'importe ce qui se passera après puisqu'on ne le verra pas. Je ne comprends pas qu'on ne stocke pas en "surface", en tous cas, à des profondeurs contrôlables au fil des siècles, et à proximité des lieux déjà contaminés, à savoir au pied des centrales.
Réponse du 31/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L'entreposage actuel des déchets sur leurs sites de production est une solution provisoire qui ne peut être pérennisée. En effet, elle nécessite l’intervention régulière de l’homme pour contrôler, maintenir et reconstruire les installations, ce qui ne peut être garanti sur le long terme. En cas de perte de contrôle de telles installations, les conséquences radiologiques sur l’homme et l’environnement ne seraient pas acceptables.
Le stockage à 500 mètres de profondeur dans une couche géologique assurant le confinement à l’échelle de plusieurs centaines de milliers d’années permet de protéger l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue. La géologie prend ainsi le relais de l’homme pour garantir la sûreté sur ces grandes échelles de temps. Cela nécessite une géologie favorable, comme celle étudiée à la limite de la Meuse et de la Haute-Marne.
De plus, le stockage géologique n’est pas incompatible avec une étroite surveillance des déchets comme vous le pensez. Pendant toute la phase d’exploitation, l’installation fera l’objet d’un contrôle continu, d’une maintenance régulière et de réexamens périodiques de sûreté, dont la loi exige qu’ils aient lieu au moins tous les 10 ans.
Après la fermeture du stockage, la sûreté sera assurée de manière passive et ne nécessitera aucune action humaine. Néanmoins, l’Andra prévoit que les générations futures puissent poursuivre la surveillance du site après la fermeture du stockage, aussi longtemps qu’elles le souhaiteront. Cette surveillance ne devra pas compromettre le confinement passif assuré par le stockage une fois fermé. Elle pourra comprendre une surveillance de l’environnement (nappes phréatiques, environnement de surface), pour confirmer l’absence d’impact du stockage, ainsi que des moyens d’auscultation du stockage non intrusifs, notamment par des méthodes géophysiques. Cette surveillance contribuera également au maintien de la mémoire du stockage.
QUESTION 112 - ORIGINE DES DECHETS
Posée par Bernard VESVAL (BOURMONT ), le 24/05/2013
Les déchets du secteur de la santé (hôpitaux, cliniques, laboratoires de radiologies) sont ils inclus dans ce stockage?
Réponse du 23/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le secteur de la santé ne produit pas de déchets qui concernent Cigéo (déchet de haute activité (HA) ou de moyenne activité à vie longue (MA-VL). Ce secteur produit en très grande majorité des déchets de faible et moyenne activité à vie courte (FMA-VC). Le reste correspond en très faible quantité à des déchets de très faible activité (TFA) ou de faible activité à vie longue (FA-VL). L’ensemble des déchets de ce secteur est actuellement pris en charge dans les centres industriels de l’Andra dans l’Aube, en stockage pour les déchets TFA et FMA-VC et en entreposage dans l’attente d’un centre de stockage adapté pour les déchets FA-VL.
QUESTION 111 - Nappes phréatiques et site de stockage
Posée par Jc BENOIT (RENNES), le 24/05/2013
Il y a-t-il une nappe phréatique sous le site de stockage? où se situent les plus proches nappes phréatiques du site? A quelle distance et à quelle profondeur? Quelles possibilités accidentelles ou non de migrations et diffusions des élements radioactifs stockés vers ces nappes?
Réponse du 31/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le projet de stockage Cigéo est prévu d’être implanté dans la couche argileuse très peu perméable du Callovo-Oxfordien, située à une profondeur d’environ 500 m et dont l’épaisseur varie de 140 à 160 m environ sur le site étudié. Au sens de la définition générale d’un aquifère (ou nappe phréatique), il existe trois formations aquifères situées de part et d’autre de la couche du Callovo-Oxfordien :
- en surface, les calcaires du Barrois : d’une épaisseur de quelques dizaines de mètres, il s’agit d’un aquifère généralement de type karts. Cet aquifère est exploité localement pour l’alimentation en eau potable,
- de part et d’autre de la couche du Callovo-Oxfordien, l’Oxfordien carbonaté au-dessus et le Dogger en dessous :
- l’Oxfordien carbonaté d’environ 300 mètres d’épaisseur est à une profondeur de 200 m. L’aquifère est en fait constitué de deux aquifères séparés par des marnes. L’aquifère le plus proche de la couche du Callovo-Oxfordien est située environ de 40 m et 100 m de cette dernière,
- le Dogger a une épaisseur d’environ 300 m. On y distingue aussi deux aquifères séparés par des marnes (marnes de Longwy) d’environ 30 m d’épaisseur : l’un, le Bathonien, est situé en partie supérieure du Dogger, avec une épaisseur moyenne de 100 m environ ; l’autre, le bajocien, est en partie basse. Sur le site, la distance entre la base du Callovo-Oxfordien et le bathonien aquifère varie de 20 m à 40 m environ.
Sur la zone de transposition, les aquifères de l’Oxfordien et du Dogger présentent des caractéristiques hydrogéologiques faibles, parfois désignés sous le nom d’aquitards. Ils ne sont de ce fait exploités qu’en dehors de la zone où pourrait être implanté Cigéo, là où leurs caractéristiques hydrogéologiques sont plus favorables.
Pendant l’exploitation du Centre, afin d’éviter tout risque de contamination des nappes phréatiques, les effluents liquides susceptibles d’être contaminés seront systématiquement collectés et contrôlés.
Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement afin de contrôler l’impact de ses activités. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, il permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement et l’absence de contamination des nappes phréatiques. L’Andra a déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
De plus, Cigéo sera en permanence soumis au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
Le stockage sera implanté la couche d’argile qui garantit l’éloignement des déchets radioactifs de la surface. Seuls quelques radionucléides mobiles et dont la durée de vie est longue pourront migrer jusqu’aux limites de la couche d’argile qu’ils atteindront après plusieurs dizaines de milliers d’années, puis potentiellement atteindre en quantités extrêmement faibles ensuite la surface et les nappes phréatiques, après plus de 100 000 ans. Leur impact radiologique serait alors plusieurs dizaines de fois inférieur à la radioactivité naturelle (qui est de 2,4 mSv par an en moyenne en France).
Dans une démarche prudente, l’Andra dans son évaluation d’impact sur l’homme et l’environnement à long terme suppose que les eaux de ces nappes phréatiques pourraient être captées par forage et utilisées pour des usages du type de ceux qui peuvent être pratiqués aujourd’hui (jardin, boisson, abreuvement des animaux). Les études montrent que, même dans ce cas, l’impact du stockage reste inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire et ne présente pas de risque pour la santé.
QUESTION 110 - Cout de fonctionnement du site dans 100, 1000, 10.000 ans
Posée par JC BENOIT (RENNES), le 24/05/2013
Comment est-il possible d'estimer le coût global de fonctionnement de ce site dans 100, 1000, 10.000 ans ou jusq'au millions d'années? Cela a -t il un sens? Autant lire dans le marc de café.
Réponse du 23/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Contrairement à l’entreposage pérennisé qui impliquerait que la société soit en mesure de remplacer indéfiniment les installations où les déchets sont entreposés – et donc soit en mesure de financer des coûts d’investissement, de fonctionnement et de démantèlement dans 100, 1000, 10 000 ou jusqu’au million d’années, le but du stockage est de mettre en sécurité de manière définitive les déchets radioactifs et de limiter les charges qui seront supportées par les générations futures.
Lorsque le stockage sera fermé, les coûts résiduels seront très limités. La seule charge laissée aux générations futures sera d’assurer la mémoire du site aussi longtemps que possible. Les générations futures pourront également continuer à assurer une surveillance du site. Néanmoins, le stockage restera sûr même si le site venait à être oublié.
L’évaluation du coût du stockage doit prendre en compte l’ensemble des coûts sur plus de 100 ans : les études, la construction des premiers ouvrages (bâtiments de surface, puits, descenderies), l’exploitation (personnel, maintenance, énergie…), la construction progressive des ouvrages souterrains, leur fermeture… Un travail important est réalisé par l’Andra sur les outils et méthodes de chiffrage pour apporter le maximum de robustesse à l’évaluation de ces différents coûts. Néanmoins cette évaluation fait nécessairement l’objet d’incertitudes compte tenu de la durée du projet. La mise à jour régulière de l’évaluation du coût de Cigéo permet de prendre en compte l’avancement des études et le retour d’expérience qui sera progressivement acquis.
QUESTION 109 - quels sont les différentes étapes de l'implantation ?
Posée par Laurence LABAT (MANDRES EN BARROIS), le 23/05/2013
Nous sommes agriculteurs sur un des 2 sites et je désire comprendre comment vont se faire les travaux. Doit on craindre pour notre ressource?
Réponse du 23/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
En tant qu’exploitant de Cigéo, si celui-ci est autorisé, l’Andra devra être propriétaire des terrains où seraient implantées les installations de surface du Centre et où seraient aménagées les voies d’accès nécessaires. L’Andra est consciente que cette obligation pourrait engendrer la disparition ou la déstructuration d’exploitations agricoles. Afin d’éviter toute expropriation, l’Andra a engagé des acquisitions foncières en Meuse et en Haute-Marne (exploitations, terres agricoles et terrains boisés) lui permettant de constituer une réserve pour procéder à des échanges (par des actes notariés ou par des actes administratifs amiables) ou pour restructurer les exploitations concernées si besoin. Cette démarche a déjà été conduite pour la construction du Centre industriel de regroupement, d’entreposage et de stockage (Cires) ouvert dans l'Aube en août 2003. Ce système avait correctement fonctionné et permis d'obtenir les terrains nécessaires par de simples actes de ventes ou d'échanges.
Afin de ne pas remettre en cause la viabilité des exploitations et proposer des modalités appropriées, l’Andra sera d’autant plus vigilante concernant les élevages dont les contraintes sont les plus fortes (notamment en ce qui concerne l’alimentation ou l’abreuvement des animaux).
QUESTION 108 - responsabilité des dommages aux personnes et biens
Posée par Michel GOUJOT (LUCEY), le 23/05/2013
Si une personne recevait accidentellement une forte dose de radioactivité provenant de déchets nucléaires voyageants vers Bure ou stockés à Bure, en surface ou sous terre, qui devrait la prendre en charge, pour les soins médicaux, la perte de revenus, le pretium doloris, le raccourcissement de sa vie? Et qui indemniserait pour la contamination durable d'un champ, d'un bovin, d'un jardin, d'une maison?
Réponse du 29/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Concernant Cigéo, sa conception repose sur de nombreuses dispositions qui seront mises en œuvre afin d’éviter toute dispersion incontrôlée de radioactivité et garantir ainsi que l’impact des activités sur la population riveraine soit toujours très faible et ne présente pas de risque pour la santé : ainsi, conformément au principe de défense en profondeur, tous les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation sont identifiés en amont de la conception. Pour la période d’exploitation, tous les risques potentiels sont examinés (séisme, chute de colis, incendie…), et l’Andra prend des mesures pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…), et prévoit par précaution des dispositions pour limiter les conséquences d’un accident (extinction d’un incendie, filtration des rejets…). Les études montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire et à l’impact de la radioactivité naturelle.
En application du régime de responsabilité civile nucléaire qui s’appliquera à l’exploitation de Cigéo, en cas d’accident nucléaire survenant sur le site de l’Andra, la responsabilité de cette dernière sera mise en cause sans que les victimes n’aient à prouver une faute de l’Andra. Ce régime a notamment pour intérêt de simplifier les recours des victimes qui ne sont pas obligées de multiplier les procédures à l’encontre des autres acteurs intervenant sur le site.
Réponse apportée par EDF :
A l'instar de tous les transports de substances radioactives réalisés aujourd’hui en France, les transports de déchets jusqu’à Cigéo relèveront de la responsabilité des producteurs et seront soumis à la réglementation applicable, découlant en grande partie de conventions internationales. Les emballages dans lesquels seront transportés les déchets les plus radioactifs sont conçus pour être étanches et le rester même en cas d’accident (collision, incendie, immersion). La fiabilité de ces transports repose sur le respect des règles prévues par le règlement pour le transport des marchandises dangereuses. La conception des emballages de transport et la formation des personnels font partie de ces règles, dont le respect est soumis au contrôle de l'Autorité de sûreté nucléaire. Le contrôle de la protection des transports contre les actions de malveillance est, lui, du ressort du Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité auprès du ministre de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie.
En matière de responsabilité civile, sauf disposition contractuelle différente, c'est l'expéditeur des déchets qui est responsable en cas d'incident ou d'accident et qui, à ce titre, doit indemniser les éventuels dommages.
QUESTION 107 - enfouissement
Posée par Jean-Pierre CHAPUIS (NANCY), le 23/05/2013
Compte tenu de l'opacité et du caractère non-démocratique observé par les pouvoirs publics, EDF etc.... depuis plus de 40 ans en matière d'énergie nucléaire (et encore tout récemment avec l'interdiction d'aborder ce sujet crucial pendant le grenelle de l'environnement ou avec la non-divulgation dénoncée par la CRIRAD des mesures de radioactivité effectuées par divers réseaux de surveillances (Etats-Unis, Canada, réseau du CTBTO) dix jours après l'accident de la centrale de Fukushima,
1. Pensez-vous raisonnablement que le débat public organisé aujourd'hui puisse remettre en cause l'enfouissement de déchets radioactifs dans la région de Bure ou bien
Etant dans l’incapacité d’être présent ce soir, je vous remercie de bien vouloir me répondre avec toute la sincérité nécessaire.
Réponse du 11/06/2013,
Le débat public est pour tous ceux qui s'interessent au projet, notamment pour s'y opposer, une opportunité de se documenter (voir notre site de la CPDP www.debatpublic-cigeo.org) et de s'exprimer, comme vous le faites en posant votre question.
A l'issue du débat, la Commission fera un compte rendu exact et sincère de ce qui se sera dit et écrit; elle décrira les arguments des uns et des autres pour ou contre le projet.
Vous avez le droit de ne pas me croire, mais je vous invite a examiner les compte rendus des débats publics des dernières années sur le site de la CNDP www.debatpublic.fr
QUESTION 106
Posée par Jean-Pierre CHAPUIS (NANCY), le 23/05/2013
Compte tenu de l'opacité et du caractère non-démocratique observé par les pouvoirs publics, EDF etc.... depuis plus de 40 ans en matière d'énergie nucléaire (et encore tout récemment avec l'interdiction d'aborder ce sujet crucial pendant le grenelle de l'environnement ou avec la non-divulgation dénoncée par la CRIRAD des mesures de radioactivité effectuées par divers réseaux de surveillance (Etats-Unis, Canada, réseau du CTBTO) dix jours après l'accident de la centrale de Fukushima,
2. Admettez-vous qu'il s'agit d'une nouvelle mascarade destinée à endiguer la contestation du choix extrêmement dangereux de l’enfouissement, (tout comme le fait d’arroser financièrement les départements concernés afin d’acheter les consciences – à commencer par celles des élus locaux ) ?
Etant dans l’incapacité d’être présent ce soir, je vous remercie de bien vouloir me répondre avec toute la sincérité nécessaire.
Réponse du 09/09/2013,
Réponse apportée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
La France s’est dotée d’un cadre législatif favorisant la transparence dans le domaine du nucléaire et de plusieurs structures de concertation, d ‘information et de débat. Ainsi, des Commissions Locales d’information (CLI) ont été créées auprès des installations nucléaires. Elles sont chargées d’une mission générale de suivi, d’information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d’impact des installations nucléaires sur les personnes et l’environnement. Ces CLI sont regroupées en une Association Nationale des Comités et Commissions Locales d’Information (ANCCLI). Le Haut Comité pour la Transparence et l’Information sur la Sécurité Nucléaire (HCTISN) a été créé par la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (dite "loi TSN"). C’est une instance d’information, de concertation et de débat sur les risques liés aux activités nucléaires et l’impact de ces activités sur la santé des personnes, sur l’environnement et sur la sécurité nucléaire. De plus, la loi du 13 juin 2006 instaure un droit d’accès à l’information en matière nucléaire directement auprès des exploitants, qui permet à tout un chacun de s’informer.
En outre, le Président de la République a souhaité la mise en place d'un grand débat national sur la transition énergétique, qui se déroule en ce moment. Tous les citoyens sont invités à y participer. La question du nucléaire y est abordée, notamment pour éclairer les modalités d'atteinte de l'objectif fixé par le Président de 50% de la part du nucléaire dans la production d’électricité en 2025.
Concernant le projet Cigéo, le débat public est une étape essentielle permettant de recueillir les avis, propositions et contributions de l’ensemble des citoyens sur le projet. Dès aujourd’hui, à travers les outils d’expressions mis en place par la Commission Particulière du Débat Public (site internet, cahiers d’acteurs, réunions), vous avez l’opportunité d’exprimer votre avis.
Enfin, des taxes prélevées sur les exploitants sont reversées à la Meuse et Haute-Marne afin d’accompagner le développement du territoire dans le cadre du laboratoire souterrain et dans le futur du projet Cigéo. Ainsi, les sommes issues des taxes d’accompagnement et de diffusion technologique sont gérées par deux groupements d’intérêt public (GIP) en Meuse et en Haute Marne, afin de réaliser les actions suivantes décrites à l’article L. 542-11 du Code de l’environnement :
1° « gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation du laboratoire ou du centre de stockage » ;
2° « mener, dans les limites de son département, des actions d'aménagement du territoire et de développement économique, particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils généraux concernés » ;
3° « soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques, notamment dans les domaines étudiés au sein du laboratoire souterrain et dans ceux des nouvelles technologies de l'énergie. »
Il s’agit donc de sommes destinées au développement du territoire autour du projet, afin de faciliter son insertion dans le territoire Meusien et Haut-Marnais.
Dans le cadre du contrôle de légalité, l’Etat contrôle que l'affectation des ressources fiscales et des dépenses des collectivités respectent la réglementation. De plus, l'Etat, est administrateur ou commissaire du gouvernement des GIP et vérifie dans ce cadre l’utilisation des ressources qui leur sont dévolues.
QUESTION 105 - Cout sous estimé du nucléaire et de CIGEO ?
Posée par Jc BENOIT (RENNES), le 23/05/2013
N'y a t-il pas une récurrence à sous estimer systèmatiquement les coûts du nucléaire : l'EPR initialement à 3.3 milliards maintenant à 8 milliards, coût du démantelement des centrales et insuffisance de provisionnement associé, le coût annoncé de CIGEO d'environ 14 milliards ,mais d'ici 5-10 ans sera-t-il plutot à 30 milliards par exemple si les normes de sécurité, de rejets étaient durcies + coût des technologies de stockage ? Affaire à suivre....
Réponse du 15/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Concernant le projet Cigéo, un travail important est réalisé par l’Andra sur les outils et méthodes de chiffrage pour apporter le maximum de robustesse à l’évaluation du coût du stockage. Cette évaluation est en cours de mise à jour. Après avoir recueilli l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et les observations des producteurs de déchets, l’État arrêtera une nouvelle évaluation.
Compte tenu de la durée du projet (plus de 100 ans sont nécessaires pour stocker les déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue produits par les réacteurs nucléaires français pendant toute leur durée d’exploitation), l’évaluation du coût de Cigéo fait nécessairement l’objet d’incertitudes. Comme vous l’indiquez, des évolutions réglementaires ultérieures sont possibles sur cette durée. De même, des effets d’apprentissage sont également probables. La mise à jour régulière de l’évaluation du coût de Cigéo permettra de préciser ces éléments.
QUESTION 104
Posée par Laurent LEFEBVRE (MENAUCOURT), le 23/05/2013
Pourquoi ne pas laisser les déchets sur les sites de productions? Pourquoi prendre le risque d'enfouir tant de déchets dans un seul et même endroit? Pourquoi ici?
Réponse du 15/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L'entreposage actuel des déchets sur leurs sites de production est une solution provisoire qui ne peut être pérennisée. En effet, elle nécessite l’intervention régulière de l’homme pour contrôler, maintenir et reconstruire les installations, ce qui ne peut être garanti sur le long terme. En cas de perte de contrôle de telles installations, les conséquences radiologiques sur l’homme et l’environnement ne seraient pas acceptables.
Le stockage à 500 mètres de profondeur dans une couche géologique assurant le confinement à l’échelle de plusieurs centaines de milliers d’années permet de protéger l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue et de ne pas reporter indéfiniment la charge de leur gestion sur les générations futures. Ce type de stockage doit être implanté dans un milieu géologique favorable (stabilité géologique, très faible sismicité…) et une couche de roche dont les propriétés permettent le confinement des déchets sur de très longues échelles de temps (profondeur et épaisseur suffisante, stabilité, faible perméabilité, propriétés de rétention…). C’est pour cela que le site choisi en Meuse/Haute-Marne est étudié pour l’implantation de Cigéo.
L’inventaire des déchets destinés à Cigéo est présenté au chapitre 1 du dossier du maître d’ouvrage. La sûreté du stockage de ces déchets sur le site étudié en Meuse/Haute-Marne a été démontrée par les études qui ont été menées par l’Andra ainsi que par les évaluations indépendantes qui en ont été faites. L’impact du stockage restera très largement inférieur à l’impact de la radioactivité naturelle (impact de l’ordre de 0,01 milliSievert/an, à comparer avec l’impact de la radioactivité naturelle de 2,4 mSv/an en moyenne en France).
Les risques potentiels liés à l’activité industrielle sont examinés (incendie, chute de colis, désordres mécaniques induits par un séisme…). L’Andra prend systématiquement des mesures pour supprimer les risques ou réduire leur probabilité, détecter tout dysfonctionnement et maîtriser leur impact dans l’hypothèse où des situations accidentelles interviendraient malgré les précautions prises. Après la fermeture du stockage, la sûreté sera assurée de manière passive grâce au milieu géologique. L’évolution à long terme du stockage et de l’environnement sont analysés de manière détaillée. Des situations altérées (forage intrusif, défaut de construction d’un ouvrage du stockage, séisme...) sont prises en compte dans l’évaluation de sûreté.
QUESTION 103
Posée par Alban HENRY (BRAS SUR MEUSE), le 23/05/2013
Il n'y a pas de réunion d'information dans le Nord Meusien
Réponse du 11/06/2013,
La Commission le reconnait : elle a voulu informer et consulter en priorité les habitants de la Meuse et de la Haute Marne les plus directement interessés, d'où la carte des réunions. La transmission intégrale des réunions sur le site internet du débat www.debatpublic-cigeo.org peut pallier partiellement cet inconvénient.
QUESTION 102 - Sur le Débat
Posée par Jc BENOIT (RENNES), le 23/05/2013
Bonjour, 3 questions à la CPDP :
1 - Ce débat est la seule partie démocratique sur le sujet du nucléaire en France et les conclusions qui en sortiront n'imposent aucunes obligations aux instances de décisions (qui d'ailleurs se fichent bien de ce débat), au final peut-on parler de démocratie ?
2- Les questions ne sont pas anonymes, peut-on savoir en retour qui y répond dans l'Andra ou avoir un nom de responsable hierarchique validant les réponses ?
3- Certains scientifiques non favorables à ce projet ne souhaitent pas s'exprimer afin d'eviter des problèmes dans leur carrière- qu'en pense la CDPD ?
Réponse du 04/06/2013,
1- ce débat public est organisé conformément aux dispositions de la loi de 2002 sur la démocratie participative. Il donnera lieu a un compte rendu détaillé immédiatement publié, et donc soumis au contrôle des participants. Il constituera un élément très important dans la décision d'autorisation, ou non, du projet, qui doit intervenir en 2018 de la part de l'Etat. Parmi ceux qui préparent ce débat, personne n'a le sentiment qu'il serait "pour la forme".
2- les réponses de l'ANDRA, comme de toute entreprise ou organisation, sont émises sous la responsabilité de sa direction générale.
3- la CPDP regrette que de telles craintes puissent survenir, à tort ou à raison.
QUESTION 102 - Sur le Débat
Posée par Jc BENOIT (RENNES), le 23/05/2013
Bonjour, 3 questions à la CPDP :
1 - Ce débat est la seule partie démocratique sur le sujet du nucléaire en France et les conclusions qui en sortiront n'imposent aucunes obligations aux instances de décisions (qui d'ailleurs se fichent bien de ce débat), au final peut-on parler de démocratie ?
2- Les questions ne sont pas anonymes, peut-on savoir en retour qui y répond dans l'Andra ou avoir un nom de responsable hierarchique validant les réponses ?
3- Certains scientifiques non favorables à ce projet ne souhaitent pas s'exprimer afin d'eviter des problèmes dans leur carrière- qu'en pense la CDPD ?
Réponse du 04/06/2013,
1- ce débat public est organisé conformément aux dispositions de la loi de 2002 sur la démocratie participative. Il donnera lieu a un compte rendu détaillé immédiatement publié, et donc soupmis au contrôle des participants. Il constituera un élément très important dans la décision d'autorisation, ou non, du projet, qui doit intervenir en 2018 de la part de l'Etat. Parmi ceux qui préparent ce débat, personne n'a le sentiment qu'il serait "pour la forme"
QUESTION 101
Posée par Martial CALIBLOT (PRESSIGNY), le 23/05/2013
Pourquoi ne pas privilégier l'enfouissement vertical profond?
Réponse du 31/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le concept de stockage en forages profonds a été étudié au niveau international. Ce concept consiste à placer les colis de déchets radioactifs au sein de différents forages, à grande profondeur c’est à dire jusqu’à plusieurs milliers de mètres de profondeur.
Le principe de gestion en forage profond a été délaissé par la plupart des pays à la fois à cause de la difficulté à démontrer la sûreté du concept (impossibilité d’étudier au moyen d’un laboratoire souterrain la formation rocheuse dans laquelle seraient placés les colis de déchets (profondeur trop importante), risque de chute et difficulté technique en cas de colis coincé au milieu d’un forage, comportement des colis difficile à maîtriser dans les conditions de température et de pression des grandes profondeurs) et pour des raisons économiques (nombre trop conséquent de forages profond dans le cas d’un inventaire en colis important).
Aujourd’hui ce concept est étudié plus particulièrement pour le stockage de sources scellées ou de petits volumes de déchets.
QUESTION 100 - devenir du projet si reponse négative
Posée par Alain MOUTAUX, CITOYEN (MONTIERS SUR SAULX), le 23/05/2013
On ouvre aujourd'hui un débat qui doit amener à une décision de faire ou ne pas faire, but de tout débat. Si la réponse est oui, on a bien été informé de ce qui allait se passer et on voit bien les choses se préparer, mais on ne sait rien du scénario de repli en cas de réponse négative, comme si celle-ci n'était pas envisagée.
Réponse du 23/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les déchets les plus radioactifs produits par les générations passées et actuelles sont aujourd’hui entreposés, de manière sûre mais provisoire, sur leurs sites de production à La Hague (Manche), Marcoule (Gard), Cadarache (Bouches-du-Rhône) et, pour un volume limité, à Valduc (Côte-d’Or). Plus de 40 000 mètres cubes de déchets de haute activité (HA) et de moyenne activité à vie longue (MA-VL) y sont actuellement entreposés.
Si le stockage profond n’est pas autorisé, de nouvelles capacités d’entreposage seront nécessaires pour accueillir les déchets HA et MA-VL futurs et remplacer les entrepôts existants lorsque leur durée de vie sera atteinte. Ce mode de gestion laisse de la latitude pour décider ou non de réaliser le projet Cigéo. En revanche, il ne constitue pas une solution de gestion définitive et conduit à reporter la charge de la gestion de ces déchets radioactifs sur les générations suivantes.
Si le stockage profond est autorisé, les colis de déchets pourront être transférés progressivement de leurs entrepôts vers le stockage. La réversibilité donnera aux générations suivantes la possibilité de réexaminer périodiquement la stratégie de gestion retenue et de la faire évoluer si elles le souhaitent. La mise en œuvre de cette solution limite les charges reportées sur les générations futures et ouvre la voie à une mise en sécurité définitive des déchets.
QUESTION 99 - Réunions publiques sur internet?
Posée par Markku LEHTONEN (PARIS), le 22/05/2013
Bonjour,
Sera-t-il possible de suivre les réunions publiques (concernant le projet Cigéo) sur internet, en direct ou en différé, comme j'ai cru comprendre en écoutant les interventions de M. Bernet? Si oui, je suppose que le lien sera clairement indiqué sur le site de la CNDP.
Bien cordialement
Réponse du 11/06/2013,
La Commission a effectivement décidé de retransmettre en direct les débats, avec interactivité (possibilité de poser des questions et de recevoir des réponses).
QUESTION 98
Posée par Patrick VARNEY, le 22/05/2013
Bonjour,
Comment se fait-il que pour les réunions concernant CIGEO dans le cadre du débat public, aucune thématique ne soit proposée dans les communes des départements concernés : Bure le 23 Mai, Joinville le 6 Juin, Ligny en Barrois le 4 Juillet, Chaumont le 11 Juillet.
Il est d'autre part regrettable que les thèmes les plus importants se discutent loin des populations directement concernées.
Merci pour les réponses que vous apporterez à mes questions.
Réponse du 11/06/2013,
Toutes les réunions se déroulant à proximité du site envisagé sont consacrées en priorité aux questions des citoyens habitant cette région. Aussi a-t-il été jugé nécessaire par la Commission du débat public de ne traiter aucun thème spécifique, qui viendrait en concurrence avec les questions du public.
Au contraire,lorsque le débat s'éloigne (Cherbourg, Marcoule), il y a par définition moins de questions du public, et l'on peut traiter des thématiques, comme l'inventaire des déchets, la réversibilité ou les solutions de gestion des déchets.
QUESTION 97
Posée par Ivan DALUZEAU, CITOYEN RESPONSABLE, le 22/05/2013
En bonne intelligence, avec les problèmes de stockages avérés aux états-unis notamment (fuites des barils de déchets), pensez-vous détenir une technologie indiscutable pour éviter tous désagréments d'ici à 100 millions d'années ? Les générations futures(vos propres enfants) se dépatouilleront de vos inepties d'enfants gâtés qui ne savent que casser des jouets !!!! Dormez bien sur vos deux oreilles et la tête dans le sable, et surtout embrassez vos enfants en sachant que le seul avenir que vous leur laissez est une mort lente.... En votre âme et conscience...
Réponse du 29/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maitre d’ouvrage :
Les hommes et les femmes de l’Andra ont justement la conviction d’agir de manière responsable en développant des solutions sûres et en laissant à la génération de nos enfants la possibilité, si ils le souhaitent, de mettre définitivement en sécurité ces déchets très radioactifs et ne pas reporter indéfiniment le poids de leur gestion sur les générations d’après.
Si c’est l’exemple du site de Hanford auquel vous faites allusion, il s’agit justement d’un exemple d’entreposage provisoire de déchets de haute activité réalisé avec des solutions techniques non durables. Ceci montre bien que la seule attitude responsable pour la gestion des déchets radioactifs est de prendre le problème à bras le corps et de mettre en place des solutions de gestion sûres et durables.
QUESTION 96 - retranscription des débats sur internet
Posée par Agnès WEILL (LORRAINE), le 22/05/2013
La CPDP pourra t-elle retranscrire rapidement l'intégralité des 14 réunions sur le site du débat public, comme l'avait fait en 2005-2006 la CPDP "gestion des déchets radioactifs" ? Ce serait très utile pour les personnes qui ne peuvent se déplacer in situ.
Merci d'avance pour votre réponse
Réponse du 11/06/2013,
Cette retranscription intégrale des comptes rendus mot a mot (verbatim) des débats est prévue, comme dans tous les débats publics. Les verbatims seront publiés environ une semaine après les réunions.
La Commission a également décidé de retransmettre en direct les débats sur son site internet, avec interactivité (possibilité de poser des questions et de recevoir des réponses).
QUESTION 95
Posée par Françoise DELBE (JOINVILLE CEDEX), le 22/05/2013
Pourquoi ce stockage en Haute-Marne et Meuse? N'y a-t-il pas d'autres moyens pour détruire ces déchets, plutôt que le stockage près des habitations qui contamine nos sols.
Réponse du 15/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Suite au vote de la loi de 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, des recherches ont été menées en France pour implanter un laboratoire souterrain. Plusieurs sites se sont portés candidats et ont été étudiés, dont les départements de Meuse et de Haute-Marne. En 1999, après l’évaluation scientifique du site, la consultation des collectivités locales et une enquête publique, le Gouvernement a autorisé l’Andra à construire un laboratoire souterrain à la limite entre les deux départements de Meuse et de Haute-Marne pour étudier la couche d’argile du Callovo-Oxfordien. En s’appuyant sur l’ensemble des recherches menées sur le site depuis 1994, l’Andra a montré qu’il présente des caractéristiques favorables pour assurer la sûreté à long terme du stockage. La Commission nationale d’évaluation mise en place par le Parlement pour évaluer sur le plan scientifique les travaux de l’Andra souligne ainsi dans son rapport 2012 : « le site géologique de Meuse/Haute-Marne a été retenu pour des études poussées, parce qu’une couche d’argile de plus de 130 m d’épaisseur et à 500 m de profondeur, a révélé d’excellentes qualités de confinement : stabilité depuis 100 millions d’années au moins, circulation de l’eau très lente, capacité de rétention élevée des éléments ».
Le choix du stockage profond a été fait par le Parlement après 15 ans d’études menées sur différentes solutions de gestion pour ces déchets. Des recherches sont menées en France et à l’étranger concernant les techniques dites de séparation et de transmutation des déchets radioactifs. Le principe consiste dans une première étape à séparer les uns des autres les différents radionucléides contenus dans ces déchets. Une seconde étape vise ensuite à transformer par une série de réactions nucléaires, les radionucléides à vie longue en radionucléides à vie plus courte. Les résultats des recherches menées notamment par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) montrent que la séparation/transmutation ne supprime pas la nécessité d’un stockage profond car elle ne serait applicable qu’à certains radionucléides contenus dans les déchets (ceux de la famille de l’uranium). Par ailleurs, les installations nucléaires nécessaires à la mise en œuvre d’une telle technique produiraient des déchets qui nécessiteraient aussi d’être stockés en profondeur pour des raisons de sûreté. Il n’est donc pas possible de « détruire » ou de faire disparaître ces déchets radioactifs.
Le stockage profond n’est pas un choix par défaut, il n’est pas question de contaminer les sols. Il est conçu pour être sûr et isoler les déchets radioactifs. Les études ont montré qu’une fois fermé, le stockage n’aura pas d’impact avant 100 000 ans et que cet impact sera largement inférieur à l’impact de la radioactivité naturelle (qui est de 2,4 mSv/an en moyenne en France).
QUESTION 94
Posée par François LANCERON (PÉLISSANNE), le 05/06/2013
Pourquoi un stockage profond plutôt qu'une autre solution et pourquoi le site de Meuse / Haute-Marne?
Est-ce que le site de Meuse / Haute-Marne est fiable géologiquement et hydrogéologiquement?
Réponse du 31/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le choix du stockage profond repose notamment sur les résultats de quinze années de recherche, suite à la loi du 30 décembre 1991 qui avait défini un programme de recherches destiné à étudier différentes solutions de gestion à long terme pour les déchets les plus radioactifs. Est-il possible de réduire leur quantité et leur dangerosité (la séparation/transmutation) ? Est-il possible de les entreposer dans des bâtiments résistants sur plusieurs centaines d’années (l’entreposage de longue durée) ? Est-il possible de les isoler définitivement de l’homme et de l’environnement en les stockant en profondeur (le stockage profond) ? Les résultats de ces recherches et leur évaluation, notamment par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et la Commission nationale d’évaluation (CNE), ont conclu que le stockage profond était la seule solution qui permette une mise en sécurité définitive des déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations futures.
Le choix du site de Meuse/Haute-Marne est le résultat de nombreuses années de recherches scientifiques et de reconnaissances géologiques qui ont permis de démontrer qu’il présentait des caractéristiques favorables à l’implantation d’un tel stockage. Suite au vote de la loi de 1991, des recherches ont été menées en France pour implanter un laboratoire souterrain. Plusieurs sites se sont portés candidats et ont été étudiés, dont les départements de Meuse et de Haute-Marne. En 1999, après l’évaluation scientifique du site, la consultation des collectivités locales et une enquête publique, le Gouvernement a autorisé l’Andra à construire un laboratoire souterrain à la limite entre les deux départements de Meuse et de Haute-Marne pour étudier la couche d’argile du Callovo-Oxfordien. En s’appuyant sur l’ensemble des recherches menées sur le site depuis 1994, l’Andra a montré qu’il présente des caractéristiques favorables pour assurer la sûreté à long terme du stockage. La Commission nationale d’évaluation mise en place par le Parlement pour évaluer sur le plan scientifique les travaux de l’Andra souligne ainsi dans son rapport 2012 : « le site géologique de Meuse/Haute-Marne a été retenu pour des études poussées, parce qu’une couche d’argile de plus de 130 m d’épaisseur et à 500 m de profondeur, a révélé d’excellentes qualités de confinement : stabilité depuis 100 millions d’années au moins, circulation de l’eau très lente, capacité de rétention élevée des éléments. »
QUESTION 93
Posée par Patrick BURDIN (DUN SUR MEUSE), le 22/05/2013
Est-il prévu une exploitation, un projet pour les 60% de déblais restants?
Quelle sera la nature de la roche? Quel volume restant?
Votre débat se révèle passionnant. Un citoyen qui vous remercie.
Réponse du 20/06/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les 60% de déblais d’argilite (correspondant à la partie des déblais de creusement des galeries souterraines non réutilisée pour refermer le stockage) représenteront à la fin de l’exploitation de Cigéo un volume d’environ 6 millions de mètres cubes*. Ces déblais resteront stockés en surface dans des verses, à proximité de la zone située à la verticale de l’installation souterraine. Ces verses feront l’objet d’un traitement spécifique afin d’être intégrées au paysage (utilisation de la topographie du site, couverture végétale, reboisement…) en cherchant à limiter leur extension, en hauteur et en surface. Ces déblais seront produits progressivement, tout au long de l’exploitation du stockage. L’Andra ne prévoit pas d’exploiter ces déblais, Cigéo n’étant pas une industrie extractive. Néanmoins, si des demandes spécifiques d’utilisation sont formulées par des acteurs du territoire, l’Andra les examinera.
* A titre de comparaison, le volume de déblais générés par le creusement de grands tunnels est du même ordre de grandeur (environ 7 millions de mètres cubes pour le tunnel sous la Manche par exemple).
QUESTION 92
Posée par René ROTH (ST DIZIER), le 22/05/2013
Quelles sont les principales provenances des déchets?
Réponse du 20/06/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les déchets de haute activité (HA) et de moyenne activité à vie longue (MA-VL) proviennent principalement du secteur de l’industrie électronucléaire et des activités de recherche associées, ainsi que, dans une moindre part, des activités liées à la Défense nationale.
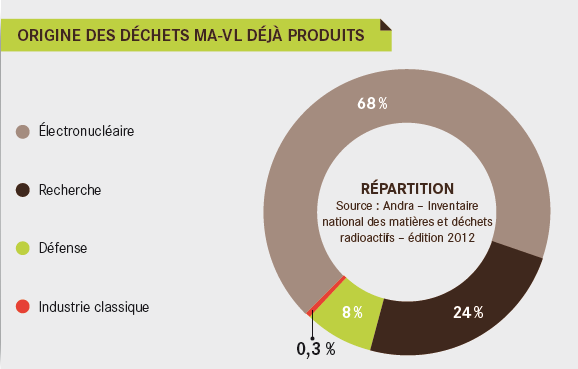 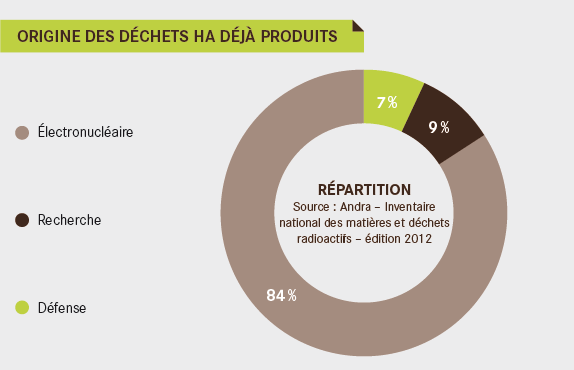
Les déchets de haute activité (HA) correspondent essentiellement aux résidus hautement radioactifs issus du traitement des combustibles usés, principalement ceux utilisés pour la production d’électricité et dans une très faible part ceux liés aux activités de la Défense nationale. Ils se présentent sous la forme de colis de déchets vitrifiés.
Les déchets MA-VL se présentent sous la forme de colis vitrifiés, bitumés ou cimentés et sont variés :
- Résidus issus du traitement des combustibles nucléaires usés (utilisés pour la production d’électricité ou pour la propulsion de sous-marins et de navires de la Marine nationale) et de la fabrication de certains combustibles (combustibles « MOX », mixtes d’uranium et de plutonium),
- Composants (hors combustible) ayant séjourné dans les réacteurs nucléaires,
- Déchets technologiques issus de la maintenance des installations nucléaires, de laboratoires, d’installations liées à la Défense nationale, du démantèlement...
Les déchets déjà produits sont entreposés à sec dans des bâtiments sur leur site de production :
- A la Hague (Manche), à l’usine AREVA NC qui traite les combustibles usés
- Dans les centre CEA de Marcoule (Gard), Cadarache (Bouches- du –Rhône) et de Valduc (Côte d’Or)
- Une installation d’entreposage est également en cours de construction sur le site de Bugey (Ain) pour certains déchets issus de l’exploitation et du démantèlement des réacteurs
QUESTION 91
Posée par Pascal FONTAINE (HARRICOURT), le 22/05/2013
Comment et sous quelle forme seront conservés l'ensemble des documents
Réponse du 11/06/2013,
Les documents mis à la disposition du public par la Commission sont tous repertoriés dans le site internet de la CPDP www.debatpublic-cigeo.org. Ils sont téléchargeables à partir de ce site.
Certains ont été distribués à 180.000 exemplaires en Meuse et Haute Marne.
Vous pouvez auss recevoir le dossier complet et ensuite tous les cahiers d'acteurs, en vous abonnant aux publications du débat (inscription sur le site ou lettre à CPDP 18 av Gambetta 55 000 Bar le duc).
QUESTION 90
Posée par Jean-Jacques RETTIG (LA BROQUE), le 10/07/2013
Le contenu du débat peut-il avoir une quelconque influence sur la réalisation ou la non-réalisation du centre d'enfouissement en couches profondes de Bure ?
Réponse du 08/10/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Aujourd’hui, la décision de créer Cigéo n’est pas prise. L’Andra a justement souhaité que le débat public intervienne en 2013, quand le projet n’est pas encore finalisé, pour pouvoir prendre en compte les retours du public dans la suite de ses études en vue d’établir le dossier de demande d’autorisation de création du centre de stockage. Le débat public permettra à l’Etat d’identifier les conditions nécessaires à l’acceptation du projet. Il contribuera notamment à la préparation de la future loi qui fixera les conditions de réversibilité du stockage et à l’insertion locale du projet.
La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra à l’État après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo. Ce processus comprendra notamment l’évaluation de la sûreté par l’Autorité de sûreté nucléaire, l’évaluation des recherches scientifiques par la Commission nationale d’évaluation, l’avis des collectivités territoriales, le vote d’une nouvelle loi fixant les conditions de réversibilité, la mise à jour de la demande de création de Cigéo par l’Andra suite à cette loi, et une enquête publique.
QUESTION 89 - envoi des déchets dans l'espace et stockage sur terre
Posée par Jc BENOIT (RENNES), le 22/05/2013
D'envoyer les dechets les plus dangereux dans l'espace intergalactique (ne polluons pas le soleil avec) serait une solution pour ne plus avoir à s'en occuper et s'en soucier. peut-on penser que cette solution n'a pas été retenue parce qu'elle ne rapporte pas financièrement et aux communes et élus(es) concernés par le site de stockage et supprime ou rend inutile des emplois à l'ANDRA : sur la réalisation de site de stockage, emplois et matériels qui vont avec ,etc. l'intéret financier du stockage est-il au final privilégié à l'interet géneral?
Réponse franche souhaitée.
Réponse du 23/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La gestion des déchets radioactifs est un sujet d’intérêt général. L'Andra est une agence publique indépendante, créée par le Parlement, dont la mission première est de trouver des solutions sûres qui reposent sur de nombreuses études scientifiques indépendantes, menées par différents organismes de recherche, en France et à l’étranger. Le choix du stockage géologique comme solution de référence pour la gestion à long terme des déchets radioactifs repose sur la volonté de ne pas faire porter la charge de cette gestion sur les générations futures et sur le fait que c’est la seule solution qui permet, aujourd’hui, sur le long terme, de protéger l’Homme et l’environnement de cette radioactivité. La sûreté et l’intérêt général sont au cœur du projet Cigéo et non les bénéfices que l’Andra et les territoires pourraient en tirer en termes financiers et d’emplois.
Concernant le scénario d’un envoi dans l’espace, sur la lune ou dans le soleil des déchets radioactifs les plus dangereux, celui-ci a été étudié. La NASA notamment s’est penchée sur cette question dès la fin des années 70. Ce scénario n’a pas été retenu en raison du risque d’explosion de l’engin spatial au décollage ou en vol (1 accident sur 100 lancements en moyenne), qui provoquerait des retombées de poussières radioactives et contaminerait l’atmosphère. Qui plus est, les volumes de déchets concernés (80 000 m3 pour les déchets HA et MAVL destinés à Cigéo) nécessiteraient plusieurs dizaines de milliers de lancements, ce qui représenterait un coût « astronomique » pour la société (un seul lancement d’Ariane 5 coûte environ 150 millions d’euros).
QUESTION 88 - Information ultérieure de la présence de déchets
Posée par Ludovic COURTOIS (ST-QUENTIN), le 21/05/2013
La durée de vie de certains déchets radioactifs atteints plusieurs millions d'années. Il m'est aujourd'hui difficile d'imaginer un moyen de communication avec une quelconque forme de vie intelligente qui peuplera peut-être notre planète d'ici quelques milliers ou millions d'années. Ainsi, comment comptez-vous signaler de manière fiable, efficace et compréhensible la présence de déchets dans le sous sol de tels sites de stockage aux populations futures?
Réponse du 15/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif fondamental de Cigéo est de protéger l’homme et l’environnement des déchets radioactifs sur de très longues échelles de temps. La sûreté à long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. C’est une des raisons qui a conduit, en 2006, le Parlement à retenir la solution du stockage profond. En effet, cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli, contrairement à l’entreposage. En cas de perte complète de la mémoire du stockage, une intrusion inopinée à 500 mètres sous terre apparaît peu plausible, du moins sans un minimum d’investigations préalables. L’Andra évalue cependant par précaution dans son analyse de sûreté les conséquences d’un forage à travers le stockage pour vérifier que le stockage resterait sûr.
Malgré cette robustesse du stockage même en cas d’oubli, l’Andra conçoit Cigéo avec l’objectif d’en conserver la mémoire et de la transmettre aux générations futures le plus longtemps possible. Des solutions d’archivage de long terme existent pour les centres de stockage de surface exploités par l’Andra et font l’objet de revues périodiques. Le retour d’expérience montre que ces solutions paraissent robustes pour au moins les 500 premières années. Ainsi, pour Cigéo, l’Andra prévoit qu’un centre de la mémoire perdurera sur le site. Il pourra accueillir le public et comprendra notamment les archives du Centre.
De manière générale, le maintien de la mémoire doit aussi impliquer les acteurs locaux, qui peuvent prendre le relai en cas de défaillance de l’Andra ou de l’État. L’Andra veille d’ores et déjà à les informer sur les enjeux associés à la mémoire et étudie avec des anthropologues, des philosophes ou encore des artistes les facteurs qui peuvent favoriser la transmission de la mémoire. La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.
L’Andra a lancé en 2010 un programme d’études pour proposer des outils qui rendent cette transmission plus robuste sur une échelle de temps millénaire. Des pistes se dessinent tels des marqueurs de surface, mais aussi des rendez-vous réguliers à mettre en place au niveau des populations locales.
En tout état de cause, comme il est impossible de garantir notre capacité à communiquer avec des êtres vivant dans plusieurs milliers d’années, c’est chaque génération qui aura la responsabilité de contribuer à transmettre cette mémoire aux générations suivantes.
QUESTION 87 - sous sol gorgé d'eau
Posée par Philippe PORTÉ (CHÂLONS EN CHAMPAGNE), le 21/05/2013
En meuse et en haute marne,il y a beaucoup de cours d'eau qui prennent leur source. pourquoi vouloir y mettre des déchets atomiques qui ne doivent pas être en contact avec l'eau? Le sous sol est gorgé d'eau avec un potentiel géothermique que l'ANDRA nie, pourquoi? Il faut arrêter ce projet pendant qu'il est encore tps.
Réponse du 29/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Concernant la présence de cours d’eau : plusieurs cours d’eau sont effectivement présents sur le site étudié pour l’implantation de Cigéo. La présence de cette eau en surface n’est pas incompatible avec l’implantation du Centre de stockage.
Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement afin de contrôler l’impact de ses activités. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, il permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement et l’absence de contamination des nappes phréatiques. L’Andra a déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
Le stockage sera implanté dans une couche d’argile située à environ 500 mètres de profondeur et de 130 mètres d’épaisseur qui garantit l’éloignement des déchets radioactifs de la surface. Seuls quelques radionucléides mobiles et dont la durée de vie est longue pourront migrer jusqu’aux limites de la couche d’argile qu’ils atteindront après plusieurs dizaines de milliers d’années, puis potentiellement atteindre en quantités extrêmement faibles ensuite la surface et les cours d’eau présents, après plus de 100 000 ans. Leur impact radiologique serait alors plusieurs dizaines de fois inférieur à la radioactivité naturelle (qui est de 2,4 mSv par an en moyenne en France).
Concernant le potentiel géothermique : l’Andra n’a jamais nié le potentiel géothermique du site étudié pour l’implantation de Cigéo ! Comme partout ailleurs en France, la géothermie dite de surface (qui permet d’alimenter des maisons individuelles et des immeubles collectifs ou tertiaires via des pompes à chaleur) est réalisable localement. L’exploitation de ces ressources en surface ne serait d’ailleurs pas incompatible avec Cigéo, même au droit des installations souterraines de Cigéo, qui seraient situées à 500 mètres de profondeur.
Les études et les conclusions de l’Andra portent sur le potentiel géothermique profond du site mesuré grâce à un forage à 2000 mètres de profondeur dans les grès du Trias (Forage EST 433, Montiers-sur-Saulx) réalisé lors d’une campagne de reconnaissance menée en 2007-2008. Les caractéristiques habituellement recherchées pour déterminer s’il existe un potentiel géothermique (salinité, température et productivité) ont été mesurées. Il en ressort que le sous-sol dans la zone étudiée pour l’implantation de Cigéo ne présente pas un caractère exceptionnel en tant que ressource potentielle pour une exploitation géothermique profonde. Dans son rapport n°4 de juin 2010, la CNE aboutit aux mêmes conclusions : « Le trias de la région de Bure ne représente pas une ressource géothermique potentielle attractive dans les conditions technologiques et économiques actuelles. »
QUESTION 86
Posée par Severine CORNUEL (LANGRES), le 17/05/2013
Pourquoi la Haute Marne? Département déjà peu attractif, un centre de stockage va aggraver la situation et la réputation?! A quand la fin du nucléaire?
Réponse du 15/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Suite au vote de la loi de 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, des recherches ont été menées en France pour implanter un laboratoire souterrain. Plusieurs sites se sont portés candidats et ont été étudiés, dont les départements de Meuse et de Haute-Marne. En 1999, après l’évaluation scientifique du site, la consultation des collectivités locales et une enquête publique, le Gouvernement a autorisé l’Andra à construire un laboratoire souterrain à la limite entre les deux départements de Meuse et de Haute-Marne pour étudier la couche d’argile du Callovo-Oxfordien. En s’appuyant sur l’ensemble des recherches menées sur le site depuis 1994, l’Andra a montré que le site présente des caractéristiques favorables pour assurer la sûreté à long terme du stockage. La Commission nationale d’évaluation mise en place par le Parlement pour évaluer sur le plan scientifique les travaux de l’Andra souligne ainsi dans son rapport 2012 : « le site géologique de Meuse/Haute-Marne a été retenu pour des études poussées, parce qu’une couche d’argile de plus de 130 m d’épaisseur et à 500 m de profondeur, a révélé d’excellentes qualités de confinement : stabilité depuis 100 millions d’années au moins, circulation de l’eau très lente, capacité de rétention élevée des éléments ».
Cigéo est un projet industriel structurant qui contribuera au développement du territoire. S’il est autorisé, entre 1 300 et 2 300 personnes travailleront à la construction des premières installations de Cigéo. Après la mise en service du Centre, entre 600 et 1 000 emplois pérennes seront nécessaires pour la phase d’exploitation. Outre l’activité industrielle créée pendant plus de 100 ans, Cigéo nécessitera la réalisation d’infrastructures, de logements, de formation, de services liés à l’accueil des familles (école, services médicaux…). Aujourd’hui, le projet participe déjà au développement des deux départements. Les emplois directs liés au Centre Meuse/Haute-Marne de l’Andra (Laboratoire souterrain, Espace technologique, Observatoire pérenne de l’environnement, Ecothèque) représentent 370 personnes, avec 90 % des salariés de l’Andra habitant à moins de 40 km. Les deux groupements d’intérêt public créés par le Parlement pour gérer les équipements de nature à favoriser et à faciliter l’installation et l’exploitation du Laboratoire ou de Cigéo et pour mener au niveau départemental des actions d’aménagement du territoire et de développement économique sont dotés de 30 M€ chacun par an, financés par une taxe sur les installations nucléaires. Par ailleurs, EDF, le CEA et Areva mènent une politique active en faveur du développement économique local.
Votre question « A quand la fin du nucléaire ? » renvoie aux choix relatifs à la politique énergétique de la France. Quelles que soient les conclusions du débat sur la transition énergétique en cours, il faut savoir que près de la moitié des déchets radioactifs destinés à Cigéo sont déjà produits et sont dans l’attente d’une solution de gestion définitive afin de ne pas reporter indéfiniment la charge de leur gestion sur les générations futures.
QUESTION 85
Posée par Guy HERTERT (MONTAIN), le 17/05/2013
Les raisons d'un stockage profond
Réponse du 11/06/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les déchets concernés par Cigéo ont un niveau de radioactivité élevé et peuvent rester dangereux plusieurs centaines de milliers d’années. Il faut donc mettre en place une solution de gestion qui protège durablement l’Homme et l’environnement de la dangerosité de ces déchets et qui permette de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations futures. Pour confiner la radioactivité de ces déchets, il est nécessaire de disposer d’une formation géologique de qualité et suffisamment épaisse comme c’est le cas de la couche d’argile étudiée par l’Andra dans son Laboratoire souterrain. De plus, la profondeur du stockage (500 mètres pour Cigéo) le met à l’abri des phénomènes d’érosion et des agressions humaines sur une très grande échelle de temps en cohérence avec la durée de dangerosité des déchets.
Les déchets radioactifs sont d'abord conditionnés dans des colis conçus pour confiner les substances qu'ils contiennent. Ces colis seraient ensuite placés dans des ouvrages souterrains qui formeront une seconde protection pendant l'exploitation du stockage. Au fil du temps, les colis et les ouvrages se dégraderont petit à petit au contact de l'eau contenue dans la roche. Après plusieurs centaines d’années, certains radionucléides pourront se dissoudre dans cette eau. C'est là que l'argile, roche imperméable, prendra le relais pour retenir ces radionucléides et freiner leur déplacement. Le stockage permet ainsi de garantir leur confinement sur de très longues échelles de temps. Seuls certains radionucléides, très mobiles et à vie longue, pourront migrer jusqu'aux limites de la couche d'argile, de manière très étalée dans le temps (plus d'une centaine de milliers d'années). Cet étalement atténuera fortement leur concentration. Leur impact radiologique sera inférieur à celui de la radioactivité naturelle.
Les pays utilisant l’énergie électronucléaire retiennent tous le stockage profond pour une gestion définitive et sûre à long terme de leurs déchets les plus radioactifs.
QUESTION 84
Posée par Annie ANDRIOT (ESNOMS AU VAL), le 17/05/2013
Si un surplus de radioactivité est constaté après quelque temps d'enfouissement, quelles dispositions sont à l'étude? Les populations environnantes seront-elles informées?
Réponse du 23/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Cigéo a été conçu pour confiner la radioactivité des déchets sur de très longues échelles de temps. Tout a été mis en œuvre pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du centre ou après sa fermeture.
Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement afin de contrôler l’impact de ses activités. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, il permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement et l’absence de contamination de l’environnement. L’Andra a déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. De plus, Cigéo sera en permanence soumis au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public. Enfin, pour répondre à une demande formulée par les populations locales, les modalités possibles pour une surveillance de la santé autour du stockage sont à l’étude. L’Andra a mis en place un groupe d’experts pour proposer des modalités techniques pour assurer cette surveillance et a saisi ses ministères de tutelle pour que la gouvernance et l’organisation d’un tel dispositif soient précisées.
Les mesures effectuées dans le cadre du plan de surveillance permettront de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité. En cas de dérive, l’Andra devra mettre en œuvre les mesures pour faire cesser l’origine de la pollution. Elle devra surveiller que les conséquences de la pollution constatée n’ont pas d’impact sur la santé et l’environnement, et le cas échéant prendre des mesures particulières de surveillance ou de dépollution. Les autorités compétentes (Autorité de sûreté nucléaire et préfectures) et le public seront immédiatement informés, conformément aux dispositions prévues par la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
QUESTION 83
Posée par Alain LAMBOUR (FAINS VEEL), le 17/05/2013
Qu'en est-il de la réouverture totale de la ligne SNCF/RFF Ligny-Gondrecourt et au delà? Acheminement des colis...
Réponse du 10/06/2013,
Réponse apportée par le Directeur du Schéma Interdépartemental de Développement du Territoire :
Dans le cadre du Schéma Interdépartemental de Développement du Territoire, une étude a été menée pour comparer l'ensemble des hypothèses de desserte ferroviaire du site de Cigéo.
3 scénarios ont été retenus pour leur pertinence (voir carte ci-dessous). Parmi ceux-ci, une hypothèse a été retenue avec l'utilisation de la ligne Nançois - Gondrecourt (à rénover) puis la reprise de l'emprise de l'ancienne voie entre Gondrecourt et Cigéo. Ce qui permet un accès ferroviaire direct du site.
Les options de transports ferroviaires ont été étudiées pour l'acheminement des colis ainsi que pour l'acheminement des matériaux de chantier, ce qui permettrait de réduire les transports routiers. D'autres transports ferroviaires pourraient également bénéficier de la modernisation de la ligne et la faisabilité de l'utilisation de cette voie pour les passagers a également été étudiée. Pour l'opérateur qui utiliserait cette voie, la faisabilité d'un transport de voyageurs est à mettre en regard des investissements à réaliser (plus importants que pour le transport de fret) et du nombre de passagers qui pourraient l'emprunter.
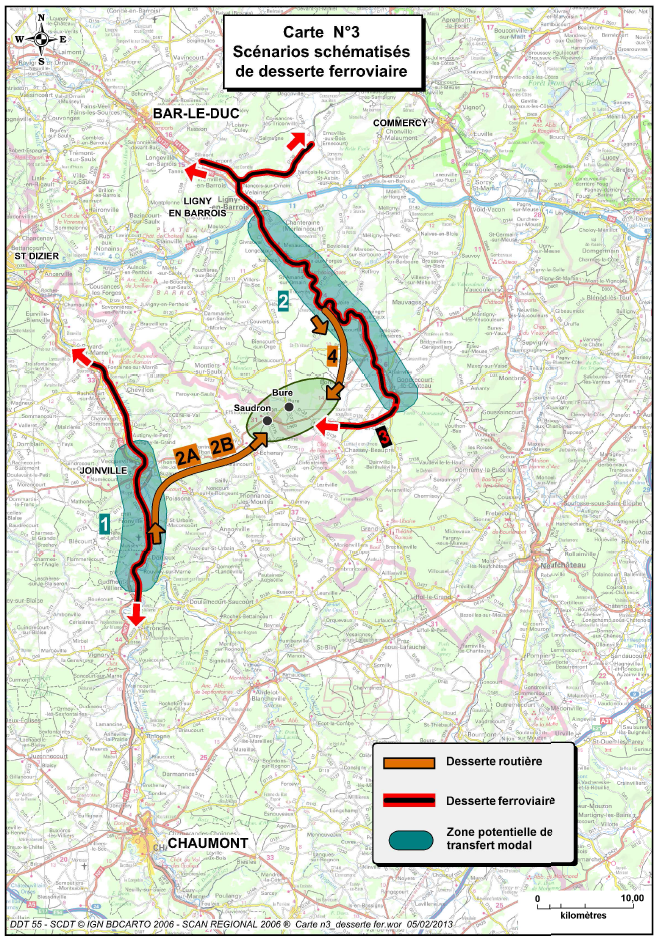
QUESTION 82
Posée par Guy HERTERT (MONTAIN), le 17/05/2013
Impact sur le territoire d'accueil
Réponse du 24/06/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Concernant l'impact de CIgéo sur l'environnement :
Pendant son exploitation, Cigéo sera à l’origine de très faibles quantités de rejets car les colis de déchets reçus sur Cigéo ne contiendront pas de liquides et peu de radionucléides gazeux. La quasi-totalité des rejets de Cigéo proviendra des émanations de gaz radioactifs (carbone 14, tritium, krypton 85…) de certains colis de déchets MA-VL. Ces gaz seront canalisés, mesurés et strictement contrôlés avant d’être dispersés et dilués dans l’air. Ces rejets et leurs limites devront faire l’objet d’une autorisation par l’Autorité de sûreté nucléaire et seront strictement contrôlés durant toute l’exploitation. Une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact des rejets serait de l’ordre de 0,01 milliSievert par an (mSv/an) à proximité du Centre, soit très largement inférieur à la norme règlementaire (1 mSv/an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv/an en moyenne en France).
Après la fermeture du stockage, son impact à long terme est évalué, aussi bien en fonctionnement normal qu’en situation dégradée, afin de s’assurer que celui-ci ne présente pas de risque sur la santé. Les études ont montré que le stockage n’aura pas d’impact avant 100 000 ans et que celui-ci sera de l’ordre de 0,01 mSv/an en évolution normale. En situation dégradée (intrusion humaine, défaut d’un composant du stockage...) les études montrent que l’impact du stockage resterait inférieur à 0,25 mSv/an. Cette évaluation s’appuie sur les travaux de recherche menés sur les phénomènes qui se produisent au sein du stockage, qu’ils soient thermiques, chimiques, mécaniques, hydrauliques, radiologiques ou biologiques.
Concernant l'impact de cigéo sur le territoire d'accueil :
Cigéo est un projet industriel structurant pour le territoire. Il sera construit et exploité sur plus de 100 ans. Entre 1 300 et 2 300 personnes travailleront à la construction des premières installations de Cigéo sur la période 2019-2025. Après la mise en service du Centre, entre 600 et 1 000 personnes travailleront à la fois à son exploitation et sa construction (qui se poursuivra en parallèle).
Il contribuera au développement de l’activité des entreprises locales et grâce à la garantie d’une activité sur plus d’un siècle, certaines entreprises feront très vraisemblablement la démarche de s’implanter localement, créant à leur tour une activité nouvelle sur le territoire.
L’implantation d’un ou plusieurs projets industriels nécessite de préparer le territoire d’accueil. La préfecture de la Meuse a été chargée par le Gouvernement de coordonner l’élaboration d’un schéma interdépartemental de développement du territoire (développement des infrastructures, habitat, formation…) sur les deux départements concernés par le projet Cigéo (la Meuse et la Haute-Marne), en lien avec les services de l’État, les collectivités et les chambres consulaires (chambre de commerce et d’industrie, chambre d’agriculture, chambre des métiers et de l’artisanat). L’Andra et les producteurs de déchets ont également contribué à la préparation de ce schéma.
La préfecture de la Meuse a publié le 21 mars 2013 un projet de schéma qui est présenté au débat public : ../docs/docs-complementaires/docs-planification/SIDT-Final.pdf
QUESTION 81
Posée par Michel GUILLAUMOT (RACHECOURT SUR MARNE), le 17/05/2013
CIGEO est-il vraiment réversible alors que les documents parlent de stockage définitif dans les sites étrangers?
Réponse du 10/06/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les projets de stockage géologique, en France ou ailleurs, sont conçus pour être fermés au terme de leur exploitation, de manière à ne pas faire porter la charge de la gestion des déchets radioactifs sur les générations futures. En France, le Parlement a toutefois demandé une période de réversibilité d’au moins cent ans afin de concevoir une installation flexible qui permette aux prochaines générations de tenir compte des évolutions techniques ou sociétales. Les modalités de la réversibilité de Cigéo devront faire l’objet d’une loi avant que l’autorisation de création du stockage ne puisse être délivrée.
QUESTION 80
Posée par Emmanuel COUPRIE (SAUVAGE MAGNY), le 17/05/2013
Aucun impact sur l'environnement et l'homme n'est décrit. Pourquoi?
Réponse du 20/06/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les impacts de Cigéo sur l’homme et l’environnement sont décrits dans le dossier du maître d’ouvrage.
Nous vous proposons notamment de lire :
QUESTION 79
Posée par Emmanuel COUPRIE (SAUVAGE MAGNY), le 17/05/2013
Pouvez-vous expliquer pourquoi la zone de stockage souterraine passe de 15km² (page 6) à 30km² (page 8) du doc de synthèse?
Réponse du 16/09/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La zone de 30 km2 correspond à la zone géographique dans laquelle l’Andra étudie l’implantation de l’installation souterraine de Cigéo. Cette zone, appelée « zone d’intérêt pour la reconnaissance approfondie » (ZIRA) a été définie en 2009 sur la base de critères liés à la sûreté, à la géologie et à l’insertion dans le territoire.
La surface de 15 km2 correspond à l’emprise qui serait utilisée par l’installation souterraine de Cigéo dans la ZIRA après une centaine d’années d’exploitation.
Pour en savoir plus : http://www.cigeo.com/la-localisation-des-installations
QUESTION 78
Posée par Maxime BIENAIMÉ, LES HABITANTS DE LA RÉGION QUE VOUS VOULEZ FOUTRE EN L'AIR (MEUSE), le 15/05/2013
C'est super sympa de vouloir venir foutre en l'air notre belle région en essayant de nous acheter en injectant de l'argent. Sauf qu'on n'est pas dupes et qu'on ne laissera pas faire. Ce débat public c'est une vaste blague, tout est déjà décidé et vous avez bien l'intention de venir nous polluer avec vos merdes, soit disant réversibles et qui ne fuieront jamais on vous le promet. Vous nous promettez quoi? Vous serez encore là pour assumer la responsabilité de vos conneries dans quelques centaines d'années peut-être?
Réponse du 15/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Serons-nous encore là dans quelques centaines d’années ? Notre génération, évidemment non, mais nos descendants oui. Et Cigéo est justement conçu dans cette logique : notre génération doit assumer ses responsabilités en proposant une solution sûre capable de protéger l’homme et l’environnement sur de très longues périodes et éviter de reporter indéfiniment la charge de la gestion des déchets radioactifs sur les générations futures. Ne serait-il pas irresponsable de laisser nos enfants se débrouiller avec les déchets que nous avons produits ?
L’accompagnement économique a été mis en place par le Parlement. Il est normal que les territoires qui acceptent d’accueillir un projet d’intérêt national en tirent un bénéfice concret.
La création de Cigéo n’est pas décidée. Le débat public est l’occasion de permettre à chacun de s’exprimer sur le projet présenté par l’Andra. Les conclusions du débat public seront prises en compte par l’Andra dans la poursuite des études.
QUESTION 77
Posée par Céline MICHELET (VERDUN), le 17/05/2013
Pourquoi sous prétexte que notre région est rurale (donc productrice en céréales alimentant le pays) devrions nous enfouir ces déchets encombrants dans notre sol? Le danger nous semble à tous exagéré! Et qu'en est-il des générations à venir?
Réponse du 20/06/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le caractère rural de la région n’a pas été le critère pris en compte pour l’implantation du projet Cigéo. C’est la nature du sous-sol qui conduit à étudier l’implantation du stockage en Meuse/Haute-Marne. Les travaux de l’Andra et l’évaluation de ses recherches par la Commission nationale d’évaluation, l’Autorité de sûreté nucléaire et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ont en effet confirmé les propriétés favorables de la couche argileuse du site pour confiner à très long terme la radioactivité.
Le but de Cigéo est de protéger durablement les hommes et l’environnement de la dangerosité des déchets. Que ce soit pendant son exploitation ou après sa fermeture, son impact sera nettement inférieur à celui de la radioactivité naturelle présente dans l’environnement. Comme c’est le cas aujourd’hui dans les régions où sont déjà implantées des centres de stockage de l’Andra ou des installations nucléaires, l’implantation de Cigéo restera compatible avec des activités agricoles et n’aura pas de conséquences sur les productions locales ni leur qualité.
L’Observatoire pérenne de l’environnement, mis en place par l’Andra en 2007, permettra de suivre l’évolution de l’environnement du stockage pendant sa construction et toute sa durée d’exploitation. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, il permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Par ailleurs, comme toutes les exploitations nucléaires, Cigéo sera en permanence soumis au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire, qui fait faire régulièrement par des laboratoires indépendants des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant.
Concernant les générations futures, la réalisation du stockage vise justement à ne pas reporter sur elles la charge de la gestion des déchets les plus radioactifs produits par les générations actuelles. L’alternative consistant à laisser les déchets dans des entreposages pérennisés, en surface ou à faible profondeur, leur imposerait de maintenir un contrôle permanent de ces installations et des moyens de les renouveler, ce qui semble difficile à garantir sur des périodes très longues.
QUESTION 76
Posée par Yves FAGEOT (FRONCLES), le 17/05/2013
La poubelle s'installe sur deux fosses, celle de Guindrecourt et celle de la Marne, pourquoi?
Réponse du 07/06/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La zone retenue pour étudier la roche argileuse à la limite de la Meuse et de la Haute-Marne a été choisie à l’écart des failles connues et les études menées par l’Andra ont ensuite permis de montrer qu’aucune faille n’est présente dans la zone d’implantation prévue pour Cigéo.
Le site de Meuse/Haute-Marne appartient à un domaine géologique stable, particulièrement favorable pour l’installation d’un stockage. L’activité sismique est en effet extrêmement faible, comme le prouvent les enregistrements de sismicité instrumentale (écoute sismique depuis 1961 à l’échelle de la France) et les chroniques historiques (séismes ayant été ressentis et/ou ayant occasionné des dégâts au cours des derniers 1 000 ans). Lorsque l’Andra a commencé à étudier le sud de la Meuse et le nord de la Haute-Marne, en 1994, elle avait connaissance des fossés de la Marne et de Gondrecourt, reportés sur toutes les cartes géologiques. La démarche de caractérisation géologique du site, avec tous les moyens d’études correspondant (cartographie, forage, sismique réflexion, images satellite), a consisté à :
- identifier un site d’implantation précis à l’écart de ces deux failles, dans un secteur où les formations géologiques sont planes,
- étudier en détail ces deux systèmes de failles pour en connaître les caractéristiques et vérifier qu’elles ne peuvent pas avoir de conséquences sur le futur stockage.
C’est ainsi que la zone de 30 km² étudiée pour l’implantation de l’installation souterraine (zone en rouge sur la carte) est, au plus proche, à 1,5 km du fossé de Gondrecourt, et à 6 km du segment le plus proche du système des failles de la Marne (le fossé de la Marne étant lui-même est à 14 km). Les analyses cartographiques montrent l’absence de mouvements de ces failles au cours des derniers millions d’années. Les derniers mouvements tectoniques du fossé de Gondrecourt datent de 20 à 25 millions d’années (datations de cristaux de calcite) ; les derniers mouvements des failles de la Marne sont du même âge ou plus anciens. La réalisation d’une écoute sismique dont le seuil de détection est très bas, et qui discrimine sans ambiguïté séismes naturels et tirs de carrières, permet d’affirmer l’absence de toute activité sur ces failles. En accord avec la réglementation en vigueur concernant la sûreté des installations nucléaires, les ouvrages de stockage sont toutefois dimensionnés pour résister aux séismes maxima physiquement possibles que pourraient générer ces failles si elles redevenaient actives dans le futur.

QUESTION 75
Posée par Yves FAGEOT (FRONCLES), le 17/05/2013
Comment se fait-il qu'il n'y ai pas eu de référendum pour l'implantation de cette poubelle. Passer par les élus en les achetant était plus facile?
Réponse du 24/06/2013,
Réponse apportée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Le projet Cigéo suit la procédure décrite à l’article L. 542-10 du Code de l’Environnement, dont le processus est illustré par les schémas présentés ci-dessous et qui ne prévoit pas la réalisation d’un référendum.
Comme cela est représenté sur les schémas, au cours de ce processus, plusieurs procédures de consultation sont organisées afin de recueillir l’avis des populations locales et nationales :
- un débat public en 2013, organisé afin de recueillir les avis de l’ensemble de la population au niveau local et national,
- un avis des collectivités locales à proximité du projet (horizon 2016),
- une enquête publique (horizon 2017-2018) préalable au décret d’autorisation de création.
Le Parlement fixe périodiquement les choix relatifs à la mise en œuvre de ce projet :
- loi du 30 décembre 1991, dite loi « Bataille », fixant un programme d’études et recherches de 15 années d’études et recherches sur les déchets radioactifs ;
- loi du 28 juin 2006, définissant le stockage géologique profond comme solution de référence pour les déchets les plus radioactifs et demandant sa mise en service en 2025 ;
- loi à venir sur la réversibilité du projet à horizon 2016.
En outre, l’Etat est en contact permanent avec les parties prenantes locales. Un important travail de concertation a été mené, notamment avec les exécutifs locaux, pour élaborer un projet de schéma interdépartemental du territoire.
L’avis des populations locales au travers des procédures de consultation et l’expression de leurs représentants au Parlement est primordiale. Dès aujourd’hui, à travers les outils d’expressions mis en place par la Commission Particulière du Débat Public (site internet, cahiers d’acteur, réunions), vous avez l’opportunité d’exprimer votre avis.
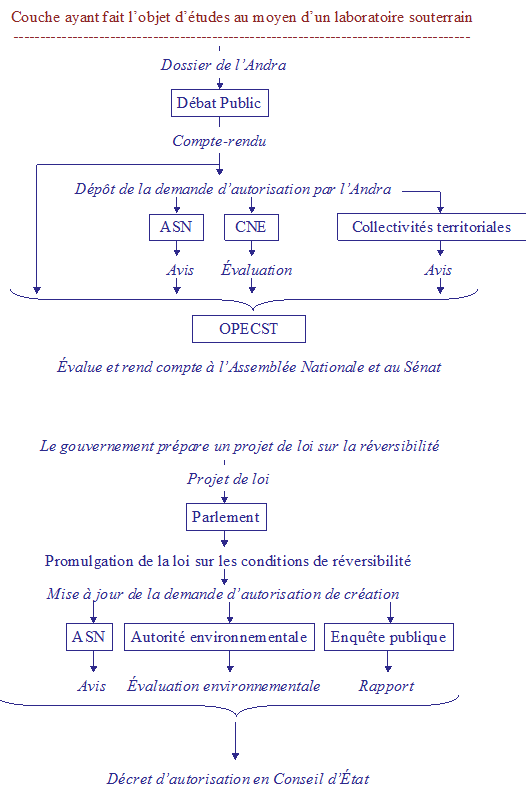
QUESTION 74
Posée par Charles BOTTIGLIRI (LANGRES), le 17/05/2013
Pourquoi ne pas avoir demandé par référendum, l'avis aux deux départements concernés. Personnellement, je suis contre le projet. Avez-vous pensé aux générations futures?
Réponse du 24/06/2013,
Réponse apportée par le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Le projet Cigéo suit la procédure décrite à l’article L. 542-10 du Code de l’Environnement, dont le processus est illustré par les schémas présentés ci-dessous et qui ne prévoit pas la réalisation d’un référendum.
Comme cela est représenté sur les schémas, au cours de ce processus, plusieurs procédures de consultation sont organisées afin de recueillir l’avis des populations locales et nationales :
- un débat public en 2013, organisé afin de recueillir les avis de l’ensemble de la population au niveau local et national,
- un avis des collectivités locales à proximité du projet (horizon 2016),
- une enquête publique (horizon 2017-2018) préalable au décret d’autorisation de création.
Le Parlement fixe périodiquement les choix relatifs à la mise en œuvre de ce projet :
- loi du 30 décembre 1991, dite loi « Bataille », fixant un programme d’études et recherches de 15 années d’études et recherches sur les déchets radioactifs ;
- loi du 28 juin 2006, définissant le stockage géologique profond comme solution de référence pour les déchets les plus radioactifs en vue, sous réserve de son autorisation, d’une mise en service en 2025 ;
- loi à venir sur la réversibilité du projet à horizon 2016.
En outre, l’Etat est en contact permanent avec les parties prenantes locales. Un important travail de concertation a été mené, notamment avec les exécutifs locaux, pour élaborer un projet de schéma interdépartemental du territoire.
L’avis des populations locales au travers des procédures de consultation et l’expression de leurs représentants au Parlement est primordiale. Dès aujourd’hui, à travers les outils d’expressions mis en place par la Commission Particulière du Débat Public (site internet, cahiers d’acteur, réunions), vous avez l’opportunité d’exprimer votre avis.
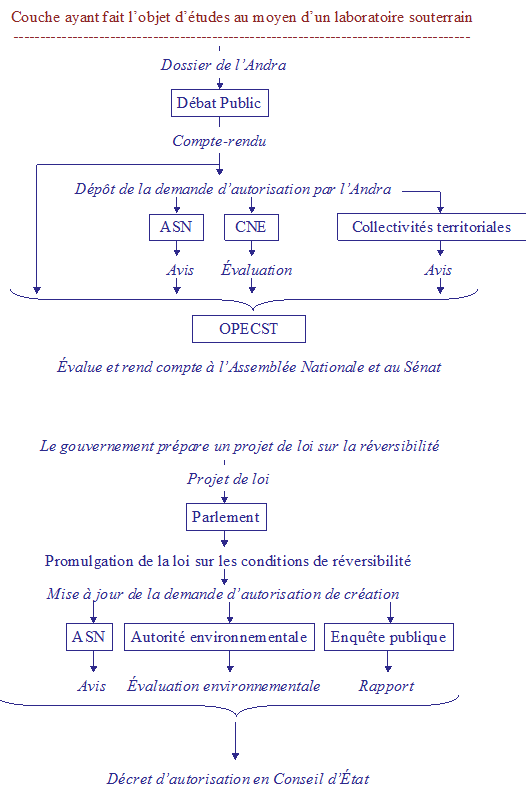
QUESTION 73
Posée par Jacques RAGOT (VOID VACON), le 17/05/2013
Beaucoup de débat et trop d'argent engagé pour arriver de toute façon à un stockage à Bure, c'est mon avis depuis le début des travaux. Si le monde continue comme aujourd'hui (pollutions) la terre existera-t-elle encore dans 500 ans?
Réponse du 31/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le stockage géologique est justement reconnu, en France et ailleurs, comme la seule solution pouvant protéger, sur de très longues échelles de temps, les générations actuelles et futures de la dangerosité des déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue. Toutefois, la création de Cigéo n’est pas encore actée.
QUESTION 72
Posée par Pierre-Christophe HUET (PARNOY EN BASSIGNY), le 17/05/2013
Une réversibilité de 100 ans pour des déchets dangereux plusieurs centaines de milliers d'années. Ne s'agit-il pas d'une "mesurette" à caractère démagogique? Pourquoi pas une réversibilité de 1000 ans? Merci
Réponse du 15/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le Parlement a demandé à l’Andra que le stockage soit réversible pendant au moins 100 ans* pour laisser des portes ouvertes aux générations suivantes. En fonction de l’expérience acquise lors de l’exploitation de Cigéo (en 100 ans, Cigéo aura fait l’objet d’au moins 10 réexamens complets de sûreté, en accord avec les exigences de l’Autorité de sûreté nucléaire qui impose un réexamen périodique de sûreté, au moins tous les 10 ans, pour toutes les installations nucléaires) et des progrès scientifiques et technologiques, les générations suivantes seront libres de décider du devenir de Cigéo, en particulier de son calendrier de fermeture. Elles pourront réévaluer la période de réversibilité. Au final, le but du stockage profond est de mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs pour ne pas reporter indéfiniment la charge de la gestion de ces déchets sur les générations futures.
Au plan technologique la demande de réversibilité a des implications très concrètes sur la conception du stockage. L’Andra retient les meilleures techniques d’ingénierie disponibles pour offrir aux générations suivantes le maximum de flexibilité pour la gestion dans le temps de l’installation : épaisseur des ouvrages, colis résistants, surveillance. L’Andra conçoit également les installations de Cigéo pour faciliter le retrait éventuel de déchets au cas où les générations suivantes le jugeraient pertinent.
*Dans son avis sur les recherches menées dans le cadre de la loi de 1991, publié en 2006, l’Autorité de sûreté nucléaire ne considère pas que la possibilité de reprendre aisément les colis de déchets soit acquise sur une durée de plusieurs siècles. Elle considère également que, sur le plan des principes, la réversibilité ne peut avoir qu’une durée limitée.
QUESTION 71
Posée par Pierre-Christophe HUET (PARNOY EN BASSIGNY), le 17/05/2013
Page 4 de la brochure reçue (bas): en ce qui concerne l'inventaire autorisé de CIGEO, qu'appelez-vous précisément une "évolution notable"?
Réponse du 11/06/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Si Cigéo est autorisé, le décret de création du Centre fixera le volume et la nature des déchets dont le stockage est autorisé. Comme le rappelle l’Autorité de sûreté nucléaire dans son avis du 16 mai 2013, si l’un ou l’autre devait être modifié ultérieurement (par exemple augmentation du volume de déchets suite à la création de nouvelles installations nucléaires, demande de stockage de nouveaux types de déchets), cela constituerait une modification notable de l’installation de stockage. Une nouvelle procédure d’autorisation, comprenant notamment une enquête publique locale et un nouveau décret d’autorisation, serait alors nécessaire pour modifier l’inventaire du stockage.
QUESTION 70
Posée par Jacqueline AUBRY (FRÉCOURT), le 17/05/2013
Pensez-vous qu'il ne pourra jamais avoir de tremblements de terre dans cette région? Et le jour que cela se produira qu'en adviendra-t-il des futures générations. Y pensez-vous?
Réponse du 15/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La zone étudiée en Meuse/Haute-Marne pour l’implantation de Cigéo a été notamment choisie parce qu’elle se situe dans un bassin sédimentaire, le Bassin de Paris, qui, du fait de sa nature géologique, a une sismicité très faible, ce que confirment toutes les études géologiques.
Dans la conception de Cigéo, l’Andra prend tout de même en compte la possibilité qu’un ou plusieurs séismes puissent éventuellement survenir, après la fermeture du stockage, au niveau des failles se trouvant les plus proches du stockage, bien que celles-ci soient inactives depuis plusieurs millions d’années. Les études ont permis de définir quel serait le plus fort séisme physiquement possible sur d’aussi grandes échelles de temps, si ces failles redevenaient actives dans le futur. Un tel séisme pourrait se produire, au plus près, au niveau de la faille de la Marne, à environ 10 kilomètres du site, tous les 100 000 à 1 million d’années et serait d’une magnitude d’environ 6. Cigéo est conçu pour que plusieurs séismes de ce type n’altèrent pas sa capacité à confiner la radioactivité contenue dans les déchets stockés.
QUESTION 69
Posée par Richard BAECHLER (MOGNEVILLE), le 17/05/2013
Sécurité transports SNCF (blocages par les anti!!!) Et si un "accident" survenait!!!! à cause des anti!!!! Protection des habitants dans un rayon de ???
Réponse du 02/07/2013,
Réponse apportée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) :
Il convient de distinguer la sûreté des transports nucléaires de la prévention des actes de malveillance.
La sûreté des transports de substances radioactives a pour objectif la prévention des accidents nucléaires par la mise en place de mesures organisationnelles et techniques. Elle s’appuie sur une logique de « défense en profondeur », incluant le colis, constitué par l’emballage et son contenu, qui doit résister aux conditions de transport envisageables. le moyen de transport et sa fiabilité et enfin les moyens d’intervention mis en œuvre face à un incident ou un accident. La responsabilité première de la mise en œuvre de ces lignes de défense repose sur l’expéditeur. La réglementation du transport de substances radioactives a une forte dimension internationale ; elle repose sur des recommandations de l’AIEA intégrées dans les accords internationaux traitant les différents modes de transport de marchandises dangereuses. Dans ce cadre, l’Autorité de sûreté nucléaire est chargée du contrôle de la sûreté des transports pour les usages civils. Elle est chargée notamment de l’agrément des modèles de colis pour les transports les plus dangereux.
Les modèles de colis sont soumis à des épreuves réglementaires destinées à démontrer leur résistance lors du transport. Le niveau d’exigence de ces épreuves est proportionné à la dangerosité des substances transportées. À titre d’exemple, les modèles de colis correspondant aux substances les plus dangereuses doivent conserver leurs fonctions de sûreté, y compris en cas d’accident (simulé par une chute de 9 m sur une surface indéformable, une chute de 1 m sur un poinçon, un incendie d’hydrocarbure totalement enveloppant de 800° C minimum pendant 30 mn, une immersion dans l’eau à une profondeur de 200 m).
La lutte contre la malveillance consiste à empêcher les pertes, disparitions, vols ou détournements des matières nucléaires ou actes de terrorisme. Elle incombe au Haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, et de l’énergie (MEDDE). Tout transporteur de matière nucléaire doit être autorisé et chaque transport fait l'objet d'une autorisation d'exécution spécifique. Certains transports font l'objet de mesures de protection particulières sous forme d'escortes qui sont à la charge des opérateurs. L’État garantit la libre circulation des transports et peut décider de la participation de forces régaliennes à la protection des transports nucléaires. Pour des raisons de sécurité, certaines informations telles que la date, les horaires, les arrêts et leur durée, ne sont pas communiquées au public.
L'exécution de chaque transport est subordonnée à la délivrance d'un accord d’exécution par le MEDDE. Elle est transmise au ministère de l’intérieur (pôle Ordre Public – Défense/Renseignement) via le COGIC (Centre Opérationnel de Gestion Interministériel de Crise) qui informe les préfectures concernées de la date et de la qualité du transport demandé. Cela permet :
-
aux autorités préfectorales, de gendarmerie et de police d’identifier au plan local toute impossibilité majeure à l’exécution de ces transports et d’en informer l’autorité de sécurité nucléaire
-
aux autorités préfectorales, de gendarmerie et de police d’anticiper les moyens de protection physique à mettre en place lors du passage du transport sur leur territoire
L’autorisation d’exécution est transmise aux préfectures concernées dans les jours précédant le transport. Elle permet de confirmer la mise en place des moyens de protection physique que le préfet a estimé nécessaire de déployer.
QUESTION 68
Posée par Jacques MENN (BURE), le 17/05/2013
Pourquoi un débat public en 2013 alors que toutes les décisions sont déjà prises? Aujourd'hui on nous annonce des rejets de gaz radioactifs et un dépôt à l'air libre? Alors qu'au départ cela n'était qu'un laboratoire?
Réponse du 25/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Concernant le débat et les décisions : Aujourd’hui, la décision de créer Cigéo n’est pas prise. L’Andra a justement souhaité que le débat public intervienne en 2013, quand le projet n’est pas encore finalisé, pour pouvoir prendre en compte les retours du débat public dans la suite de ses études en vue d’établir le dossier de demande d’autorisation de création du centre de stockage. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra à l’État après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo. Ce processus comprendra notamment une évaluation de sûreté par l’Autorité de sûreté nucléaire et scientifique par la Commission nationale d’évaluation, l’avis des collectivités territoriales, le vote d’une nouvelle loi fixant les conditions de réversibilité et une enquête publique.
Concernant les rejets : Si Cigéo est autorisé, il sera une installation distincte du Laboratoire souterrain qui n’accueille pas de déchets radioactifs. Le fonctionnement de Cigéo sera à l’origine d’une très faible quantité de rejets. Les dispositions prises par l’Andra pour garantir que ces rejets n’auront pas d’impact pour la santé et l’environnement sont présentées dans le dossier du maître d’ouvrage au chapitre 5.
Concernant le dépôt à l’air libre : Aucun dépôt à l’air libre de colis de déchets n’est prévu sur Cigéo. En surface, la réception, le contrôle et la préparation des colis de déchets en vue de leur stockage se fera dans des bâtiments fermés, conçus pour accueillir des déchets radioactifs de ce type. Ils seront ensuite transférés dans l’installation souterraine de Cigéo, à environ 500 mètres de profondeur.
QUESTION 67
Posée par Marie-Eve BODENREIDER (GONDRECOURT LE CHATEAU), le 17/05/2013
Il semble être beaucoup question de l'enfouissement, qui est déjà par lui-même, un projet des plus dangereux à long terme, pour l'environnement, la terre, et surtout pour l'homme et la santé publique, mais qu'en est il du transport des matières radioactives? Au 1er débat il y a environ 20 ans, on nous a dit qu'il n'y aurait pas d'accident...!!! Il ne devrait pas y avoir d'incendie à stocamine, ni de problème au Japon... Merci de rester à l'échelle humaine en tant qu'humain!... Vous êtes scientifiques et non voyants aux seuls intérêts financiers!!!
Réponse du 26/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La gestion des déchets radioactifs est un sujet d’intérêt général. L'Andra est une agence publique indépendante, créée par le Parlement, dont la mission première est de trouver et de mettre en œuvre des solutions de gestion sûres à long terme pour les déchets radioactifs. Les solutions étudiées reposent sur de nombreuses études scientifiques indépendantes, menées par différents organismes de recherche, en France et à l’étranger.
L’objectif fondamental de Cigéo est de protéger l’homme et l’environnement des déchets les plus radioactifs sur de très longues échelles de temps. La sûreté est au cœur du projet : Cigéo est conçu pour être sûr pendant sa construction, son exploitation et après sa fermeture afin de mettre en sécurité ces déchets de manière définitive. Des scénarios accidentels sont pris en compte et leurs conséquences sont étudiées dans le cadre des analyses de sûreté afin de garantir que si de tels évènements se produisaient la sûreté du stockage ne serait pas remise en cause. Le retour d'expérience des autres installations est pris en compte pour concevoir Cigéo.
Pour que le projet puisse être autorisé, l’Andra doit démontrer aux populations locales et aux évaluateurs, scientifiques (Commission nationale d’évaluation) et de sûreté (Autorité de sûreté nucléaire), qu’elle maîtrise tous les risques liés à l'installation. Par ailleurs, si Cigéo est autorisé, l’Andra devra procéder périodiquement à des réexamens complets de la sûreté de l’installation, en prenant en compte les meilleures pratiques internationales.
Concernant les transports des matières radioactives, ils relèvent de la responsabilité des producteurs de déchets (Areva, CEA et EDF). L’Autorité de sûreté nucléaire est responsable du contrôle de la sûreté de ces transports.
Réponse apportée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) :
Environ 900 000 colis de substances radioactives sont transportés chaque année. 85 % des colis transportés sont destinés aux secteurs de la santé, de l’industrie non-nucléaire ou de la recherche, dits "nucléaire de proximité", dont 30 % environ pour le seul secteur médical. L’industrie nucléaire ne représente qu’environ 15 % du flux annuel de transports de substances radioactives. On estime à environ 11 000 le nombre annuel de transports nécessaires au cycle du combustible, pour 141 000 colis. Le contenu des colis est très divers : leur radioactivité varie sur plus de douze ordres de grandeur, soit de quelques milliers de becquerels pour des colis pharmaceutiques de faible activité à des millions de milliards de becquerels pour des combustibles irradiés. Leur masse varie de quelques kilogrammes à une centaine de tonnes.
Les risques majeurs des transports de substances radioactives sont les suivants :
- le risque d’irradiation externe de personnes dans le cas de la détérioration de la « protection biologique des colis », matériau technique qui permet de réduire le rayonnement au contact du colis ;
- le risque d’inhalation ou d’ingestion de particules radioactives dans le cas de relâchement de substances radioactives ;
- la contamination de l’environnement dans le cas de relâchement de substances radioactives ;
- le démarrage d’une réaction nucléaire en chaîne non contrôlée (risque de « sûreté-criticité ») pouvant occasionner une irradiation des personnes, en cas de présence d’eau et de non-maîtrise de la sûreté de substances radioactives fissiles.
La prise en compte de ces risques conduit à devoir maîtriser le comportement des colis pour éviter tout relâchement de matière et détérioration des protections du colis dans le cas :
- d’un incendie ;
- d’un impact mécanique consécutif à un accident de transport ;
- d’une entrée d’eau dans l’emballage (l’eau facilitant les réactions nucléaires en chaîne en présence de substances fissiles) ;
- d’une interaction chimique entre différents constituants du colis ;
- d’un dégagement thermique important des substances transportées, pour éviter la détérioration éventuelle avec la chaleur des matériaux constitutifs du colis.
Cette approche conduit à définir des principes de sûreté pour les transports de substances radioactives :
- la sûreté repose avant tout sur le colis : des épreuves réglementaires et des démonstrations de sûreté sont requises par la réglementation pour démontrer la résistance des colis à des accidents de référence ;
- le niveau d’exigence, notamment concernant la définition des accidents de référence auxquels doivent résister les colis, dépend du niveau de risque présenté par le contenu du colis.
Ainsi, les colis qui permettent de transporter les substances les plus dangereuses doivent être conçus de façon à ce que la sûreté soit garantie y compris lors d’accident de transport. Ces accidents sont représentés par les épreuves suivantes :
- trois épreuves en série (chute de 9 m sur une surface indéformable, chute de 1 m sur un poinçon, incendie totalement enveloppant de 800 °C minimum pendant 30 minutes);
- immersion dans l’eau d’une profondeur de 15 m (200 m pour les combustibles irradiés) pendant 8 h.
La sûreté des transports est également fondée sur la fiabilité des opérations de transport qui doivent satisfaire à des exigences réglementaires notamment en matière de radioprotection. L'ASN assure le contrôle de la sûreté des transports de matières radioactives. Enfin, la gestion des situations accidentelles est régulièrement testée lors d'exercices.
Réponse apportée par AREVA :
En France, les premiers transports de substances radioactives liés à l’industrie électronucléaire ont débuté dans les années 60. Aujourd’hui, on estime à environ 11 000 par an le nombre total de transports nécessaires au cycle du combustible pour l’activité électronucléaire. Les exigences des autorités nationales et internationales en termes de sûreté et de sécurité de transport n’ont cessé de se renforcer. Les matières et déchets radioactifs sont transportés dans des « emballages » de haute technologie et agréés par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (voir illustration). Le retour d’expérience de plusieurs dizaines d’années confirme le haut niveau de sûreté mis en œuvre : aucun accident ayant eu des conséquences radiologiques n’est à déplorer.
Une organisation de crise éprouvée a été mise en place pour gérer les accidents. Les autorités françaises s’appuient sur les dispositifs mis en place dans le cadre des plans ORSEC et à leur déclinaison départementale. AREVA, par ailleurs, dispose d’un plan d’urgence interne spécifique appelé PUI-T. Testé chaque année, il met à la disposition des autorités compétentes des moyens humains spécialisés et des matériels spécifiques. Dans le cadre du débat public, AREVA propose un cahier d’acteur dédié aux transports de déchets.
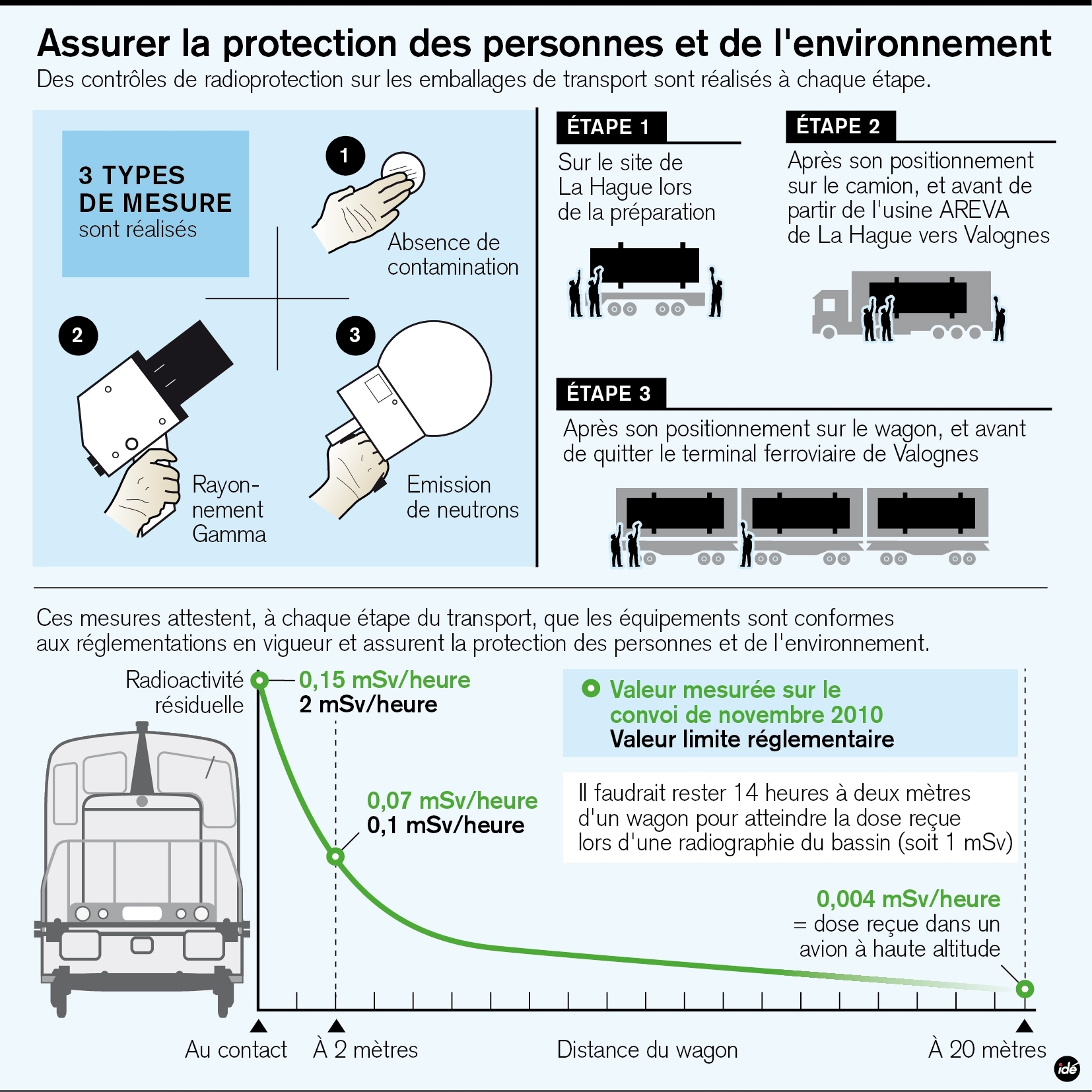
Réponse apportée par EDF :
Les transports de déchets radioactifs jusqu’à Cigéo relèveront de la responsabilité des producteurs et seront soumis à la réglementation internationale comme pour tous les transports de substances radioactives réalisés aujourd’hui en France. Les emballages dans lesquels seront transportés les déchets sont conçus pour être étanches et le rester même en cas d’accident (collision, incendie, immersion). La fiabilité de ces transports repose sur le respect des règles prévues par le règlement pour le transport des marchandises dangereuses. La conception des emballages de transport et la formation des personnels font partie de ces règles, dont le respect est soumis au contrôle de l'Autorité de sûreté nucléaire. Le contrôle de la protection des transports contre les actions de malveillance est, lui, du ressort du Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité auprès du ministre de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie.
QUESTION 66
Posée par Fernand LAMBERT (ANCERVILLE), le 17/05/2013
Qu'en est-il des 4 autres sites prévus?
Réponse du 20/06/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La loi de recherche du 30 décembre 1991 prévoyait la réalisation de laboratoires souterrains pour l’étude des possibilités de stockage dans les formations géologiques profondes. Suite à une mission de concertation lancée fin 1992 et à des premières analyses géologiques, quatre sites candidats avaient été identifiés dans les départements du Gard, de la Meuse, de la Haute-Marne (couches argileuses) et de la Vienne (couche granitique). L’Andra a été autorisée par le Gouvernement à mener des investigations géologiques dans le but de savoir s’il était intéressant d’y construire un laboratoire souterrain pour continuer les études. En 1996, l’Andra a déposé trois dossiers de demandes d’installation de laboratoires souterrains. Les résultats des investigations géologiques ont montré que la géologie du site en Meuse/Haute-Marne (les deux sites ont été fusionnés en une seule zone en raison de la continuité de la couche argileuse étudiée) était particulièrement favorable. Concernant le Gard, le site présentait une plus grande complexité scientifique liée à son évolution géodynamique à long terme et faisait l’objet d’oppositions locales. L’instruction du dossier relatif au site étudié dans la Vienne n’a pas abouti à un consensus scientifique sur la qualité hydrogéologique du massif granitique.
En 1998, le Gouvernement a décidé la construction d’un laboratoire de recherche souterrain en Meuse/Haute-Marne et la poursuite des études pour trouver un autre site dans une roche granitique. La recherche d’un site dans une roche granitique a finalement été abandonnée, la mission de concertation n’ayant pas abouti. L’Andra a toutefois poursuivi ses recherches sur le milieu granitique jusqu’en 2005, en s’appuyant notamment sur les connaissances déjà disponibles sur les massifs granitiques français et sur les travaux menés dans les laboratoires souterrains d’autres pays (Suède, Canada, Suisse). Ces recherches ont conduit l’Andra à conclure en 2005 qu’un stockage dans les massifs granitiques ne présenterait pas de caractère rédhibitoire mais que la principale incertitude porte sur l’existence de sites en France avec un granite ne présentant pas une trop forte densité de fractures.
QUESTION 65
Posée par Lionel BRETONNET (SAINT SELVE), le 21/05/2013
2- Qui finance?
3- Répartition du financement privé/public?
SVP
Réponse du 20/06/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maitre d’ouvrage :
Les modalités de financement du projet Cigéo sont définies par la loi du 28 juin 2006.
Les études et recherches sont financées par une taxe (dite taxe « de recherche ») additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base. Elle est collectée par l'Autorité de sûreté nucléaire auprès des exploitants nucléaires concernés (Areva, CEA, EDF) et versée sur un fonds géré par l’Andra. Sur la période 2010-2012, cette taxe s’élevait à environ 118 millions d’euros par an.
La construction, l’exploitation et la fermeture de Cigéo seront également financées par les producteurs de déchets, au travers d’un autre fonds, alimenté par des conventions entre l’Andra et les producteurs. La clé de répartition sera liée notamment à l’inventaire de déchets de chaque producteur. Elle est aujourd’hui de 78 % pour EDF, 17 % pour le CEA et 5 % pour Areva.
QUESTION 64
Posée par Lionel BRETONNET (SAINT SELVE), le 21/05/2013
1- Quel est le coût total?
Réponse du 15/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’évaluation du coût total de Cigéo doit prendre en compte l’ensemble des coûts du stockage sur plus de 100 ans : les études, la construction des premiers ouvrages (bâtiments de surface, puits, descenderies), l’exploitation (personnel, maintenance, énergie…), la construction progressive des ouvrages souterrains, leur fermeture… Conformément à la loi du 28 juin 2006, le ministre chargé de l’énergie arrête et publie l’évaluation du coût, sur la base de l’évaluation proposée par l’Andra et après avoir recueilli l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et les observations des producteurs de déchets (EDF, CEA, Areva) qui financeront ces dépenses. Des mises à jour régulières du chiffrage sont prévues pour prendre en compte les résultats des études menées par l’Andra.
Pour un nouveau réacteur nucléaire sur l’ensemble de sa durée de fonctionnement, le coût du stockage des déchets radioactifs est de l’ordre de 1 à 2 % du coût total de la production d’électricité.
La dernière évaluation du coût du stockage validée par le ministère en charge de l’énergie date de 2005. Le coût du stockage avait été estimé entre 13,5 et 16,5 milliards d’euros, répartis sur une centaine d’années. Cette évaluation couvrait notamment le stockage de tous les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue produits par les réacteurs nucléaires français pendant 40 ans. Une nouvelle évaluation est en cours par l’Andra, pour intégrer les pistes d'optimisation et les nouveautés en termes de solutions techniques, de sécurité et de dimensionnement.
La Cour des comptes a réalisé une analyse des enjeux associés à ces différents points dans son rapport public thématique portant sur « Les coûts de la filière électronucléaire » (janvier 2012) disponible sur le site du débat : ../docs/docs-complementaires/docs-avis-autorites-controle-evaluations/rapport-thematique-filiere-electronucleaire.pdf.
QUESTION 63
Posée par Philippe PORTMANN (LANEUVILLE AU PONT), le 21/05/2013
Qu'entendez-vous par "réversibilité" du projet?
Réponse du 23/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les conditions de réversibilité constituent l’un des sujets majeurs à discuter dans le cadre du débat public. Les échanges alimenteront la préparation de la future loi qui fixera les conditions de réversibilité du stockage. Cette loi sera votée avant que la création de Cigéo ne puisse être décidée.
Quelles sont les attentes ? Une large démarche de dialogue au niveau local, national et international a été engagée par l’Andra pour identifier les attentes liées à la réversibilité. Pour beaucoup, un stockage réversible est un stockage sûr qui permet de pouvoir récupérer les colis de déchets radioactifs et qui permet de revenir sur les décisions prises aujourd’hui.
Quelles sont les propositions de l’Andra ? Durant le siècle d’exploitation, l’Andra propose des conditions de réversibilité qui ne compromettent pas la sûreté du stockage et qui sont réalisables sur le plan technique. Ces propositions concernent à la fois la technique et le pilotage du stockage.
1) Pouvoir récupérer les colis de déchets après leur stockage
De nombreuses dispositions techniques sont mises en œuvre pour faciliter une opération éventuelle de retrait de colis du stockage. Ces dispositions prennent en compte le retour d’expérience d’autres installations, en France et à l’étranger. Les colis utilisés pour le stockage des déchets, en béton ou en acier, sont indéformables. Des espaces suffisants sont ménagés entre les colis pour permettre leur retrait. Les tunnels de stockage (alvéoles de stockage) ont un revêtement en béton ou en acier pour éviter les déformations. L’exploitant disposera d’une connaissance précise de l’emplacement de chaque colis et de ses conditions de stockage. Des essais de retrait de colis ont d’ores et déjà été réalisés à l’échelle 1. Des nouveaux tests de retrait seront réalisés dans le stockage avant que la mise en service de Cigéo ne puisse être autorisée, puis pendant toute l’exploitation de Cigéo.
2) Un calendrier de fermeture progressif et révisable dans le temps
Pour assurer la mise en sécurité définitive des déchets radioactifs, le stockage devra être fermé. La conception de Cigéo offre la possibilité d’une fermeture progressive des alvéoles de stockage, des galeries souterraines puis des puits et des descenderies. Chaque étape de fermeture rendra plus complexe le retrait de colis (nécessité de rouvrir l’alvéole et de réinstaller les équipements de manutention) mais permettra d’ajouter des dispositifs de sûreté passive. Compte tenu de leur importance, l’Andra propose que le franchissement de ces étapes fasse l’objet d’une autorisation spécifique. Le Parlement a d’ores et déjà décidé que seule une loi pourrait autoriser la fermeture définitive du stockage.
3) Des rendez-vous réguliers avec l’ensemble des acteurs pour décider ensemble
L’Andra propose que des rendez-vous soient programmés régulièrement avec l’ensemble des acteurs (riverains, collectivités, évaluateurs, État…) pour contrôler le déroulement du stockage et préparer les étapes suivantes. Ces rendez-vous seront alimentés par les résultats des réexamens périodiques de sûreté, dont la loi exige qu’ils aient lieu au moins tous les 10 ans, de la surveillance du stockage et par les progrès scientifiques et technologiques. Le premier de ces rendez-vous pourrait avoir lieu cinq ans après le démarrage du centre.
QUESTION 62
Posée par Samuel HENRI (JONCHERY), le 21/05/2013
1- Y aura-t-il des enquêtes sanitaires régulières pour contrôler l'impact des rejets et du fonctionnement lié à CIGEO?
2- En cas de rejet supérieur aux scénarios envisagés (tout n'étant pas prévisible), que se passerait-il?
3- Et après 100 ans, si de meilleures solutions sont trouvées et que celles-ci s'avèrent aussi fiable que prévue?
Réponse du 23/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement afin de contrôler l’impact de ses activités. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, il permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement et l’absence de contamination de l’environnement. L’Andra a déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement. De plus, Cigéo sera en permanence soumis au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public. Enfin, pour répondre à une demande formulée par les populations locales, les modalités possibles pour une surveillance de la santé autour du stockage sont à l’étude. L’Andra a mis en place un groupe d’experts pour proposer des modalités techniques pour assurer cette surveillance et a saisi ses ministères de tutelle pour que la gouvernance et l’organisation d’un tel dispositif soient précisées.
Les mesures effectuées dans le cadre du plan de surveillance permettront de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité. En cas de dérive, l’Andra devra mettre en œuvre les mesures pour faire cesser l’origine de la pollution. Elle devra surveiller que les conséquences de la pollution constatée ne puissent pas avoir d’impact sur la santé et l’environnement, et le cas échéant prendre des mesures particulières de surveillance ou de dépollution. Les autorités compétentes (Autorité de sûreté nucléaire et préfectures) et le public seront immédiatement informés, conformément aux dispositions prévues par la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
Si Cigéo est autorisé, l’Andra propose que des rendez-vous réguliers soient programmés pour faire le point sur l’exploitation du stockage et préparer les étapes suivantes. Ces rendez-vous seront alimentés par les réexamens de sûreté réguliers du stockage et sa surveillance ainsi que par les résultats des recherches menées en France et à l’étranger sur la gestion des déchets radioactifs. A chaque étape, il sera possible de décider de poursuivre le processus de stockage tel qu’initialement prévu ou de le modifier, par exemple si des solutions alternatives sont identifiées. Les conditions de réversibilité et le calendrier de fermeture du stockage pourront être réexaminés lors de ces rendez-vous. C’est aux générations suivantes qu’il reviendra de décider dans un siècle si elles souhaitent fermer définitivement le stockage ou temporiser cette étape.
QUESTION 61
Posée par Christian LECLERC (VAUDEVILLE LE HAUT), le 21/05/2013
Beaucoup de questions à ce jour et peu de réponse?
Réponse du 13/06/2013,
A ce jour, la Commission a reçu 139 questions. Près de 30 % d'entre elles ont reçu une réponse.
La CPDP traite les questions relatives au débat public et transmet au maître d'ouvrage les questions qui le concernent. Nous veillons à apporter des réponses complètes et personnalisées qui peuvent demander un certain temps de rédaction.
La CPDP vérifie que toutes les réponses répondent bien aux questions posées, de manière précise et transparente. Ce n'est qu'une fois ce processus terminé que les réponses sont publiées et envoyées à leurs auteurs.
Nous nous engageons à répondre dans un délai de 4 semaines. Jusqu'à présent, le délai entre la réception de la question et la publication de sa réponse se situe entre 8 et 26 jours.
QUESTION 60
Posée par Anne-Marie BALLY (VARENNES SUR AMANCE), le 21/05/2013
Liste des associations envisageant de participer aux débats
Réponse du 20/06/2013,
A la date du 19 juin 2013, les associations ayant participé au débat public Cigéo sont les suivantes :
- La Qualité de Vie - Ville sur Terre (La QV)
- Environnement et Développement Alternatif (EDA)
- Comité de Réflexion, d’Information et de Lutte Antinucléaire (CRILAN)
- Sauvons le Climat (SLC)
- Association Nationale des Comités et Commissions Locales d'Information (ANCCLI)
- Stop EPR Penly
- Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l'Ouest (ACRO)
QUESTION 59
Posée par Ferdinand NOWAKOWSKI (JULVECOURT), le 21/05/2013
Quels sont les risques pour l'environnement? Peut-on maîtriser les fuites s'il y a?
Réponse du 23/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif de Cigéo est de protéger l’environnement des risques que présentent les déchets radioactifs. Pour cela, de nombreuses dispositions sont prises dès la conception du stockage pour minimiser l’impact du stockage.
Les rejets liquides et gazeux seront en très faibles quantités. Ils seront canalisés, mesurés et strictement contrôlés afin de vérifier que leur impact reste inférieur aux normes réglementaires et ne présente pas de risque.
Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement afin de contrôler l’impact de ses activités. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, il permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement et l’absence de contamination des nappes phréatiques. L’Andra a déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
De plus, Cigéo sera en permanence soumis au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
Les mesures effectuées dans le cadre du plan de surveillance permettront de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité. En cas de dérive, l’Andra devra mettre en œuvre les mesures pour faire cesser l’origine de la pollution. Elle devra surveiller que les conséquences de la pollution constatée ne puissent pas avoir d’impact sur la santé et l’environnement, et le cas échéant prendre des mesures particulières de surveillance ou de dépollution. Les autorités compétentes (Autorité de sûreté nucléaire et préfectures) et le public seront immédiatement informés, conformément aux dispositions prévues par la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
Après la fermeture du stockage, au-delà de la durée de vie des ouvrages industriels, la couche d’argile très peu perméable, de plus de 130 mètres d’épaisseur, dans laquelle sera installé le stockage souterrain, servira de barrière naturelle pour retenir les radionucléides contenus dans les déchets et freiner leur déplacement. Le stockage permet ainsi de garantir leur confinement sur de très longues échelles de temps. Seuls quelques-uns de ces radionucléides, les plus mobiles et dont la durée de vie est longue, pourront migrer de manière très étalée dans le temps. Ils ne sortiraient pas de cette couche avant 100 000 ans et atteindraient en quantités extrêmement faibles la surface et les nappes phréatiques. Leur impact radiologique serait alors plusieurs dizaines de fois inférieur à l’impact de la radioactivité naturelle (qui est de 2,4 mSv par an en moyenne en France).
QUESTION 58 - Démantèlement des centrales nucléaires hors d'usage
Posée par Daniel DELRUE (POMPEY), le 21/05/2013
Bonjour Mesdames, Messieurs,
Pourquoi faut il absolument démanteler les centrales nucléaires qui vont s'arrêter. Ne serait-il pas plus judicieux et beaucoup moins onéreux de conserver celles ci en l'état, même si elles sont à l'arrêt définitif, de plus les nouvelles qui devront être construites pour les remplacer ,pourraient être construites sur le même site, à côté des anciennes, ce qui permettrait à EDF de surveiller l'évolution des installations anciennes tout en exploitant les nouvelles sur des sites sécurisés. Bien entendu un partie des déchets radioactifs devront être traités et stockés,et là Bure est vital mais les volumes ne seraient pas du tout de même ampleur; Edf prendrait toutes les précautions et moyens pour être certain que les centrales à l'arrêt définitif soient d'une sécurité maximum. Leurs expèriences et leurs responsablités dans ce domaine ne peuventt laisser aucun doute sur leurs compétences.
Merci de votre attention
Réponse du 07/06/2013,
Réponse apportée par EDF :
EDF, en tant qu'exploitant, est responsable de l'ensemble du cycle de vie de ses centrales nucléaires, c'est à dire leur conception, leur exploitation et leur déconstruction, étape ultime de ce cycle. Pour la déconstruction, EDF a fait le choix d'une stratégie de déconstruction immédiate, à savoir réaliser l'ensemble des opérations pour les centrales concernées sans période d'attente. L'objectif est double : d'une part, ne pas laisser aux générations futures la charge de la déconstruction ; d'autre part, bénéficier pour la déconstruction de l'expertise et des compétences des salariés qui ont exploité la centrale et qui la connaissent très bien. Ce choix est d'ailleurs cohérent avec les préconisations de l'Autorité de Sureté Nucléaire et de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique, et conforme à la réglementation française (Arrêté INB du 7 février 2012).
Il est également important de noter que :
• La plus grande part des déchets de démantèlement dispose déjà de solutions de traitement et de stockage définitif opérationnelles. Seuls environ 0,5% des déchets produits sont des déchets radioactifs MA-VL destinés à être stockés dans Cigéo ;
• EDF provisionne dans ses comptes et place dans des fonds dédiés sécurisés les ressources financières nécessaires pour réaliser le moment venu le programme de déconstruction. Ces provisions, prévues dès la conception, sont constituées durant toute la phase d'exploitation des centrales nucléaires, et sont donc payées par les utilisateurs de l'électricité produite ;
• Dès 2001, EDF a mis en place une unité dédiée à la déconstruction, le CIDEN, Centre d'Ingénierie Déconstruction et Environnement.
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les déchets destinés à Cigéo proviennent essentiellement de l’exploitation des centrales nucléaires et du traitement des combustibles nucléaires utilisés dans ces centrales. Les déchets produits par la déconstruction des centrales nucléaires sont en grande majorité des déchets dont le niveau de radioactivité est très faible (déchets dits TFA) ou dont la durée de vie est courte (déchets dits FMA-VC). Ces types de déchets disposent déjà de solutions de gestion opérationnelles et sont stockés dans deux centres de stockage de surface exploités par l’Andra dans le département de l’Aube. Seuls, 0,5 % des déchets radioactifs produits par la déconstruction d’un réacteur nucléaire nécessitent d’être stockés dans Cigéo (il s’agit de déchets MA-VL). Ces déchets ne représenteront qu’une faible part des déchets destinés à Cigéo.
QUESTION 57 - Quels risques d'attaques terroristes ou militaires de ce site
Posée par Jc BENOIT (RENNES), le 21/05/2013
Quelles seraient les possibilités d'attaques militaires ou de terroristes kamikazes de ce site en vue de créer le maximum de dégats possibles sur notre territoire? Il y aura t -il une surveillance armée de ce site et par qui: gardiennage, armée, gendarmerie et pendant combien d'années?
Réponse du 25/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Du fait de son implantation à 500 mètres de profondeur, le stockage sera peu vulnérable aux attaques de ce type. En particulier, après sa fermeture, le stockage sera complètement inaccessible à toute agression depuis la surface. Les installations de surface, nécessaires pendant la phase d'exploitation, sont conçues pour protéger les déchets des différents risques qui peuvent survenir. Parmi ceux-ci, l'Andra prend en compte, dans ses analyses de risques, l’éventualité d’actes de malveillance : elle mettra en œuvre les dispositions appropriées (contrôle des accès, gardiennage, résistance des bâtiments…) pour assurer la protection des installations. Comme pour toute installation nucléaire, l’ensemble des dispositions prises fait l’objet d’un contrôle par le Haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère en charge de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
QUESTION 56 - Détérioration de l'infrastructure et robotique
Posée par Jc BENOIT (RENNES), le 21/05/2013
Le retour d'expérience à Fukushima montre que dans un environnement indutriel nucléaire détruit et hautement radioactif les robots ne sont plus capables d'intervenir efficacement par exemple pour faire des mesures, des soudures,ou toute intervention mécanique cela pourrait donc être bien le cas aussi sur ce site en cas de pbs graves, ou alors avons nous de biens meilleurs robots que ceux des japonais (permettez moi d'en douter)?
Réponse du 29/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les moyens de manutention et d’intervention qui seront mis en œuvre sur Cigéo se fondent sur le retour d’expérience important des exploitations nucléaires actuelles. En effet, les engins de manutention manipulant les déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité ainsi que les moyens de dépannage et d’intervention associés sont mis en œuvre dans les installations des producteurs de déchets depuis des décennies. Par ailleurs, la France a développé des compétences dans le domaine des robots d’intervention en milieux irradiants. Les sociétés AREVA, CEA et EDF, par exemple, développent en commun des robots spécifiques pour les besoins d’intervention dans leurs installations nucléaires.
Réponse apportée par AREVA :
Dans le cadre de l’exploitation et le démantèlement de ses propres installations ou de ceux de ses clients, AREVA a développé des moyens robotisés. En effet, AREVA a l'expérience des interventions robotisées en haute activité sur ses sites, que ce soit pour la maintenance des installations du cycle du combustible ou des réacteurs, ou pour les interventions de démantèlement, et donc pour réaliser des interventions de type inspection, soudure et toute autre intervention mécanique.
Grâce à cette expérience, les équipes d'AREVA, dans le cadre d'un partenariat avec le groupe japonais ATOX, spécialiste dans le domaine de l’assainissement et du démantèlement, travaillent actuellement à l'établissement et à la mise en place des scenarios d’intervention pour l’inspection des bâtiments des réacteurs accidentés.
Par ailleurs, le G.I.E. Groupe INTRA, créé par les trois principaux acteurs du nucléaire français, EDF, le CEA et AREVA est capable de déployer des équipements robotisés en cas d’accident nucléaire. Les missions du Groupe INTRA sont de 2 ordres :
- concevoir, fabriquer, exploiter et maintenir une flotte d'engins robotisés capables d'intervenir, à la place de l'homme, en cas d'accident nucléaire majeur, dans et autour des bâtiments industriels de ses membres.
- développer une expertise de l’intervention à distance, en recensant et capitalisant l’expérience des interventions réalisées au sein des entreprises ou ailleurs à l'occasion de situations incidentelles, de maintenance exceptionnelle ou d'assainissement démantèlement.
QUESTION 55
Posée par Didier RABIN (MARLY LE ROI), le 21/05/2013
Chers responsables et décideurs, comme beaucoup de Français, je suis concerné par la problématique des déchets nucléaires. Je souhaiterai suggérer une idée pour leur élimination. Pourquoi ne pas faire des "petits paquets" à satelliser sur un orbite solaire où ils disparaîtraient dans le soleil: l'astre des explosions thermonucléaires en continu ? La France et l'Europe possédent le pas de tir de Guyanne, la gamme des fusées Ariane qui ont montré leur fiabilité; reste à developper l'enveloppe de confinement adéquate des "petits paquets" qui devraient résister à un raté d'une fusée. Je ne vois pas là un défi insurmontable par la technique actuelle. Compte tenu du coût actuel annoncé du projet CIGEO et du coût connu des lancements de fusée, je pense qu'il ya un potentiel financier favorable pour développer ma suggestion. Cette méthode aussi développerait beaucoup d'emplois et dans des technologies de pointe. Elle permettrait en plus de dynamiser la recherche et l'industrie spatiale, là où il reste beaucoup à faire et qui permet encore à l'industrie de faire rêver. Déjà de par le monde des nations ont décidé de lancer des engins spaciaux avec des moteurs nucléaires (qui parfois retombent sur terre) et des recherches sont en cours pour utiliser le nucléaire comme futur moyen de propulsion des fusées. Je ne vois donc pas d'obstacle si ce n'est une volonté politique pour envoyer nos déchets dans le soleil!
Ma suggestion est-elle jugée trop farfelue pour ne pas mériter une réponse? D'avance un grand merci à la réponse qui saura m'éclaircir.
Réponse du 15/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le scénario d’un envoi dans l’espace, sur la lune ou dans le soleil des déchets radioactifs les plus dangereux a été étudié. La NASA notamment s’est penchée sur cette question dès la fin des années 70. Ce scénario n’a pas été retenu en raison du risque d’explosion de l’engin spatial au décollage ou en vol (1 accident sur 100 lancements en moyenne), qui provoquerait des retombées de poussières radioactives et contaminerait l’atmosphère. Qui plus est, les volumes de déchets concernés (80 000 m3 pour les déchets HA et MAVL destinés à Cigéo) nécessiteraient plusieurs dizaines de milliers de lancements, ce qui représenterait un coût « astronomique » pour la société (un seul lancement d’Ariane 5 coûte environ 150 millions d’euros).
QUESTION 54
Posée par Yann FLORY, COLLECTIF (RICHWILLER), le 21/05/2013
Comment croire à la réversibilité du stockage Cigeo quand la réversibilité du stockage de déchets ultimes de Stocamine à Wittelsheim (68) rendu obligatoire par la loi de 1992 n'est pas mis en oeuvre ?
Réponse du 23/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le projet Cigéo a pour but de mettre en sécurité de manière définitive les déchets français les plus radioactifs pour ne pas en transmettre la charge aux générations futures. Dans cette optique, le stockage est conçu pour être fermé à l’issue de son exploitation. En 2006, le Parlement a également demandé à l’Andra d’étudier un stockage réversible pendant au moins 100 ans. Les conditions de réversibilité seront définies dans une future loi, préalable à l’autorisation de création du Centre.
En vue du débat public, l’Andra a élaboré des propositions concernant la réversibilité. Ces propositions s’appuient sur de nombreux échanges avec les parties prenantes au niveau local (Comité local d’information et de suivi du Laboratoire de Bure, rencontres avec le public et les acteurs locaux), national (colloque scientifique interdisciplinaire à Nancy en 2009, échanges avec les évaluateurs, rencontres avec les associations) et international (projet international sous l’égide de l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’OCDE, conférence internationale de Reims en 2010).
Le retour d’expérience de Stocamine montre qu’il existe différents niveaux de récupérabilité d’un stockage, plus ou moins faciles, et que ces niveaux peuvent évoluer au fil du temps par exemple lorsque les ouvrages se sont déformés. Dans le domaine des déchets radioactifs, une échelle internationale a ainsi été mise en place pour définir différents niveaux de récupérabilité.
L’Andra étudie des concepts techniques permettant de récupérer les colis en toute sûreté. Les colis de déchets radioactifs seront placés dans des conteneurs indéformables, en béton ou en acier épais. Ils seront placés dans des tunnels avec un revêtement en béton ou en acier afin qu’ils ne se déforment pas. Des tests ont d’ores et déjà été réalisés et ont montré la faisabilité du retrait. Les tunnels de stockage seront équipés de capteurs pour suivre leur évolution dans le temps.
L’Andra propose des rendez-vous réguliers avec l’ensemble des acteurs (société civile, élus, État...) pour faire le point sur l’exploitation du stockage et les prochaines étapes. Ces discussions seront alimentées par les résultats des réexamens de sûreté et de la surveillance du stockage.
QUESTION 53 - quel serait le pire evenement possible et redouté de ce site de stockage
Posée par Jean-Christophe BENOIT (RENNES), le 20/05/2013
Quel serait, selon l'ANDRA, le pire évenement redouté pouvant arriver et résultant du stockage des déchets radio-actifs sur ce site et avec quelle probabilité et surtout quelles conséquences : pollution des cours d'eau, etc...?
PS : réponse franche et détaillée fortement souhaitée même si elle peut faire peur.
Réponse du 29/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le pire événement redouté serait la dispersion incontrôlée de radioactivité, quelle qu’en soit la cause. L’objectif même de Cigéo est de protéger l’homme et l’environnement contre ce risque.
Selon le principe de défense en profondeur, pour éviter toute dispersion incontrôlée, l’objectif dès le début de la conception de Cigéo est d’identifier l’ensemble des défaillances et des agressions potentielles d’origine interne (chute, collision, incendie, explosion…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourrait remettre en cause le confinement des colis de stockage. Pour chaque défaillance et agression, l’Andra met en place un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles. Ainsi, conformément à la demande formulée par l’Autorité de sûreté nucléaire, l’Andra conçoit Cigéo de sorte que l’on puisse exclure un accident de grande ampleur, comme l’incendie d’un grand nombre de colis dans une alvéole.
Malgré ces dispositions, selon le même principe de défense en profondeur, les situations accidentelles sont envisagées, pour vérifier que les conséquences en termes radiologiques restent limitées. Au stade actuel de la conception et de l’analyse des risques, les accidents les plus significatifs qui pourraient conduire à une dispersion de la radioactivité sont la chute d’un colis de déchets, une collision ou un départ de feu sur un engin de transfert transportant un colis. Cela s’explique par la nature des activités nucléaires de Cigéo qui sont principalement de la manipulation de colis de déchets.
Ainsi, la situation la pire en termes de conséquences proviendrait de l’accumulation des nombreuses défaillances successives suivantes :
- un départ de feu malgré la minimisation des matériaux inflammables dans l’installation;
- une détection tardive du fait d’une défaillance du réseau de surveillance;
- un système d’extinction inopérant;
- une intervention des pompiers retardée ou empêchée, malgré la présence d’engins de secours disposés dans l’installation;
- la perte de confinement d’un colis de déchets malgré la protection apportée par le conteneur de stockage.
Ceci engendrerait alors un rejet incontrôlé de particules radioactives à l’extérieur de Cigéo. L’évaluation réalisée, à ce stade de la conception, de l’impact d’un tel scénario hautement improbable montre que ses conséquences resteraient limitées, et nettement en deçà du seuil réglementaire qui impose la mise à l’abri des populations (10 millisieverts).
QUESTION 52 - gestion du site de stockage
Posée par Jean-Christophe BENOIT (RENNES), le 20/05/2013
Si l'espèce humaine venait à disparaitre brutalement: guerre nucleaire, choc d'asteroïde géant, etc (pouvons-nous l'exclure ?) Que se passerait-il en cas de problèmes type incendie, fuite de dechets, etc... sur le site?
Réponse du 05/06/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Cigéo est conçu pour protéger l’homme et l’environnement à la fois pendant la période d’exploitation et sur le très long terme (plusieurs centaines de milliers d’années). Il est ainsi placé à 500 mètres de profondeur ce qui permet de mettre les déchets à l’abri des activités humaines et des évènements naturels de surface. Après la fermeture du stockage, la sûreté est assurée de manière passive sans nécessiter une action humaine. Cela repose sur la conception du stockage et plus particulièrement sur le choix de la couche d’argile qui sert de barrière naturelle.
Si une catastrophe planétaire venait à intervenir durant la période d’exploitation, le stockage souterrain serait globalement moins vulnérable que les installations de surface dans lesquelles les déchets sont aujourd’hui entreposés. Par contre, le stockage n’étant pas encore fermé, le niveau de protection maximal visé par le stockage ne serait pas atteint. Après la fermeture, le stockage serait relativement à l’abri de telles catastrophes du fait de son éloignement de la surface.
En tout état de cause, si une explosion nucléaire ou un astéroïde géant venaient à avoir une incidence jusqu’à un stockage situé à 500 mètres de profondeur… il y a fort à penser que la planète ferait face à d’autres conséquences plus terribles.
QUESTION 51
Posée par Jean-Jacques RETTIG (LA BROQUE), le 21/05/2013
- Pourrait-il être décidé de ne plus produire de nouveaux déchets radioactifs d'ici 5 ans, par exemple ?
Je souhaite surtout recevoir une réponse claire et nette à mes deux questions. Merci.
Réponse du 20/06/2013,
Réponse apportée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
En France, le nucléaire occupe une place prépondérante dans le mix électrique, assurant près de 75% de la production française d’électricité. Compte tenu de la durée nécessaire à la construction de moyens de production d’électricité de substitution, un arrêt à court terme de l’ensemble du parc nucléaire n’est pas envisageable sans remettre en cause l’approvisionnement électrique du pays, c’est à dire sans coupures très importantes d’électricité pour les consommateurs. Il apparaît donc extrêmement difficile de ne plus produire de nouveaux déchets radioactifs provenant de l’industrie électronucléaire à très court terme.
En matière de mix électrique, le Président de la République a fixé le cap suivant pour la France : réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% d'ici 2025. Parallèlement, le Président de la République a indiqué que la transition énergétique serait fondée sur deux principes : l'efficacité énergique d'une part, et la priorité donnée aux énergies renouvelables d'autre part. Cette mutation prendra du temps – trois quinquennats – et supposera des étapes d’évaluation en fonction des progrès technologiques et scientifiques et des prix relatifs de chaque source d’énergie.
L’ensemble des déchets radioactifs (qui sont en partie destinés au projet Cigéo et en partie à d’autres centres de stockage) proviennent de plusieurs secteurs d’activité :
- l’industrie électronucléaire (59%) ;
- la recherche (26%) : recherche sur le nucléaire civil, mais aussi des laboratoires de recherche médicale, de physique de particules, d’agronomie, de chimie ;
- la Défense (11%) : activités liées à la force de dissuasion, dont la propulsion de certains navires ;
- l’industrie non électronucléaire (3%) : extraction de terres rares, fabrication de sources scellées, contrôle de soudures, stérilisation de matériel médical, stérilisation et conservation de produits alimentaires ;
- le secteur médical (1%) : activités thérapeutiques (soins pour les cancers, etc.), de diagnostic et de recherche.
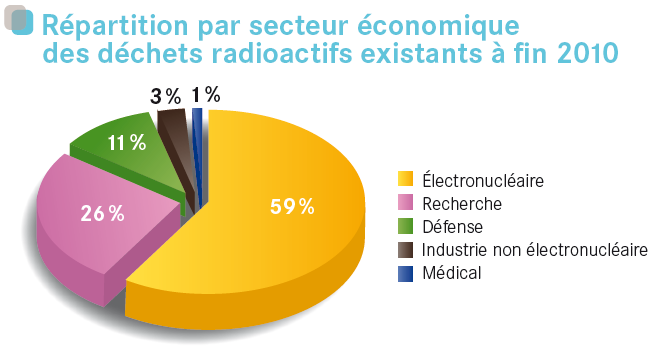
Source : Edition 2012 de l'Inventaire national - Andra
Par conséquent, même dans l’hypothèse d’un arrêt de toutes les centrales nucléaires, il apparaît impossible ne plus produire de déchets radioactifs du fait de l’usage de substances radioactives par des secteurs qui ne sont pas en liens avec la production électronucléaire.
QUESTION 50
Posée par Jacky DUHAUT (METZ), le 23/07/2013
Si le débat sur la transition énergétique entraine des fermetures de centrales nucléaires, le volume de stockage prévu dans CIGEO va-t-il augmenter? De combien? La durée de vie du site risque-t-elle d'évoluer? Merci
Réponse du 28/10/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Cigéo est conçu pour mettre en sécurité définitive les déchets les plus radioactifs déjà produits ou en cours de production par les installations nucléaires existantes. L’Andra a vérifié que l’architecture de Cigéo serait suffisamment flexible pour s’adapter aux différents scénarios envisagés dans le cadre du débat national sur la transition énergétique. Les conséquences de ces scénarios sur la nature et le volume de déchets sont présentés dans un document réalisé par l’Andra et les producteurs de déchets à la demande du ministère en charge de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (../docs/rapport-etude/20130705-courrier-ministere-ecologie.pdf). Suivant les scénarios, l’emprise de l’installation souterraine de Cigéo varierait entre 15 et 25 km2. En revanche, Cigéo n’est pas conçu pour gérer les déchets qui seraient produits par un éventuel futur parc de réacteurs.
Compte tenu des volumes de déchets déjà produits, les premières modifications sur Cigéo induites par un changement de politique énergétiques n’interviendraient qu’à l’horizon 2070/2080, et la durée d’exploitation de Cigéo ne serait pas modifiée.
QUESTION 48 - le moindre mal
Posée par Anne JORDAN (PLOERDUT), le 19/05/2013
ARRÊTER de produire des déchets, voilà pour l'instant la seule voie digne d'adhésion! On voit bien que les "solutions " proposées ne tiennent compte ni des réalités géologiques, ni des risques inhérents à toute activité humaine, ni de l'opinion publique ni du respect des générations futures.
Réponse du 15/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Quelles que soient les décisions qui seront prises en matière de politique énergétique, plus de 40 000 m3 de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue sont déjà produits et entreposés provisoirement dans des bâtiments à La Hague (Manche), Marcoule (Gard), Cadarache (Bouches-du-Rhône), dans l’attente d’une solution de gestion définitive.
Ce sont justement les réalités géologiques qui ont conduit à envisager le stockage profond. La profondeur du stockage, sa conception et son implantation dans une roche argileuse imperméable et dans un environnement géologique stable permettront de mettre les déchets à l’abri des activités humaines et des évènements naturels de surface et d’isoler les déchets sur de très longues échelles de temps. La roche argileuse étudiée en Meuse/ Haute-Marne au moyen du Laboratoire souterrain est stable depuis plusieurs dizaines de millions d’années. Elle possède des propriétés qui permettent le confinement des radionucléides à très long terme : circulation de l’eau très lente, capacité de rétention, épaisseur…
Cigéo est conçu pour protéger l’homme et l’environnement du danger que représentent les déchets radioactifs. Pour cela, dès la conception du stockage, les risques sont caractérisés et les installations sont dimensionnées pour y résister, suivant les règles définies par l’Autorité de sûreté nucléaire : séisme, inondation, conditions climatiques extrêmes (vent, neige, pluie, foudre…), chute d’avion, environnement industriel (voies de circulation, présence d’autres installations présentant des risques…), malveillance, chute de colis, incendie, explosion…
C’est bien le respect des générations futures qui a conduit le Parlement à retenir le stockage profond comme solution de référence pour la gestion des déchets les plus radioactifs, afin de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations futures. Le Parlement a également demandé que le stockage soit réversible pendant 100 ans au moins. Cela permet de laisser des choix aux générations suivantes : en fonction de l’expérience acquise lors de l’exploitation de Cigéo et des progrès scientifiques et technologiques, elles seront libres de décider du devenir de Cigéo, en particulier de son calendrier de fermeture, voire de remonter en surface des déchets.
La création de Cigéo n’est pas décidée. Le débat public est l’occasion de permettre à chacun de s’exprimer sur le projet présenté par l’Andra. Les conclusions du débat public seront prises en compte par l’Andra dans la poursuite des études.
QUESTION 47 - Vitrification-Réversibilité
Posée par Clément CAMINCHER (GRENOBLE), le 18/05/2013
On parle souvent de déchets scellés, vitrifiés dans des colis hermétiques... Si un jour on arrivait à développer des techniques d'éliminations des isotopes radioactifs, pourrait-on ré-extraire ces éléments des colis? Savons-nous déjà le faire ?
Réponse du 15/07/2013,
Réponse apportée par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) :
Si le verre a été choisi comme matrice pour les déchets de haute activité, c’est justement pour ses propriétés de confinement, c’est-à-dire son aptitude à incorporer les radionucléides qu’ils contiennent et à les immobiliser durablement. L’ensemble des études menées par le CEA a prouvé la très bonne résistance de la matrice vitreuse à l’altération sur des temps très longs. De ce fait, il est extrêmement difficile de ré-extraire les éléments radioactifs sans refondre le verre à haute température, ce qui est loin d’être réalisable techniquement parlant. De ce fait, il n’est à ce jour pas envisagé de récupérer les radionucléides contenus dans les déchets une fois vitrifiés.
QUESTION 46 - Usure et pannes sur les appareils destinés au placement des colis
Posée par Sandro TOMASSETTI (LES ISLETTES), le 18/05/2013
Comment seront traitées, l'usure et les pannes pouvant affecter les dispositifs robotisés qui devront permettre de placer les colis dans les alvéoles de stockage? En particulier pour les colis de déchets de haute activité.
Réponse du 07/06/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
A l’instar des installations nucléaires existantes, la problématique liée aux pannes des systèmes automatisés est traitée par la redondance de certains composants sensibles ou par la mise en place de moyens d’intervention spéciaux. La redondance consiste en un doublement des composants dont la simple défaillance pourrait entraîner un dysfonctionnement ou un blocage de la manutention. Dans certain cas, si cette redondance n’est pas possible, n’est pas suffisante ou rend la machine trop complexe, des moyens et/ou des outillages spéciaux extérieurs au système sont alors privilégiés (robots d’intervention, appareils de manutention…). Pour les colis de stockage de déchets HA, le robot pousseur permettant leur stockage est conçu de manière à ce que le câble assurant son alimentation électrique permette de le tracter en dehors de l’alvéole en cas de panne.
En ce qui concerne l’usure des composants, elle est traitée selon plusieurs axes :
- Des contrôles périodiques des équipements tout au long de l’exploitation du stockage afin d’anticiper les problèmes par une maintenance préventive adaptée.
- La mise en place de capteurs ou de mesures au niveau des engins capables d’informer l’exploitant sur l’ensemble des paramètres de fonctionnement afin d’effectuer un pré-diagnostic en temps réel des conditions de fonctionnement de l’équipement. Ceci avant que l’usure soit dommageable au bon déroulement du cycle de stockage (température du moteur électrique par exemple).
QUESTION 45
Posée par Stéphane LE GOASTER (CHAUMONT), le 17/05/2013
Non au nucléaire. Oui à la sobriété énergétique.
Pourquoi ne pas apprendre à tous à dépenser beaucoup moins d'énergie (cycle de vie complet des produits et en services) avec une partie des milliards consacrés à la promotion et construction des centrales nucléaires et des centres d'enfouissements en France?
Réponse du 20/06/2013,
Réponse apportée par le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Quelles que soient les orientations en matière de politique nucléaire, les déchets déjà produits devront être gérés de façon sûre et responsable. Il est par conséquent nécessaire de consacrer de l’argent à la construction et à l’exploitation des centres de stockage. En vertu de la loi, ces sommes qui ont été mises de côté par les producteurs de déchets ne peuvent pas être détournées à d’autres fins. Cela conduirait à reporter intégralement sur les générations futures les charges de long terme liées à la gestion des déchets radioactifs.
S’agissant des choix d’investissement dans la production ou les économies d’énergie, le Président de la République a rappelé, lors du conseil de politique nucléaire du 28 septembre 2013, que le réacteur EPR de Flamanville, dont la construction est avancée, serait le seul réacteur mis en service durant ce quinquennat. Il a également décidé d’engager la transition énergétique, cette transition reposant d'une part sur la sobriété et l’efficacité énergétique et d'autre part sur la diversification des sources de production d’énergie. C’est à l’issue du débat national sur la transition énergétique engagé le 29 novembre 2012 que sera fixée la façon la plus pertinente économiquement et écologiquement et la plus juste socialement d’engager cette transition énergétique.
QUESTION 44
Posée par Françoise MASSON (VARENNES), le 17/05/2013
Trajet de l'acheminement des déchets?
Réponse du 11/06/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les modalités d’acheminement des colis de déchets depuis les sites où ils sont entreposés jusqu’à Cigéo sont étudiées par les producteurs de déchets (Areva, CEA et EDF). Le transport des colis par voie ferroviaire est privilégié. Le réseau ferré national permet d’acheminer les convois jusqu’à proximité de Cigéo. Différents itinéraires sont étudiés depuis les sites où sont entreposés les colis de déchets (voir carte).
La desserte locale de Cigéo est étudiée dans le cadre du schéma interdépartemental de développement du territoire. L’arrivée et le déchargement des trains se ferait dans un terminal ferroviaire spécifique. Deux options sont possibles :
- Soit le terminal ferroviaire est implanté sur une voie ferroviaire existante en Meuse ou en Haute-Marne. Le transport final jusqu’à Cigéo serait alors réalisé par voie routière.
- Soit le terminal ferroviaire est implanté sur le site même de Cigéo, ce qui nécessiterait de créer un raccordement ferroviaire d’environ 15 km.

QUESTION 43
Posée par Michel DUC (MONTILS - 17), le 17/05/2013
Bonjour,
Critiquer est trop simple, que ce soit l'enfouissement ou tout autre système de stockage, seul le temps aura le dernier mot. Par contre, je fais la proposition suivante, en corrélation avec mon niveau de connaissances en la matière. A l'origine, tout élément minéral n'était que lave en fusion. Serait-il possible de rendre à notre bonne vieille terre ce qui lui appartient ? Le magma devrait avoir tôt fait de "digérer" et dissoudre ces déchets irradiants ; de nombreux "points d'accès" existent de par le monde, par les cratères des volcans actifs. C'est une simple idée, qui a le mérite d'exister, et loin de moi l'idée de prétendre à être le seul à l'avoir eu. Je serais intéressé par les études menées dans ce sens.
Merci
Réponse du 07/06/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Enfouir les colis de déchets dans le magma se heurterait à des difficultés techniques majeures. En effet, il faudrait réaliser des forages tubés jusqu’à des profondeurs de plusieurs kilomètres, donc avec des températures et des pressions très élevées (plusieurs centaines de degrés Celsius et plusieurs milliers de bars), ce que les techniques actuelles ne permettent pas. De plus, la réalisation d’un seul de ces forages prendrait plusieurs années. A titre d’exemple, on peut citer le forage profond de la presqu’île de Kola (Russie) qui a commencé en 1970 et a dû être stoppé à 12 262 mètres de profondeur (au lieu des 15 000 m prévus) en 1989 : les difficultés techniques rencontrées y ont été très nombreuses du fait de la profondeur, des fortes pressions et températures, et surtout des très fortes contraintes de torsion exercées sur les tiges de forage.
Si l’on envisageait de mettre les colis de déchets dans des cratères de volcans actifs, la lave, après les avoir fondus, pourrait toujours les renvoyer en surface lors d’une éruption. Elle disperserait alors largement la radioactivité dans l’environnement. Il s’agit donc d’une solution pour laquelle nous n’avons aucune possibilité de contrôle et de prévision des conséquences.
La dernière possibilité serait au niveau des zones de subduction. Cette solution, imaginée à la fin des années 1970, a été très tôt éliminée pour plusieurs raisons. Les vitesses de subduction sont de l’ordre de quelques centimètres par an (8 à 10 cm/an au maximum). Comment être certain d’envoyer des colis de déchets suffisamment près de la zone de subduction à très grande profondeur (souvent 10 000 mètres ou plus) pour qu’ils soient « absorbés » assez rapidement ? Si les colis de déchets sont pris dans la gigantesque zone broyée, que constitue la zone de subduction, ils seront eux-mêmes écrasés et détruits, et relâcheront leur radioactivité avant de passer sous la plaque continentale. S’ils restent au fond des océans, ils seront progressivement corrodés et libéreront progressivement leur radioactivité. Nous n’aurions donc aucun moyen de surveillance et de contrôle de leur devenir.
Enfin, d’un point de vue juridique, en 1993, les signataires de la convention de Londres ont décidé d’interdire l’immersion de tout type de déchets radioactifs dans la mer ; cette décision se fondait sur des critères moraux, sociaux et politiques.
QUESTION 42 -
Posée par Anne-Sophie JEAN (SAUDRON), le 20/06/2013
Semble t-il logique d'installer l'usine Syndièse classée seveso à 1 km à vol d'oiseau de l'entrée du stockage cigéo et le village de Saudron au milieu ? Quel avenir pour notre commune ?
Réponse du 30/09/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Garantir la protection des populations riveraines est l’objectif fondamental des études menées par l’Andra pour la conception du stockage. Ainsi, pour être autorisé à construire Cigéo, l'Andra doit démontrer à l’Autorité de sûreté nucléaire que les risques engendrés par l’installation sont maîtrisés, en particulier vis-à-vis de la commune de Saudron.
Comme pour toute installation nucléaire, l’implantation et le dimensionnement des installations de surface de Cigéo (périmètre de sécurité, résistance des bâtiments…) tiennent compte des risques présentés par son environnement industriel (installations existantes ou prévues comme c’est le cas de Syndièse).
Réponse apportée par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) :
Syndièse est un projet de construction d’un démonstrateur BtL – « Biomass to Liquid » - de production de biocarburants de 2ème génération sur le site de Bure-Saudron. Il vise à démontrer la faisabilité technique et économique d’une chaîne complète de production BtL, sur un site unique, depuis la collecte de la biomasse jusqu’à la synthèse de carburant. Le choix du site de Bure-Saudron, pour son implantation, s'inscrit dans les engagements pris en 2006 par les acteurs de la filière nucléaire, d’accompagner le développement économique des territoires qui accueillent le laboratoire de recherche sur le stockage des déchets nucléaires en couche géologique profonde.
Toutes les dispositions concernant le suivi et la mise en œuvre des règlementations associées aux aspects sécurité, environnement et sanitaire seront prises et respectées.
En outre, cette installation doit créer à terme environ 80 emplois directs ce qui va participer à la revitalisation du tissu local en termes d’emplois indirects créés et des infrastructures nécessaires pour les accueillir. De plus, la mise en place d’un plan d’approvisionnement en biomasse adapté, environ 125 000 tonnes de biomasse annuelle, va permettre de valoriser la ressource locale.
Réponse apportée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
EDF, le CEA et AREVA mènent une politique active en faveur du développement économique local. Cela comprend notamment l’implantation de nouvelles installations, créatrices d’emploi et de valeur ajoutée pour le territoire.
Le projet de démonstrateur industriel SYNDIESE porté par le CEA s’inscrit dans cette démarche d’accompagnement. Il relève de deux objectifs:
- tester la production de bio-carburants de 2ème génération à partir d'une ressource biomasse, dans un procédé mis au point par le CEA dans sa stratégie de diversification des ressources énergétiques
- tester la viabilité de l'équipement industriel et des conditions d'approvisionnement de biomasse dans un territoire sylvestre et rural (dans une structuration de la filière bois sans conflits d'usages).
L’installation Syndièse devra respecter la réglementation en vigueur et fonctionner dans des conditions de sécurité accrues, en tenant compte de sa proximité avec le projet de stockage et le village de Saudron.
QUESTION 41
Posée par Pascale VINCENT, CITOYEN DU MONDE (DOMRÉMY), le 16/05/2013
Il est possible d'arrêter toutes les centrales nucléaires en France dès aujourd'hui en changeant un tout petit peu nos habitudes. Le Japon nous le prouve depuis 2 ans avec seulement 2 réacteurs en fonction sur les 54 existants. Alors pourquoi nos dirigeants ne prennent-ils pas la décision d'arrêter les centrales nucléaires, au constat de l'importance du danger de la production, du danger de l'enfouissement ou de toute autre gestion des déchets ? Pourquoi les déchets continuent-il à être produits ?
Réponse du 20/06/2013,
Réponse apportée le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
Le Président de la République a décidé d’engager la transition énergétique, cette transition reposant d'une part sur la sobriété et l’efficacité énergétique, et d'autre part sur la diversification des sources de production et d'approvisionnement.
Concernant la diversification de nos sources d’énergies, le Président de la République a fixé un cap : réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% d'ici 2025. Parallèlement, le Président de la République a indiqué que la transition énergétique serait fondée sur deux principes : l'efficacité énergétique d'une part, et la priorité donnée aux énergies renouvelables d'autre part. Cette mutation prendra du temps et supposera des étapes d’évaluation en fonction des progrès technologiques et scientifiques et des prix relatifs de chaque source d’énergie.
Pour le quinquennat, le Président de la République a pris quatre engagements en cohérence avec cette perspective : la plus ancienne de nos centrales – Fessenheim – sera arrêtée ; le chantier du réacteur EPR de Flamanville sera conduit à son terme ; le système de traitement – recyclage des combustibles usés et la filière qui l’accompagne seront préservés ; aucune autre centrale ne sera lancée durant ce mandat.
Un arrêt immédiat de l’ensemble du parc nucléaire français n’est pas envisageable sans remettre en cause l’approvisionnement électrique du pays. La France ne dispose pas de moyens de production alternatifs capables de se substituer intégralement au parc nucléaire dès aujourd’hui.
La situation du Japon diffère sensiblement de celle de la France. En effet, avant l’accident de Fukushima, la part de nucléaire dans le mix électrique japonais était de l’ordre de 27%. Elle était en France de près de 75% en 2012, soit près de trois fois plus en proportion.
A la suite de l’accident de Fukushima, le Japon a fait face à la situation d’arrêt de ses réacteurs nucléaires en augmentant le recours au gaz et en demandant des efforts importants aux particuliers et aux entreprises.
En effet, le Japon a remis en service d’anciennes centrales thermiques pour soutenir la production d’électricité et fait fonctionner intensément son parc thermique. Ainsi, selon les données de l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE), la production d’électricité des centrales thermiques est passée de 680 TWh en 2009 à 880 TWh en 2012, soit une production additionnelle d’environ 200 TWh, compensant une large majorité des 274TWh que produisait le parc nucléaire japonais avant l’accident de Fukushima. La demande gazière japonaise s’est ainsi accrue de près de 30 % entre 2010 et 2012, dégradant fortement la balance commerciale japonaise.
QUESTION 40
Posée par Dominique PÉAN (26410 MENGLON), le 16/05/2013
Nous avons découverts de magnifiques grottes avec des peintures rupestres, nos anciens nous ont laissés un certains nombres de présents, et nous qu'allons-nous laisser aux générations futures: des poubelles de toutes sortes, et plus précisément radio-actives en avons-nous le droit. Je pense que la recherche devrait payer des "trouveurs" pour anéantir ces déchets et non les enfouir
Réponse du 05/06/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Depuis plus de 20 ans, des recherches sont menées en France et à l’étranger concernant les techniques de séparation et de transmutation des éléments à vie longue présents dans les déchets radioactifs. Le principe consiste dans une première étape à séparer les différents radionucléides contenus dans les déchets les uns des autres. Une seconde étape vise ensuite à transformer par une série de réactions nucléaires, les radionucléides à vie longue en radionucléides à vie plus courte. Les résultats des recherches menées notamment par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) montrent que la séparation/transmutation ne supprime pas la nécessité d’un stockage profond car elle ne serait applicable qu’à certains radionucléides contenus dans les déchets (ceux de la famille de l’uranium). Par ailleurs, les installations nucléaires nécessaires à la mise en œuvre d’une telle technique produiraient des déchets qui nécessiteraient aussi d’être stockés en profondeur pour des raisons de sûreté. Il n’est donc pas possible « d’anéantir » ou de faire disparaître ces déchets radioactifs. Le stockage permet de protéger l’homme et l’environnement des déchets radioactifs sur le très long terme et évite de reporter la charge de leur gestion sur les générations futures.
Plus de renseignements : Les rapports de recherche - Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) - Dossier 2012 – Tome 2 – Séparation-transmutation des éléments radioactifs à vie longue ../informer/documents-complementaires/rapports-autorites-evaluations-ponctuelles.html
QUESTION 39
Posée par Valéry KERGROACH (LORIENT), le 15/05/2013
Je suis radicalement contre ce projet. C 'est de la folie pure. Sommes nous certains des risques? Les avons nous tous évalués? Et si....? Les générations à venir seront concernées et ne nous pardonneront pas.
Réponse du 15/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les déchets radioactifs destinés à Cigéo sont des déchets dangereux, qui le resteront plusieurs dizaines à centaines de milliers d’années. Le seul et unique objectif du stockage profond est de protéger l’homme et l’environnement de ces déchets sur de très longues durées.
La sûreté est au cœur du projet Cigéo. L’ensemble des risques est caractérisé et l’installation est dimensionnée en conséquence pour garantir une sûreté maximale. L’Andra doit démontrer qu’elle maîtrise tous ces risques pour que la création de Cigéo puisse être autorisée. Par ailleurs, si Cigéo est autorisé, sa construction se fera de manière très progressive pour contrôler toutes les étapes de son développement. Tout ceci se fait sous le contrôle d’évaluateurs scientifiques et de sûreté indépendants, notamment la Commission nationale d’évaluation et l’Autorité de sûreté nucléaire qui orientent les travaux de l’Andra. L’avis des évaluateurs est rendu public.
Le stockage sera réversible pendant au moins 100 ans. Cela permet de laisser des choix possibles aux générations suivantes : en fonction de l’expérience acquise lors de l’exploitation de Cigéo et des progrès scientifiques et technologiques, elles seront libres de décider du devenir de Cigéo, en particulier de son calendrier de fermeture, voire de remonter en surface des déchets.
Derrière ce projet, ce sont des hommes et des femmes, de l’Andra mais également d’autres institutions ou organismes de recherche, en France et à l’étranger, qui s’investissent de manière responsable depuis plus de 20 ans avec un seul et même objectif : développer les solutions les plus sûres pour nos enfants, nos petits-enfants et les générations futures. Est-ce de la folie pure de permettre aux générations suivantes, si elles le souhaitent, de mettre définitivement en sécurité ces déchets très radioactifs et ne pas reporter indéfiniment le poids de leur gestion sur les générations futures ? A l’inverse, comment les générations futures nous jugeront-elles si nous leur laissons la gestion de nos déchets, sans possibilité de choix ?
QUESTION 38
Posée par Hervé GOUJON (42), le 15/05/2013
Si les déchets nucléaires étaient mis au centre de la terre, dans le magma qui doit lui-même l'être un peu, cela ne serait-il pas la solution de traitement la plus naturelle ? Il y a je crois dans certains fonds de mer des zones de subduction qui "avalent" à l'échelle des millénaires tout ce qui s'y trouve pour l'engloutir vers le centre de la terre. Est-ce in-envisageable ?
Réponse du 07/06/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le magma qui constitue le manteau au centre de la Terre est effectivement radioactif. Les zones de subduction ont été imaginées comme solution à la fin des années 1970. Cette proposition a très tôt été éliminée pour plusieurs raisons.
Les vitesses de subduction sont de l’ordre de quelques centimètres par an (8 à 10 cm/an au maximum). Comment être certain d’envoyer des colis de déchets suffisamment près de la zone de subduction à très grande profondeur (souvent 10 000 mètres ou plus) pour qu’ils soient « absorbés » assez rapidement ? Si les colis de déchets sont pris dans la gigantesque zone broyée, que constitue la zone de subduction, ils seront eux-mêmes écrasés et détruits, et relâcheront leur radioactivité avant de passer sous la plaque continentale. S’ils restent au fond des océans, ils seront progressivement corrodés et libéreront progressivement leur radioactivité. Nous n’aurions donc aucun moyen de surveillance et de contrôle de leur devenir.
Enfin, d’un point de vue juridique, en 1993, les signataires de la convention de Londres ont décidé d’interdire l’immersion de tout type de déchets radioactifs dans la mer ; cette décision se fondait sur des critères moraux, sociaux et politiques.
QUESTION 37 - Participation à la réunion publique du 23/09/2013 à Paris
Posée par Gabriella SALZANO (NEUILLY / SEINE), le 17/05/2013
Bonjour,
Je suis enseignant-chercheur à l'Université Paris Est Marne-la-Vallée. Pour mes activités de recherche, je souhaiterai participer à la réunion publique sur les Expériences Internationales, qui aura lieu à Paris le 23/9/2013, dans le cadre du débat public sur le projet Cigéo. Or, le site ../actualite/calendrier_view.html?id=13 ne permet pas d'inscriptions et le lien "Contact" indique Rubrique en cours de réalisation. Pourriez-vous SVP avoir la gentillesse de m'indiquer comment procéder pour réaliser mon inscription à cette réunion ?
En vous remerciant d'avance, bien cordialement.
Réponse du 11/06/2013,
Les réunions publiques sont, par principe, ouvertes à tous. Il n'est pas nécessaire de vous inscrire.
QUESTION 36 - Pourquoi enfouir les déchets quand on pourrait les bruler
Posée par John LAURIE, HTTP://ENERGIEDUTHORIUM.FR (VERSAILLES), le 16/05/2013
Nous avons des déchets à vie longue à cause des réacteurs actuels qui utilisent un combustible solide. Avec un combustible LIQUIDE on peut filtrer pour extraire uniquement les produits de fission. Les actinides peuvent retourner dans le réacteur pour fissioner et produire de l'énergie. Nous pouvons résoudre le problème des déchets avec un changement de technologie. Ce sera beaucoup moins cher que de tout enfouir
Réponse du 21/06/2013,
Réponse apportée par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) et Edf :
Il existe en effet un concept de réacteur dit "à sels fondus" dans lequel le combustible est sous forme liquide. Ce type de technologie permettrait de séparer les produits de fission des actinides, ces derniers pouvant effectivement être de nouveau fissionnés en réacteur pour produire de l'énergie.
Ce concept de réacteur fait partie de la famille des réacteur dits de 4ème génération, qui font l'objet actuellement d'études et recherches au niveau international. La faisabilité technique et industrielle d’un réacteur dit "à sels fondus" de 4ème génération, n'est pas aujourd'hui démontrée et son déploiement industriel n'est donc pas envisagé en France actuellement.
Leur fonctionnement génèrerait également des produits de fission et des produits d'activation, dont certains à vie longue qui consistueraient des déchets pour lesquels le stockage profond serait la solution de gestion à long terme.
Enfin, l'éventuel déploiement de réacteurs de ce type ne supprimera pas la nécessité de disposer d'une solution pour les déchets à vie longue déjà produits qui représentent actuellement plus de la moitié des déchets radioactifs à stocker dans Cigéo.
QUESTION 35
Posée par Dominique GHESQUIERE (COMMERCY), le 16/05/2013
Le choix du site étant réalisé depuis 1998 par le gouvernement, est-il (ou non) envisageable de le remettre en question en fonction des débats. Ce choix est-il aujourd'hui absolument définitif?
Réponse du 13/06/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le choix du site de Meuse/Haute-Marne a été le fruit d’un processus décisionnel de plusieurs années s’appuyant notamment sur de nombreuses études scientifiques et sur une large démarche de concertation. En effet, suite au vote de la loi de 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, des recherches ont été menées en France pour étudier les possibilités de stockage dans les formations géologiques profondes. Plusieurs sites se sont portés candidats et ont été étudiés sur le plan géologique, dont les départements de Meuse et de Haute-Marne. L’Andra a déposé en 1996 trois demandes de création de laboratoires souterrains. En 1999, après avis des évaluateurs scientifiques, consultation des collectivités locales et enquêtes publiques, le Gouvernement a autorisé l’Andra à construire un laboratoire souterrain à la limite des deux départements de Meuse et de Haute-Marne pour étudier la couche d’argile dans laquelle est aujourd’hui envisagée l’implantation de Cigéo. En s’appuyant sur l’ensemble des recherches menées depuis une vingtaine d’années, l’Andra a montré que le site étudié en Meuse/Haute-Marne présente des caractéristiques favorables pour assurer la sûreté à long terme du stockage. La Commission nationale d’évaluation mise en place par le Parlement pour évaluer sur le plan scientifique les travaux de l’Andra souligne ainsi dans son rapport 2012 : « le site géologique de Meuse/Haute-Marne a été retenu pour des études poussées, parce qu’une couche d’argile de plus de 130 m d’épaisseur et à 500 m de profondeur, a révélé d’excellentes qualités de confinement : stabilité depuis 100 millions d’années au moins, circulation de l’eau très lente, capacité de rétention élevée des éléments ».
La loi du 28 juin 2006 a fait le choix du stockage réversible profond pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations futures. Elle demande à l’Andra d’étudier et d’implanter Cigéo en stipulant que « la demande d'autorisation de création [d’un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs] doit concerner une couche géologique ayant fait l'objet d'études au moyen d'un laboratoire souterrain ». L’Andra poursuit donc ses études en vue d’élaborer pour 2015 le dossier support à l’instruction de la demande d’autorisation de création de Cigéo en Meuse/Haute-Marne, dans la couche d’argile dont les propriétés de confinement sont désormais reconnues.
La décision d’autoriser ou non la création de Cigéo en Meuse/Haute-Marne n’est cependant pas encore prise. Elle reviendra à l’État après l’évaluation du dossier remis par l’Andra en 2015 par l'Autorité de sûreté nucléaire et la Commission nationale d'évaluation, l’avis des collectivités territoriales, le vote d’une nouvelle loi fixant les conditions de réversibilité et une enquête publique. S’il était décidé d’étudier un autre site d’implantation pour le stockage, cela impliquerait de reprendre l’ensemble du processus de recherche de site, de caractérisation par un laboratoire souterrain et de conception d’un stockage adapté à ce nouveau site, ce qui impliquerait de repousser le calendrier prévu par la loi pour la création du Centre.
QUESTION 34 - Subventions financières et communes concernées
Posée par Jc BENOIT (RENNES), le 24/06/2013
Peut-on savoir quelles communes vont bénéficier financièrement de ce projet de stockage et pour quels montants et sur quelle durée ?
Quelles sont les communes les plus proches qui ne bénéficieront pas financièrement de ce projet et pourquoi ?
Réponse du 09/09/2013,
Réponse apportée par le ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie :
Fiscalité liée au Laboratoire de recherche et au Centre technologique de l’ANDRA
Le laboratoire de recherche et le Centre Technologique de l’Andra sont soumis à la fiscalité de droit commun (taxes foncières et contribution économique territoriale qui remplace aujourd’hui la taxe professionnelle) comme toutes les entreprises. La taxe foncière est due pendant toute la durée de vie des biens immobiliers, la contribution foncière des entreprises pendant toute la durée de vie de l’activité professionnelle de l’établissement.
Cette fiscalité de droit commun générée par le laboratoire et le Centre Technologique de Saudron est majoritairement reversée aux collectivités locales après les mécanismes de péréquations prévues par la loi (chiffres 2010) :
- communes : environ 1.2 M€ ;
- communautés de communes : environ 1.5 M€ ;
- conseil général de la Meuse : environ 2.4 M€
Environ 0.1 M€ ont été versés à la région de la Lorraine.
Conformément à la réglementation, une partie de cette fiscalité est reversée à l’établissement public foncier local de Lorraine (environ 0,1M€) et à la chambre de commerce et d’industrie de région (environ 0,1 M€).
D’autre part, des taxes payées par les producteurs de déchets radioactifs sont reversées à la Meuse et Haute-Marne afin d’accompagner le développement du territoire dans le cadre du laboratoire souterrain et dans le futur du projet Cigéo. Il s’agit des taxes d’accompagnement et de diffusion technologique qui sont gérées par deux groupements d’intérêt public (GIP) en Meuse et en Haute Marne, afin de réaliser les actions suivantes décrites à l’article L. 542-11 du Code de l’environnement :
1° « gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation du laboratoire ou du centre de stockage » ;
2° « mener, dans les limites de son département, des actions d'aménagement du territoire et de développement économique, particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils généraux concernés » ;
3° « soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques, notamment dans les domaines étudiés au sein du laboratoire souterrain et dans ceux des nouvelles technologies de l'énergie. »
Il s’agit donc de sommes destinées au développement du territoire autour du projet, afin de faciliter son insertion dans le territoire Meusien et Haut-Marnais.
Chacun des groupements d’intérêt public a reçu 30 M€ en 2012. Le code de l’environnement prévoit qu’une partie de ces sommes soit automatiquement reversée par les GIP aux communes situées à moins de 10km du laboratoire. Ainsi, les communes de Meuse situées à moins de 10km ont reçu 1,8 M€ et les communes de Haute-Marne situées à moins de 10 km ont reçu 1,3 M€ au titre de l’accompagnement économique.
Depuis 2007, les sommes reversées par les GIP aux collectivités locales meusiennes et haut-marnaises correspondent à 78% des dépenses et celles reversées aux entreprises locales à 19%.
Fiscalité liée au projet CIGEO
Le projet Cigéo est également soumis à la fiscalité locale, notamment la taxe foncière et la contribution économique territoriale. Ces taxes seront versées par l’Andra pendant toute la durée de vie de l’installation. Les montants de fiscalité précis sont en cours d’évaluation dans le cadre du chiffrage du projet. Ils seront de l’ordre de plusieurs milliards d’euros répartis sur plus de cent ans.
Le Comité de Haut Niveau, regroupant les élus locaux meusiens et haut-marnais, les producteurs de déchets, l’Andra et les services de l’Etat, a retenu le principe de la création d'une Zone Interdépartementale (ZID) regroupant les communes les plus proches de Cigéo. L’objectif de la ZID est de permettre de redistribuer de manière adéquate au sein des communes, des communautés de communes et des deux départements les revenus fiscaux générés par CIGEO. Cette ZID sera dotée d’une gouvernance afin d’accompagner le développement du territoire suite à l’implantation du stockage.
QUESTION 33
Posée par Evelyne ANDRE (VERDUN), le 16/05/2013
Pourquoi n'y a-t-il pas de réunions dans le Nord Meusien? Le débat ne le concevrait-il pas? Lorsque l'on projette une "poubelle" aussi dangereuse le périmètre concerné est en fait bien plus étendu que celui que vous estimez arbitrairement.
Réponse du 04/06/2013,
La Commission regrette de n'avoir pas répondu à votre légitime souci de participer; elle a voulu concentrer son effort vers la région directement concernée, d'où la liste des 4 réunions en Meuse. 53 km seulement séparent Verdun de Bar le Duc, et les réunions seront retransmises en direct par internet.
QUESTION 32
Posée par Dominique PIERRON (ETAIN), le 16/05/2013
Par qui chaque membre de la CPDP a-t-il été nommé ou choisi? Combien y avait-il de "candidats" potentiels?
Les questions ne sont-elles pas biaisées? ex: de quoi va-t-on débattre? Les questions supposent que le projet d'enfouissement sera réalisé! donc le débat n'est-il pas qu'un leurre?
Réponse du 04/06/2013,
Bonjour Madame
Le président de la CPDP a été désigné par la Commission nationale du débat public siégeant en formation plénière, le 7 novembre 2012. Il a été proposé à la CNDP par son président, au vu de son expérience (présidence de 4 débats publics, participation à un 5ème debat en qualité de membre de la CPDP).
Conformément à la règle, c'est le président de la CPDP qui a proposé les 5 autres membres à la CNDP.
Il a auditionné une dizaine de personnes pour préparer ces propositions. Il s'est attaché à la diversité des membres (choix d'un chercheur indépendant, de plusieurs économistes, d'un spécialiste du monde rural et de l'agriculture, parité femmes/hommes, diversité des âges).
QUESTION 31
Posée par Jean-Claude PINEL (DARDENAY), le 16/05/2013
La radioactivité serait-elle "piégée" (réflexion, réfraction...) par de la vitrocéramique en quantité?
Je vous adresse mes salutations.
Réponse du 15/07/2013,
Réponse apportée par le Commissariat à l'Énergie Atomique et aux énergies alternatives (CEA) :
L’objectif des matériaux utilisés pour enrober les déchets radioactifs est de confiner les radionucléides qu’ils contiennent, c’est-à-dire de les piéger et de les immobiliser sur le long terme. La matrice vitreuse est la matrice la plus utilisée pour confiner les déchets de haute activité à vie longue issus du traitement des combustibles usés et destinés à être stockés dans Cigéo. En effet, le verre a, de par sa structure chimique, la capacité d’intégrer une grande variété de radionucléides au sein même de sa structure, et ce avec une très bonne homogénéité. Par ailleurs, les études menées par le CEA ont montré une très bonne résistance de la matrice vitreuse à l’altération sur des temps très longs.
La vitrocéramique reste toutefois une bonne alternative dans certains cas. Cette matrice est ainsi par exemple utilisée aujourd’hui pour le conditionnement de certains déchets riches en molybdène issus du retraitement des combustibles de la filière graphite-gaz (première génération de centrales nucléaires aujourd’hui à l’arrêt).
QUESTION 30
Posée par Grégory MENDOUSSE (CHAUMONT), le 16/05/2013
Voici entre autre les questions qui me préoccupent:
- Qu'est ce qui est prévu par rapport aux risques d'incendie ou d'explosion (chaleur des colis radioactifs, dégagement d'hydrogène...)
Réponse du 20/06/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Comme pour l’ensemble des risques pouvant remettre en cause la sûreté de Cigéo, qu’ils soient d’origine naturelle ou industrielle, les risques d’incendie et d’explosion sont d’ores et déjà pris en compte dans la conception du Centre. Des dispositions sont ainsi prises pour supprimer ces risques quand c’est possible, pour surveiller l’installation pendant toute son exploitation afin de détecter tout incident et pour prévoir par précaution des dispositions pour en limiter les conséquences.
Concernant le risque d’incendie, la première mesure de prévention consiste à limiter la quantité de produits combustibles ou inflammables dans les équipements du stockage. Contrairement au cas des tunnels routiers où les véhicules à moteur thermique constituent des sources de combustibles importantes, il n'y aura pas de véhicule de ce type dans les installations nucléaires de Cigéo. Des dispositifs de détection incendie seront répartis dans les installations pour détecter rapidement et localiser tout départ de feu et des systèmes automatiques de lutte contre l'incendie seront présents dans les installations en vue de l'éteindre rapidement. Malgré toutes ces dispositions, une situation d'incendie est quand même considérée dans les études par prudence. Des systèmes de compartimentage et de ventilation sont prévus pour limiter la propagation du feu et ses conséquences. Des véhicules d’intervention et de secours seront prépositionnés dans la zone centrale du stockage. L'architecture souterraine du stockage permettra aux secours d'intervenir dans des galeries à l'abri des fumées et facilitera l'évacuation du personnel. Les conteneurs de stockage sont également conçus pour protéger les colis des effets d’un incendie. Malgré cela, on imagine que la protection apportée par les conteneurs puisse ne pas suffire à préserver l’intégrité des colis et le maintien d'une filtration en situation accidentelle est prévu pour limiter la dispersion dans l'environnement de substances qui pourraient avoir été relâchées par les colis.
Le risque d’explosion est lui lié à la présence d’hydrogène qui, au-delà d'une certaine quantité, peut présenter un risque d'explosion en présence d'oxygène. Seulement certains déchets MA-VL, notamment ceux contenant des composés organiques, dégagent de l'hydrogène produit par radiolyse : les ¾ des colis de déchets MA-VL destinés à Cigéo dégagent peu d’hydrogène (moins de 3 litres par an et par colis), voire pas du tout. Pour maîtriser ce risque, l’Andra fixe une limite stricte aux quantités d’hydrogène émises par chaque colis. Des contrôles seront mis en place et aucun colis ne sera accepté s’il ne respecte pas cette limite. Pour éviter l’accumulation de ce gaz, les installations souterraines et de surface seront ventilées en permanence pendant leur exploitation, comme le sont les installations d’entreposage dans lesquelles se trouvent actuellement ces déchets. Le système de ventilation du stockage fait l’objet de dispositions pour réduire le risque de panne (redondance des équipements, maintenance..) et des dispositifs de surveillance seront mis en place pour détecter toute anomalie sur son fonctionnement. Des situations de perte de la ventilation sont étudiées malgré tout. Les études montrent que, dans le pire des cas, on disposera de plus d’une dizaine de jours pour rétablir la ventilation, ce qui permettra de mettre en place une ventilation de secours. Les conséquences d’une explosion sont tout de même évaluées afin d’envisager tous les scénarios possibles : les résultats montrent que les colis concernés ne seraient que faiblement endommagés, sans aucune perte de confinement des substances qu’ils contiennent.
QUESTION 29
Posée par Grégory MENDOUSSE (CHAUMONT), le 16/05/2013
Voici entre autre les questions qui me préoccupent:
- Qu'est ce qui est prévu par rapport aux risques de contamination des nappes phréatiques?
Réponse du 22/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Pendant l’exploitation du Centre, afin d’éviter tout risque de contamination des nappes phréatiques, les effluents liquides susceptibles d’être contaminés seront systématiquement collectés et contrôlés.
Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement afin de contrôler l’impact de ses activités. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, il permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement et l’absence de contamination des nappes phréatiques. L’Andra a déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.
De plus, Cigéo sera en permanence soumis au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.
Après la fermeture du stockage, au-delà de la durée de vie des ouvrages industriels, la couche d’argile très peu perméable, de plus de 130 mètres d’épaisseur, dans laquelle sera installé le stockage souterrain, servira de barrière naturelle pour retenir les radionucléides contenus dans les déchets et freiner leur déplacement. Le stockage permet ainsi de garantir leur confinement sur de très longues échelles de temps. Seuls quelques-uns de ces radionucléides, les plus mobiles et dont la durée de vie est longue, pourront migrer de manière très étalée dans le temps. Ils ne sortiraient pas de cette couche avant 100 000 ans et atteindraient en quantités extrêmement faibles la surface et les nappes phréatiques. Leur impact radiologique serait alors plusieurs dizaines de fois inférieur à l’impact de la radioactivité naturelle (qui est de 2,4 mSv par an en moyenne en France).
QUESTION 28
Posée par Jacqueline MAGNIER (JOINVILLE), le 16/05/2013
Quel sera l'impact sur l'environnement et la santé?
Réponse du 10/06/2013,
Réponse apportée par l’Andra, le maître d’ouvrage :
Pendant son exploitation, Cigéo sera à l’origine de très faibles quantités de rejets pendant son exploitation car les colis de déchets reçus sur Cigéo ne contiendront pas de liquides et peu de radionucléides gazeux. La quasi-totalité des rejets de Cigéo proviendra des émanations de gaz radioactifs (carbone 14, tritium, krypton 85…) de certains colis de déchets MA-VL. Ces gaz seront canalisés, mesurés et strictement contrôlés avant d’être dispersés et dilués dans l’air. Ces rejets et leurs limites devront faire l’objet d’une autorisation par l’Autorité de sûreté nucléaire et seront strictement contrôlés durant toute l’exploitation. Une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact des rejets serait de l’ordre de 0,01 milliSievert par an (mSv/an) à proximité du Centre, soit très largement inférieur à la norme règlementaire (1 mSv/an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv/an en moyenne en France).
Après la fermeture du stockage, son impact à long terme est évalué, aussi bien en fonctionnement normal qu’en situation dégradée, afin de s’assurer que celui-ci ne présente pas de risque sur la santé. Les études ont montré que le stockage n’aura pas d’impact avant 100 000 ans et que celui-ci sera de l’ordre de 0,01 mSv/an en évolution normale. En situation dégradée (intrusion humaine, défaut d’un composant du stockage...) les études montrent que l’impact du stockage resterait inférieur à 0,25 mSv/an. Cette évaluation s’appuie sur les travaux de recherche menés sur les phénomènes qui se produisent au sein du stockage, qu’ils soient thermiques, chimiques, mécaniques, hydrauliques, radiologiques ou biologiques.
QUESTION 27
Posée par Michel et Paulette VILTARD (VARENNES SUR AMANCE), le 16/05/2013
Nous espérons toutefois que même enfouis profondément ces déchets radioactifs ne poluerons pas les eaux souterraines.
Réponse du 11/06/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le stockage géologique a pour principe de confiner la radioactivité des déchets sur de très longues échelles de temps. Pour cela, le stockage serait implanté, à environ 500 mètres de profondeur, dans une couche d’argile très peu perméable de plus de 130 mètres d’épaisseur qui servira de barrière naturelle pour retenir les radionucléides contenus dans les déchets et freiner leur déplacement. Seuls quelques-uns de ces radionucléides, les plus mobiles et dont la durée de vie est longue, pourront migrer de manière très étalée dans le temps (plus d’une centaine de milliers d’années) et atteindre en quantités extrêmement faibles les couches géologiques situées au-dessus et au-dessous de l’argile et dans lesquelles l’eau peut circuler (couches géologiques appelées aquifères). Dans une démarche prudente, l’Andra dans son évaluation d’impact sur l’homme et l’environnement à long terme suppose que les eaux de ces couches pourraient être captées par forage et utilisées pour des usages du type de ceux qui peuvent être pratiqués aujourd’hui (jardin, boisson, abreuvement des animaux). Les études montrent que même dans ce cas, l’impact du stockage reste inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire et ne présente pas de risque pour la santé.
QUESTION 26
Posée par Marie-Aline DELVAUX (SIVRY LA PERCHE), le 16/05/2013
Pourquoi les conditions de réversibilité de CIGEO seront-ils fixés par une loi à postériori et ne sont-ils pas proposés et débattus dans le débat public qui s'instaure.
Réponse du 02/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les propositions de l’Andra concernant la réversibilité sont présentées au chapitre 7 du dossier du maître d’ouvrage en ligne sur le site de la CPDP. Ces propositions concernent à la fois les dispositions techniques pour faciliter le retrait éventuel des déchets du stockage et les dispositions pour laisser des choix aux générations suivantes. Le débat public est l’occasion de débattre sur ces propositions. Ces échanges alimenteront la préparation de la future loi qui fixera les conditions de réversibilité de Cigéo.
QUESTION 25
Posée par Grégory MENDOUSSE (CHAUMONT), le 16/05/2013
Voici entre autre les questions qui me préoccupent:
- Quelle est la durée de vie des structures en béton etc. ?
Réponse du 07/06/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les entreprises de génie civil savent garantir des structures en béton pendant plus de 100 ans (par exemple 120 ans pour le tunnel sous la Manche). Pour les tunnels de Cigéo, les types de béton et leur épaisseur sont définis pour résister aux contraintes mécaniques exercées par la couche d’argile pendant toute l’exploitation du Centre. Des marges sont intégrées dans leur dimensionnement. Ils seront équipés de capteurs qui permettront de suivre leur comportement dans le temps.
QUESTION 24
Posée par Guy URBANIAK (AUJEURRES), le 16/05/2013
Etudes et comparaisons entre radioactivité naturelle et émise par stockage.
Analyse des risques éventuels (inondation, tremblement terre)
Réponse du 11/06/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La radioactivité fait partie de notre environnement naturel, aussi bien dans l’écorce terrestre (qui contient par exemple quelques milligrammes d’uranium par tonne) que dans l’eau, l’air, le corps humain ou certains aliments. En France, à titre illustratif, un habitant reçoit chaque année une dose moyenne de 3,5 mSv. Il reçoit notamment en moyenne : 2,4 mSv chaque année liée à la radioactivité naturelle moyenne, dont 0,9 mSv liée aux rayonnements cosmiques, et 1,2 mSv liée à la présence de radon dans les habitations. La radioactivité artificielle fait aussi partie de notre quotidien, comme les expositions dues aux activités médicales (en moyenne 1,1mSv/an) ou aux voyages aériens (environ 0,03mSv lors d’un vol Paris-New -York).
Selon la réglementation française, la dose annuelle liée aux activités industrielles nucléaires doit être aussi limitée que possible et ne peut pas dépasser 1 mSv pour la population. Pour la conception de Cigéo, l’Andra s’est fixé une contrainte de dose annuelle de 0,25 mSv/an à ne pas dépasser pour la population, que cela soit en exploitation ou après fermeture.
Cigéo sera à l’origine de très faibles quantités de rejets pendant son exploitation, car les colis de déchets reçus sur le Centre, ne contiendront pas de liquides et peu de radionucléides gazeux. La quasi-totalité des rejets de Cigéo proviendra des émanations de gaz radioactifs (carbone 14, tritium, krypton…) de certains colis de déchet MA-VL. Ces gaz seront canalisés, mesurés et strictement contrôlés avant d’être rejetés dans l’air. Une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact de ces rejets serait de l’ordre de 0,01 mSv/an à proximité du Centre. Après fermeture du stockage, les études ont montré que le stockage n’aura pas d’impact avant 100 000 ans et que celui-ci serait également de l’ordre de 0,01 millisievert en évolution normale.
Concernant l’analyse des risques, celle-ci a été prise en compte dès le début de la conception du Centre, y compris la phase de choix de site d’implantation, selon le « principe de défense en profondeur » appliqué à l’ensemble des installations nucléaires de base en France. L’Andra a ainsi identifié les risques dont les conséquences pour Cigéo pourraient être à l’origine d’un impact, radiologique ou non, sur les personnes et sur l’environnement. Les risques peuvent être liés à des dangers externes (liés aux activités humaines ou industrielles) ou internes à l’installation (co-activité, incendie, panne électrique…). Pour chaque risque identifié, des dispositions sont prévues (implantation, conception, exploitation) pour supprimer si possible ces risques, les prévenir, réduire leur probabilité et limiter leurs effets. Les risques liés aux aléas naturels, sont évalués dès la phase de choix de site d’implantation afin de retenir un site présentant des caractéristiques favorables. Par ailleurs, Cigéo serait dimensionné en prenant en compte ces aléas en prenant des marges conformément à la réglementation en vigueur et pour prendre en compte le retour d’expérience notamment des évaluations complémentaires de sûreté suite à l’accident de Fukushima. Par exemple, concernant le risque sismique, la zone étudiée en Meuse/Haute-Marne a été notamment choisie parce qu’elle présente une faible sismicité. L’Andra propose une conception des installations de Cigéo qui permettrait de résister à des séismes au moins cinq fois plus puissants que tous les séismes envisageables sur le site. De même, l’implantation des installations de surface de Cigéo est proposée en dehors des zones inondables par des crues de cours d’eau, et elles seront protégées en cas de pluviométrie exceptionnelle ou de remontée des nappes phréatiques, comme le préconise le guide de l’ASN relatif à l’inondation publié en 2013 qui prend en compte le retour d’expérience des événements extrêmes notamment celui de Blayais en 1999.
QUESTION 23
Posée par Daniel BOUQUET (VOID VACON), le 16/05/2013
Je ne suis toujours pas persuadé que le stockage profond soit la meilleure solution car on ne peut pas deviner comment évoluera ce stockage. A-t-on le droit de laisser ce risque aux générations futures?
Aujourd'hui, je continue à me renseigner.
Merci d'avance.
Réponse du 22/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les recherches menées par l’Andra ont pour objectif d’étudier l’évolution du stockage sur le long terme. La démarche des scientifiques se fonde d’abord sur l’observation et l’expérimentation, qui permettent de décrire les phénomènes physiques, de les modéliser et d’identifier les incertitudes. Sur cette base, la simulation numérique permet ensuite d’extrapoler des résultats à des échelles de temps longues.
La couche géologique étudiée possède des propriétés favorables pour le confinement des déchets radioactifs. Elle est stable depuis plusieurs dizaines de millions d’années. Sa profondeur permet de mettre les déchets à l’abri des activités humaines et des événements naturels de surface, comme l’érosion. Les compositions minéralogiques de la roche argileuse et chimique de l’eau qu’elle contient limitent la mise en solution de nombreux éléments radioactifs, empêchant ainsi leur déplacement dans la roche. Par ailleurs, compte tenu de la très faible perméabilité, la migration des éléments radioactifs mis en solution dans l’eau se fera très lentement, par diffusion.
Le Laboratoire souterrain a permis d’étudier, au cœur de la roche, les caractéristiques de l’argile et les phénomènes qui seraient induits par la réalisation du stockage (creusement, échauffement…). Les essais qui y sont réalisés permettent de tester les prévisions des modèles, de même que l’étude d’analogues archéologiques ou naturels (par exemple des objets en fer retrouvés dans des milieux argileux ou le site géologique de Maquarin en Jordanie pour l’étude des perturbations chimiques qui seraient générées par le béton sur l’argile).
Grâce à l’ensemble de ces éléments, l’Andra a ainsi évalué que le stockage n’aurait pas d’impact avant 100 000 ans et que celui-ci serait très inférieur à l’impact de la radioactivité naturelle, même en prenant en compte des incertitudes sur la performance des différents composants.
A-t-on le droit de laisser ce risque aux générations futures ? C’est justement pour ne pas laisser aux générations futures la charge de la gestion des déchets radioactifs et les risques associés que le Parlement a fait le choix du stockage réversible profond, après 15 années de recherche et leur évaluation sur le plan scientifique et de la sûreté. A l’inverse de l’entreposage, le stockage permet de mettre en place une protection pour le très long terme. Les générations suivantes auront la possibilité de contrôler sa mise en œuvre grâce à la réversibilité. L’Andra propose ainsi que des points de rendez-vous réguliers soient prévus pendant toute la durée de réalisation du projet pour évaluer le fonctionnement du Centre et préparer les étapes suivantes.
QUESTION 22
Posée par Michel GUMY (LIGNY EN BARROIS), le 16/05/2013
Pourquoi la Meuse?...
Réponse du 07/06/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Suite au vote de la loi de 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, des recherches ont été menées en France pour implanter un laboratoire souterrain. Plusieurs sites se sont portés candidats et ont été étudiés, dont les départements de Meuse et de Haute-Marne. En 1999, après l’évaluation scientifique du site, la consultation des collectivités locales et une enquête publique, le Gouvernement a autorisé l’Andra à construire un laboratoire souterrain à la limite entre les deux départements de Meuse et de Haute-Marne pour étudier la couche d’argile du Callovo-Oxfordien.
En s’appuyant sur l’ensemble des recherches menées sur le site depuis 1994, l’Andra a montré que le site présente des caractéristiques favorables pour assurer la sûreté à long terme du stockage. La Commission nationale d’évaluation mise en place par le Parlement pour évaluer sur le plan scientifique les travaux de l’Andra souligne ainsi dans son rapport 2012 : « le site géologique de Meuse/Haute-Marne a été retenu pour des études poussées, parce qu’une couche d’argile de plus de 130 m d’épaisseur et à 500 m de profondeur, a révélé d’excellentes qualités de confinement : stabilité depuis 100 millions d’années au moins, circulation de l’eau très lente, capacité de rétention élevée des éléments ».
Pour en savoir plus : Chapitre 3 du dossier du maître d’ouvrage : « Pourquoi la Meuse/Haute-Marne pour implanter CIGEO ? » ../docs/dmo/chapitres/DMO-Andra-chapitre-3.pdf
QUESTION 21
Posée par Aurélie BOINETTE (VERDUN), le 16/05/2013
La solution d'un stockage au large des côtes Françaises dans les fonds marins a-t-elle déjà été étudiée?
Quelle est la radioactivité actuelle émise par les déchets entreposés et depuis combien de temps?
Réponse du 11/06/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Entre 1977 et 1988, un groupe de travail international, dit groupe « Seabed », regroupant des scientifiques d'une dizaine de pays, dont la France, l'Allemagne, les Etats-Unis ou encore le Japon a étudié la possibilité d'une immersion de déchets nucléaires dans les sédiments sous-marins. La principale option envisagée était de placer les déchets dans un engin en forme de torpille, lancé depuis la surface et capable de s'enfoncer jusqu'à 30 mètres dans la boue argileuse des grands fonds marins. Une option proche était de creuser un puits, à partir d'une plateforme de surface, pour stocker les déchets à 200 mètres de profondeur dans le sous-sol marin. En 1983, un moratoire volontaire sur l’immersion des déchets a été adopté dans l’attente d’un examen global de la question. En 1988, ce programme « Seabed » a été abandonné, les études scientifiques, s'orientant alors vers les stockages dans les formations géologiques continentales. En 1993, les signataires de la convention de Londres ont décidé d’interdire l’immersion de tout type de déchets radioactifs dans la mer ; cette décision se fondait sur des critères moraux, sociaux et politiques.
Concernant la radioactivité émise par les déchets actuellement entreposés, vous trouverez les informations sur les entreposages ainsi que sur la radioactivité contenue dans ces déchets (à la date de fin 2010) dans l’Inventaire national publié par l’Andra.
Vous trouverez aussi sur chaque site Web des producteurs de déchets, des informations dans leur rapport annuel requis par l’article L 125-15 du code de l'environnement (ancien article 21 de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, dite loi TSN) concernant notamment la nature et la quantité des déchets radioactifs entreposés sur le site de l’installation.
QUESTION 20
Posée par Romuald COLMON (OURCHES SUR MEUSE), le 16/05/2013
N'est-il pas irraisonnable d'envisager de stocker tous ces déchets sur un même site? Que pourra-ton faire si un incident intervient (géologique, sismique, mécanique) avec une telle quantité de matière?
Réponse du 15/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La majeure partie des déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue est aujourd’hui centralisée dans des entrepôts de surface situés à La Hague (Manche), Marcoule (Gard) et Cadarache (Bouches-du-Rhône).
Pour des raisons de sûreté, ces déchets nécessiteront d’être stockés en profondeur pour garantir leur mise en sécurité définitive. Ce type de stockage doit être implanté dans un milieu géologique favorable (stabilité géologique, très faible sismicité…) et une couche de roche dont les propriétés permettent le confinement des déchets sur de très longues échelles de temps (profondeur et épaisseur suffisante, stabilité, faible perméabilité, propriétés de rétention…). C’est pour cela que le site choisi en Meuse/Haute-Marne est étudié pour l’implantation de Cigéo.
L’inventaire des déchets destinés à Cigéo est présenté au chapitre 1 du dossier du maître d’ouvrage. La sûreté du stockage de ces déchets sur le site étudié en Meuse/Haute-Marne a été démontrée par les études qui ont été menées par l’Andra ainsi que par les évaluations indépendantes qui en ont été faites. L’impact du stockage restera très largement inférieur à l’impact de la radioactivité naturelle (impact de l’ordre de 0,01 milliSievert/an, à comparer avec l’impact de la radioactivité naturelle de 2,4 mSv/an en moyenne en France).
Les risques potentiels liés à l’activité industrielle sont examinés (incendie, chute de colis, désordres mécaniques induits par un séisme…). L’Andra prend systématiquement des mesures pour supprimer les risques ou réduire leur probabilité, détecter tout dysfonctionnement et maîtriser leur impact dans l’hypothèse où des situations accidentelles interviendraient malgré les précautions prises.
Après la fermeture du stockage, la sûreté sera assurée de manière passive grâce au milieu géologique. L’évolution à long terme du stockage et de l’environnement sont analysés de manière détaillée. Des situations altérées (forage intrusif, défaut de construction d’un ouvrage du stockage, séisme...) sont prises en compte dans l’évaluation de sûreté.
QUESTION 19
Posée par Michaël LE BESCOND (VIÉVILLE), le 16/05/2013
Le maître d'ouvrage sera-t-il juge et partie pour suites à donner ou bien sera-t-il soumis à une décision parlementaire suite au débat public?
Réponse du 05/06/2013,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat public, la Commission Particulière du Débat Public établira un compte rendu du débat et la Commission Nationale du Débat Public en dressera le bilan. En tant que maître d’ouvrage du projet Cigéo, il reviendra alors à l’Andra d’informer de la manière dont elle prend en compte le débat dans la suite de ses études. Ces études visent à déposer en 2015 le dossier support à l’instruction de la demande d’autorisation de création de Cigéo. Le compte rendu et le bilan du débat seront joints à ce dossier.
Ce n’est pas l’Andra qui décidera de la mise en œuvre du projet mais le Gouvernement suite à l’instruction de la demande d’autorisation. Cette évaluation comprendra notamment le vote d’une loi par le Parlement sur les conditions de réversibilité du stockage, l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et de la Commission nationale d’évaluation (instance d’évaluation scientifique mise en place par le Parlement depuis la loi de 1991), l’avis des collectivités territoriales et une enquête publique.
QUESTION 18
Posée par François ERZEPA (BAR LE DUC), le 16/05/2013
A l'issue du débat public y aura-t-il un vote de la population (locale ou nationale?) pour la poursuite ou l'arrêt du projet d'enfouissement?
Réponse du 02/07/2013,
C'est en vertu deux lois que le débat public sur le centre de stockage de déchets radioactifs est organisé par la Commission nationale du débat public.
- loi de 2002 sur la démocratie participative
- loi de 2006 sur lagestion des déchets radioactifs
Le référendum ne figure pas au nombre des instruments de consultation du public que la Commission du débat public est susceptible de mettre en œuvre. Il appartient aux personnes qui se sentent concernées par le projet de faire connaître leur avis en utilisant les moyens d'expression mis à leur disposition : donner un avis, participer au forum, poser une question, rédiger un cahier d’acteurs, participer aux réunions, etc.
L'objectif du débat public est de faire en sorte que le maximum d'arguments s'expriment grâce à la participation du plus grand nombre de personnes.
A la fin des 4 mois de débat, le rôle de la CPDP n'est pas de compter les "pour", les "contre" et les "indécis", mais de rendre compte aussi clairement que possible de l'argumentation qu'elle a entendu.
QUESTION 17
Posée par François ERZEPA (BAR LE DUC), le 16/05/2013
Qui a "choisi" les membres de la CNDP? Des scientifiques indépendants, des personnalités politiques?...
Réponse du 27/05/2013,
Bonjour Monsieur,
La réponse à votre question se trouve dans l'article L 121-3 du Code de l'Environnement issu de la Loi de 2002 sur le débat public. Les 25 membres de la CNDP sont nommés pour une période de 5 ans renouvelable une fois.
Le Président est, depuis la réforme constitutionnelle, entendu par les Commissions parlementaires compétentes.
Les membres représentant le Parlement ou les grandes juridictions (Conseil d'Etat, Cour de cassation, Cour des comptes, Tribunaux administratifs) sont désignés par les Présidents de ces institutions.
Les membres issus des associations d'environnement ou de consommateurs sont proposés par leurs associations.
S'agissant de la Commission particulière, les membres sont désignés par la CNDP.
QUESTION 16
Posée par Joël MOUGNIOT (CHALINDREY), le 16/05/2013
LA CNDP sera-t-elle totalement indépendante? Par qui sera-t-elle payée?
Réponse du 27/05/2013,
La Commission nationale du débat public, forte de 25 membres, est composée de membres proposés par les Assemblées parlementaires, les associations d'élus, les grandes fédérations environnementales et de consommateurs. Ils sont nommés pour une durée de 5 ans, renouvelable une fois, sans possibilité d'être démis. Le Président et les deux Vice-présidents, bénéficient du même statut.
Les dépenses de rémunération et de fonctionnement de la CNDP sont inscrites au budget, et gérées par le Président de la CNDP.
Il en va de même pour les rémunérations et frais de déplacement des présidents et membres des Commissions particulières.
QUESTION 15
Posée par Gérard DARDE (MONTIER EN DER), le 16/05/2013
8 réunions sur 4 mois dans les départements 52-55. Toujours le jeudi? Un samedi ou un dimanche par département, pour un projet d'exploitation de 100 ans, serait correcte pour une réunion.
Réponse du 27/05/2013,
Bonjour Monsieur,
La préparation des réunions publiques est trop engagée pour modifier le calendrier. Cependant la CPDP reconnait que votre suggestion a du sens. Les réunions sont organisées en semaine pour tenir compte de leur caractère de réunion de travail, mais effectivement on aurait pu imaginer de recourir au samedi soir pour une ou deux réunions.
QUESTION 14
Posée par Virgile BRUAUX (MANDRES LA CÔTE), le 16/05/2013
Quels types de rejets le stockage sera suceptible d'émettre (air-eau)? Dispositifs de contrôle associés? Les voies d'acheminement des déchets sont elles prisent en compte dans le projet? (risques accidentels, contaminations...)
Réponse du 02/07/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Concernant les rejets radioactifs : Cigéo sera à l’origine de très faibles quantités de rejets radioactifs pendant son exploitation. Ces rejets et leurs limites devront faire l’objet d’une autorisation par l’Autorité de sûreté nucléaire et seront strictement contrôlés.
Ils proviendront, pour la quasi-totalité, des très faibles émanations de gaz radioactifs (carbone 14, tritium, krypton 85…) de certains colis de déchets MA-VL qui seront canalisées, évacuées par la ventilation, contrôlées et diluées dans l’air. Une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que leur impact serait de l’ordre de 0,01 milliSievert par an (mSv/an) à proximité du Centre, soit très largement inférieur à la norme règlementaire (1 mSv/an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv/an en moyenne en France).
Les effluents liquides susceptibles d’être contaminés par de la radioactivité (par exemple effluents produits lors du nettoyage d’un équipement nucléaire) seront récupérés grâce à un réseau particulier. Une fois récupérés, ces effluents seront analysés pour contrôler leur niveau de radioactivité. En cas de contamination, ils seront traités : les effluents décontaminés seront rejetés dans le respect de l’autorisation de rejet et les résidus de traitement de ces effluents seront gérés comme des déchets radioactifs.
Concernant les dispositifs de contrôle : comme toutes les installations nucléaires, Cigéo établira un plan de surveillance présentant les mesures qui seront faites dans l’environnement y compris celles sur les rejets. Cigéo sera en permanence soumis au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public et présenté à la Commission locale d’information. Enfin, l’Observatoire pérenne de l’environnement mis en place par l’Andra a pour objectif de suivre l’évolution de l’environnement du stockage pendant sa construction et toute sa durée d’exploitation. Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, il permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement.
Réponse apportée par L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) :
Concernant le transport des déchets : environ 900 000 colis de substances radioactives sont transportés chaque année. 85 % des colis transportés sont destinés aux secteurs de la santé, de l’industrie non-nucléaire ou de la recherche, dits "nucléaire de proximité", dont 30 % environ pour le seul secteur médical. L’industrie nucléaire ne représente qu’environ 15 % du flux annuel de transports de substances radioactives. On estime à environ 11 000 le nombre annuel de transports nécessaires au cycle du combustible, pour 141 000 colis.
Le contenu des colis est très divers : leur radioactivité varie sur plus de douze ordres de grandeur, soit de quelques milliers de becquerels pour des colis pharmaceutiques de faible activité à des millions de milliards de becquerels pour des combustibles irradiés. Leur masse varie de quelques kilogrammes à une centaine de tonnes.
Les risques majeurs des transports de substances radioactives sont les suivants :
- le risque d’irradiation externe de personnes dans le cas de la détérioration de la « protection biologique des colis », matériau technique qui permet de réduire le rayonnement au contact du colis ;
- le risque d’inhalation ou d’ingestion de particules radioactives dans le cas de relâchement de substances radioactives ;
- la contamination de l’environnement dans le cas de relâchement de substances radioactives ;
- le démarrage d’une réaction nucléaire en chaîne non contrôlée (risque de « sûreté-criticité ») pouvant occasionner une irradiation des personnes, en cas de présence d’eau et de non-maîtrise de la sûreté de substances radioactives fissiles.
La prise en compte de ces risques conduit à devoir maîtriser le comportement des colis pour éviter tout relâchement de matière et détérioration des protections du colis dans le cas :
- d’un incendie ;
- d’un impact mécanique consécutif à un accident de transport ;
- d’une entrée d’eau dans l’emballage (l’eau facilitant les réactions nucléaires en chaîne en présence de substances fissiles) ;
- d’une interaction chimique entre différents constituants du colis ;
- d’un dégagement thermique important des substances transportées, pour éviter la détérioration éventuelle avec la chaleur des matériaux constitutifs du colis.
Cette approche conduit à définir des principes de sûreté pour les transports de substances radioactives :
- la sûreté repose avant tout sur le colis : des épreuves réglementaires et des démonstrations de sûreté sont requises par la réglementation pour démontrer la résistance des colis à des accidents de référence ;
- le niveau d’exigence, notamment concernant la définition des accidents de référence auxquels doivent résister les colis, dépend du niveau de risque présenté par le contenu du colis.
Ainsi, les colis qui permettent de transporter les substances les plus dangereuses doivent être conçus de façon à ce que la sûreté soit garantie y compris lors d’accident de transport. Ces accidents sont représentés par les épreuves suivantes :
- trois épreuves en série (chute de 9 m sur une surface indéformable, chute de 1 m sur un poinçon et incendie totalement enveloppant de 800 °C minimum pendant 30 minutes) ;
- immersion dans l’eau d’une profondeur de 15 m (200 m pour les combustibles irradiés) pendant 8 h.
La sûreté des transports est également fondée sur la fiabilité des opérations de transport qui doivent satisfaire à des exigences réglementaires notamment en matière de radioprotection. L'ASN assure le contrôle de la sûreté des transports de matières radioactives. Enfin, la gestion des situations accidentelles est régulièrement testée lors d'exercices.
QUESTION 13
Posée par Françoise et Jacques BERTHET (NARCY), le 16/05/2013
"Comment notre génération actuelle peut enlever toute nocivité aux déchets nucléaires et ce quelqu'en soit le prix?" = c'est la vraie question à se poser si on est des femmes et des hommes responsables
Réponse du 10/06/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Cette question s’est posée dès 1991 lorsque le Parlement s’est saisi de la question des déchets radioactifs afin de trouver des solutions de gestion pour les plus radioactifs d’entre eux (les déchets de haute activité et à vie longue). Le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) a ainsi été chargé d’étudier s’il était possible de réduire la nocivité des déchets par une technique appelée la séparation/transmutation. Le principe consiste dans une première étape à séparer les différents radionucléides contenus dans les déchets les uns des autres. Une seconde étape vise ensuite à transformer par une série de réactions nucléaires, ceux à vie longue en radionucléides à vie plus courte.
Après plus de 20 ans de recherche, il apparaît que cette technique ne serait applicable qu’à certains radionucléides contenus dans les déchets (ceux de la famille de l’uranium) et que les installations nucléaires nécessaires à la mise en œuvre d’une telle technique produiraient des déchets qui nécessiteraient aussi d’être stockés en profondeur pour des raisons de sûreté. Ces recherches sont aujourd’hui poursuivies par le CEA en lien avec celles sur les futurs réacteurs.
Il n’est donc pas possible de supprimer les déchets radioactifs ou leur nocivité. Sur la base de ces résultats, de leur évaluation scientifique , le Parlement a fait le choix du stockage réversible profond pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets de haute activité et à vie longue et ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations futures.
Plus de renseignements : Les rapports de recherche - Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) - Dossier 2012 – Tome 2 – Séparation-transmutation des éléments radioactifs à vie longue ../informer/documents-complementaires/rapports-autorites-evaluations-ponctuelles.html
QUESTION 12 - Réversibilité
Posée par Sébastien REMMELE (SAINT-MAX), le 16/05/2013
Bonjour,
Pourquoi nous laisse-t-on croire que le stockage sera réversible puisque le principe même du stockage en couche géologique profonde est de freiner la dissémination des déchets dans les sols en espérant qu’ils y resteront suffisamment longtemps confinés pour perdre leur activité. Réversibilité veut bien dire possibilité de récupérer à tout moment les déchets. Comment peut-on raisonnablement penser pouvoir récupérer ceux qui se seront propagés dans les sols?
Cordialement.
Réponse du 07/06/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
L’objectif du stockage profond est la mise en sécurité définitive des déchets pour ne pas en transmettre la charge aux générations futures. Dans cette optique, Cigéo est conçu pour être fermé à l’issue de son exploitation.
Le stockage est aussi conçu pour être réversible pendant au moins 100 ans. Pendant cette période, les colis de stockage des déchets resteront intègres et assureront le confinement de la radioactivité. Les moyens techniques mis en œuvre pour la récupération de colis sont similaires à ceux utilisés pour leur mise en stockage.
La décision de fermeture définitive du stockage conduira à refermer les galeries souterraines, les puits et les descenderies pour garantir la sûreté du stockage de manière passive, sans nécessiter d’actions de l’homme. Cela rendra plus complexe la récupération de déchets puisqu’il serait alors nécessaire d’excaver les remblais de fermeture et les scellements pour revenir dans le stockage. Le Parlement a d’ores et déjà décidé que seule une loi pourrait autoriser la fermeture définitive de Cigéo. La dégradation des déchets dans le stockage au contact de l’eau sera un phénomène très lent. Après plusieurs centaines d’années, certains radionucléides pourront se dissoudre dans cette eau. C’est là que l’argile prendra le relais pour retenir ces radionucléides et freiner leur déplacement. Le stockage permet ainsi de garantir leur confinement sur de très longues échelles de temps.
Concernant la définition de la réversibilité, celle-ci suppose effectivement de pouvoir récupérer des colis de déchets stockés. La définition de la réversibilité est cependant plus large. Il s’agit notamment d’organiser le processus de stockage, qui se déroulera sur une centaine d’années, par étapes successives. A chaque étape, il sera possible de décider de poursuivre le processus tel qu’initialement prévu ou de le modifier. L’Andra propose que les décisions à prendre tout au long du processus puissent être préparées par des rendez-vous réguliers avec l’ensemble des acteurs.
Pour en savoir plus : http://www.cigeo.com/un-projet-flexible-et-reversible
QUESTION 11 - Sens du débat
Posée par Divi KERNEIS (ELVEN), le 16/05/2013
Bonjour,
Est-ce que des avis massivement opposés à votre projet, de la part des citoyens participant au débat, pourraient avoir pour conséquence un abandon du projet?
Cordialement
Réponse du 27/05/2013,
La loi de 2006 sur la gestion des déchets radioactifs a prévu une longue procédure aboutissant ou non à l'autorisation d'un centre de stockage profond et réversible. Le débat public est l'étape de cette procédure préalable à la demande d'autorisation. Ensuite viendront des avis scientifiques, de sureté, puis les avis des collectivités territoriales, et un réexamen du projet par le Parlement, au titre, notamment, de la réversibilité, enfin une enquête publique. C'est au vu de tous ces éléments, dont les enseignements du débat public, que les autorités de l'Etat, en 2018 ou 2019, auront à se prononcer sur la demande d'autorisation.
Les enseignements du débat public, quelqu'ils soient, auront à l'évidence beaucoup d'importance dans cette décision.
QUESTION 10 - Où peut-on lire les avis des citoiyens participants au débat?
Posée par Christine MERLIN, PARTICULIER - BLOGGUEUSE - ORIGINAIRE DE HAUTE-MARNE (BOULOGNE-SUR-MER), le 16/05/2013
Merci de nous donner la parole amis il semble que les avis et autres questions des différents internautes ne sont pas accessibles (ou pas encore)...
Réponse du 27/05/2013,
Bonjour Madame,
Le site internet a été ouvert en lecture seule pendant plusieurs semaines, pour permettre aux participants de consulter le dossier du projet le plus tôt possible. Cependant, le débat public n'étant pas ouvert, il n'était pas possible de poser une question, ni de déposer un avis. C'est possible depuis le 15 mai et jusqu'au 15 octobre.
QUESTION 9
Posée par Daniel PREAU (TORCENAY), le 16/05/2013
Quelles sont les garanties de sécurité?
Réponse du 10/06/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Les déchets radioactifs contiennent des substances dangereuses qui peuvent irradier une personne à proximité ou contaminer l’homme et l’environnement si elles sont dispersées. L’objectif fondamental de Cigéo est de protéger l’homme et l’environnement de ces déchets sur de très longues échelles de temps. Cigéo est conçu pour être sûr pendant sa construction, son exploitation et après sa fermeture. Pour cela, l’objectif principal de l’Andra est d’éviter la dispersion incontrôlée de radioactivité afin que la quantité de radioactivité qui se retrouve au contact des travailleurs et des populations riveraines soit très faible et ne présente pas de risque pour la santé.
Pour la période d’exploitation, tous les risques potentiels sont examinés (séisme, chute de colis, incendie…), et l’Andra prend des mesures pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…), et prévoit par précaution des dispositions pour limiter les conséquences d’un accident (extinction d’un incendie, filtration des rejets…).
Après la fermeture du stockage, la sûreté sera assurée de manière passive et ne nécessitera aucune action humaine. Une surveillance sera, néanmoins, maintenue après la fermeture du stockage et des actions seront menées pour conserver et transmettre sa mémoire.
Le Gouvernement décidera de la suite du projet à l’issue de l’instruction de la demande d’autorisation que l’Andra doit déposer en 2015. Cette instruction comprendra notamment le vote d’une loi par le Parlement sur les conditions de réversibilité du stockage, l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et de la Commission nationale d’évaluation (instance d’évaluation scientifique mise en place par le Parlement depuis la loi de 1991), l’avis des collectivités territoriales et une enquête publique.
Pour que le projet puisse être autorisé, l’Andra doit donc démontrer aux évaluateurs du projet (Autorité de sûreté nucléaire, Commission nationale d’évaluation) qu’elle maîtrise tous les risques, que ce soit pour la sûreté de Cigéo pendant son exploitation ou après sa fermeture.
Voir l’ensemble des dispositions prévues pour garantir la sûreté du centre http://www.cigeo.com/la-surete-du-centre
QUESTION 8
Posée par Jean-Dominique MARCHAL (FRONCLES), le 16/05/2013
Quelle sera la température de la terre en surface, au dessus de l'installation souterraine, 40°, 80°? Etat de la forêt?
Réponse du 10/06/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d'ouvrage :
La chaleur dégagée par le stockage géologique ne modifiera pas la température du sol en surface à l’aplomb du stockage. Au maximum, son impact serait de l’ordre de 0,001 °C (soit un millième de °C) au bout de quelques milliers d’années. C’est complètement négligeable par rapport à des phénomènes naturels tels que les variations du rayonnement solaire, du climat ou la chaleur dégagée naturellement par le sol (flux géothermique). A titre de comparaison, son impact représenterait quelques dixièmes du flux géothermique ou moins de 0,001 % du rayonnement solaire. L’état de la forêt ne devrait donc pas être modifié par l’implantation d’un centre de stockage profond de déchets radioactifs.
QUESTION 7 - personnel
Posée par Daniel VANRYSEGHEM (VECQUEVILLE), le 16/05/2013
Au cas où le transport des déchets ce ferait par voie ferrée quel serait le parcours retenu, le terminal choisi sera t il aménagé pour recevoir ces déchets, des équipes de secours et décontamination seront elles formées? Dans 10, 15, 20 ans à venir que vaudront vos instruments de mesure actuels au vu de la vitesse du changement dans l'informatique, n'y aura-t-il pas comme pour les médicaments des risques de contredire vos résultats actuels?
Merci pour votre réponse.
Réponse du 13/06/2013,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le transport des colis par voie ferroviaire est privilégié. Le réseau ferré national permet d’acheminer les colis de déchets jusqu’à proximité de Cigéo, en toute sécurité. Différents itinéraires sont actuellement étudiés par les producteurs de déchets depuis les sites où sont actuellement entreposés ces colis de déchets (voir carte). L’arrivée et le déchargement des trains se feront dans un terminal ferroviaire spécifique spécialement aménagé et équipé pour réceptionner ce type de convoi. L’emplacement de ce terminal ferroviaire n’est pas encore arrêté, il pourrait être implanté soit sur une voie ferroviaire existante en Meuse ou en Haute-Marne, soit sur le site même des installations de surface de Cigéo avec un raccordement ferroviaire d’environ 15 km à créer.
Comme dans toutes les installations nucléaires, des équipes du personnel d’exploitation seront formées pour intervenir en cas d’incident ou d’accident. Des exercices seront organisés régulièrement pour tester les procédures d’intervention et vérifier leur maîtrise par les équipes. Les instruments de mesure pour la radioprotection et la sécurité tout comme les moyens informatiques pourront être renouvelés en tant que de besoin lors d’opérations de maintenance programmées. La sûreté de l’installation sera réexaminée périodiquement en tenant compte notamment des résultats de la surveillance et des évolutions en matière de réglementation, connaissances…

QUESTION 6 - Stockage en surface
Posée par Emmanuel CHRETIEN (NANCY), le 15/05/2013
Pourquoi ne peut on pas pérenniser les stockages en surface sûre à proximité des lieux de production comme cela est fait actuellement?
Réponse du 28/05/2013,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
L'entreposage actuel des déchets sur leurs sites de production est une solution provisoire qui ne peut être pérennisée. En effet, elle nécessite l’intervention régulière de l’homme pour contrôler, maintenir et reconstruire les installations, ce qui ne peut être garanti sur le long terme. En cas de perte de contrôle de telles installations, les conséquences radiologiques sur l’homme et l’environnement ne seraient pas acceptables.
Le stockage à 500 mètres de profondeur dans une couche géologique assurant le confinement à l’échelle de plusieurs centaines de milliers d’années permet de protéger l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue. La géologie prend ainsi le relais de l’homme pour garantir la sûreté sur ces grandes échelles de temps. Cela nécessite une géologie favorable, comme celle étudiée à la limite de la Meuse et de la Haute-Marne.
QUESTION 5
Posée par Marc DELPLANQUE (AGEN), le 16/05/2013
Question 3 : est-ce que les étrangers ont le droit de participer aux réunions publiques ?
Cordialement
Réponse du 27/05/2013,
Bonjour Monsieur
Les étrangers, communautaires ou non, peuvent participer aux réunions publiques, et utiliser les autres moyens du débat (internet, courrier). Ils doivent le faire en français.
QUESTION 4
Posée par Marc DELPLANQUE (AGEN), le 16/05/2013
Question 2 : Comment s'est fait le choix des sujets abordés et thèmes des réunions ?
Réponse du 27/05/2013,
Bonjour Monsieur,
Le choix des thèmes abordés a été fait par la Commission nationale sur proposition de la Commission particulière, à partir de l'analyse de la question centrale posée au débat public : "Faut-il, ou non, réaliser l'installation nucléaire permettant le stockage profond reversible de certains déchets, sur le site et selon les modalités proposées par le maître d'ouvrage ANDRA ?", et de toutes les questions qui en découlent (pour quels déchets ?, pourquoi en stockage profond ? pourquoi sur ce site?, avec quelles technologies ? avec quelle reversibilité ?, avec quelle sécurité?, avec quelles conséquences sur le territoire? avec quelle gouvernance? dans quel délai? etc.
Pour effectuer ce choix, la CPDP s'est appuyée sur les analyses et les propositions des nombreuses personnalités qu'elle a rencontrées de décembre 2012 à mai 2013 (élus, responsables administratifs et associatifs, économiques et sociaux, scientifiques, journalistes, etc.).
QUESTION 3 - Qui a fixé le calendrier précis des 14 réunions ?
Posée par Marc DELPLANQUE (AGEN), le 15/05/2013
Bonjour, qui a fixé définitivement et en détail le calendrier des 14 réunions publiques, choix des lieux et des dates des réunions ; et selon quels critères ?
Cordialement
Réponse du 27/05/2013,
Comme il est de règle dans le débat public, c'est la Commission nationale du débat public (CNDP) qui a fixé, le 6 février 2013, les sites et le calendrier des réunions publiques, sur la proposition de la Commission particulière (CPDP).
Elle s'est efforcée de couvrir les territoires qui devraient accueillir le projet s'il est réalisé (sud de la Meuse et nord de la Haute Marne), ainsi que les secteurs comportant actuellement des déchets entreposés (La Hague, Marcoule, 2 centrales nucléaires représentatives).
Le choix des thèmes a également été fait, en toute indépendance, par la Commission nationale, sur la proposition de la Commission particulière.
Enfin, les étrangers peuvent bien entendu participer aux débats mais doivent le faire en français.
QUESTION 1 - Où est le débat??!
Posée par Stéphanie DEMEURE (SAINT GEORGES D'AUNAY), le 15/05/2013
Après de longues recherches pour trouver le site du débat public, je ne trouve nulle part l'accès aux questions du dit débat. C'est comme cela que vous concevez l'aspect "public" de ce débat??? Merci de m'indiquer où je peux effectivement donner mon avis et transmettre l'information aux nombreuses personnes qui souhaitent participer activement à ce débat PUBLIC...
Réponse du 27/05/2013,
Bonjour Madame,
Avant l'ouverture officielle du débat, c'est a dire le 15 mai, le site internet a été ouvert "en lecture seule", c'est a dire qu'il permettait la consultation du dossier du projet, mais pas de poser des questions et avis.
Il restera désormais ouvert aux questions et avis, jusqu'au 15 octobre.
Si vous aviez des difficultés à consulter les questions adressées à la Commission, c'est parce que vous êtes la première personne à vous être exprimée sur ce site. Depuis vous trouverez les questions et avis dans la rubrique "participer".
Enfin, si vous souhaitez déposer un avis, il vous suffit d'utiliser l'onglet prévu à cet effet sur la page d'accueil du site du débat "Donnez votre avis" et qui fonctionne de la même manière que celui que vous avez utilisé pour poser votre question. Vous pouvez également nous adresser votre contribution par courrier ou mail.
Commission du débat public Cigeo
18 avenue Gambetta
55000 Bar-le-Duc
contact@debatpublic-cigeo.org
QUESTION 0
Posée par Benoît DE CREVOISIER, le 29/07/2013
en lisant bon nombre d'avis ou de questions je me rends compte que les rédacteurs ont souvent une culture scientifique et/ou technique rudimentaire et que leurs contributions sont assez souvent des déclarations péremptoires arbitraires, voir parfois militantes. Comment entendez-vous gèrer ce flux d'avis et de questions pour ne pas enterrer vos correspondants et permettre de dégager les contributions qui font réellement avancer le débat ?
Réponse du 31/10/2013,
La Commission du débat public enregistre tous les avis et questions qui lui sont adressés. Le débat public repose sur le principe d'équivalence des participants. Certaines contributions apportent voire confrontent des connaissances techniques, d'autres des savoirs en sciences humaines et sociales, d'autres encore des connaissances empiriques ... C'est précisément cette diversité qui fait la richesse du débat.
Lorsque viendra le temps d'en rédiger la synthèse, la Commission s'attachera aux arguments développés.
QUESTION 0
Posée par Eric , le 25/07/2013
Comment s'assurer que les spécifications d'acceptation de CIGEO ne vont pas "mettre des déchets dehors" et que l'on ne se retrouve pas avec des déchets non acceptables à CIGEO? 'ce qui revient à mettre le déchet au centre de la reflexion et pas les problèmes d'ingénierie comme cela parait être actuellement)
Réponse du 27/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
La loi du 28 juin 2006 prévoit que « Après entreposage, les déchets radioactifs ultimes ne pouvant pour des raisons de sûreté nucléaire ou de radioprotection être stockés en surface ou en faible profondeur font l'objet d'un stockage en couche géologique profonde ». L’Andra étudie le projet Cigéo pour répondre à ce besoin. Le rôle de l’Andra est de garantir que ce stockage permettra de protéger les travailleurs, les populations et l’environnement pendant son exploitation et après sa fermeture. Une partie importante des études porte sur le comportement des colis de déchets dans le stockage. Sur cette base, l’Andra définit les critères d’acceptation à respecter par les colis de déchets. L’Andra vérifiera que les colis de déchets respectent ces exigences avant d’autoriser leur mise en stockage. En tout état de cause, l’Andra refusera le colis s’il présente des caractéristiques rédhibitoires pour la sûreté du stockage. Le cas échéant, un nouveau conditionnement devra être réalisé par le producteur du déchet pour respecter les exigences de sûreté de Cigéo.
QUESTION 0 - sécurité incendie
Posée par christian HAGER, NÉANT (REVIGNY-SUR-ORNAIN), le 13/10/2013
que comptez-vous faire pour la protection et la sécurité incendie qui doit être drastique et hyper professionnelle? Les conséquences d'un incendie pourraient être incalculables : effondrement des galeries avec contamination des eaux souterraines, dégagement de fumées radioactives contaminant la région, tout l'Est de la France et au delà. ( Je suis d'accord avec l'analyse de M. Bertrand Thuillier parue dans l'Est Républicain le 13/10/2013).
Réponse du 21/01/2014,
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le risque incendie est bien sûr pris en compte dès la conception de Cigéo : pour réduire le risque d’incendie, une première mesure consiste à limiter la quantité de produits combustibles ou inflammables dans les équipements du stockage. Par exemple, si Cigéo est réalisé, les câbles électriques seront ignifugés et les véhicules à moteur thermique seront interdits dans l’installation nucléaire souterraine de Cigéo. De plus, des dispositifs de détection incendie seront répartis dans les installations pour détecter rapidement et localiser tout départ de feu. Plusieurs systèmes d’extinction automatiques seront installés dans l’installation souterraine. Des systèmes embarqués d’extinction automatique (gaz, poudre...) seront placés sur les engins de transfert des colis de déchets et sur les engins de manutention en alvéole, afin d’éteindre tout départ de feu. Des systèmes d’extinction automatique seront également disposés dans certaines zones de l’installation souterraine telles que les locaux électriques et les zones de soutien logistique. Ces dispositifs seront mis en place en complément de moyens de lutte contre l’incendie plus traditionnels de types extincteurs, points de raccordement à un réseau d’alimentation en agent extincteur (eau, mousse…) etc.
Malgré toutes ces dispositions, une situation d'incendie est quand même considérée par prudence. Dans les installations de surface, les mêmes principes seront appliqués que dans les installations nucléaires de base : en cas d’incendie, les locaux concernés seraient isolés du reste de l’installation, les moyens d’extinction et d’intervention seraient déclenchés et le personnel serait évacué. Dans l’installation souterraine, compte tenu de sa géométrie spécifique, ces dispositions sont adaptées dès la conception. Des systèmes de compartimentage et de ventilation sont prévus pour limiter la propagation du feu. Des équipements d’intervention seront prépositionnés dans l’installation souterraine en permanence. L'architecture souterraine retenue pour le stockage permettra aux secours d'intervenir dans des galeries à l'abri des fumées et facilite l'évacuation du personnel.
Outre la mise à l’abri du personnel, la maîtrise du risque incendie vise aussi à protéger les colis contenant les substances radioactives des effets de l’incendie afin de maintenir le confinement de ces substances. Pour cela, les colis seront disposés dans des équipements qualifiés pour résister au feu (cellules résistantes au feu munies de portes coupe-feu, hotte de protection pour le transfert dans l’installation souterraine). Les conteneurs de stockage sont également conçus pour assurer une protection contre l’incendie. Ces dispositions permettent d’exclure tout effet domino entre les colis stockés.
La définition de l’ensemble de ces dispositifs associe les services compétents des sapeurs-pompiers et fait l’objet de contrôle par l’Autorité de sûreté nucléaire. Cigéo ne sera jamais autorisé si l’Andra ne démontre pas qu’elle maîtrise tous les risques, dont le risque d’incendie.
QUESTION 0
Posée par Patricia ANDRIOT, le 14/11/2013
Question posée lors du débat contradictoire du 23 octobre 2013 - les transports de déchets :
Pouvez-vous revenir sur la question de la sécurisation des transports et nous redire le nombre de camions ou trains qui arriveront sur la zone ?
Réponse du 30/01/2014,
Réponse apportée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) :
Environ 900 000 colis de substances radioactives sont transportés chaque année. 85 % des colis transportés sont destinés aux secteurs de la santé, de l’industrie non-nucléaire ou de la recherche, dits "nucléaire de proximité", dont 30 % environ pour le seul secteur médical. L’industrie nucléaire ne représente qu’environ 15 % du flux annuel de transports de substances radioactives. On estime à environ 11 000 le nombre annuel de transports nécessaires au cycle du combustible, pour 141 000 colis. Le contenu des colis est très divers : leur radioactivité varie sur plus de douze ordres de grandeur, soit de quelques milliers de becquerels pour des colis pharmaceutiques de faible activité à des millions de milliards de becquerels pour des combustibles irradiés. Leur masse varie de quelques kilogrammes à une centaine de tonnes.
L’ASN est chargée du contrôle de la sûreté. La sûreté est l’ensemble des dispositions techniques et organisationnelles prises en vue de prévenir les accidents ou d’en limiter les effets.
Les risques majeurs des transports de substances radioactives sont les suivants :
- le risque d’irradiation externe de personnes dans le cas de la détérioration de la « protection biologique des colis », matériau technique qui permet de réduire le rayonnement au contact du colis ;
- le risque d’inhalation ou d’ingestion de particules radioactives dans le cas de relâchement de substances radioactives ;
- la contamination de l’environnement dans le cas de relâchement de substances radioactives;
- le démarrage d’une réaction nucléaire en chaîne non contrôlée (risque de « sûreté-criticité») pouvant occasionner une irradiation des personnes, en cas de présence d’eau et de non-maîtrise de la sûreté de substances radioactives fissiles.
La prise en compte de ces risques conduit à devoir maîtriser le comportement des colis pour éviter tout relâchement de matière et détérioration des protections du colis dans le cas :
- d’un incendie ;
- d’un impact mécanique consécutif à un accident de transport ;
- d’une entrée d’eau dans l’emballage (l’eau facilitant les réactions nucléaires en chaîne en présence de substances fissiles) ;
- d’une interaction chimique entre différents constituants du colis ;
- d’un dégagement thermique important des substances transportées,pour éviter la détérioration éventuelle avec la chaleur des matériaux constitutifs du colis.
Cette approche conduit à définir des principes de sûreté pour les transports de substances radioactives :
- la sûreté repose avant tout sur le colis : des épreuves réglementaires et des démonstrations de sûreté sont requises par la réglementation pour démontrer la résistance des colis à des accidents de référence ;
- le niveau d’exigence, notamment concernant la définition des accidents de référence auxquels doivent résister les colis, dépend du niveau de risque présenté par le contenu du colis. Ainsi, les colis qui permettent de transporter les substances les plus dangereuses doivent être conçus de façon à ce que la sûreté soit garantie y compris lors d’accident de transport. Ces accidents sont représentés par les épreuves suivantes :
- trois épreuves en série (chute de 9 m sur une surface indéformable, chute de 1 m sur un poinçon et incendie totalement enveloppant de 800 °C minimum pendant 30 minutes) ;
- immersion dans l’eau d’une profondeur de 15 m (200 m pour les combustibles irradiés) pendant 8 h.
La sûreté des transports est également fondée sur la fiabilité des opérations de transport qui doivent satisfaire à des exigences réglementaires notamment en matière de radioprotection. L'ASN assure le contrôle de la sûreté des transports de matières radioactives. Enfin, la gestion des situations accidentelles est régulièrement testée lors d'exercices.
Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
Le transport des colis de déchets radioactifs représenterait en moyenne deux trains par mois sur la durée d’exploitation de Cigéo (le pic serait au maximum de l’ordre de deux trains par semaine). L’arrivée des trains s’effectuerait dans un terminal ferroviaire dédié. Deux options sont présentées au débat public : ce terminal pourrait être construit soit sur le site de Cigéo, avec la création d’une voie de raccordement au réseau ferré existant par exemple sur l’ancienne ligne entre Gondrecourt-le-Château et Joinville, soit à une vingtaine de kilomètres de Cigéo, sur le réseau ferré existant. Dans ce dernier cas, les emballages de transport contenant les colis de déchets devraient alors être transportés par camions entre le terminal et Cigéo. Pour décharger un train, qui transporte en moyenne une dizaine de wagons, une dizaine de rotations d’un camion entre le terminal ferroviaire et Cigéo seraient nécessaire.
QUESTION 0
Posée par Daniel (TRONVILLE-EN-BARROIS), le 12/12/2013
Avant de parler du futur, actuellement des transports de déchets radioactifs circulent. On parle de technique et de prévisions mais on parle peu de l'actualité. Je suis surpris que l'on ne s'interesse pas à du concret, de ce qui se passe actuellement. En ce moment, depuis les centrales, des transports se font. Voici des questions que je n'ai jamais entendues détaillées ou lues : Quand un conducteur de camion transporte les déchets, a-t-il un dosimètre sur lui pour connaître le taux de radiations reçues avant et après chaque transport? Quelle est la dose maximum pour une personne? Combien de temps faut-il pour que la dose diminue, avant de pouvoir refaire un nouveau transport? Un diagramme existe-t-il? Des conducteurs de camions, on pourra toujours en trouver, mais les conducteurs de train, tout le monde ne peut pas y être. Combien y a-t-il de conducteurs de train en France sachant qu'il y a ceux qui sont pour les voyageurs et ceux pour le fret? Ont-ils des dosimètres également? Les conducteurs ont-ils un carnet de santé spécifique pour noter les doses déjà reçues (date, quantité)? D'après Philippe GUITER, il suffit de passer de 30 minutes à 2 mètres de ce type de cargaison pour recevoir la dose annuelle. Aura-t-on assez de conducteurs de trains sains pour les années futures pour continuer de conduire les trains de déchets? Y a-t-il une protection spéciale dans les cabines de camion ou de train? Ont-ils le droit de retrait (SNCF)? Et le personnel SNCF, est-il au courant? Les colis ne se mettent pas tout seul sur les wagons ni n'en descendent. Le personnel de manutention? Les accrocheurs de wagons? Equipés aussi? Pour les trajets futurs, les préfets au courant mais pas les maires, pourquoi? La SNCF (avec l'accord de l'Europe) autorise de mélanger les cargaisons de fret = matières radioactives et produits chimiques. Le matériel souvent le même utilisé, sera lui-même irradié donc emettra des radioactions, sera en attente dans des lieux (population). Qui a-t-il de prévu pour intervenir en cas de collision, d'incendie? Les pompiers sont-ils formés? Est-ce à eux d'intervenir? Les exploitants vont souhaiter plusieurs fois pour que leur personnel n'ait rien. On a du recul pour savoir : "les irradiés d'Epinal", où en sont-ils dans la diminution de la dose de radiations qu'ils ont encore en ce moment? Avec 2 trains par semaine, que risquent les populations? Tout cela pour aller d'un point A à B, est-ce necessaire de doubler les lieux d'entreposage?
Réponse du 27/01/2014,
Réponse apportée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) :
Quand un conducteur de camion transporte les déchets, a-t-il un dosimètre sur lui pour connaître le taux de radiations reçues avant et après chaque transport?
Chaque entreprise intervenant dans le transport de substances radioactives doit établir un programme de protection radiologique, tel que défini au chapitre 1.7.2 de l’ADR[1] et du RID[2]. Ce programme permet l’évaluation de la dose que subit chaque personne de l’entreprise au cours d’une année.
Ainsi, si un chauffeur est susceptible de recevoir entre 1 mSv et 6 mSv par an, il faut appliquer un programme d'évaluation des doses par le biais d'une surveillance des lieux de travail (cabine) ou d’une surveillance individuelle. Si un chauffeur est susceptible de recevoir plus de 6 mSv en un an, il faut procéder à une surveillance individuelle. Le chauffeur devra alors obligatoirement porter un dosimètre.
Quelle est la dose maximum pour une personne?
Pour une personne du public, la dose maximale annuelle est de 1 mSv. Pour un travailleur, elle est de 20 mSv (article R 4451-12 du Code du travail). Cette dernière est plus élevée car les travailleurs sont suivis spécifiquement par la médecine du travail.
Combien de temps faut-il pour que la dose diminue, avant de pouvoir refaire un nouveau transport? Un diagramme existe-t-il?
La dose maximale annuelle pour une personne en contact avec des substances radioactives a été retenue de telle sorte qu’un travailleur ayant été exposé toute sa vie à la dose maximale n’ait pas d’effets dits déterministes [3], c'est-à-dire se produisant de façon certaine du fait des rayonnements ionisants.
Combien y a-t-il de conducteurs de train en France sachant qu'il y a ceux qui sont pour les voyageurs et ceux pour le fret?
Cette question est en dehors du champ de compétence de l’ASN. L’ASN vous invite à vous rapprocher de la société FRET SNCF.
Ont-ils des dosimètres également?
Les conducteurs équipés de dosimètres sont ceux identifiés dans le plan de protection radiologique établi par la SNCF.
Les conducteurs ont-ils un carnet de santé spécifique pour noter les doses déjà reçues (date, quantité)?
Chaque travailleur dit exposé est suivi spécifiquement par la médecine du travail. Les doses reçues sont suivies également par la médecine du travail.
D'après Philippe Guiter, il suffit de passer de 30 minutes à 2 mètres de ce type de cargaison pour recevoir la dose annuelle.
Le RID impose, à l’alinéa b du paragraphe 7.5.11 CW 33 (3.3), un débit de dose maximal à 2 mètres du wagon de 0,1 mSv/h. La dose annuelle du public étant de 1 mSv, elle est atteinte en 10 heures.
Aura-t-on assez de conducteurs de trains sains pour les années futures pour continuer de conduire les trains de déchets?
Cette question est en dehors du champ de compétence de l’ASN. L’ASN vous invite à vous rapprocher de la société FRET SNCF.
Y a-t-il une protection spéciale dans les cabines de camion ou de train?
Dans les cabines de camion, on retrouve très souvent des plaques de plomb pour limiter le débit de dose dans la cabine du chauffeur.
Pour les trains, la distance entre le conducteur et la cargaison est suffisante pour garantir une protection efficace contre les rayonnements.
Ont-ils le droit de retrait (SNCF)?
Cette question est hors du champ de compétence de l’ASN.
Et le personnel SNCF, est-il au courant?
Le RID, à son chapitre 1.7.2.5, impose à la SNCF une formation spécifique de tous les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants.
Les colis ne se mettent pas tout seul sur les wagons ni n'en descendent. Le personnel de manutention? Les accrocheurs de wagons? Equipés aussi?
Toutes les entreprises intervenant dans le transport de substances radioactives, y compris le chargement et le déchargement, doivent établir un programme de protection radiologique. Selon l’exposition déterminée lors des études de poste, les mesures décrites dans la réponse à la première question sont à mettre en œuvre.
Pour les trajets futurs, les préfets au courant mais pas les maires, pourquoi?
Le choix des itinéraires relève du transporteur. Les substances radioactives peuvent emprunter toutes les voies de transport, sauf en cas d’interdiction fixée par arrêté préfectoral.
Les substances les plus sensibles du point de vue de la prévention des actes de malveillance relevant du code de la défense font l’objet de dispositions spécifiques. À ce titre, les itinéraires sont validés par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère chargé de l’environnement.
La SNCF (avec l'accord de l'Europe) autorise de mélanger les cargaisons de fret = matières radioactives et produits chimiques.
La règlementation concernant le transport ferroviaire de marchandises dangereuses est élaborée au niveau international (Agence internationale à l’énergie atomique ; Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires). Les restrictions au transport de marchandises dangereuses en commun avec des substances radioactives concernent les marchandises explosives, spontanément inflammables ou les peroxydes organiques.
Le matériel souvent le même utilisé, sera lui-même irradié donc émettra des radiations, sera en attente dans des lieux (population).
Il n’y a pas de risque d’activation des métaux constitutifs du matériel utilisé. Cela veut dire que le matériel n’étant pas radioactif et ayant servi à transporter des colis de substances radioactives, même ayant été irradié, ne peut pas être rendu radioactif.
Il peut y avoir des risques de contamination du matériel, c'est-à-dire de fuite de produits radioactifs sur le wagon. C’est la raison pour laquelle ces matériels sont contrôlés périodiquement pour vérifier qu’il n’y a pas de contamination.
Qui a-t-il de prévu pour intervenir en cas de collision, d'incendie? Les pompiers sont-ils formés? Est-ce à eux d'intervenir?
En cas d’accident, le préfet du département concerné dirige les opérations de secours et prend les mesures nécessaires pour assurer la protection de la population et des biens menacés par l’accident. Il s’appuie sur des plans d’urgence spécifiques aux transports de substances radioactives. L’ASN apporte son concours au préfet sur la base du diagnostic et du pronostic de l’accident et des conséquences effectives et potentielles.
De leur côté, le transporteur et l’expéditeur doivent mettre en œuvre une organisation et des moyens permettant de faire face à une situation incidentelle ou accidentelle, d’en évaluer et d’en limiter les conséquences, d’alerter et d’informer régulièrement les autorités publiques.
Des exercices sont menés régulièrement par les responsables de transport et les pouvoirs publics.
On a du recul pour savoir : "les irradiés d'Epinal", où en sont-ils dans la diminution de la dose de radiations qu'ils ont encore en ce moment?
Les doses de rayonnements pour traiter des cancers sont délivrées en plusieurs séances et sur des zones très localisées englobant la tumeur cancéreuse.
Après son traitement, par radiothérapie externe tel qu’à Epinal, le patient n’est pas porteur de radioactivité et donc ne peut exposer son entourage.
Dans le cas de l’accident d’Épinal, les doses délivrées de façon localisées ont été, par erreur, supérieures à celles prescrites, de 20 à 35 % pour la cohorte la plus exposée de 24 personnes.
Les doses en radiothérapie, de l’ordre de plusieurs dizaines de grays (1 gray = 1000 mSv) pour un traitement complet, sont très nettement supérieures aux seuils limites retenus pour le transport de substances radioactives. On ne peut pas comparer une exposition de travailleurs avec des limites de doses annuelles dites basses et des doses anormalement élevées telles que celles reçues par des patients de façon accidentelle
Avec 2 trains par semaine, que risquent les populations? Tout cela pour aller d'un point A à B, est-ce nécessaire de doubler les lieux d'entreposage?
L’intérêt d’un site de stockage est de regrouper tous les déchets au même endroit au lieu de les stocker sur le site de production (centrale, installation de recherche, hôpital, etc.), ce qui permet donc de diminuer les lieux d’entreposage.
En ce qui concerne les risques pour la population, même en prenant des hypothèses très pénalisantes, la dose reçue par une personne du public reste très en deçà des seuils règlementaires.
QUESTION 0 - Qui sera responsable ?
Posée par Cécile GEORGES, L'organisme que vous représentez (option) (LA TRINITÉ), le 14/12/2013
Quand, dans 6 dizaines années ou 6 milliers d’années, un accident mécanique, un accident électrique, un bug informatique, une erreur humaine, une erreur de conception, un mouvement de terrain, un tremblement de terre, un agrandissement de faille, une infiltration d’eau, une intrusion humaine, ou un ac te terroriste... conduiront à une explosion, un incendie, une perte de confinement, des fuites... et donc à un retour des radionucléides en surface, dans l’herbe des vaches, le pied des girolles, l’eau des rivières, l’eau du robinet avec les conséquences qu’on a connues à KYCHTYM,(2) TCHERNOBYL et FUKUSHIMA Qui sera responsable ?
Réponse du 07/01/2014,
Réponse apportée par l'Andra, maître d'ouvrage :
La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.
L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.
Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat. Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva NC) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat.
RÉPONSE APPORTÉE PAR LE MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE :
Les dispositions relatives au principe de précaution figurent à l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». La Charte de l'environnement est un texte de valeur constitutionnelle, intégré en 2004 dans le bloc de constitutionnalité du droit français, reconnaissant les droits et les devoirs fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Elle énonce notamment trois grands principes : le principe de prévention, le principe de précaution, et le principe pollueur-payeur. Ces dispositions s’appliquent donc de manière systématique et générale.
Par ailleurs, la loi du 28 juin 2006 relative à la gestion des déchets radioactifs demande qu’un débat public se tienne sur le projet Cigéo, avant le dépôt de la demande d’autorisation de création du projet. C’est pourquoi la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) a organisé un débat public national sur Cigéo, qui s’est déroulé du 15 mai au 15 décembre 2013. Tout au long de cette période, la Commission Particulière du Débat Public (CPDP) et la CNDP ont mis en place des moyens permettant au public de s’informer et s’exprimer, malgré l’impossibilité de tenir les réunions publiques. La CNDP a également pris l’initiative d’organiser une Conférence de citoyens.
RÉPONSE APPORTÉE PAR L’ANDRA :
Les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue déjà produits sont entreposés sur différents sites en France. Ces déchets génèrent un risque potentiel pour la santé des générations futures et pour l’environnement. En effet, les installations d’entreposage dans lesquelles ils se trouvent actuellement ont une durée de vie limitée (typiquement 50 à 100 ans), au terme de laquelle les déchets doivent en être ressortis puis replacés dans une nouvelle installation, faute de quoi la sûreté ne serait plus assurée. Tant que l’on utilise des installations d’entreposage, la sûreté de la gestion de ces déchets repose sur la capacité technique et financière des générations futures à renouveler les installations. En application du principe de précaution, le Parlement a mis en place en 1991 un programme de recherches pour étudier différentes solutions pour la gestion à long terme de ces déchets, un dispositif d’évaluation et de concertation et un processus de décision.
Après plus de 20 années de recherches, seul le stockage profond est aujourd’hui reconnu en France et à l’étranger comme une solution robuste pour mettre en sécurité définitive les déchets les plus radioactifs. L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.
Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.
Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de ces déchets. Grâce à la réversibilité, ces générations garderont la possibilité de faire évoluer cette solution.
|
|